Les Ensablés - La Confrontation, de Louis Guilloux (1899-1980)
Né en 1899 à Saint Brieuc, dans une famille de condition modeste, Louis Guilloux a publié de nombreux romans dans lesquels il a témoigné d'une attention particulière pour les pauvres et les laissés pour compte. Son premier roman La Maison du peuple, publié en 1927, évoque la figure de son père, cordonnier et militant socialiste. Son œuvre la plus célèbre Le Sang noir (objet d'un précédent article) s'inspire de la vie de George Palante qui fut son professeur de philosophie et son ami. Par Isabelle Luciat.
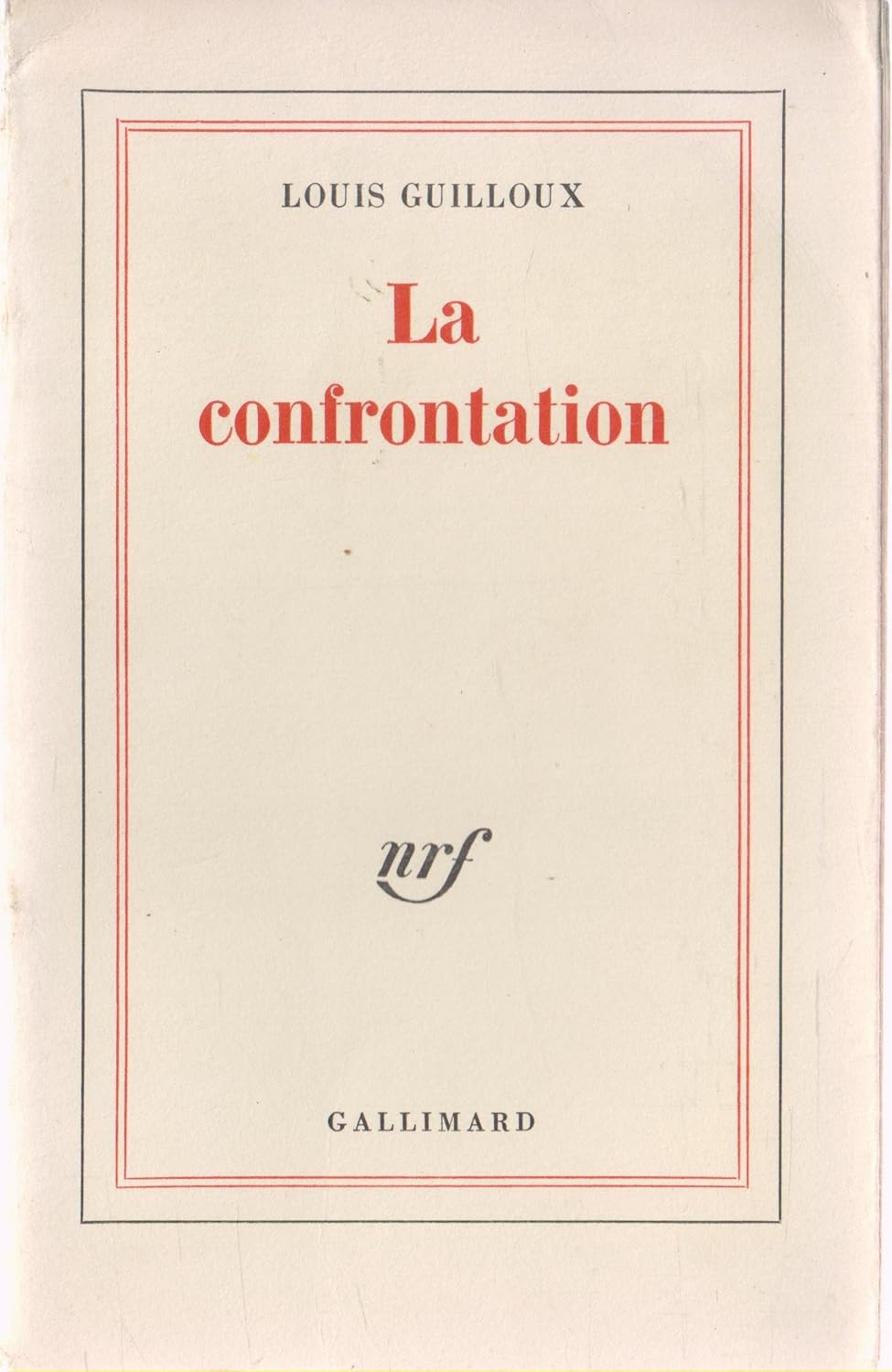
Engagé en 1935 et 1936 dans le mouvement des écrivains antifascistes et le Secours populaire français (proche du parti communiste), Louis Guilloux n'a pas combattu lors des deux conflits mondiaux en raison de sa santé fragile mais il a pris une part active dans la Résistance. Marqué à gauche, il n'a pourtant été l'homme d'aucun parti et se méfiait des étiquettes.
En 1931, il confiait à Romain Rolland « ... les hommes que j’ai voulu peindre ne sont pas d’abord des prolétaires. Ils sont avant tout des hommes (…) Il n’y a qu’une expérience, la même pour tous, et qui est l’expérience de l’Amour ». Ami de Camus, de Malraux, fréquentant les intellectuels les plus en vue de son temps, Louis Guilloux s’est aussi lié d’amitié avec plusieurs prêtres, lui que l’on croyait volontiers anticlérical.
Lecteur de Pascal, de Dostoïevski, de Tolstoï, il note dans ses Carnets : « Il y a en moi un grand désir que je ne puis nommer autrement que par ces mots : le désir de Dieu (…) Il ne faut pas attendre que Dieu nous délivre, il faut arriver à Dieu délivré. C’est cela la tâche et le devoir ». Dans un article du journal, Le Monde, l’académicien Émile Henriot le définit comme un « pacifiste intégral » et un « évangélique incroyant ».
Publié en 1968, largement autobiographique sous l’apparence d’un polar, « La Confrontation » est le roman d’un écrivain à l’automne de sa vie, désillusionné et parfois amer. Cette « confrontation » qui donne son titre au roman est, comme le relève Yves Loisel, biographe de Louis Guilloux, celle d’un « homme mûr devenu riche avec l’enfant pauvre qu’il fut ». C’est aussi un examen de conscience.
La situation de départ est la suivante : l’inspecteur Favien (le narrateur) reçoit la visite d’un homme qui prétend s’appeler Germain Forestier. Ce dernier lui demande de mener une enquête de moralité sur un certain Gérard Ollivier, ami de lycée perdu de vue depuis plus de quarante ans, dans le but de lui faire don d’un trésor.
On apprendra très vite que celui que l’on prend pour Favien est en réalité un journaliste, ami du vrai Favien, qui, poussé par la curiosité, a accepté de prendre la place du détective. À l’issue de l’enquête, le pseudo Favien obtiendra la certitude que Germain Forestier et Gérard Ollivier ne sont qu’une seule et même personne. On le comprend, cette superposition virtuose de personnages interchangeables tourne autour de la question de l’identité et du double (en 1954, l’écrivain confiait déjà dans ses Carnets : « Commebien des hommes, je suis devenu non seulement un autre, mais ce que je ne voulais pas être ».
L’espace de la narration est celui d’une nuit au cours de laquelle Favien rend compte de son enquête à son commanditaire, dans un petit appartement perché au sommet d’un immeuble, boulevard Saint-Germain. Les heures sont ponctuées par le clocher de l’église Saint Thomas d’Aquin. Favien apostrophe son commanditaire à la façon dont Clamence dialogue avec son interlocuteur muet dans le roman de Camus « La Chute », une « saisissante analogie de structure » qui sera relevée par l’écrivain Pierre Henri Simon, dans un article du journal Le Monde publié après la sortie du livre. Louis Guilloux lui-même note dans ses Carnets : « ... je suis décidé à mettre le paquet » […]. C’est ce que me disait Albert, ayant achevé La Chute. « Cette fois, j’ai mis le paquet ».
Et, en effet, le récit de Favien, lancé à la recherche de Gérard Ollivier, mais aussi de son propre passé, est celui d’une conscience inquiète, tourmentée par ses oublis, ses renoncements, ses manquements, ses trahisons, une conscience qui interroge, un peu comme Dieu interroge Caïn après le meurtre d’Abel, par ces propos mis dans la bouche du narrateur : « Tout au long des âges de la vie... Qu’as-tu fait de tes frères et sœurs ? » ou comme au Jugement dernier : « Qu’as-tu fait pour les pauvres et les persécutés ? ».
Le roman ne donne jamais la parole à Germain Forestier pas plus qu’au grand absent, ce Gérard Ollivier, né à Laval, qui semble n’avoir d’existence qu’à travers les impressions de Favien lorsqu’il parcourt les vieux quartiers de Laval [très belle errance dans cette ville qui donne lieu à des méditations sur le temps passé et sur les écarts de fortune révélés par le paysage urbain]. Par le jeu d’identités floues, les trois personnages principaux finissent par se confondre en une seule et même personne dont Favien pourrait être le corps [il est le seul, en sa qualité de narrateur, dont la réalité physique ne peut faire de doute], le commanditaire serait l’âme [la conscience qui tourmente] et Gérard serait l’esprit [évanescent, insaisissable, et dont la seule trace tangible sera une photo de classe pâlie et jaunie].
Louis Guilloux les définit en quelques traits : tous trois ont à peu près le même âge, ils sont nés en province dans « cette classe un peu grouillante qu’on appelle la classe des petites gens », ont fréquenté le lycée et ont rompu avec leur milieu familial pour intégrer une classe sociale plus proche de la bourgeoisie, déjouant la fatalité du déterminisme social [autre thème du roman]. Ce portrait-robot présente des similitudes frappantes avec l’auteur Louis Guilloux. Et c’est bien de lui-même que l’auteur nous parle à travers l’inspecteur Favien lancé à la recherche de sa propre enfance.
Deux personnages sont convoqués régulièrement tout au long du roman, jaillissant des pensées du narrateur. Le maçon Philippe [évocation du père de l’auteur] est un révolté, un homme en colère qui dénonce le culte de l’argent [« Vous aimez l’argen ?? Mangez-le ! »], un homme ancré dans la survie matérielle, qui se veut fort, mais qui est condamné à rester définitivement dans le camp des opprimés, lui qui sait à peine lire et écrire, un homme qui a voulu que ses enfants soient instruits.
Il apparaît à Favien dans son sommeil, le regardant « avec reproche », mais aussi « dans la plus profonde tendresse ». Favien se réveille au moment où il tendait les bras vers Philippe. Cette rencontre avortée qui rappelle l’épisode du jeune-homme riche de l’Évangile et qui ne pourra plus jamais avoir lieu [Philippe est mort depuis de nombreuses années] manifeste l’impossibilité d’un retour innocent au pays de l’enfance pauvre pour l’homme bien installé qu’est devenu le narrateur et l’impossibilité d’une réconciliation avec une figure paternelle dont l’autorité a été contestée et vis-à-vis de laquelle le narrateur se reconnaît une dette.
Dans ses vieux jours, Philippe est devenu avare. Sa dernière ambition a été de construire de ses mains « une petite maison à lui ». « Un tonneau vide quoi ! » ajoute méchamment le narrateur qui ne cesse toutefois de se reprocher : « Pourquoi ne nous sommes-nous jamais rien dit ? ... C’était à moi de te dire le mot que tu as toujours attendu et que je n’ai pas su trouver ». Le second personnage est la marraine Éléonore, vieille femme très pieuse qui ne vit plus que dans la compagnie des anges. À la fin du roman, le narrateur lui rendra visite et elle apparaîtra, telle une Sainte Vierge nimbée de blanc et de bleu, comme dans une vision du paradis, prémonitoire d’une mort dont elle a été avertie et à laquelle elle s’est préparée, « toute blanche dans un grand lit blanc », « la même vieille marraine, le même visage rayonnant, le même sourire, la même joie dans son regard bleu, son même visage de jeunesse un instant retrouvé ».
Auprès d’elle, le narrateur trouve la paix, se sent « heureux, rapatrié ». La vie n’a pourtant pas épargné la vieille femme qui a survécu à ses nombreux enfants et a dû mettre en vente la petite maison héritée de Philippe pour aller vivre dans un asile. Elle avoue néanmoins vivre dans « une espèce de bonheur » qu’elle n’a pas mérité. Peut-elle être humaine, elle qui n’exprime aucune souffrance, n’assène aucun jugement et, dans le dépouillement le plus absolu, continue à s’émerveiller de la contemplation de la nature et à répandre le bien autour d’elle ? Plus qu’une réalité humaine, la marraine Éléonore semble l’image d’un idéal sublime et inatteignable.
Le roman se termine au petit matin. Le narrateur lance une dernière apostrophe à son commanditaire : « Cela va passer ! Tout va rentrer dans l’ordre... » et il l’invite à le rejoindre sur le balcon : « peut-être aurons-nous la chance de voir se lever le soleil ». Ainsi s’achève cet examen de conscience dans une tonalité à la fois âpre et apaisée qui rappelle le livre de l’Ecclésiaste [« Vanité des vanités, tout est vanité », « Ce qui fut sera. Ce qui s’est fait se refera. Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil »]. L’auteur renvoie-t-il dos à dos « celui qui croyait au ciel et celui n’y croyait pas », chers au poète Aragon ?
Rien n’est moins certain. Sans se ranger sous l’une ou l’autre de ces bannières, Louis Guilloux semble plutôt se revendiquer de ces deux héritages et exprime plus que tout sa grande compassion vis-à-vis d’une humanité faillible, vouée à la mort, d’une humanité dans laquelle il se reconnaît pleinement.

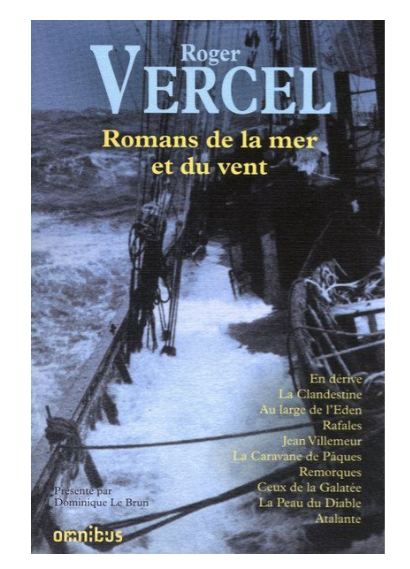
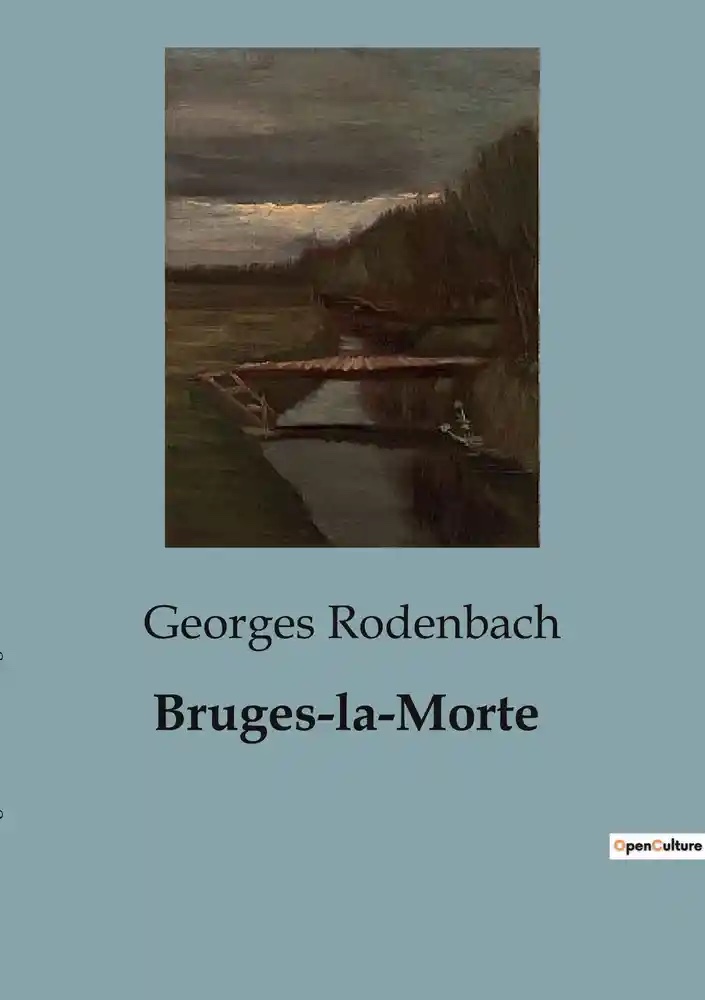
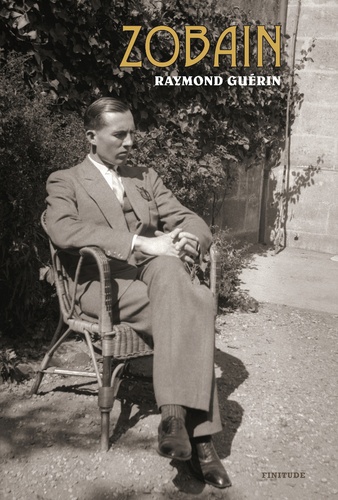

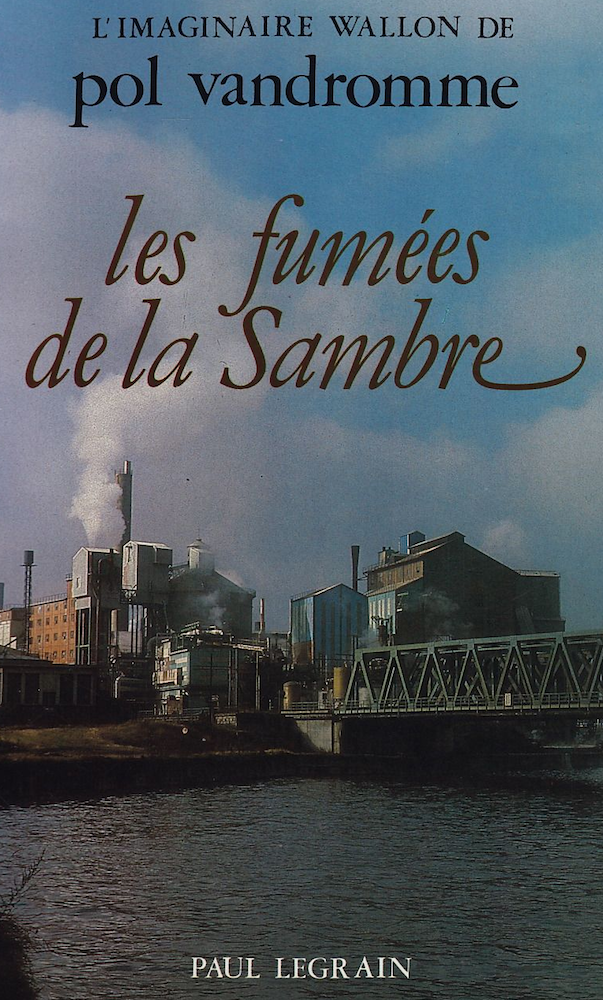
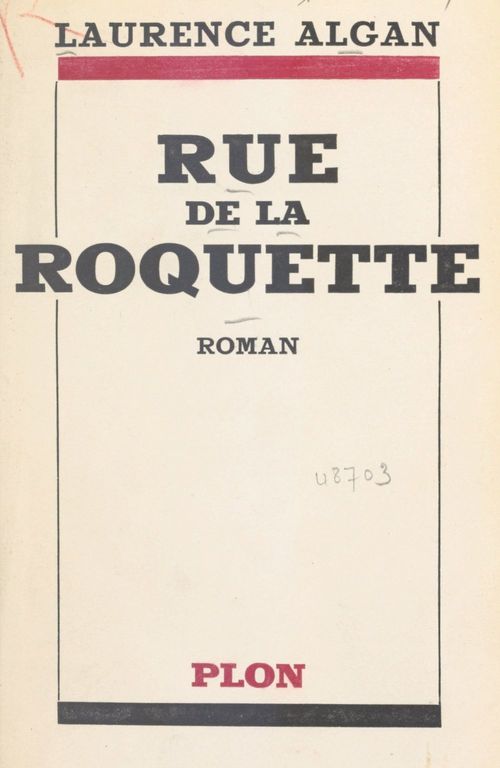
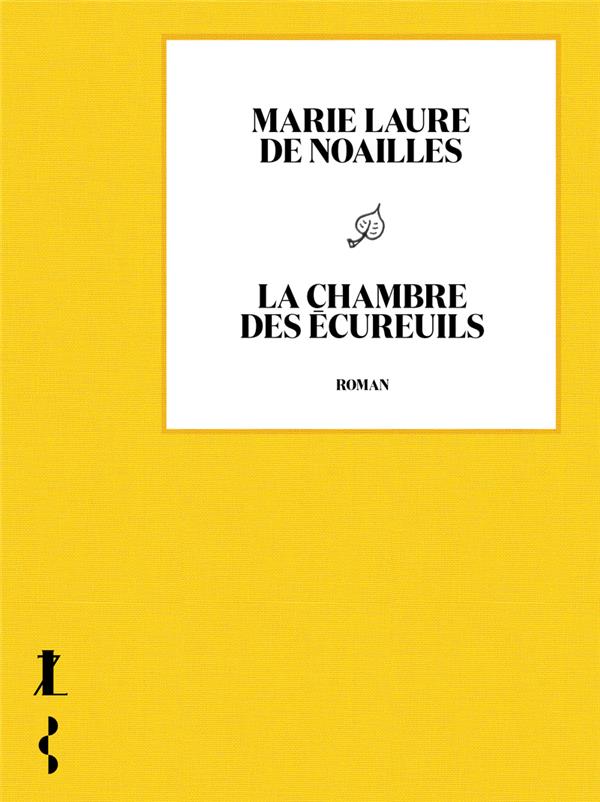
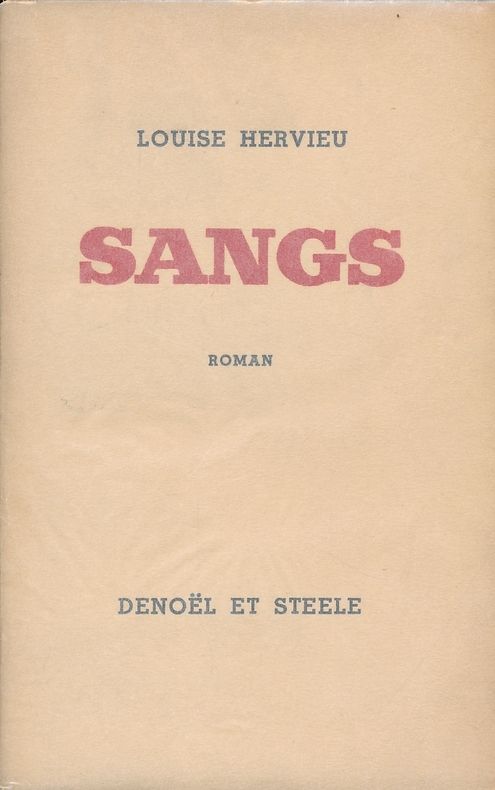
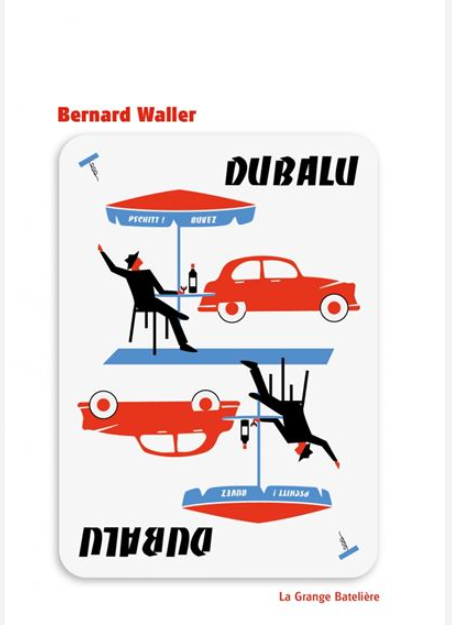
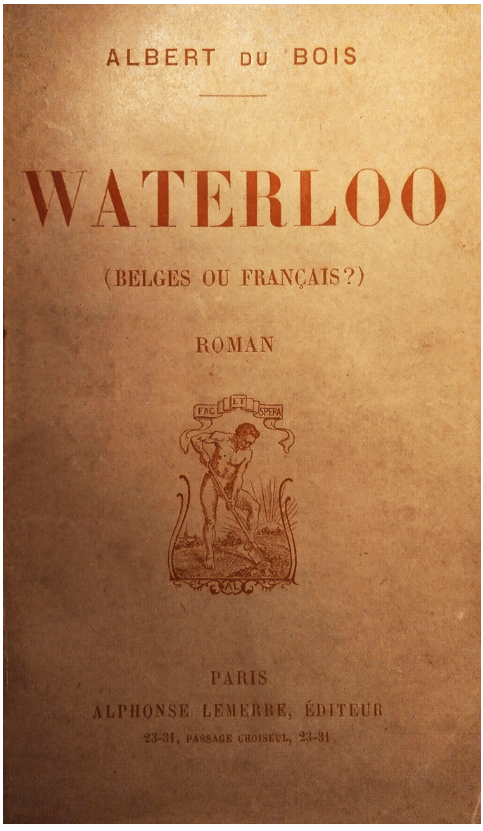

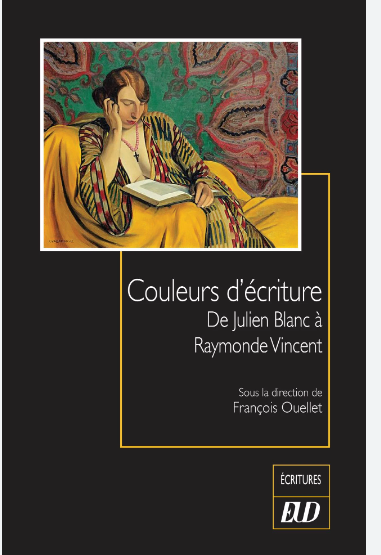
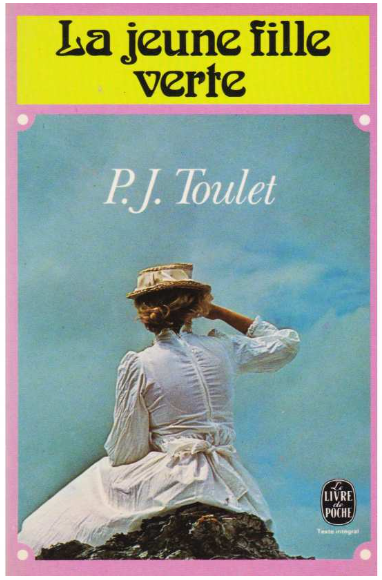
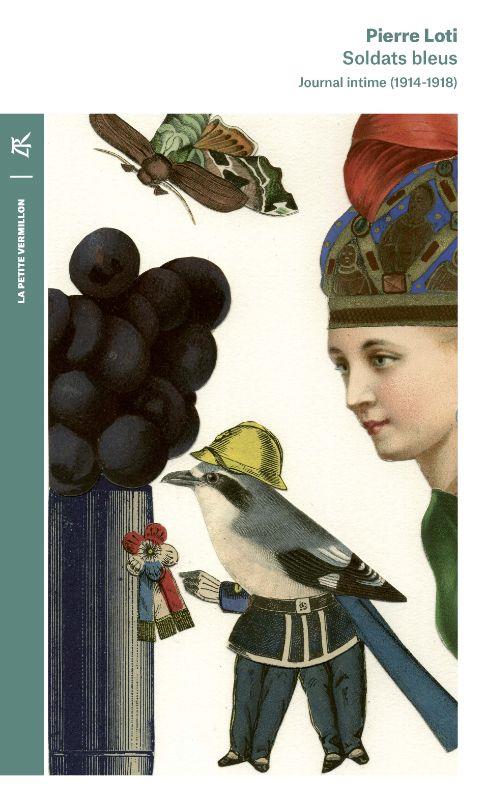
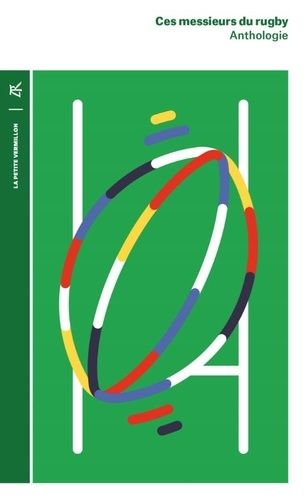
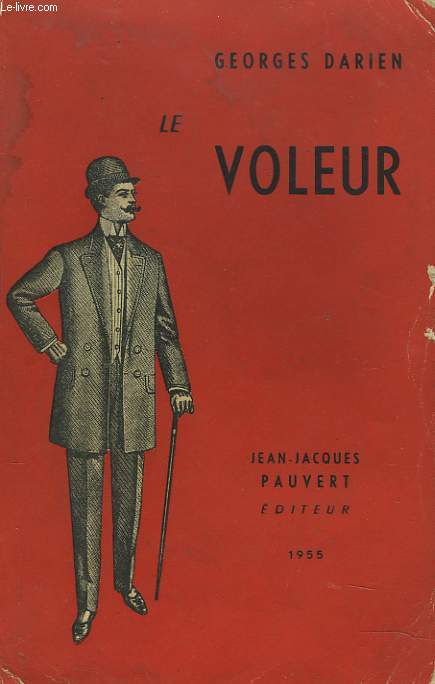
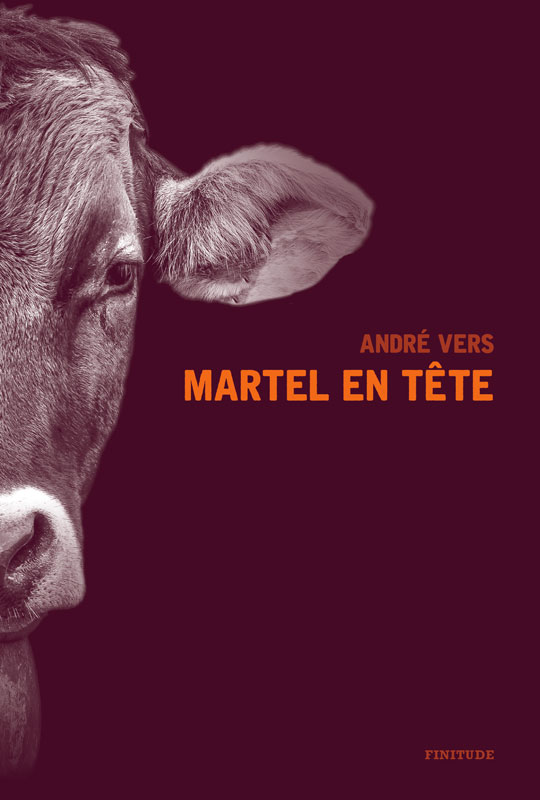

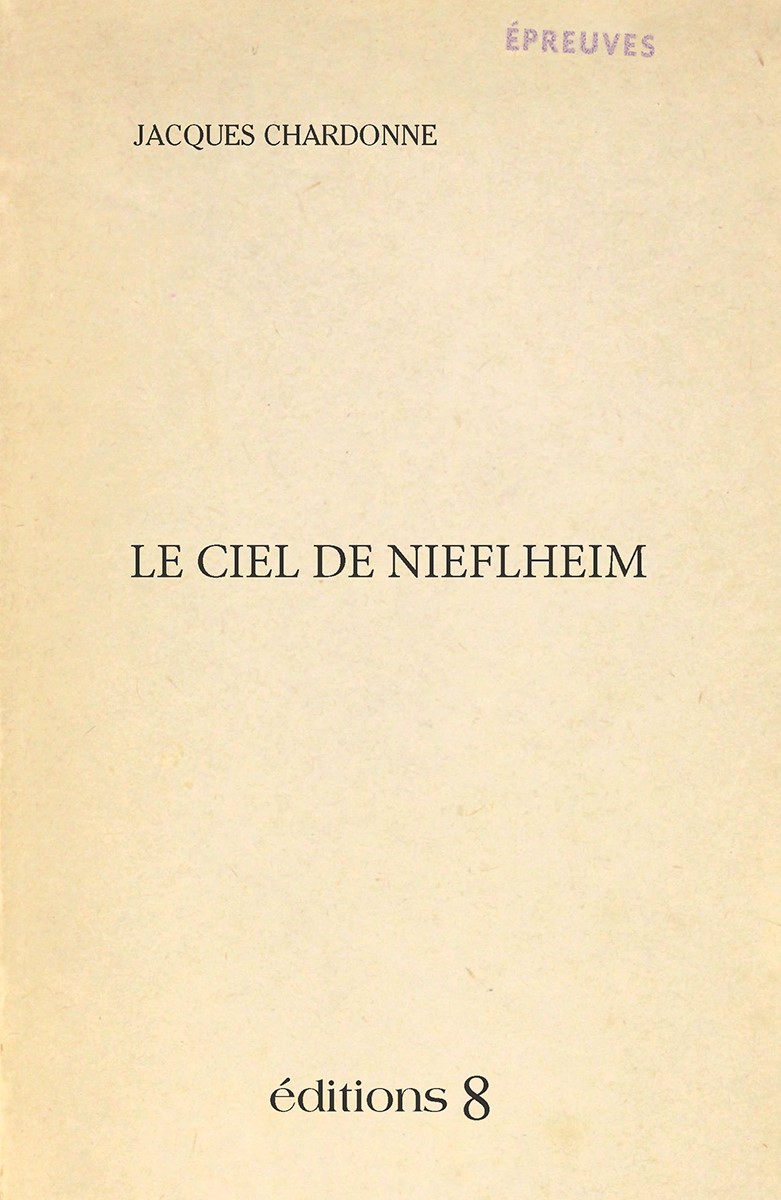
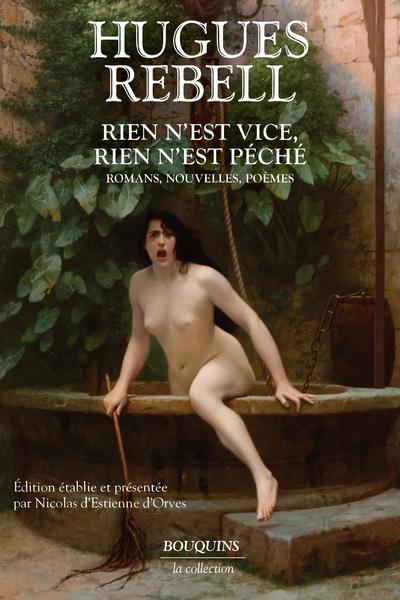
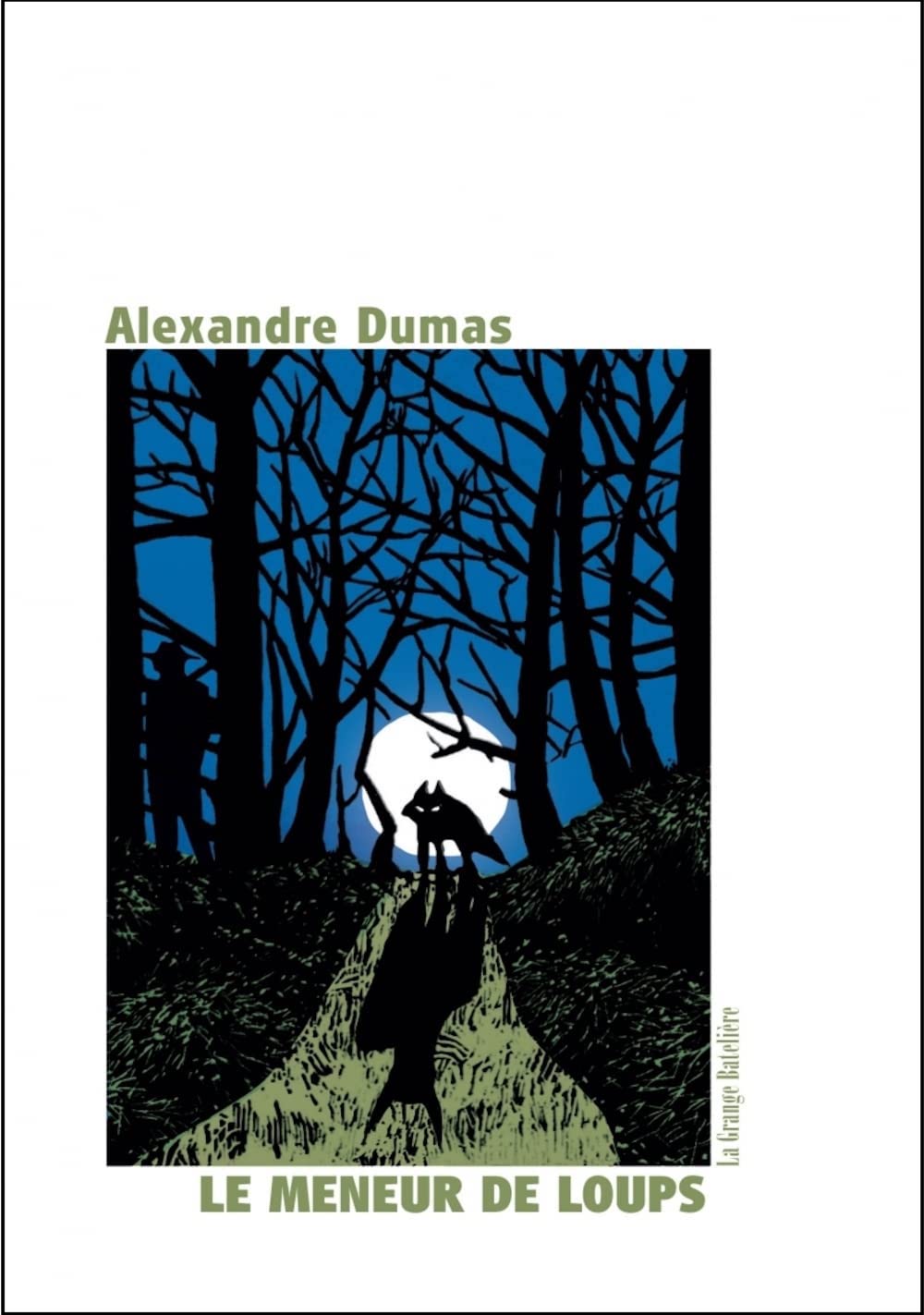

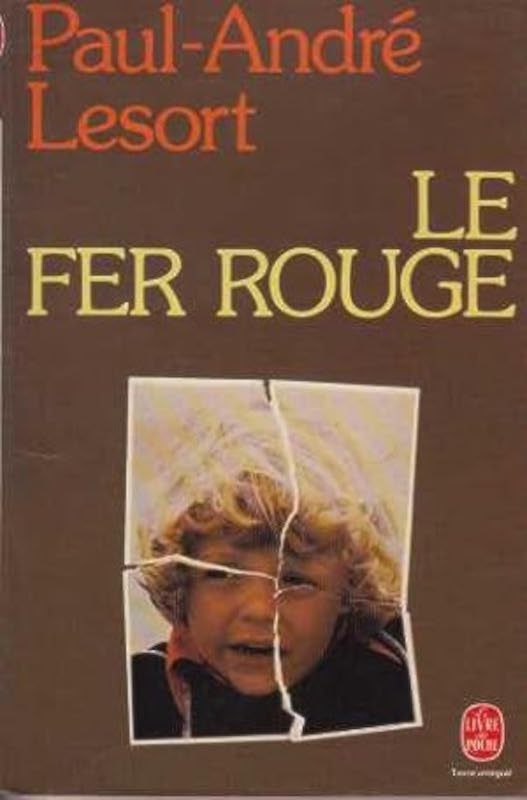


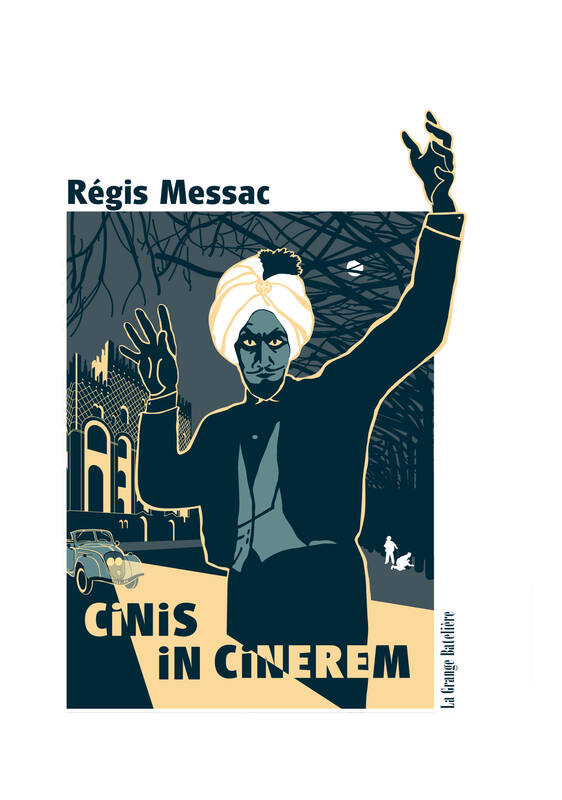

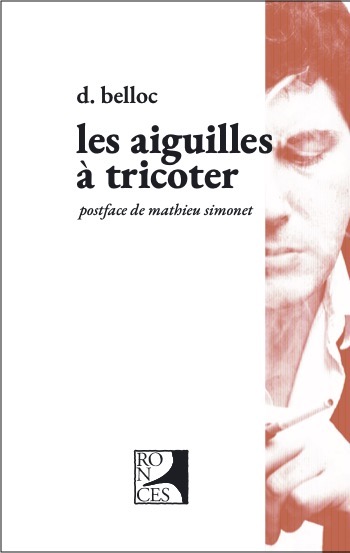
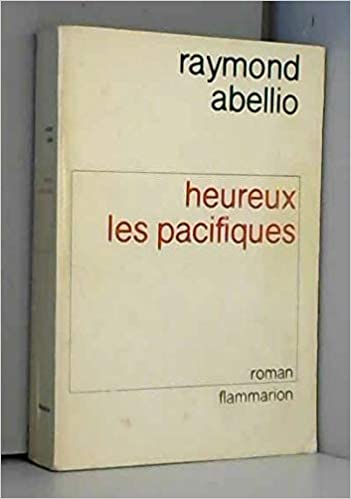
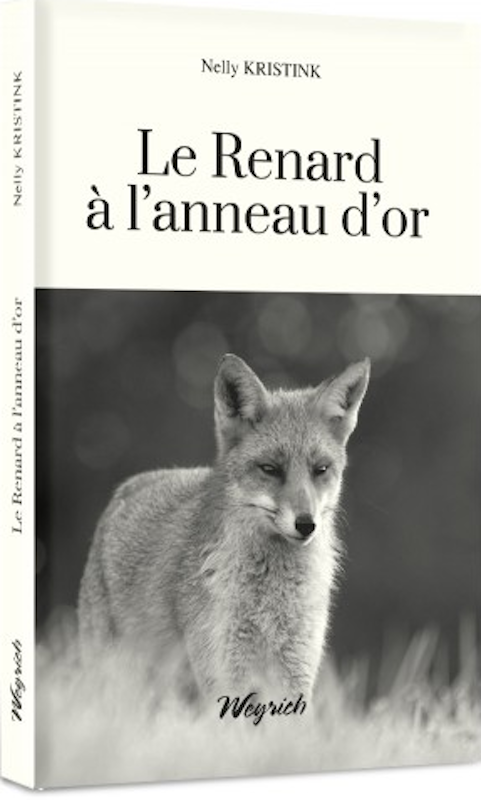
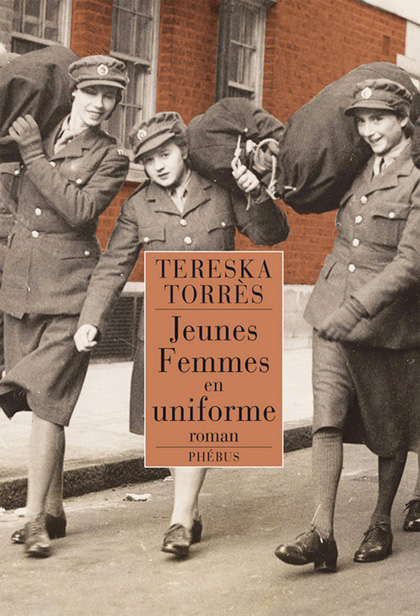
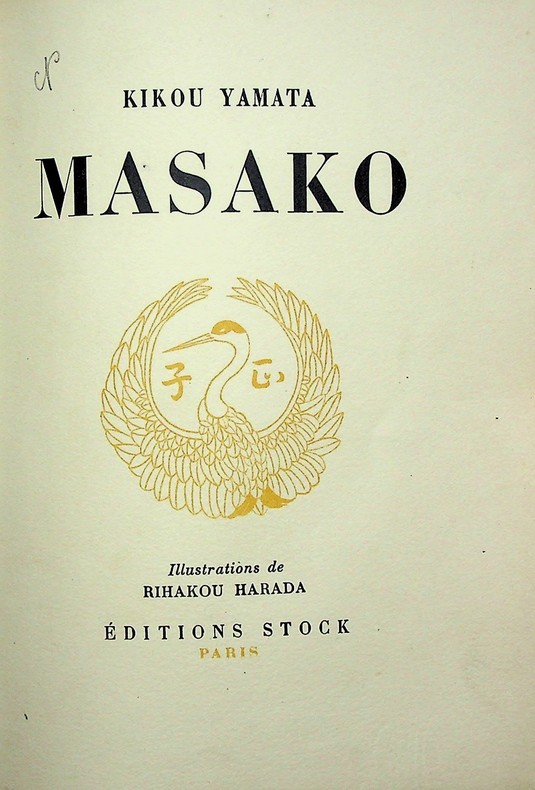
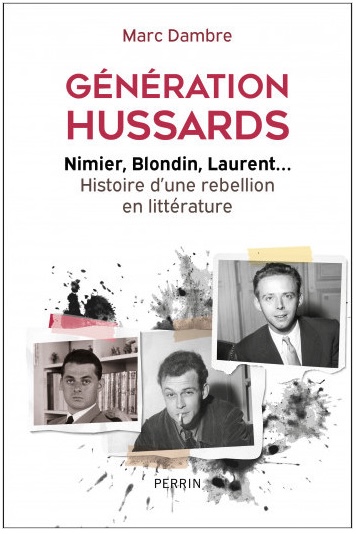
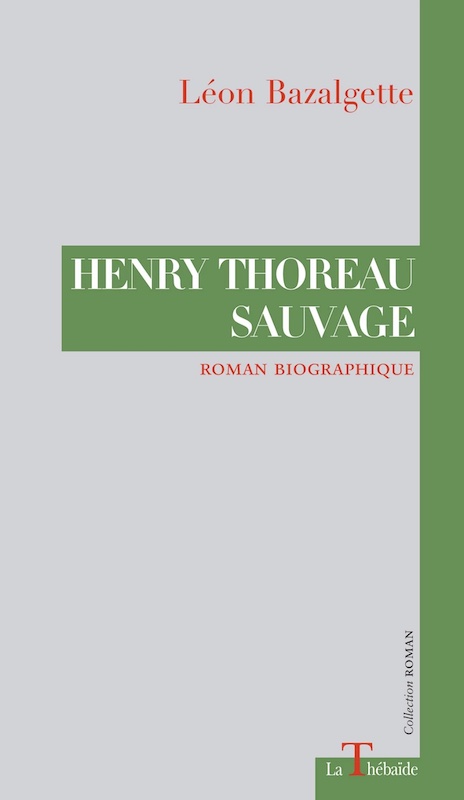

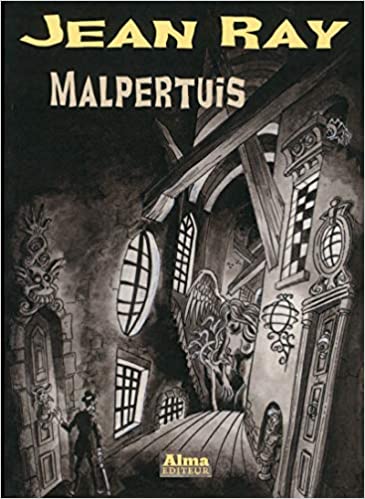
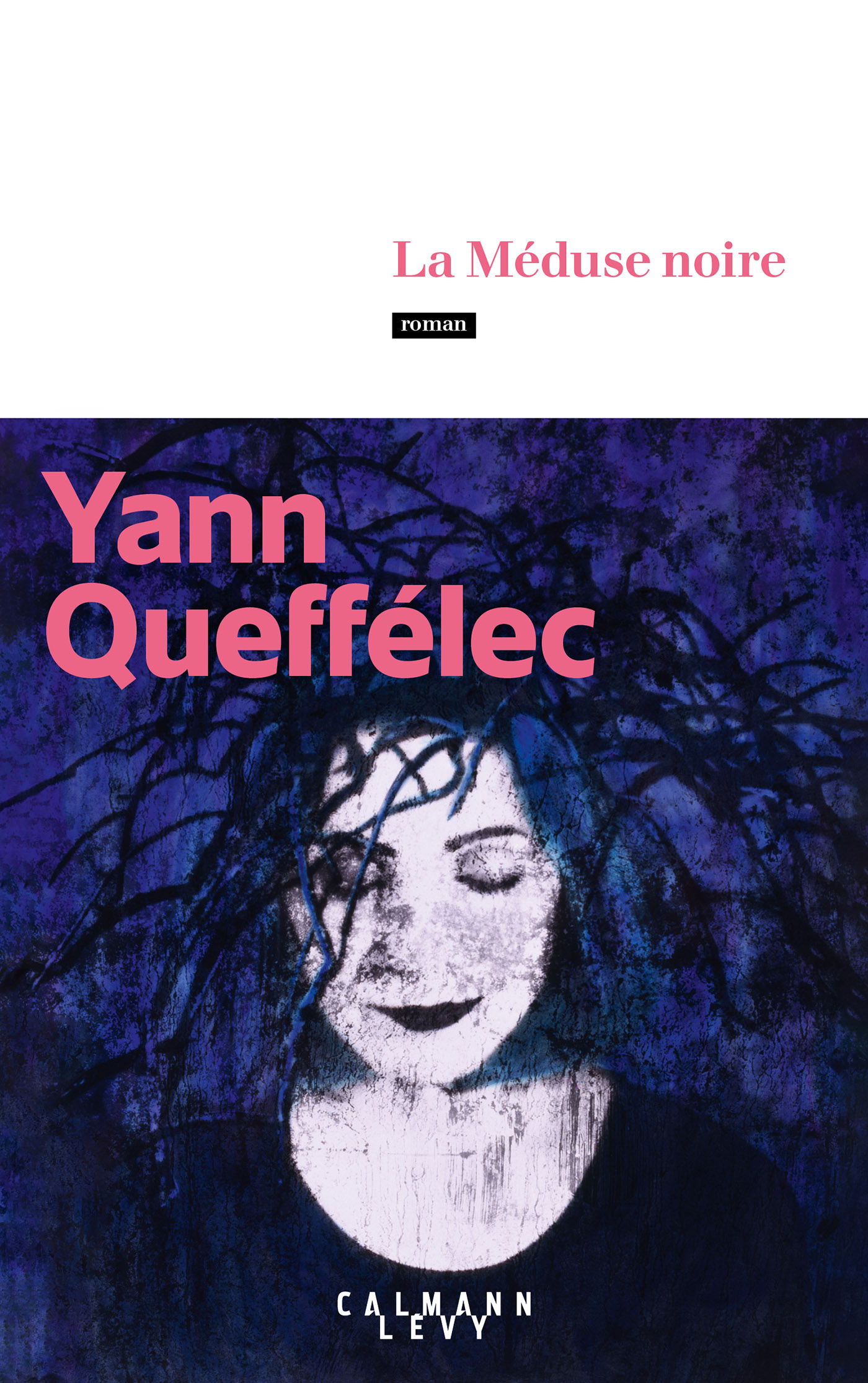


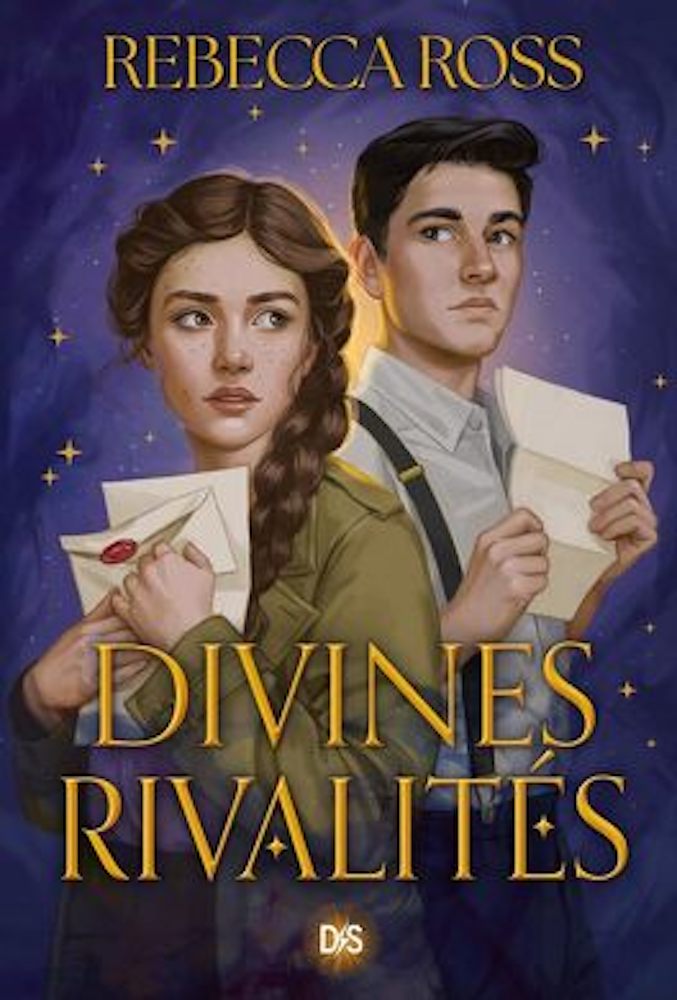



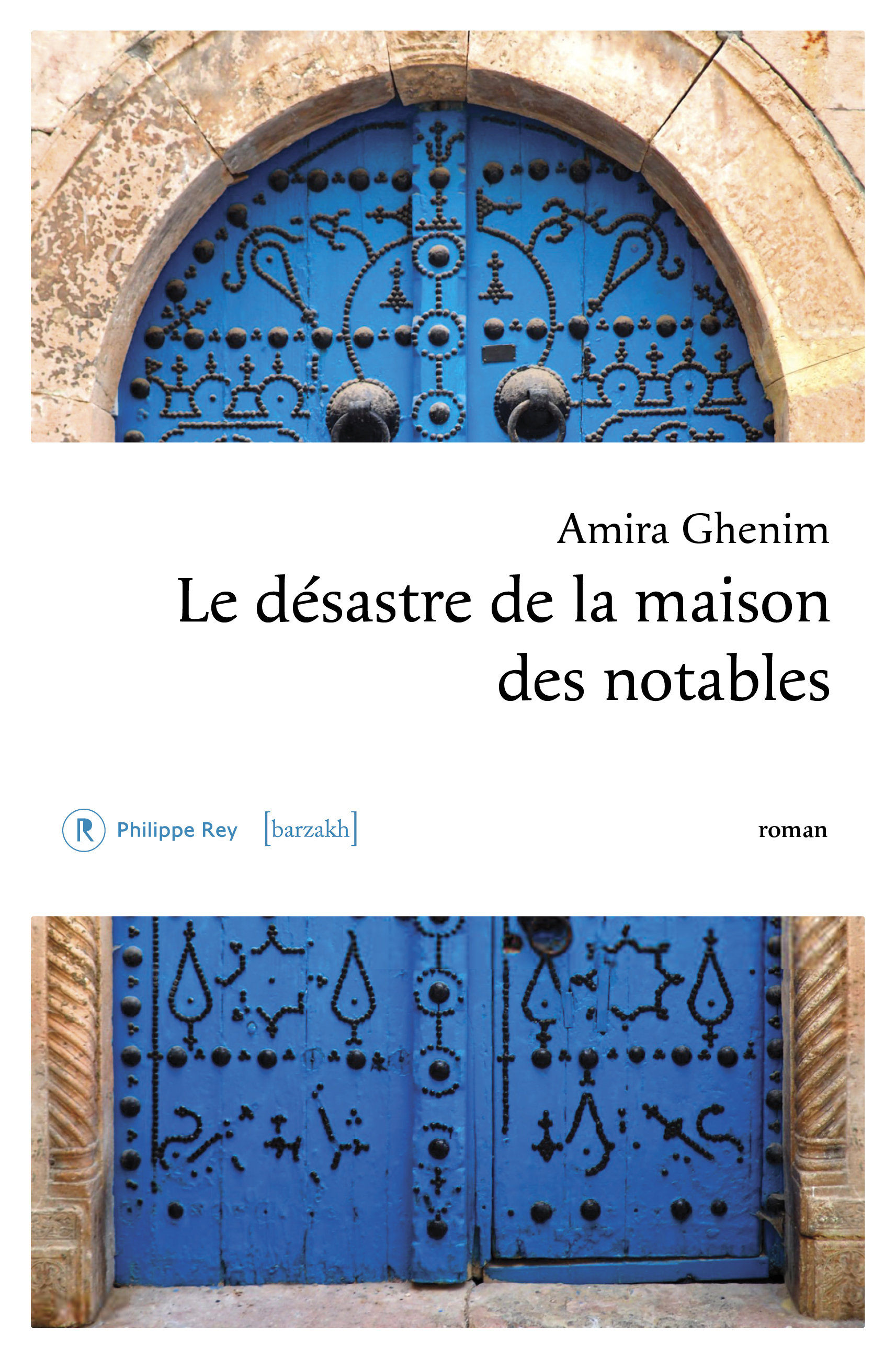
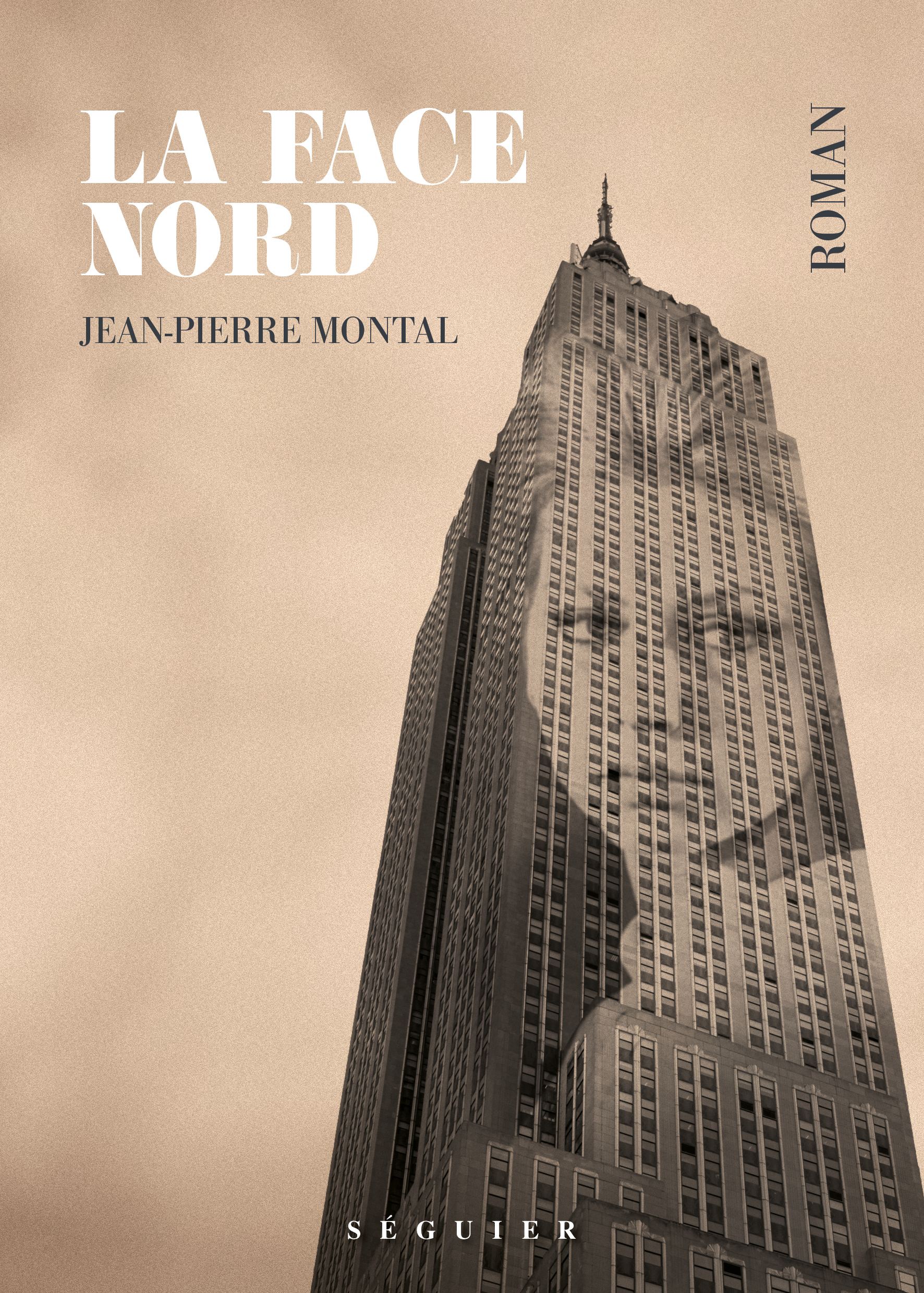



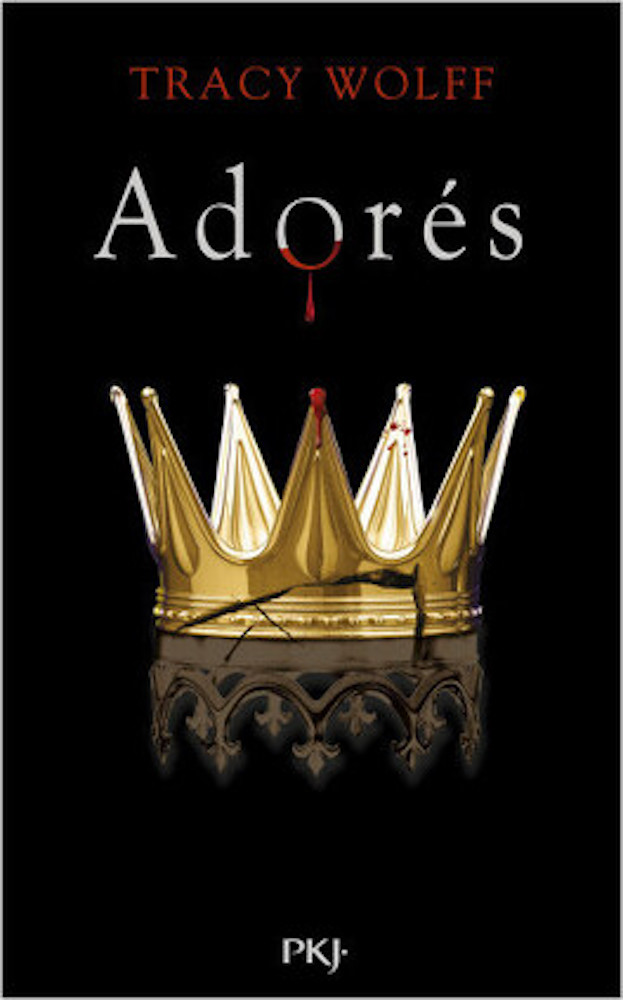
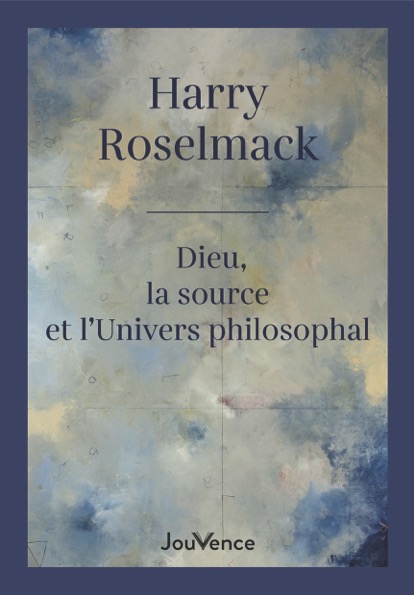
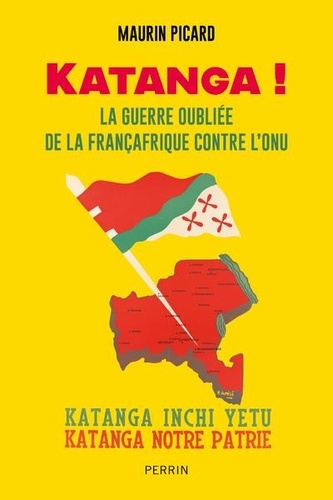

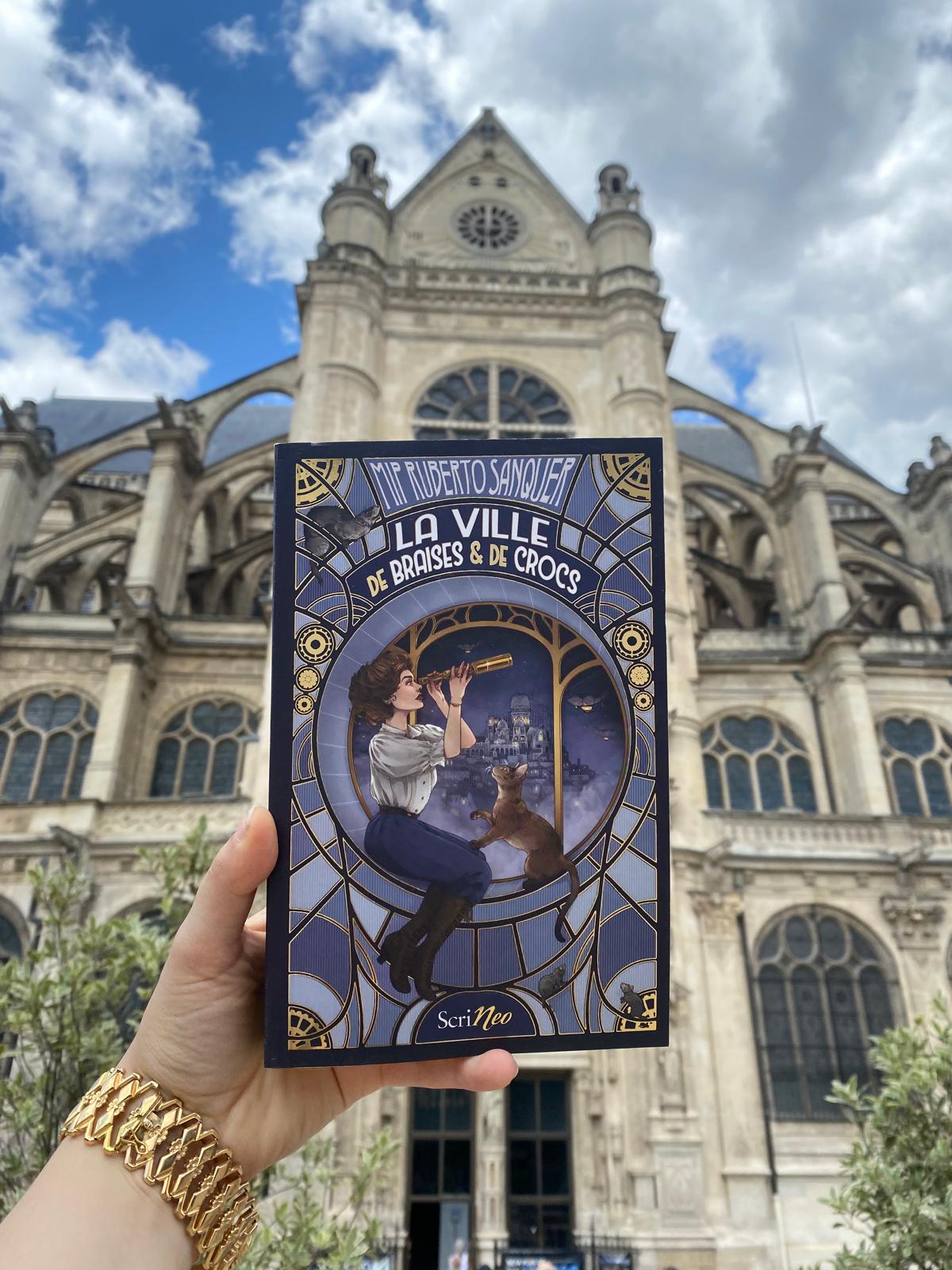
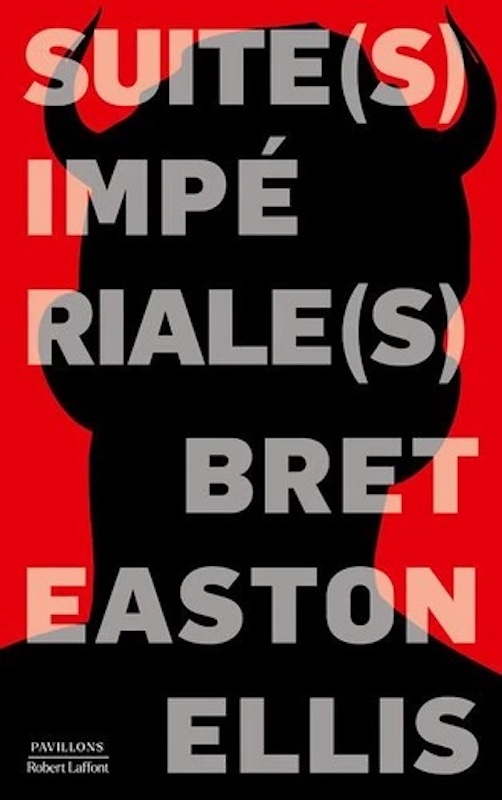




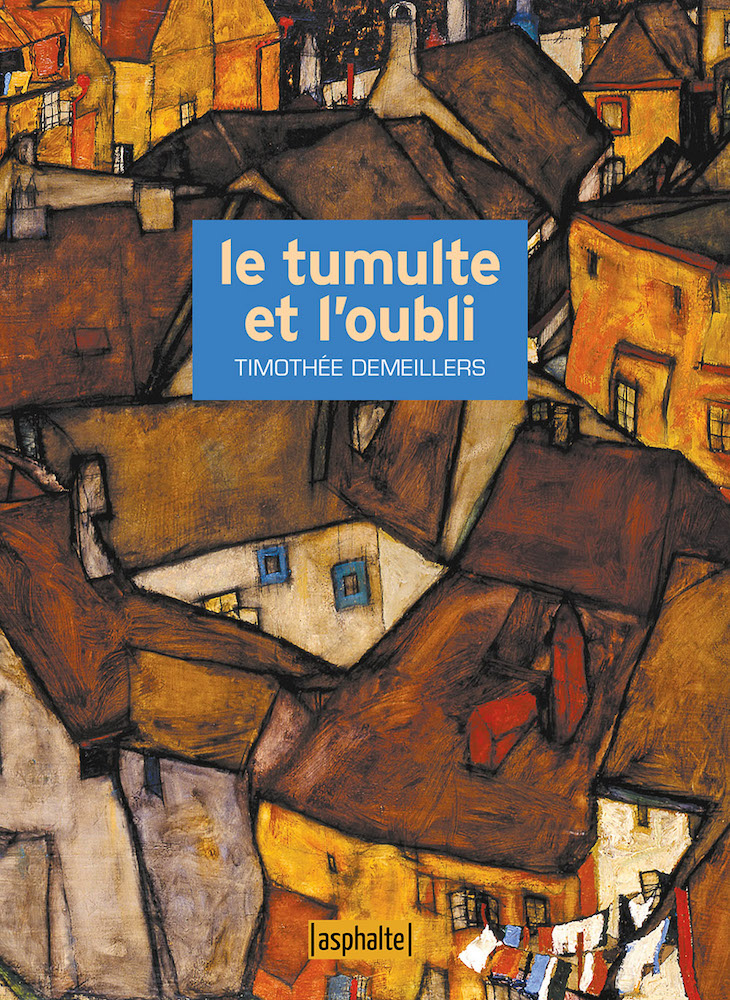


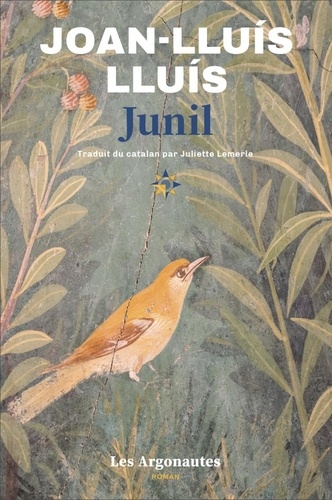

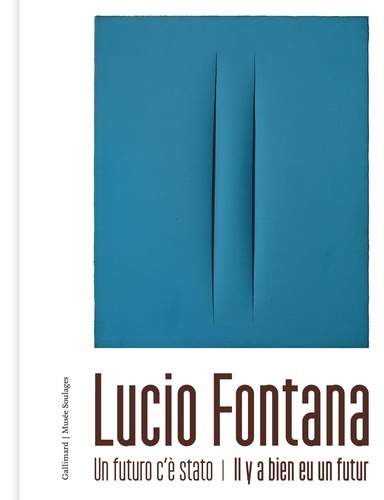


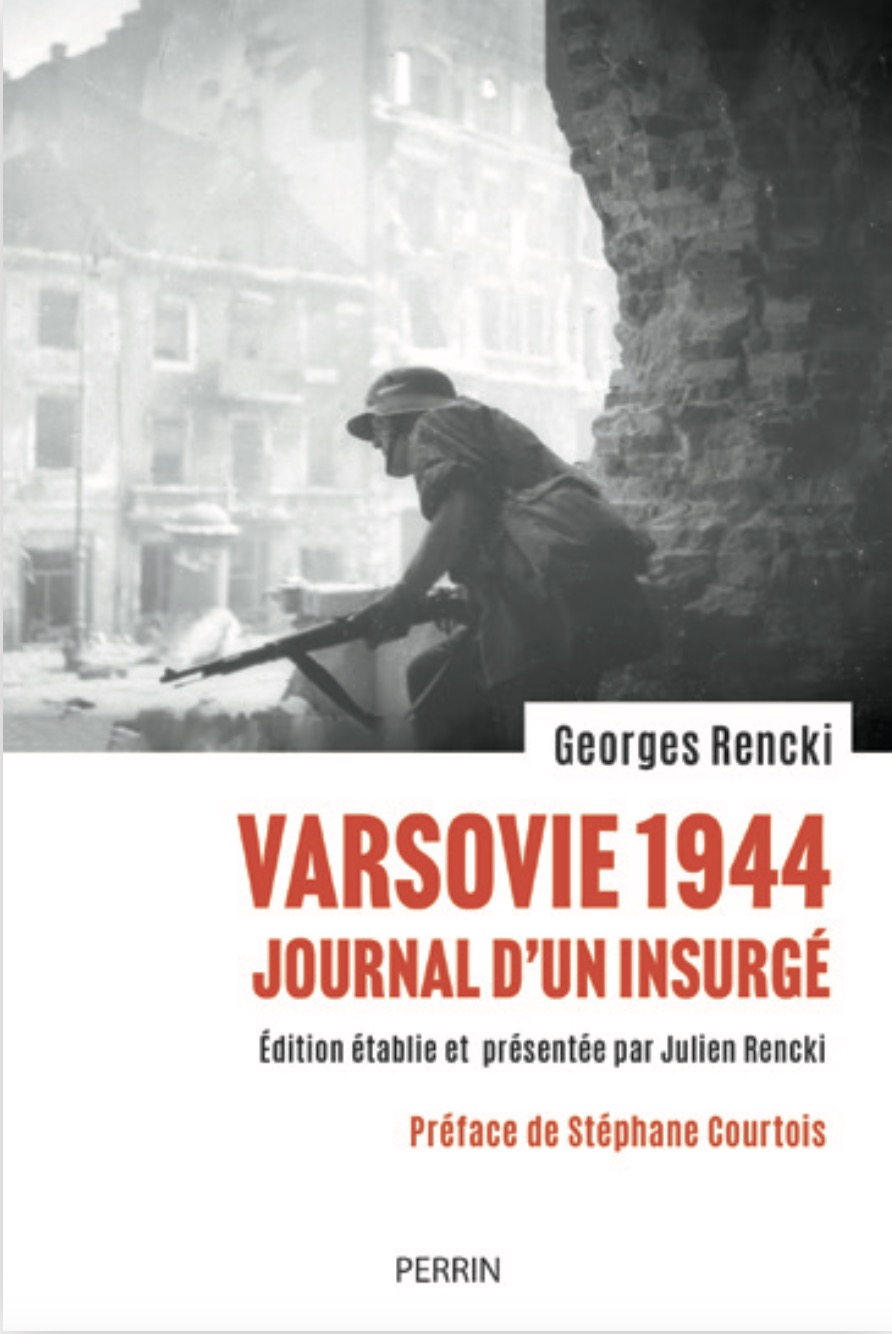
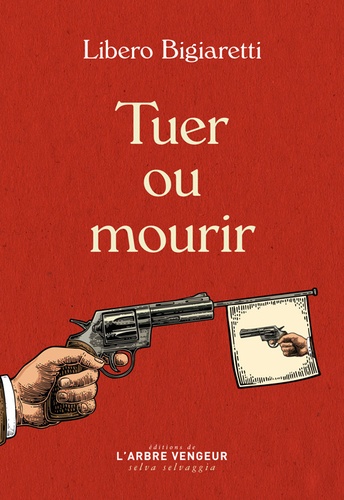

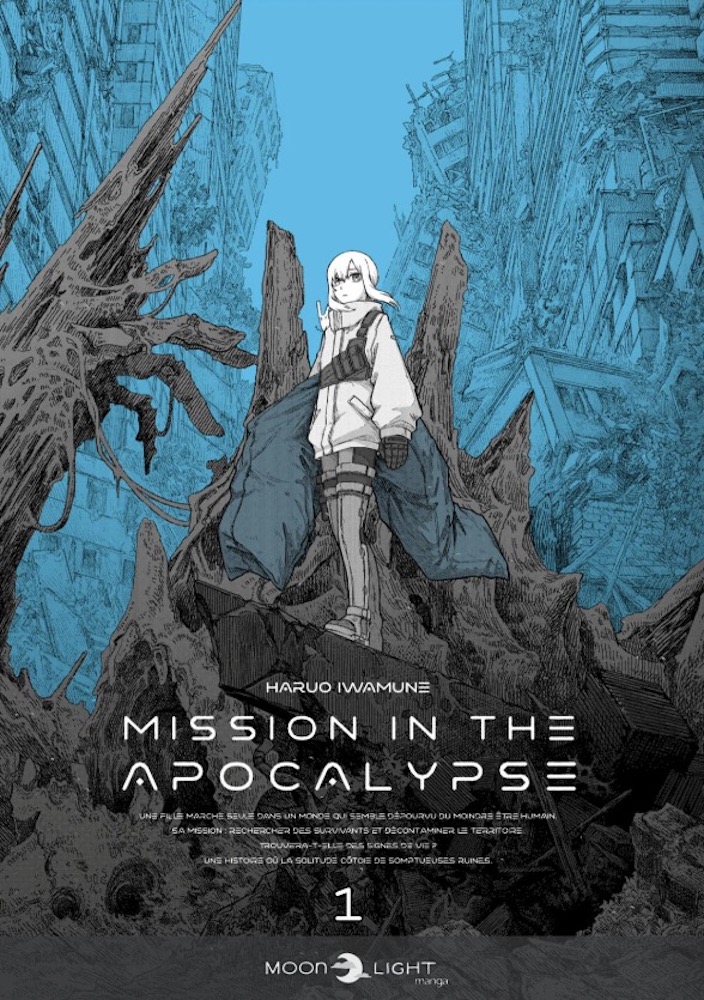


Commenter cet article