Les Ensablés - Le tramway des officiers (1973) de Georges Thinès
Georges Thinès (1923-2016) est un écrivain belge de langue française né en 1923 à Liège et décédé en 2016 à Court-Saint-Étienne. D’abord attiré par les lettres classiques, il fut étudiant en philosophie et lettres à la Faculté universitaire Saint-Louis de Bruxelles. Après son engagement à la Royal Navy durant la guerre, Georges Thinès renonce à la philologie et s’oriente vers la psychologie. Professeur à l’université de Louvain, il fut un spécialiste de renommée mondiale dans le domaine de l’éthologie animale. Excellent musicien, fondateur de l’orchestre symphonique de Louvain, il fut encore poète, nouvelliste, romancier, dramaturge, essayiste. Par Armel Job
Le 28/05/2023 à 09:00 par Les ensablés
1 Réactions | 453 Partages
Publié le :
28/05/2023 à 09:00
1
Commentaires
453
Partages

Parcourir toute son œuvre représenterait un travail de bénédictin et réclamerait une abnégation de trappiste, car, il faut bien le dire, la littérature de Georges Thinès est souvent très aride. Sa poésie, en particulier, s’apparente à une toile abstraite, dont on se demande, au moment de l’encadrer, dans quel sens il faut la placer. Je me contenterai donc d’évoquer ici l’œuvre romanesque de Georges Thinès et, plus particulièrement, son roman Le tramway des officiers[1] qui lui valut le prix Rossel en 1973.
Le tramway des officiers se passe pendant la Seconde Guerre dans une ville sous occupation allemande. Au début, les personnages principaux, un groupe d’officiers allemands, sont affectés à une banale mission administrative.
Ils se rendent au bureau par le tram de 8h04 sous l’œil des civils, parmi lesquels l’astronome Crespel qui revient de l’Observatoire. À la suite d’une attaque aérienne des Alliés, Crespel, un certain docteur Lefaure et le lieutenant Führmann s’emploient ensemble à secourir une vieille dame. C’est ainsi que Crespel et le docteur Lefaure deviennent des familiers des officiers, au point que le staff s’installe dans la villa du médecin.
Bientôt il apparaît que les Allemands s’occupent en fait d’une opération secrète concernant rien moins que l’utilisation de certaines forces de la nature à des fins militaires. Crespel, en tant que scientifique et germanophile, se rallie avec enthousiasme au mystérieux projet, tandis que Lefaure tombe sous le charme d’Hélène, une souris grise chargée du déchiffrement des codes secrets utilisés par les Alliés. Elle devient sa maîtresse.
Manifestement les Anglais ont eu vent du projet clandestin. Le groupe, en effet, est visé par des bombardements de la RAF qui mettent systématiquement à côté de la plaque et provoquent d’énormes dégâts latéraux. Qui espionne les Allemands ? Les conjurés n’ont de cesse qu’ils ne dénichent et n’éliminent les informateurs des Anglais. Cette chasse à l’homme et l’avancement du projet secret constituent l’essentiel de l’intrigue.
Avec une telle matière, un romancier moyennement doué pouvait fabriquer un bon roman. Cependant, le lecteur qui s’embarque en compagnie de Georges Thinès constate très rapidement que l’auteur s’emploie bientôt à faire voler en éclat, un à un, tous les repères de l’amateur de littérature romanesque.
Commençons par le décor du roman. Le lecteur, tout naturellement, a envie de savoir tout de suite où se passe l’action. En gros, il y a deux possibilités : soit le lieu est réel, soit il est fictif. Comme le tramway débouche dès les premières lignes de l’avenue Houzeau, venant de l’Observatoire, et se dirige vers le boulevard Poincaré, le lecteur bruxellois – ucclois plus précisément – reconnaît illico sa ville et se félicite que l’auteur n’ait pas sacrifié à l’habitude, commune à bien des littérateurs belges, de délocaliser l’action en France, à Paris de préférence.
Mais, à peine quelques chapitres plus loin, notre lecteur est obligé de revoir ses positions. Manifestement, le tramway, qui a poursuivi sa route, se retrouve, Dieu sait comment, dans une ville de province française. Comme si Georges Thinès s’amusait de la perplexité qu’il crée chez son lecteur, il prend plaisir à multiplier les noms des localités où le tramway s’est aventuré, qu’il affuble de toponymes de son invention, à consonance provinciale. Il va jusqu’à indiquer la distance kilométrique qui les sépare et se paie les gants au milieu de multiples Mesnil-Boissec, Mormilly et autres Rubenpré d’insérer des villes bien réelles comme Villers-Cotterêts, Varenne ou Béthune.
D’emblée, le lecteur est ainsi frustré de son désir le plus spontané : savoir où on se trouve. Il aurait admis sans peine que le roman se déroule uniquement dans des lieux fictifs. Le problème, c’est qu’il a d’abord été déposé à un arrêt de tram qu’il a peut-être fréquenté lui-même, et que brusquement cet arrêt semble s’être transporté dans un lieu qu’il ne connaît pas et qui, manifestement, n’existe même pas. La convention la plus élémentaire entre l’auteur et celui à qui il s’adresse est donc rompue.
Le lecteur désarçonné va-t-il pouvoir se raccrocher aux autres usages du roman ?
Par exemple, le temps, le moment de l’action ? Là aussi, Georges Thinès a commencé de façon fort rassurante. À la page 2, il nous dit que nous sommes le 15 septembre 1940 à 8h04 du matin. On ne peut être plus précis, mais c’est trop beau pour être vrai. L’action qui suit dans le roman, en effet, est censée se dérouler sur les quatre longues années qui ont précédé l’arrivée des Alliés, en 1944. Mais il apparaît bientôt que l’auteur a décidé de sauter des étapes, comme s’il trouvait le déroulement de la guerre beaucoup trop lent à son goût. Ainsi, à partir des faits rigoureusement pointés en septembre 1940, il indique au mépris total du calendrier que, onze mois plus tard, on se trouve en septembre 1942. Puis il avance allègrement de quatre mois jusqu’en janvier 1943, et là, surprise, pas question d’attendre plus longtemps, les Alliés sont déjà sur place, plus d’un an à l’avance !
Ce n’est pas tout ! Bien qu’il ait commencé le roman comme une relation directe des événements au jour le jour, tout à coup l’auteur abandonne le fil du récit. Il laisse entendre désormais que les faits qu’il rapporte ne sont pas de son cru, mais qu’ils résultent d’une enquête ultérieure qu’il aurait menée dans les années cinquante. Ses investigations l’auraient conduit à un certain Dietrich, lequel aurait suivi l’affaire de loin pendant la guerre. Du style direct on passe donc sans crier gare au style indirect, et d’une sorte de roman d’aventures à une très sérieuse enquête historique.
Voilà donc un narrateur bien curieux qui ne nous ménage guère. Mais qui est-il au fait, ce narrateur ? Encore une fois, le roman démarre gentiment, avec le bon vieux système du narrateur impersonnel style « La marquise sortit à cinq heures ». Le conteur semble décidé à rester dans les coulisses. Toutefois, il ne faut pas attendre bien longtemps avant qu’il use tout à coup du « je », comme s’il avait lui-même pris une certaine part aux événements, puis que certains personnages brusquement s’emparent à leur tour du récit, eux aussi à la première personne, le docteur Lefaure le plus souvent, épisodiquement l’astronome Crespel, Hélène çà et là, ensuite un témoin qui guette les mouvements des Allemands à sa fenêtre, un anonyme qui a connu Lefaure à la faculté de médecine, la mère du narrateur intempestivement sur une question d’étiquettes sur les pots de confiture, et Dietrich, que je viens d’évoquer, mobilisé en Allemagne, à travers des lettres, aux trois-quarts présentées avec des blancs résultant de la censure, qu’il adresse à Hélène, dont il a été l’amant autrefois.
On aurait pu admettre un chapitre entier à la première personne, une sorte d’alternance dans le procédé narratif, mais le roman peut très bien nous balader de la forme impersonnelle à la prise de parole intempestive de l’auteur ou d’un personnage séance tenante d’un paragraphe à l’autre dans le même passage.
Pour ne rien arranger, l’auteur fait appel quelquefois à un « observateur objectif » qui superviserait l’exposé de l’ensemble des faits. On s’imagine logiquement qu’il s’agit de l’écrivain lui-même quand il s’exprime de façon impersonnelle, mais tout à coup ce mystérieux observateur objectif est interpellé
par Georges Thinès qui tient à protester qu’il s’en démarque, créant du même coup une mise en abîme du processus impersonnel. Bref, le lecteur qui aime avoir une relation simple et claire avec le narrateur ne sait plus à quel saint se vouer.
Au moins pourrait-il espérer retrouver ses marques avec les personnages du roman. Voyons les protagonistes, les officiers allemands, l’auxiliaire Hélène, puis l’astronome Crespel et le docteur Lefaure qui se joignent bientôt à eux.
Les Allemands sont, selon l’expression, « parfaitement corrects ». Ils se font du souci pour les civils, contrairement aux Alliés dont l’aviation rase deux villages par erreur. Jamais, ils ne s’expriment sur le nazisme ni sur l’éthique du conflit.
Ils effectuent leur travail consciencieusement avec une attitude chevaleresque.
Leurs conversations sont aussi sereines et élégantes que celles des officiers britanniques dans Les silences du Colonel Bramble d’André Maurois.
Quant à Crespel et Lefaure, ils collaborent sans états d’âme, Crespel parce qu’il est enthousiasmé par les recherches scientifiques des Allemands, Lefaure, qui a perdu sa femme et ses deux enfants, parce qu’il conçoit pour Hélène, qui lui rappelle sa fille, un amour qui frôle l’inceste. Tous les deux sont censés emporter la sympathie du lecteur alors que Berger, le résistant qui les espionne, est présenté comme le dernier des fourbes.
Bref, Georges Thinès adopte une perspective diamétralement opposée à celle qu’on attendrait de n’importe quel auteur belge ou français animé d’un minimum de sens national et a fortiori d’un écrivain qui s’est engagé dans la Royal Navy. C’est comme si Roger Nimier, au lieu du Hussard bleu, avait écrit Le Feldwebel bleu.
Et à quoi s’occupent-t-ils, nos aimables occupants ? Le lieutenant Führmann et Hélène d’abord s’absorbent dans un fichier de troupes à caserner, puis sont chargés de présenter des excuses à son propriétaire pour un chien abattu par erreur par une patrouille, avant de se consacrer au projet top secret sur l’utilisation stratégique des éléments naturels, à savoir les éclairs et la foudre qu’il s’agit de capter pour – évidemment – foudroyer l’ennemi. Des ronds-de-cuir en passant par la rubrique des chiens écrasés, l’auteur nous emmène ainsi dans une conspiration complètement surréaliste, assortie de considérations pseudoscientifiques dont il balance le vocabulaire ésotérique à la figure du lecteur, qui n’y comprend goutte pour la bonne raison sans doute qu’il n’y a rien à comprendre.
Les officiers, Crespel et le docteur Lefaure sont espionnés par un mystérieux homme en gris qui emprunte le tramway et qui a partie liée avec Berger, le résistant, lequel sera tué à cause d’un courant d’air. Près d’éternuer, en effet, il porte la main à sa poche, geste malencontreusement interprété de travers par un Allemand à la gâchette nerveuse.
On apprendra alors que les artisans du projet sur la foudre sont en fait infiltrés par un service rival qui lui-même est peut-être couvert par une instance supérieure. On se retrouve ainsi pris dans une parodie des récits d’espionnage et d’aventures dignes de Black et Mortimer, inspirés par les armes secrètes que les nazis auraient voulu mettre au point, bombe atomique, missiles, U-Boote intercontinentaux. Le projet manifestement loufoque de capter le feu du ciel imaginé par Thinès n’empêche nullement les personnages d’en débattre tout au long des pages avec le plus grand sérieux.
C’est d’ailleurs un des aspects les plus remarquables et des plus agréables du roman que l’élégance parfaite de tous les dialogues, quand bien même les personnages échangent sur des sujets creux sinon extravagants.
Notons encore que l’auteur a soin de signaler que les conversations entre Crespel, Lefaure et les Allemands se passent dans la langue des occupants, que les occupés connaissent parfaitement. Du même coup, le lecteur assiste à une suite d’échanges entre beaux esprits dans la langue de Molière, tout en sachant qu’en réalité, si l’on peut dire, les propos étaient tenus en allemand.
Ce décalage crée une incertitude qui traverse tout le roman et qui touche à l’aspect le plus essentiel d’une œuvre littéraire, la langue elle-même. Le minimum minimorum est qu’on sache dans quelle langue on lit. Or le lecteur lit du français dont le narrateur ne cesse de lui rappeler que c’est, en fait, de l’allemand. Ce qu’il lit est donc du faux français ou du faux allemand.
Il y a de quoi y perdre son latin…
Son latin, le lecteur ne risque guère de le retrouver dans les multiples digressions du roman. À de nombreuses reprises, Georges Thinès semble abandonner le récit – il va même jusqu’à s’excuser de son peu d’intérêt – pour se livrer à des considérations d’allure poétique, obscurs souvenirs d’enfance, évocation de parcs, observations sur la dernière maison d’une ville, exposés philosophiques, scientifiques, anecdotes musicales, dont l’irruption ne peut que paraître très obscure au lecteur.
Tout porte à croire que Georges Thinès s’est amusé à composer des simulacres de réflexion, des pseudo-spéculations dans le style cérébral cher aux intellectuels français, mais qui n’avaient aucune signification réelle. Ne comptait-il pas que chaque lecteur s’avouerait in petto qu’il n’y comprenait goutte, mais n’oserait pas l’avouer – surtout s’il s’agissait d’un respectable critique littéraire – et ferait semblant d’avoir suivi l’auteur jusque dans les arcanes les plus hermétiques de sa pensée ?
Que Georges Thinès ait usé d’humour à travers tout le roman, qu’il ait recouru au faux sérieux pour traiter de l’imbroglio des relations entre les personnages ou des expériences sur la foudre, c’est, me semble-t-il assez clair. Qu’en outre, il n’ait pas répugné à quelques moqueries, j’en vois la manifestation dans les deux exemples suivants.
Au dernier paragraphe du chapitre 24, il se réfère sentencieusement à un vers du poète latin Vulturnius et mentionne – je le cite – « son commentateur le plus autorisé » qui n’a pu se décider sur le sens précis du fragment invoqué. Étant philologue classique et, ayant étudié dans mon cours d’Encyclopédie de la littérature latine jusqu’aux noms d’auteurs dont on n’a pas conservé la moindre ligne, je suis resté le bec dans l’eau devant ce Vulturnius, que Georges Thinès ne présente pas davantage que s’il s’agissait de Virgile ou d’Horace.
Vulturnius ? Absolument inconnu au bataillon. Sans l’ouvrage de Valérie Catelain[2] consacré à la poétique de Thinès, je n’aurais pas appris que notre auteur avait lui-même composé des hexamètres dactyliques latins sous le pseudonyme de Vulturnius. On se prend à regretter que Bernard-Henri Lévy, grand lecteur de Jean-Baptiste Botul, n’ait pas eu l’occasion de commenter ce passage du Tramway des officiers, il aurait certainement pu suppléer au « commentateur le plus autorisé » dont Georges Thinès signale l’indécision.
Je tire mon second exemple de l’ironie pince-sans-rire de Georges Thinès d’une autre citation, qu’il met en exergue de son roman. Les romanciers aiment apposer une épigraphe sur la première page de leur œuvre. Elle les met illico sous l’égide d’un écrivain prestigieux déniché dans le Dicocitation en ligne, dont ils donnent à croire qu’il est leur lecture favorite. Que fait Georges Thinès ?
Il nous sert une citation, mais cette citation, c’est un extrait d’une lettre d’Hélène, son personnage féminin!
Le tramway des officiers est ainsi d’emblée placé sous les auspices goguenards d’une phrase fictive d’un auteur qui n’existe pas. Quant au sens caché sans doute de cette citation d’une platitude totale : «De ces étreintes physiques, il est sorti comme une entente du cœur et de l’esprit », une fois de plus, il nous faudrait un BHL pour nous le dévoiler.
La perplexité que cette pensée suscite en nous dès l’ouverture du roman n’a d’égale que celle qui nous restera quand nous le refermerons. Un bon roman, me semble-t-il, c’est un roman qui, d’une manière ou d’une autre, nous a étonnés.
Il nous a tenus en haleine par le sujet, par tel personnage, par telle considération, il a introduit dans notre âme quelque chose de neuf que nous n’oublierons plus.
Les mauvais romans, grâce au ciel, sont ceux dont on ne retient rien. Le problème avec Le Tramway des officiers, c’est qu’il nous aura procuré sans conteste de l’étonnement, mais pas un seul étonnement, comme celui qu’on éprouve à la fin d’un roman policier, quand on découvre qui était le coupable et qu’on remonte le fil de l’histoire pour y retrouver la logique qui nous avait échappé. L’étonnement que Le Tramway provoque n’est pas d’un seul tenant, on l’a compris, c’est un étonnement à fragmentations qui explose dans tous les azimuts du début à la fin. À tout moment du récit, Georges Thinès semble dire à son lecteur : « Ça va ? Tu situes bien ? Tu es confortable là ? » Le lecteur répond : « OK, Georges, pas de problème, tu peux y aller. » Et, juste à ce moment-là, Georges Thinès lui balance un pavé en plein dans la mer de sa tranquillité.
« Tu te croyais à Bruxelles ? Attention, tu descends à Morlancourt !
— Mais Georges, ça n’existe pas Morlancourt !
— Tu es sûr ? C’est à côté de Villers-Cotterêts. Ça existe Villers-Cotterêts, non ?
— Bon, admettons. Mais, à propos, la date, on est à quelle date, Georges ? Tu m’as bien dit que je devais me transporter douze mois après le 15 septembre 1940 ?
— Euh, oui.
— Alors, comment est-ce qu’on peut se retrouver en 1942 ?
— Demande au narrateur.
— Justement, excuse-moi, mais c’est qui, le narrateur ? Je croyais que c’était toi, puis tu as dit que toi c’est pas toi !
— Ben oui, c’est compliqué. Tout est compliqué, mon brave lecteur, les bons, les méchants, l’allemand, le français, la science, la philosophie. La vie est compliquée. Essaie de réfléchir à tout ça, si tu peux ! »
La vie ? Est-ce que Le Tramway des officiers nous dirait donc quelque chose sur la vie, enfin, la vraie vie, je veux dire ? Ce roman serait-il autre chose que le simple jeu de l’esprit dont il donne l’apparence ? Sous ses airs dégagés, fantaisistes même, il couverait quelque chose de sérieux ! Dans ce cas, l’incertitude permanente à laquelle Georges Thinès nous confronte, ces bifurcations continuelles, ces digressions inattendues, ce serait la vie, ça ?
Une espèce de jeu de cartes que l’on rebat en permanence, qui nous oblige à chaque instant à nous débrouiller avec une nouvelle donne ? Notre histoire sortirait d’un réseau inextricable de possibilités incertaines ?
Nous, nous pensons que notre vie suit tout simplement les rails de la réalité. Quand nous montons à Houzeau, nous sommes sûrs de descendre à Gare de Linkebeek, et pas à un prétendu Mesnil-Boissec. Et pourtant, Georges Thinès n’a-t-il pas raison ? Songeons à la manière dont nous projetons notre vie à cet instant. Lorsque j’aurai terminé la lecture de cet article, j’enfourche ma bicyclette, je file m’acheter des moules et des frites à emporter Chez Léon, je m’installe devant la télé pour une heure de vraie culture avec une bonne Duvel à portée de main. Voilà l’avenir simple et radieux qui m’attend. Le hic, c’est que, tout à l’heure, peut-être le pneu arrière de mon vélo sera crevé, j’arriverai si tard Chez Léon que ce sera fermé, je devrai me contenter de sardines mais je ne trouverai pas l’ouvre-boîte et, comble de malheur, je constaterai qu’il n’y a plus une seule Duvel au frigo. Devant ce désastre, je me rappellerai sans doute que la vie n’est jamais que le chemin que je me fraie vaille que vaille à travers le réseau des possibles qui s’ouvre en permanence devant moi.
Nous croyons trop facilement que notre vie est toute tracée parce que nous n’en considérons que le passé qui a figé une fois pour toutes l’itinéraire hasardeux que nous avons emprunté. Mais la vie, dans le moment où elle se fabrique, est ouverte à tous les possibles. Elle en choisira un seul, sans que cela signifie que les autres n’existaient pas.
Le roman, précisément, se saisit de ce vaste champ de possibilités. La fiction consiste à fabriquer ce que la vie aurait pu fabriquer si elle avait choisi d’autres voies. De ce fait, les événements et les personnages fictifs possèdent autant de vérité virtuelle que les événements et les personnages avérés.
Je livre cette anecdote de mémoire, l’ayant entendue de la bouche de Pierre Assouline. Maurice Piron, le spécialiste de Simenon[3], et Georges Simenon sont assis dans un café. Piron demande à Simenon : « Finalement, c’est quoi un roman ?
— Tu vois la fille derrière le comptoir, Maurice ? dit Simenon.
— Oui, c’est Ginette, la fille du patron.
— Tu es sûr qu’elle est la fille du patron ? » demande Simenon. Piron ne sait que répondre. « Ben, tu vois, c’est ça, un roman », conclut Simenon.
Le génie propre à notre autre Georges, Georges Thinès, est de nous mettre en présence, non pas d’un autre possible de la vie isolé, qui nous fait trop penser à la linéarité du réel basculé dans le passé, mais de nous placer devant la diversité des possibles du réel en cours de réalisation. Le procédé est bien du grand scientifique que fut Georges Thinès, non seulement de l’éthologue qui avait étudié de près l’évolution des êtres vivants dans leur quête infatigable de la meilleure voie à l’adaptation, mais aussi du philosophe, admirateur de Bergson et de sa théorie de l’élan vital, cette force qui crée de façon aléatoire des structures biologiques toujours plus complexes.
L’effet le plus certain de la lecture du Tramway des officiers est de nous déstabiliser. Ce n’est pas pour rien sans doute que le tramway menace de dérailler dès la première page et finit par sortir de ses rails au chapitre 63.
Non, la vie ne se déroule pas conformément à l’infaillible annuaire des chemins de fer et des paquebots emporté autour du monde par Phileas Fogg, qui affirme que l’imprévu n’existe pas.
Georges Thinès rappelle à son lecteur que ce qui est arrivé n’était qu’une possibilité parmi d’autres. Il nous donne à voir une représentation de la période de la guerre à l’envers de sa représentation commune, parce que cet envers n’est ni plus ni moins significatif que son avers. La fonction essentielle du roman, me semble-t-il, est de présenter une alternative à notre représentation de la vie.
Le roman remet en question les stéréotypes que nous installons dans nos esprits par facilité, parce qu’il n’y a rien que nous aimions autant que le plancher des vaches.
Comme le dit Milan Kundera : « Le romancier doit détruire les certitudes. » – « Le romancier est l’explorateur de l’existence. » – « Le romancier doit montrer le monde tel qu’il est : une énigme et un paradoxe. » Ainsi nous voyons que Georges Thinès a accompli de manière exceptionnelle la mission du romancier, celle de nous introduire au mystère de la vie.
Armel JOB
[1] Les références se réfèrent à l’édition des éditions Labor, collection Espace-Nord, 1995
[2] CATELAIN Valérie, Présence au monde, Samsa, 2016
[3] PIRON Maurice, LEMOINE Michel, L’univers de Simenon, Presses de la cité
Le tramway des officiers
Paru le 01/06/1995
381 pages
Editions Labor
10,00 €




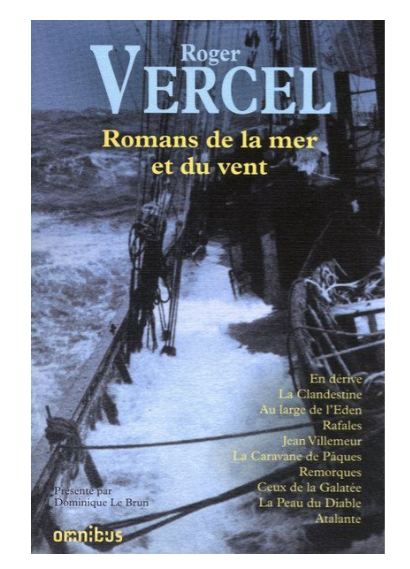
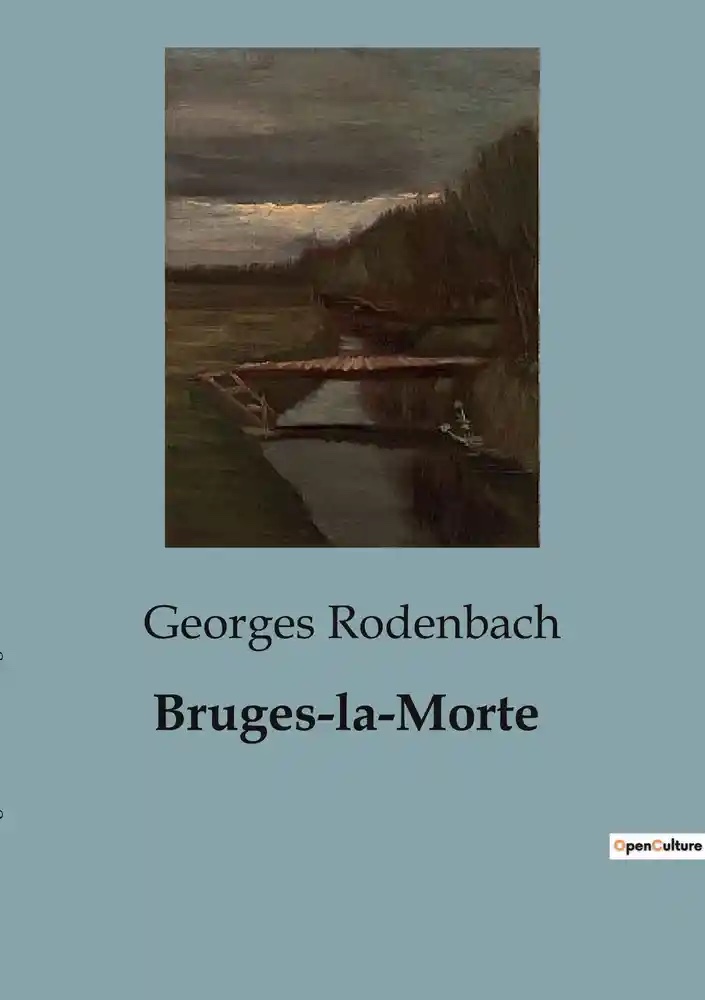
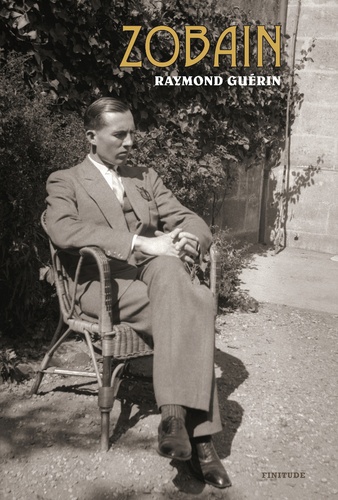

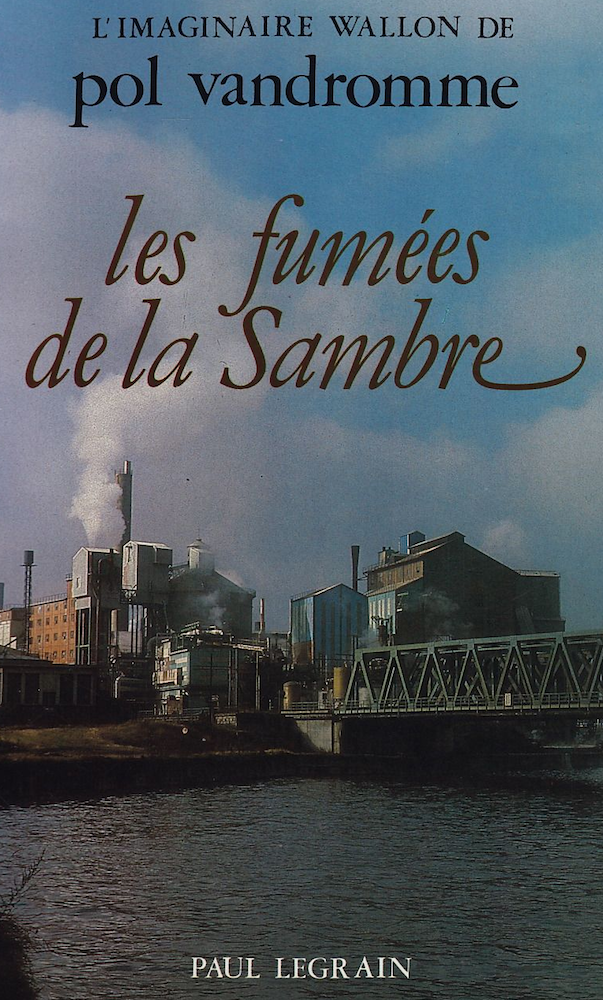
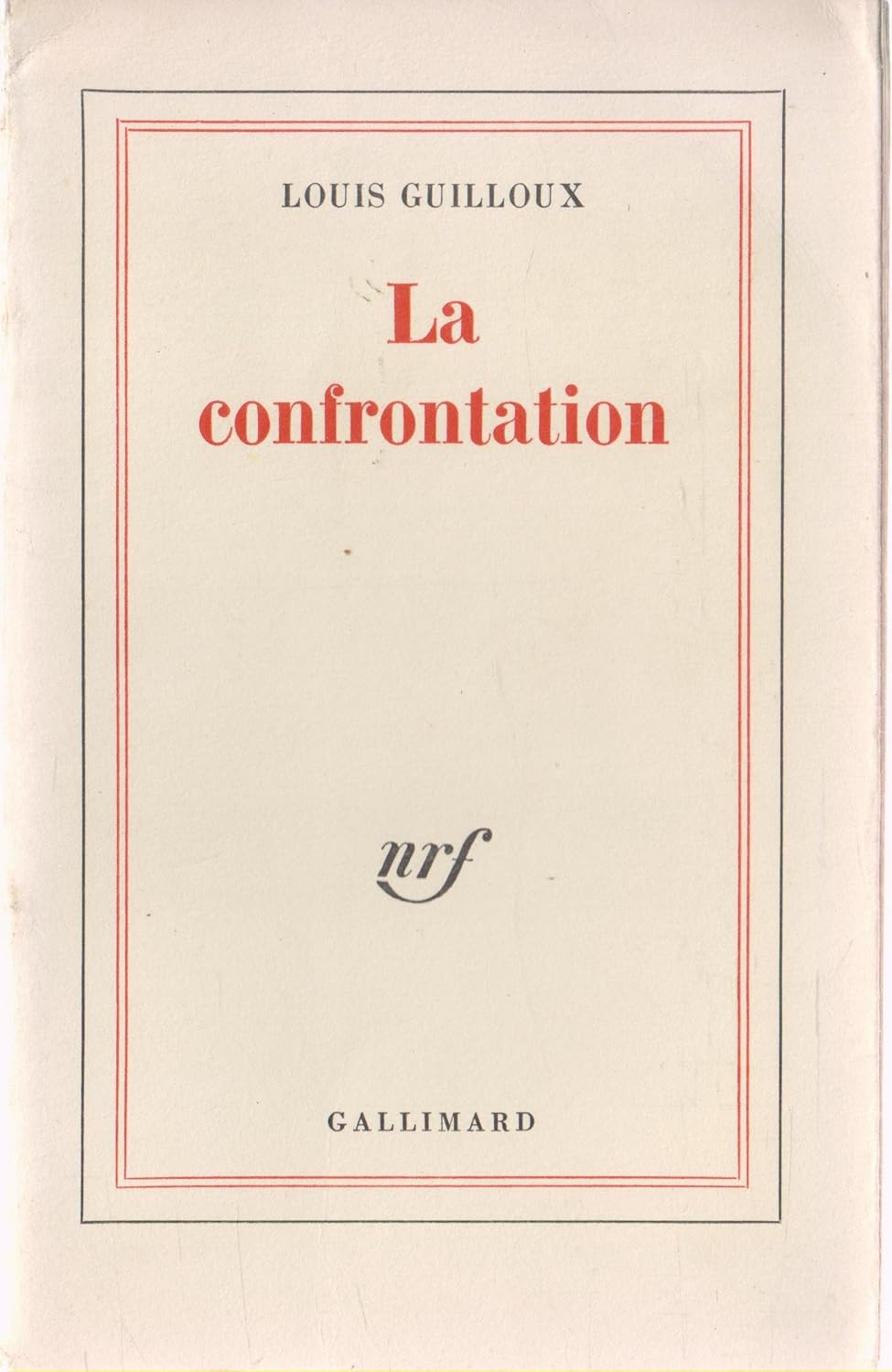
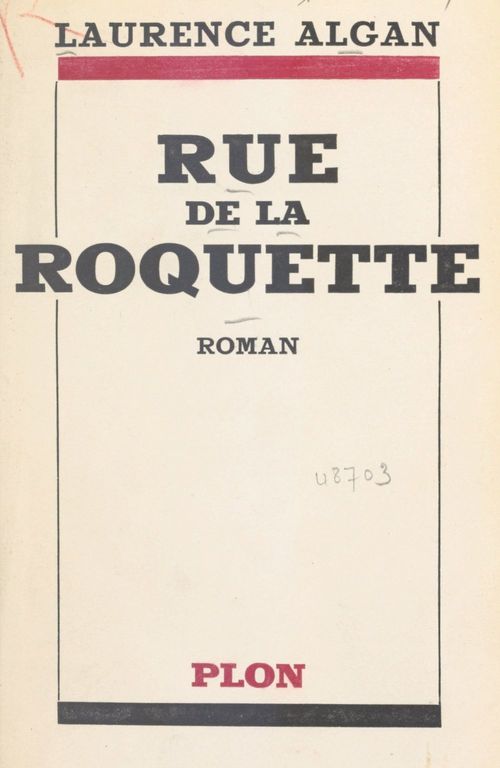
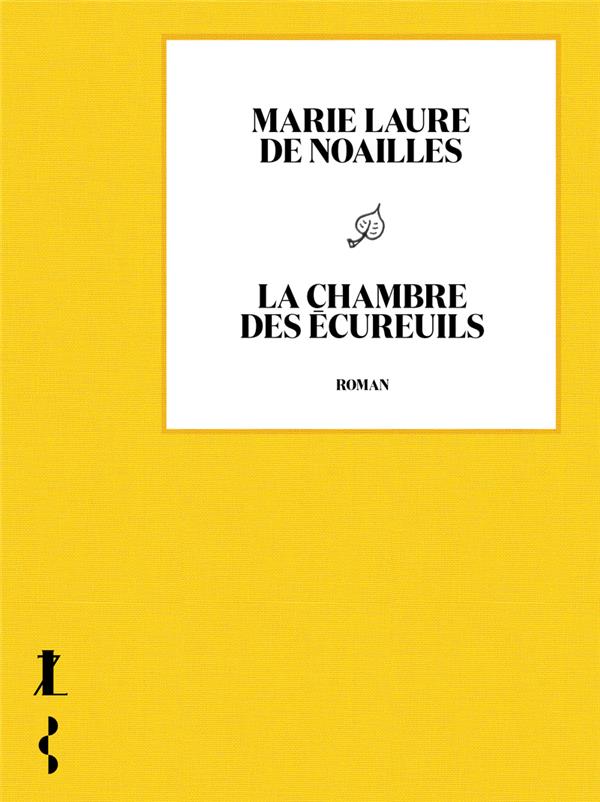
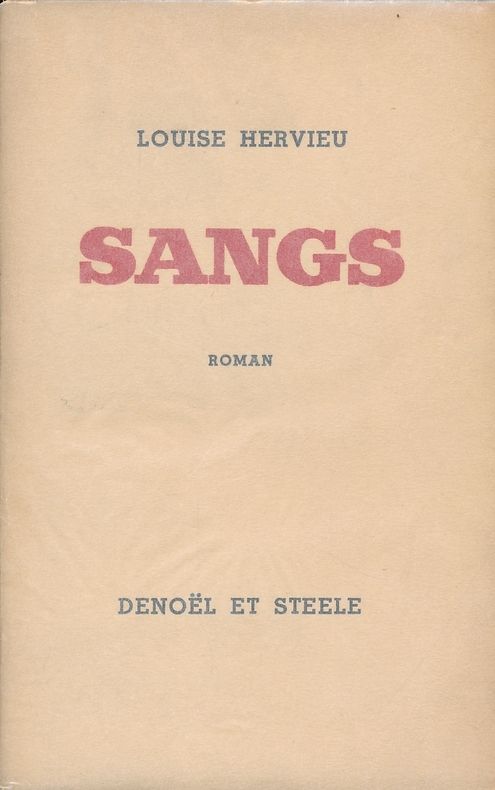
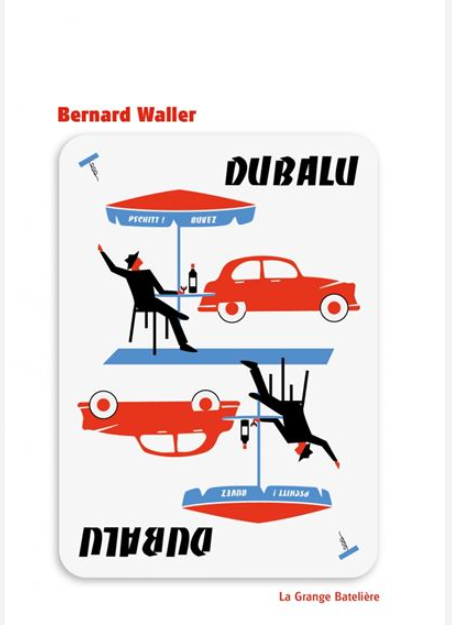
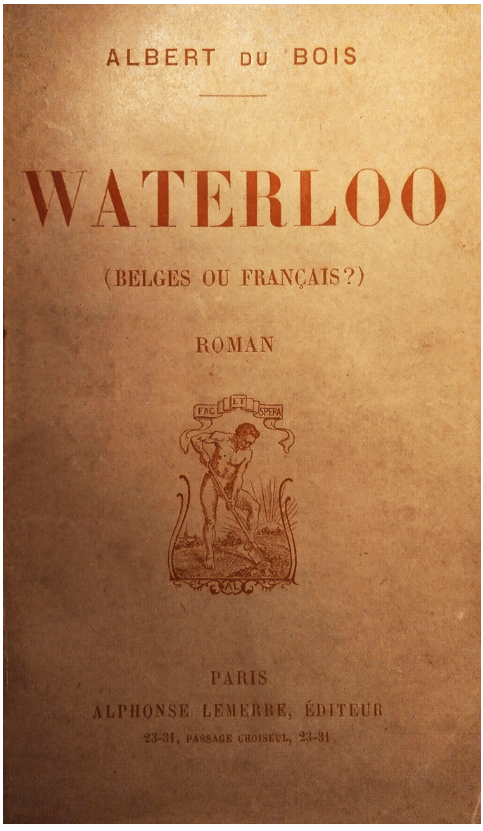

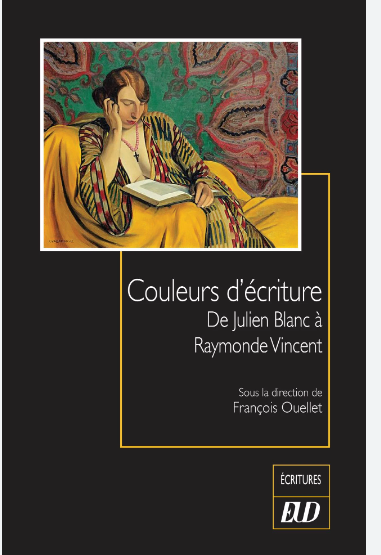
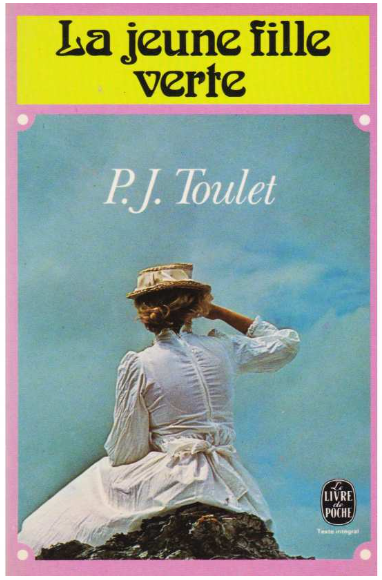
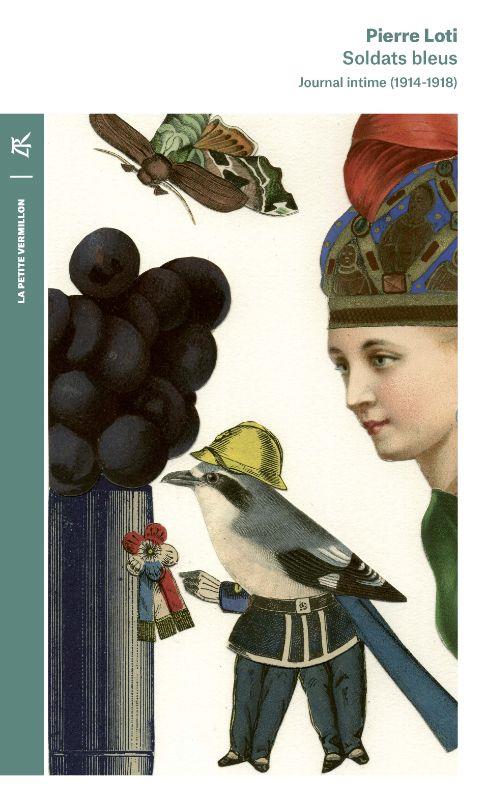
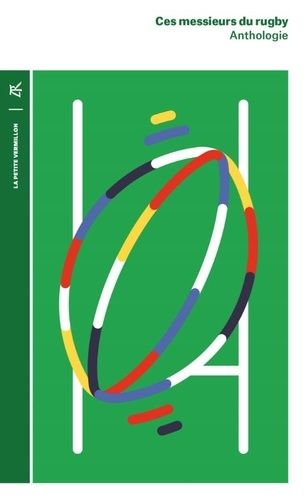
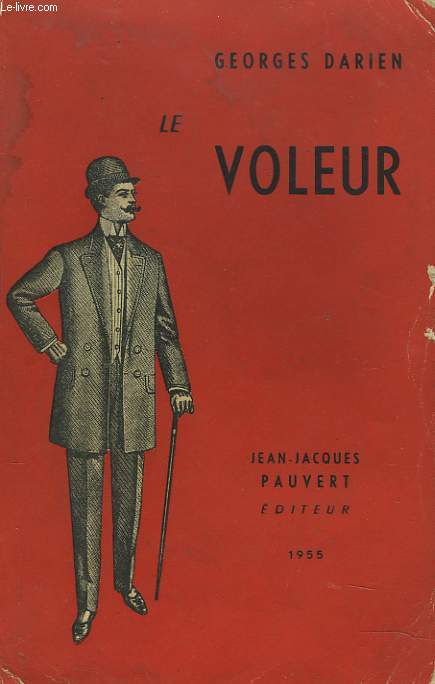
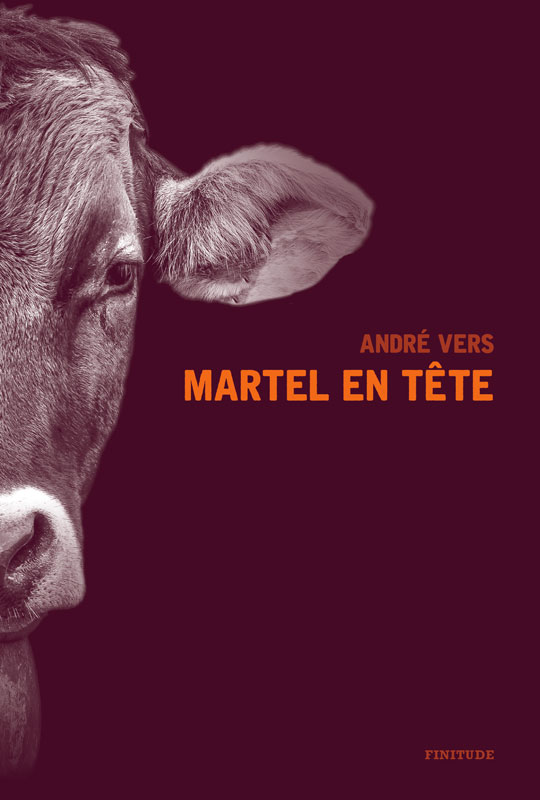

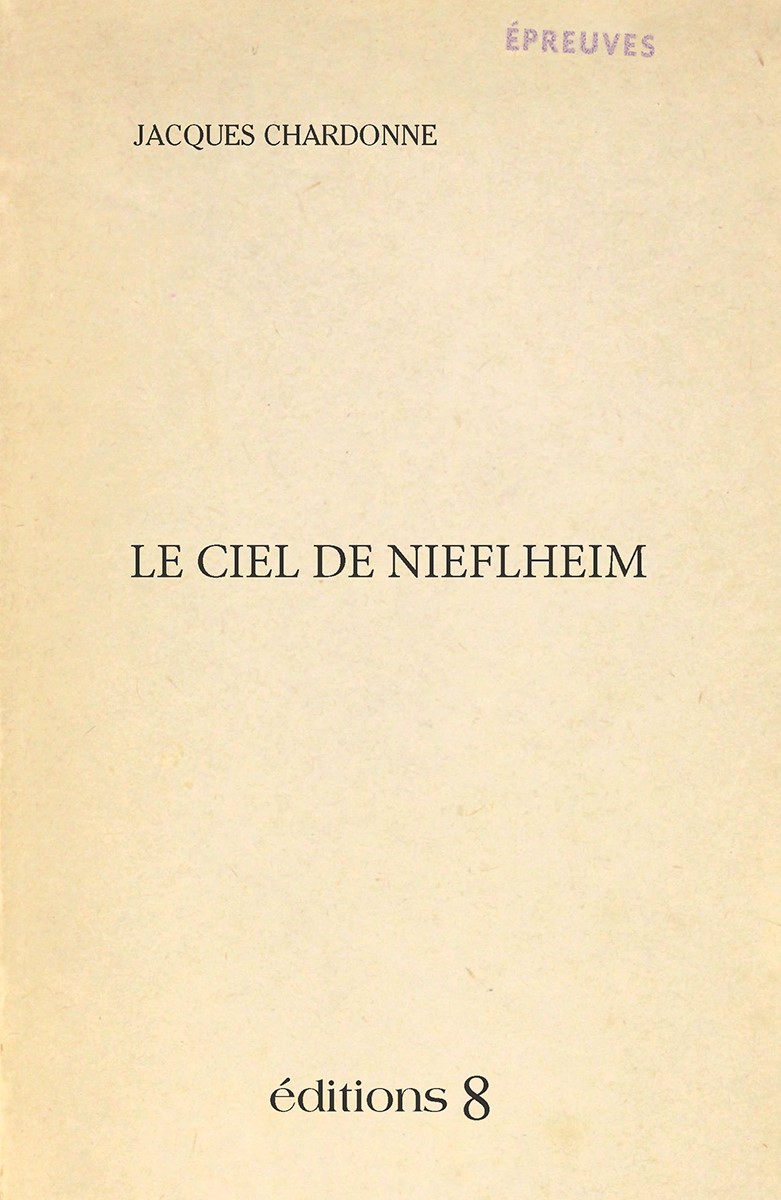
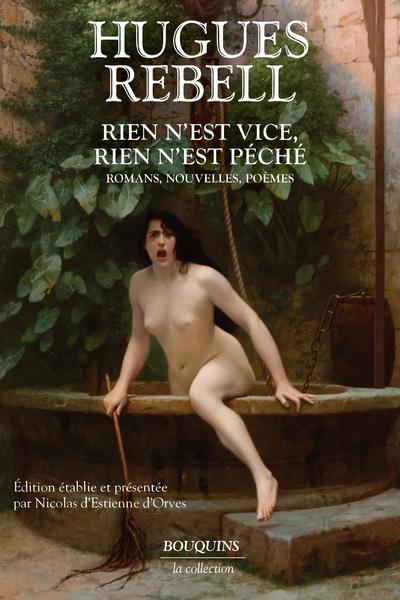
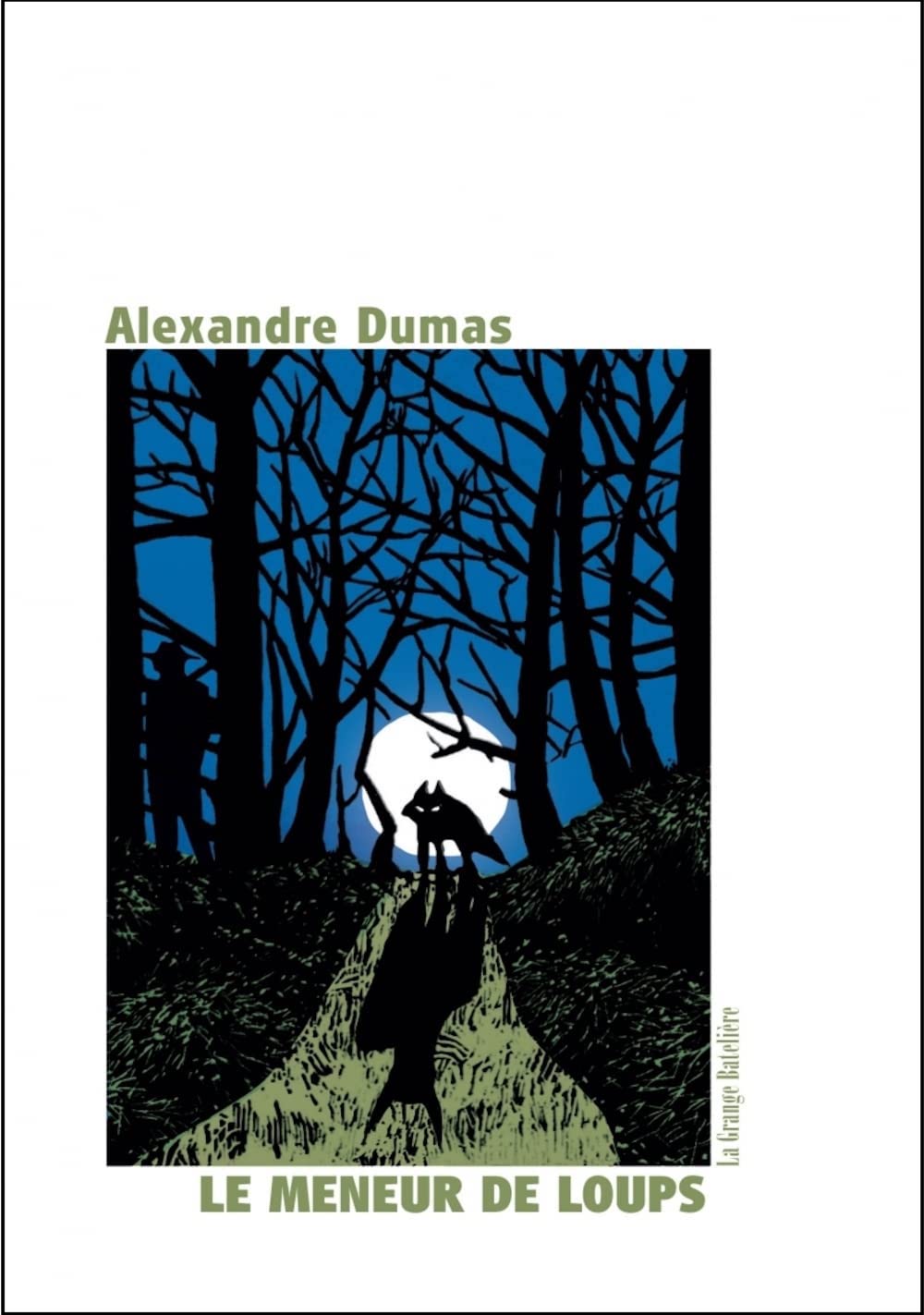

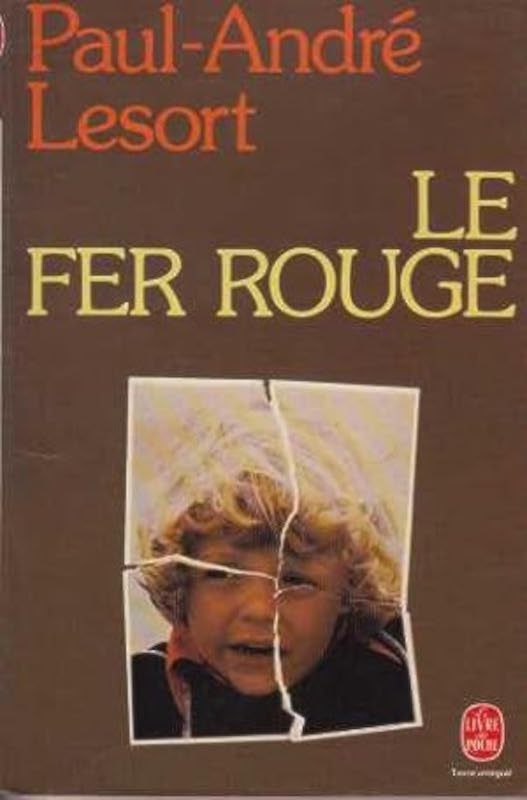


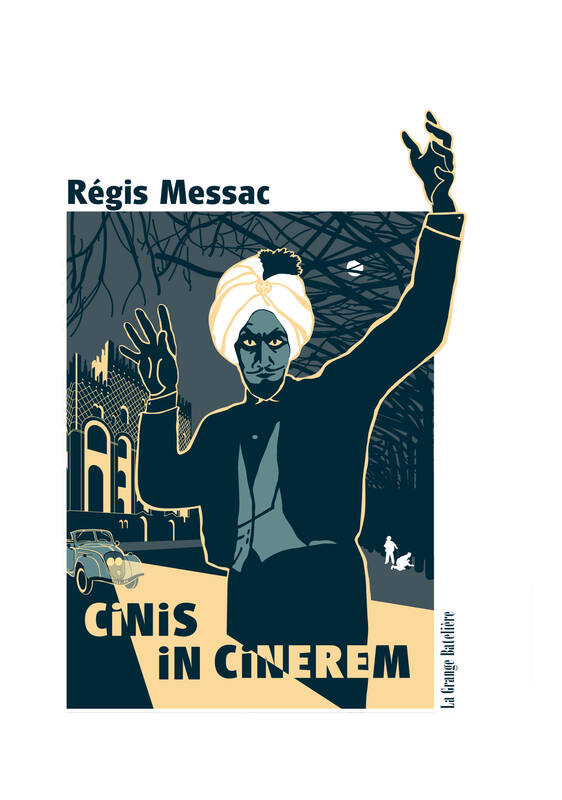
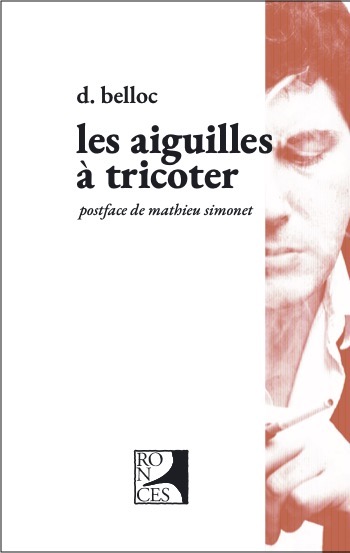
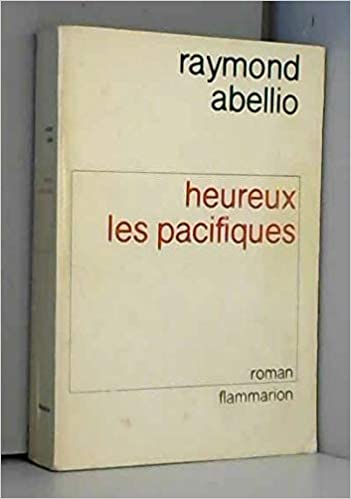
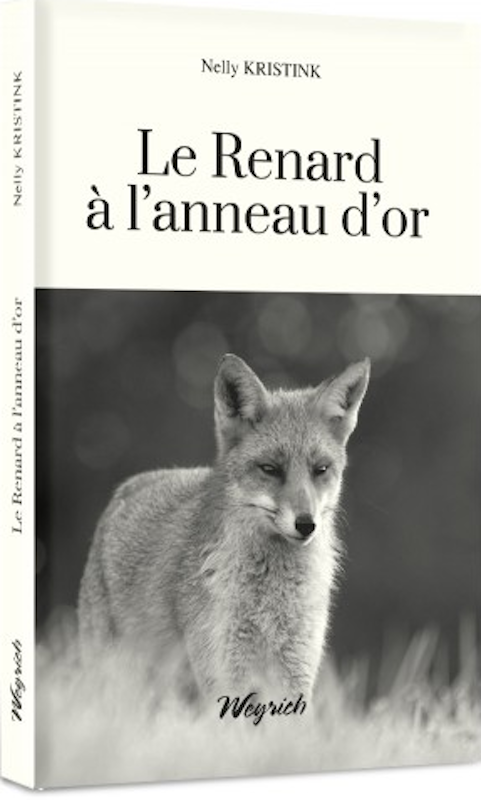
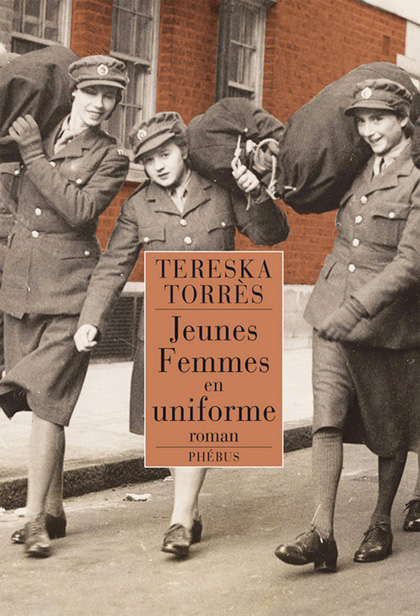
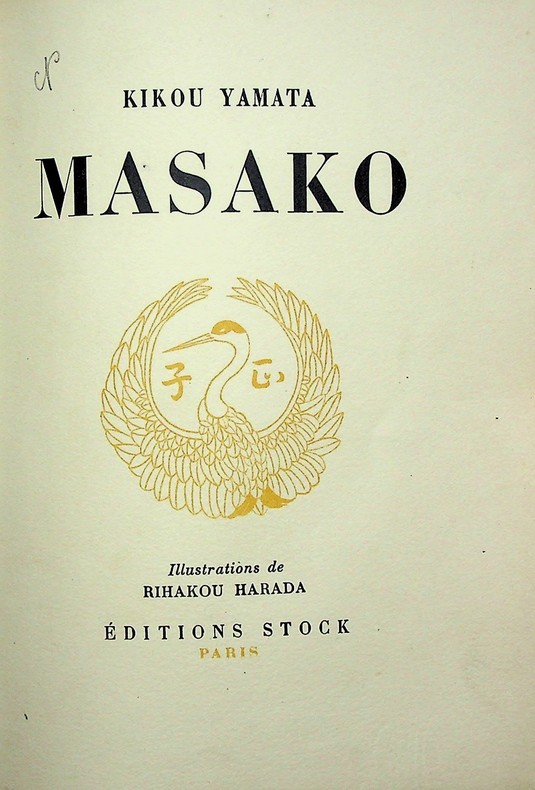
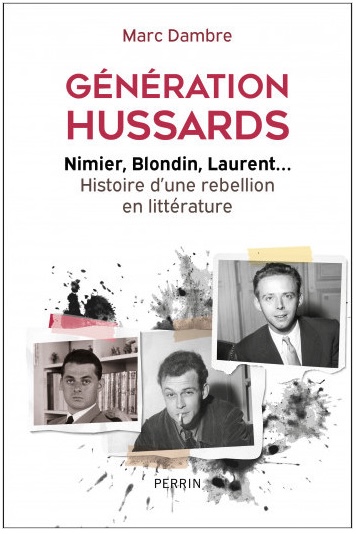
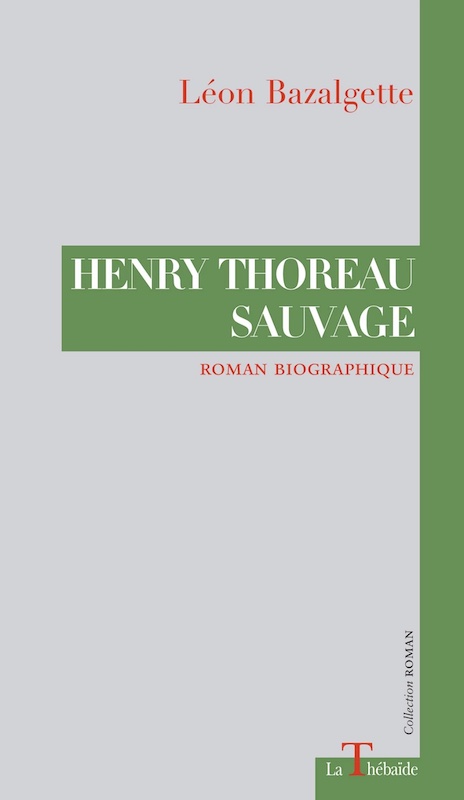

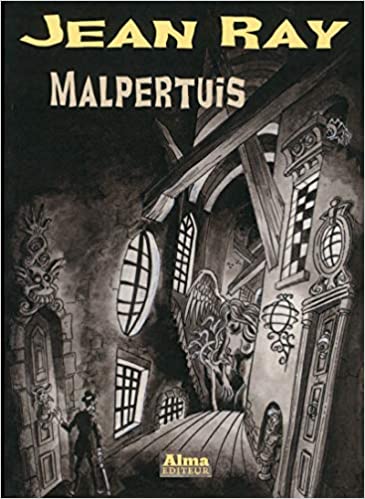
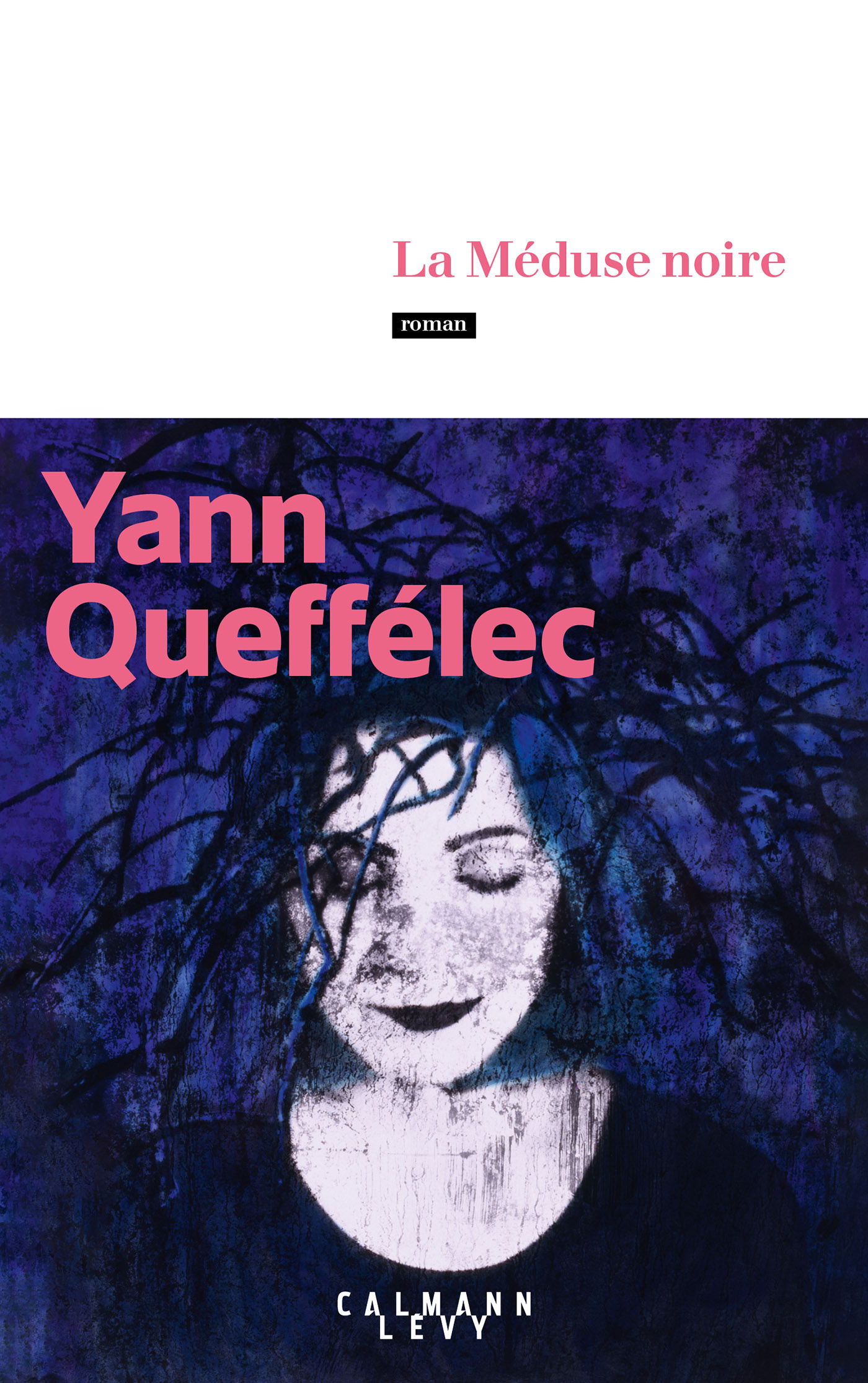


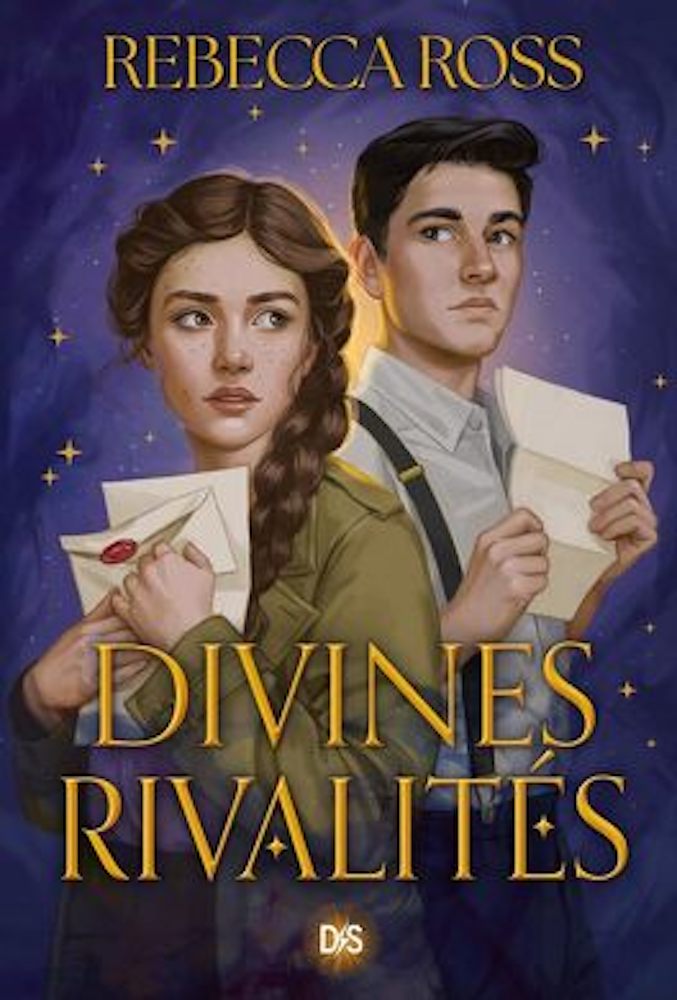



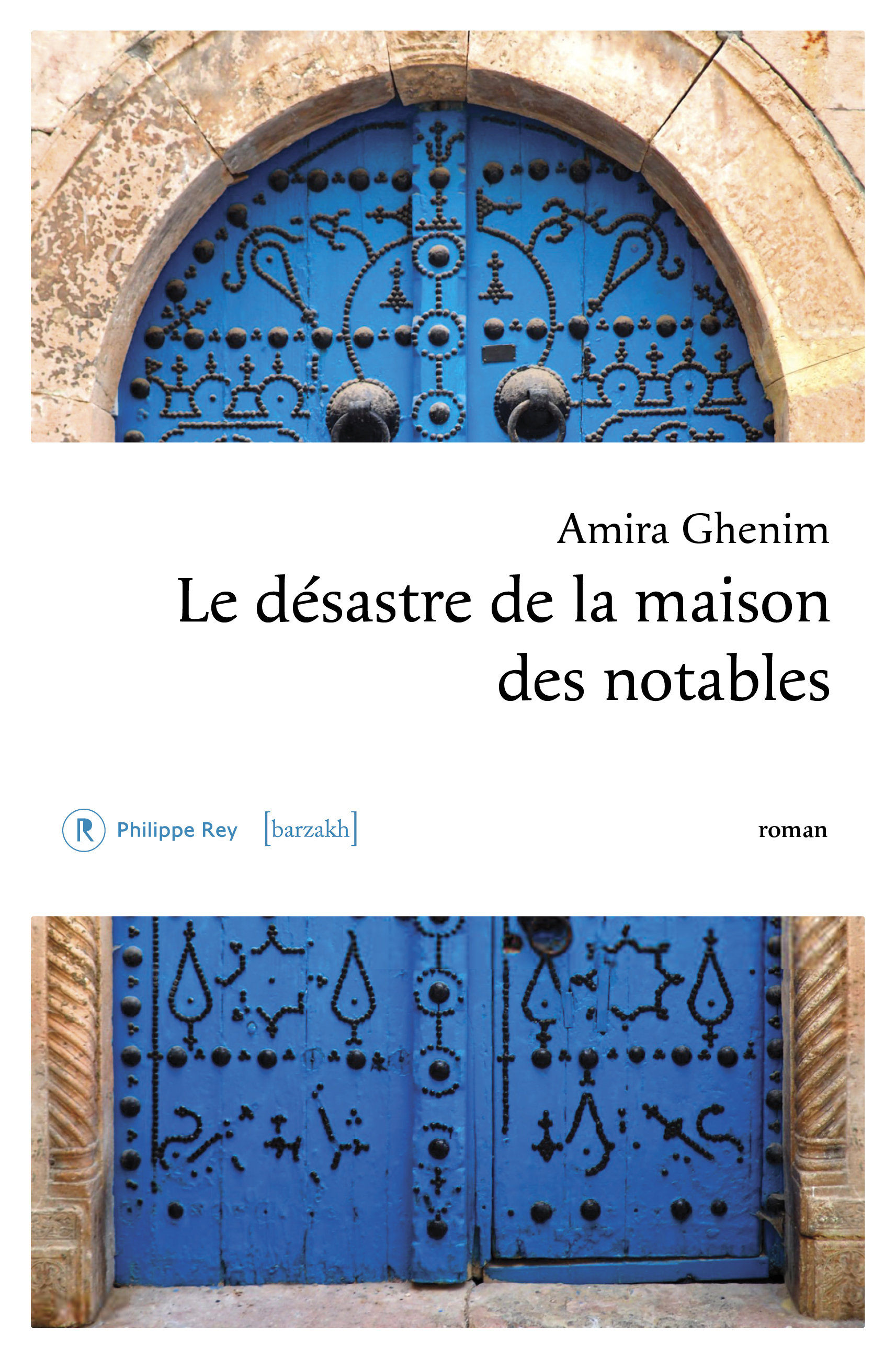
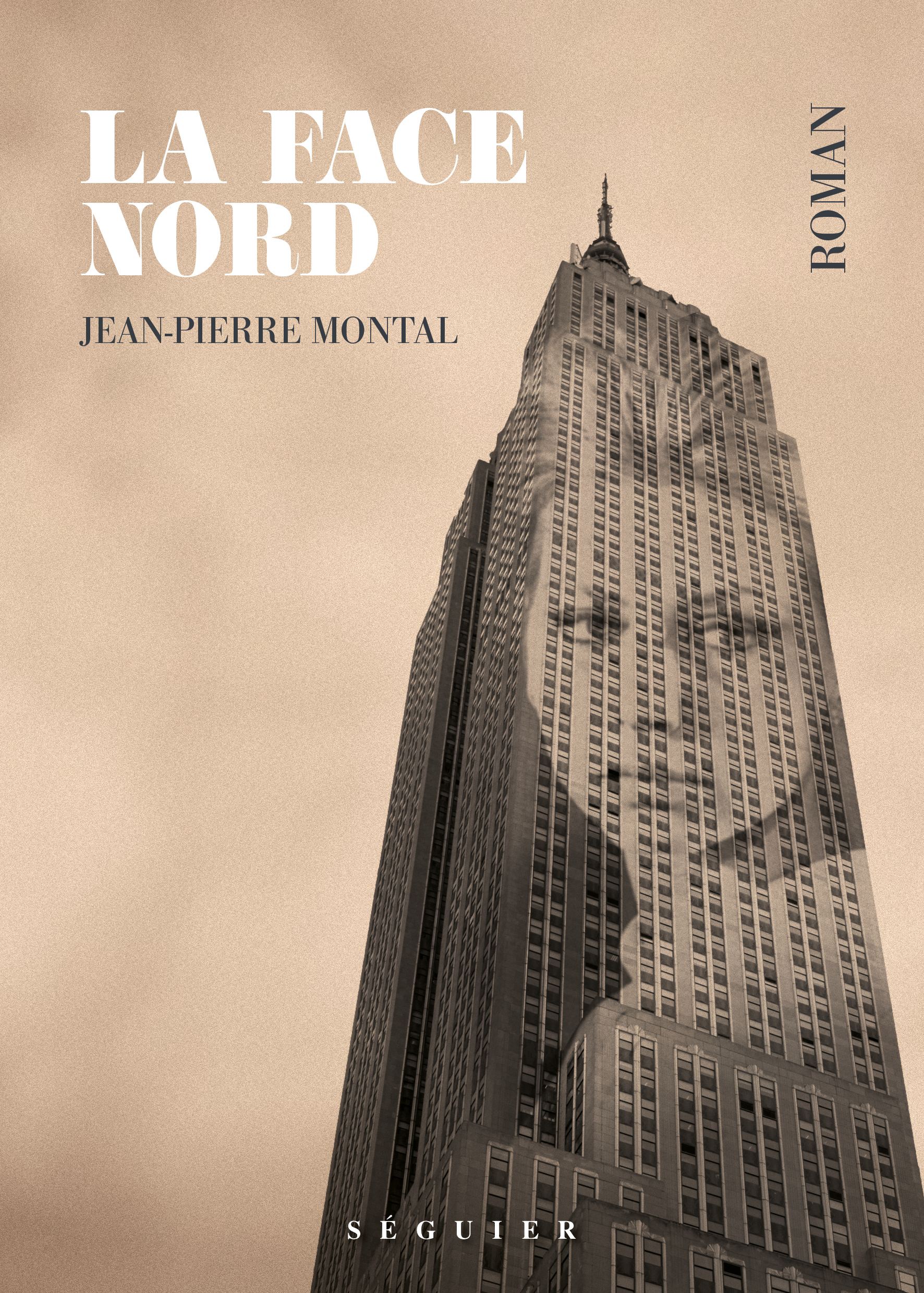



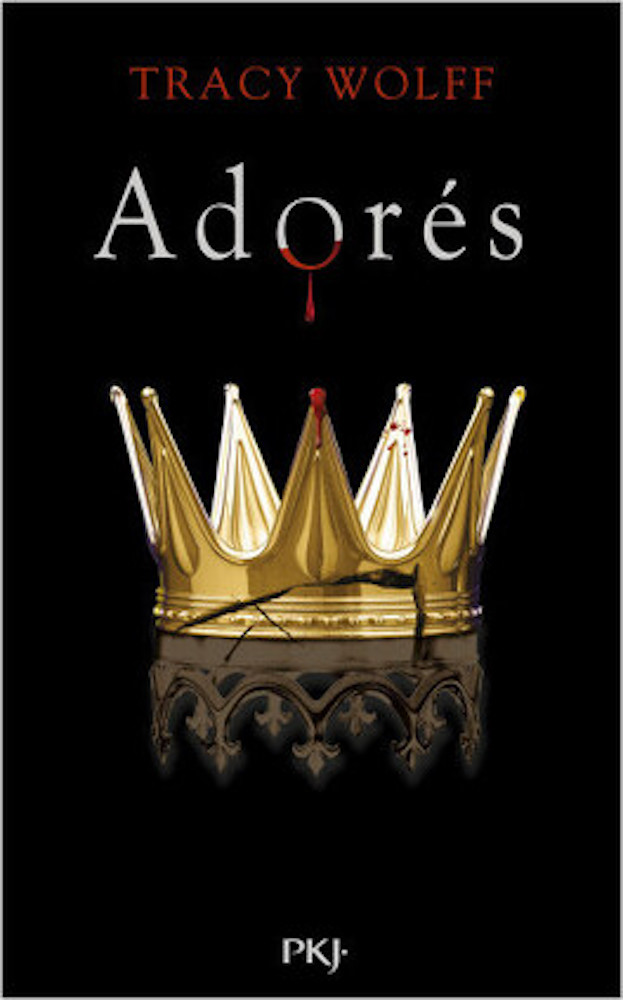
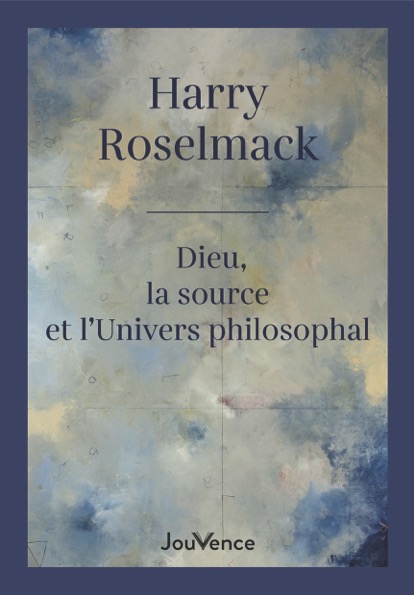
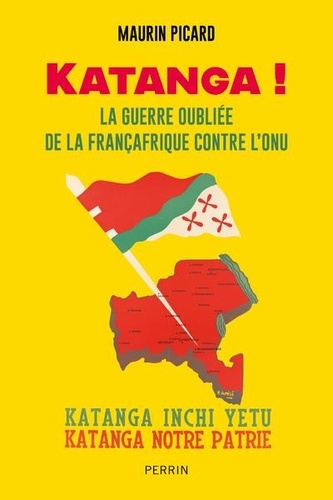

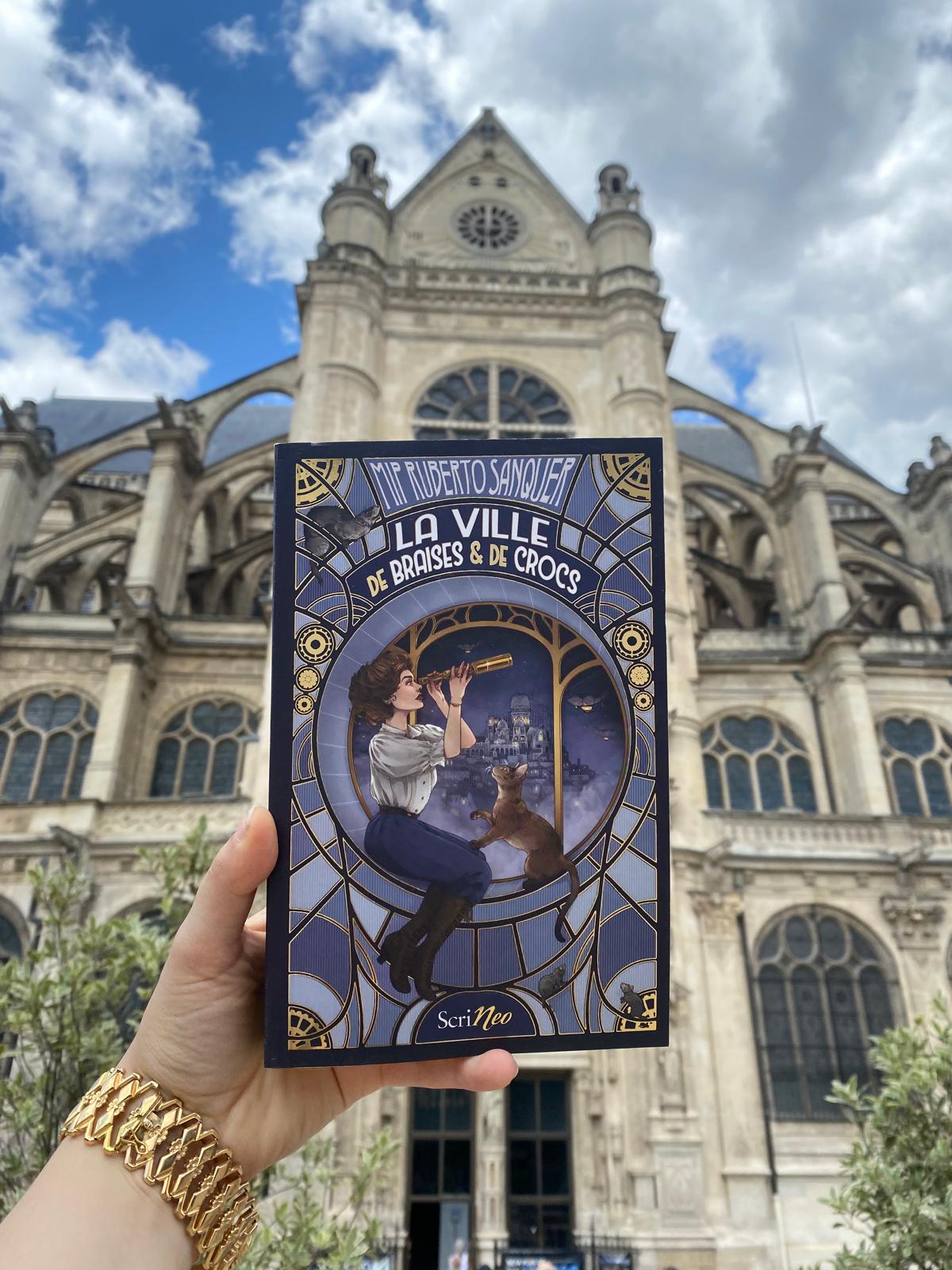
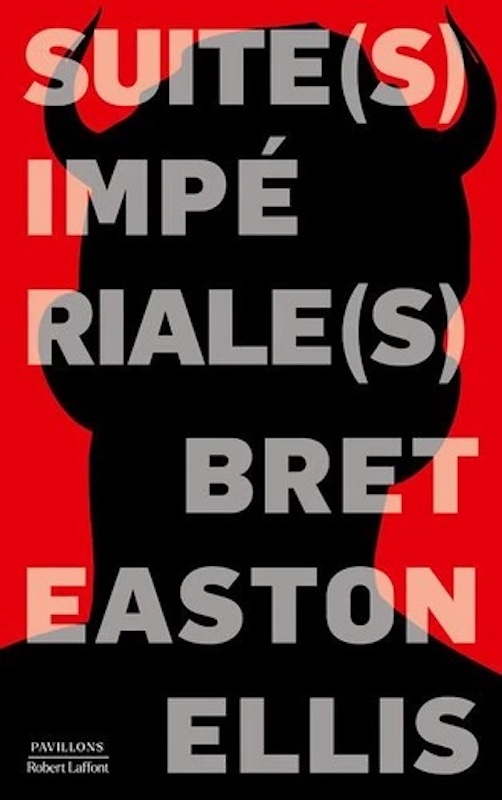




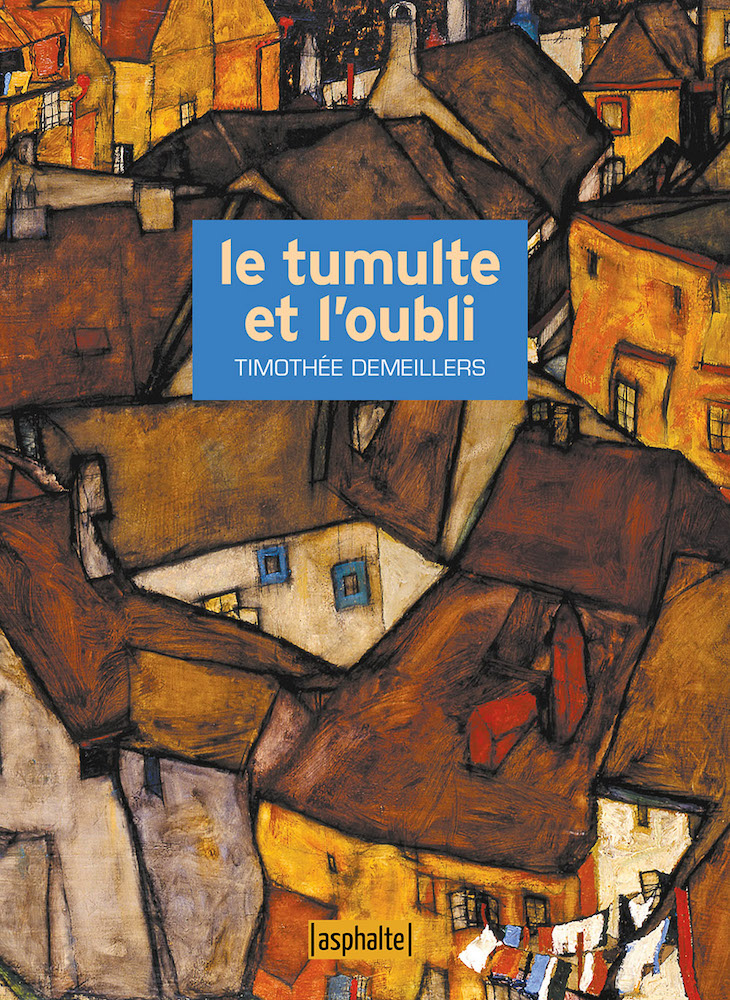


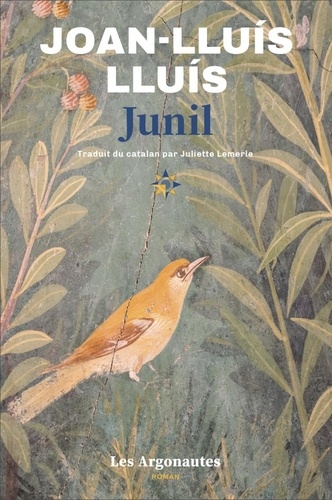

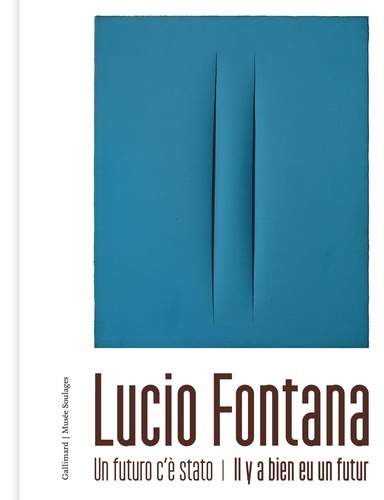


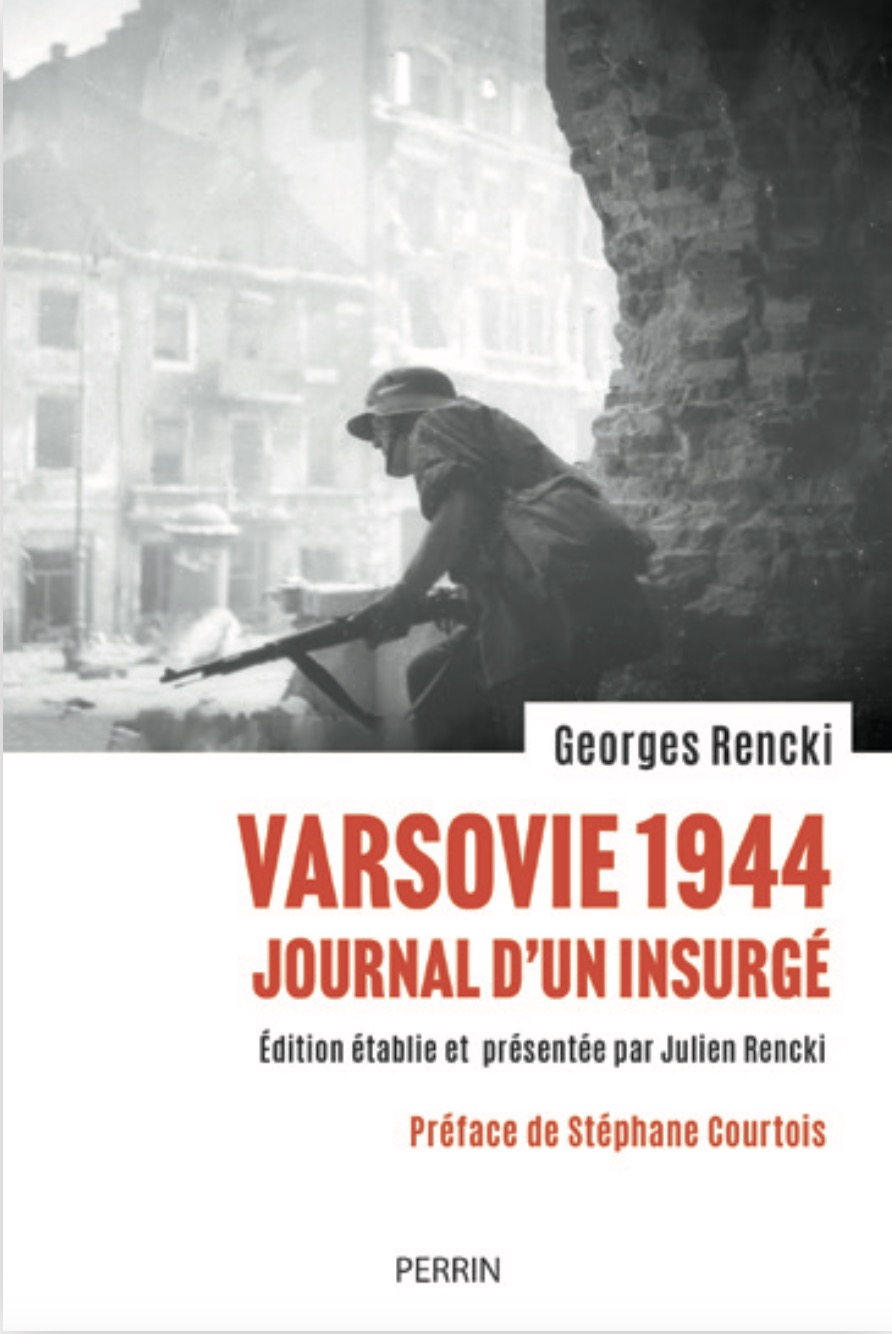
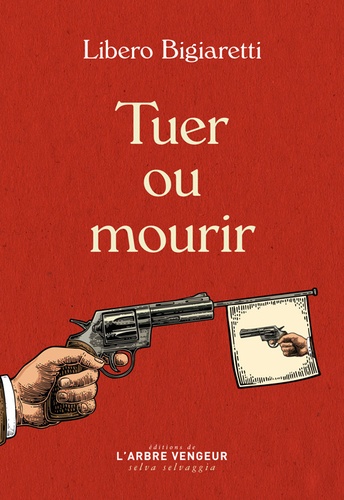

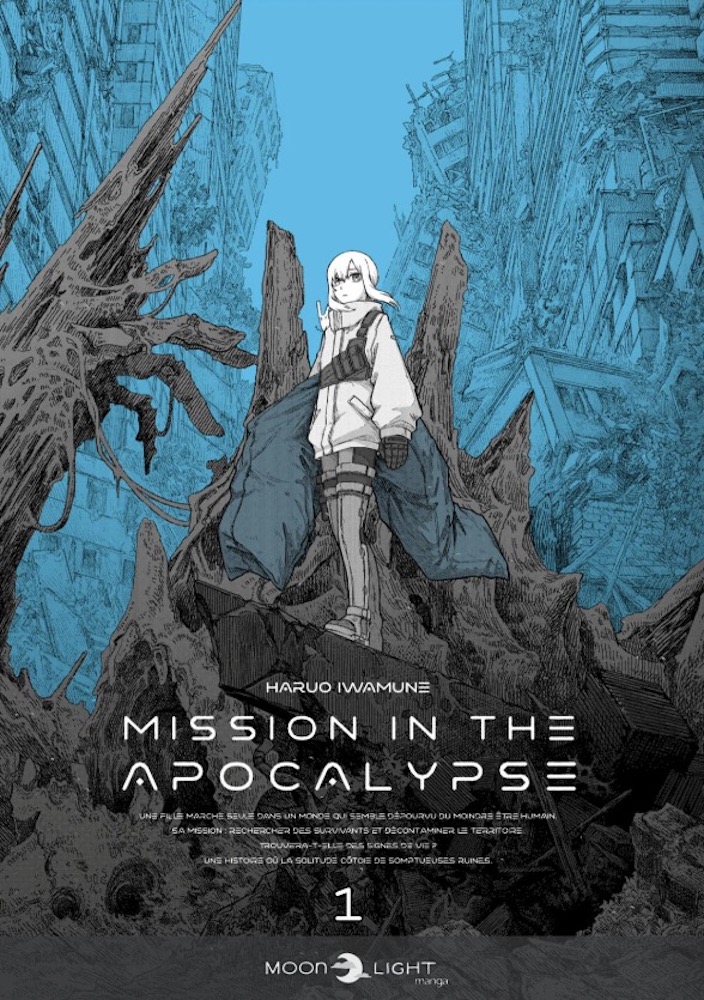


1 Commentaire
Joseph
30/05/2023 à 20:24
…fatone an forte…