Les Ensablés - Deutschland de René Trintzius (1898-1953)
Quiconque vous demanderait ce qu’évoque pour vous le nom de Trinztius, vous resteriez coi ou chercheriez en vain du côté des érudits anversois de la Renaissance. Bien oublié aujourd’hui, René Trintzius fut très connu dans le monde des lettres de la première moitié du siècle dernier. Né en 1898 dans une famille bourgeoise de Rouen -son père était un architecte renommé- il abandonna très en amont une carrière de magistrat pour se consacrer dans un premier temps au journalisme, puis rapidement à l’écriture de pièces de théâtre et de romans. Par Marie Coat
Le 22/01/2023 à 09:00 par Les ensablés
1 Réactions | 367 Partages
Publié le :
22/01/2023 à 09:00
1
Commentaires
367
Partages

Il avait tout juste 26 ans lorsque son premier drame figura à l’affiche d’un théâtre parisien et en 1928, se joua sa deuxième pièce à la Comédie française. Très lié au monde du théâtre avec notamment Gaston Baty et Lugné-Poë — il n’en commença pas moins une carrière de romancier publiant de 1927 à 1934, chez Gallimard, sept romans qui rencontrèrent un franc succès — et l’estime de personnalités du monde littéraire tel que Gide — dont Le septième jour, qui échoua de peu à remporter le Prix Goncourt en 1931.
Mais à compter de 1938 et jusqu’à sa mort en 1953 à Paris, outre son activité de critique, René Trintzius se consacra à la création théâtrale, à des essais historiques (sur Rousseau, Corday, Cazotte, Law...) et à des ouvrages sur l’ésotérisme, n’écrivant que de rares romans à connotation fantastique.
Comme nombre d’écrivains et reporters de cette période de l’entre-deux-guerres qui cherchèrent autant à comprendre l’étranger qui fascine ou inquiète et ce qui a pu justifier un conflit aussi meurtrier, qu’à mettre à l’épreuve de la réalité le bien-fondé de certitudes ancrées et les stéréotypes, René Trintzius est parti à la rencontre de ses voisins d’outre-Rhin. Dans la mouvance d’une littérature française éprise de germanité (Siegfried et le Limousin »,...), il publie en 1929 Deutschland, roman qui nous plonge dans une Allemagne étonnamment redressée, d’une audacieuse modernité, en pleine effervescence cosmopolite, et dresse le portrait de l’Allemande moderne : « Les guerriers d’hier (...) sont remarquablement absents puisque, du haut en bas de l’échelle, c’est la femme qui s’exhibe, qui commande, qui règne. »
Le narrateur, un jeune provincial d’Aigles de 24 ans prénommé André, couvé par ses parents et cœur d’artichaut (« Je suis né avec mal au cœur et le mal change de place, voilà tout »), est un personnage qui n’inspire a priori pas de sympathie : plutôt immature et velléitaire, frileux, il est indécis, méfiant, mais aussi d’une ironie critique aiguisée, conscient de mener une existence calfeutrée et étriquée. Son affection va bien plus à sa tante, forte femme, qu’à ses parents auxquels l’unissent « des rapports chloroformés amortis par l’habitude ».
C’est donc avec soulagement qu’il accueille l’occasion, présentée par son hôtelier de père, d’aller suivre en Allemagne, chez une de ses connaissances, un stage d’hôtellerie et d’allemand. Pendant le long voyage en train, il remâche souvenirs (« Mon passé est comme un ver solitaire que je ne peux pas, que je ne veux pas rendre. ») et réflexions prud’hommesques : « L’amour en France est comme la cuisine : on sert tout par plats séparés » ou « France ! Je sais bien que tu es autre chose que ces petites âmes ratatinées, après l’effort fou de la guerre ! »
Il voit sa vie comme un grand ratage et « peut-être, si ma vie devient différente de l’autre côté du Rhin, comprendrai-je davantage ce qu’elle fut ces derniers temps ».
Arrivé à destination — une petite ville de Basse-Saxe — et chaleureusement accueilli par son hôte M.Nachtlicht (qu’il traduit malicieusement « M. Lumière de la nuit »), il est impressionné par la « magnifique hospitalité allemande », la propreté, la modernité urbaine et la logistique domestique (« je suis malade de peur en constatant que rien n’est laissé au hasard et je me demande où peut bien s’être caché ce tout-puissant hasard qui m’a servi d’oreiller, à moi et à la France, depuis au moins 25 ans »). Il n’en reste pas moins ébahi par certains us locaux, tels que manger et boire en quantité, à toute heure : « L’Allemand ne renoncera jamais à estimer, avec Hegel, que la qualité peut être atteinte par la quantité. C’est par là qu’il semble rejoindre l’Amérique. »
Le début du stage est toutefois reporté, car il est invité pour un court séjour chez des amis de son hôte, les Ginster, où tout l’enchante ou l’étonne : le confort des lieux va de pair avec la franchise des propos et l’intimité offerte de l’appartement. Mais surtout le subjugue la beauté de la nièce des Nachtlicht, Ingrid, qui s’occupe de lui en l’absence de ses oncle et tante (chose inimaginable en France). Comme Pierre Mac Orlan ou Paul Morand croquant les portraits des « femmes nouvelles », René Trintzius trace, avec Ingrid, celui de l’Allemande moderne rompue à tous les sports et adepte de danse et de nudisme.
Francophone, Ingrid cite Voltaire et est friande de littérature contemporaine française ; elle gagne fort bien sa vie en créant et commercialisant des objets décoratifs qu’elle vend même à l’étranger. Il note qu’elle le convie à « le suivre » et non à l’« accompagner » en promenade et se retrouve au Stadion, où sa frilosité et son incompétence le ridiculisent devant l’athlétique sportive pénétrée d’une « mystique de l’hygiène », qui lui accorde tout de même — mais sans émoi et « déçue par une nullité sportive sans précédent » — qu’il peut bien être son 23e fiancé.
Dépité, André conclut : « Je dois être encore plus Français, plus bourgeois, plus mesuré que je ne pouvais le croire. » Il est bien désorienté, d’autant que, selon Herr Ginster : « Il y a au moins six Allemagnes... bien plus mélangées qu’on ne le croit : les Nibelungen, le Saint Empire Germanique, la musique allemande, le romantisme, l’ère prussienne et die neue Sachlichkeit [NdR : la nouvelle conception objective], qui n’est pas froide du tout. »
Lors d’une soirée costumée chez les Ginster, André rencontre Anna Herzberghauer, une amie d’Ingrid un peu exaltée, lectrice d’un Cocteau si mal vu à Aigles, qui l’« enlève » pour une promenade nocturne et le conquiert par son originale personnalité de « violon sauvage » : « Une telle conscience mélangée à tant de spontanéité me plongea dans la stupéfaction. En quel siècle vivaient donc les jeunes filles d’Allemagne ? »
Il est fasciné par ce feu follet, mais se sent « gauche et couard » dans un contexte étranger — à divers titres — à sa province étiolée : « Je ne perdrais donc jamais ma prudence désordonnée. »
Comme le remarque Anna, « vous êtes habitué aux Françaises, des esclaves qui sont obligées de cacher leur puissance sous une bonne dose de sourires ». Tous mettent en garde le narrateur : Mme Ginster (« Les jeunes filles de chez nous sont très dangereuses, faites attention ») ou le Dr Falkenstein (un des « fiancés » d’Ingrid dont la femme, parfaitement autonome, dirige une importante maison de parfums germano-américaine exportant en Europe et en Russie et est par ailleurs une photographe talentueuse) : « Chez vous (...) la femme est encore la proie. Chez nous, c’est l’homme. » Ou : « Nos femmes ne supportent plus qu’un homme se jette à leurs pieds. Cela les humilie de façon cinglante. »
Mais pour le jeune homme, il s’agit d’« un danger qui prouve qu’on s’intéresse à moi, que je compte, que j’existe, que je suis une force dans ma faiblesse »…
Aussi se lance-t-il dans une brève aventure rocambolesque où, subjugué par la franchise d’Anna « qui relègue au grenier des accessoires tous les marivaudages », parlant de son corps « comme d’une automobile ou d’un paysage », il se laisse tour à tour fiancer puis rejeter dans le plus pur esprit des « jeunes filles dominatrices comme l’Allemagne d’aujourd’hui en sécrète ». Comme le souligne Falkenstein, « ces femmes nouvelles veulent nous conduire et elles n’ont pas de gouvernail, puisque tous les gouvernails en usage, fiançailles, mariage, institutions de toute sorte, sont essentiellement masculins ».
C’est un André littéralement choqué qui part en train à Berlin en compagnie d’un cousin poète (et platonique soupirant) d’Anna, Fiedler, qui tente de trouver une explication aux contradictions de sa fantasque cousine : « La seule façon que les femmes ont trouvé pour sortir de leur esclavage c’est de brûler les étapes mais justement, les sentiments vont moins vite que le temps. »
Par un froid intense, André se jette avec Fiedler dans les vertiges d’une vie berlinoise bouillonnante, en pleine effervescence artistique, sans tabou de genre ni de sexualité (« visage et corps se tenaient dans un équilibre indéchiffrable et le plus juste entre les deux sexes. »).
S’il le fascine, ce tourbillon l’inquiète, car dans les journaux « la rubrique des suicides est bien remplie », on compte des centaines de décès quotidiens dus à la grippe et comme l’a magistralement décrit Döblin dans son roman « Berlin Alexanderplatz » — paru aussi en 1929 — le petit peuple berlinois souffre en cette difficile période de Weimar. Les fractures d’une société en crise sont évidentes, comme en Basse-Saxe où André avait vu « sur une palissade de deux cents mètres des lettres communistes d’un mètre de haut [qui] injuriaient la République ».
De passage à Berlin, Anna recontacte le narrateur, qui la revoit d’autant plus facilement qu’il s’avère que l’affection de Fiedler, à la personnalité opaque, est pour le moins trouble, et que leur relation s’apaise, évoluant en une clairvoyante camaraderie, « quelque chose de prodigieux... dont je savais qu’aucune Française (...) ne m’avait ni ne m’aurait jamais gratifié ». Mais l’aventureuse Anna, qui se livre avec Fiedler et un autre comparse à des recherches dignes du Dr Caligari, va disparaître de la vie d’André qui va revenir à la version lumineuse de la femme émancipée, Ingrid.
Laquelle neue Frau « indéchiffrable et rose » a fui en un lointain voyage. Que la fugitive lui échappe excite la passion du jeune homme, qui apprend qu’elle est la passagère d’un raid aérien de 40 000 kilomètres : fi du train ou de l’automobile, quand on recherche une abondante couverture médiatique et la célébrité. Et le narrateur, moins empoté qu’au début de son séjour, affermi par une « lucidité nouvelle », se jette avec une femme d’exception dans une vie intense et médiatisée.
A l’écart — à quelques mentions près — des aspects sombres de la République de Weimar (occupation de territoires par les puissances étrangères ; crise économico-financière, sociale, politique ; éclosion du nazisme ; montée de la xénophobie et de l’antisémitisme,…), le roman de René Trintzius se focalise, entre amusement et admiration, sur la « femme nouvelle », dans deux versions opposées aux caractères bien trempés, qui sont des doubles romanesques d’aventurières et héroïnes des Années Folles. Aussi son titre — Deutschland — peut-il étonner.
Il n’en reste pas moins que sous l’apparente désinvolture ironique de son Candide, l’auteur analyse avec finesse tout un contexte social et psychologique. Il restitue avec pertinence les interrogations de qui va à la rencontre de l’Autre dans son étrangeté et remet en cause ses certitudes : André certes, mais aussi les Ginster et Herzberghauer (juifs parfaitement intégrés dans la bonne société allemande) qui ont l’image de « cette France idéale qui, je le sens, obsède l’Allemagne d’un amour à la fois transi, irrité, irritant et malheureux ».
Tout anodin, trivial ou rocambolesque qu’il puisse paraître, le récit laisse percer la gravité du propos et résonne avec des questions d’actualité...
Marie Coat — Janvier 2023

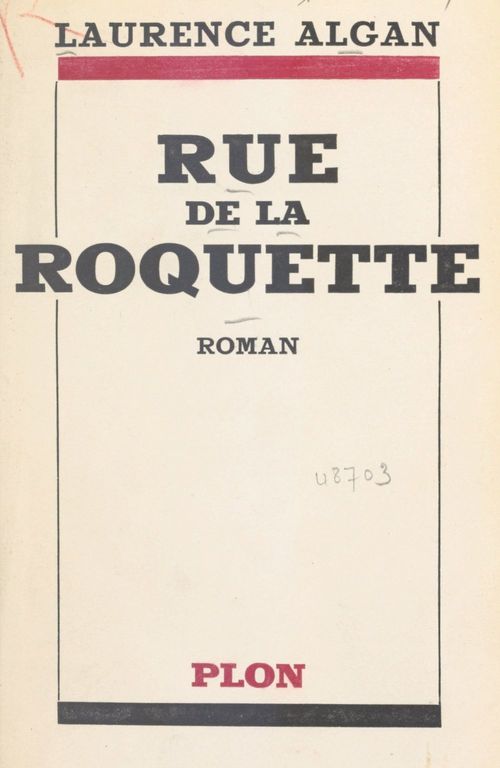
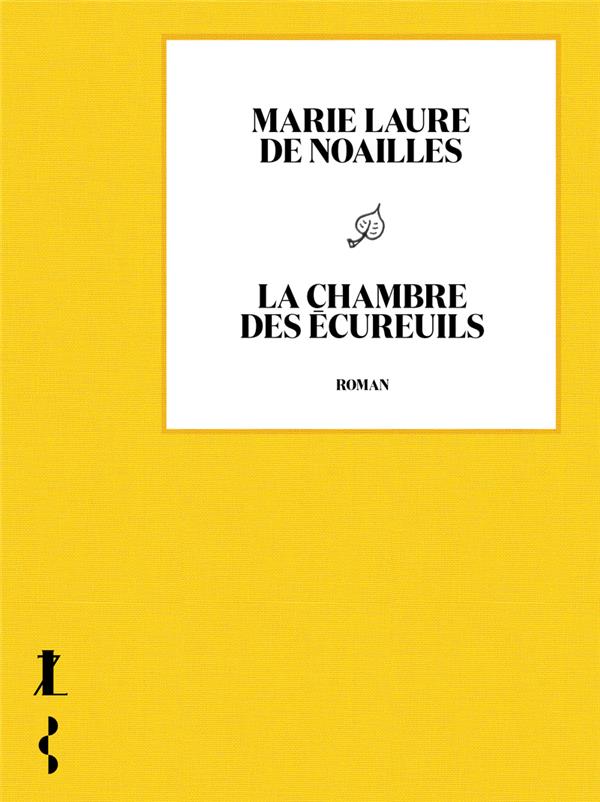
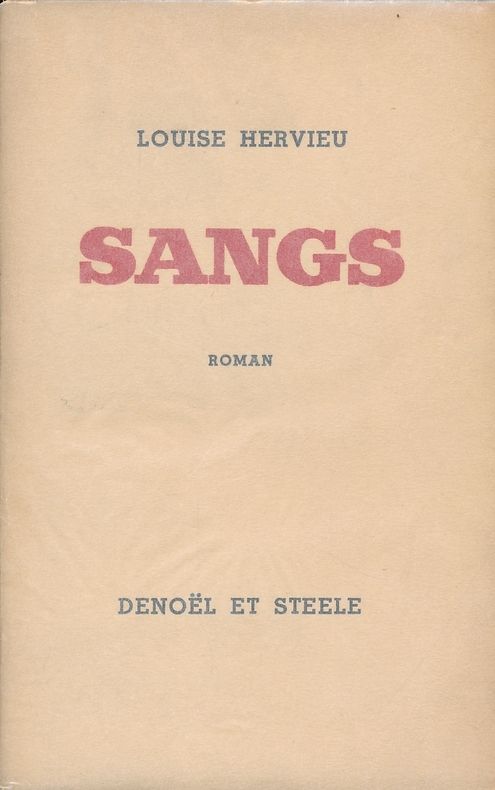
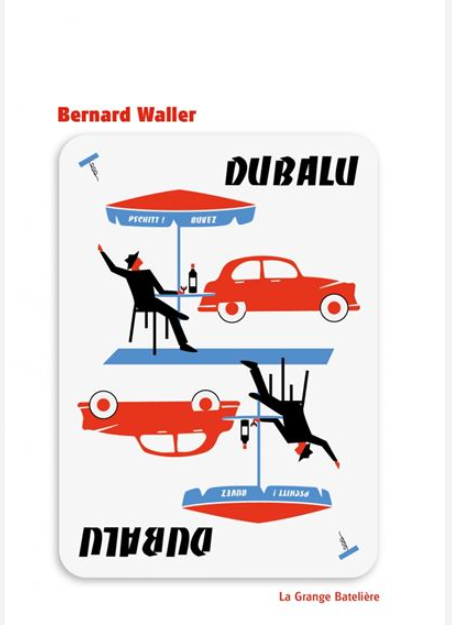
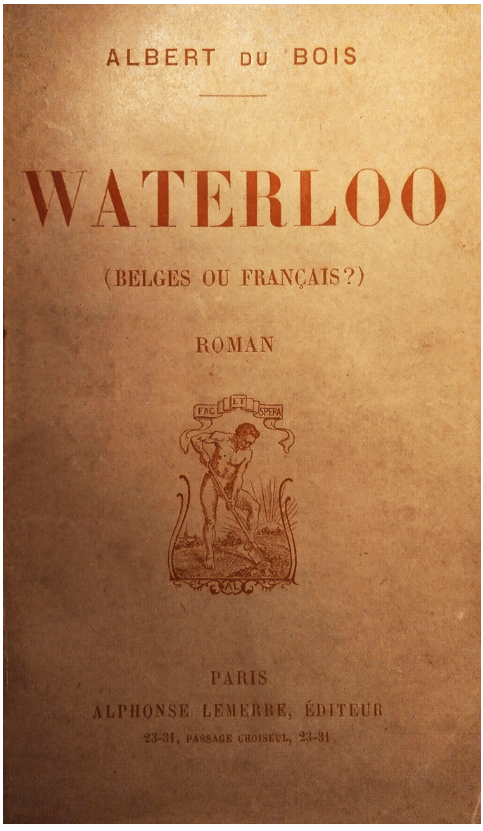

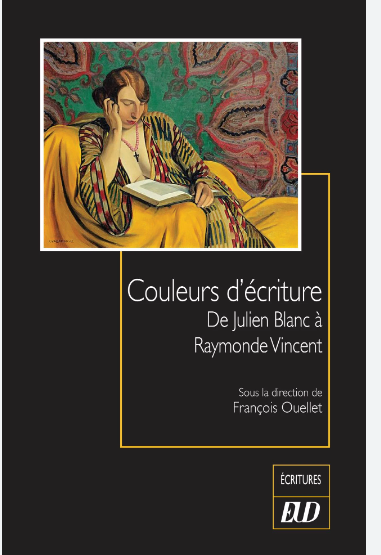
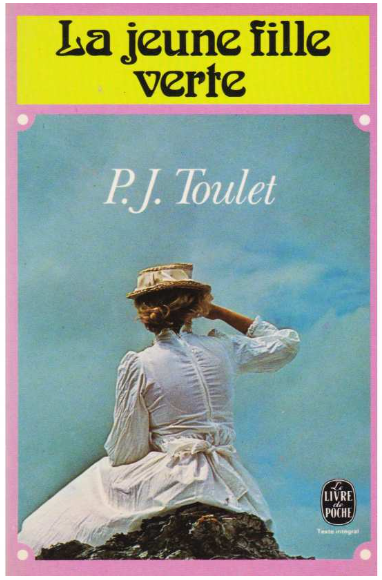
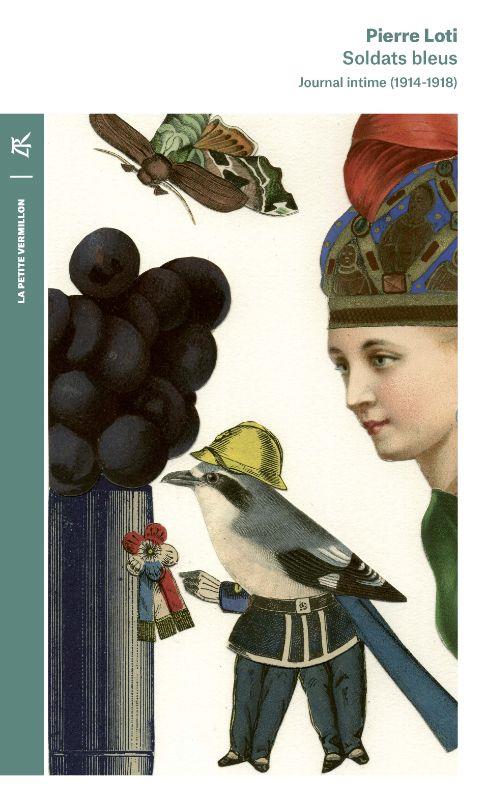
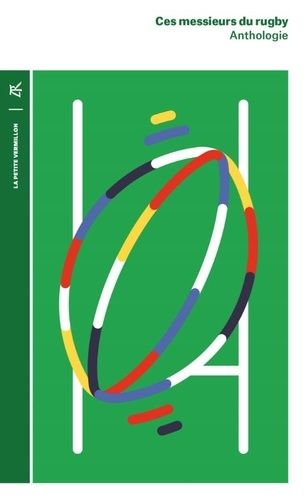
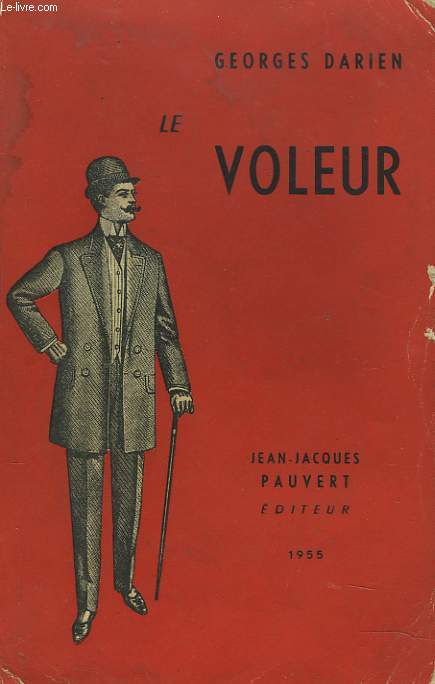
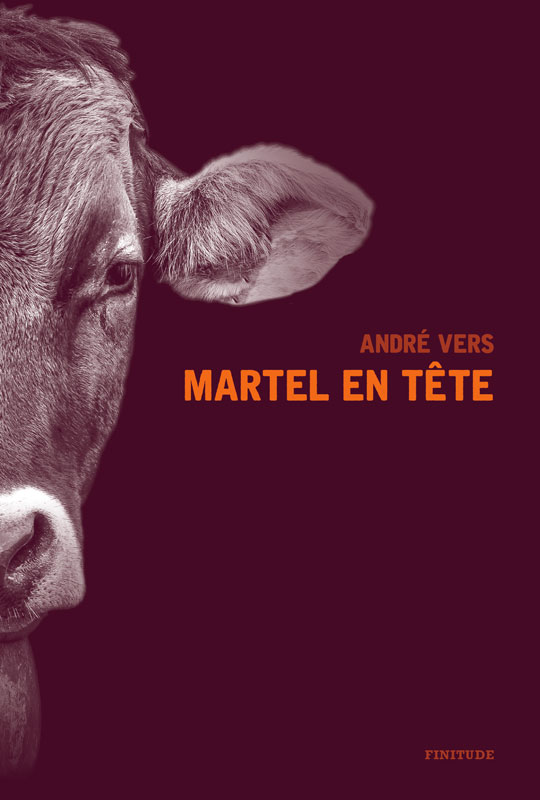

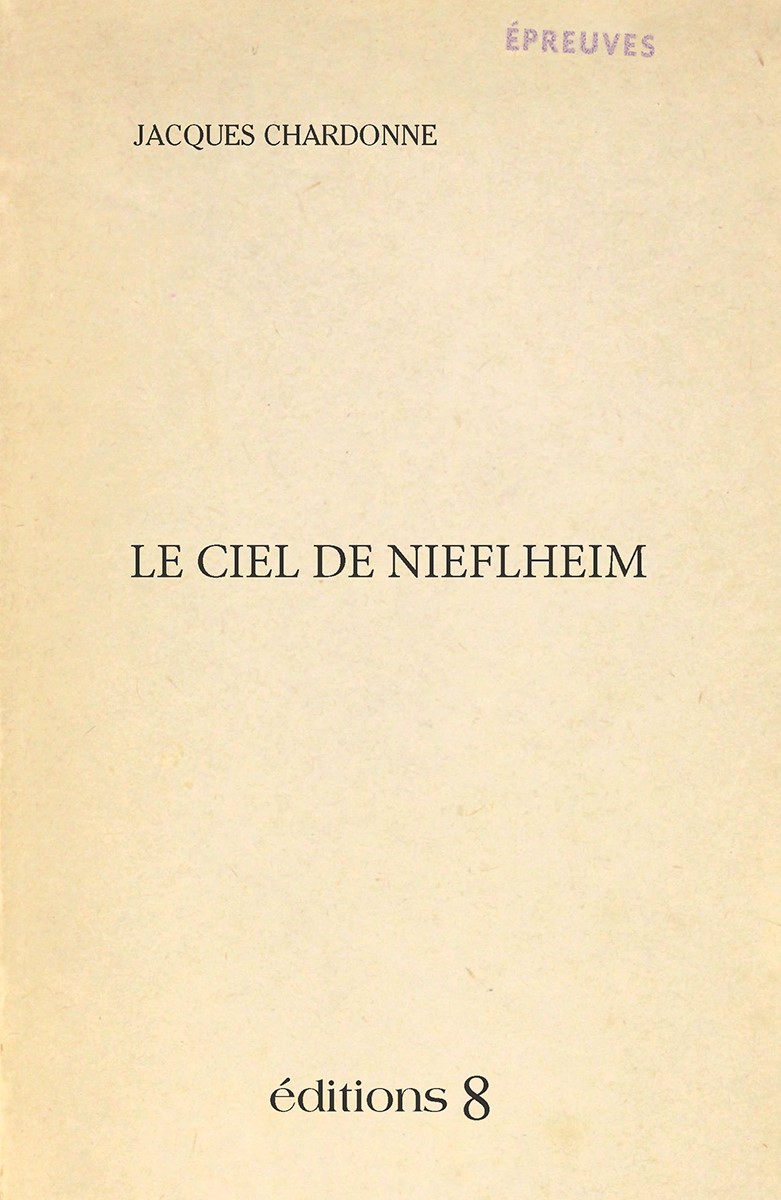
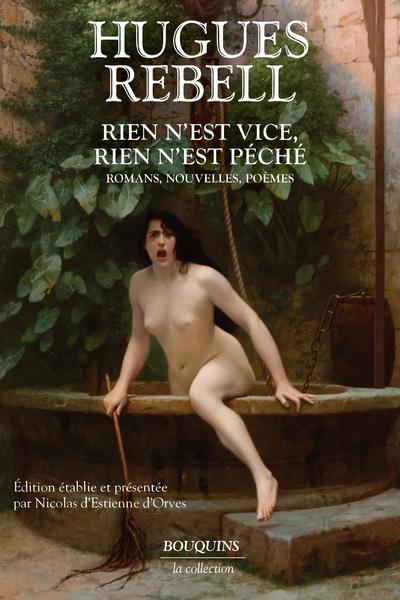
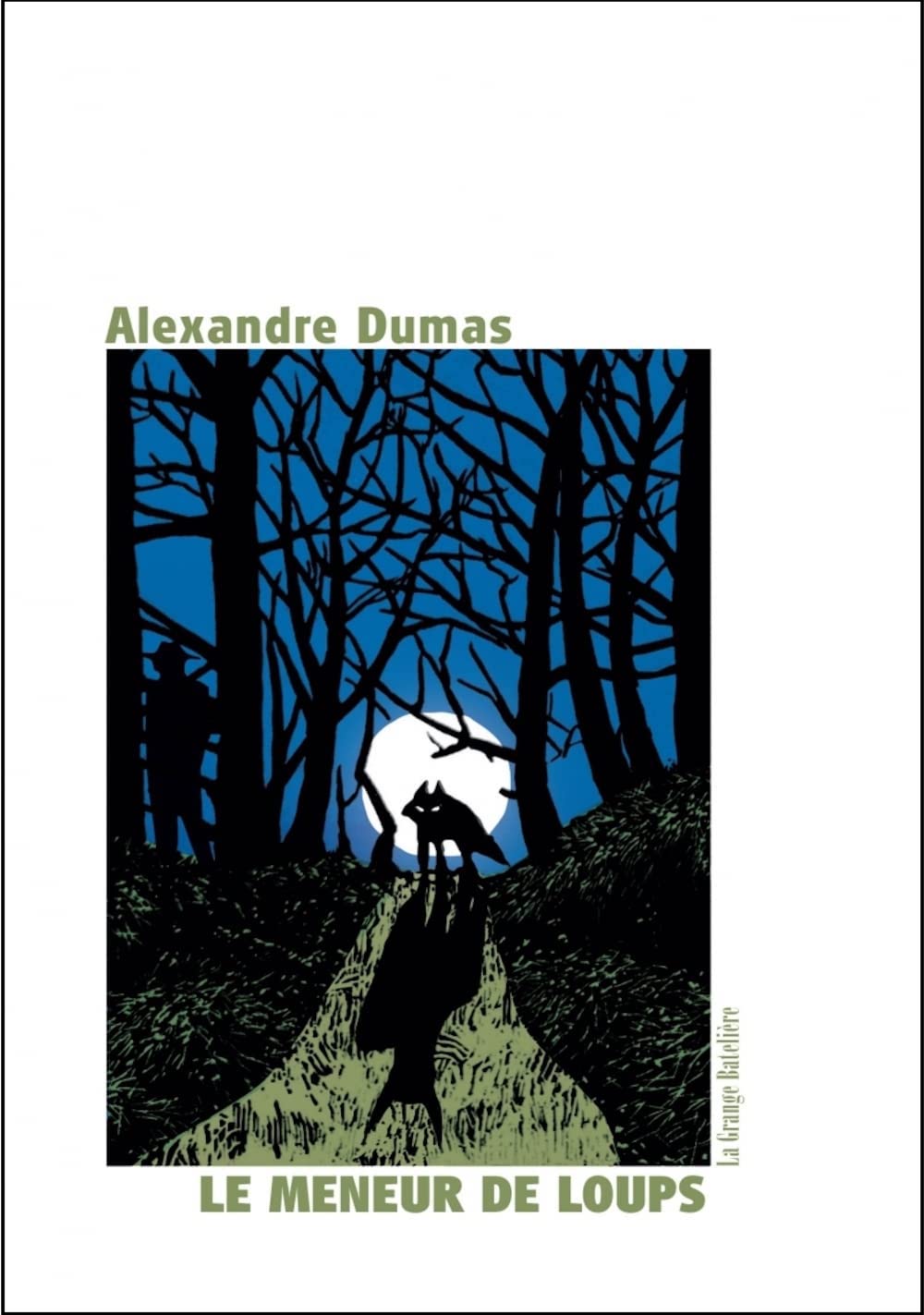

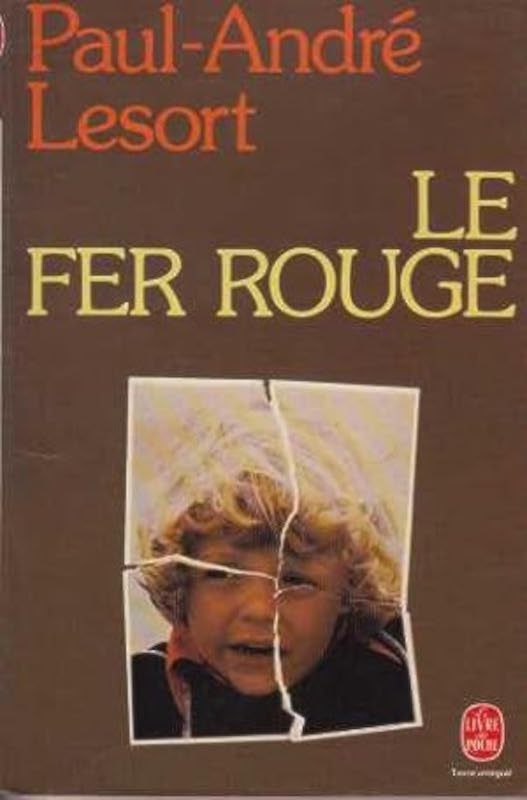


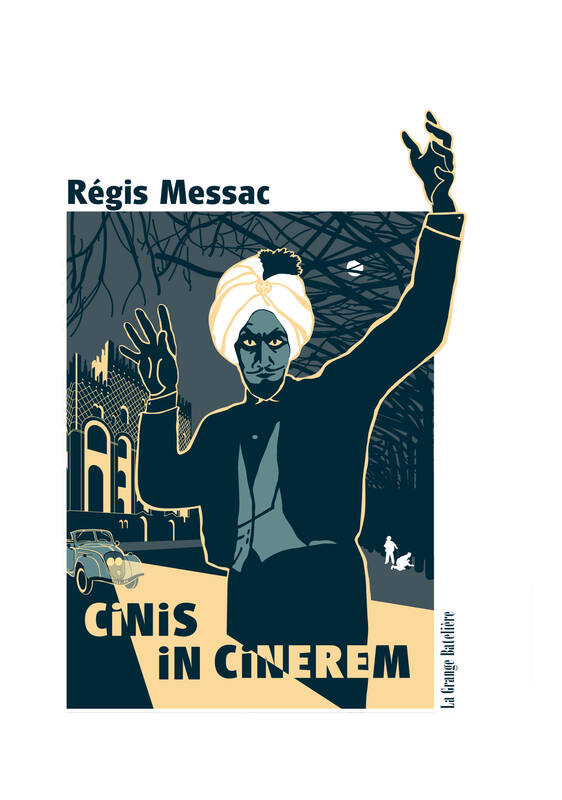

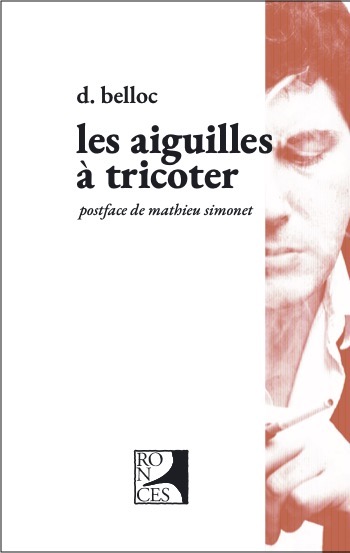
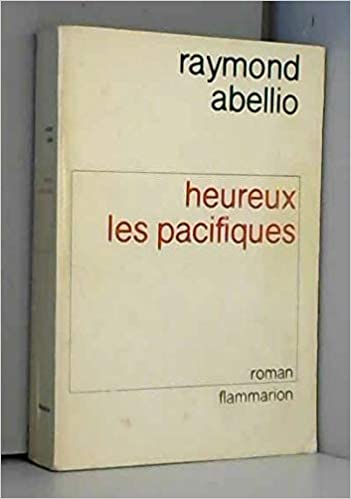
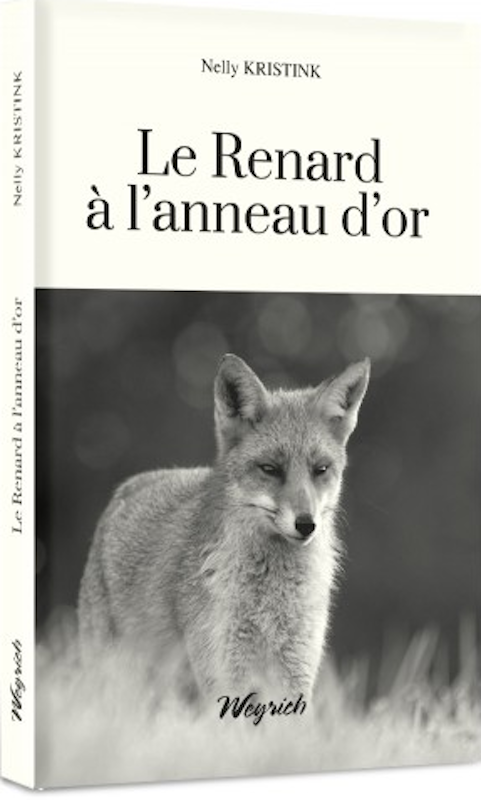
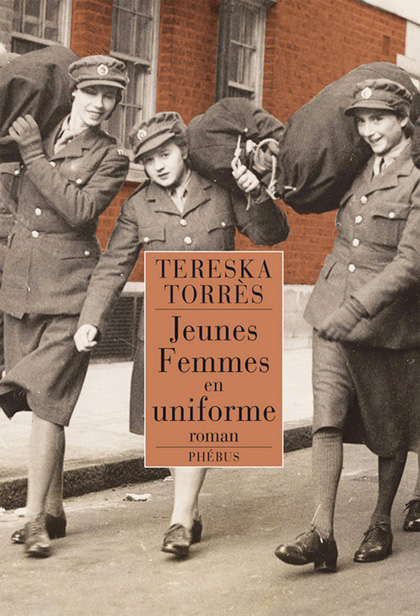
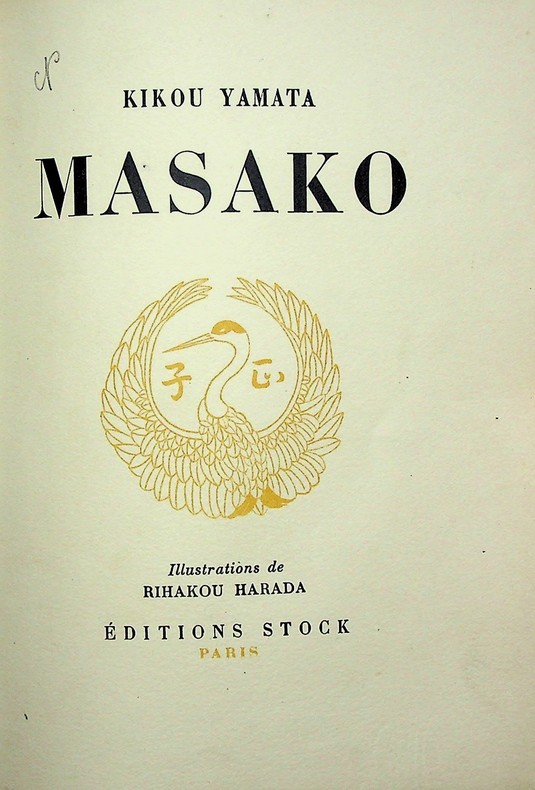
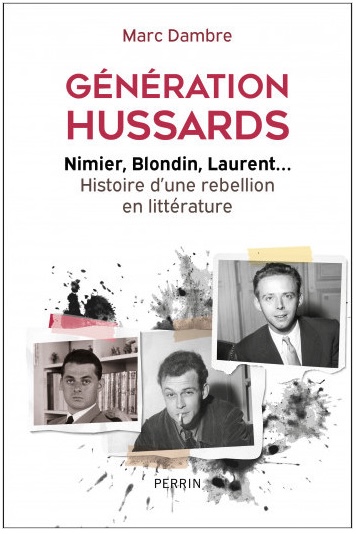
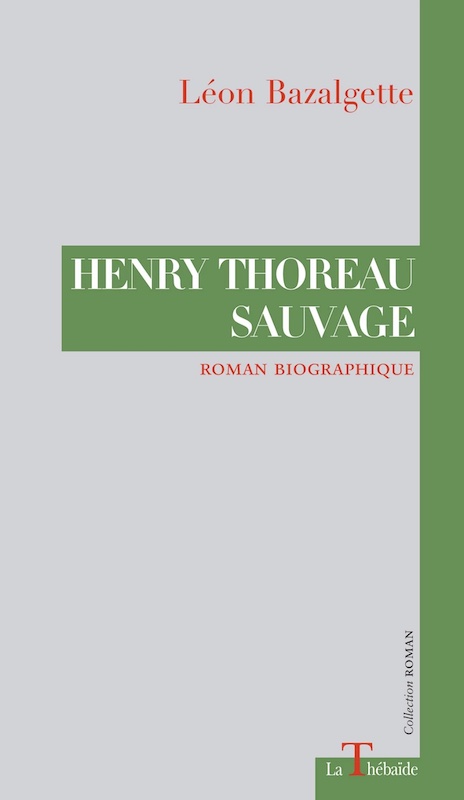
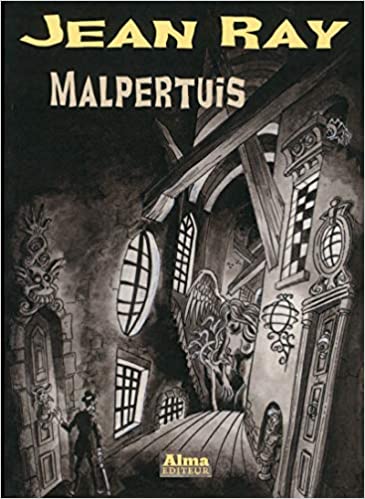
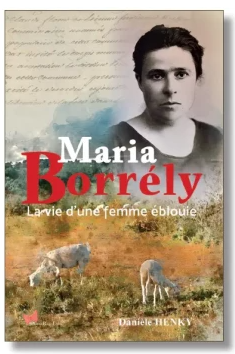
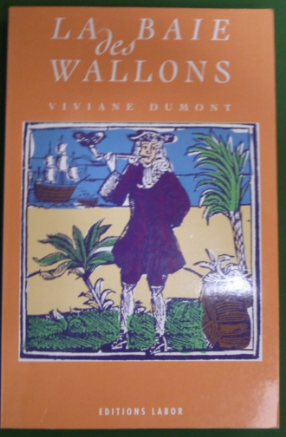

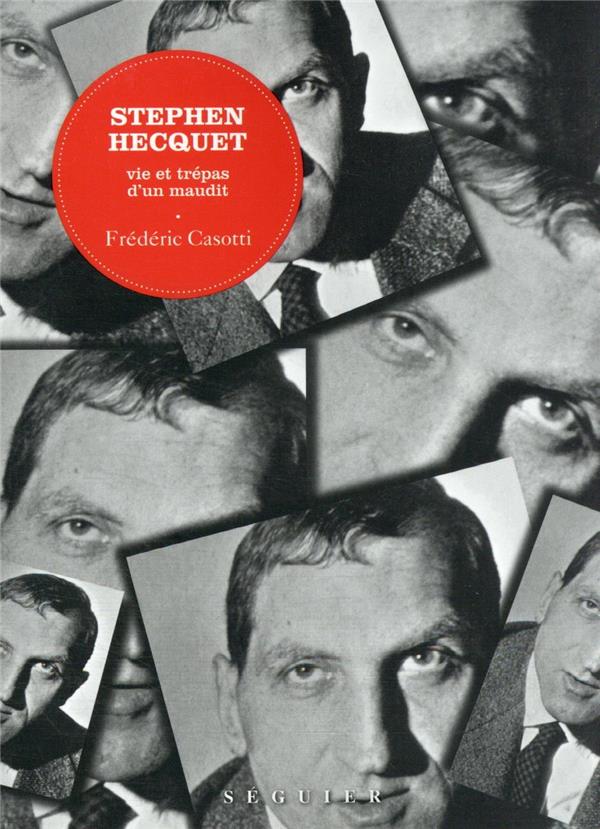

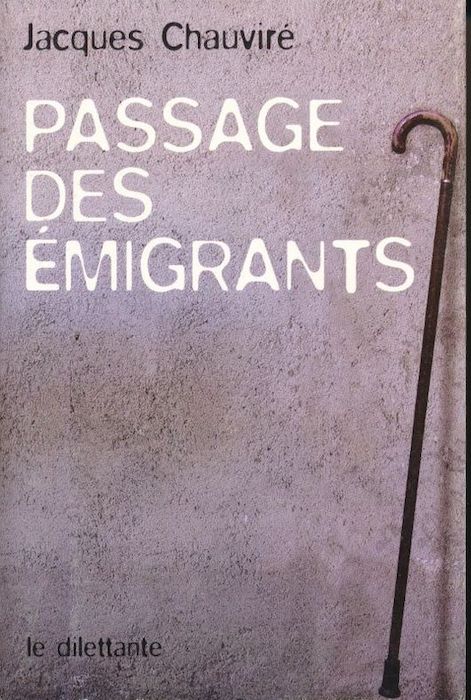




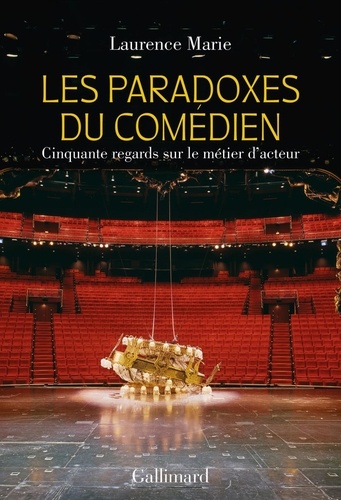
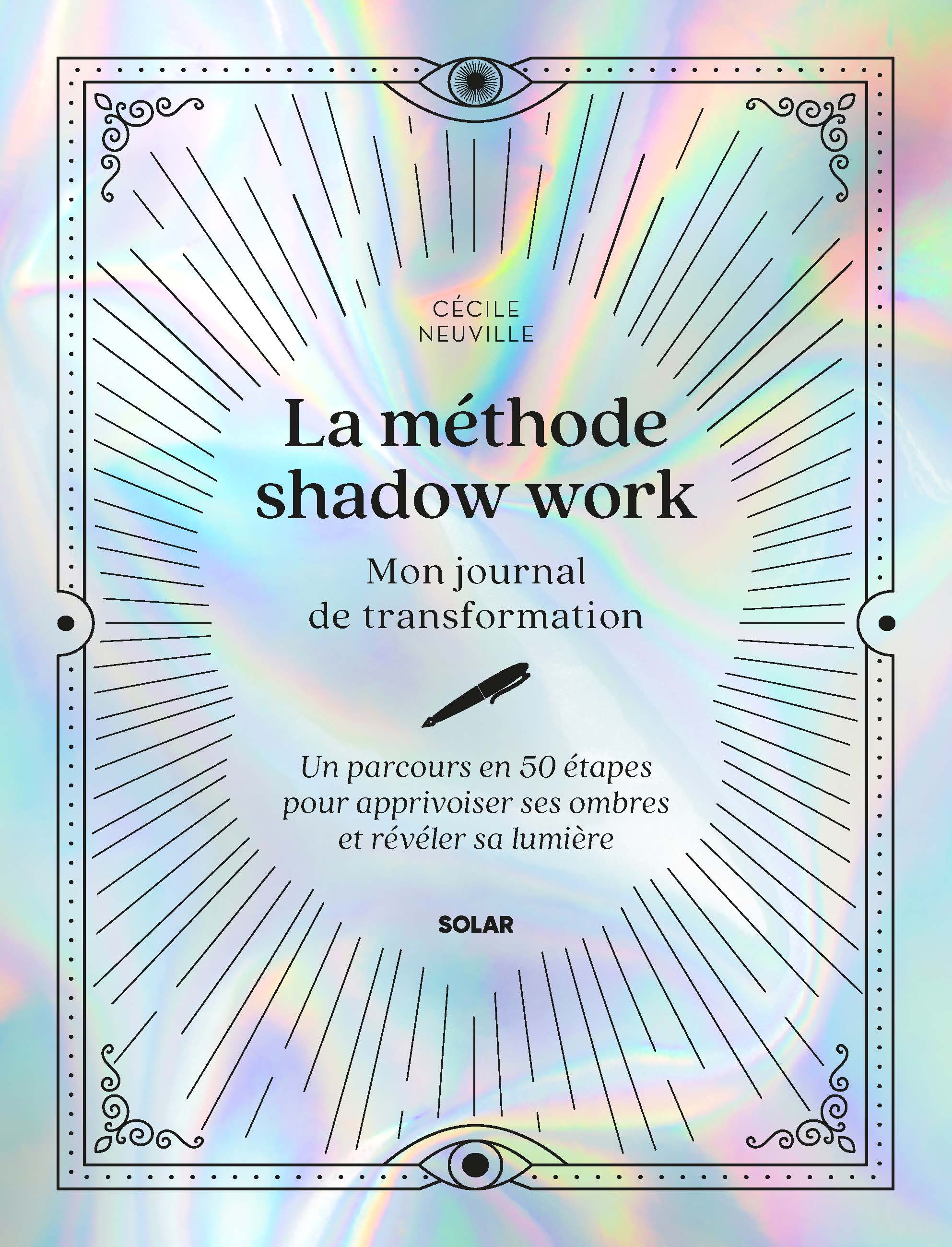


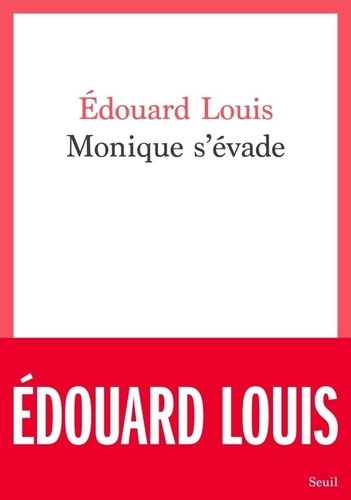
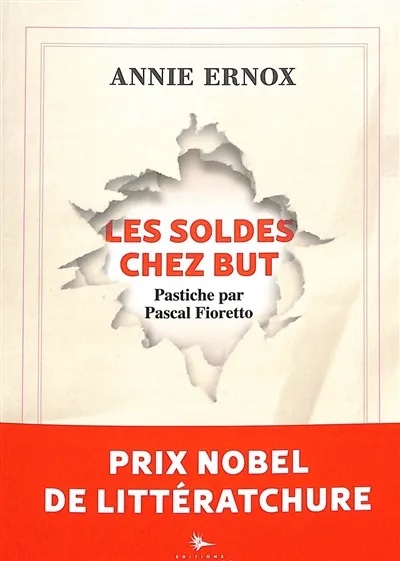
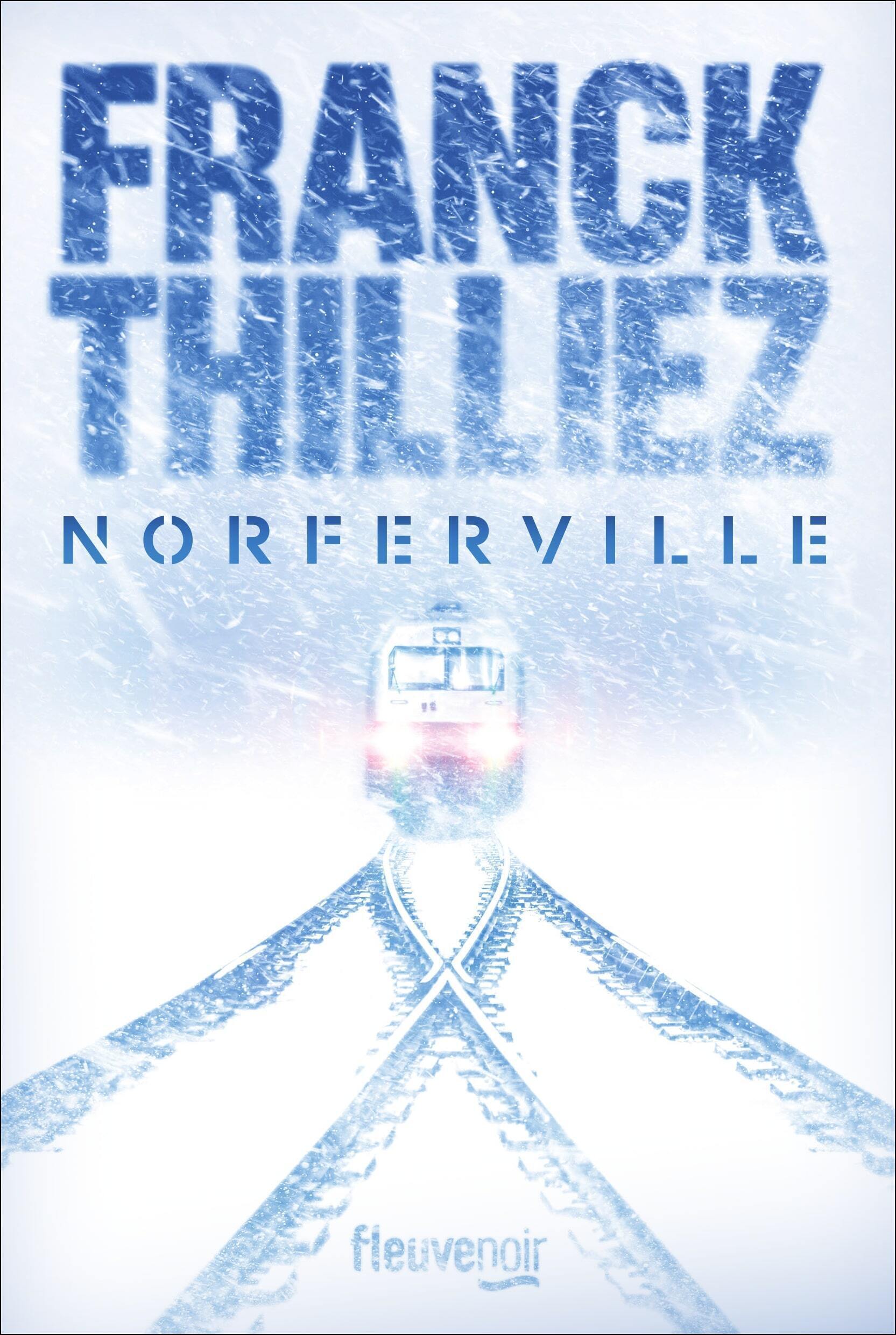
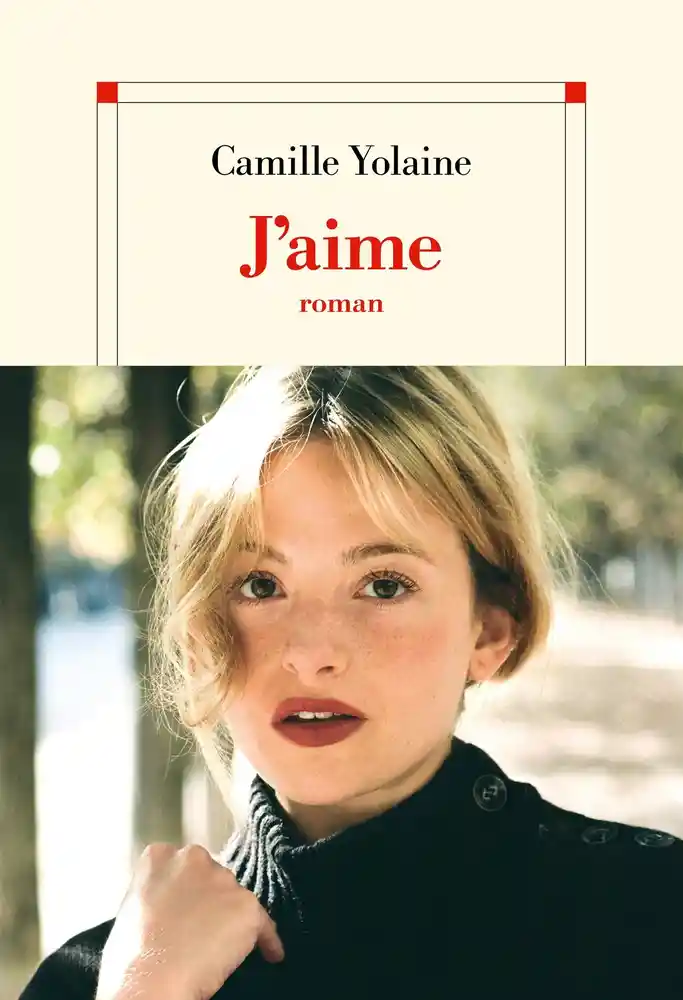
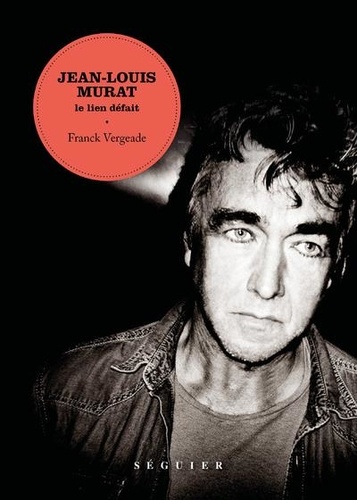
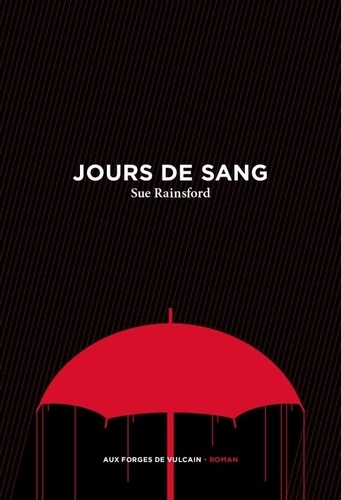







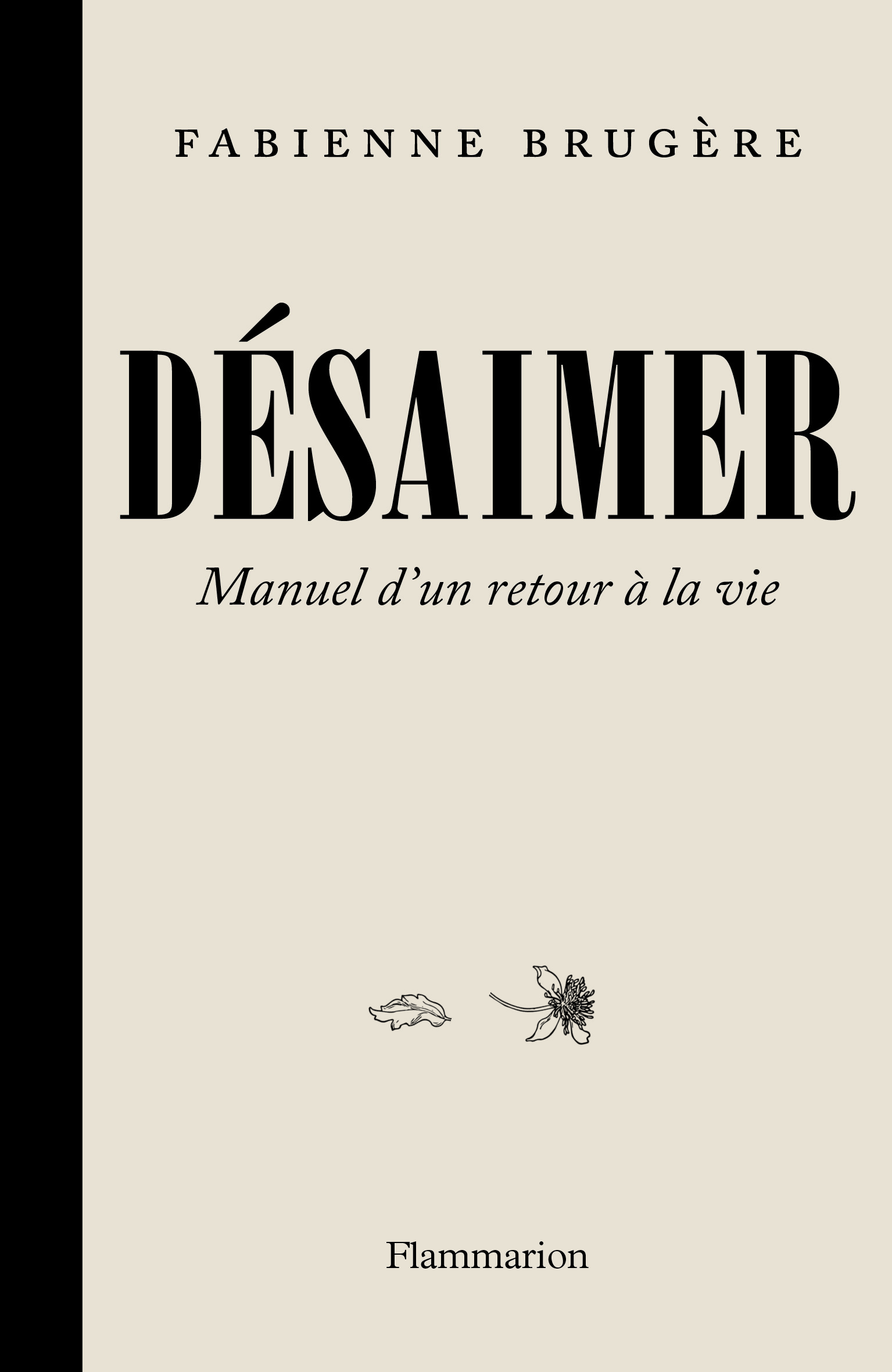
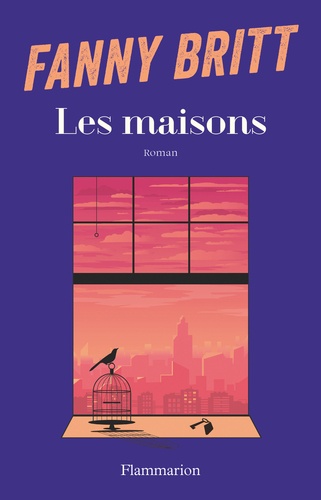



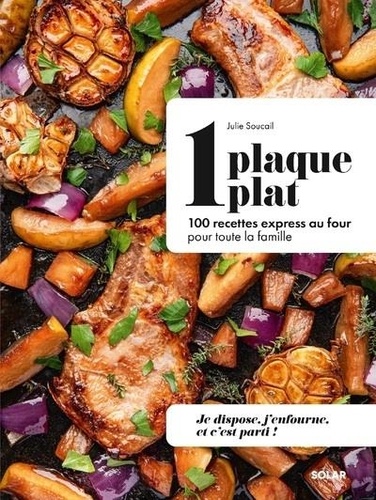
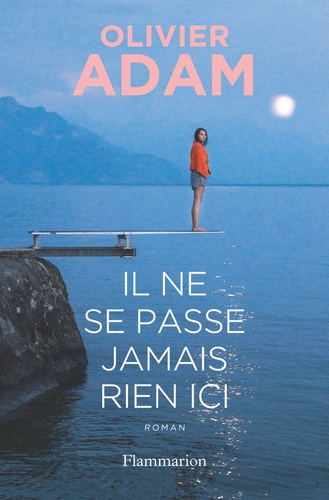
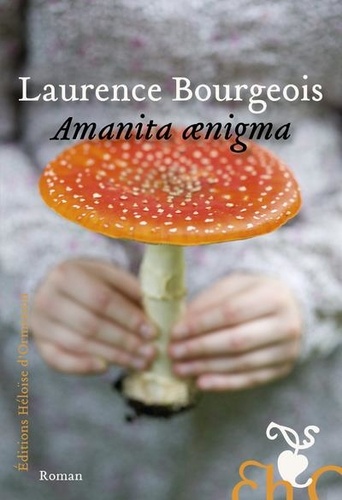



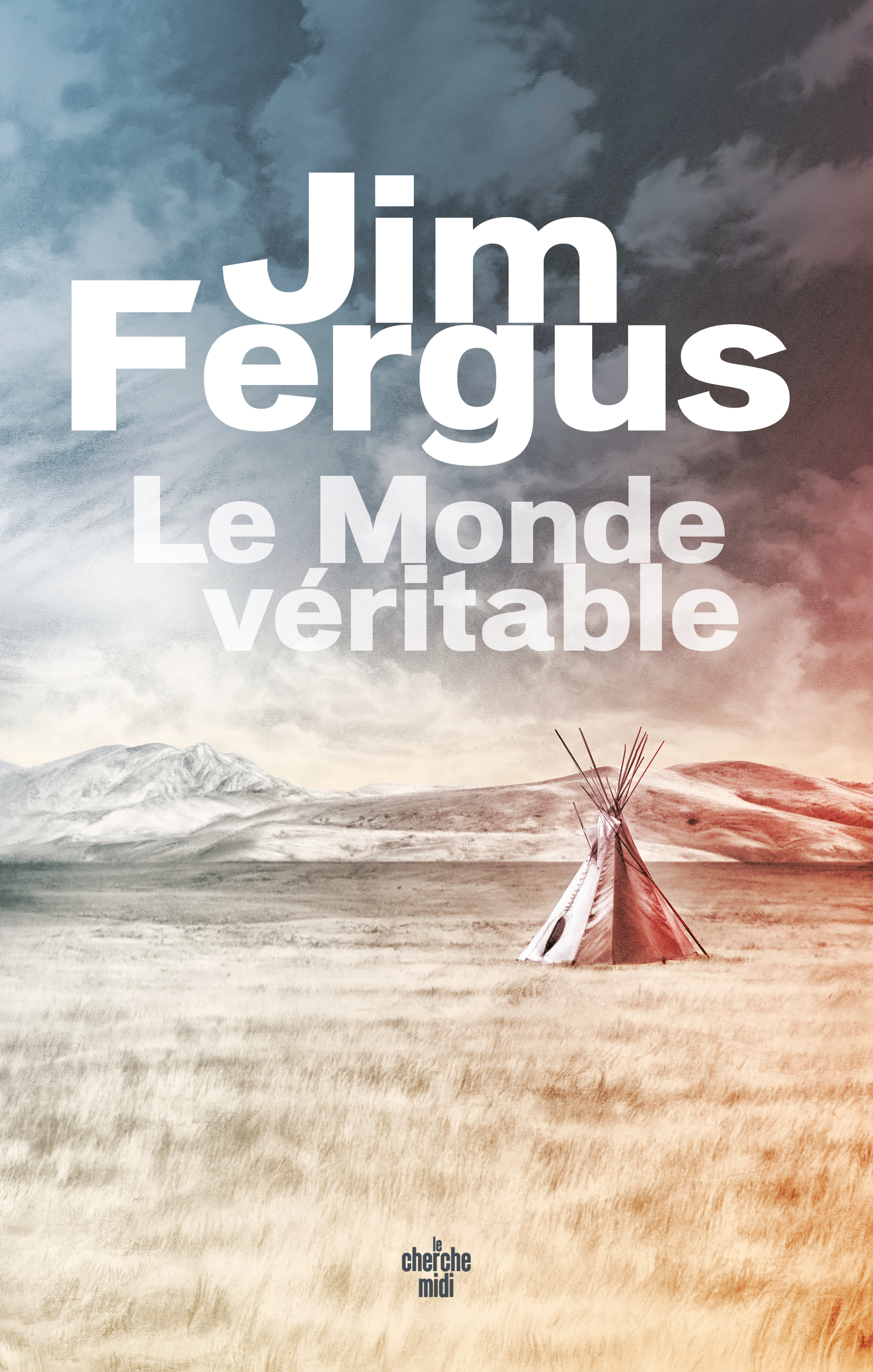

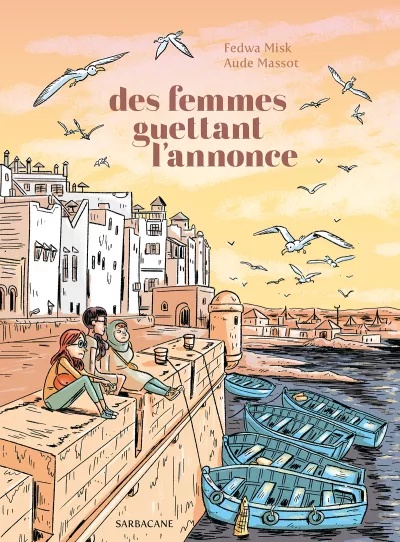

1 Commentaire
Trintzius Bernard
07/02/2023 à 11:35
Fils de René Trintzius, je m'intéresse à son oeuvre que j'ai pu découvrir et apprécier vraiment bien après son décès prématuré. En compagnie de mon épouse, je rassemble depuis des années ses textes publiés ou non et tout ce qui est de l'ordre de la réception critique de ses publications. J'ai donc lu avec beaucoup d'intérêt votre article qui témoigne d'une lecture précise et profonde à la fois.
Des universitaires allemands (à Berlin) ont été eux aussi intéressés par ce livre dont leur pays a été "privé" peu après sa parution dans les circonstances que vous connaissez (en France, c'est l'occupant qui s'est empressé de l'interdire). La réédition par Phébus (1995) a suscité de l' intérêt outre-Rhin et plusieurs articles auxquels j'ai eu le plaisir d'apporter quelques matériaux. Quand on lit Deutschland aujourd'hui, on mesure mieux l'incroyable catastrophe qui a mis à bas tant d'espoirs, tant de potentialités entrevues par mon père, notamment, comme vous le soulignez, sur la question du féminisme. Merci pour votre texte !
Bernard Trintzius