Les Ensablés - Soldats bleus, journal intime (1914-1918) de Pierre Loti
A priori, publier le journal intime de Pierre Loti, sur la période couvrant la Première Guerre mondiale relève de la gageure, tant le style et l’œuvre de cet écrivain sont aujourd’hui passés de mode. Sa ferveur patriotique, sa soif d’en découdre avec l’ennemi, qui le pousse, alors qu’il a dépassé l’âge d’être mobilisé, à faire intervenir les plus hautes autorités, pour prendre part malgré tout à la guerre, nous est difficile à comprendre. par Carl Aderhold
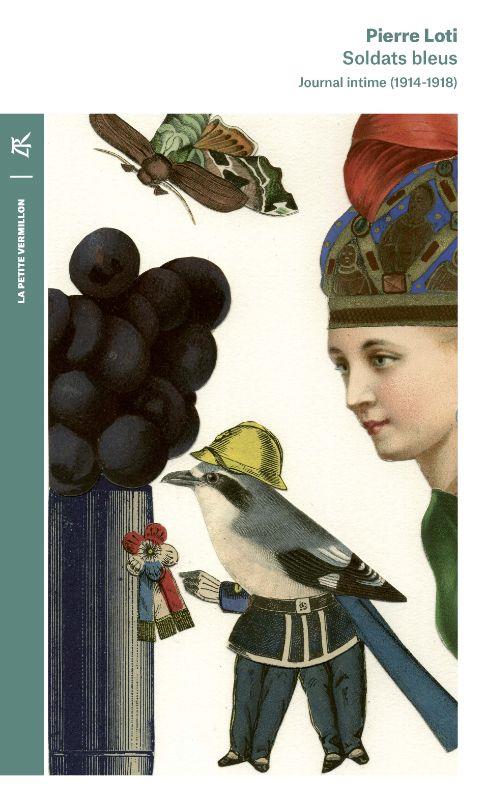
Qui plus est, les articles publiés par Loti dans L’Illustration témoignent jusqu’à la caricature de cette littérature de « bourrage de crânes » qui fait de la haine du Boche un paradigme qui nous apparaît aujourd’hui aussi ridicule que sinistre. « N’oublions jamais que cette race de proie est incurablement trompeuse, voleuse et tueuse, qu’il n’y a pas avec elle de traité de paix qui puisse tenir », écrit-il ainsi en septembre 1915.
Mais s’arrêter à la lecture de ces articles que les éditeurs ont eu la bonne idée d’insérer à la suite des notes prises par Loti et qui ont servi à leur rédaction, serait courir le risque de passer à côté de la force du journal de l’écrivain.
Au contraire, il faut les prendre pour ce qu’ils sont : l’écume de l’œuvre, tout à la fois littérature de surface, le Loti « officiel » en phase avec la propagande de son époque, et moyen de mesurer la distance avec l’autre, le créateur instinctif, débarrassé de l’apprêt vieillot, sincère avec lui-même, au regard pénétrant.
Car avec Loti, les choses ne sont jamais complètement ce qu’elles semblent être. Il y a chez lui, une complexité, une ambiguïté pourrait-on dire, qui rend le personnage attachant. Militaire dans l’âme, fier de ses décorations, il est aussi l’officier qui porte des uniformes flamboyants. Dans l’introduction, Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier rappellent que « dans les popotes de l’armée de terre, on ne se privera pas de ridiculiser ce marin-littérateur, bizarrement accoutré de défroques de mer sur son uniforme de guerre, dont il change sans cesse, et fardé comme à son habitude ! »
Pour Loti, l’apparence compte autant que l’action. A la date du 21 juillet 1917, il note à propos des officiers de marine qu’ils croisent: « Les jeunes seuls sont tout en blanc, - comme moi qui m’obstine à être jeune ». Il ne s’agit pas là d’une fantaisie ou d’une lubie mais bien d’une revendication tout autant artistique que philosophique, le refus de la réalité sans fard, la volonté obstinée non seulement d’en débusquer les interstices romanesques mais plus encore de les provoquer.
Contre la brutalité et la sauvagerie de la guerre, Loti affirme la liberté de l’homme à s’inventer un autre monde. Qu’importe que le kitsch de son imagination, le caractère parfois naïf ou passéiste de ses rêves, la force et la beauté de Loti résident tout entier dans ce refus de capituler devant la réalité. En témoigne la scène incroyable où, parti à la recherche de la tombe d’un proche tué au combat, il erre dans un de ces cimetières improvisés et se retrouve en première ligne sous le feu des batteries allemandes.
Loti mène sa guerre à lui qui n’a rien à voir avec celle des états-majors. Contre les boucheries de masse, les armes de destruction moderne, les effrayantes inventions techniques, Loti cherche désespérément les actions héroïques, les exploits des hommes qui sortent de la norme anonyme des combattants. Il s’agit pour lui d’une lutte pied-à-pied contre une modernité qu’il pressent destructrice pour l’aventurier, et plus largement pour l’individu. Au-delà de la haine de l’Allemagne, il mesure le danger mortel de cette guerre. « Nous autres civilisations, savons que nous sommes mortelles » disait Valéry au sortir du conflit.
Loti est plus pessimiste encore. « Et dire qu’il y a de pauvres esprits à visées courtes pour célébrer les bienfaits de la science, écrit-il lors de sa visite à Venise en guerre, dire que l’humanité n’a pas édicté les lois qu’il aurait fallu pour étrangler à temps des inventeurs comme ceux de la guerre sous-marine ou de l’aviation ! » Il entrevoit même une guerre à venir où les techniques et les sciences auront raison de la civilisation.
Sa dénonciation du progrès est avant tout portée par son exigence de beauté. Cette beauté que Loti a traqué toute son existence à travers le monde. A le lire, on retrouve l’angoisse qui saisit les explorateurs et autres aventuriers au début du XXe siècle face à la disparition des dernières terra incognita. Le progrès n’a eu de cesse que de faire reculer le mystère et son merveilleux. Loti est le témoin sensible, émouvant de cette fin de partie. Lorsqu’il prend ses quartiers à Mirecourt, en août 1916, il note : « Jamais je ne m’étais senti si dépaysé que là, dans ce cadre d’ouvrier enrichi, dans une petite ville qui n’est même pas exotique, mais quelconque de la France. Il ne me semble pas que c’est moi, qui suis là… »
Ce qui donne une intensité particulière à ce chant du cygne, c’est qu’il se double d’une angoisse personnelle qui court tout au long des pages de ce journal. La mort qui plane au-dessus des soldats, qui fauche des millions de vie est aussi la sienne qui s’annonce. Loti mourra à peine cinq ans après la fin de la guerre. Cette peur est omniprésente. Loti la ressent chaque fois que son fils monte au front, craignant qu’il soit tué, mais aussi lorsqu’il revient dans les lieux qui lui sont familiers, persuadé qu’il y vient pour la dernière fois. Elle est alimentée par le sentiment grandissant de la vieillesse qu’il redoute encore plus que la fin.
Il y a chez Loti une véritable obsession de rester jeune, de refuser de vieillir. Lorsqu’il rencontre la reine de Belgique, en juin 1917, il la scrute attentivement avec la crainte de trouver vieille celle dont il avait été sous le charme deux ans auparavant et il ajoute :
« J’avais tant redouté pour mon propre compte un examen pareil, que j’avais fait ma toilette avec un soin inaccoutumé et tous les plus habiles subterfuges. A tout prix, j’avais voulu être jeune, l’être encore une fois ce jour-là […] je me savais bien droit, bien sanglé dans mon uniforme bleu horizon rehaussé d’or et d’un peu d’écarlate, et le sabre d’acier tranchant bien sur le tout. J’avais vingt ans de moins qu’hier, et je me disais : je parais jeune encore, à force de volonté, mais ce sera la dernière fois… »
Cette peur de vieillir n’est pas seulement une peur de ne plus plaire, c’est avant tout que la jeunesse, dans l’esprit de Loti, est la possibilité même de saisir les opportunités qui se présentent de connaître l’aventure, comme il l’explique un mois plus tard en opposant le furtif de la jeunesse au définitif de la vieillesse et la mort. « Je me sens jeune encore, avec des lendemains et de l’imprévu devant ma route, et on dirait par instants que cela me suffit… »
Le journal de Loti est empreint de nostalgie. Mais si elle cède par moment au refrain racorni du « c’était mieux avant… », elle atteint chez lui face à la catastrophe de la guerre, une profondeur puissante. Elle devient au sens propre mélancolie, c’est-à-dire, sentiment d’étrangeté au monde qui pousse à retrouver des sensations anciennes mais aussi à débusquer l’humanité, la paix dans les scènes surprenantes qu’offrent alors le spectacle de la guerre. La description de la vie arrêtée dans les villages détruits comme celle de la basilique Saint-Marc de Venise « pour ainsi dire emballée » pour la protéger des obus sont parmi ces moments de pure création que le lecteur n’est pas prêt d’oublier, comme si l’œil encore alerte de Loti était toujours capable, en quelques notations de saisir l’étrangeté et la beauté du monde.
La force de ses images, la précision de ses descriptions faites d’analogies, de rapprochements avec d’autres lieux, d’autres paysages, donnent à son journal une émotion aussi inattendue que puissante. Loti sait voir, ou plutôt, il voit ce que les autres ne voient pas. Parfois, il est grandiloquent, ou trop précieux mais quand il trouve la note juste, ce qui arrive souvent, la force de son style demeure intacte, nous transporte. Tout son voyage en Italie durant le mois d’août 1917 qui le conduit dans Venise occupée puis dans les Dolomites est un rêve hallucinatoire d’une poésie saisissante.
De même, il nourrit tout au long de ses pages, un amour particulier pour la nature qui le conduit à coucher sur le papier ses manifestations au cours des saisons. Il y a là quelque chose de vraiment singulier. Dans leurs lettres comme dans leurs mémoires, les soldats ont souvent été aussi marqués par la nature, mais c’était pour mieux en souligner la destruction par les bombes, arbres fauchés, sols retournés, animaux tués.
Loti lui en souligne la capacité à renaître, à résister au bouleversement de la guerre. Il s’émerveille devant le spectacle du petit jardin à Rochefort, « les daturas embaument quand je m’assieds, sur le banc au clair de lune » (22 août 1915), du printemps, « l’air est saturé, le soir, de l’odeur des lilas, des seringas, des chèvrefeuilles » (27 mai 1917), des paysages italiens, « avec ses jardins de pays tiède, où les dracénas se balancent au bout de leurs longues tiges, où les lauriers-roses, tout roses de fleurs, sont grands comme des arbres » (11 août 1917).
Pour Loti, c’est comme si la nature continuait sa vie en parallèle des hommes et qu’il appartenait à ces derniers d’en saisir le spectacle à la façon d’un antidote à la mort industrielle, mais aussi à la nostalgie – la parfaite symbiose entre le définitif et le furtif qu’il a essayé d’établir au long de son existence entre sa quête de gloire, de reconnaissance sociale et l’affirmation d’une sensibilité en dehors de tout compromis.
Soldats bleus. Journal intime 1914-1918
Paru le 09/02/2023
426 pages
Editions de La Table Ronde
10,50 €



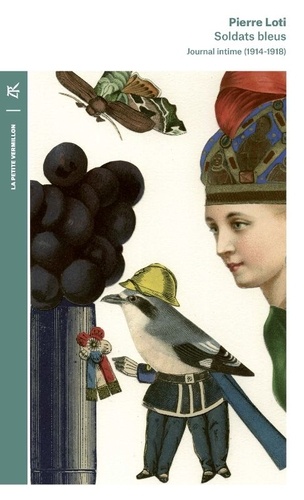
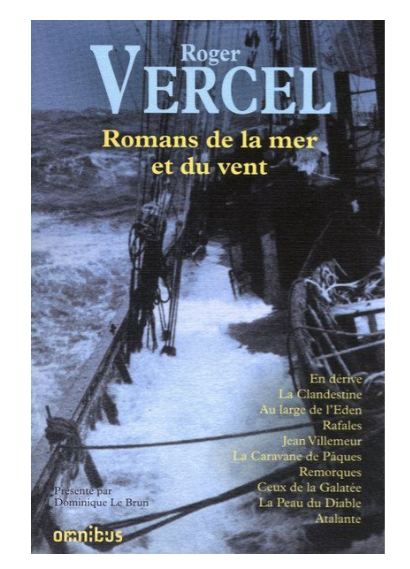
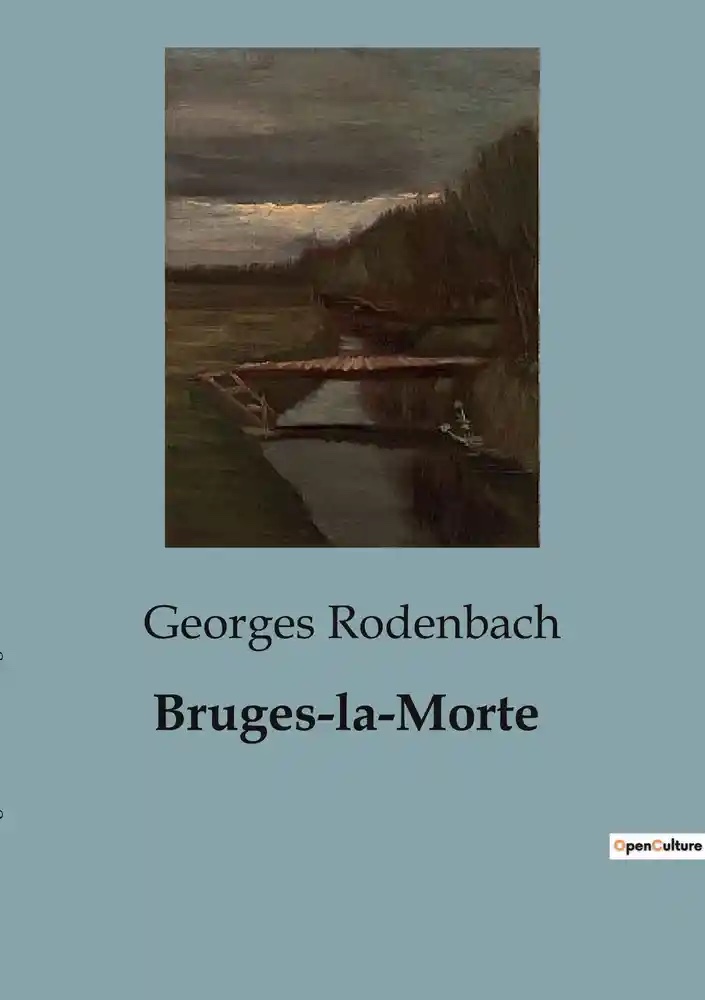
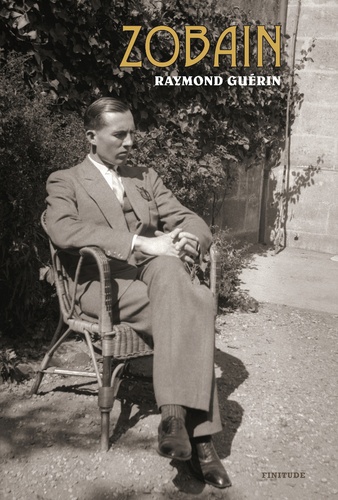

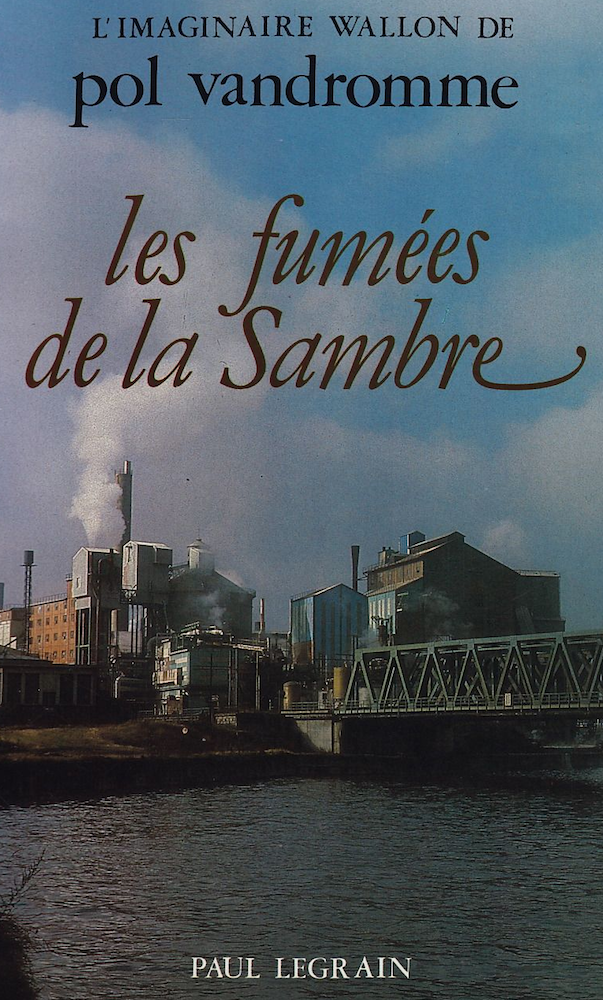
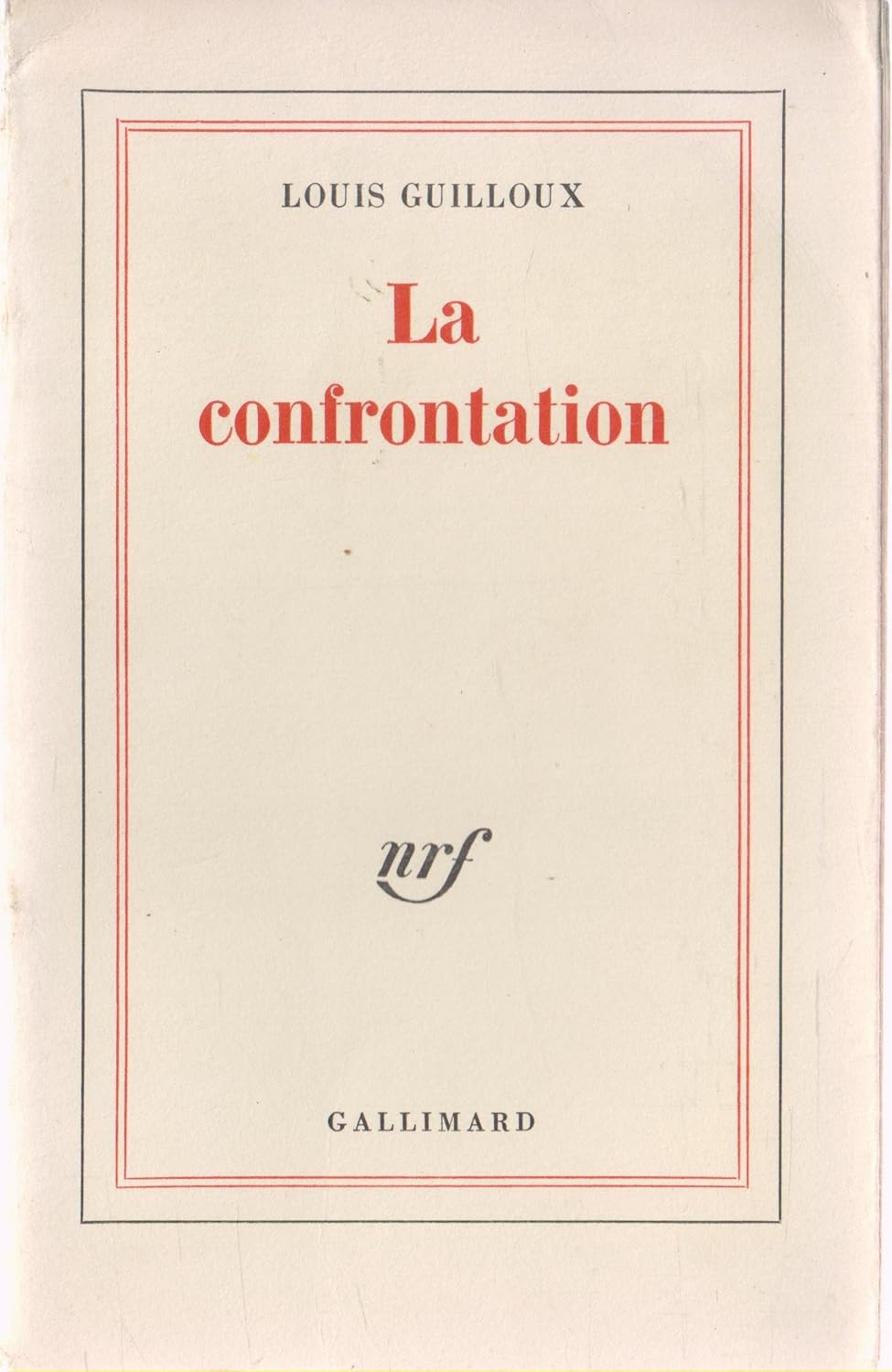
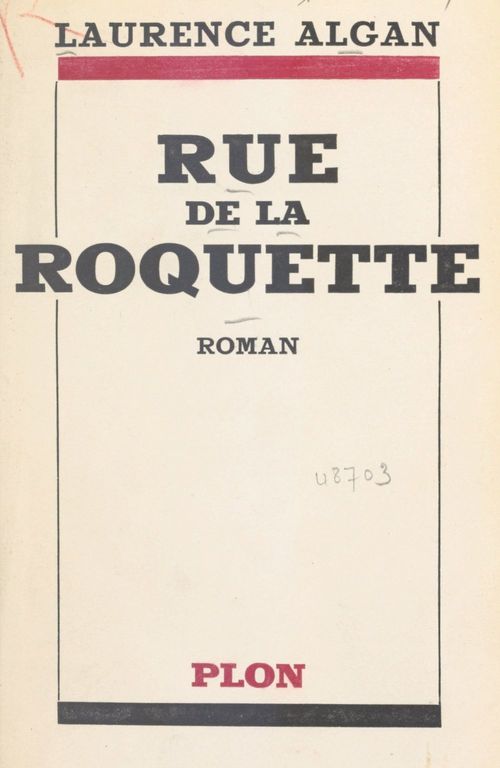
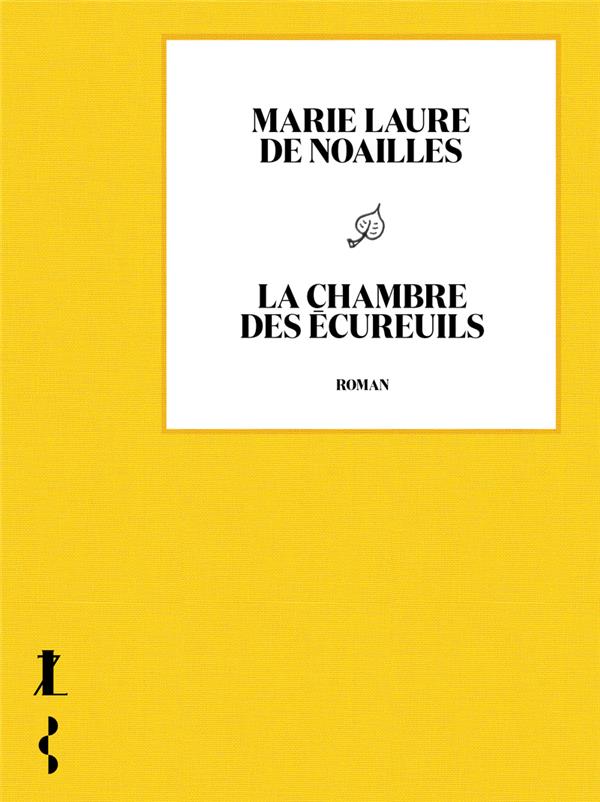
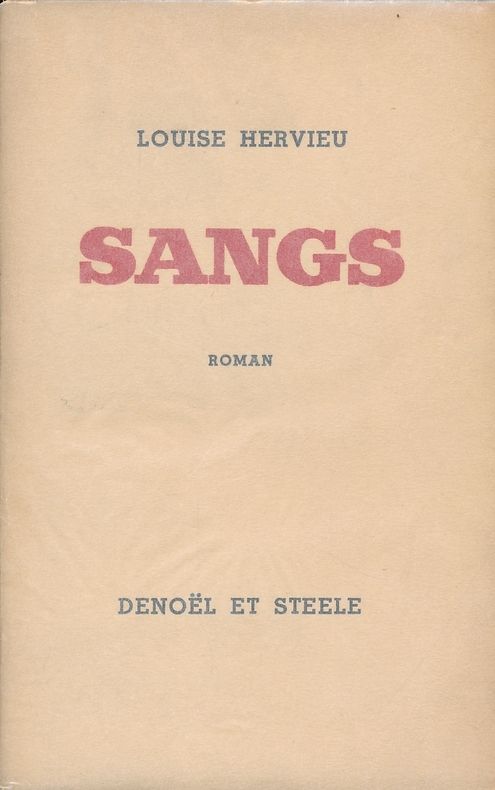
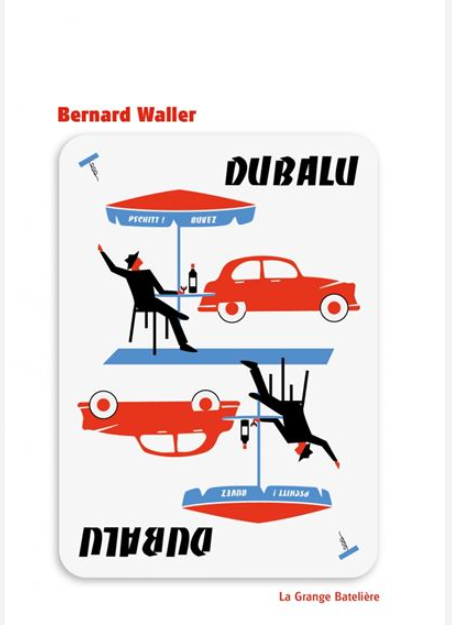
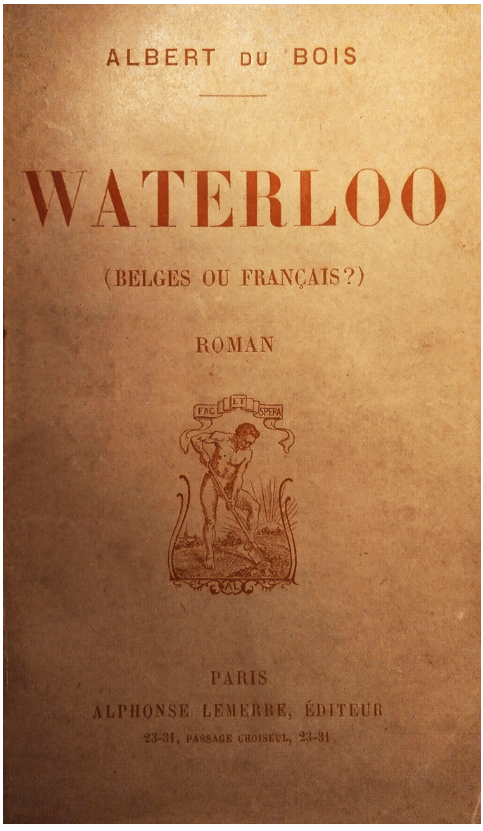

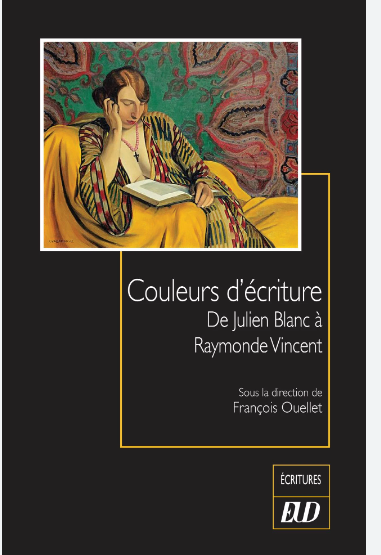
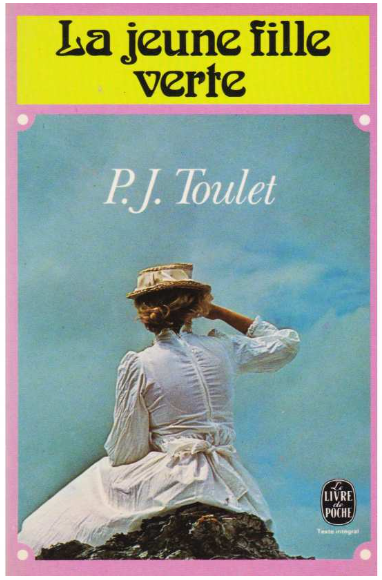
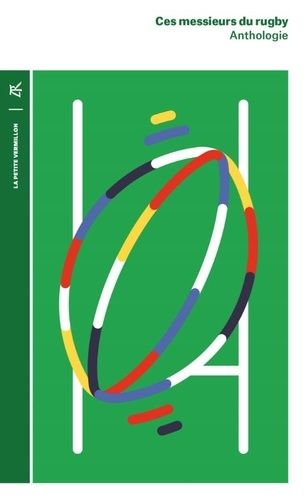
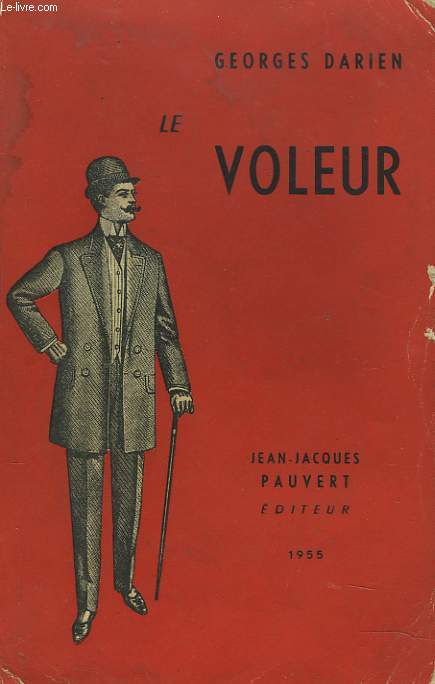
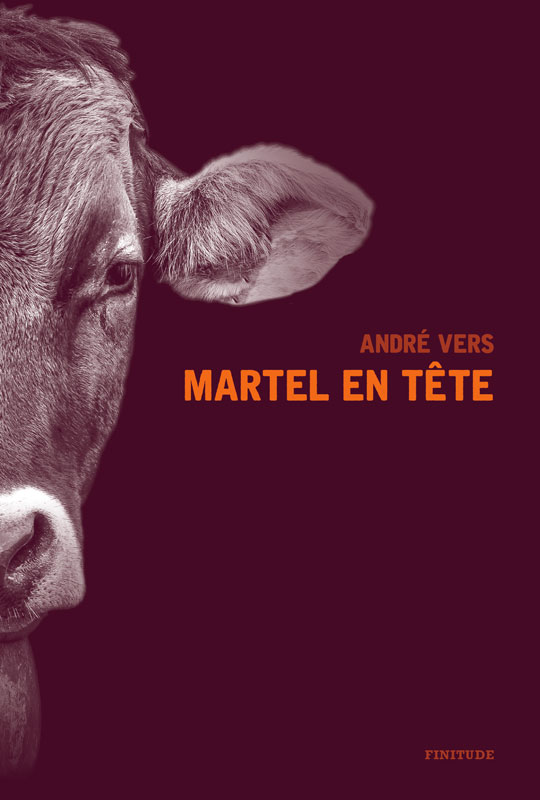

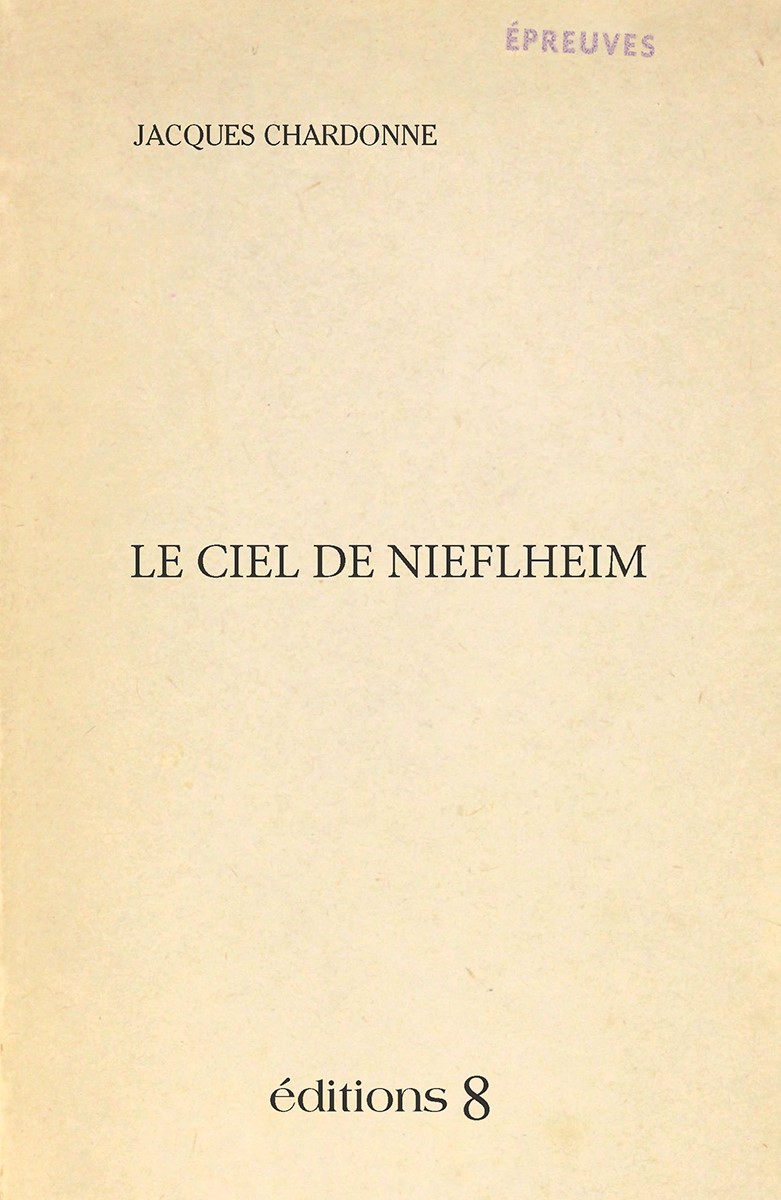
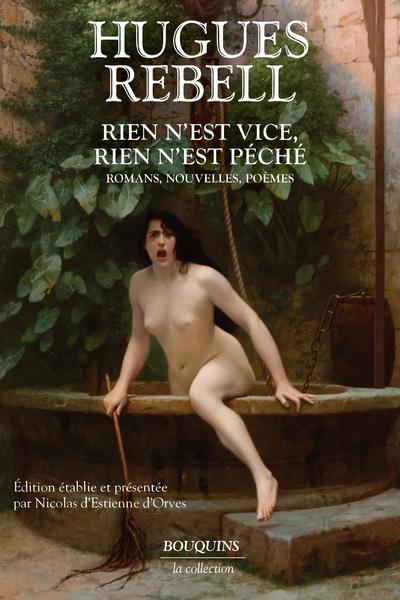
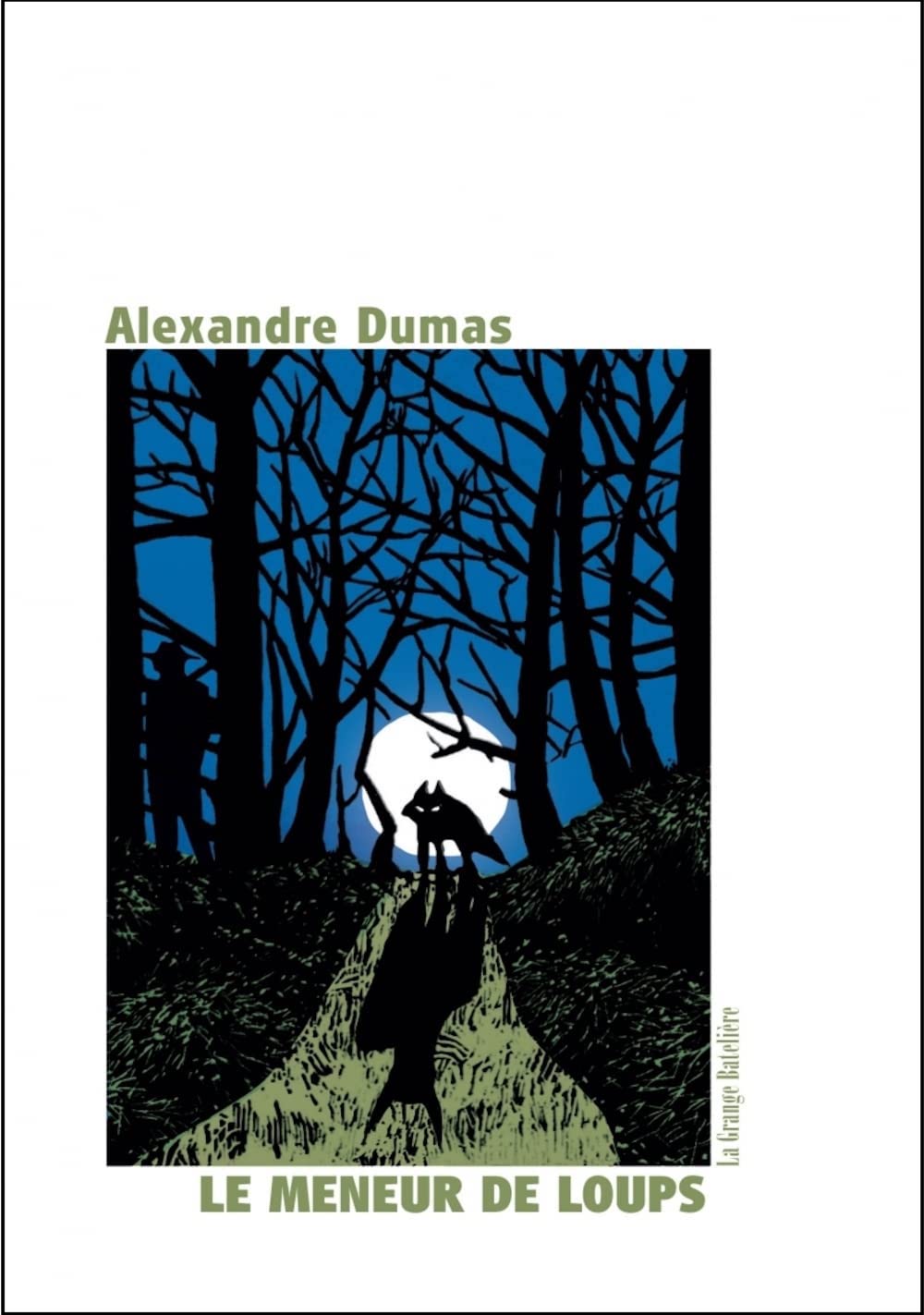

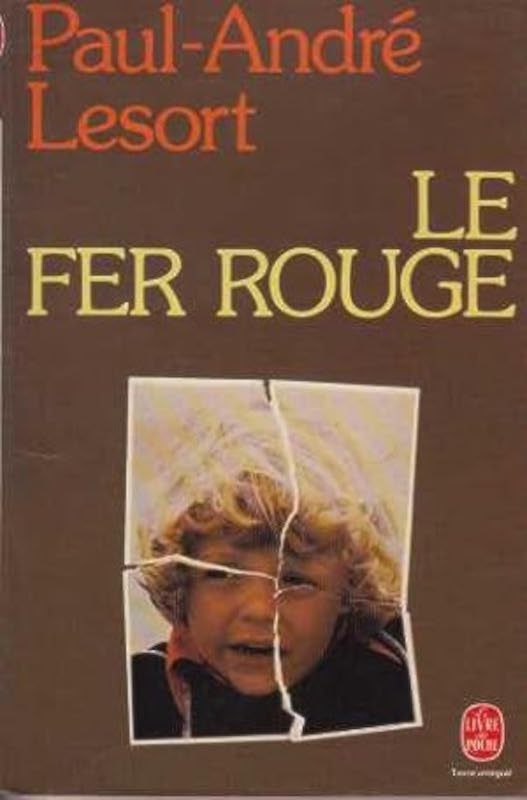


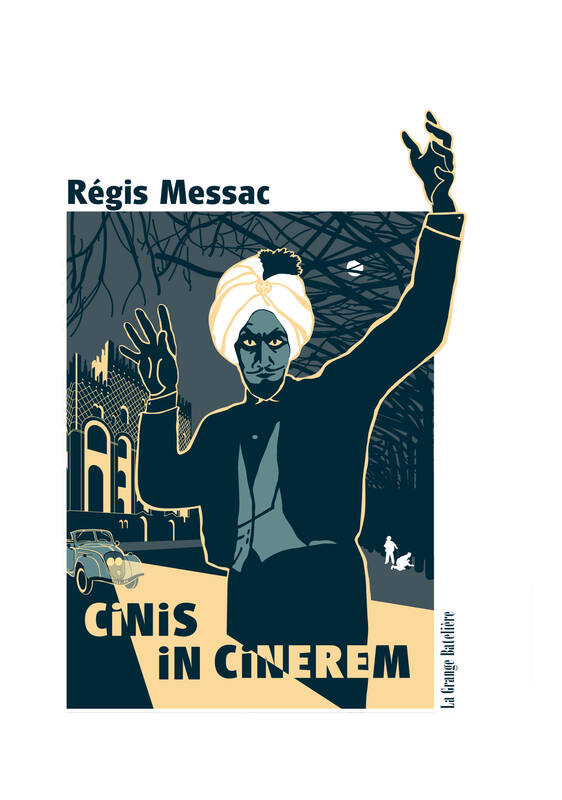

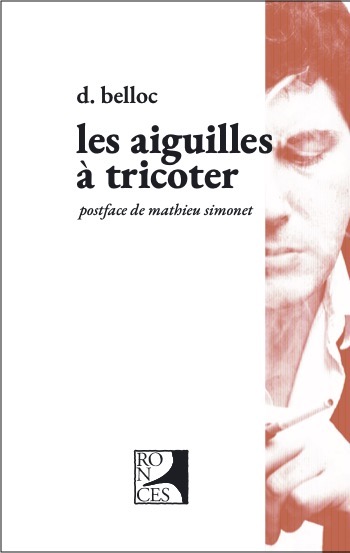
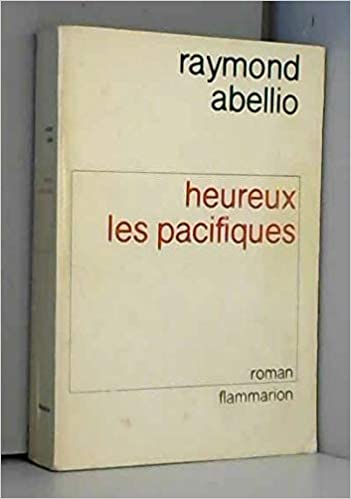
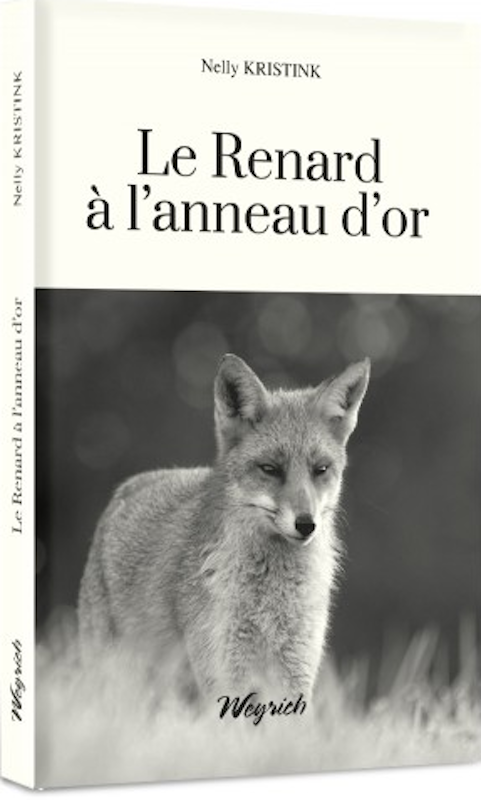
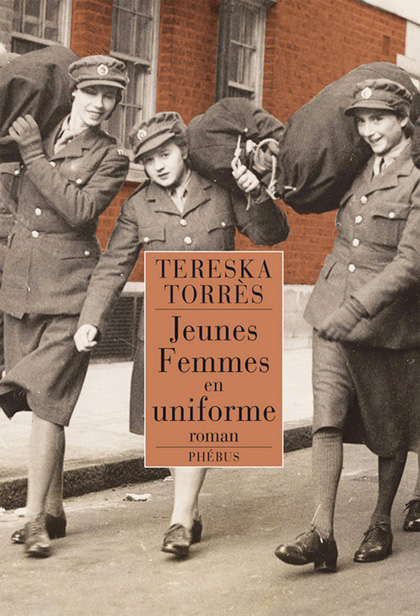
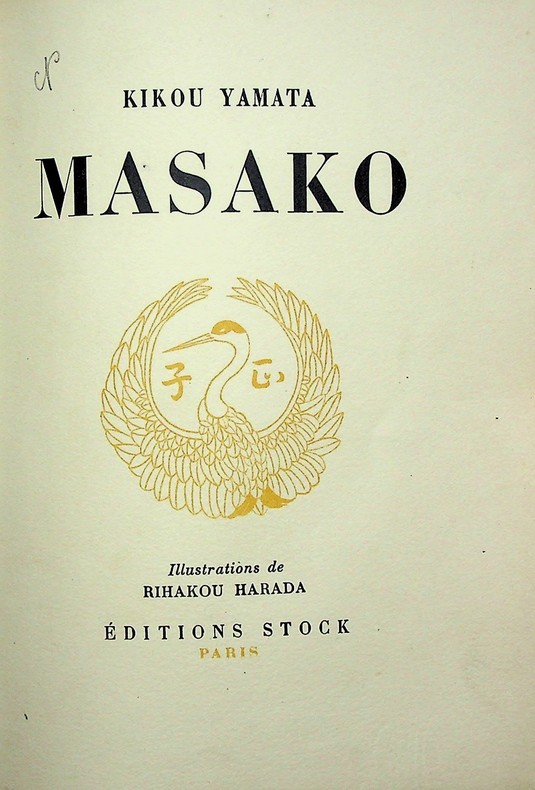
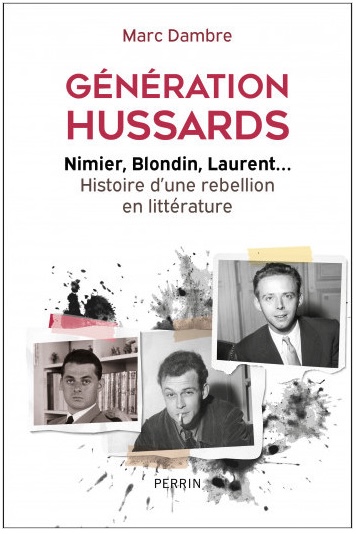
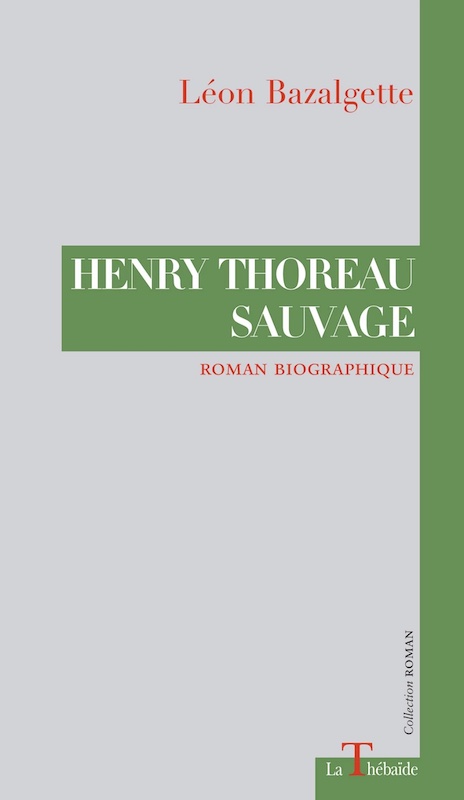

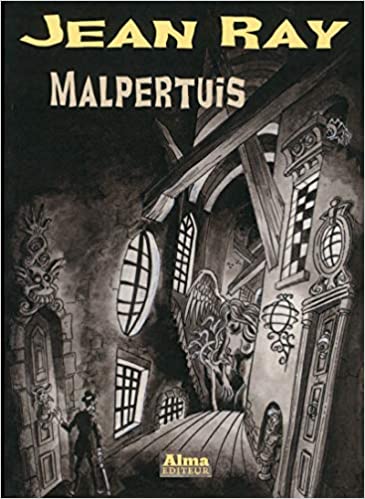
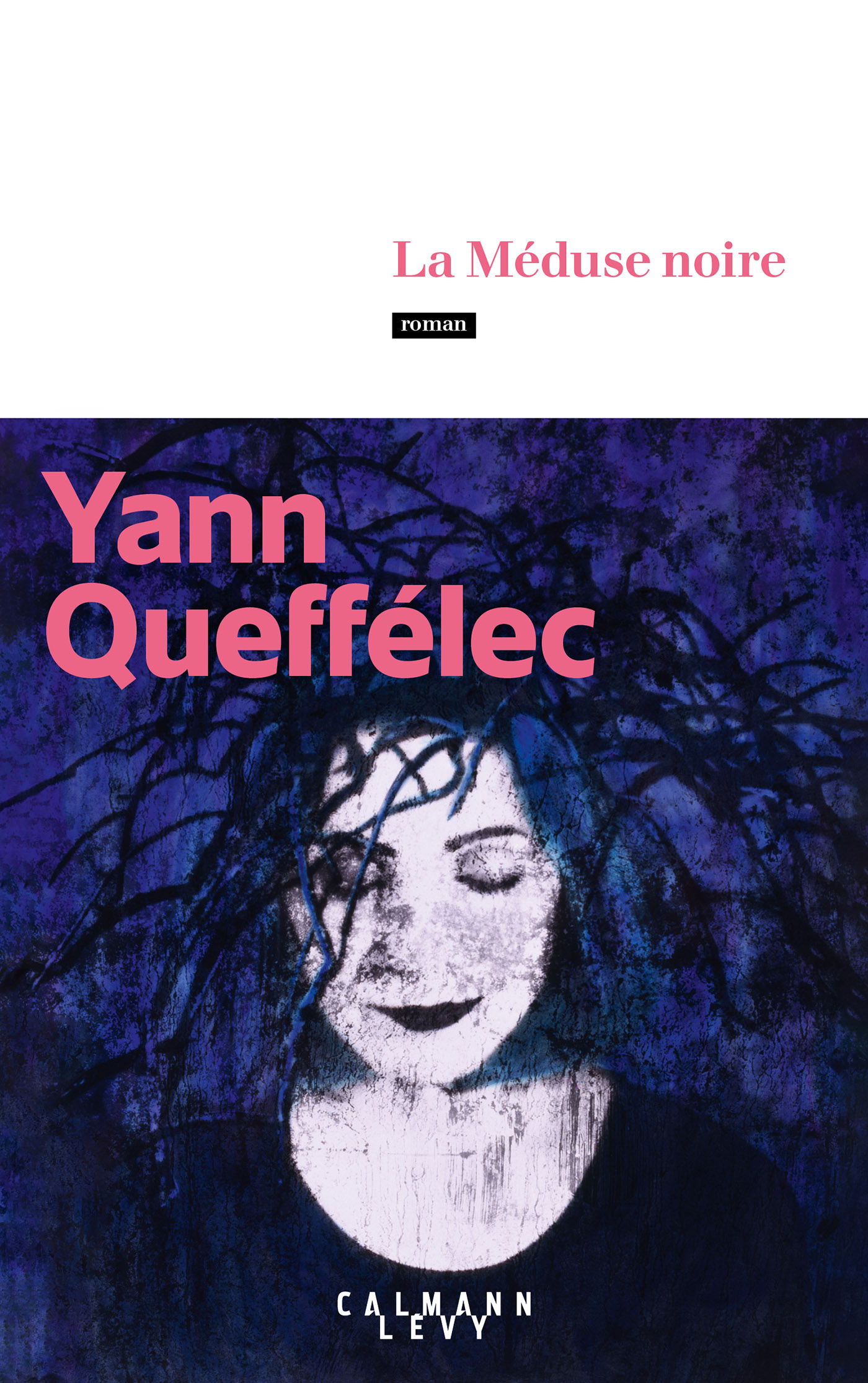


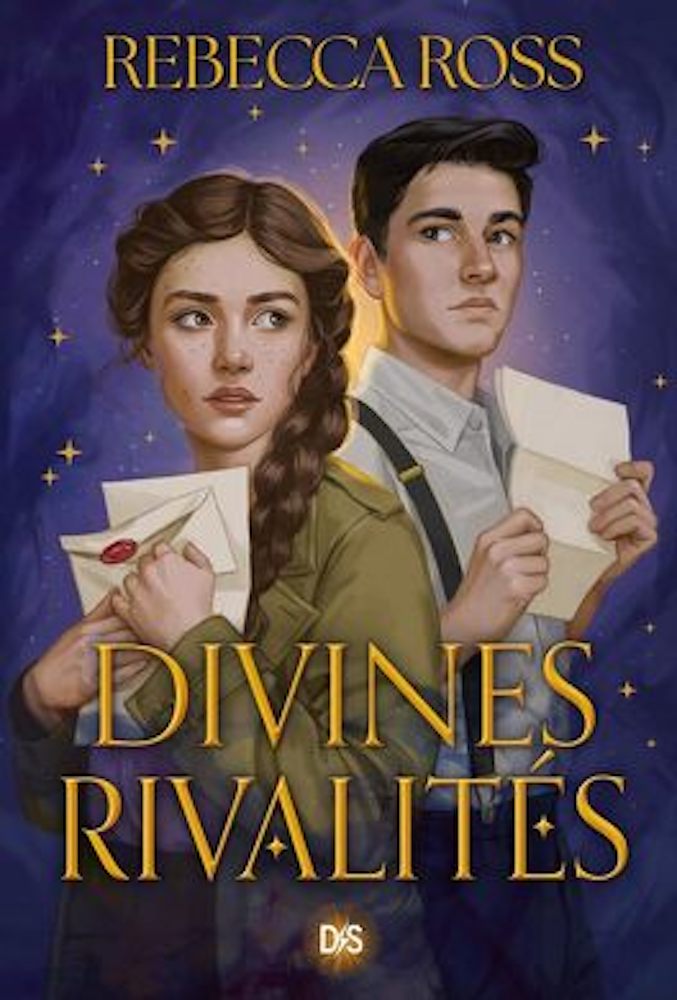



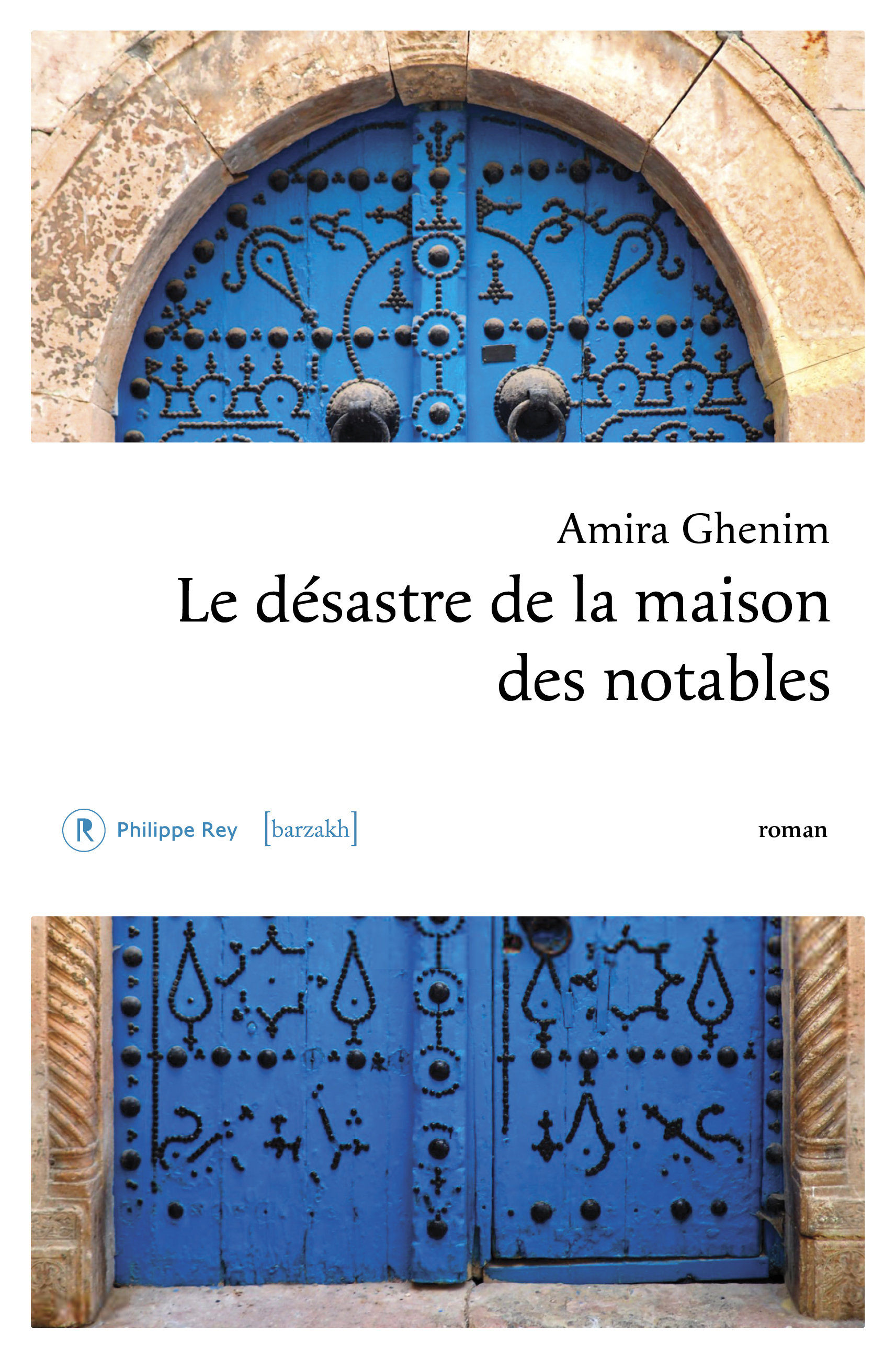
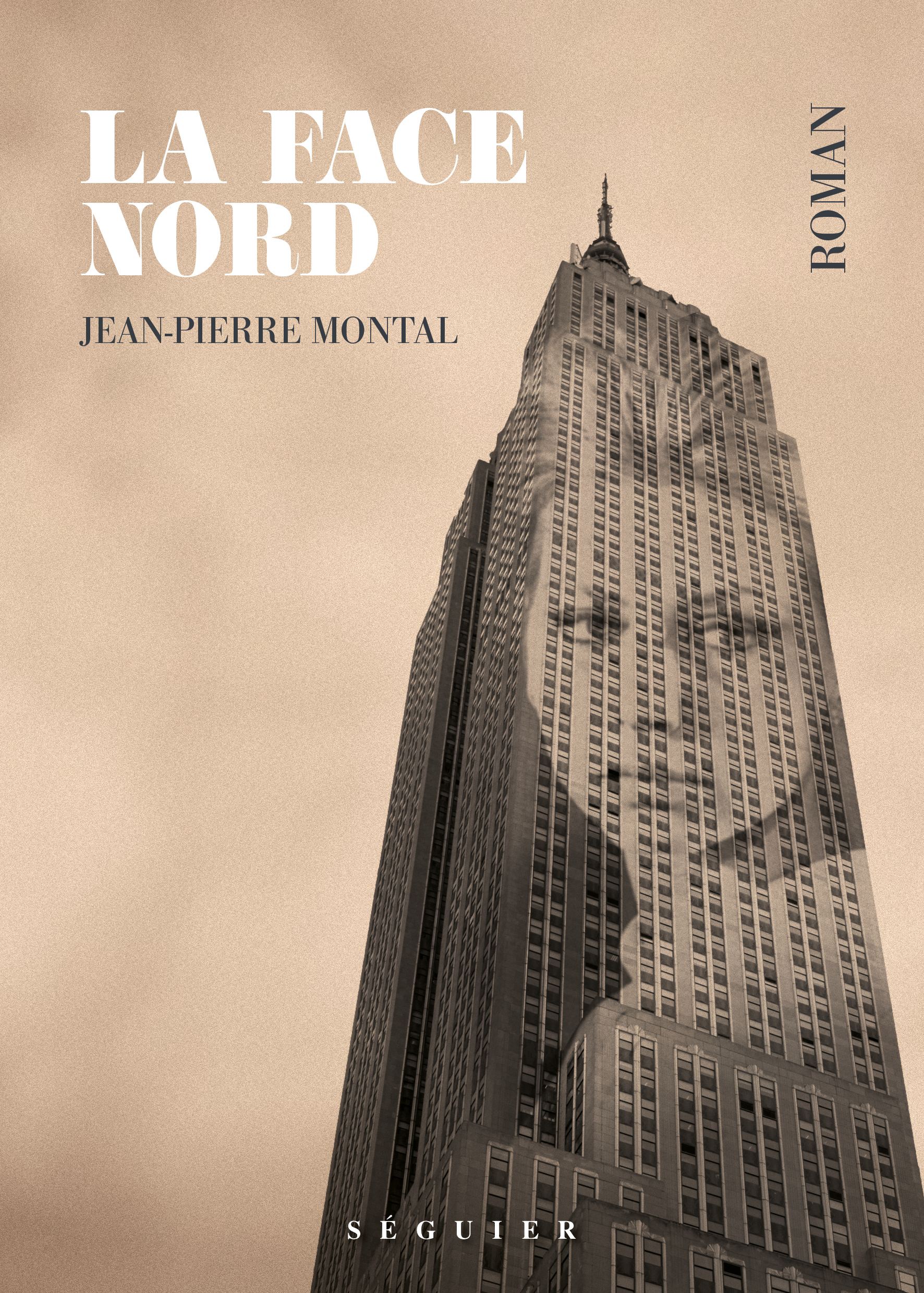



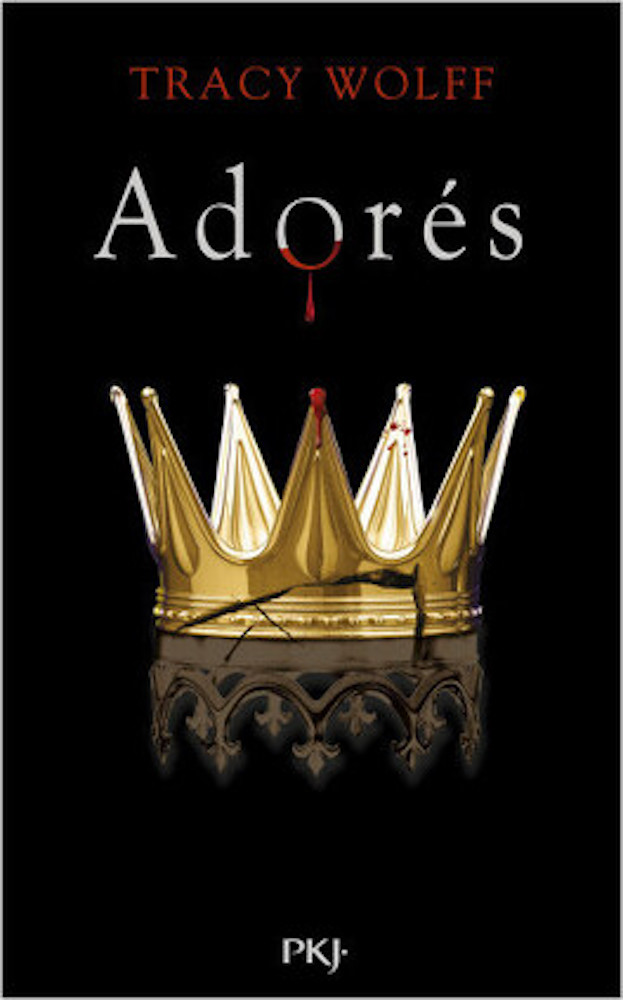
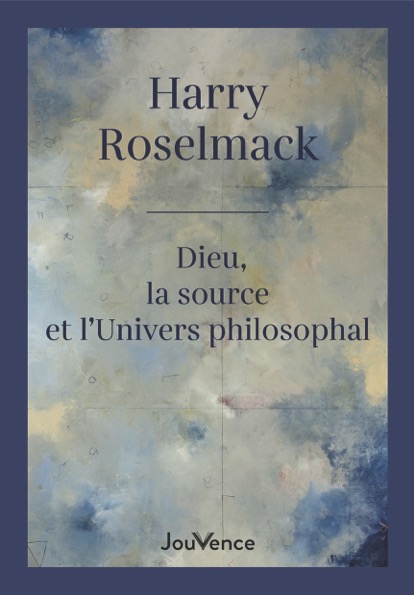
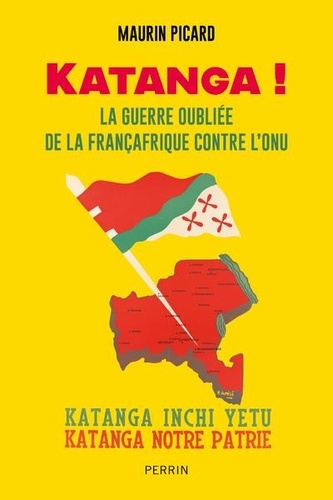

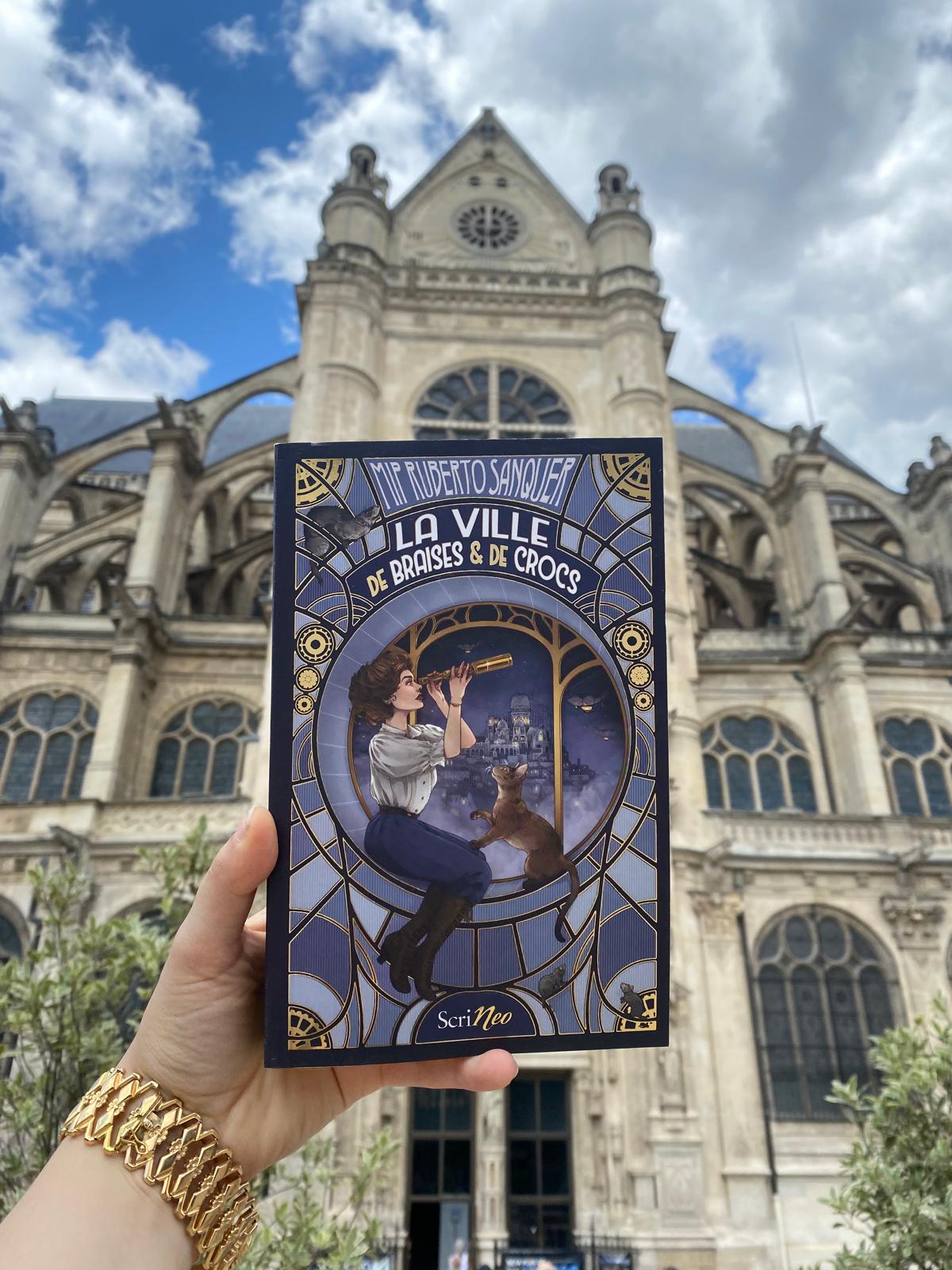
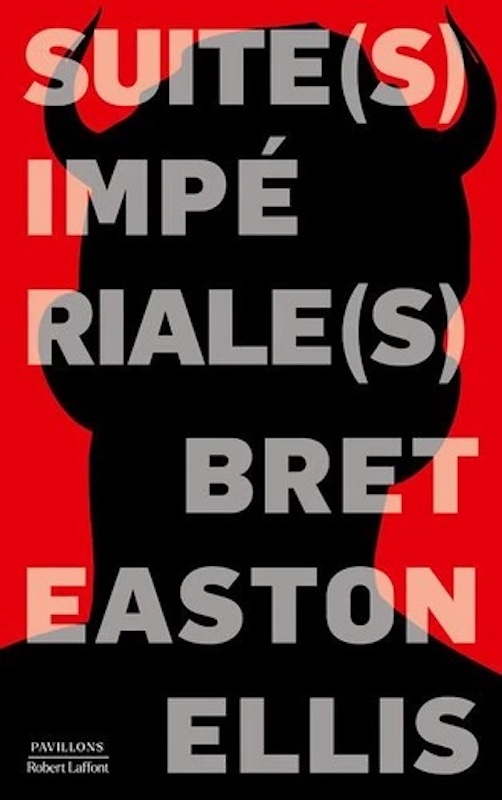




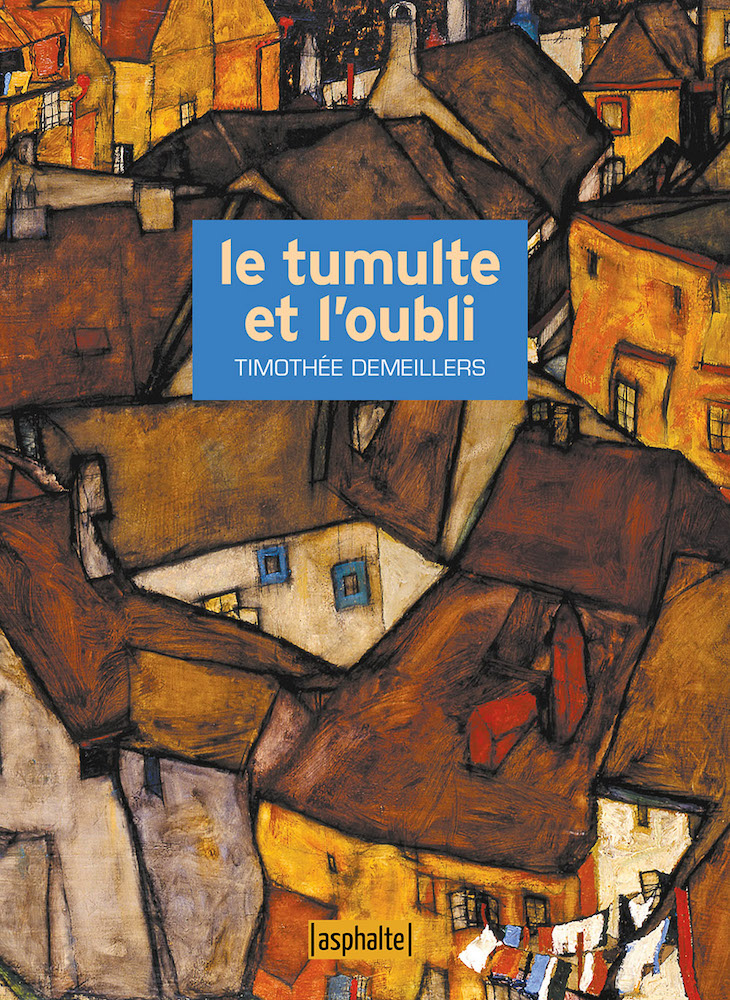


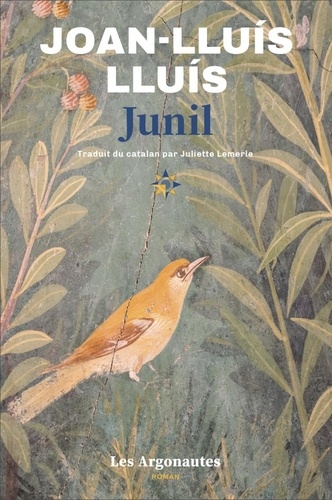

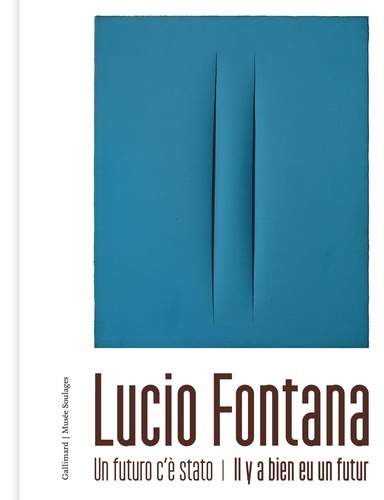


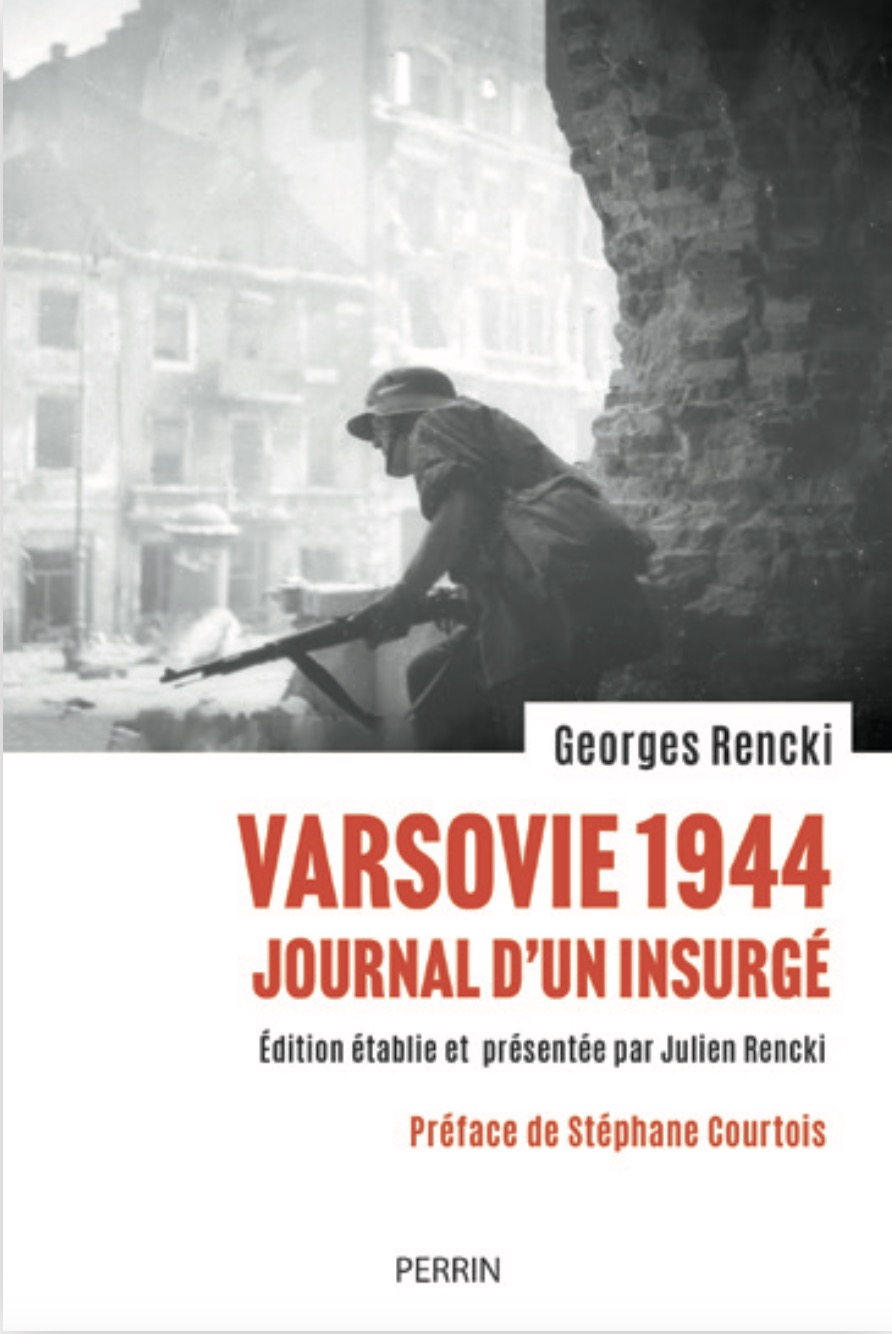
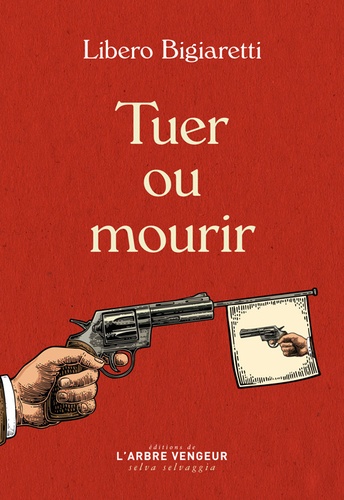

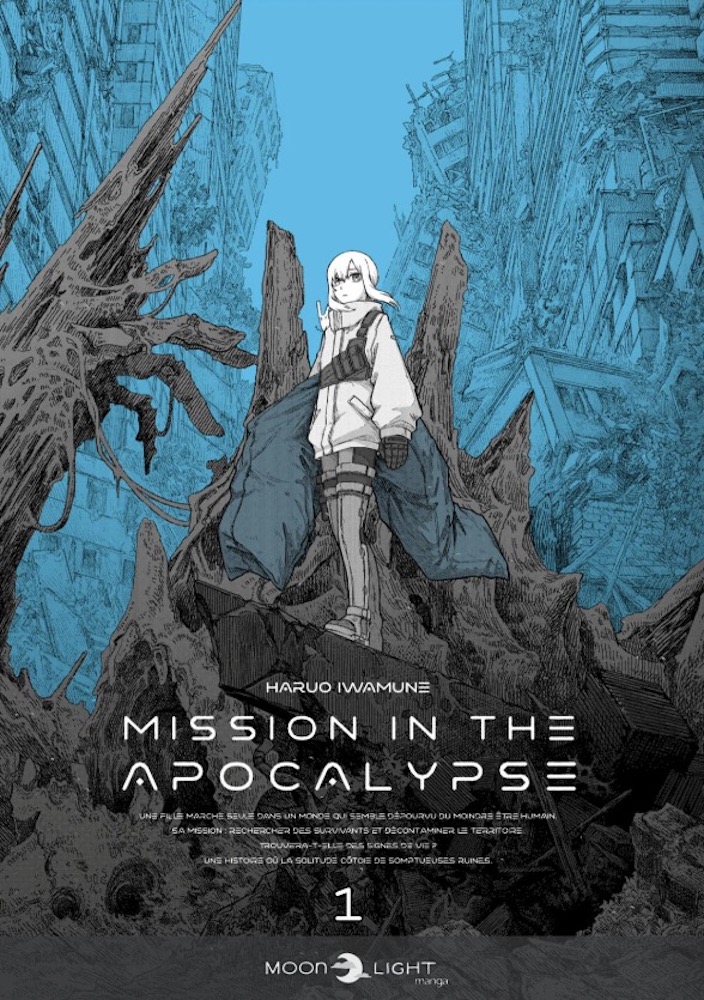


Commenter cet article