Les Ensablés - L'hôtel du Nord d'Eugène Dabit, “triste, poignant et beau”
Publié en 1929, L’Hôtel du Nord est le premier roman d'Eugène Dabit ((1898-1936voir ici et ici). Ce roman connut un succès inégalé dans la courte carrière de l'auteur, disparu brutalement en 1936 alors qu'avec un groupe d'écrivain français, il accompagnait André Gide dans un voyage en URSS. Issu d'un milieu modeste, marqué comme tous les jeunes gens de sa génération par la guerre de 1914, Eugène Dabit a fréquenté les milieux artistiques après la guerre et a gravi l'échelle sociale, sans jamais renier ses origines. Par Isabelle Luciat

Cette position singulière de transfuge de classe, selon l'expression consacrée de nos jours, semble avoir été une source d'angoisse pour Eugène Dabit qui note dans son « Journal intime » (publié à titre posthume) : « ...me voici (...) entre deux mondes, entre deux vies, moi qui ai tant de peine à choisir... ». Ainsi, à la manière des écrivains naturalistes, Eugène Dabit présente dans L'Hôtel du Nord des portraits sans concessions et parfois cruels de petites gens croisés dans son milieu d'origine, mais ce regard extérieur laisse toutefois filtrer, entre les lignes, amour et compassion pour les humbles.
En 1931, le roman reçut le prix Populiste qui était décerné pour la première fois. Ce prix, qui porte depuis 2012 le nom de « Prix Eugène Dabit du roman populiste », récompense une œuvre romanesque qui « préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors à condition qu'il s'en dégage une authentique humanité ». Cette récompense et les polémiques qu'elle a créées avec les milieux littéraires politisés se revendiquant du prolétariat (Eugène Dabit avait adhéré en 1932 à l'Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, liée au communisme) semble avoir embarrassé l'auteur qui note dans son journal : « Mon désir d'individualité cadre mal avec tous ces systèmes ».
Il est difficile, en effet, de réduire le roman L'Hôtel du Nord à une présentation humaniste des milieux populaires ou d'y discerner une quelconque prise de position politique. Eugène Dabit y fait la chronique de « vies pitoyables, sans espoir, sans révoltes ». « Il y faudrait de l'esprit » ajoute-t-il, non sans cruauté, dans son « Journal intime ». Mais il y a surtout une volonté de faire mémoire des petites gens (« De leur passage, les hommes pauvres laissent si peu de signes », note-t-il dans son journal) et aussi, me semble-t-il, de rendre hommage à ses parents (et particulièrement à sa mère) qui furent les véritables gérants de « L'Hôtel du Nord » de 1923 à 1942. « L'Hôtel du Nord » est, à ce titre, une œuvre très personnelle, un tombeau peuplé des souvenirs d'un jeune homme, un adieu à un monde en voie de disparition.
En 1938, le roman a été adapté au cinéma par Marcel Carné. Le film « Hôtel du Nord » est devenu un classique du cinéma français de l'entre-deux guerres, probablement plus connu du grand public que le roman dont il s'inspire. La célèbre réplique d'Arletty à Louis Jouvet, la gouaille de la comédienne continuent à charmer les cinéphiles. C'est d'ailleurs la photographie de ces deux acteurs qui illustre la couverture du roman dans l'édition Folio. Le scénario du film (élaboré par Jean Aurenche et Henri Jeanson) est toutefois très éloigné de la trame du roman.
Les deux œuvres présentent les mêmes types de personnages - des ouvriers, des prostituées, un éclusier, des femmes trompées ou infidèles, ... - mais contrairement au film, aucun des personnages du roman n'échappe à la tragédie. Le déterminisme social y est implacable, ne laissant aucune place à l'espoir (incarné dans le film par un jeune couple d'amoureux, absents du roman) ou à la rédemption (incarné dans le film par un malfrat en cavale, Monsieur Edmond, devenu proxénète désabusé, personnage également absent du roman). Autre différence marquante : le roman ne recourt que rarement à l'argot des faubourgs alors que les dialogues du film font la part belle au « pittoresque outré », selon les termes de Marcel Carné.
Le roman se situe dans un hôtel du 10ème arrondissement de Paris, au bord du canal Saint Martin. Il se compose de 35 courts chapitres, traités quasiment de manière indépendante, sans véritable fil narratif, chaque chapitre étant centré sur un groupe de personnages, clients de l'hôtel ou habitués du café. Ce sont des personnages de passage, croqués dans une courte tranche de vie. Les gérants de l'Hôtel, Émile et Louise Lecouvreur, servent de fils conducteurs.
Au début du roman, ce couple d'ouvriers décide de prendre l'hôtel en gérance avec l'aide financière d'un parent (ce qui fut aussi le cas des parents d'Eugène Dabit). Emplis d'espoir (d'illusions ?), Émile et Louise rêvent de transformer cet établissement vétuste et misérable en un lieu propre et coquet. Ainsi, lorsqu'elle visite l'hôtel pour la première fois, Louise établit un lien entre l'embellissement de l'hôtel et celui de sa propre vie : « Ne se voit-elle pas, lavant, astiquant, mettant 'une petite cretonne' dans les chambres ? Un monde vierge s'offre à elle, une chance, enfin, d'embellir ses jours, de fixer sa vie ».
L'espoir et la lumière habitent ce premier chapitre du roman, dédié à la découverte de l'hôtel. Invité à monter sur le toit de l'hôtel (une ascension du sombre couloir de l'hôtel vers la lumière du ciel et des eaux du canal qui symbolise le rêve d'ascension sociale du couple Lecouvreur), Émile s’exclame : « Ah ! Quelle vue ! » et ajoute « Je suis un vieux Parisien, mais voyez-vous, je ne connaissais pas ce coin-là. On se croirait au bord de la mer. ».
Dans une certaine mesure, mais au prix d'un travail qui confine à l'esclavage, Émile et Louise parviendront à améliorer les lieux et à créer des liens avec leurs locataires et les ouvriers du quartier. Ce souci des autres caractérise particulièrement Louise, personnage le plus récurrent du roman. Sous les traits de cette femme sensible, pleine de sollicitude, sondant avec compassion les misères entraperçues, le lecteur de « Petit-Louis » (roman largement autobiographique) reconnaîtra la mère adorée d'Eugène Dabit.
Louise tente de prévenir les dérives et les malheurs, mais elle ne peut empêcher les tragédies : les jeunes bonnes de l'hôtel (ses protégées) seront abusées et abandonnées, le vieux locataire désargenté finira ses jours à l'hospice, le locataire malade résistera pour garder sa chambre mais il sera finalement conduit à l'hôpital pour y mourir, l'enfant innocent sera exploité sans pitié par une famille veule et indigne. Toute cette triste humanité défile sous les yeux de Louise. Ses bons sentiments, ses actes généreux ne pèsent pas grand-chose face à la misère et à la déchéance inexorable.
Quelques hommes dans la force de l'âge tentent d'aller de l'avant, mais cette résilience semble être le fruit d'une forme d'insensibilité ou de déni. Les hommes encore jeunes fuient le malheur comme ils fuient les femmes trop aisément séduites et qui ont cessé de leur plaire, comme ils fuient la rudesse de la vie dans la consommation d'alcool ou se risquent à quelques plaisanteries avec le vieil homme accablé de solitude qui leur offre le miroir de leur propre fin de vie. Les femmes, à de rares exceptions, restent constantes dans leurs sentiments et affrontent l'adversité.
C'est ainsi que le roman se clôt sur la démolition de l'hôtel, métaphore de ces vies vampirisées, et l'expropriation du couple Lecouvreur. Les locataires se dispersent, sans nostalgie pour certains (« Pour les jeunes gens, tous les hôtels se valaient »), avec plus de difficultés, d'ordre matériel, pour d'autres. Seule, Louise semble établir un lien entre ce lieu appelé à disparaître et ces petites gens dont l'Histoire ne fera pas mémoire. Elle assiste à la démolition de l'hôtel : « Elle voyait son effort des dernières années anéanti ; son passé s'en allait en morceaux ». Puis, accompagnée d'Émile, elle revient regarder le chantier des futurs bureaux appelés à remplacer l'Hôtel et pense : « C’est comme si l'Hôtel du Nord n'avait jamais existé (…). Il n'en reste plus rien...pas même une photo. ».
Le roman terminé, le lecteur ne peut se résoudre à ce constat de néant. Non, il ne reste pas rien de l'Hôtel du Nord, de ses résidents, des clients du café et de son couple de gérants. Par son œuvre, Eugène Dabit leur a donné une forme d'éternité, sans doute guidé par l'amour filial (c'est de la vie-même de ses parents que l'écrivain témoigne) et peut-être (je me risque à cette hypothèse) par une volonté de réparation vis-à-vis d'un milieu dont il s'est détaché. En ce début d'automne, saison élégiaque par excellence, je vous suggère d'accompagner la lecture de ce court roman, triste, poignant et beau, d'une promenade au bord du canal. Ce quartier fut pauvre et industriel avant de devenir un lieu à la mode, à la population mélangée. Il reste, çà et là, quelques traces du passé mais surtout, une lumière exceptionnelle, des arbres empourprés se reflétant dans les eaux, des bateaux amarrés, le cri des mouettes...
« On se croirait au bord de la mer. ». Alors, peut-être, penserez-vous avec douceur, à ces pauvres vies qui ont contemplé, bien avant nous, les eaux du canal, joui de sa lumière et ont pu y trouver quelques instants de réconfort.
L'Hôtel du Nord
Paru le 01/05/1993
218 pages
Editions Gallimard
7,80 €




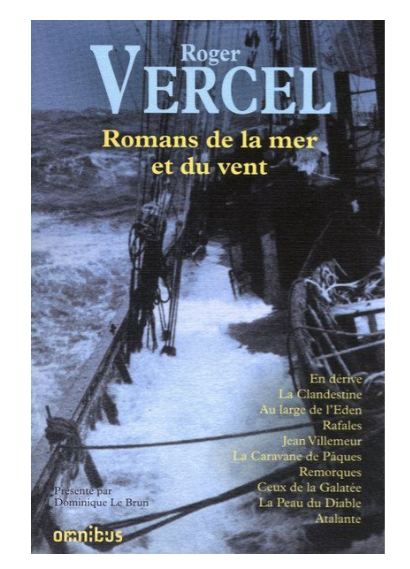
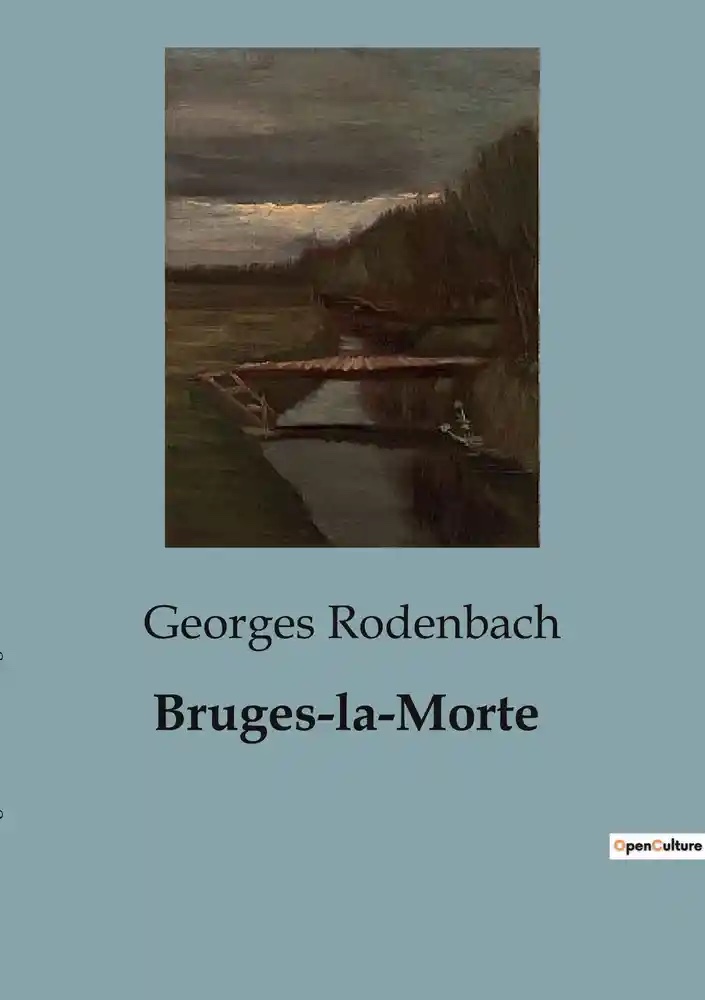
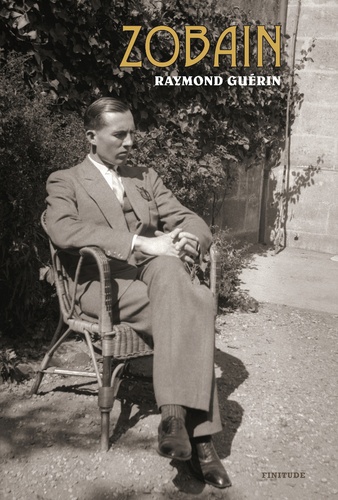

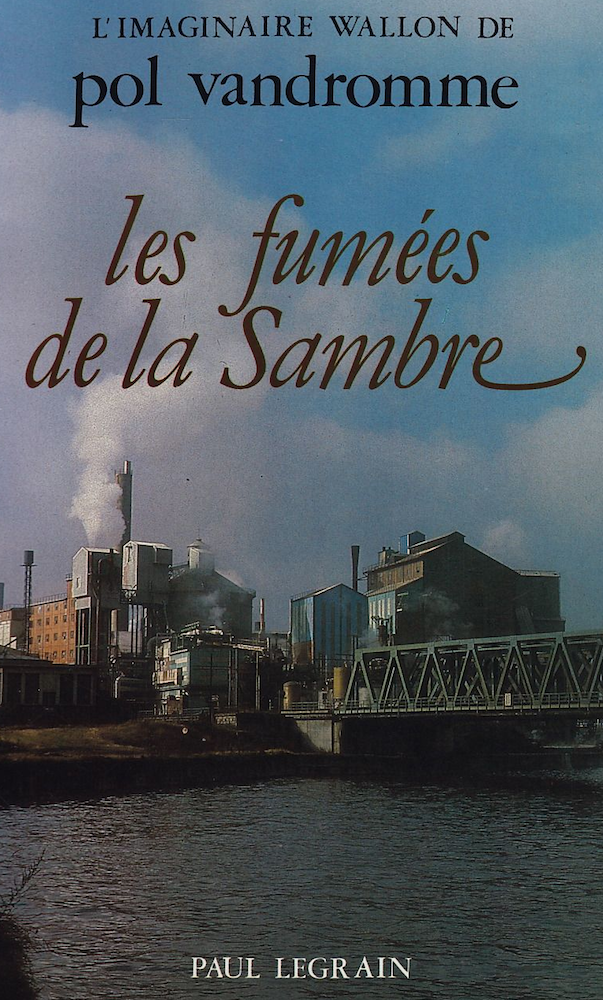
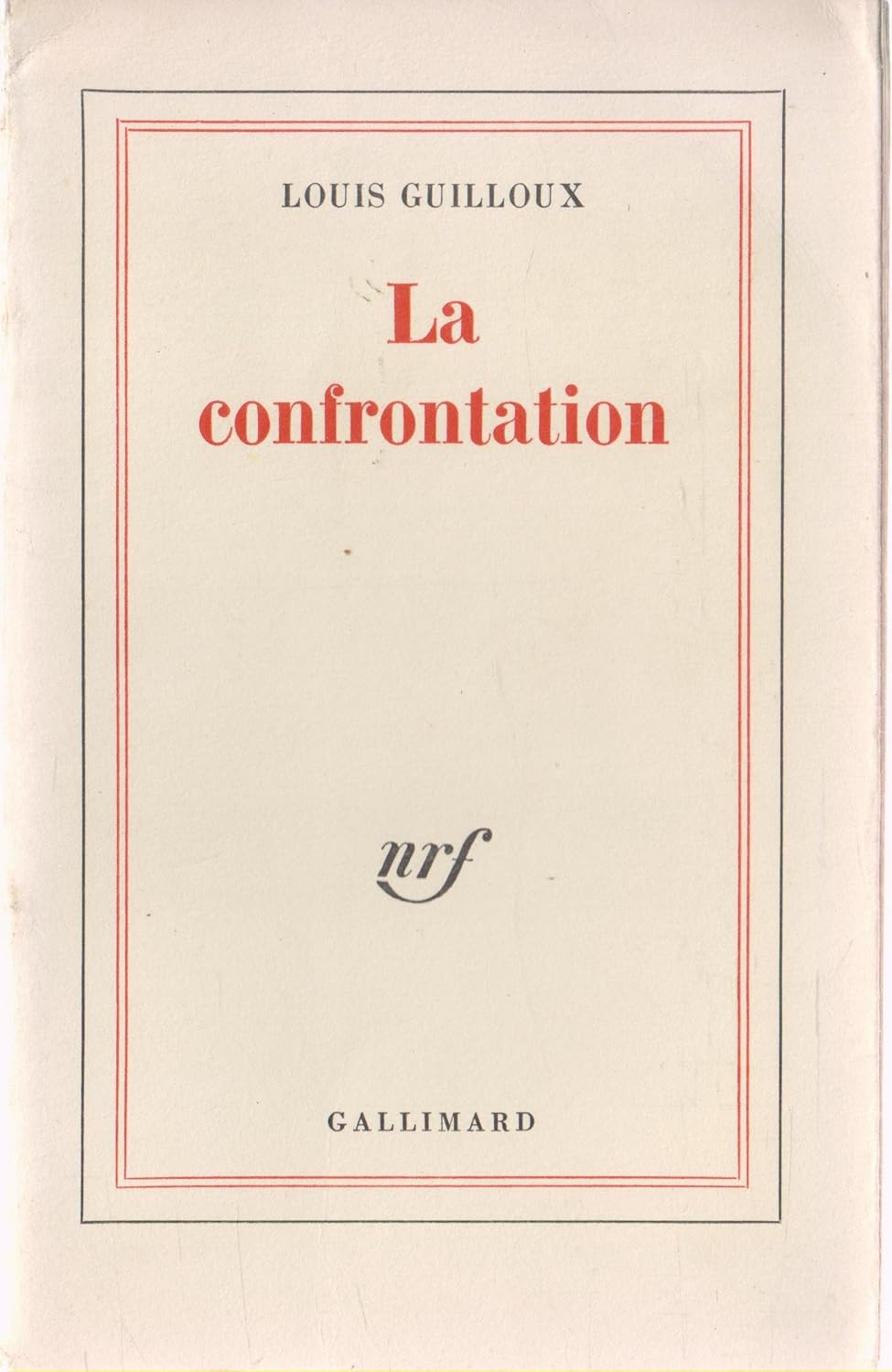
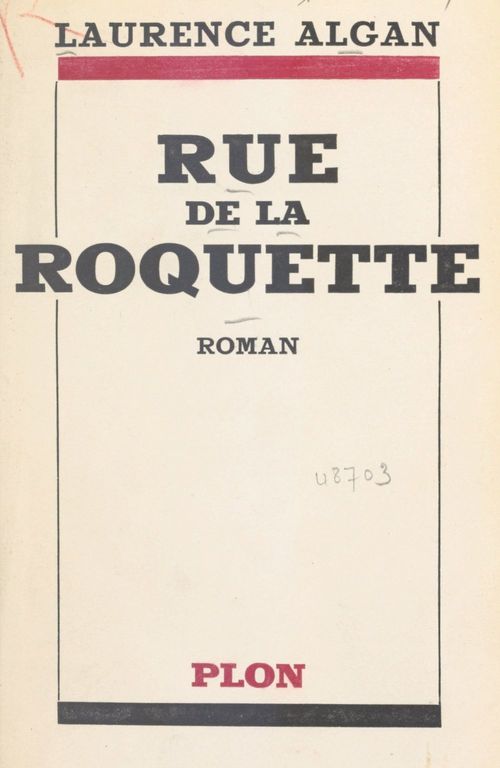
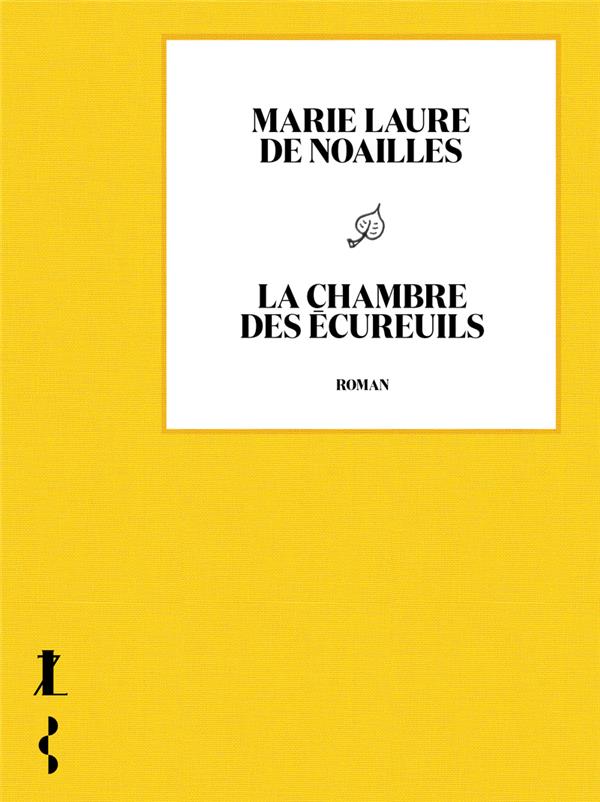
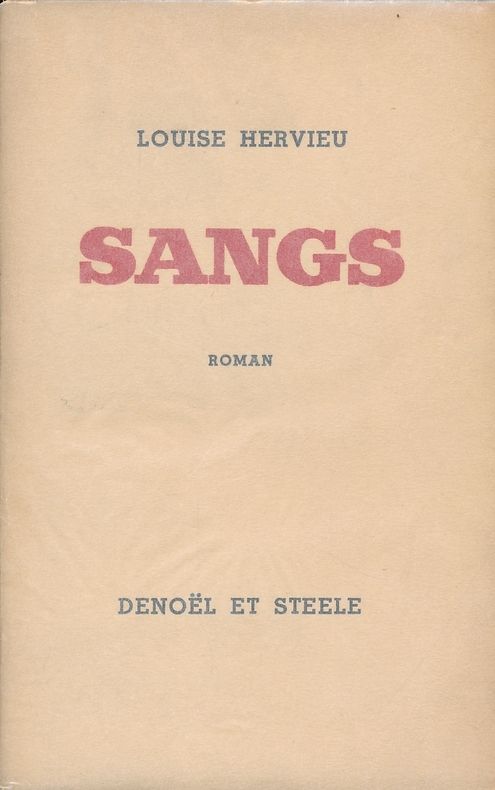
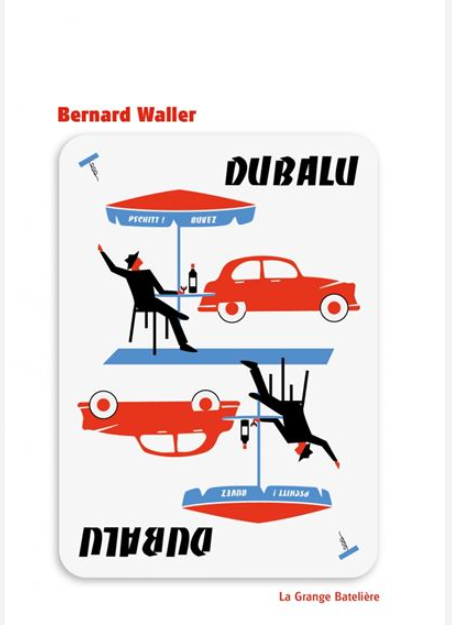
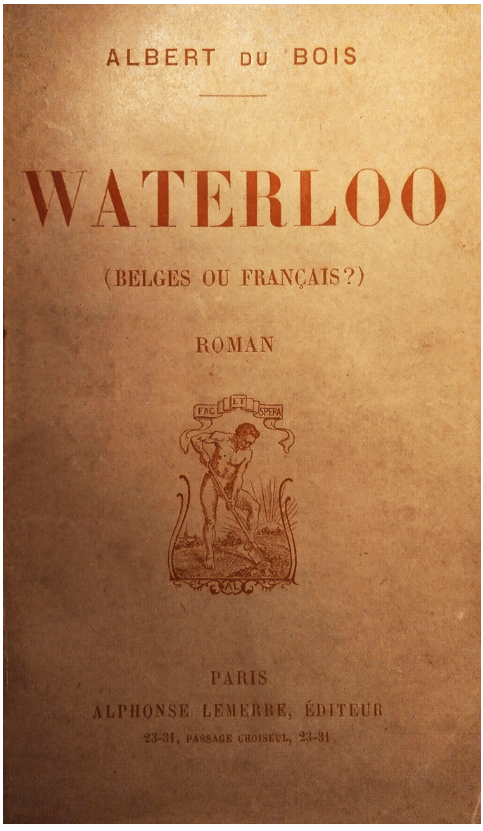

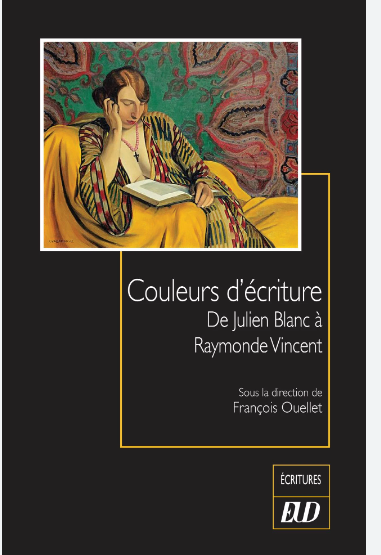
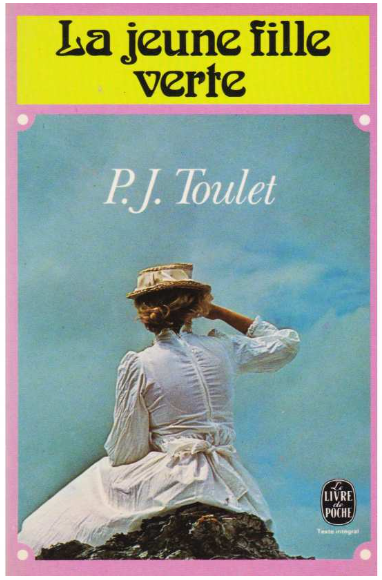
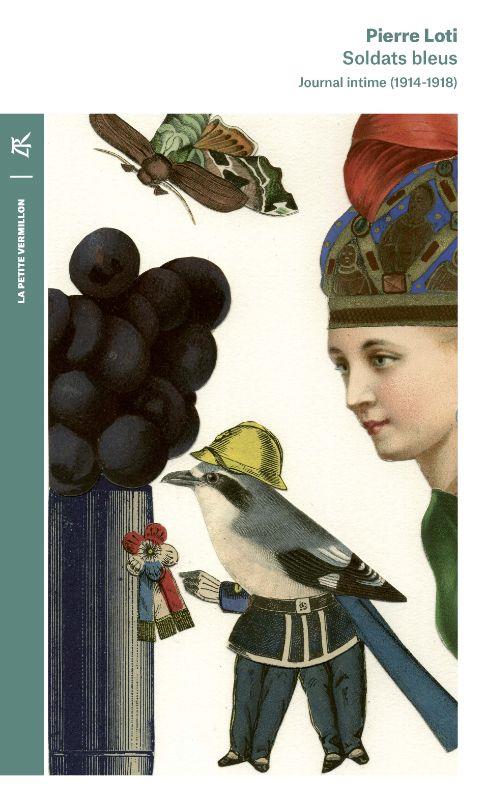
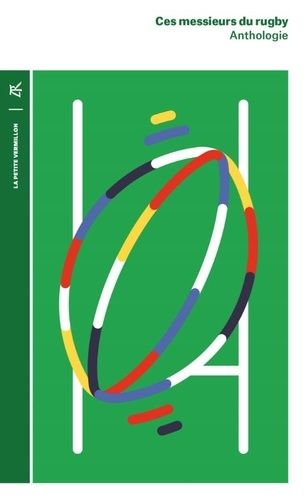
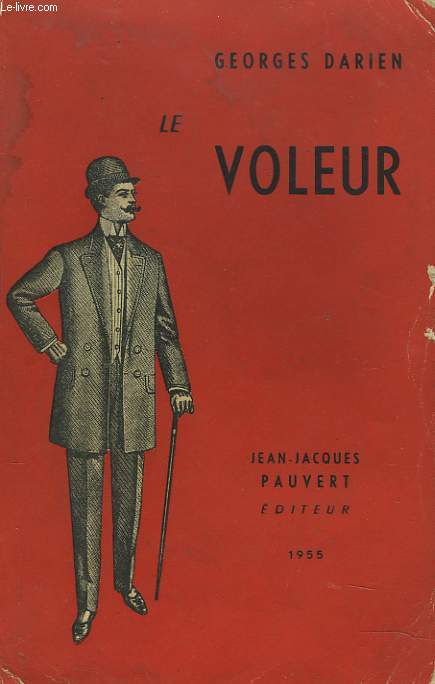
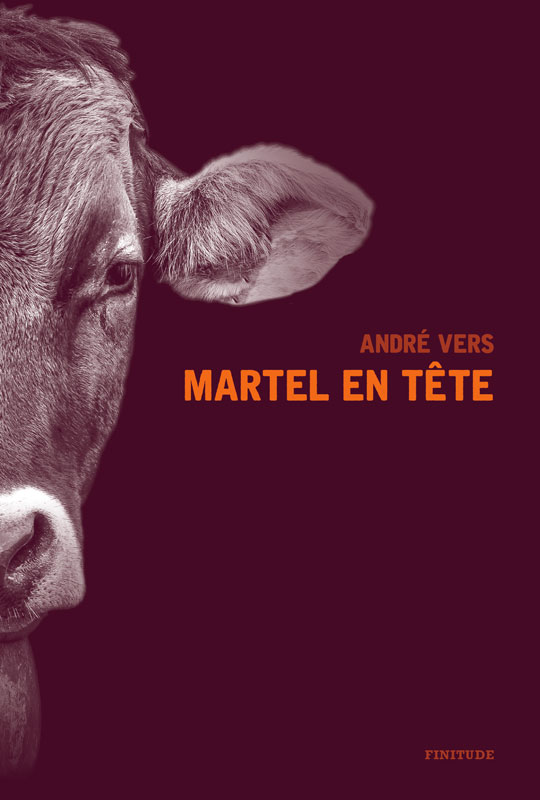
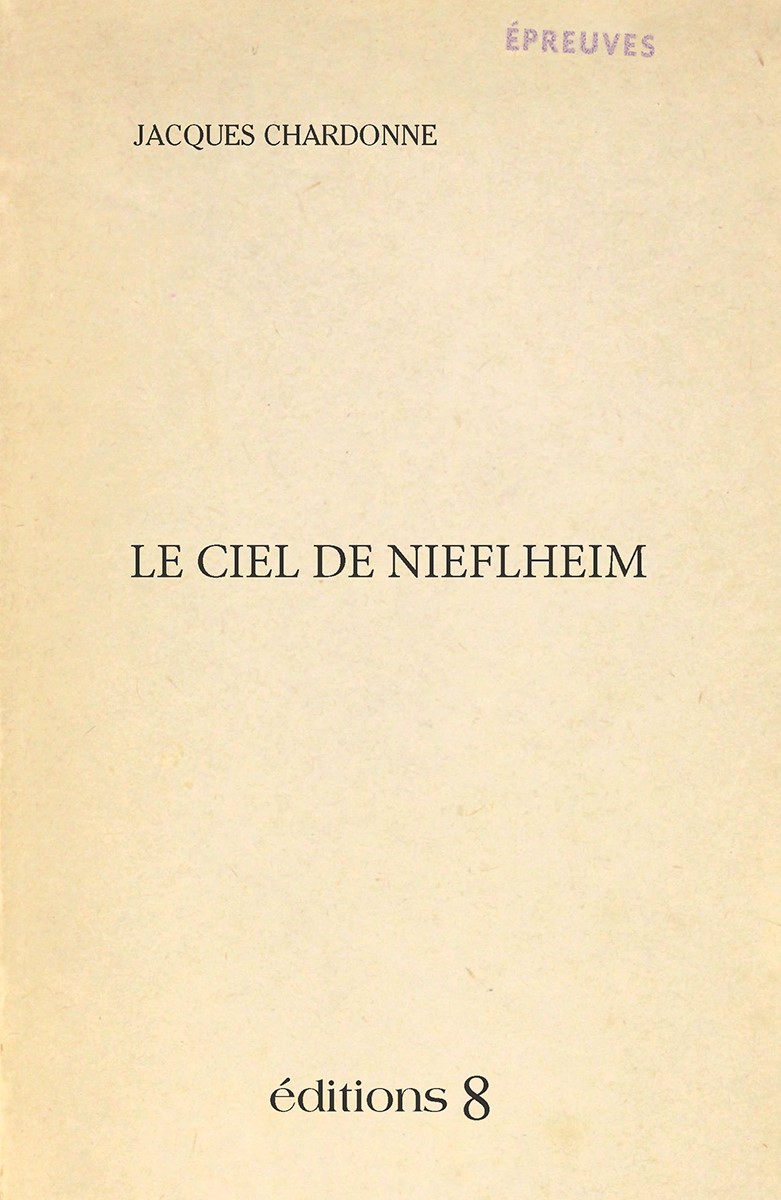
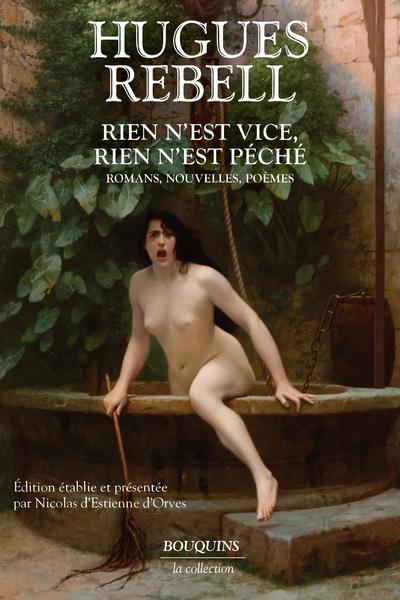
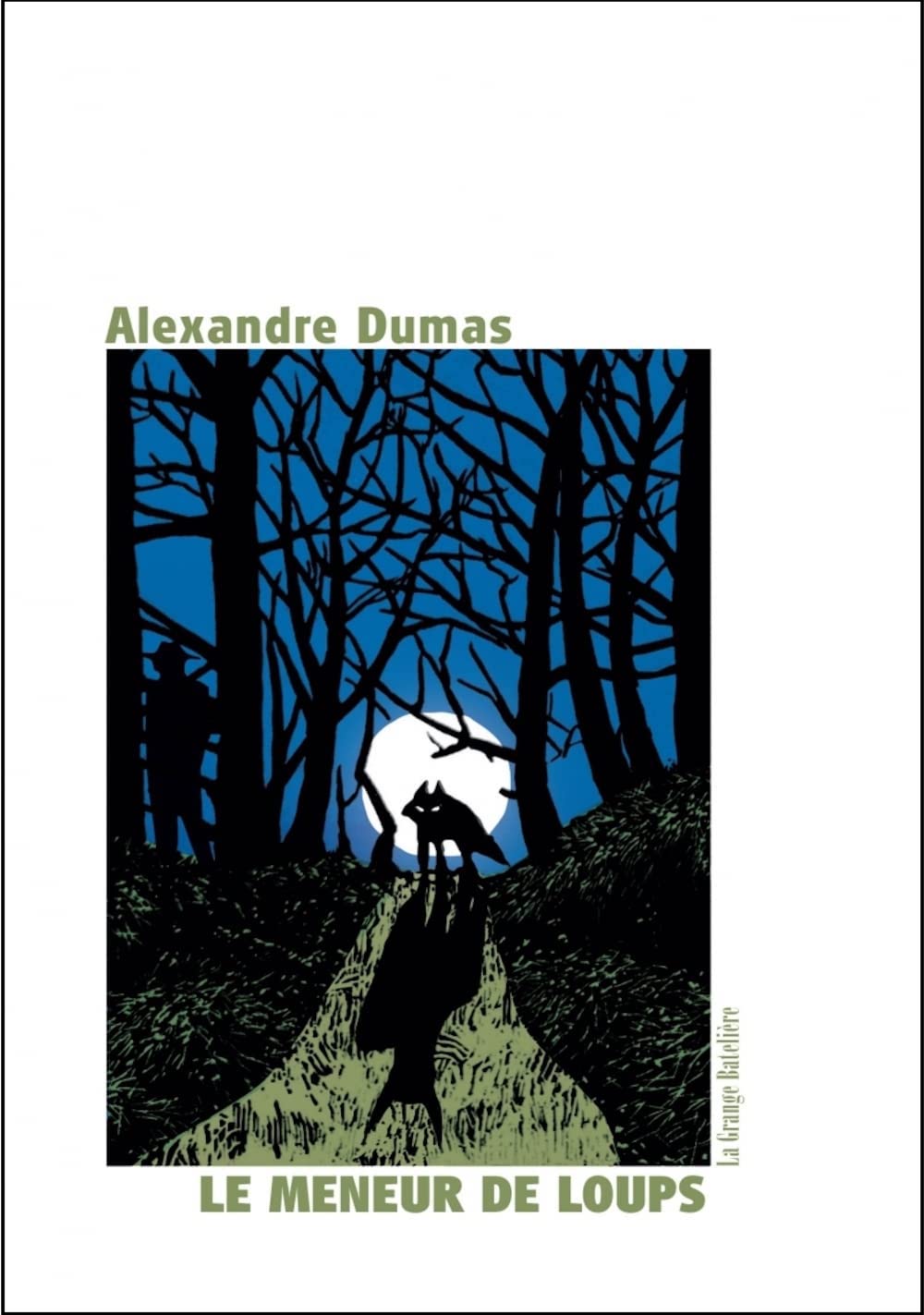

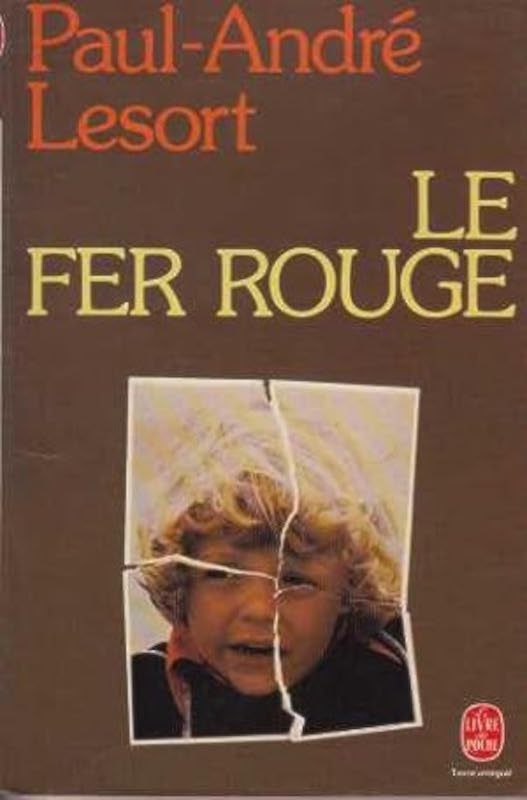


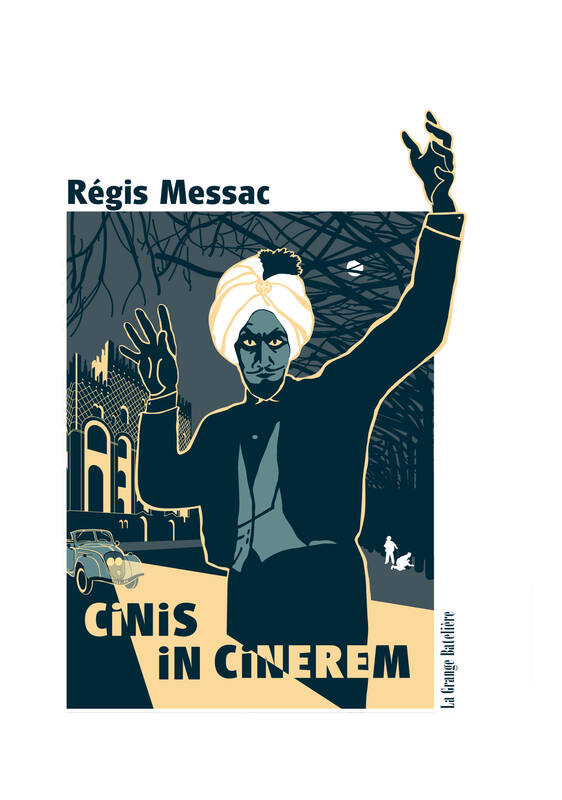

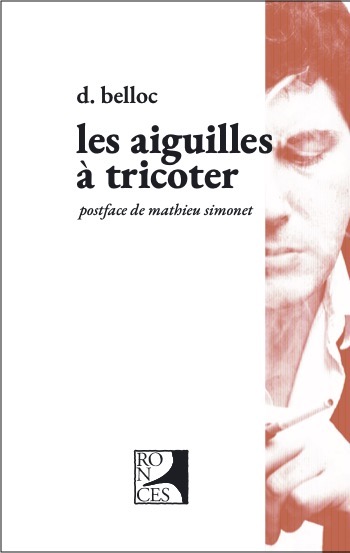
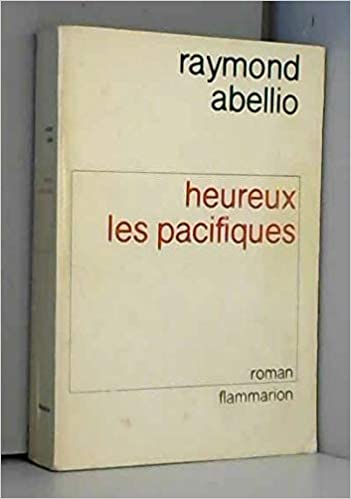
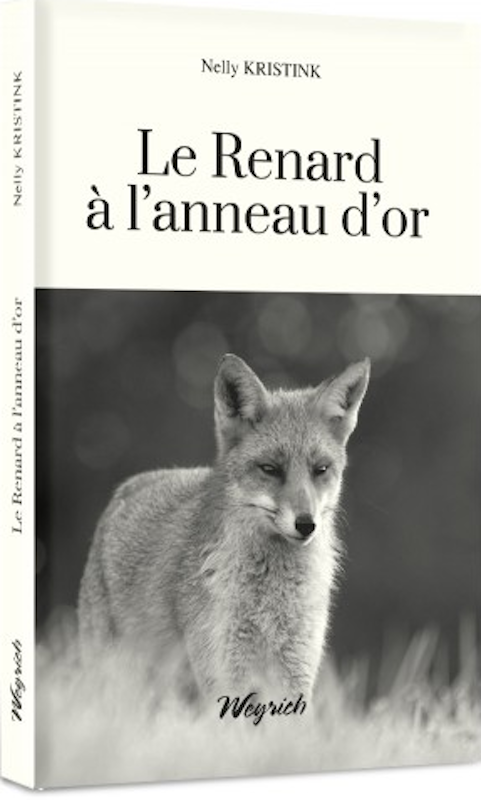
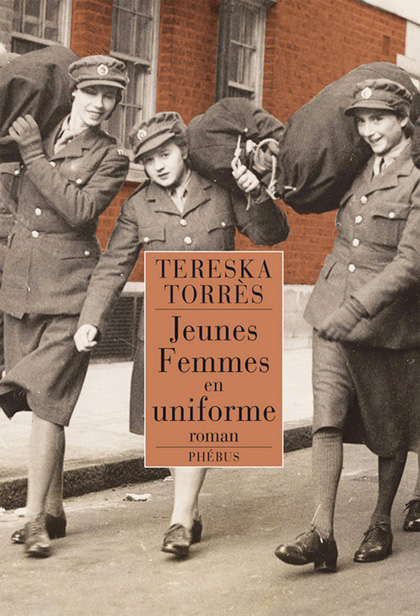
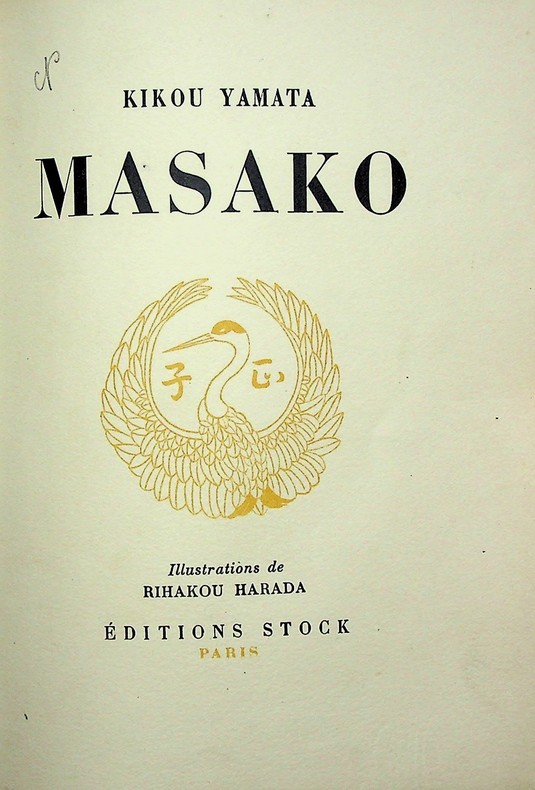
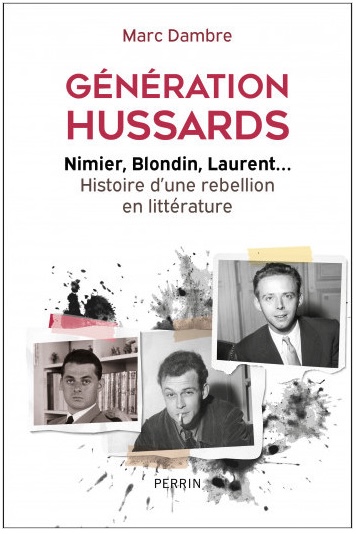
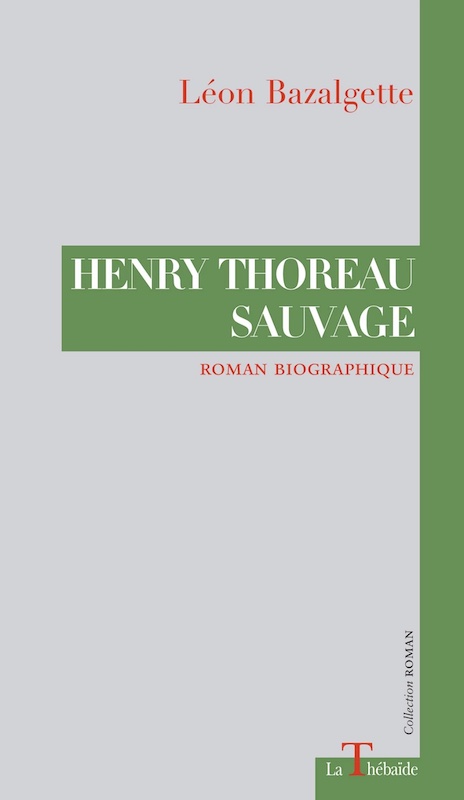

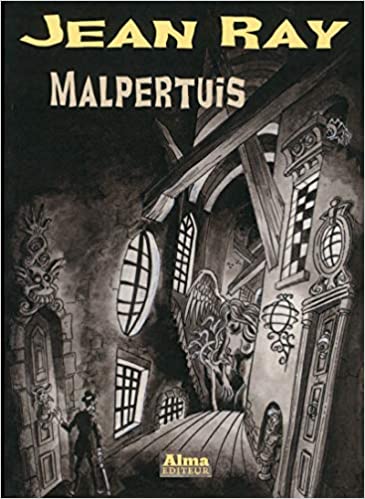
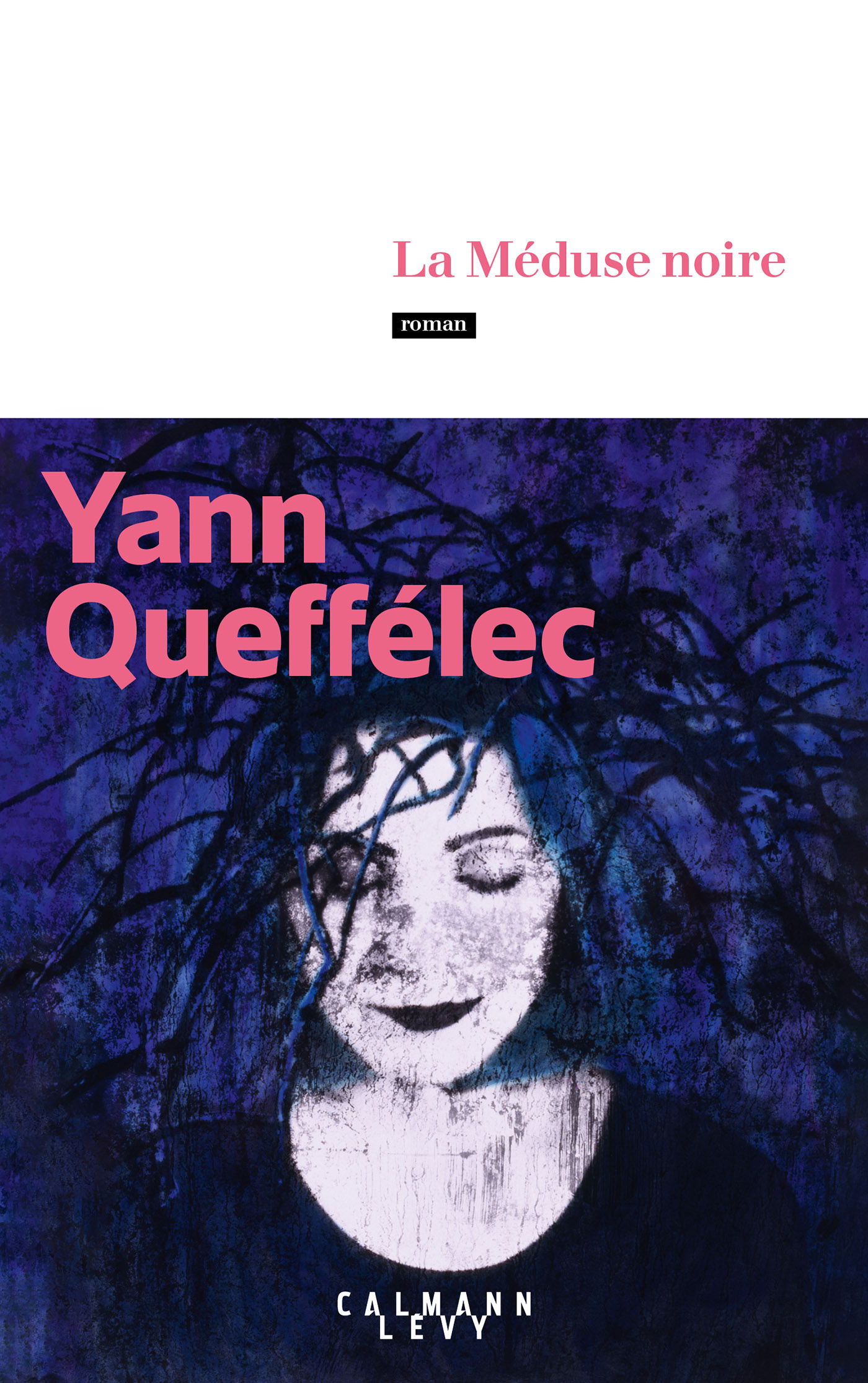


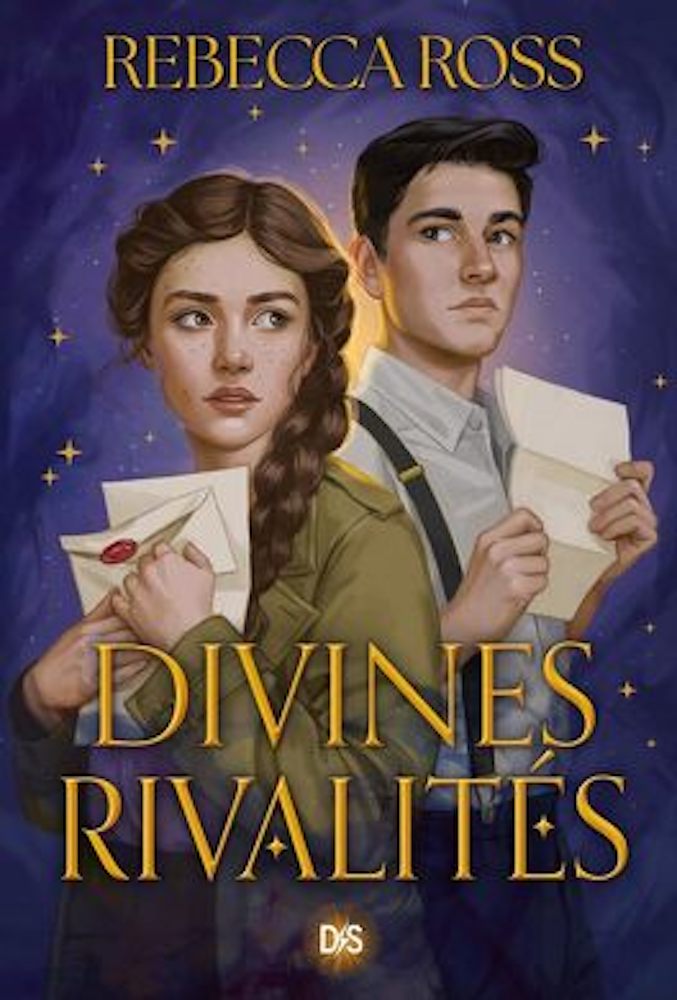



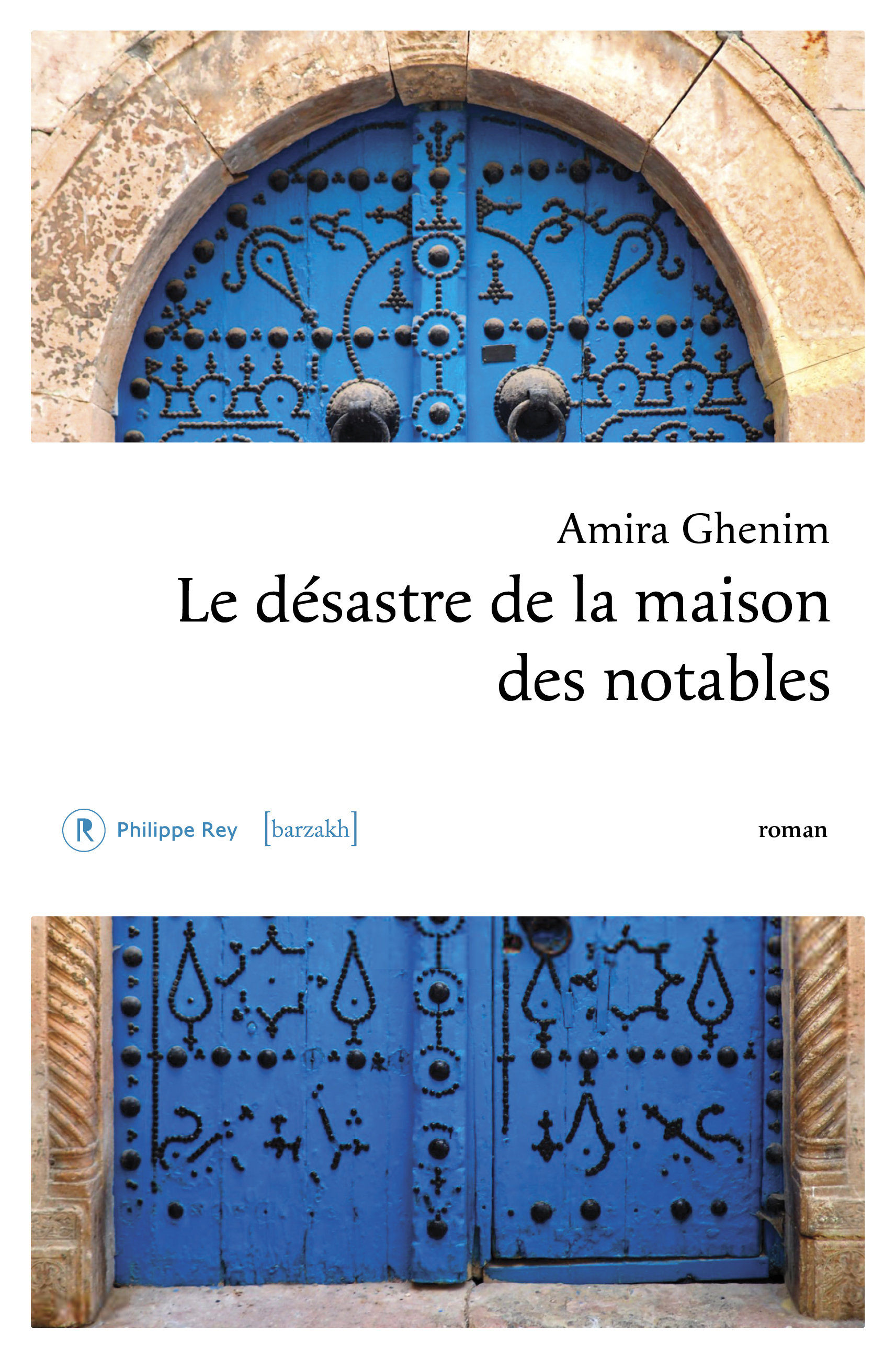
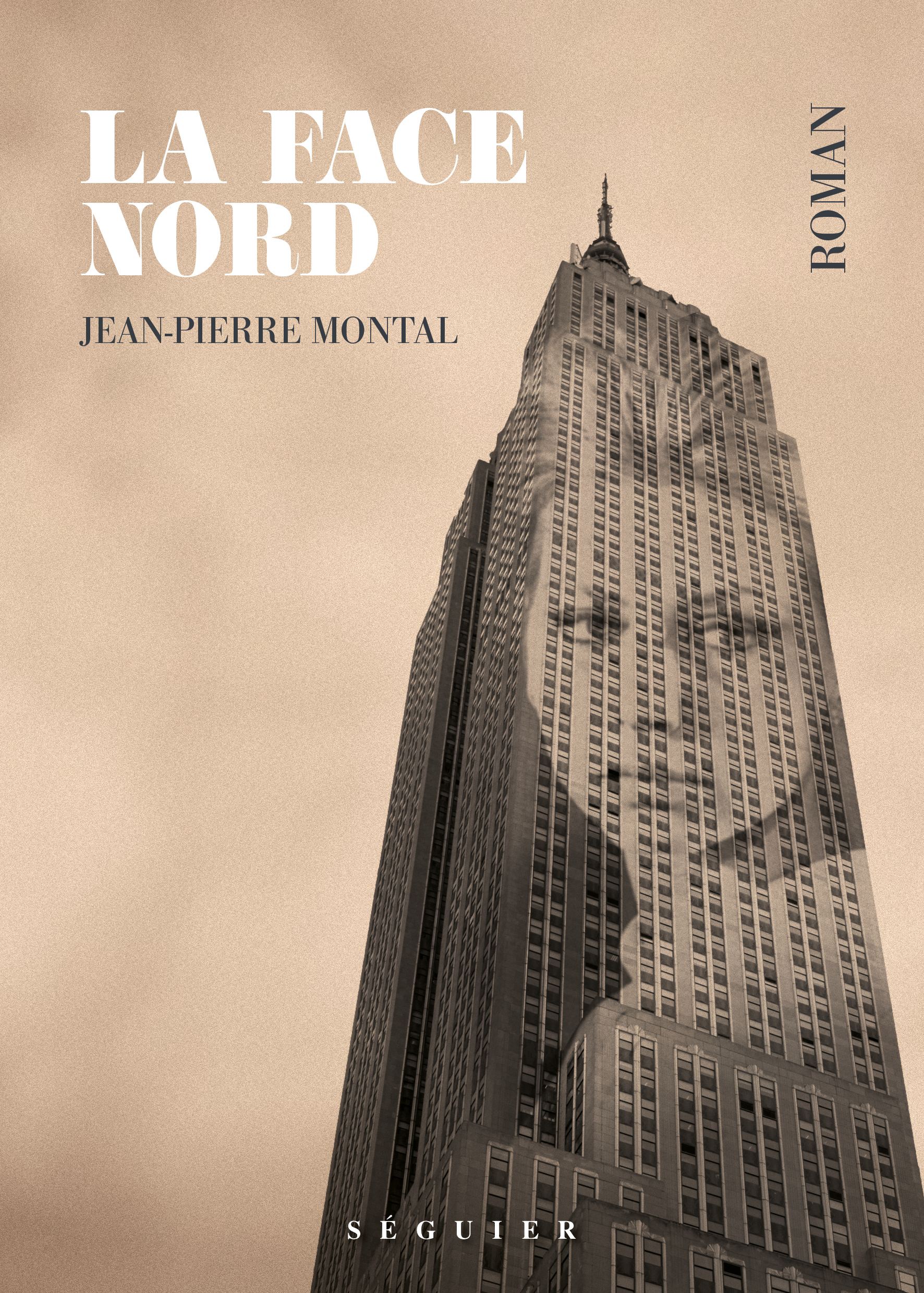



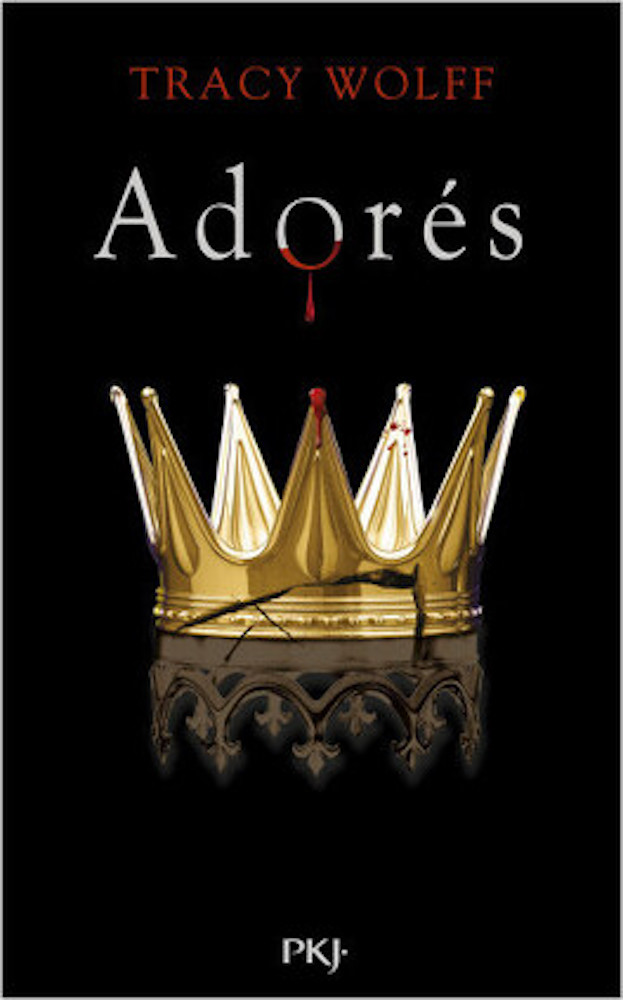
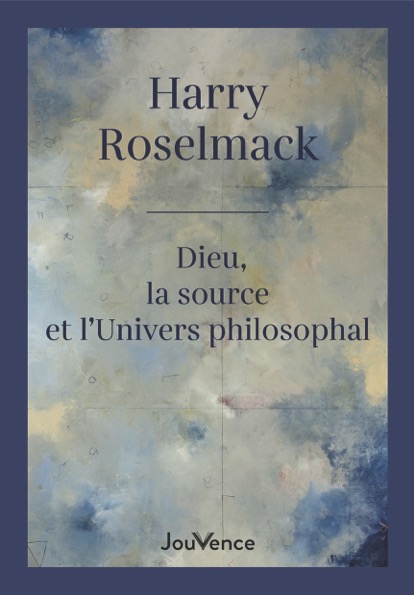
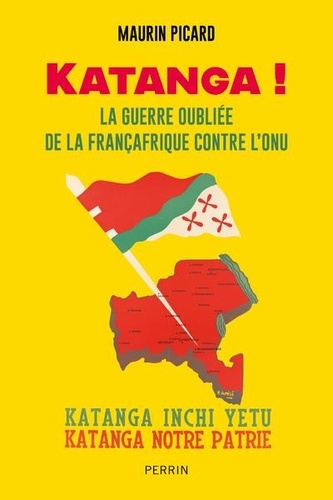

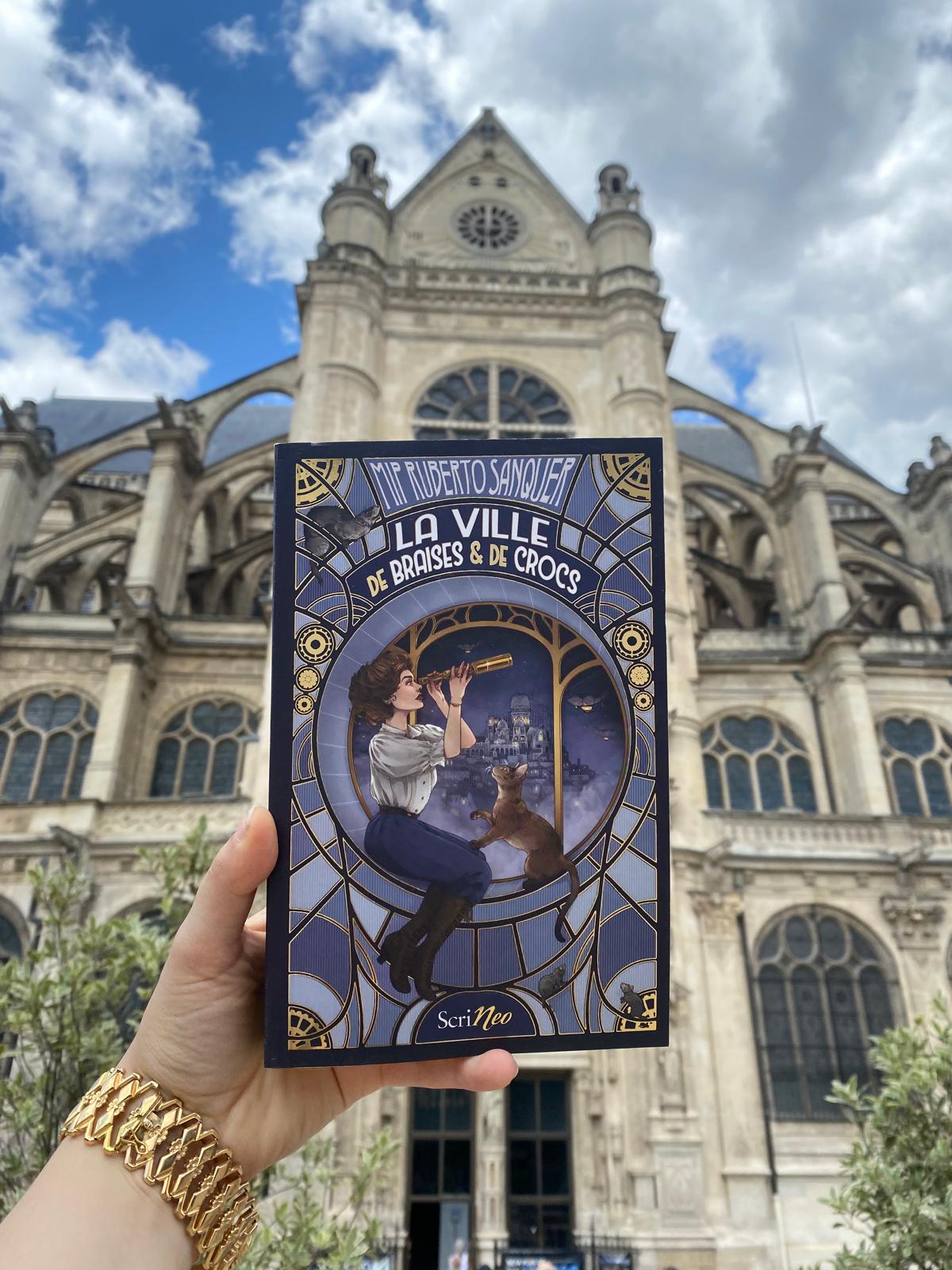
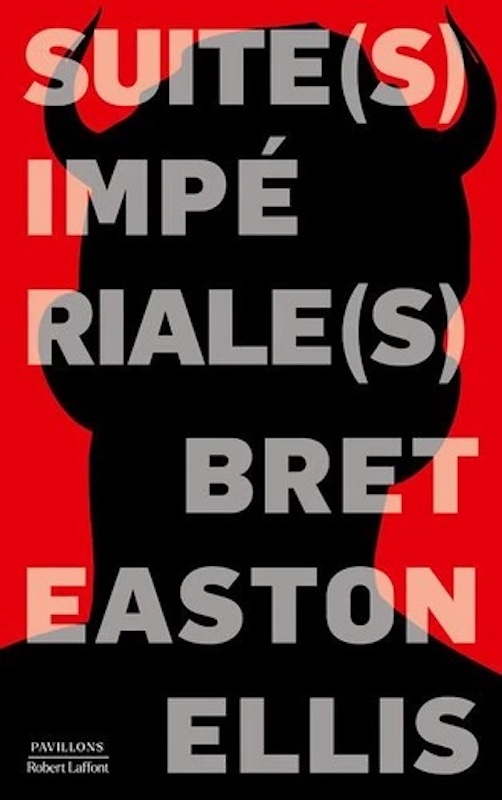




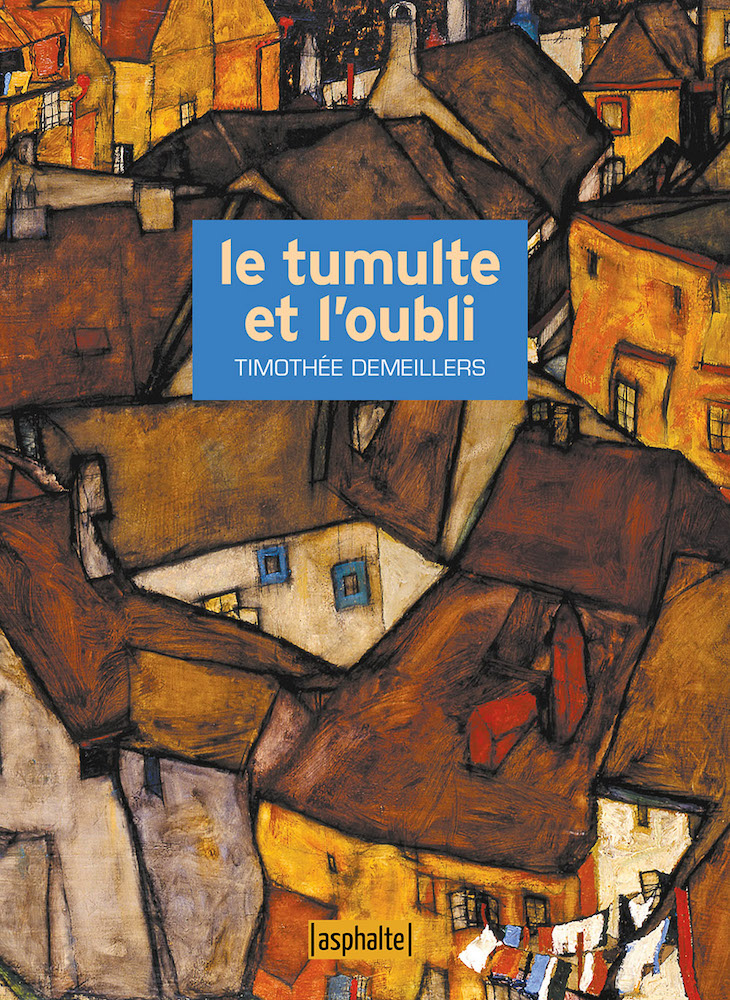


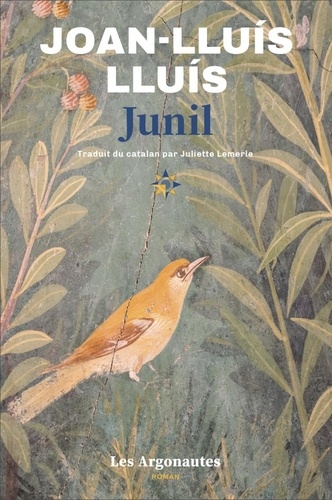

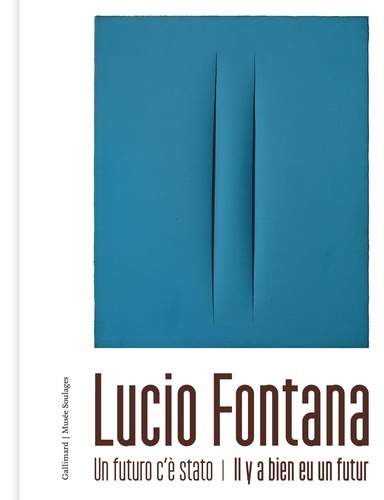


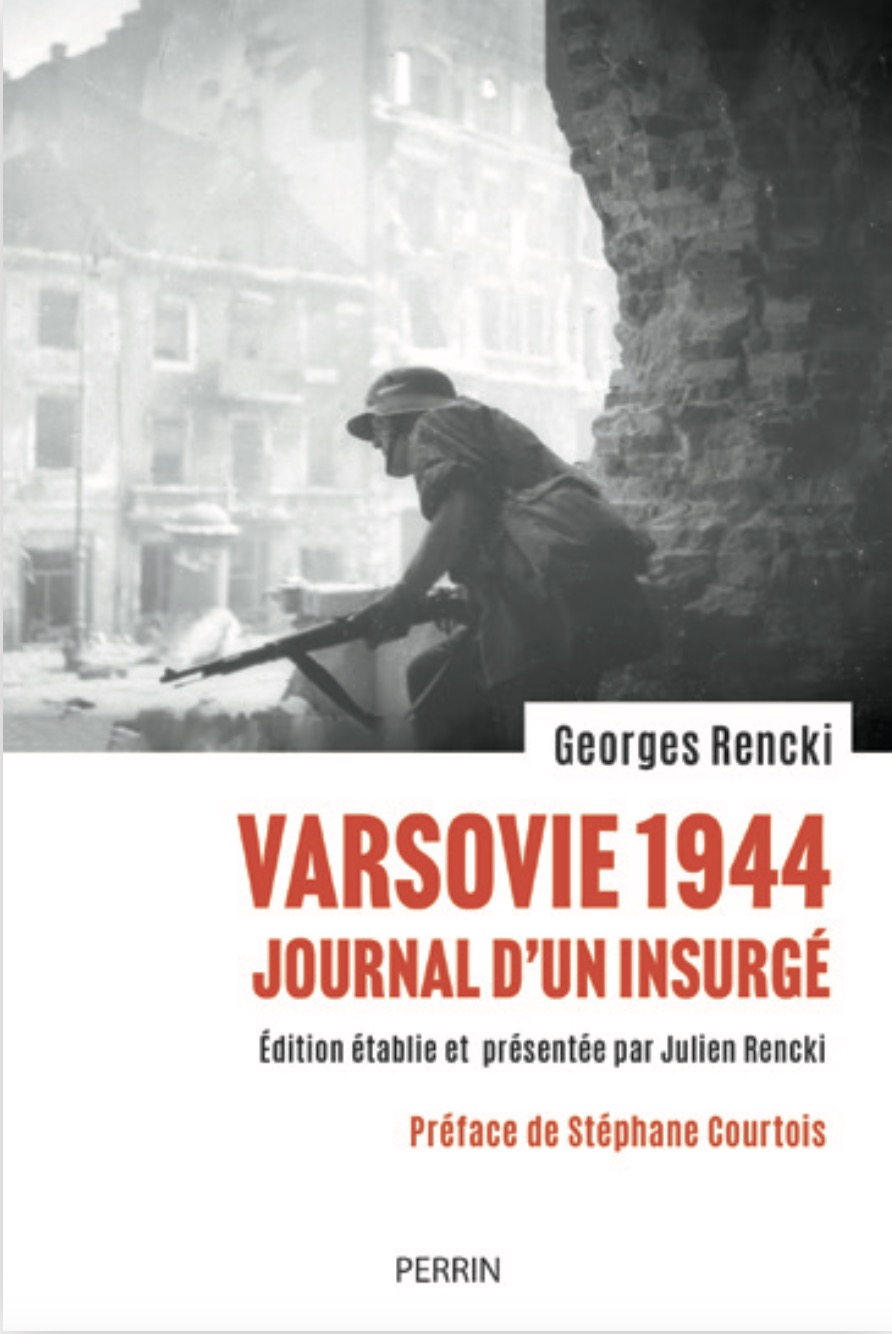
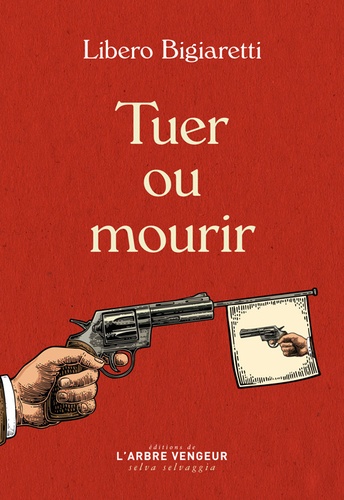

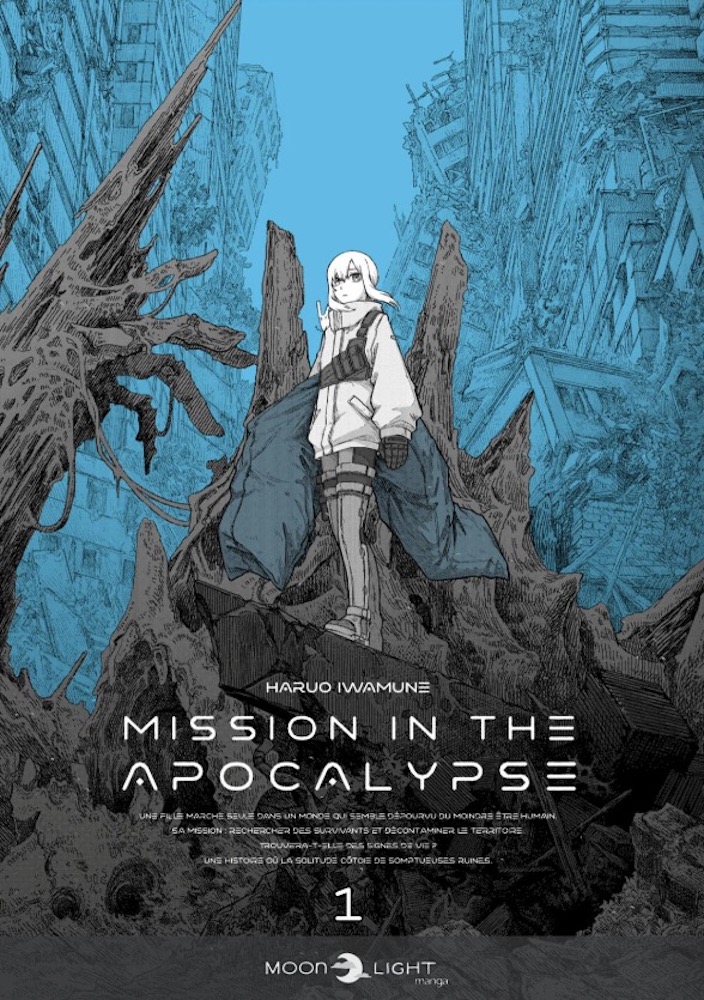


Commenter cet article