Ken Follett dévoile l'écriture de Pour rien au monde, son dernier roman
Exclusif - Sur le chemin de la guerre, le romancier gallois vient de poser une nouvelle pierre : Pour rien au monde (traduit par Odile Demange, Jean-Daniel Brèque, Nathalie Gouyé-Guilbert, Dominique Haas et Christel Gaillard-Paris) envisage un conflit d'une nouvelle ampleur. « L’histoire la plus réaliste que j’aie jamais écrite », nous avait-il confié. Avec le concours des éditions Robert Laffont, l'écrivain nous raconte la construction de son ouvrage, dans sa conception même.
Le 10/11/2021 à 13:53 par Victor De Sepausy
2 Réactions | 444 Partages
Publié le :
10/11/2021 à 13:53
2
Commentaires
444
Partages

Pour rien au monde se déroule à l’époque présente, mais a été inspiré par des événements survenus il y a plus d’un siècle.
Je me suis intéressé aux prémices de la Première Guerre mondiale pendant la rédaction de La Chute des géants et j’ai eu la surprise de constater qu’aucun des dirigeants de l’époque n’avait vraiment voulu d’un conflit européen. Pourtant, la suite de décisions mineures, parfaitement rationnelles, qu’ont prises les empereurs et les chefs de gouvernement a débouché sur la guerre, la plus effroyable que l’espèce humaine ait jamais connue.
Cette prise de conscience m’a incité à me poser cette question : l’histoire pourrait-elle se répéter ? En faisant abstraction de l’éventualité d’une guerre nucléaire déclenchée par accident ou par un dirigeant mentalement déséquilibré comme Donald Trump, peut-on imaginer que des hommes raisonnables se trouvent entraînés malgré eux dans une Troisième Guerre mondiale ?
À LIRE: Ken Follett : “L’histoire la plus réaliste que j’aie jamais écrite”
Je discerne quatre étapes sur le chemin de la guerre : l’étincelle, l’escalade, la menace existentielle et l’engagement.
Chacun sait que l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, a été assassiné par un nationaliste bosnien à Sarajevo le 28 juin 1914. C’est l’étincelle qui a allumé le feu, et ma première tâche en écrivant Pour rien au monde a été d’imaginer quel pourrait être le point d’ignition d’une Troisième Guerre mondiale.
J’ai posé la question à plusieurs personnes très au fait des affaires internationales au plus haut niveau et qui ont eu la bonté de m’accorder des entretiens : l’ancien Premier ministre Gordon Brown, la baronne Ashton, qui occupa le poste de Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sir Kim Darroch – qui fut ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington avant d’avoir des démêlés avec le président Trump – et un certain nombre d’universitaires.
Un point d’ignition est un lieu où un conflit est susceptible d’impliquer les principales puissances. Aujourd’hui, les possibilités ne manquent pas : l’Ukraine, le détroit d’Ormuz, le Cachemire, Taïwan, différents sites de la mer de Chine méridionale, pour n’en citer que quelques-uns.
Riposte et proportionnalité

Dans Pour rien au monde, les dirigeants mondiaux – le président des États-Unis, son homologue chinois et d’autres chefs d’État – parviennent à surmonter un certain nombre de menaces minimes, jusqu’au jour où ils doivent affronter une crise plus grave. L’étape suivante est l’escalade.
En 1914, l’empereur François-Joseph estima devoir punir la Serbie, un satellite faible et secondaire de l’Empire austro-hongrois, et lui déclara la guerre. Il gravit ainsi le premier barreau de l’échelle de l’escalade.
François-Joseph était un vieillard arrogant de 83 ans, ultraconservateur et d’un catholicisme rigide. Certains membres de l’élite dirigeante autrichienne estimaient que s’il était effectivement nécessaire de châtier la Serbie, il aurait été possible de recourir à d’autres mesures que la guerre. Mais, tout bien considéré, on s’accorda généralement à juger l’action de François-Joseph raisonnable selon les critères de l’époque.
Il n’empêche que la déclaration de guerre à la Serbie inquiéta les Russes. La Serbie appartient à la région des Balkans qui jouxte à la fois l’Autriche et la Russie, deux grands empires à l’époque, et toute intrusion dans cette zone par l’un ou l’autre camp était considérée comme une agression. Le tsar Nicolas II mobilisa donc l’armée russe.
Là encore, une réaction plus modérée aurait été suffisante, mais les généraux russes affirmèrent au tsar qu’une mobilisation partielle était impossible. Ils appelèrent donc sous les drapeaux l’intégralité de leur armée de trois millions d’hommes. Rétrospectivement, on peut y voir une réaction excessive, mais sur le moment, on la jugea légitime. Il s’agissait pourtant du deuxième barreau de l’échelle.
Ce n’était pas une déclaration de guerre. On ne déplora aucun mort. Le tsar Nicolas II n’imagina pas un instant avoir déclenché une conflagration.
Une Europe embrasée
Il n’est que trop facile de voir comment un enchaînement de ce genre pourrait se produire de nos jours. Les Américains renforcent leurs sanctions contre l’Iran, et les Iraniens s’emparent d’un pétrolier dans le détroit d’Ormuz. Les Canadiens arrêtent la directrice financière d’Huawei, et les Chinois appréhendent deux Canadiens qu’ils accusent d’espionnage. La 6e flotte américaine bombarde un village libanais et le Hezbollah lance des roquettes contre la caserne des marines à Beyrouth. Il arrive que des responsables politiques s’abstiennent d’exercer des représailles, mais cela ne leur vaut généralement pas la gratitude de leurs électeurs, désireux que leur pays projette une image de force.
Examinez maintenant la position de l’empereur allemand alors que trois millions de soldats russes commencent à se masser sur les frontières que partage leur pays avec l’Allemagne et l’Autriche, alliée de l’Allemagne. L’empereur Guillaume devait mobiliser l’armée allemande – en fait, toute autre attitude eût été un manquement à son devoir équivalant à une trahison. L’Europe gravit donc ainsi un barreau supplémentaire de l’échelle.
Mais l’Allemagne ne jugea pas cette mesure suffisante. Le haut commandement allemand pensait pouvoir vaincre la Russie ou la France, mais pas les deux à la fois. Aussi le gouvernement demanda-t-il à la France de s’engager à rester neutre dans l’éventualité d’une guerre entre l’Allemagne et la Russie.
L’Allemagne avait de bonnes raisons de craindre un coup de poignard dans le dos. Quarante-trois ans auparavant, à la fin de la guerre franco-prussienne, elle avait pris l’Alsace et la Lorraine à la France, qui voulait récupérer ces territoires.
Mais la France était liée à la Russie par un traité de défense qu’une déclaration de neutralité aurait violé. Les traités peuvent toujours être rompus, certes, mais il était de toute évidence dans l’intérêt de la France de conserver un allié aussi puissant que la Russie.

Une fois encore, nous pouvons dire avec le recul que si René Viviani, le président du Conseil français, avait engagé des pourparlers de paix sous une forme ou une autre avec l’empereur Guillaume, il aurait sans doute pu épargner des millions de vies françaises. Cette fois encore, peu en eurent conscience à l’époque. Quoi qu’il en soit, Viviani refusa purement et simplement de répondre favorablement à l’assurance que réclamaient les Allemands.
Aux yeux du Kaiser, c’était une menace existentielle, une menace contre l’existence même de son pays – lequel, rappelez-vous, n’avait que quarante-trois ans d’existence. Ce fut un moment clé. Une simple tension se transforma en danger immédiat.
L’Allemagne était menacée à l’est et à l’ouest. Le haut commandement de Berlin pensait, sans doute à juste titre, que sa seule chance de survie était de neutraliser la France – ce qu’il pensait pouvoir faire très vite, et il n’avait pas tort. Ensuite, leurs arrières étant ainsi assurés, les soldats allemands pourraient se retourner pour faire face à leur ennemi plus redoutable sur la frontière de l’Est.
C’est ainsi que l’on arriva rapidement à la dernière étape, l’engagement. L’Allemagne envahit la France, et ce fut l’apocalypse.
De la fiction à la réalité
Il y a un moment similaire dans Pour rien au monde. Je ne veux pas révéler une trop grande part de l’intrigue, mais un chef d’État s’y dit : « Mon pays est sur le point d’être rayé de la carte. Quant à moi, je vais probablement être assassiné ; je n’ai rien à perdre. Je vais donc utiliser les armes les plus terribles dont je dispose. »
En 1914, seuls les premier et dernier dominos disposèrent d’un vrai choix. L’empereur François-Joseph d’Autriche aurait pu préférer une réaction moins incendiaire à l’assassinat de Sarajevo ; et concernant la dernière décision fatale avant le début du massacre, les Britanniques pouvaient choisir d’intervenir ou non dans le conflit.
La Grande-Bretagne avait conclu un traité défensif avec la France, mais celui-ci aurait pu être rompu au prétexte qu’en refusant de déclarer sa neutralité, la France avait elle-même attiré la foudre sur sa tête. Les Britanniques tenaient pourtant à jouer un rôle. Notre histoire a montré à maintes reprises que nous avons toujours considéré le pays le plus puissant du continent européen comme notre ennemi et avons donc généralement fait cause commune avec la deuxième nation occidentale la plus forte, afin de nous assurer qu’il n’y aurait jamais de rival sérieux à notre hégémonie.
C’est ainsi, plus ou moins par accident, que la Première Guerre mondiale fut déclenchée.
Le cœur de mon roman, et l’aspect le plus fascinant de tout cela à mes yeux, est la partie médiane, l’escalade de la crise. Comment des dirigeants centristes, modérés, prennent-ils des décisions qui conduisent à une guerre catastrophique ? Pourquoi les dirigeants japonais choisirent-ils en 1941 d’attaquer les États-Unis – la nation la plus riche, la plus puissante de l’histoire de la civilisation humaine ? Comment le président Lyndon Johnson s’empêtra-t-il lentement et inexorablement au Vietnam, ruinant sa réputation en même temps que son pays ? Comment Tony Blair put-il être assez imprudent pour engager le Royaume-Uni dans une guerre organisée par George W. Bush, le président américain le plus ignorant et le plus incompétent depuis un siècle ?
J’ignore évidemment les réponses à toutes ces questions, mais je propose un nouvel éclairage. Le romancier, qui utilise des personnages de fiction, a toute latitude d’imaginer les émotions intérieures et les processus de réflexion d’hommes et de femmes qui prennent des décisions propres à changer la face du monde. Pour rien au monde établit un parallèle entre Washington et Pékin. Les deux chefs d’État – dans mon livre, des personnes intelligentes et bien intentionnées – essaient de se livrer à un numéro d’équilibrisme. La présidente américaine, une républicaine, cherche à éviter la guerre tout en repoussant les attaques nationalistes de son belliqueux rival aux primaires. Le président chinois est un progressiste dans l’âme, mais il a les mains liées par les communistes radicaux qui détiennent le pouvoir ultime.
La plupart des gouvernants doivent affronter le problème de la lutte contre les opinions extrêmes au sein de leur propre base politique ; c’est le cas par exemple de Boris Johnson, confronté à la vieille garde conservatrice, ou de Joe Biden, qui doit faire face à la faction de Bernie Sanders. Dans les démocraties, les responsables politiques ne peuvent pas rester sourds à l’opinion publique. Or les gens détestent que leur pays donne une image de faiblesse, et cette pression pousse les leaders à prendre des décisions un peu plus risquées qu’ils ne le souhaiteraient.
Pendant un certain temps, aucune de ces décisions n’est suffisante en soi pour avoir des conséquences fatales. La déclaration de guerre de François-Joseph à la Serbie n’était pas condamnée à apparaître comme une menace pour la Russie ; le tsar et le Kaiser auraient pu trouver un modus vivendi. Mais à un moment, une de ces décisions devient existentielle.
En 1914, les Allemands ont eu l’impression que la France à l’ouest et la Russie à l’est allaient les prendre en étau et ont craint que la nation prospère qu’ils avaient créée au cours du demi-siècle précédent ne disparaisse purement et simplement, à l’exemple de la Pologne. Dans de telles circonstances, les nations prennent des risques. L’empereur Guillaume ne voulait pas la guerre ; mais si celle-ci était inévitable, il tenait à la mener à ses propres conditions. C’est pourquoi il a envahi la France.
Et ce n’était pas fini. Les Russes auraient pu ne pas intervenir, mais ils ont envahi l’Allemagne par l’est. Les Britanniques auraient pu rester à l’écart du conflit, auquel cas la bataille de France aurait été courte et bien des vies auraient été épargnées. Mais, une fois encore, les responsables nationaux ont pris des décisions qui leur paraissaient raisonnables, inévitables peut-être ; et le résultat fut quatre années d’un massacre d’une ampleur qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.
C’est ainsi que mon histoire se construit : une série de conflits mineurs, dont l’un est plus dangereux que d’ordinaire ; une escalade graduelle dans laquelle chaque action provoque une réaction plus agressive ; un moment existentiel où un pays considère que son existence même est en jeu ; puis la décision ultime : déclencher ou non une guerre nucléaire. Je ne vous dirai pas si celle-ci a réellement lieu dans ce livre ; quand vous le lirez, vous ne le saurez pas avant la dernière page. Et alors, quand vous connaîtrez la fin, je vous demande de bien vouloir ne la révéler à personne.
Ken Follett
Ken Follett © Barbara Follett ; © Olivier Favre 51
Pour rien au monde
Paru le 10/11/2021
777 pages
Robert Laffont
24,90 €



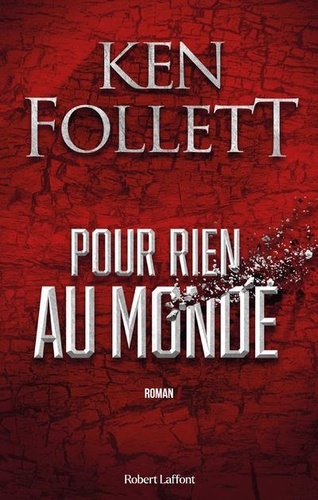




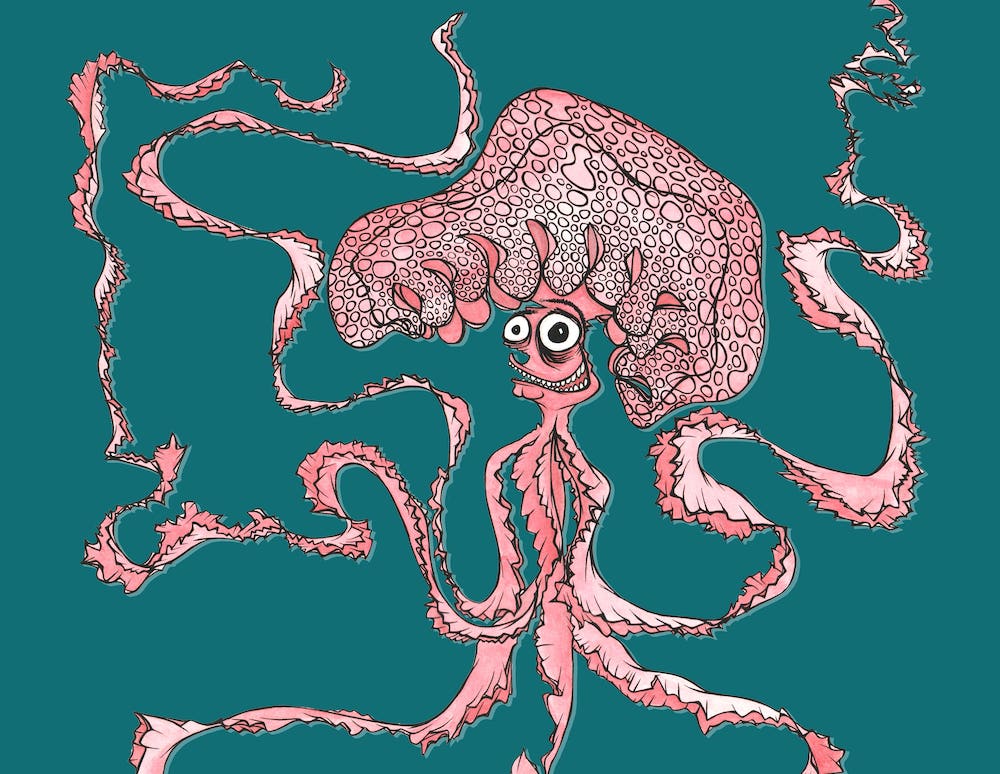


















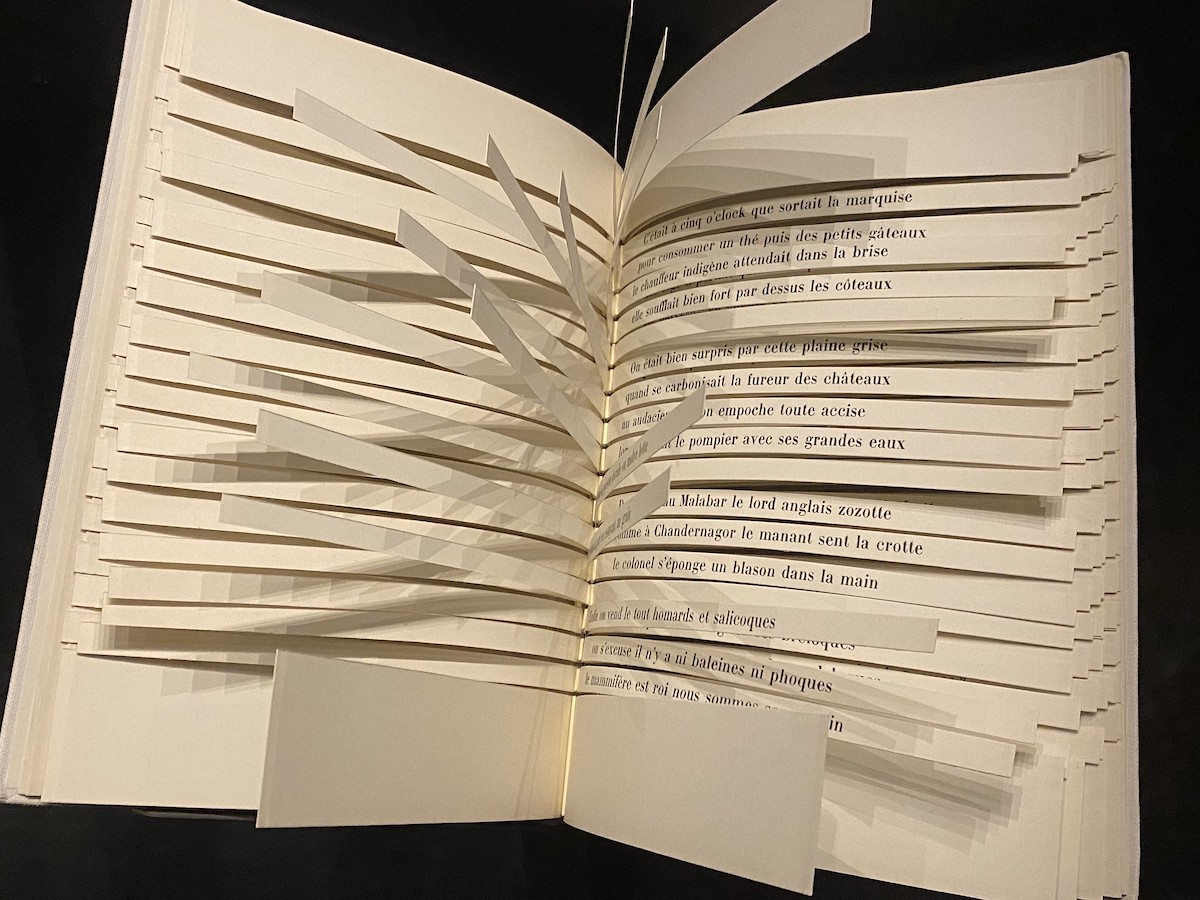

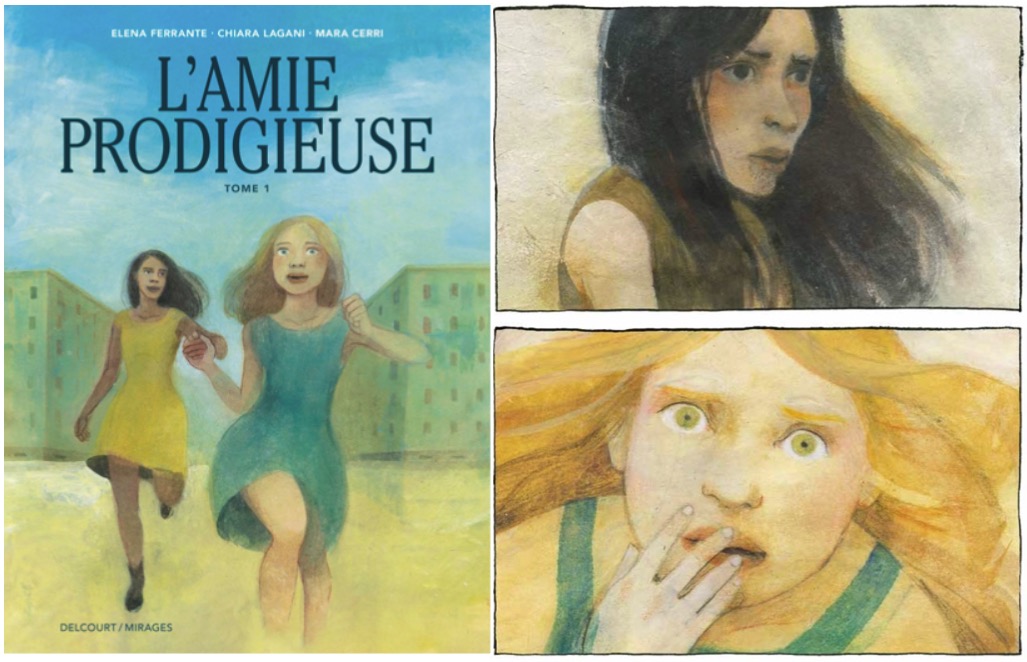











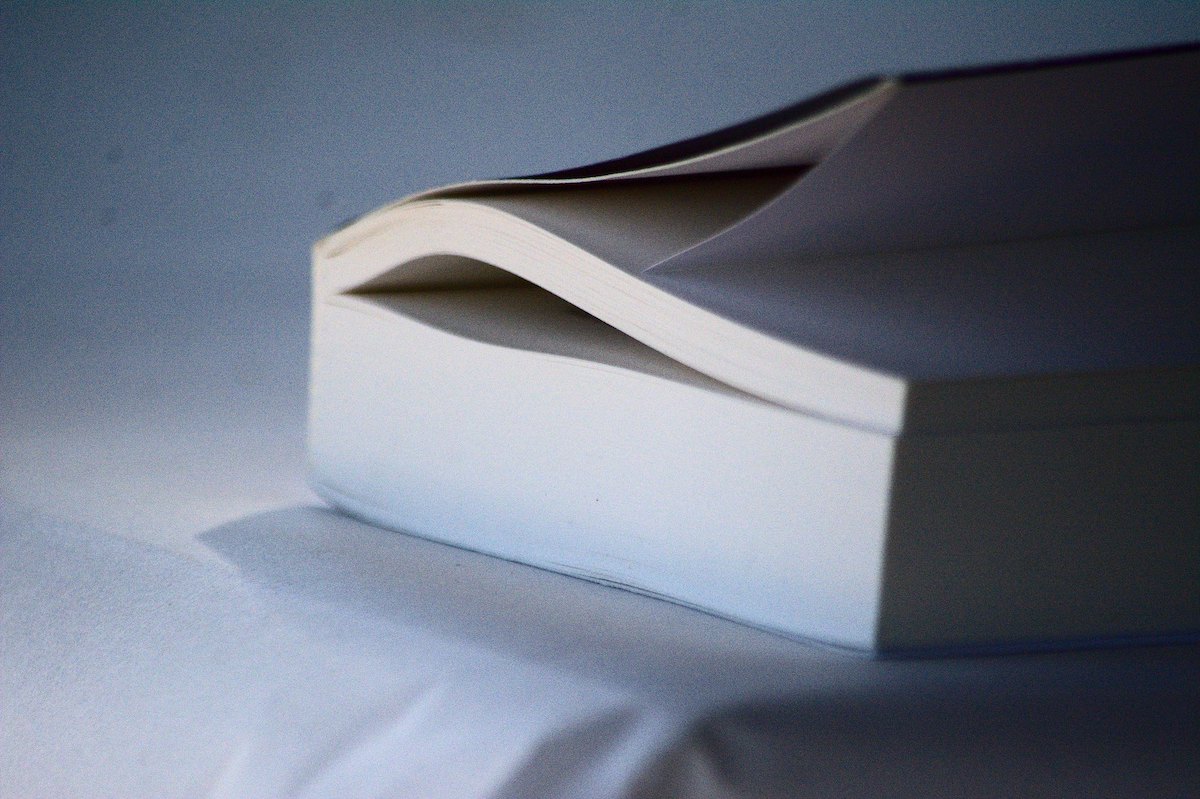

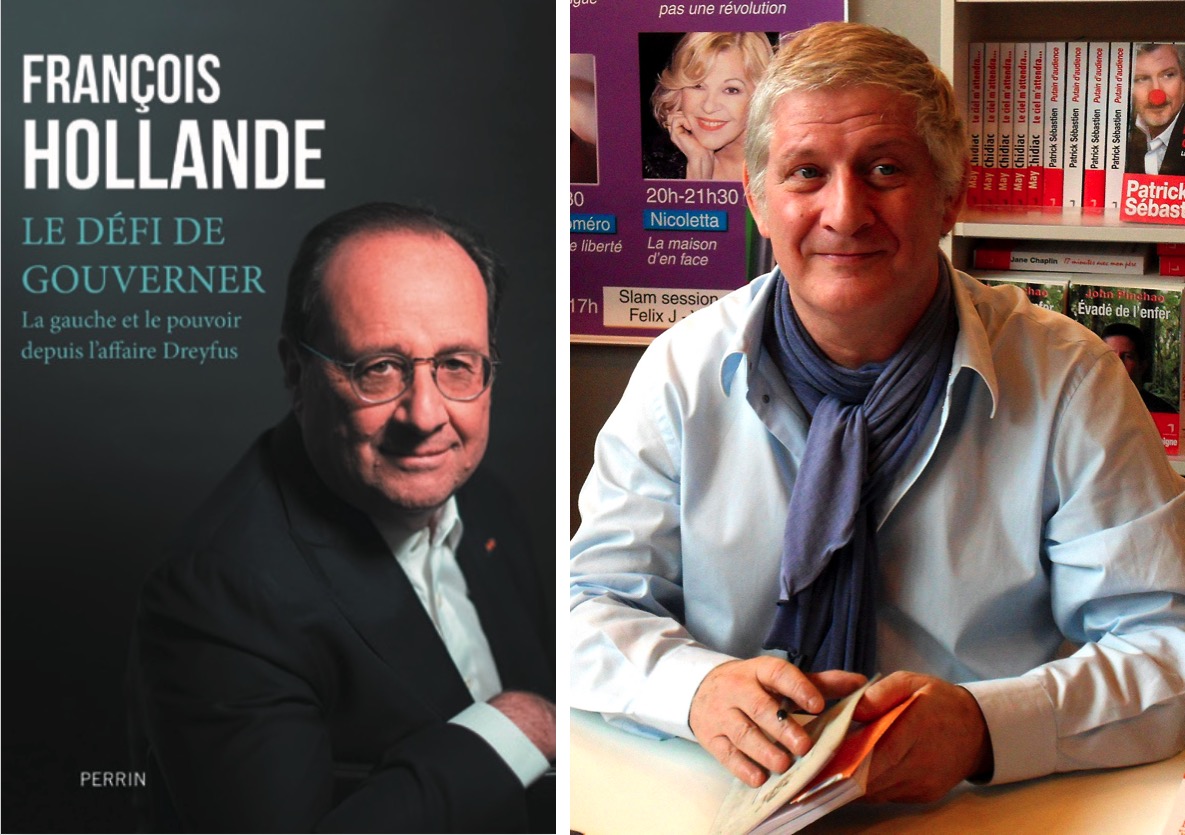









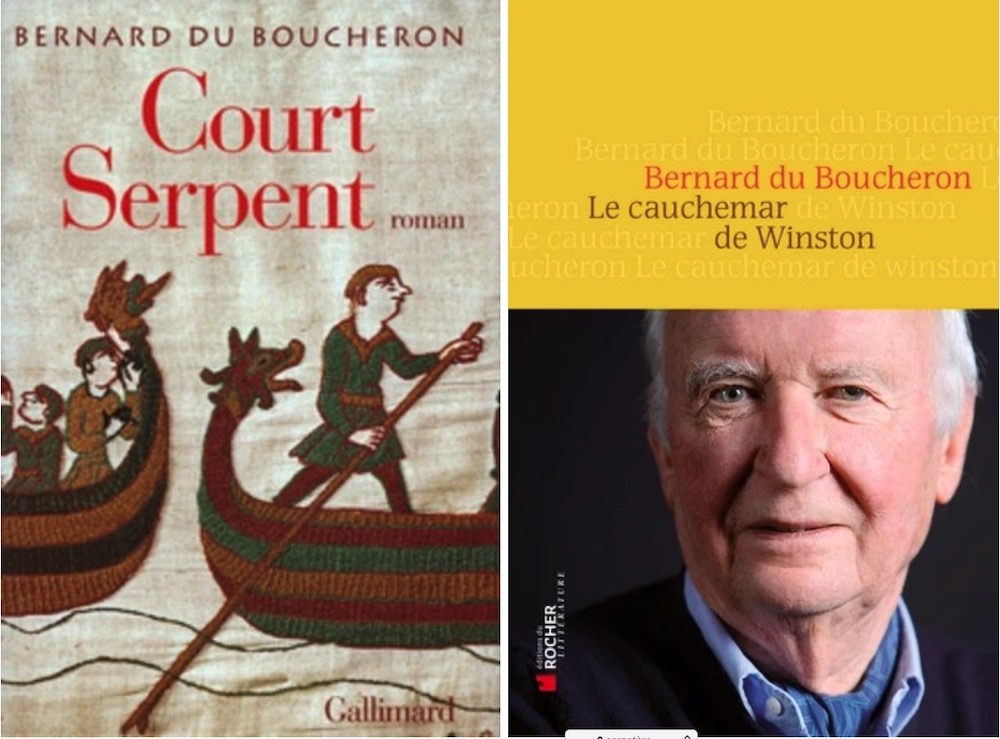



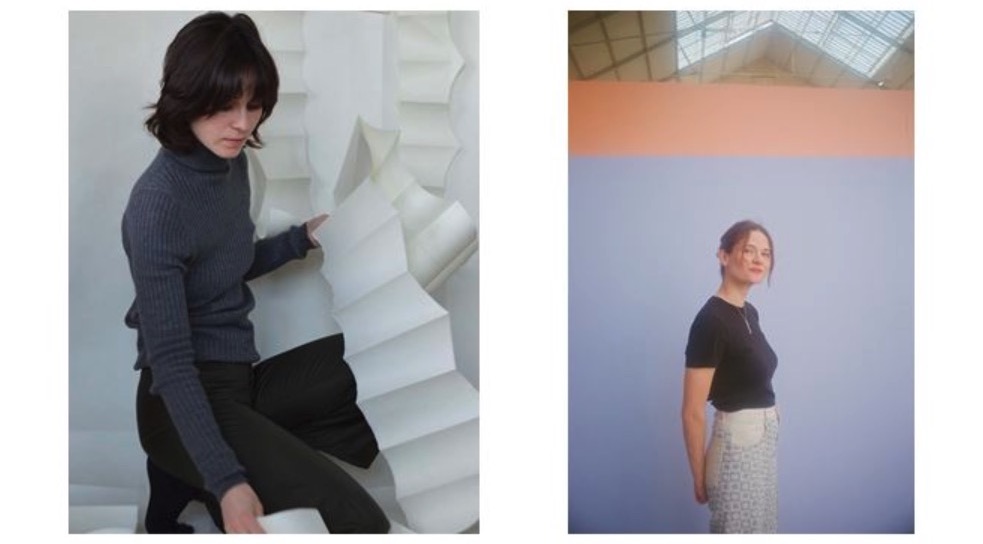


















2 Commentaires
Historia
11/11/2021 à 08:17
La vision de Ken Follett est historiquement fausse. Les traités ont toujours été signés pour être respectés. Un traité oblige donc les contractants. Ainsi, aujourd'hui, si les Turques agressent les Grecs, la France sera obligée d'entrer en guerre contre la Turquie (cf. le dernier traité signé par Macron avec la Grèce).
Un traité dénoncé - comme le souligne Follett pour éviter la guerre - conduit en général au pire. Par exemple, les Soviétiques, alliés des Français dans les années 30, ont dénoncé ce traité au dernier moment en faisant un pacte avec Hitler, lui laissant alors le champ libre pour envahir l'Europe de l'ouest, dont la France. Le résultat d'un traité non assumé est donc aussi la guerre.
Enfin, « En 1914, les Allemands ont eu l’impression que la France à l’ouest et la Russie à l’est allaient les prendre en étau et ont craint que la nation prospère qu’ils avaient créée au cours du demi-siècle précédent ne disparaisse purement et simplement, à l’exemple de la Pologne. » est aussi historiquement faux. Les Allemands ne craignaient rien, trop forts qu'ils étaient (on rappelle qu'ils restaient sur leur écrasante victoire de 1870). Les Allemands en revanche avaient besoin d'air, car sans grandes ressources internes, notamment agricoles. Plus tard, Hitler appellera cela le « lebensraum », l'espace vital, nécessaire au développement de tout pays. D'ailleurs, la France occupée correspond à la partie la plus riche agricole de France, ce qui n'est pas un hasard.
La Chine actuelle est confrontée au même problème : ne trouvant pas les ressources en interne pour se développer, elle se tourne vers l'extérieur pour les trouver. D'où l'inévitable conséquence qui sera la guerre.
Sonic
13/11/2021 à 09:20
Mouais... je viens de le finir et comme d'habitude il y a beaucoup de blabla. Je n'ai pas eu l'impression de lire un thriller ou un roman d'espionnage. La Pdte des États-Unis est appelée "Pauline", l'auteur nous raconte la couleur de son soutif ou de sa doudoune... D'autres chapitres parlent de RV au restaurant et de sexe... Il n'y a que les chapitres consacrés à la Chine et la Corée du Nord qui paraissaient plus crédibles et relevant de l'espionnage. Déçue.