Les Ensablés - Notes de voyage de Laurent Jouannaud: Zola, au bonheur de lire
Ces derniers jours, j’ai relu Zola, oui, comme on réécoute Mozart ou Duke Ellington. Le plaisir de lire, c’est la relecture, de même que le plaisir de la musique vient des morceaux qu’on aime réentendre. Le plaisir vient des retrouvailles, familiarité et répétition. Ce qui est courant en musique l’est moins en littérature : écouter Bach et Ravel, ça vous pose mais relire Racine et Gide, c’est passer pour ringard, être cuistre ou chercher le paradoxe. Je relis beaucoup pour mon plaisir. Parmi mes classiques, il y a Zola.
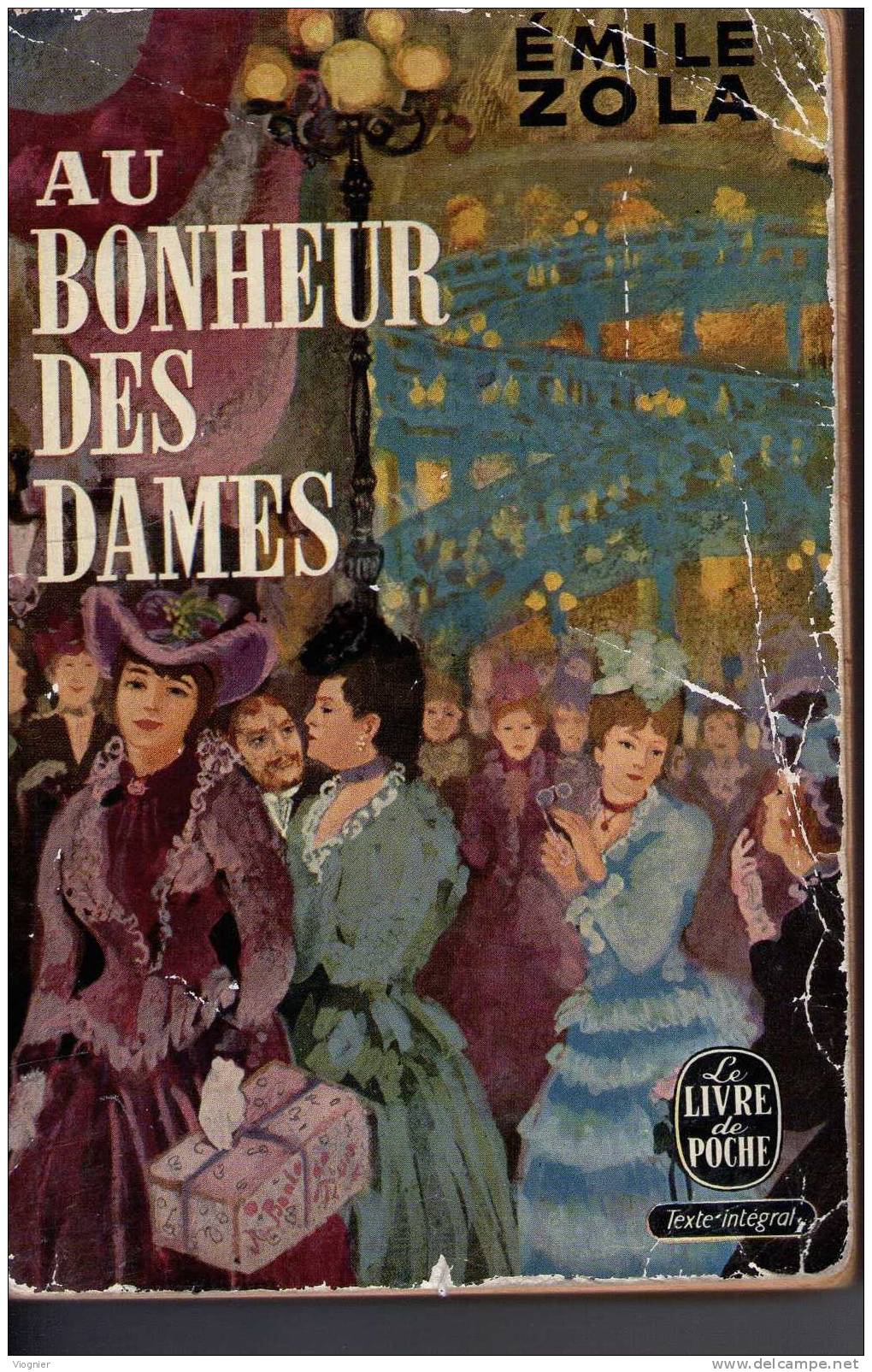
Chers lecteurs, en 2012, Laurent Jouannaud nous enchantait par son amour pour Zola. Voici l'article réédité à l'occasion de ces grandes vacances 2016.
Par Laurent Jouannaud
C’est un monument, personne n’en doute, mais si on a forgé les mots « balzacien », « stendhalien », « flaubertien », le mot « zolien » n’est pas reçu. Le stendhalien apprécie l’élégance des sentiments, le balzacien aime la vieille France, le flaubertien place les mots au-dessus de tout, mais qui se voudrait zolien ? Zola ne trempait-il pas sa plume dans le sang, la sueur et le cambouis ? Zola trempait sa plume dans la vie, mon cher Hervé, et je suis zolien. J’admire l’homme, j’admire l’œuvre : c’est à mes yeux le premier des quatre éléphants du XIXe siècle et je le relis souvent.
J’ai choisi pour ce début d’été Au Bonheur des Dames, un des rares romans de Zola qui finisse bien, un peu à l’écart dans la terrible généalogie des Rougon-Macquart. La relecture ne joue pas sur le suspense : je sais de quoi parle le roman et « comment ça finit ». Du coup, je lis tranquillement, plus attentif aux détails et à la construction. La jeune Denise Baudu arrive de province, pauvre, avec ses deux frères à charge. Sa première rencontre, en quittant la gare Saint-Lazare, c’est le Bonheur des Dames : « Ah bien ! reprit-elle, après un silence, en voilà un magasin ! » C’est un magasin de tissus et confections qui change les règles du commerce de quartier.
Avec Zola, ça ne traîne pas, les pions sont tout de suite mis en place. Le lendemain, elle se présente à l’embauche : « La vue d’un jeune homme, qui arrivait rapidement par la rue Port-Mahon, l’arrêta une minute encore. Evidemment, ce devait être un chef de rayon, car tous les commis le saluaient. Il était grand, la peau blanche, la barbe soignée ; et il avait des yeux couleur de vieil or, d’une douceur de velours, qu’il fixa un moment sur elle, au moment où il traversa la place. » Cet homme, c’est Octave Mouret, le patron, le propriétaire, « le maître de la terrible machine ». Denise entre comme employée dans le grand magasin de nouveautés que Mouret vient de reprendre et dont il fera le premier grand centre commercial de Paris. Parallèlement, le magasin va ruiner les petits commerçants du quartier et faire de son propriétaire un millionnaire. A la fin du roman, la petite vendeuse épousera le patron : Octave Mouret, le séducteur de ces dames, succombera devant l’irréprochable jeune femme.
Je me souviens de quelques péripéties : la rivalité entre les vendeuses, la colère de Mouret quand la jeune fille se refuse, les journées de grande vente, l’étranglement des petits commerces, l’obstination d’un marchand de parapluies qui refuse de céder son bail. Mais je ne risque pas de m’ennuyer : j’ai oublié bien des détails de ce gros roman de 500 pages Denise débarque chez son oncle qui tient un magasin de nouveautés juste en face du Bonheur des Dames. Elle espérait travailler chez lui mais les affaires vont trop mal, l’oncle ne peut l’embaucher. Denise n’hésite pas : elle est jeune et moderne et le Bonheur des Dames représente l’avenir du commerce. C’est « une machine », « une usine », « un monstre », c’est un des personnages du roman. Denise ne lui échappera pas : « A cette heure de nuit, avec son éclat de fournaise, le Bonheur des Dames achevait de la prendre tout entière.
Dans la grande ville, noire et muette sous la pluie, dans ce Paris qu’elle ignorait, il flambait comme un phare, il semblait à lui seul la lumière et la vie de la cité. Elle y rêvait son avenir, beaucoup de travail pour élever les enfants, avec d’autres choses encore, elle ne savait quoi, des choses lointaines dont le désir et la crainte la faisaient trembler. » Ce qu’écrit Zola de « cette mécanique à manger les femmes » n’a pas vieilli : il décrit en 1883 ce qui est devenu la base de notre système économique. Avant, on vendait peu mais cher : avec Mouret, on vendra beaucoup et pas cher. Le mot « beaucoup » implique l’exploitation maximale des matières premières, la multiplication artificielle des besoins, le renouvellement incessant des modèles, l’obsolescence programmée des produits. Les mots « pas cher » impliquent la mort du petit commerce, la réduction des frais de personnel, l’exploitation des producteurs. Zola a parfaitement compris cela et ne le condamne pas forcément : Mouret « démocratise le luxe » et son magasin est un chef d’œuvre de lumière d’espace, de confort, d’organisation. Les employés travaillent dur, mais ils sont logés, nourris, payés au fixe et au pourcentage : qui travaille plus gagne plus… Quand Mouret s’enrichit, ses employés sont moins pauvres. D’ailleurs, le patron, jeune provincial, est parti de rien et chaque soldat aurait donc dans sa giberne un bâton de maréchal !
Je ne relis pas ce roman comme un traité d’économie ou une page de l’Humanité. Je suis avec intérêt cette bataille du commerce qui a effectivement eut lieu à la fin du XIXe siècle, je m’intéresse à l’histoire d’amour, mais la littérature, c’est aussi le plaisir des mots, toujours latent, parfois violent. Une simple phrase m’enchante, page 124 : « Une dernière clarté luisait au flanc de la théière, une lueur courte et vive de veilleuse, qui aurait brûlé dans une alcôve attiédie par le parfum du thé. » Et page 128, ce long passage pour décrire les tapis en vente au Bonheur des Dames : « La Turquie, l’Arabie, la Perse, les Indes étaient là. On avait vidé les palais, dévalisé les mosquées et les bazars. L’or fauve dominait, dans l’effacement des tapis anciens, dont les teintes fanées gardaient une chaleur sombre, un fondu de fournaise éteinte, d’une belle couleur cuite de vieux maître.
Et des visions d’Orient flottaient sous le luxe de cet art barbare, au milieu de l’odeur forte que les vieilles laines avaient gardée du pays de la vermine et du soleil. » Et j’ai envie de relire la description des fleurs du Paradou (La Faute de l’abbé Mouret), celle des légumes des halles (Le Ventre de Paris) ou du centre de la mine (Germinal). Je suis avec intérêt, bien que j’en connaisse la fin, la lutte de Denise pour survivre. La petite employée souffre : « Son tourment fut d’avoir le rayon contre elle. Au martyre physique s’ajoutait la persécution de ses camarades. Après deux mois de patience et de douceur, elle ne les avait pas encore désarmées. » L’ascension de Denise se fait dans la douleur. Il faut rester des heures debout et les manteaux, jupes, coupons de tissu sont lourds. Ses quatre sous de débutante passent à l’entretien ses deux frères plus jeunes. « Elle agonisait de fatigue, mal nourrie, mal traitée, sous la continuelle menace d’un renvoi brutal. »
A chaque fois que l’employée et le patron se croisent, Zola fait monter l’amour d’un cran. Denise a paru d’abord laide et gauche, puis Mouret a senti chez cette jeune fille « un charme caché ». Ensuite, il est troublé par cette petite vendeuse, « avec ses cheveux si drôles ». Il la trouvera « charmante avec ses beaux cheveux épeurés sur son front » : il pense que c’est un amant qui l’embellit ainsi. Plus tard, comme elle fait de la couture la nuit, ce qui est interdit (« si elles travaillaient à leur compte la nuit, elles travaillaient moins dans le jour au magasin, c’était clair »), Mouret lui trouve des excuses. Mais les péripéties sont inévitables : Denise sera renvoyée. A la page 233, retentit le terrible : « Passez à la caisse. » C’est la morte-saison : « L’usine chômait, on supprimait le pain aux ouvriers ; et cela passait dans le branle indifférent de la machine, le rouage inutile était tranquillement jeté de côté. »
Un homme est venu relancer Denise jusque dans les rayons : ils se parlent dans un coin obscur. Le détective du magasin, qu’elle a repoussé, ne la manque pas. Renvoi. Mouret s’irrite de cette décision mais il laisse faire. Denise touche le fond, mais je ne me fais pas de souci pour elle. Je sais que Denise reviendra au Bonheur des Dames. Ce que Denise regrette le plus, c’est de « quitter la maison sans lui jurer qu’elle n’avait pas appartenu à un autre ». Mais Mouret le sait, il a mené son enquête. C’est la misère. Il y a les tentations : jeune et jolie, elle n’aurait qu’à céder à ces hommes qui la convoitent. « Pourquoi donc n’avait-elle pas un amant ? Cela étonnait, semblait ridicule. Il faudrait bien qu’elle succombât un jour. »
Ce ridicule de la vertu, c’est ce qui permet à Denise de ne pas devenir Gervaise, la malheureuse de L’Assommoir. Et un soir d’été Denise et Mouret se rencontrent par hasard (pourquoi pas ?) dans le jardin des Tuileries, alors qu’elle promène son jeune frère : « C’est vous, mademoiselle. » Je lis sans me presser. Je lis à la maison, au café, dans le tram. C’est mon plaisir, à côté des lectures utiles à mon prochain roman. Les romans de Zola sont touffus. L’histoire d’amour entre Denise et Mouret est le fil rouge mais il y a aussi, en toile de fond, les amours entre employés, l’amour de Geneviève, cousine de Denise, pour Colomban qui aime une vendeuse du Bonheur des Dames, le mariage arrangé de Paul de Vallagnosc, un ami d’enfance de Mouret, et la maîtresse en titre de ce dernier. J’avais oublié ces détails que je retrouve avec plaisir. Mouret continue à manger les commerces du quartier : « Chaque fois que le Bonheur des Dames créait des rayons nouveaux, c’étaient de nouveaux écroulements, chez les boutiquiers des alentours. Le désastre s’élargissait, on entendait craquer les plus vieilles maisons. Mlle Tatin, la lingère du passage Choiseul, venait d’être déclarée en faillite ; Quinette, le gantier, en avait à peine pour six mois ; les fourreurs Vanpouille étaient obligés de sous-louer une partie de leurs magasins ; si Bédoré et sœur, les bonnetiers, tenaient toujours, rue Gaillon, ils mangeaient évidemment les rentes amassées jadis. »
Denise revient au magasin : « C’était la cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clientes. » La déesse de ce temple, c’est la consommation, avec ses plaisirs, bien sûr, et ses dangers. Mouret invente des techniques de vente : catalogues avec échantillons, « dont cinquante mille à l’étranger, traduits dans toutes les langues », ballons pour les enfants, sirops et biscuits gratuits, possibilité de rendre les articles. Et bien sûr, un grand choix de produits, rapidité de livraison, prix les plus bas : il vend certains articles à perte mais regagne sur les autres. Tout le commerce moderne est là. Un jour, bien sûr, Mouret demande à Denise de passer à son bureau. Il la nomme seconde : elle dirigera, avec Mme Aurélie, toutes les employées féminines. Mais Denise a compris ce qu’il veut : « Brusquement, elle comprenait, elle sentait la flamme croissante du coup de désir dont il l’enveloppait, depuis qu’elle était de retour aux confections. » Beaucoup pensent que ça y était déjà ! Mais ça n’y est pas encore.
Mouret la prie un soir, par lettre, de dîner avec lui. On sait ce que cela veut dire, elle n’est pas la première. Un bon mot court dans le magasin : « Après le dîner, il y a le dessert. » Ce qui était « un caprice imbécile » à la page 265 est devenu un désir violent : il la désire, il la veut. Ce désir éveille Denise qui comprend qu’elle l’aime, depuis le premier jour, un amour mêlé de crainte et de respect. Mais elle ne se donnera pas, je le sais. Elle le dit à une amie : « Quand un homme vous aime, il vous épouse. » Denise Baudu ne confond pas amour et désir ! Elle dit non : « Et puis, monsieur, vous aimez une personne, oui, cette dame qui vient ici… Restez avec elle. Moi, je ne partage pas. » Cette phrase sidère Mouret : « Jamais les filles ramassées par lui dans les rayons ne s’étaient inquiétées d’être aimées. Il aurait dû en rire, et cette attitude de fierté tendre achevait de lui bouleverser le cœur. » Cette fois, il est accroché. « Tout avait disparu, les victoires bruyantes d’hier, la fortune colossale de demain. » Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme dit le poète. J’attends maintenant, avec sérénité, la grande scène qui décidera du sort de Denise.
La maîtresse en titre, la riche Mme Desforges, a appris que Mouret s’intéresse beaucoup trop à une de ses employées. Elle la convoque pour un essayage, elle l’humilie devant Mouret : « Toutes deux, face à face, frémissantes, se contemplaient. Il n’y avait désormais ni dame, ni demoiselle de magasin. Elles n’étaient plus que femmes, comme égalées dans leur rivalité. » Et c’est Denise qui l’emporte, victoire de la jeunesse et de l’innocence. Mais avant la conclusion, il y a le terrible chapitre 13 : la mort de Geneviève, cousine de Denise, que son fiancé abandonne, le suicide manqué du marchand Robineau qui a fait faillite, la mort de la tante, « perdant sa vie à mesure que son magasin perdait sa clientèle », l’expulsion du père Bourras dont l’entêtement est admirable. Ce sont « les victimes du monstre » et Zola n’écrit pas un roman à l’eau de rose. Pourtant, Denise ne condamne rien ni personne : « Il fallait ce fumier de misère à la santé du Paris de demain. Oui, c’était la part du sang, toute révolution voulait des martyrs, on ne marchait en avant que sur des morts. »
Le dernier chapitre raconte la grande exposition de blanc dans le magasin qui occupe maintenant tout le quartier, sur quatre avenues. Viennent ces pages magnifiques où Zola décrit « la chanson du blanc que chantaient les étoffes de la maison entière. » Cette fois encore, j’éprouve le plaisir de la langue, riche, structurée, variée, colorée : « On avait changé le rayon en une chapelle blanche. Des tulles, des guipures tombant de haut, faisaient un ciel blanc, un de ces voiles de nuages dont le fin réseau pâlit le soleil matinal. Autour des colonnes, descendaient des volants de malines et de valenciennes, des jupes blanches de danseuse, déroulées en un frisson blanc, jusqu’à terre. Puis, de toutes parts, sur tous les comptoirs, le blanc neigeait, les blondes espagnoles légères comme un souffle, les applications de Bruxelles avec leurs fleurs larges sur les mailles fines, les points à l’aiguille et les points de Venise aux dessins plus lourds, les points d’Alençon et les dentelles de Bruges d’une richesse royale et comme religieuse. » Et quand, le soir, l’éclairage électrique s’allume : « Une lueur blanche jaillissait des toiles et des calicots de la galerie Monsigny, pareille à la bande vive qui blanchit le ciel la première du côté de l’Orient, tandis que, le long de la galerie Michodière, la mercerie et la passementerie, les articles de Paris et les rubans, jetaient des reflets de coteaux éloignés, l’éclair blanc des boutons de nacre, des bronzes argentés et des perles. » (A chaque fois, mon correcteur automatique me signale que la phrase est trop longue !) Je lis lentement, je relis même : les mots ont de la chair, c’est une nourriture. Cette journée de succès est sombre pour Mouret : Denise a décidé de quitter le magasin ce soir-là. Il a vaincu toutes les femmes de Paris sauf elle. Mais la chanson du blanc qu’il a mise en scène, symbole de pureté et de virginité, symbole du mariage, symbole de l’enfant, finira par le décider à franchir le pas. Le comptable annonce alors la recette de la journée : « Un million, deux cent quarante-sept francs quatre-vingt-quinze centimes ! » Enfin, c’était le million, le million ramassé en un jour, le chiffre dont Mouret avait longtemps rêvé. » Après ce million, il ne reste plus que trois pages, mais Zola sait faire bref : « Vous êtes toujours résolue à nous quitter ? demanda Mouret dont la voix tremblait. - Oui, monsieur, il le faut. - Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous ? » C’est dit, ce sera fait.
Je lis volontiers les notes explicatives. Voici la note 36, la dernière : « Cette fin heureuse avait des répondants historiques. Larivière, directeur du Coin de rue, avait épousé la première de son rayon de lingerie. Cognacq, qui avait fondé la Samaritaine en 1869, épousa en 1872 Marie-Louise-Jay, première du rayon des costumes au Bon Marché. » Je vous le disais bien, cher Hervé, Zola, c’est la vie ! Et c’est au bonheur de lire.

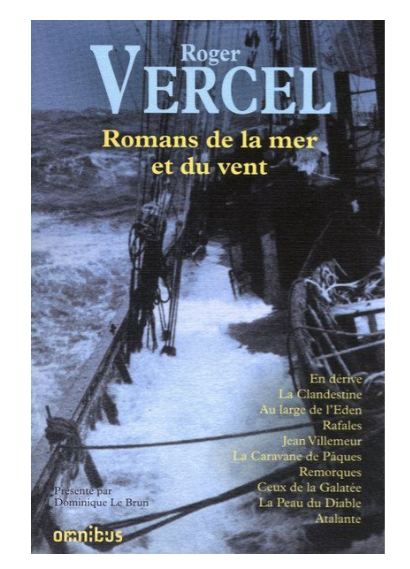
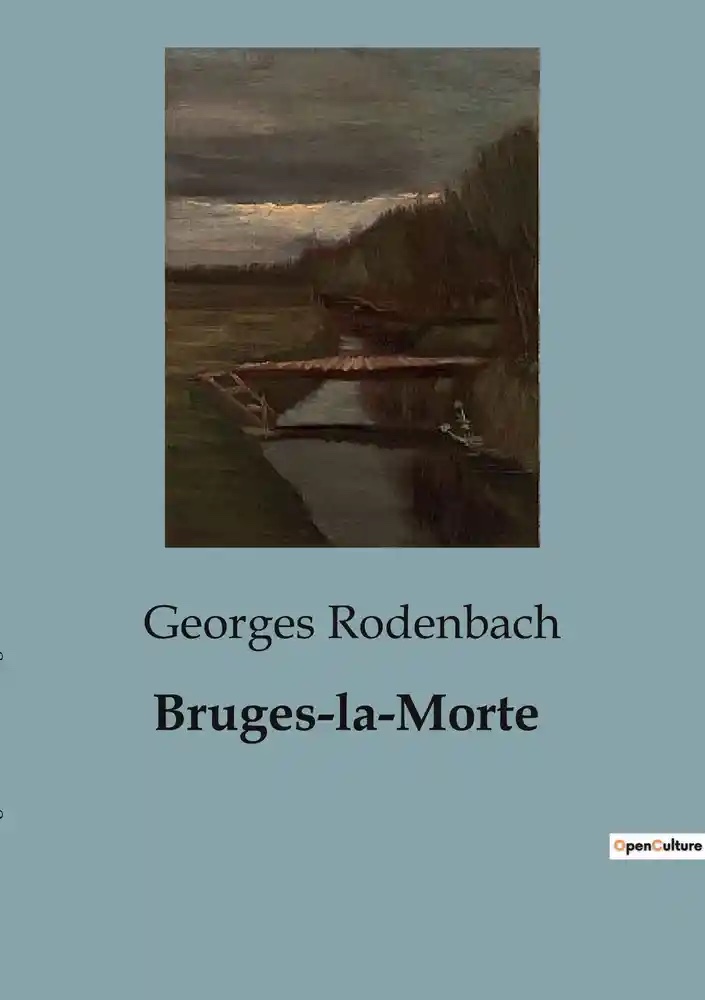
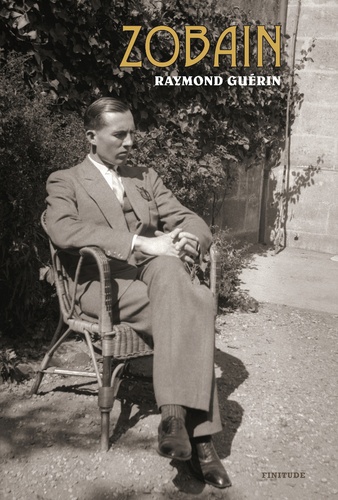
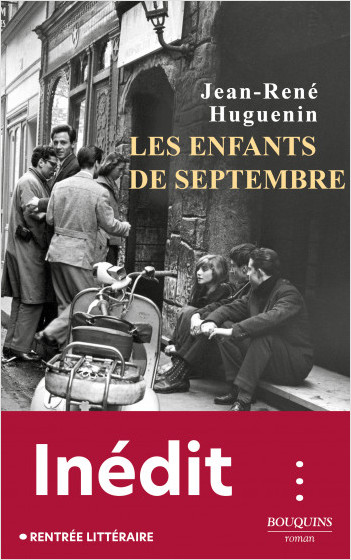
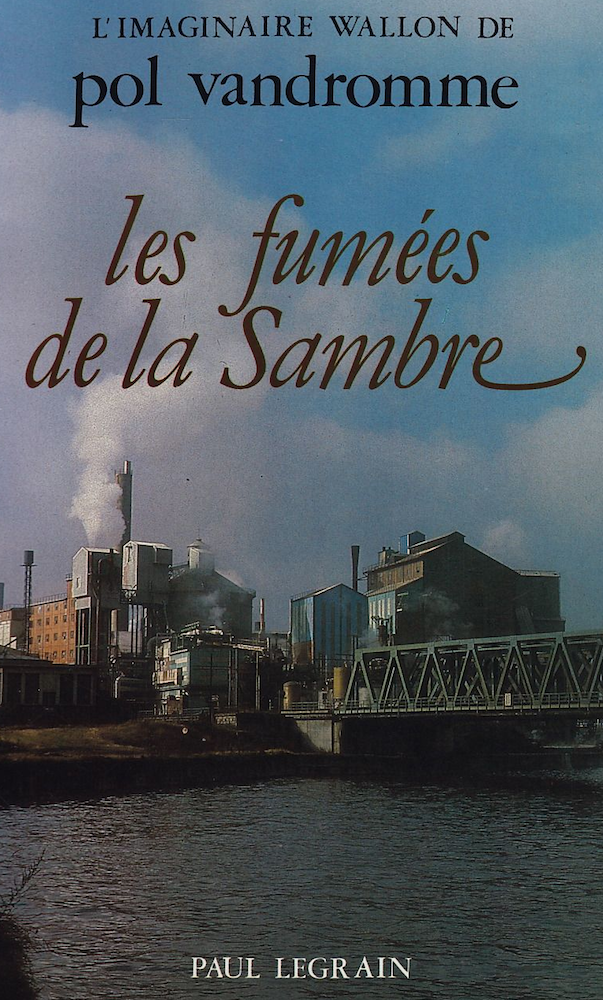
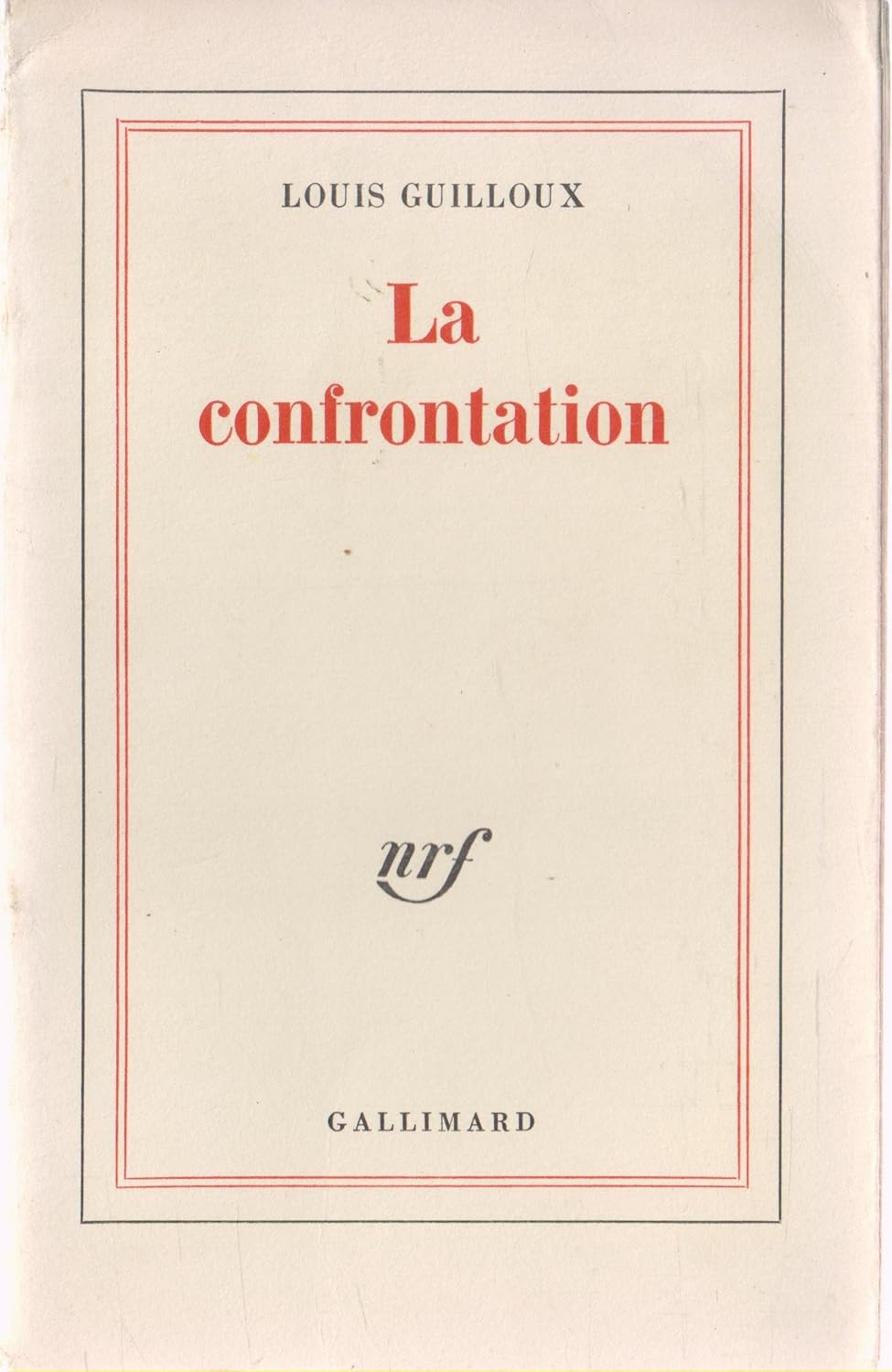
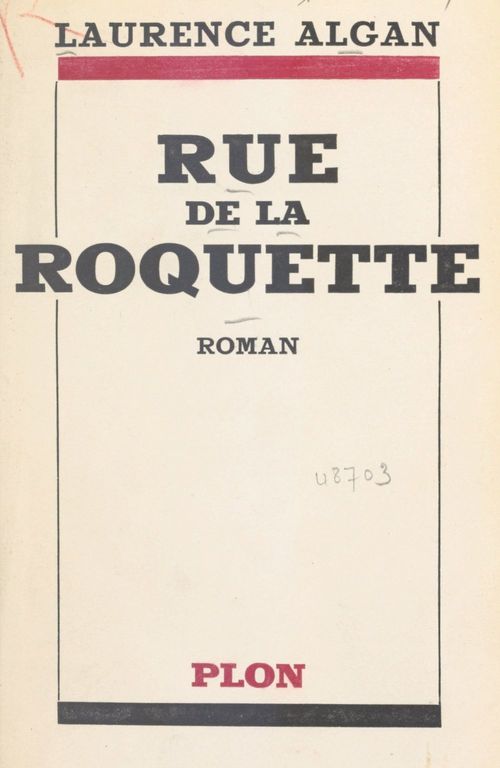
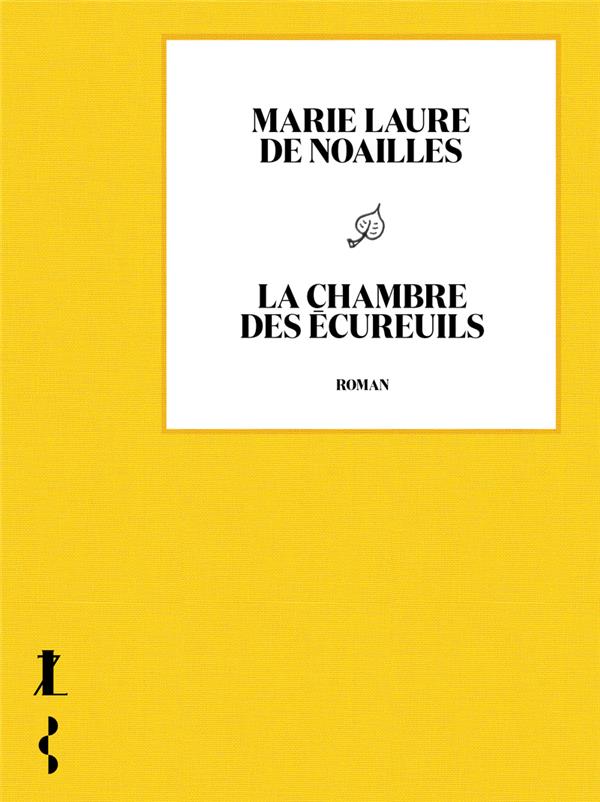
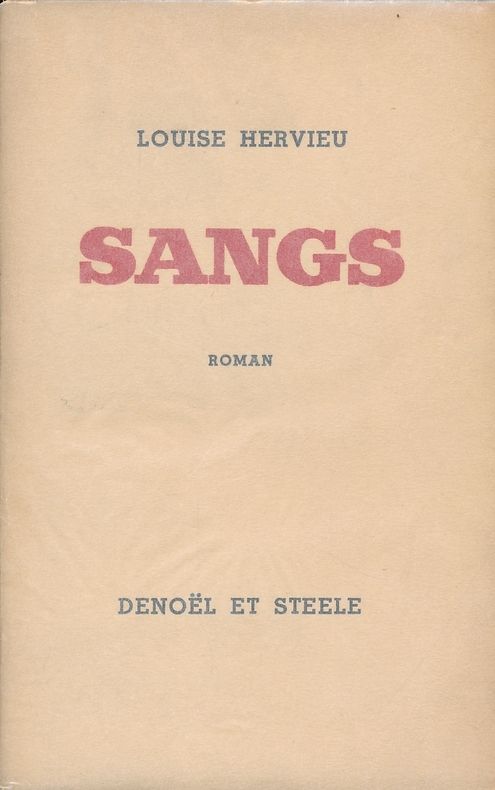
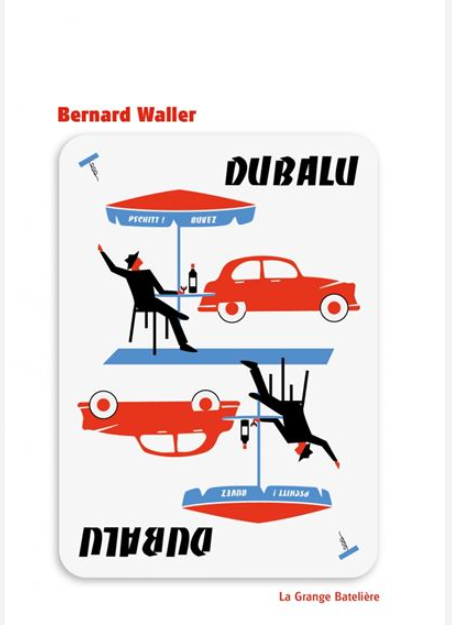
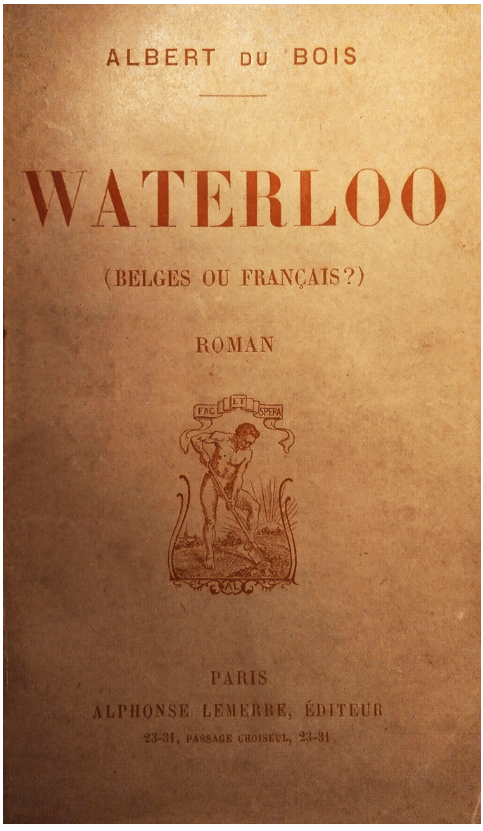
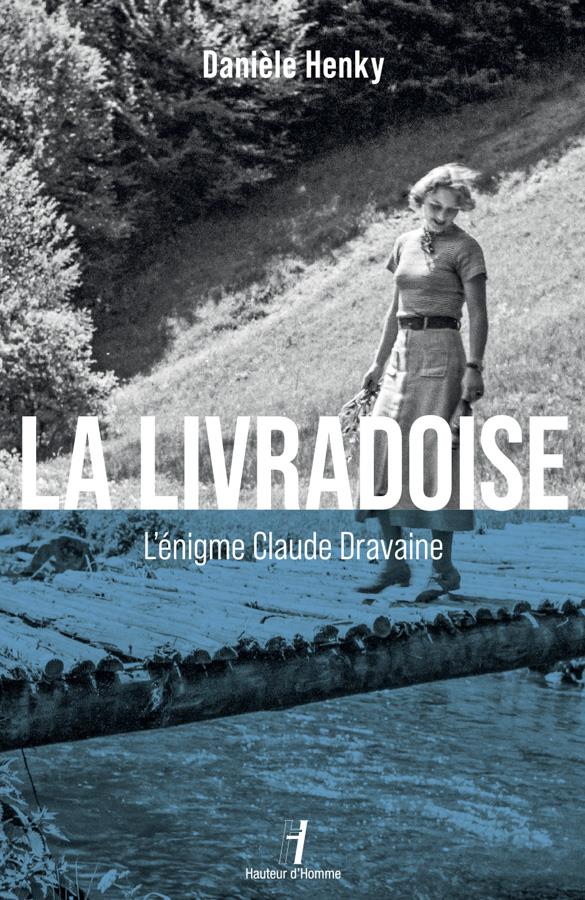
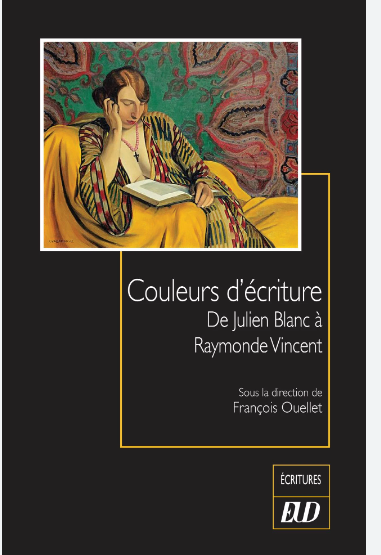
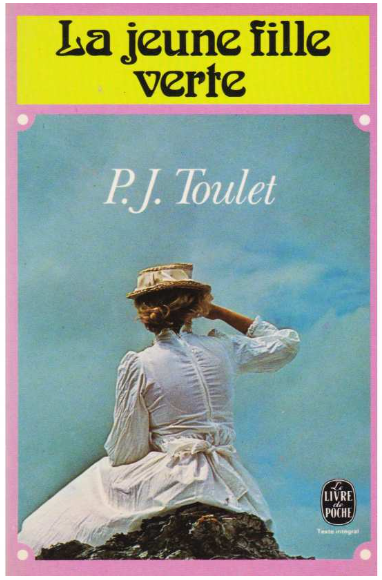
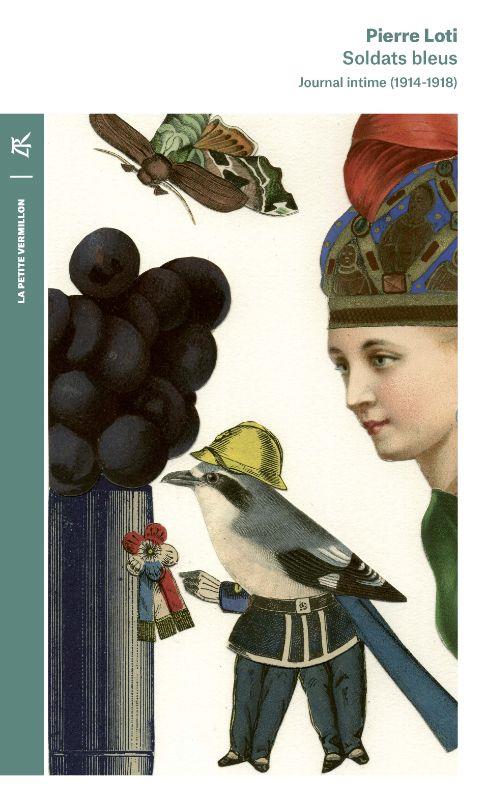
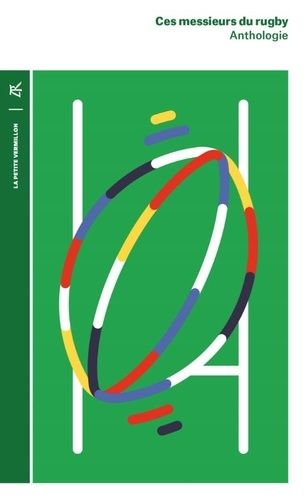
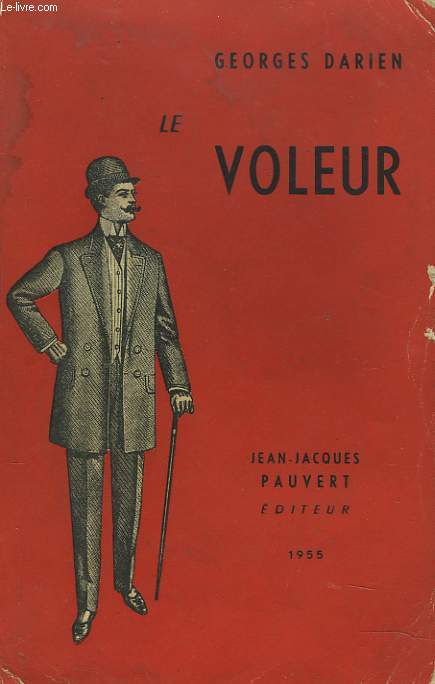
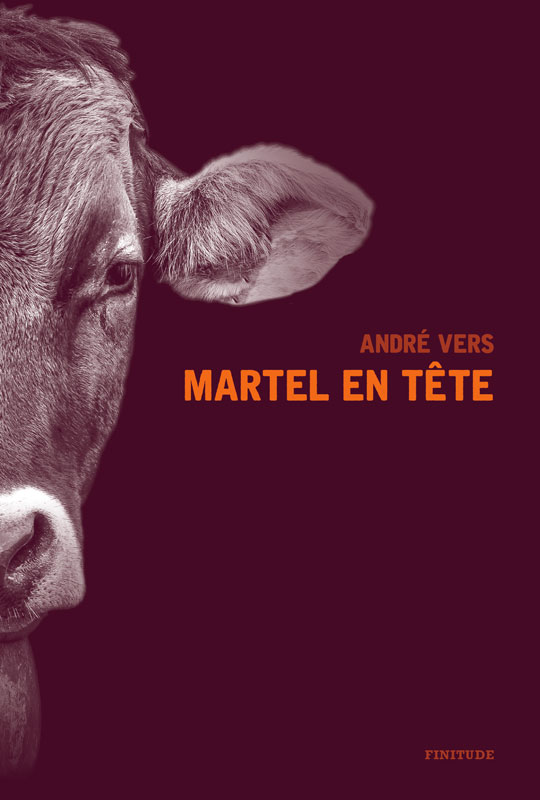

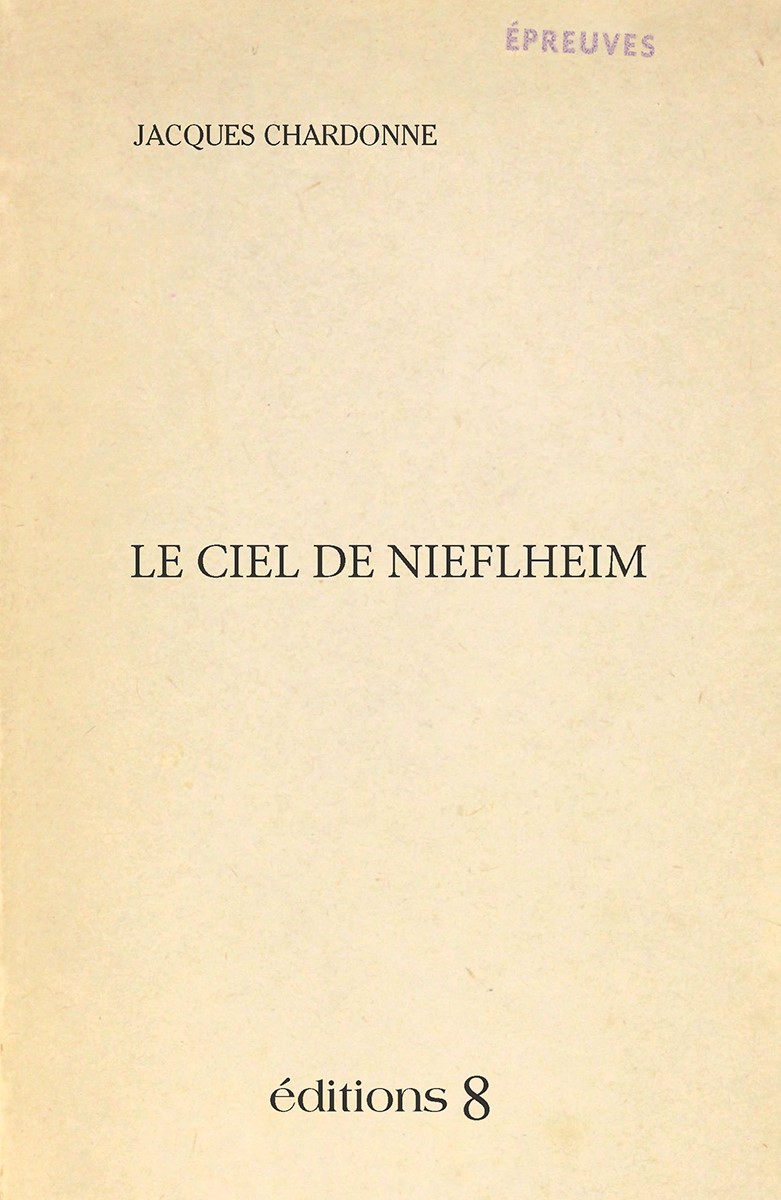
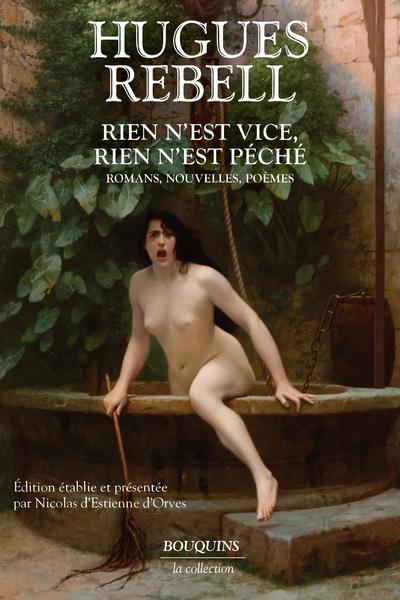
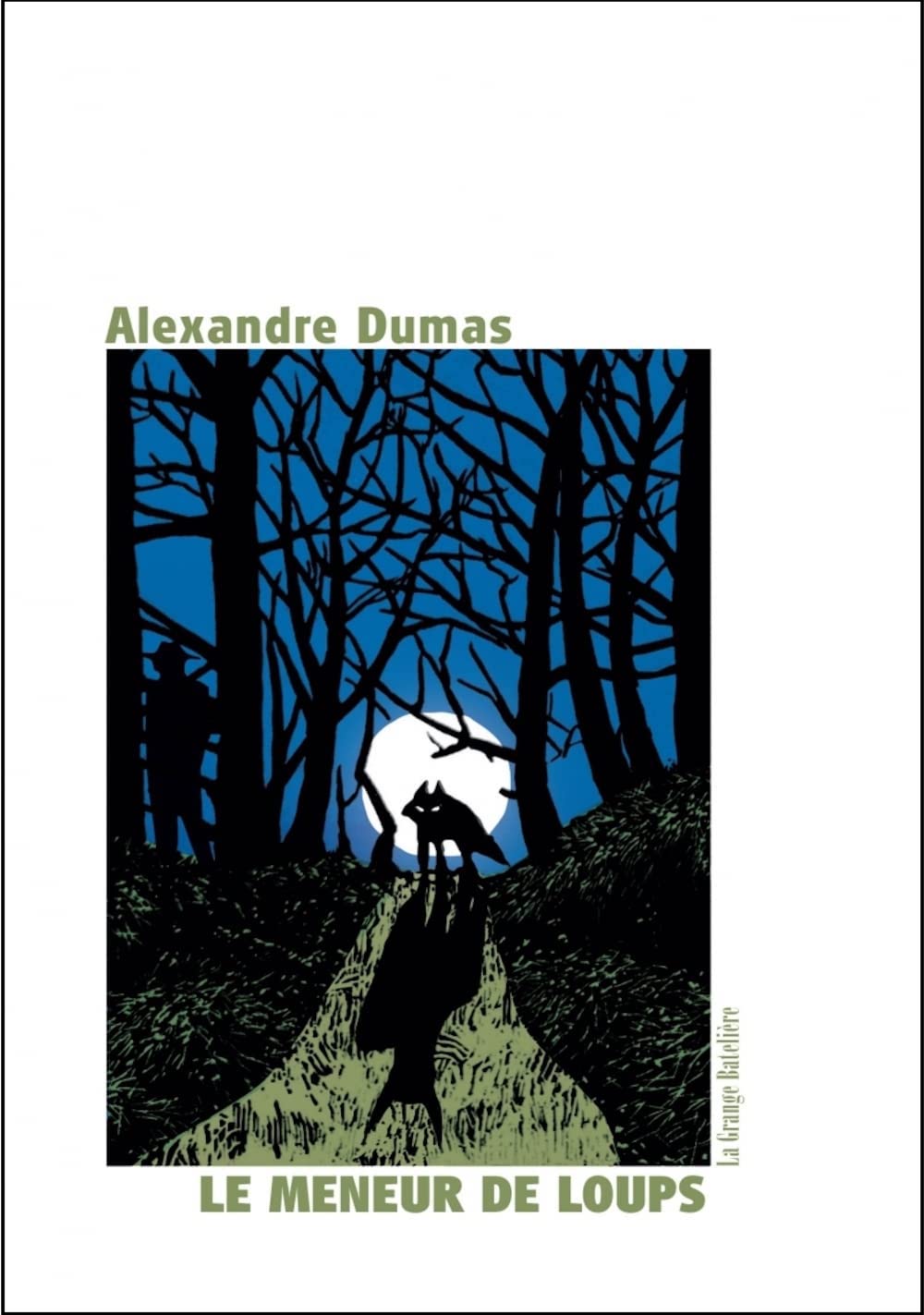
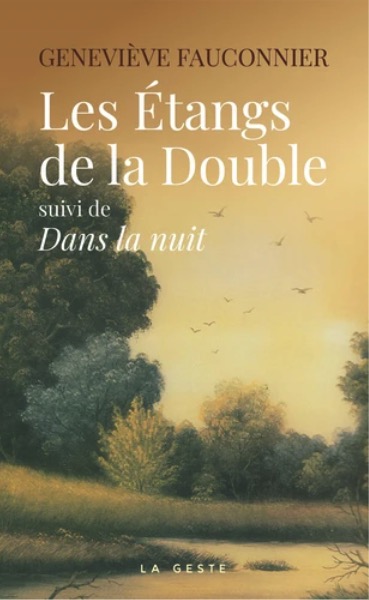
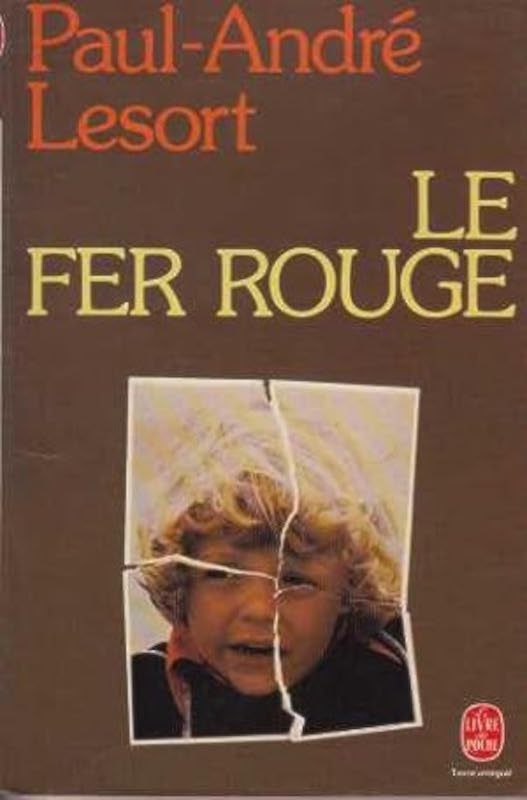

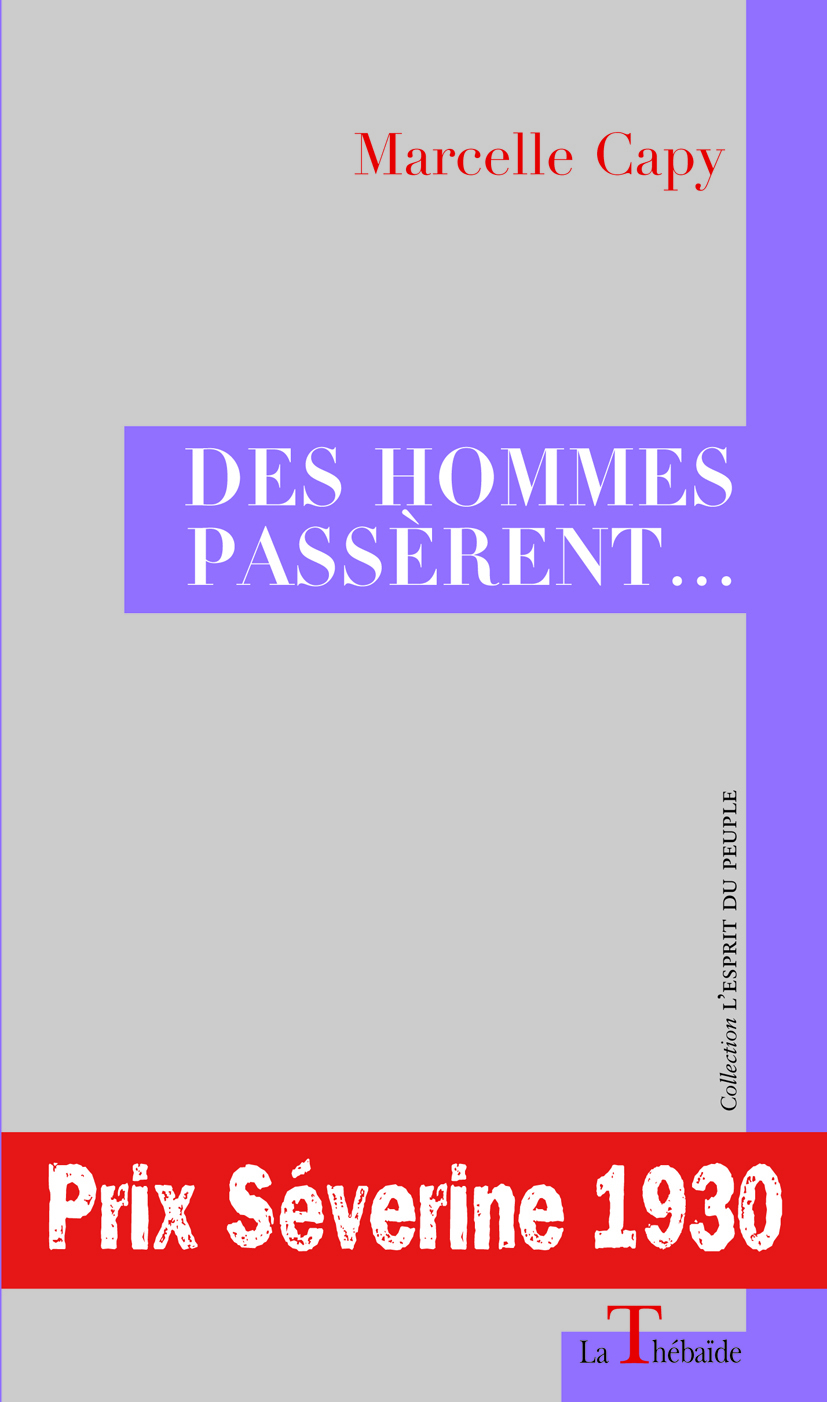
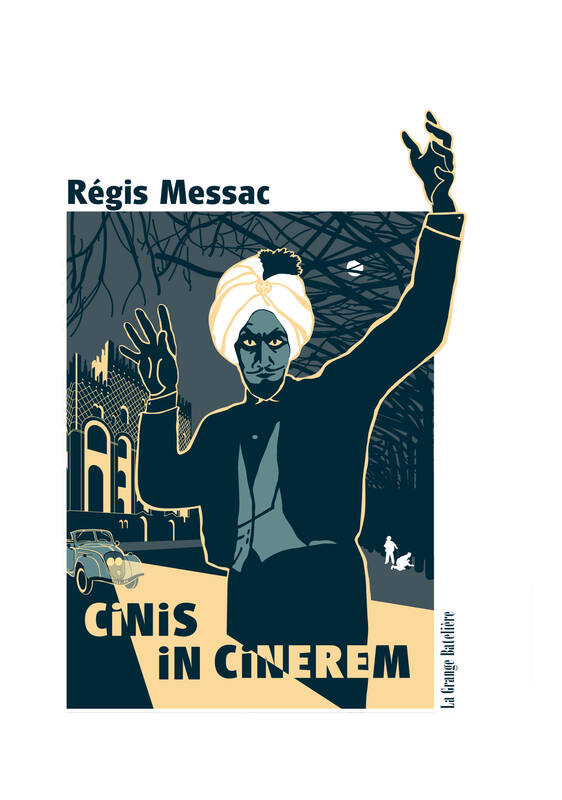
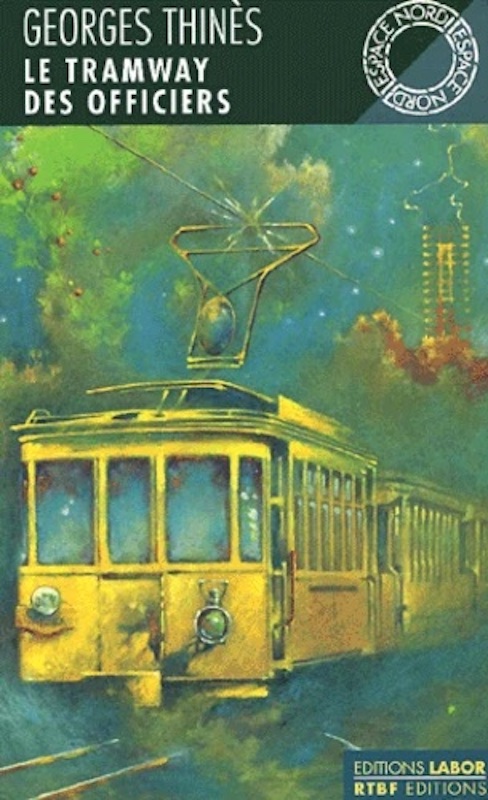
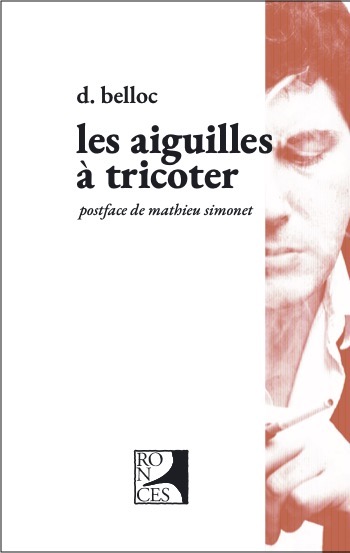
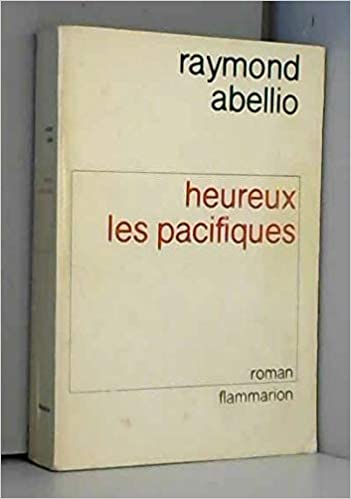
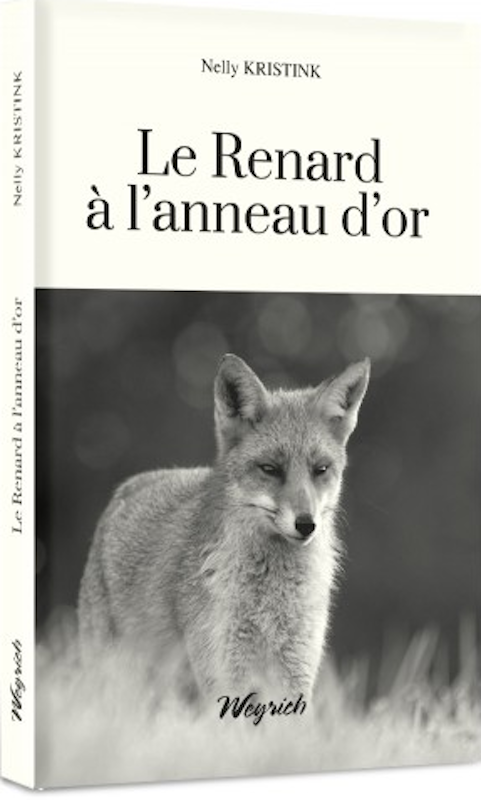
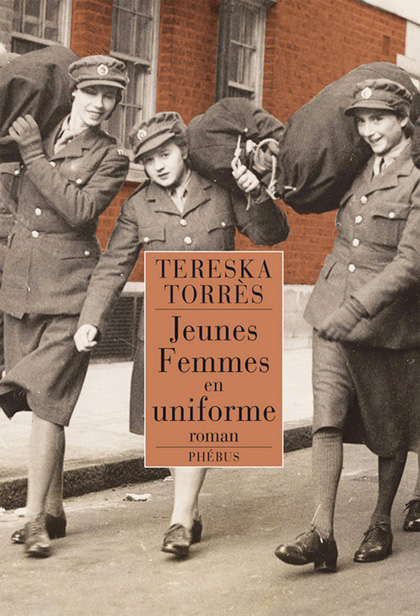
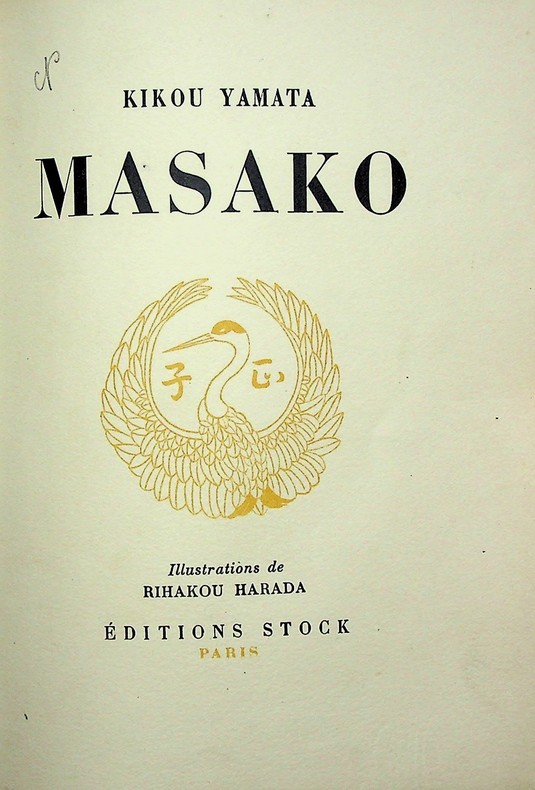
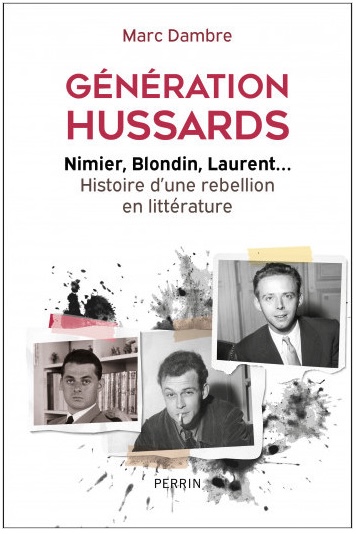
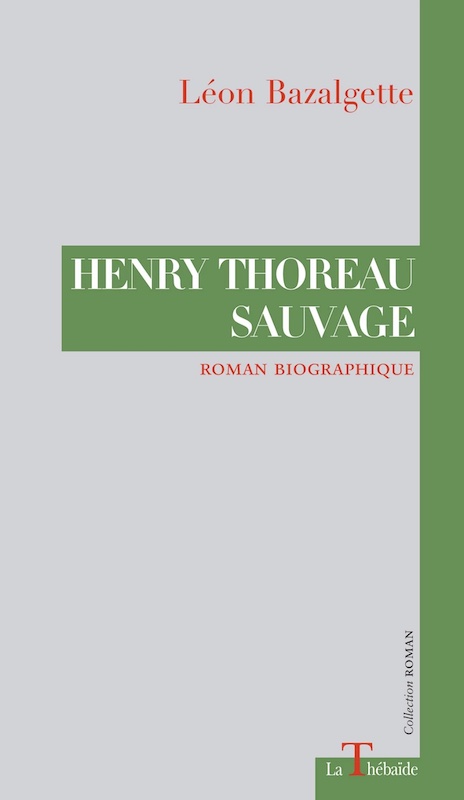
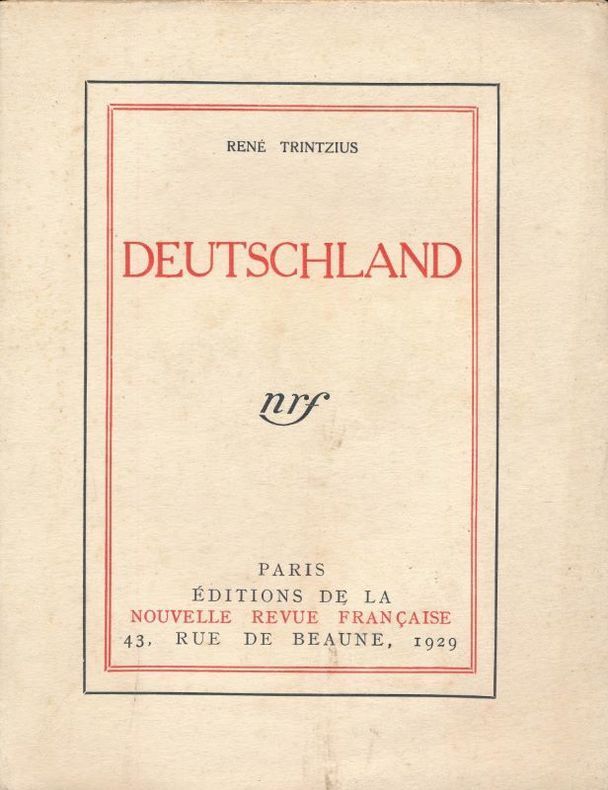
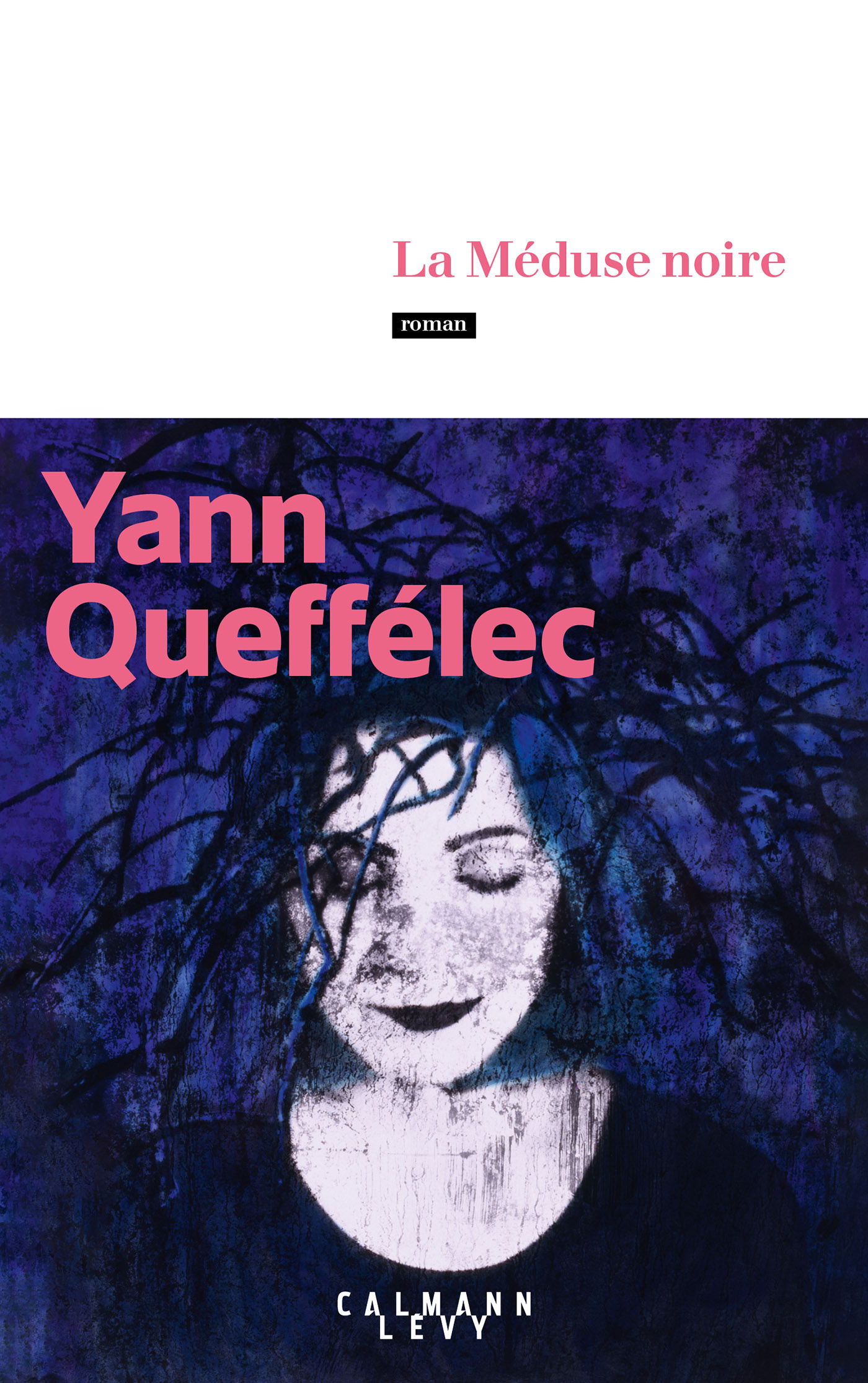
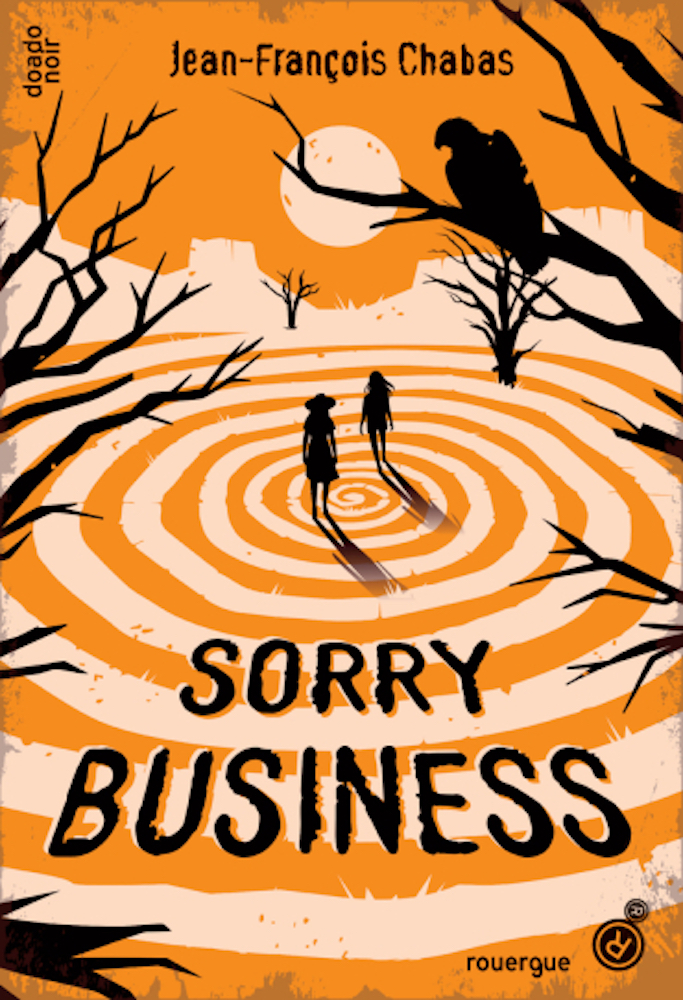
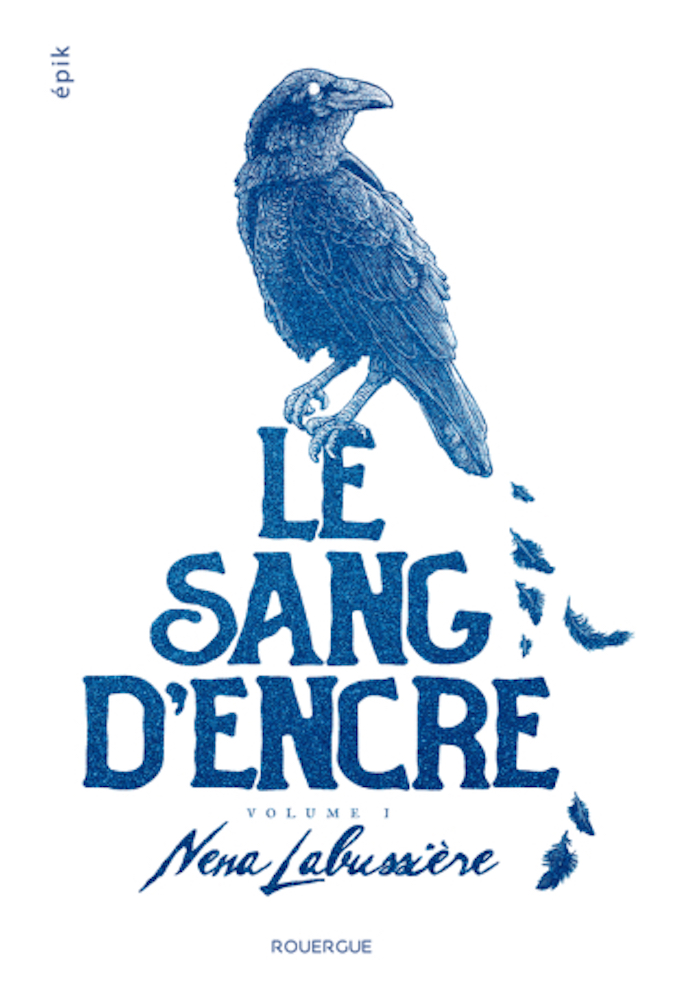
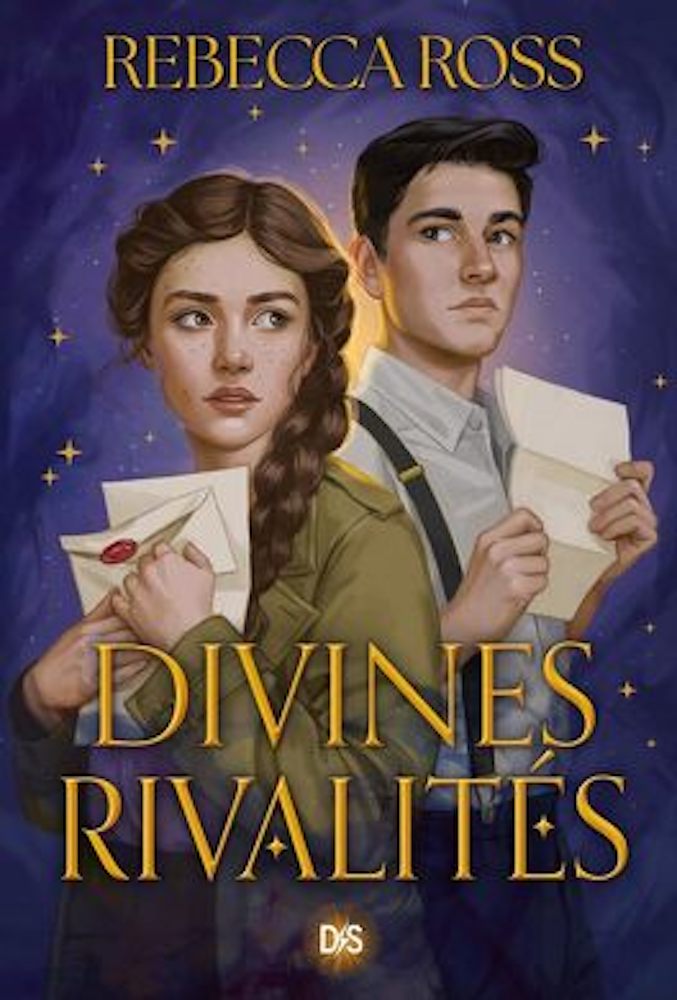
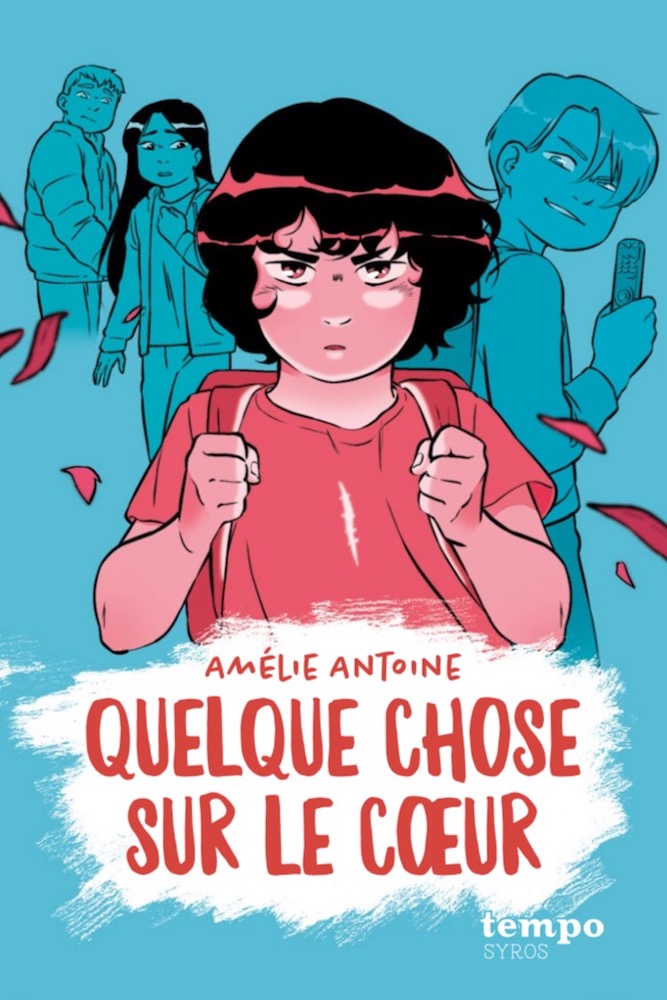

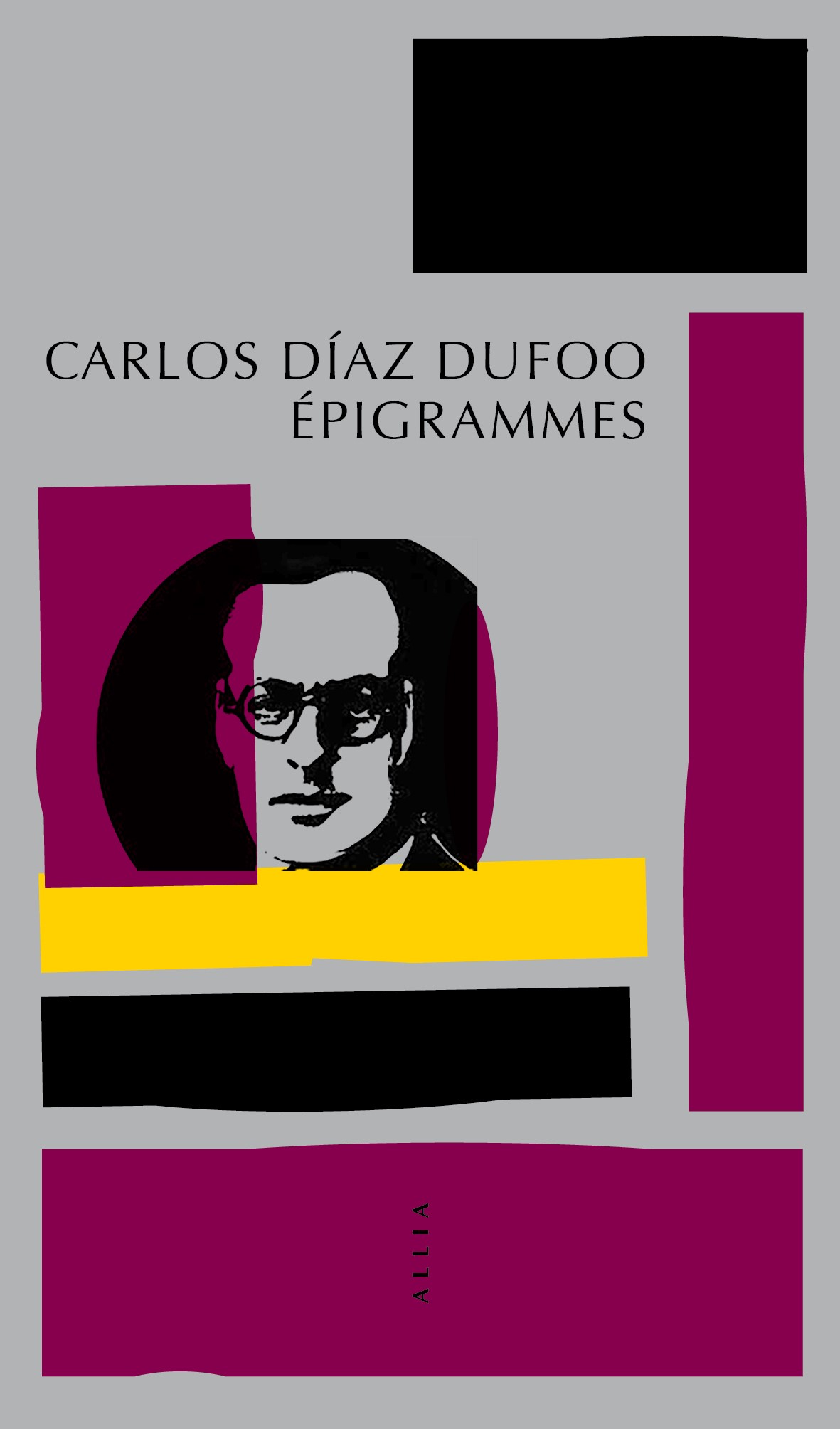
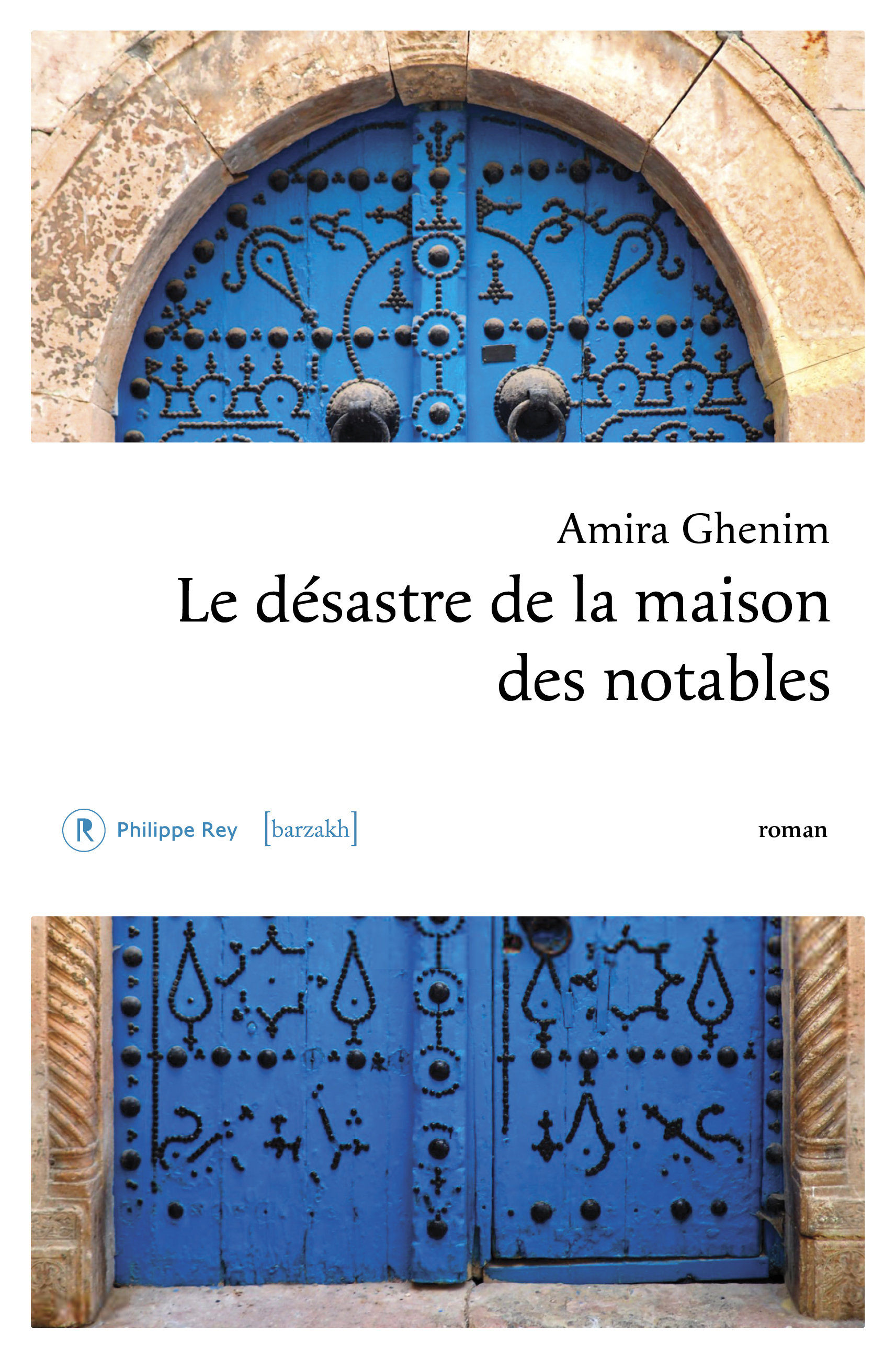
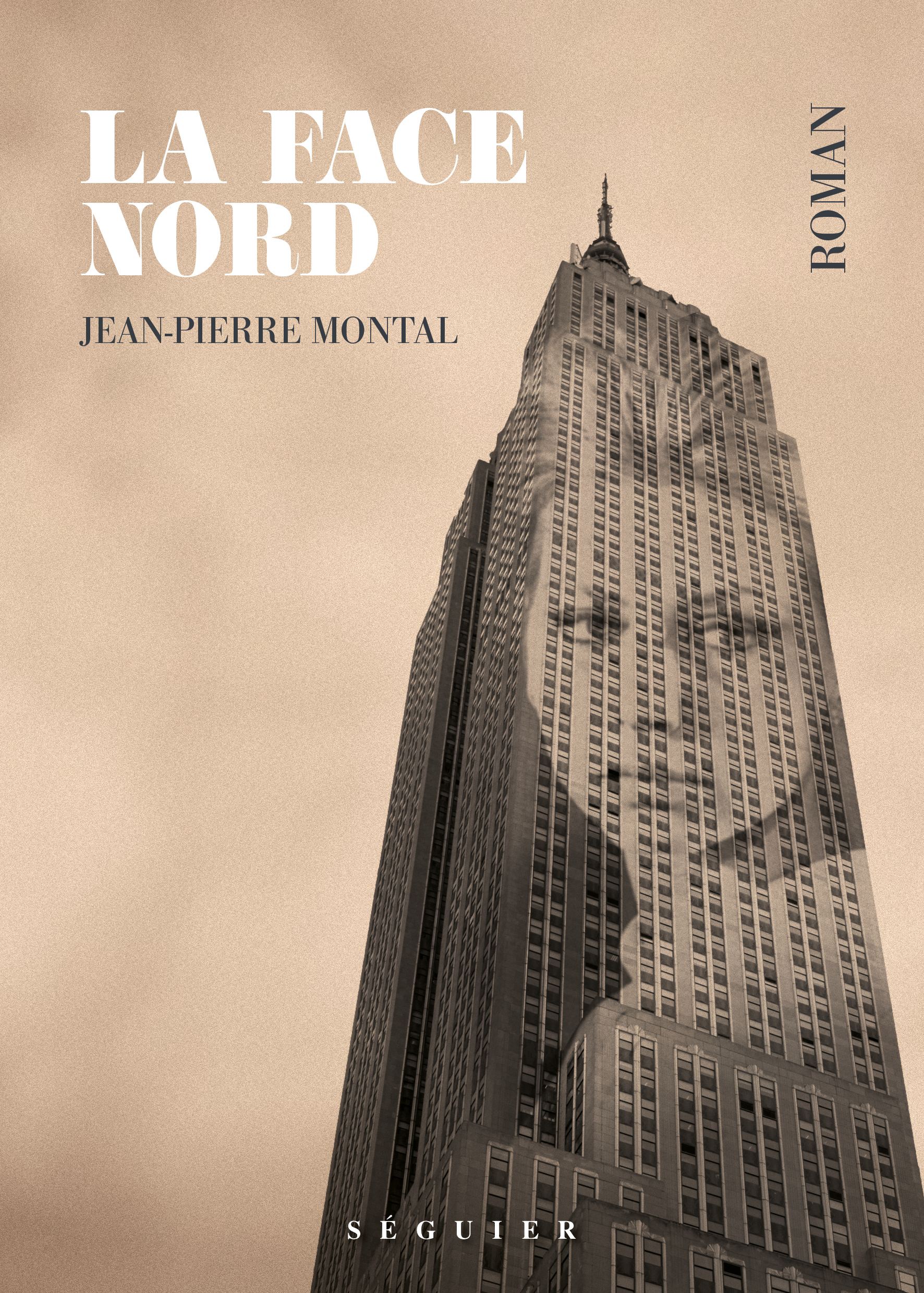
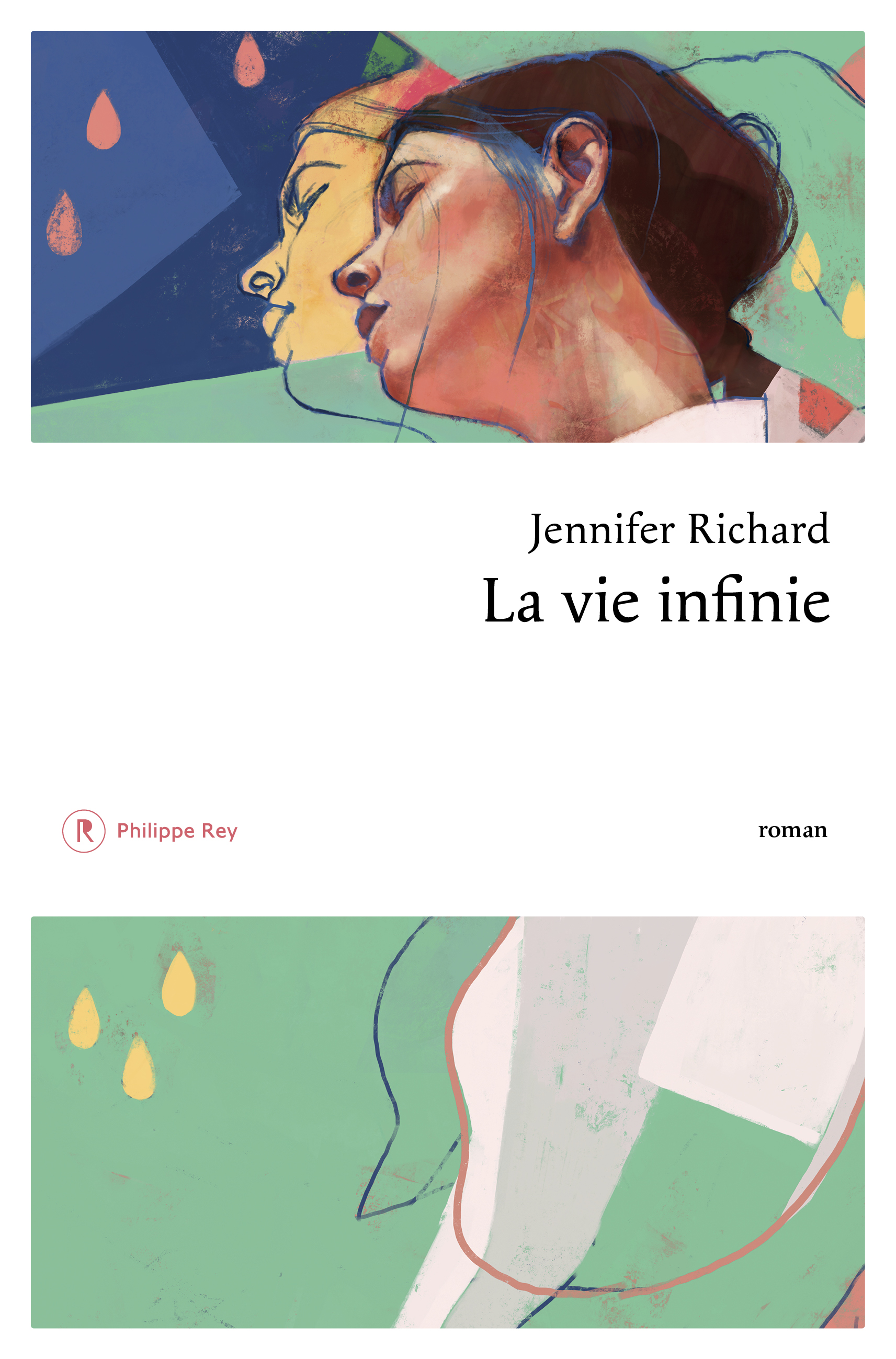
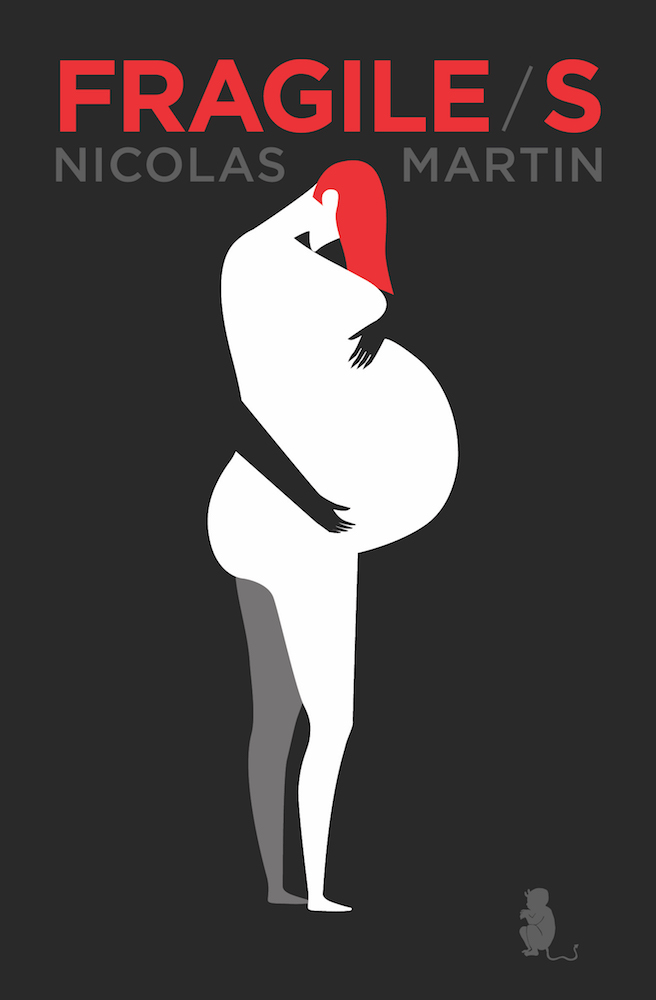

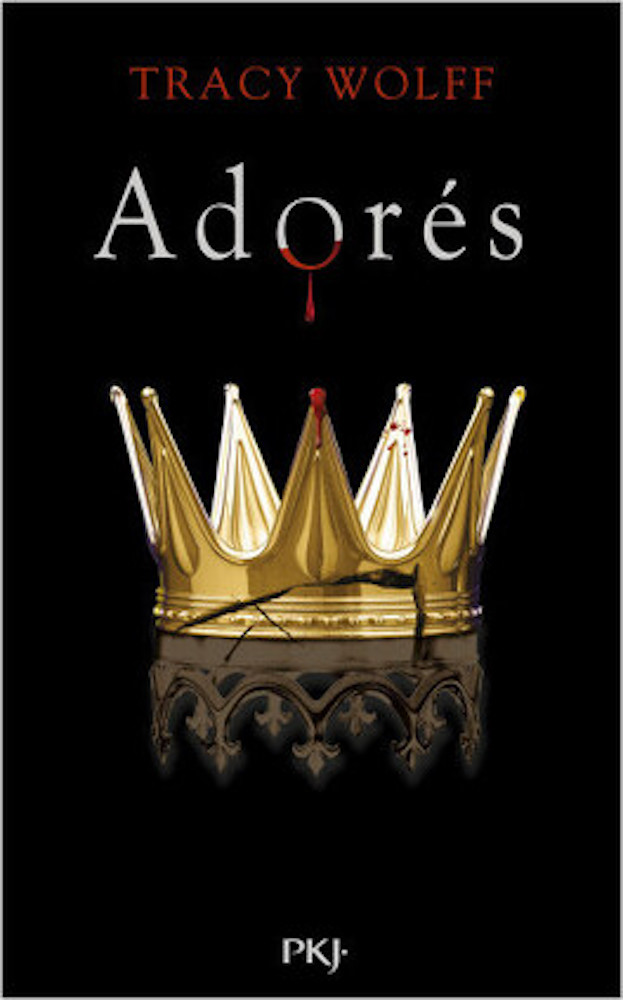
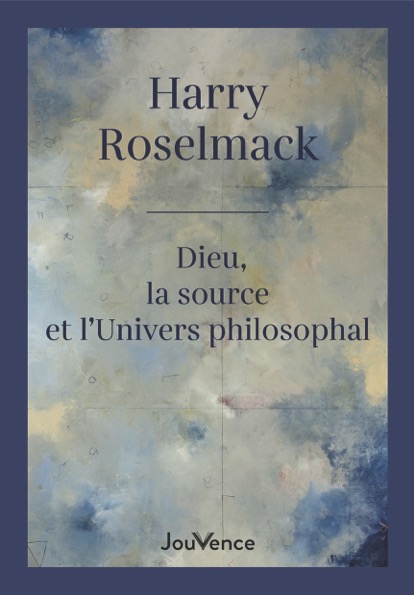
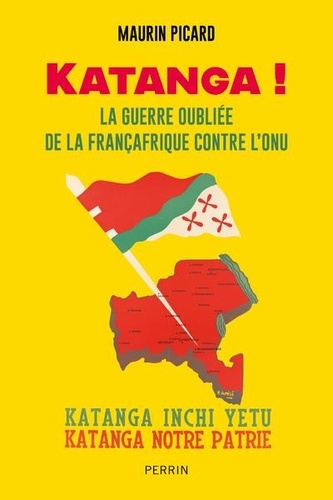
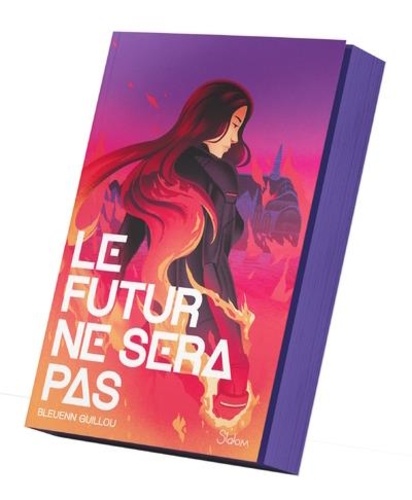
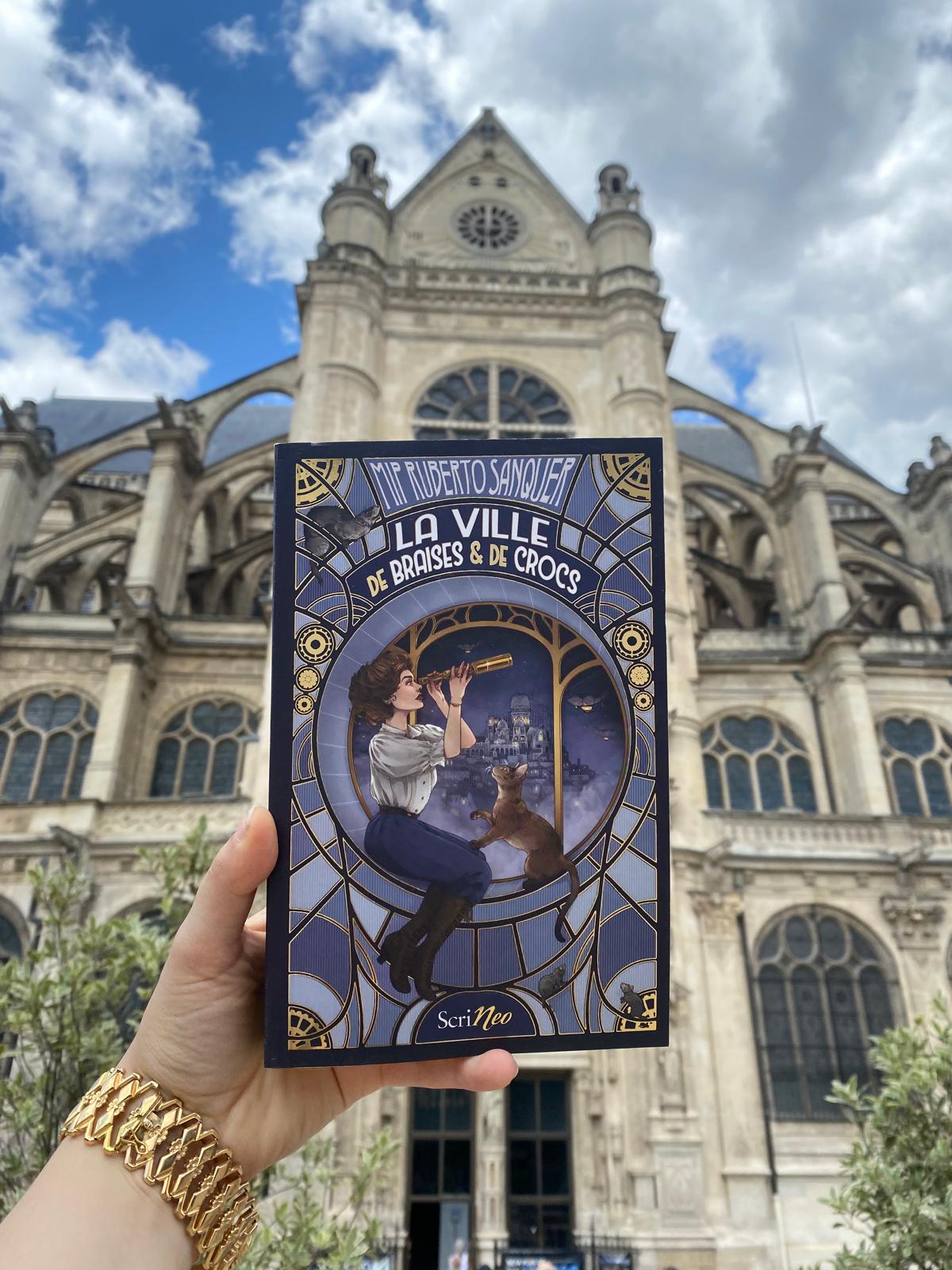
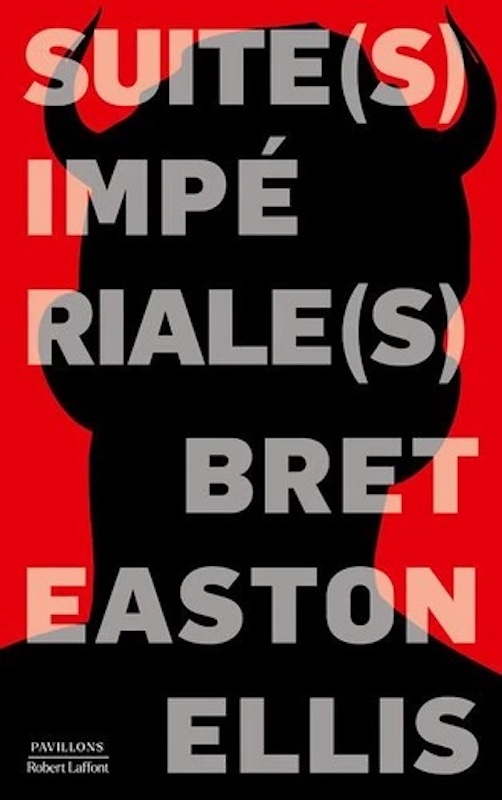


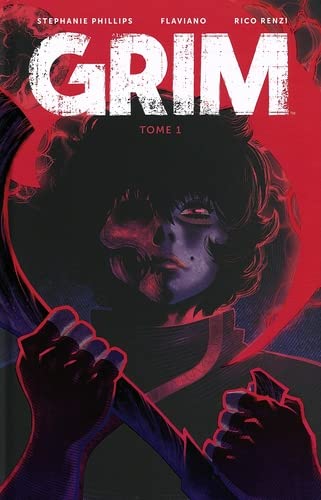
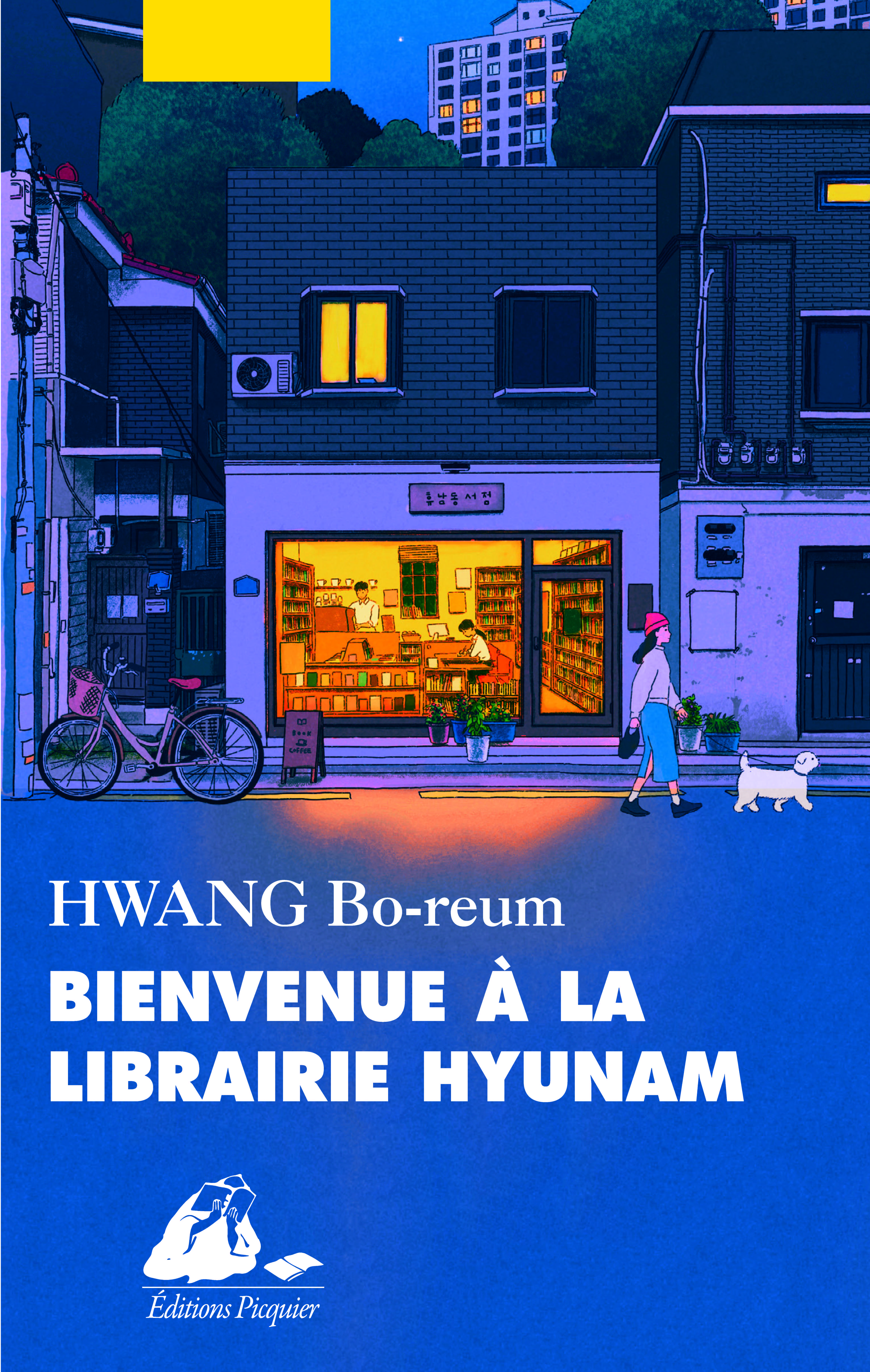
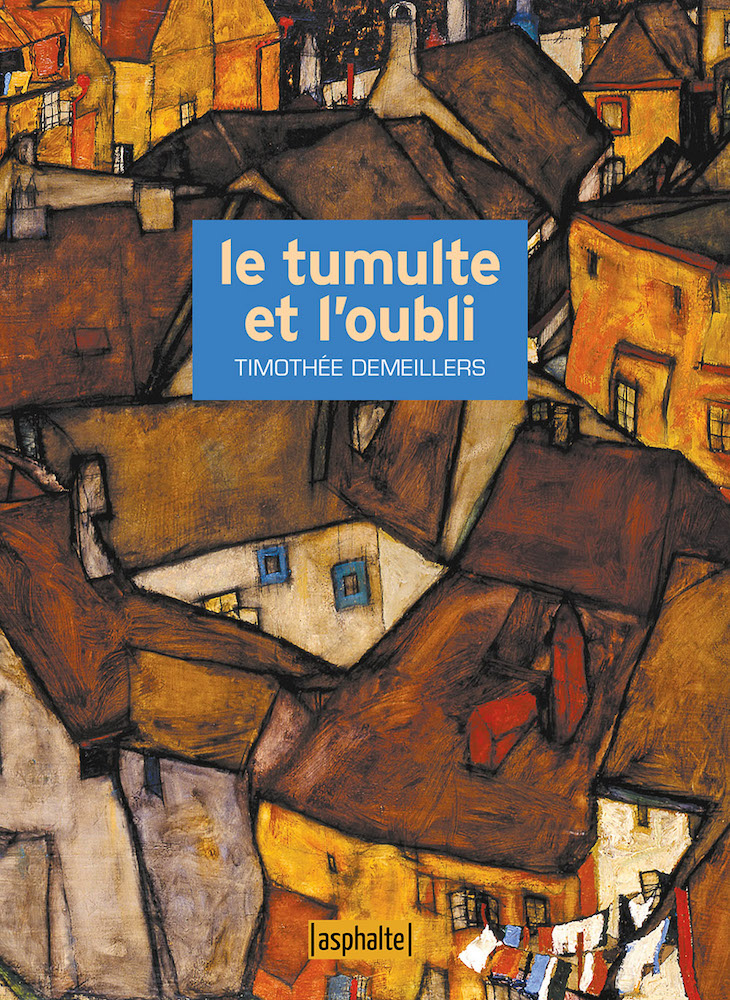
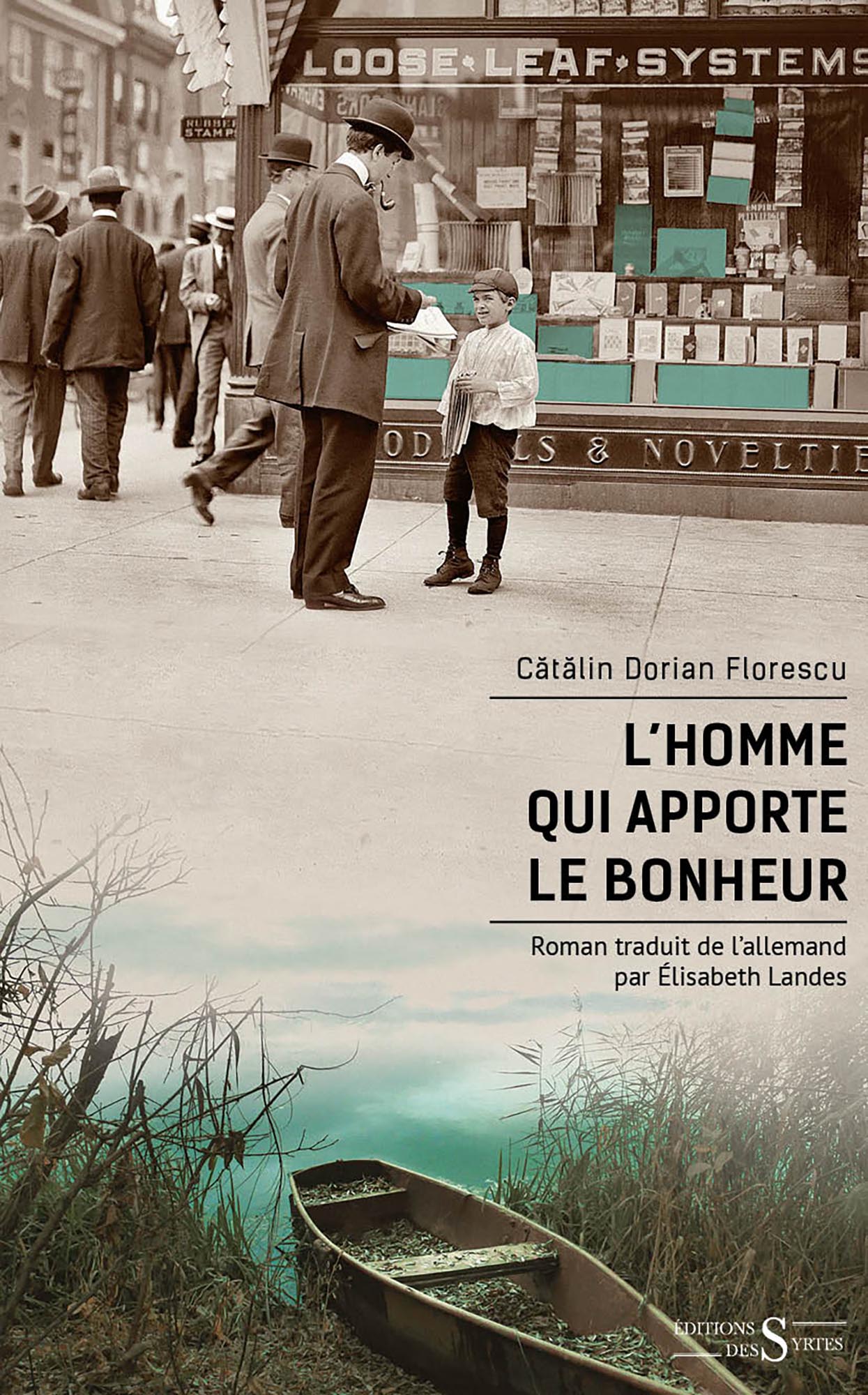
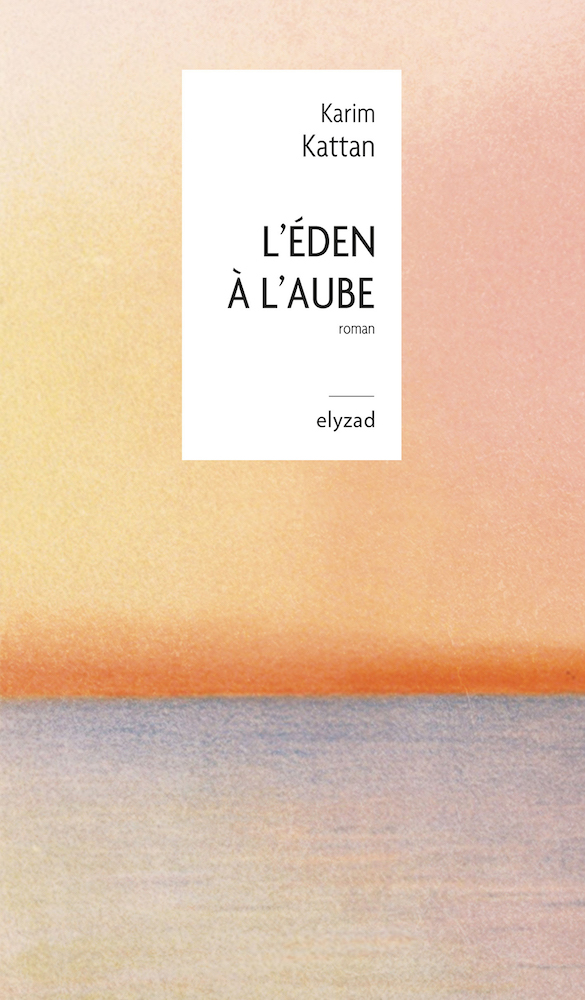
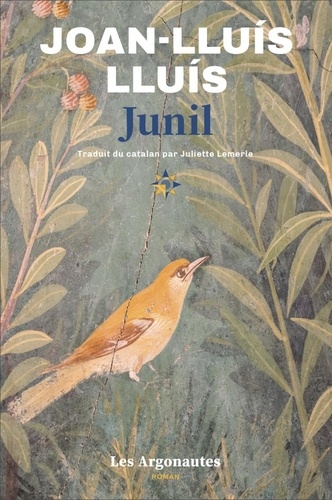
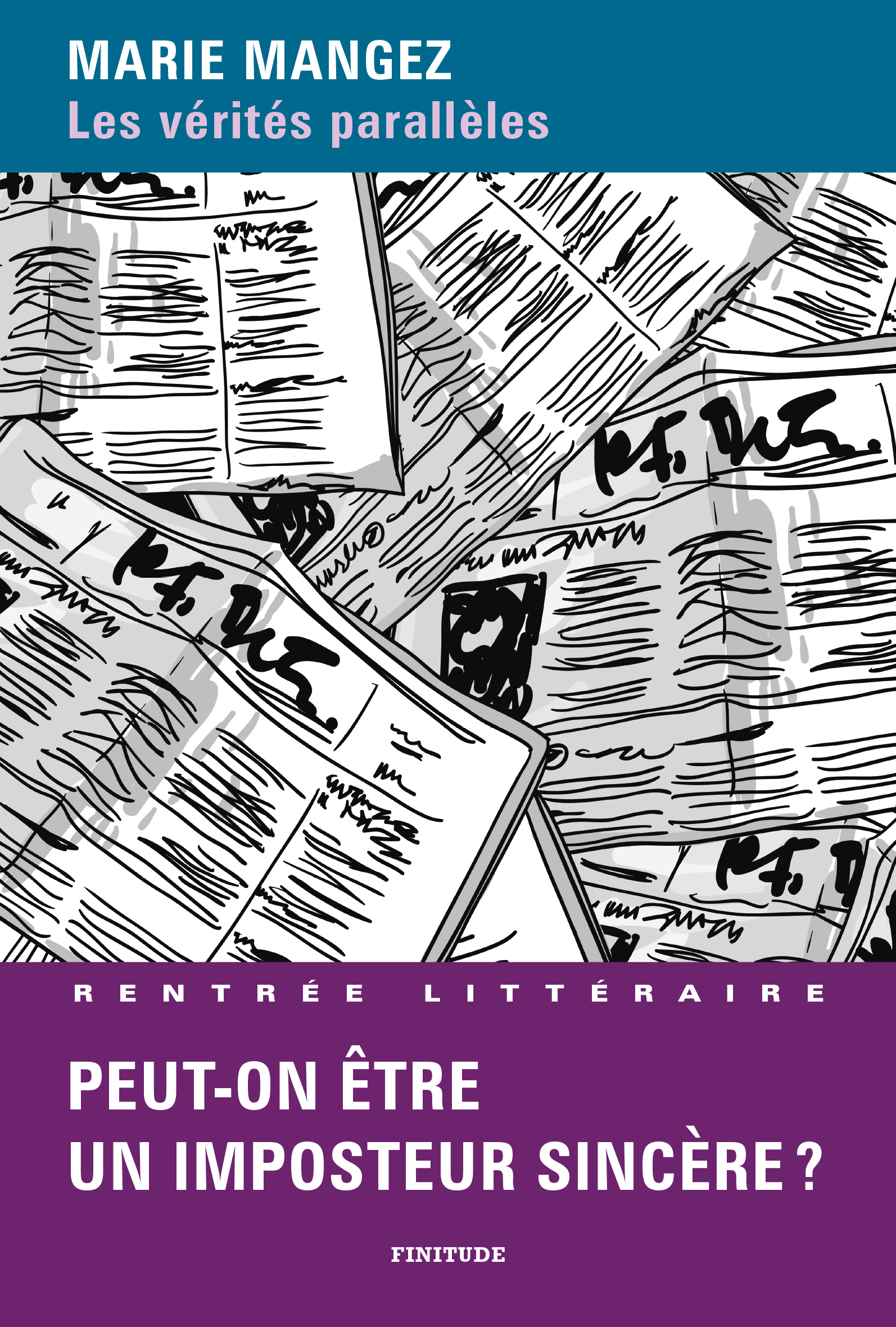
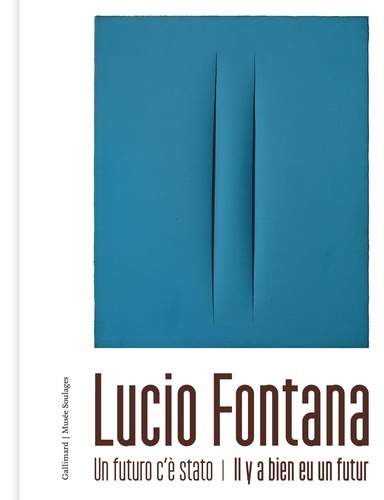

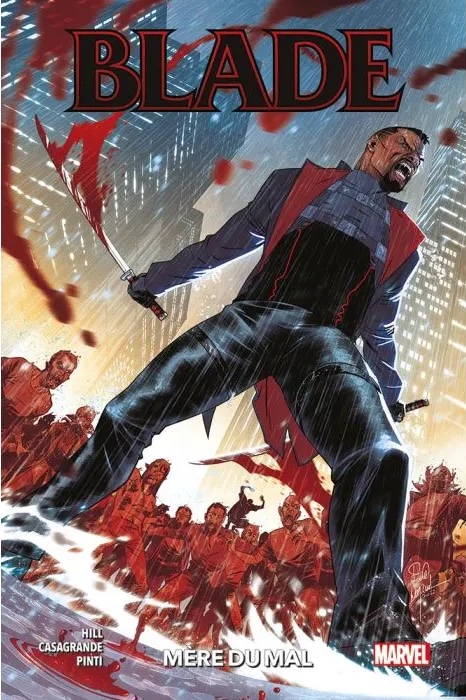
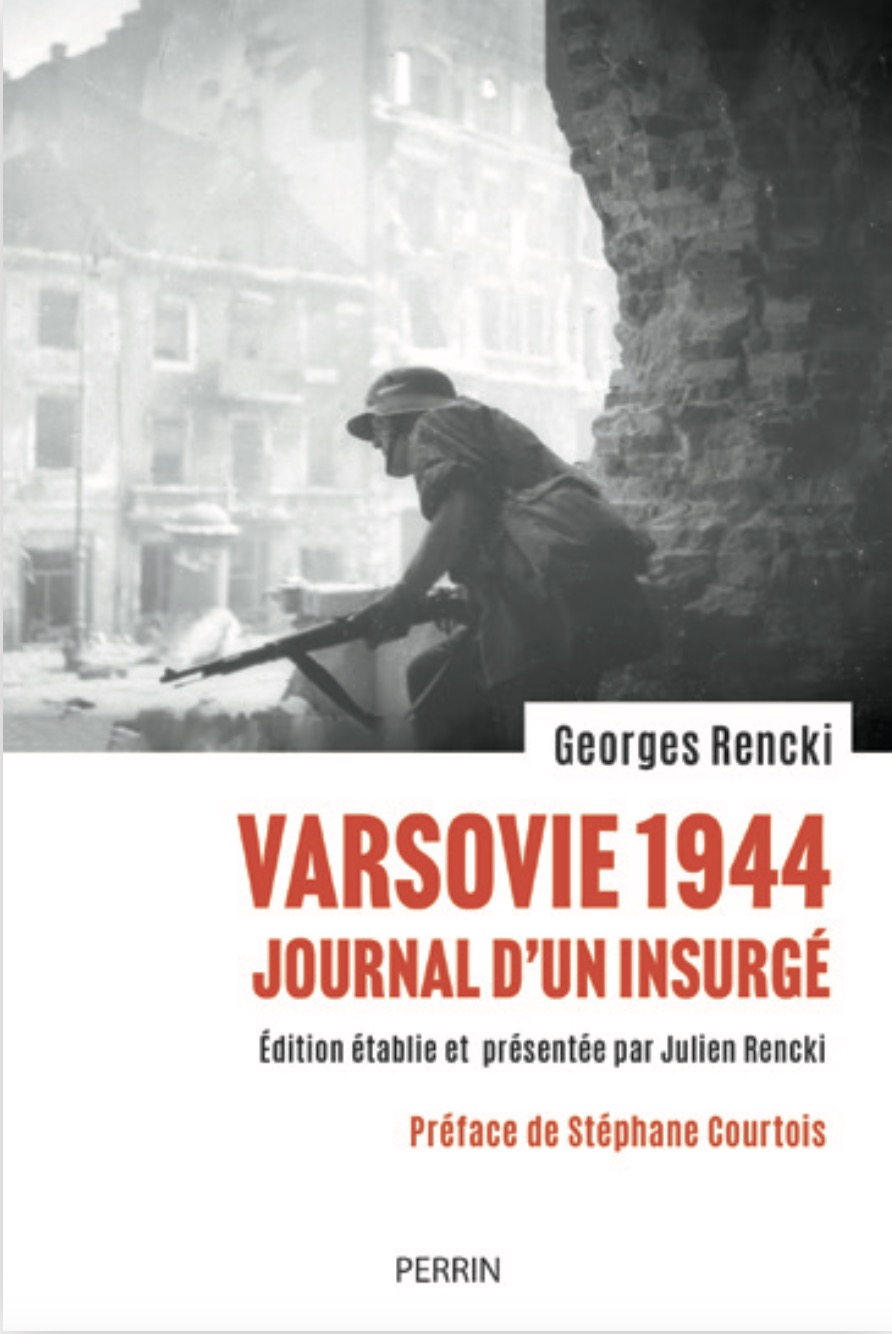
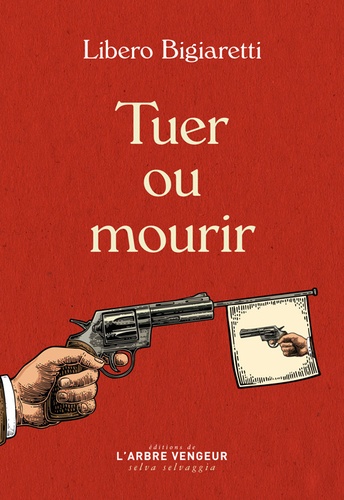
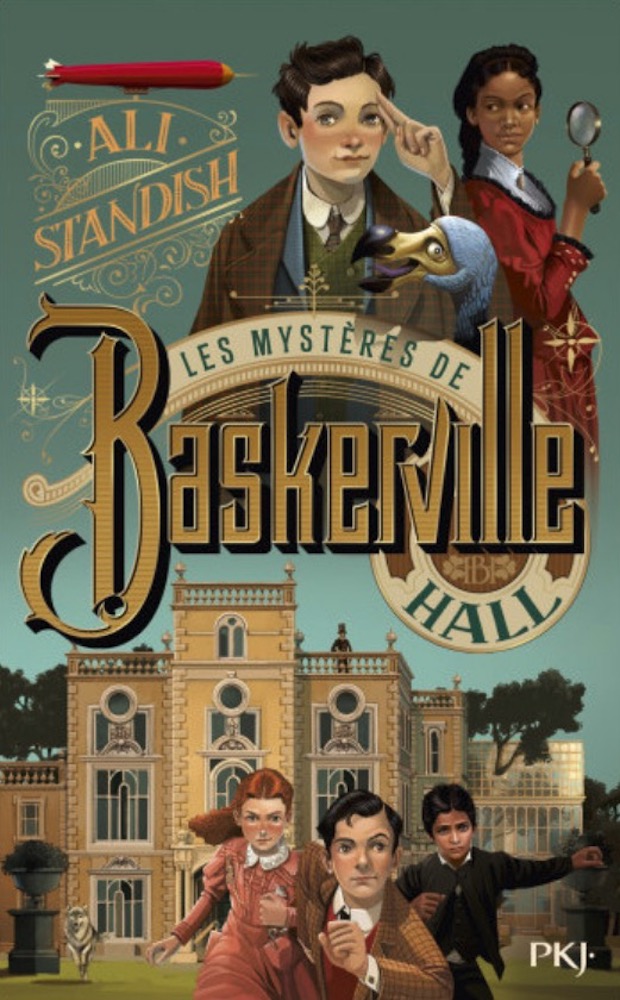
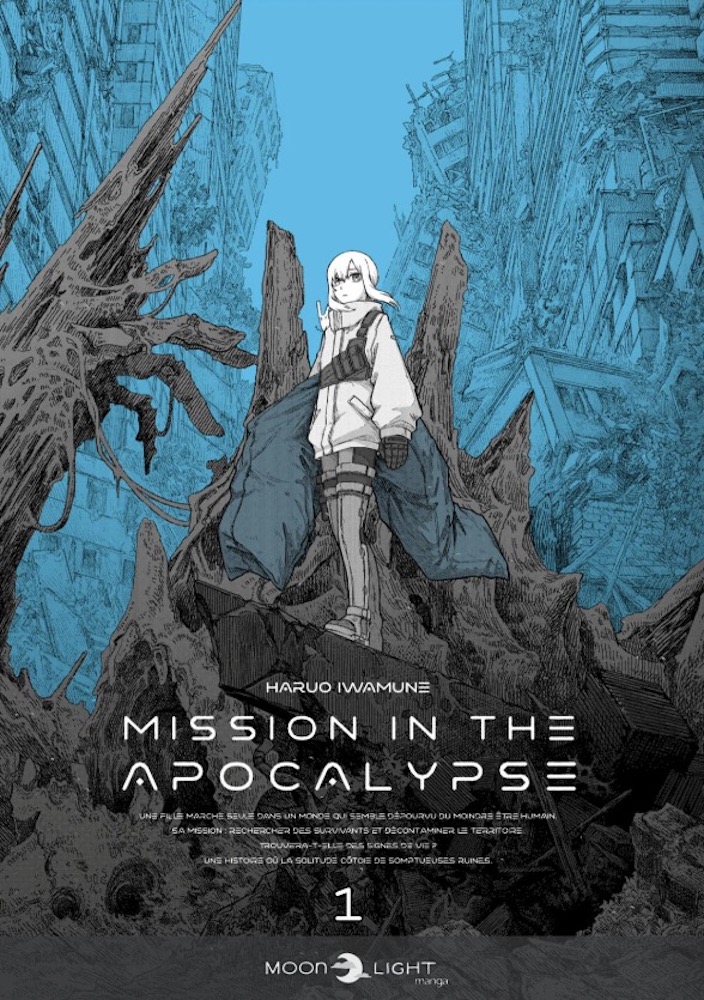
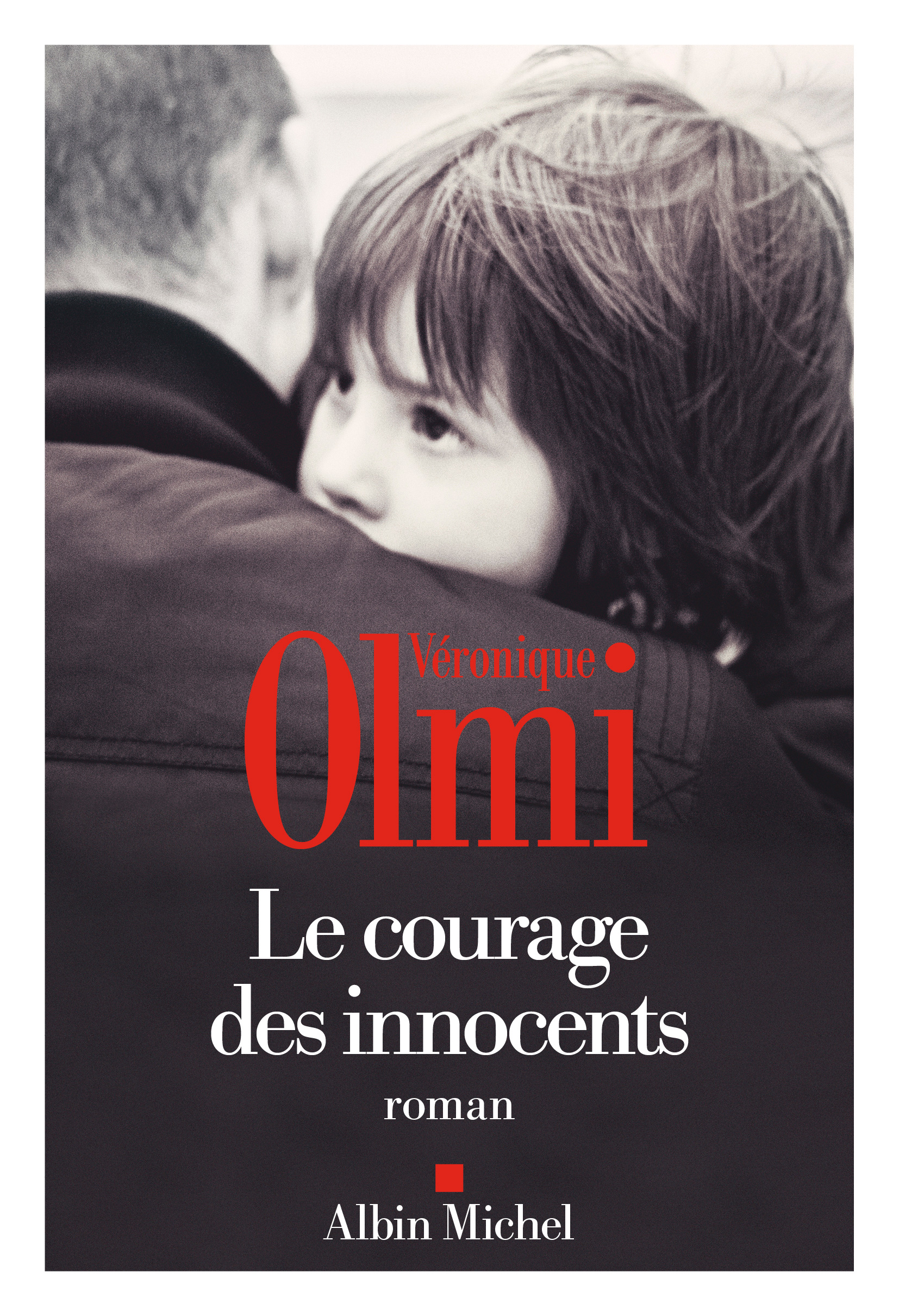
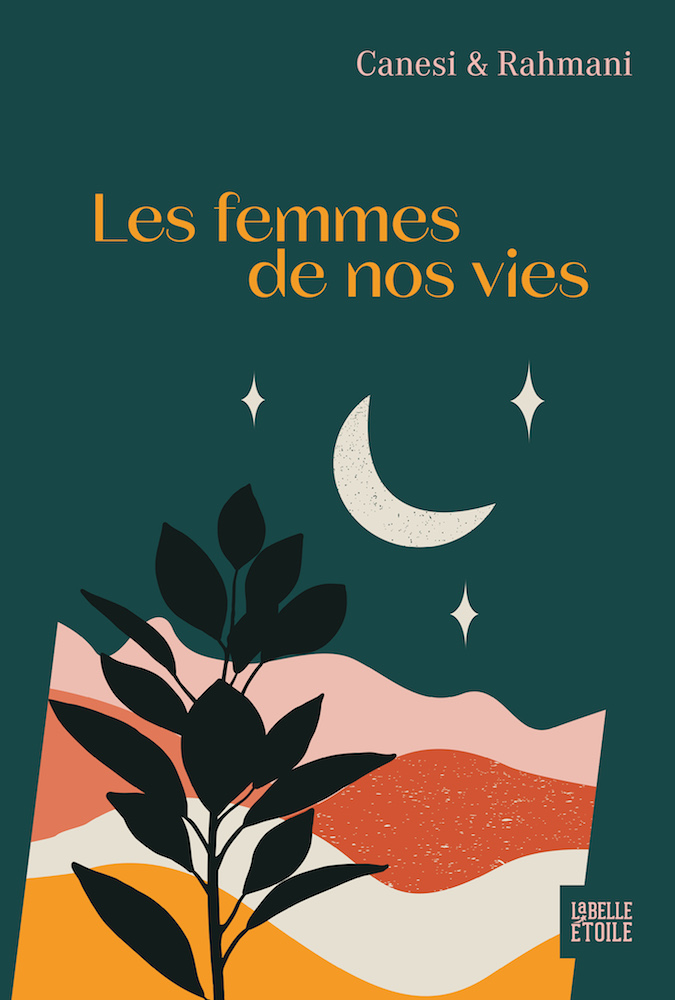
Commenter cet article