Les Ensablés - Notes de voyage de Laurent Jouannaud: "Siloé" (1941) de Paul Gadenne (1907-1956)
Mon cher Hervé, je ne suis pas un connaisseur de cette littérature française qui va d’un après-guerre à l’autre et que vous remettez à l’honneur. Vous connaissiez Paul Gadenne, pas moi. Quand je vous en ai parlé au téléphone, vous m’avez tout de suite dit que François Mitterrand aimait Gadenne qu’il comparait à Dostoïevski. C’est en lisant cette semaine le livre que Jérôme Garcin a consacré à son ami François-Régis Bastide (Son excellence, monsieur mon ami, 2008), star médiatique disparue et déjà à demi ensablée, que j’ai découvert cet auteur. Bastide a bien connu Gadenne, l’a admiré, l’a aidé : il était pauvre, malade et oublié.
Le 02/04/2017 à 09:00 par Les ensablés
Publié le :
02/04/2017 à 09:00
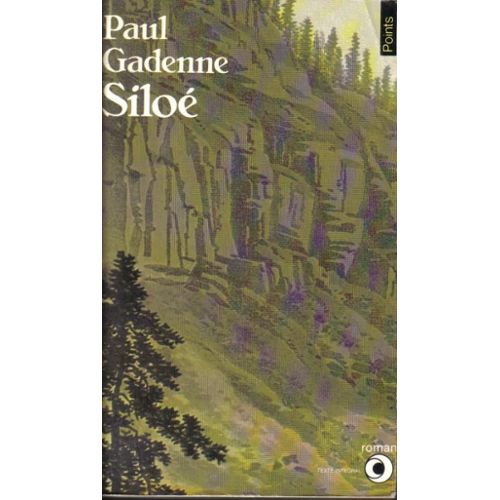
La bibliothèque universitaire à laquelle j’emprunte pas mal de livres me proposait plusieurs titres. J’ai choisi Siloé, un titre mystérieux au parfum de femme fatale, publié en 1941, 471 pages denses. Jérôme Garcin écrit de Siloé que ce fut La Montagne magique de Gadenne : il l’a écrit au sanatorium de Praz-Coutant, en Haute-Savoie.
Le roman comprend quatre parties : Prologue, L’initiation, Paix sur la terre, Le printemps. La composition est simple : Simon Delambre, brillant étudiant en Sorbonne, doit partir d’urgence en sanatorium car on découvre une tâche suspecte sur un de ses poumons. C’était au printemps, juste avant les épreuves d’agrégation. Il va y passer un an, jusqu’au printemps suivant. Là-haut, dans la montagne, il change de monde, il côtoie la mort, il rencontre des êtres à part, il réfléchit et s’initie aux vraies questions. La question essentielle, Gadenne l’a inscrite en exergue du prologue, citant la formule rimbaldienne : « La vraie vie est absente. »
Le prologue constitue la meilleure partie du roman : l’ambiance universitaire, deux étudiants brillants qui méprisent leurs camarades besogneux, deux professeurs brillants qui méprisent leurs collègues besogneux, l’engagement total des jeunes gens dans l’étude, avec pourtant, par moments, cette impression d’y gâcher sa jeunesse. Après un exposé réussi sur Ronsard, Simon a des doutes : « En se représentant cet amoncellement de chapitres sur la douce mémoire d’un poète, sur l’aimable substance d’une œuvre dont le meilleur célèbre païennement l’amour de la vie, le simple corps des femmes, le temps qui passe, la grâce familière du renouveau ; d’une œuvre dont tout ce qui nous touche, nous parle encore, c’est une odelette qui chante la fraîcheur d’une fontaine, ou une invitation à l’amour, Simon pensait à ces occupations auxquelles se livrent les condamnés à mort, pour ne pas devenir fous, derrière les barreaux de leurs cellules : c’était un passe-temps de désespéré. »
Et bien sûr, le sanatorium avec ses cellules blanchies à la chaux sera un lieu où l’on vit davantage qu’en bas, dans le monde. Simon s’en apercevra au bout de quelques mois d’initiation, en se soumettant aux strictes consignes médicales : « En même temps que l’orgueil mourait en lui, naissaient des joies qu’il n’avait pas conçues jusqu’alors et qui le faisaient progresser dans l’intimité des choses. » Gadenne décrit le magnifique décor naturel et rend parfaitement l’ambiance feutrée, la surveillance médicale, les rivalités entre malades qui caractérisent les milieux fermés.
Il y a au Crêt d’Armenaz plusieurs voies possibles pour arriver à la vraie vie : l’art, la religion, la nature, l’amour. On y croise le peintre Jérôme, l’autodidacte révolté Pondorge, Kramer le russe sensuel, Massube à la cruelle lucidité, qui cherchent eux aussi une vérité. Simon Delambre va y découvrir l’amour : Siloé est un long roman d’amour.
L’héroïne s’appelle Ariane. Elle est jeune, belle, mystérieuse. Naguère malade elle aussi, mais guérie, elle n’est pas redescendue dans le monde. Entre elle et Simon, c’est un amour d’abord platonique, puis une longue dialectique érotique se met en marche. La troisième partie du roman, sur 330 pages, raconte le progrès de leur amour. Simon se contente d’abord de son image, car Ariane ne se montre guère. Puis ils se voient quelques minutes tous les jours. Il connaît la paix grâce à elle, car Ariane est en parfait accord avec l’univers. Auprès d’elle, il éprouve une forme de bonheur : « Le bonheur, c’est quand on n’attend plus, quand l’espoir ni l’anxiété n’ont plus de sens, quand il n’y a rien de ce qui pourrait être qui soit supérieur à ce qui est. » (p. 197) Ils se retrouvent tous les soirs, au bord de la forêt, dans une nature que Gadenne décrit avec une généreuse profusion. « Il n’avait chaque fois que peu d’instants à passer auprès d’Ariane, mais il acceptait avec sagesse cette discipline imposée à leur bonheur. » Mais Simon découvre qu’Ariane a une autre vie, avec d’autres : « Il voyait se construire sous ses yeux une Ariane nouvelle, redoutable, ayant une vie qu’il ne connaissait pas. » D’autre part, une autre femme, Minnie, jeune, jolie, sexuée, cherche à le séduire et le fait sortir de son flegme. La paix ressentie avec Ariane n’est d’ailleurs pas la paix qu’il ressent dans la nature, qu’il a ressentie en écoutant de la musique, ou celle qu’il imagine sous le mot « Dieu ». Simon comprend alors qu’il lui faut aimer Ariane sans vouloir se l’attacher ni la garder pour lui : « Ariane ne serait jamais à lui, Ariane n’était à personne, non plus que ces brillantes aiguilles [de sapins] qu’il avait regardées en montant et qui remplissaient encore là-haut le fond du ciel. » (p. 264) Il faut donc aimer sans rien exiger en retour. « Qu’ai-je besoin de croire à l’amour des êtres pour les aimer ? Qu’ai-je besoin de croire pour l’aimer que la nature est là qui m’invite et qui m’aime ? » (p. 279) Il pourrait aussi bien aimer une Ariane immatérielle ou absente. Mais celle-ci lui rappelle qu’elle est aussi un corps. Ce corps, fragile, mortel, n’est-il pas une gêne, un danger ? « Peut-être ne suis-je vraiment heureux que lorsque vous m’êtes invisible ? » Ils s’aiment, mais leur amour est encore incomplet : « Ils se regardaient, se contemplaient l’un l’autre avec avidité, heureux de se sentir envahis tout entiers par leur amour, par la certitude qu’ils ne se rencontraient pas seulement dans les limites étroites d’un monde clos, mais qu’ils étaient en présence d’une chose qu’ils n’avaient pas faite à eux seuls. Car leur amour se tenait entre eux comme une personne muette et invisible qui les dominait. » (p. 296) Mon cher Hervé, il y aura ensuite le premier baiser. Mais ce baiser ne saurait suffire, l’attente du prochain rendez-vous est presque insoutenable, cet amour n’est pas encore mûr. Simon dira enfin à Ariane: « Je vous aime », page 382. Leur amour finira par intégrer le corps dans son ascension : « Chaque ligne de votre corps est esprit et pensée. » (p. 384) Et à la page 410, ils couchent enfin ensemble dans un chalet de randonnée, derrière le sanatorium. « Elle s’était abandonnée à lui sans l’ombre d’une hésitation, comme on s’abandonne à la vérité, à l’évidence ». Mais cet amour dépasse l’union de deux corps, il est la vie en train de se faire ! Les deux personnages se voient vivre ensemble. Cela sera-t-il le comble de l’amour ou la fin de l’amour ? Un stade encore plus élevé apparaît alors : l’amour, c’est donner la vie ! Ils refont l’amour, c’est extraordinaire, mais « le désir n’allait pas vers une chose claire où l’on pouvait s’arrêter et dire : nous y sommes…Nous y voici ! Vers quoi allait-il donc ? Vers quoi ? Ah, il allait vers un abîme où la lumière était aveuglante comme la nuit, si bien qu’on ne savait pas si c’était de la nuit ou bien de la lumière ». (p. 436) Et finalement, on revient au point de départ, à la banale vie d’en bas qui contient la vérité, mais cette fois transcendée par l’esprit qui sait qu’il lui faut s’incarner. Gadenne a lu Hegel et Kierkegaard.
Les dialogues sont très longs, les personnages sont trop intelligents, et les problèmes un peu trop académiques : « Le bonheur, est-ce être rassasié ou est-ce le désir continué? » Quand et comment tout cela finira-t-il ?, se demande le lecteur impatienté. Gadenne choisit la facilité en faisant mourir son héroïne. Au printemps, Ariane est emportée par un avalanche au moment même où le grand maître, le docteur Marchat, explique à Simon que la radiographie est nette et qu’il peut partir. Il partira donc, seul, transformé, emportant Ariane avec lui : « Ariane morte n’existait pas moins, n’agissait pas autrement sur eux qu’Ariane absente. Elle les forçait toujours à avancer, seuls, mais incontestablement, au cœur de l’incommunicable. ».
Gadenne a aussi lu Proust. Il reconnaît sa dette avec humour, car passe dans Siloé une grand-mère qui admire les lettres de Madame de Sévigné ! Et il y a même un musicien du nom de Sugère, dont un morceau intitulé Poème inspire à Delambre des réflexions un peu trop connues des connaisseurs de A la recherche du temps perdu. Et bien sûr, les longues analyses rappellent les subtiles dissections de Proust. Il manque cependant à la prose de Gadenne la sensualité poétique du maître.
Et Siloé ? Je l’attendais à chaque page ! Qui est-ce donc ? Voici l’explication. A la fin de ce trop long roman, Delambre retourne dans le monde, et Gadenne répète la leçon, la morale de l’histoire : « Il allait retourner parmi ce peuple d’hommes qui, n’ayant à aucun degré la conscience de leurs maladies véritables, ne retiennent des réalités que les seules choses visibles ou chiffrables, prennent pour sérieuse une activité souvent machinale ou puérile et qui, emportés dans l’épais tourbillon de la vie, prisonniers de leur agitation, esclaves du quotidien et de l’utile, nécessairement asservis à l’argent, n’ont pas encore eu le temps de soupçonner l’existence, en bordure du monde, de ce monde étonnant qui s’ouvre à ceux-là seuls qui savent se tenir immobiles. Combien d’eux auraient eu besoin que quelqu’un vînt un jour les prendre par le bras et les menât se tremper dans les eaux de Siloé ! »
Siloé serait donc une fontaine, une eau purifiante ? Je cherche sur Google : « Siloé ou Shiloah : la source près de laquelle s’est construite Jérusalem. » Et Gadenne a placé en exergue de son roman un passage de l’Evangile de Saint Jean (9, 1) qui mentionne cette source. Jésus envoie un aveugle laver ses yeux au réservoir de Siloé, et l’aveugle en revient guéri : « Et abii, et lavi, et video. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !
Paul Gadenne a écrit Siloé à 34 ans. C’est un roman de jeunesse. On y sent une belle facilité de plume, une grande subtilité psychologique, une forte inquiétude métaphysique, mais les personnages restent abstraits. Ce sanatorium semble en apesanteur, à une époque (1941) où l’Europe s’effondre. Et ses maîtres empêchent encore l’auteur de se trouver. Le grand Gadenne se montre, me dit Wikipédia, dans La plage de Scheveningen (1952) et Les Hauts-Quartiers, paru en 1973, sans éditeur du vivant de l’auteur.
Je mets La plage de Scheveningen sur ma liste de lectures. Je vous en reparlerai un jour, cher Hervé, chers lecteurs.

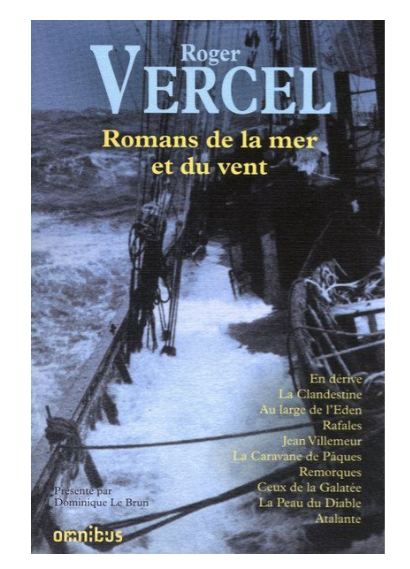
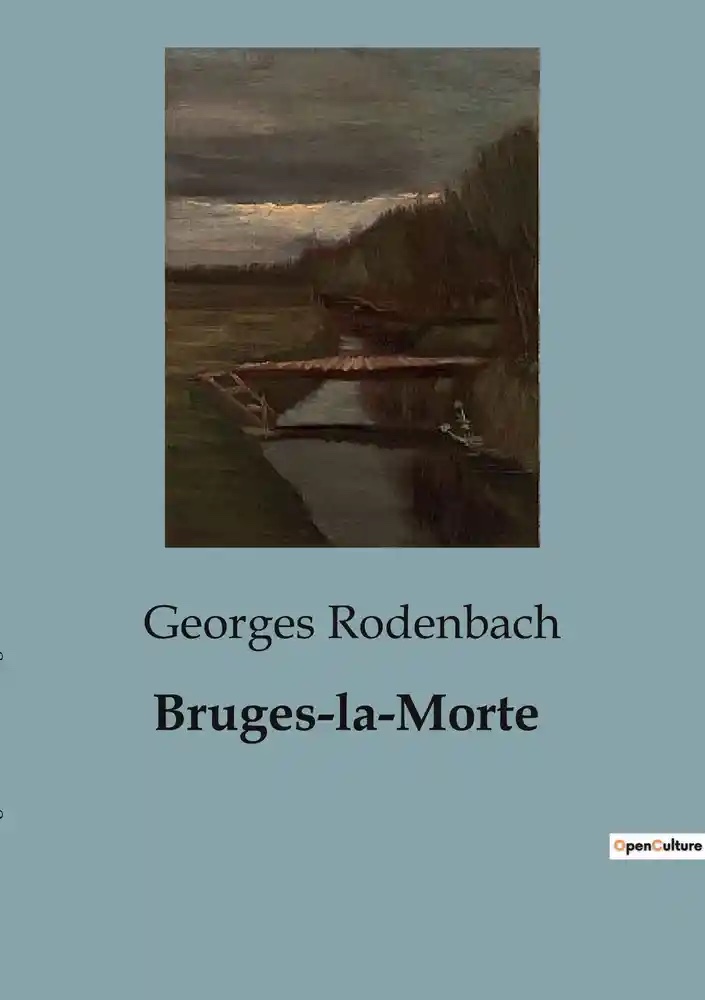
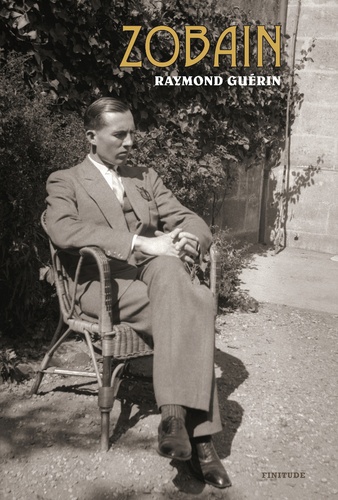

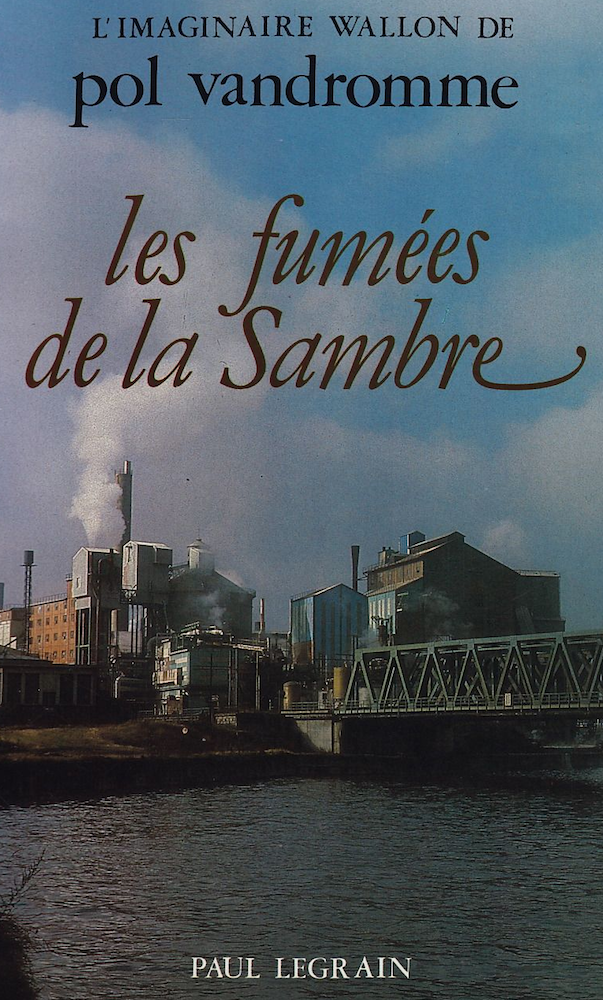
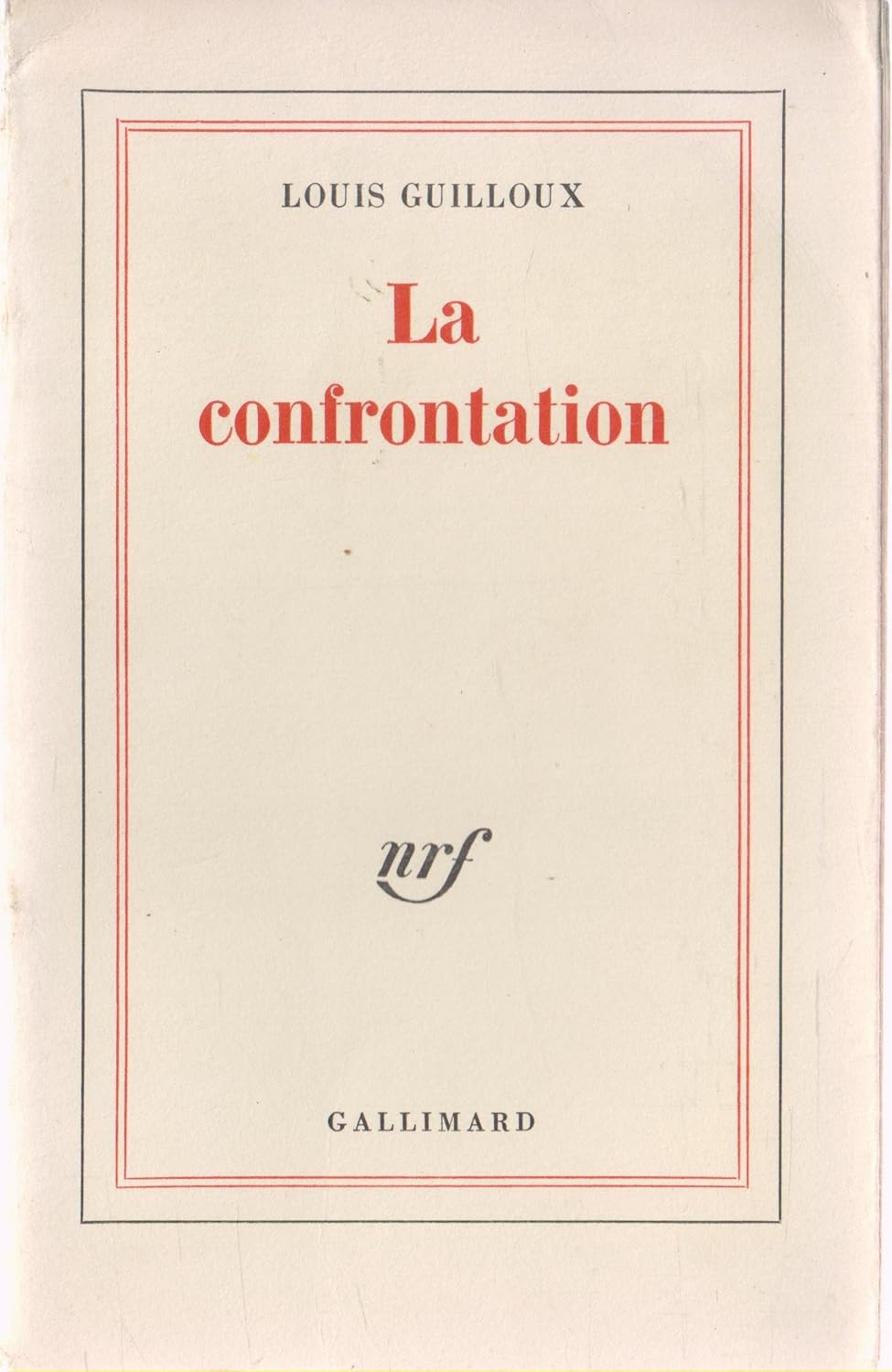
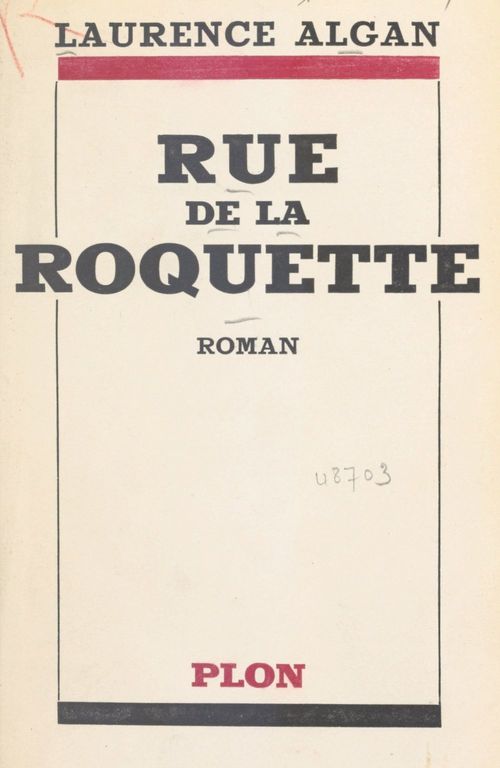
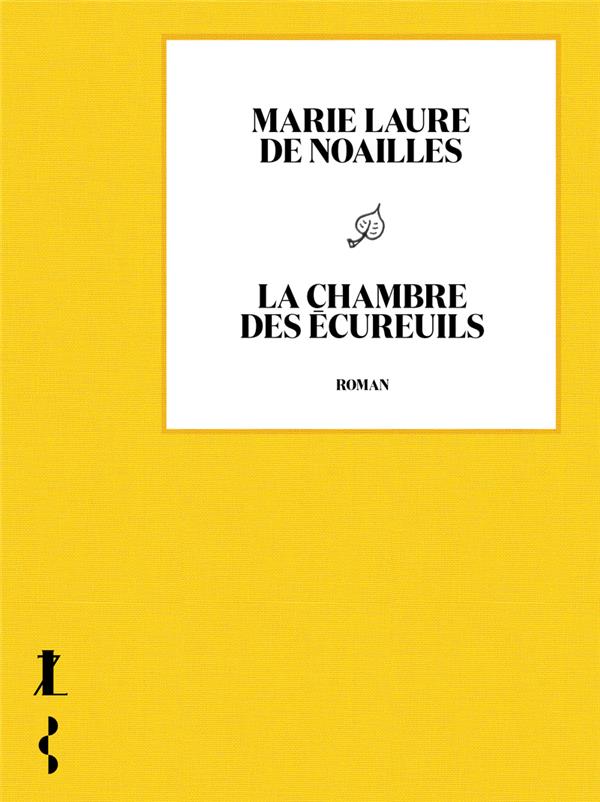
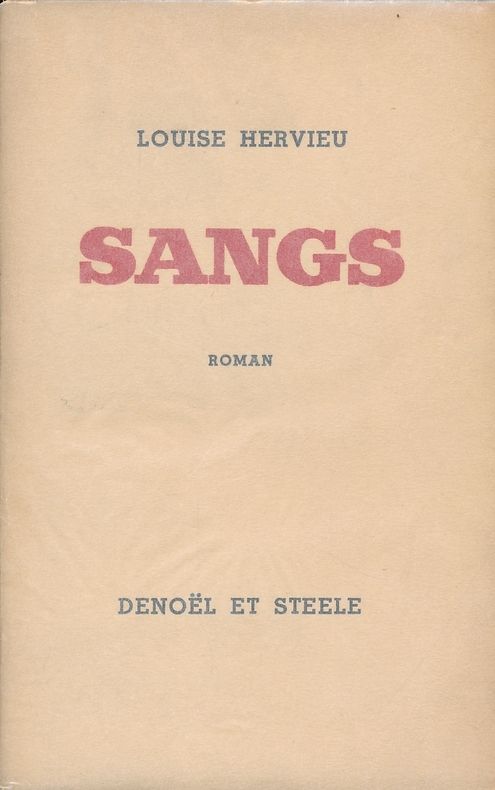
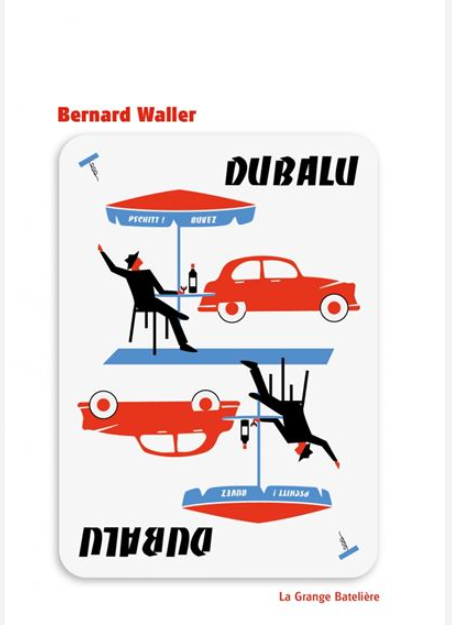
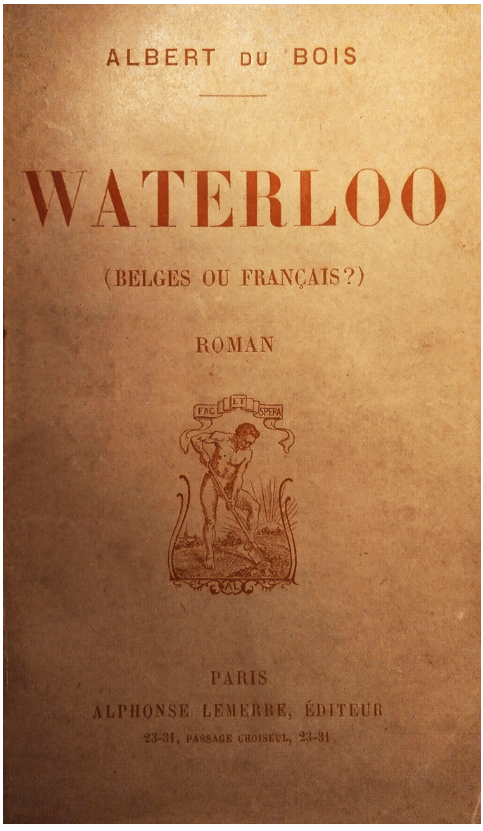

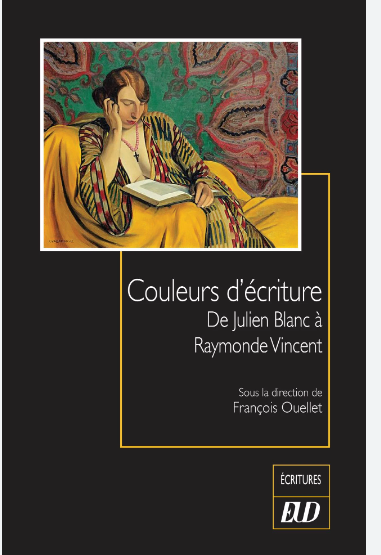
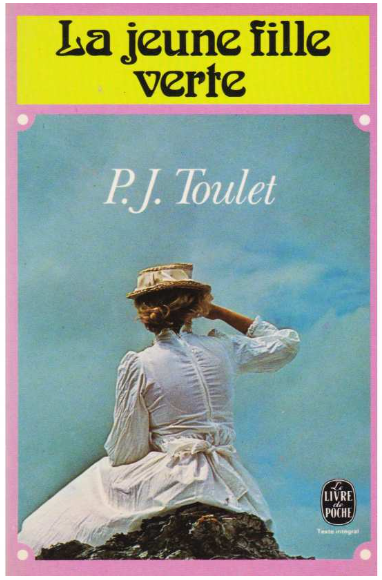
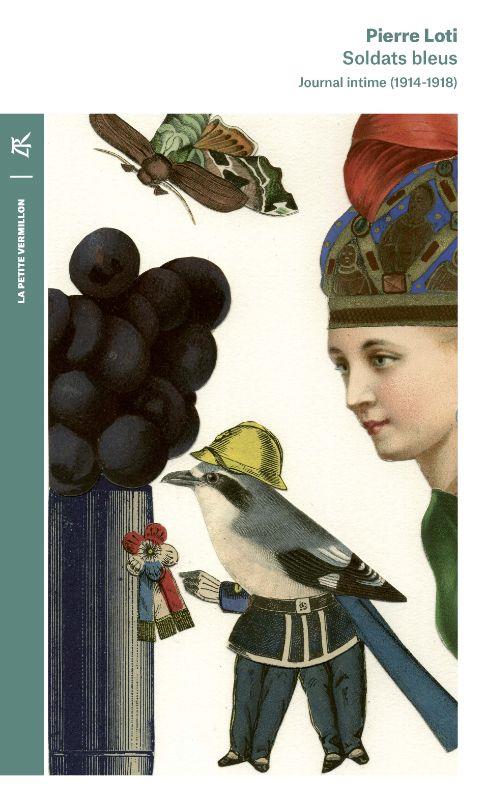
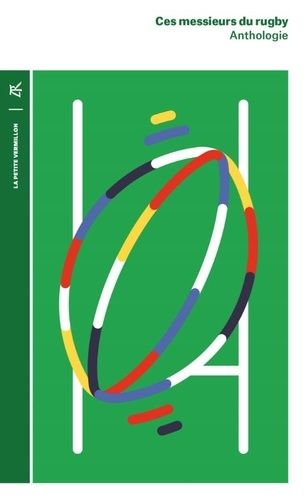
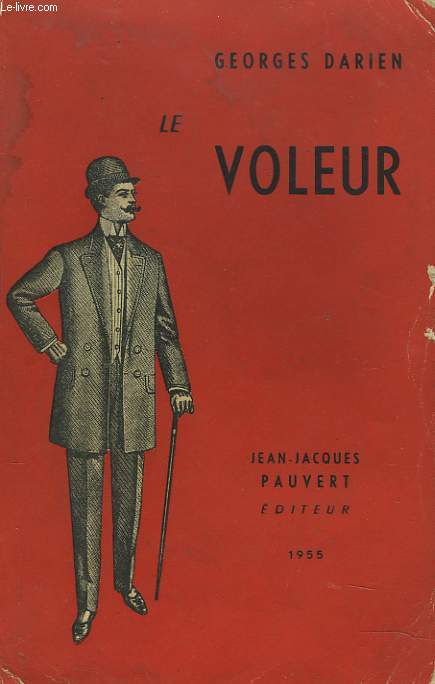
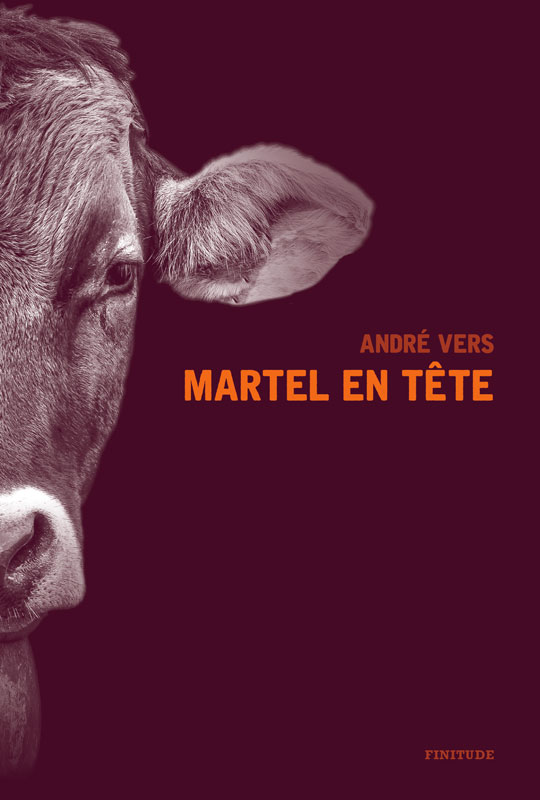

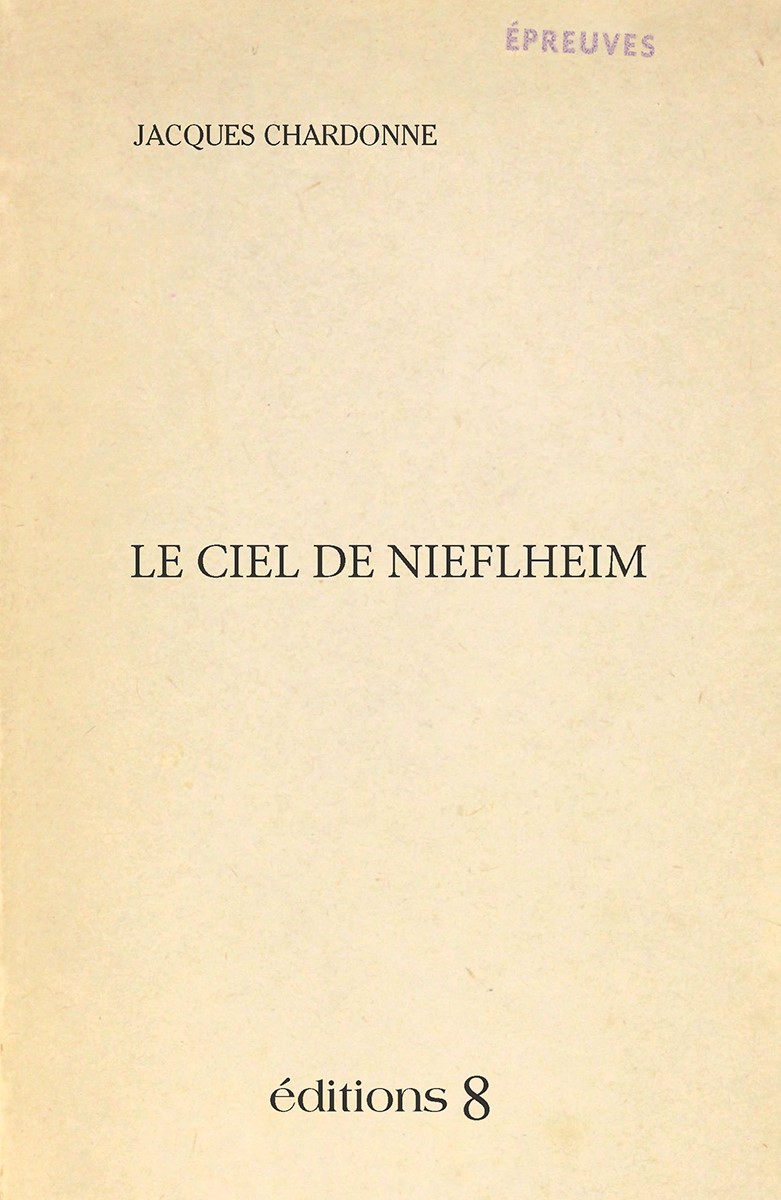
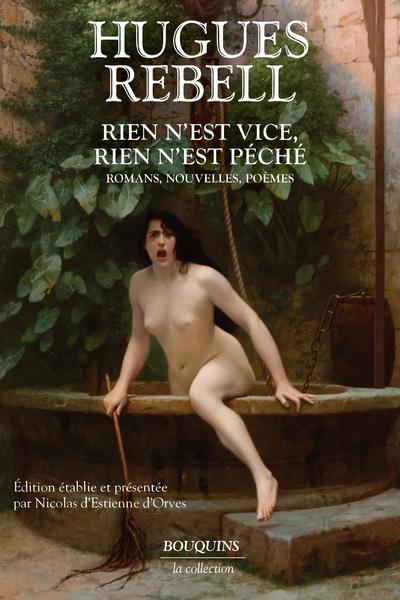
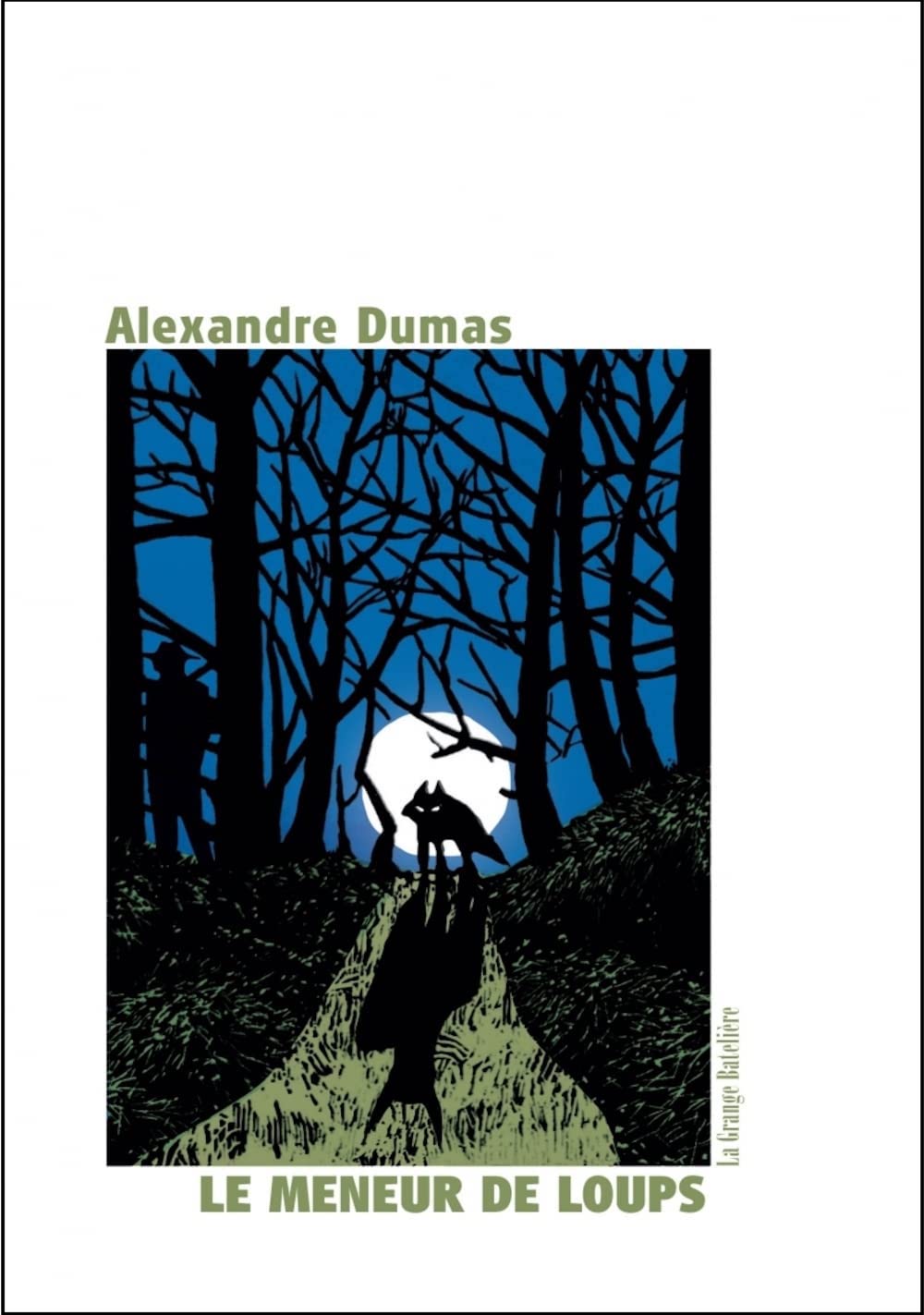

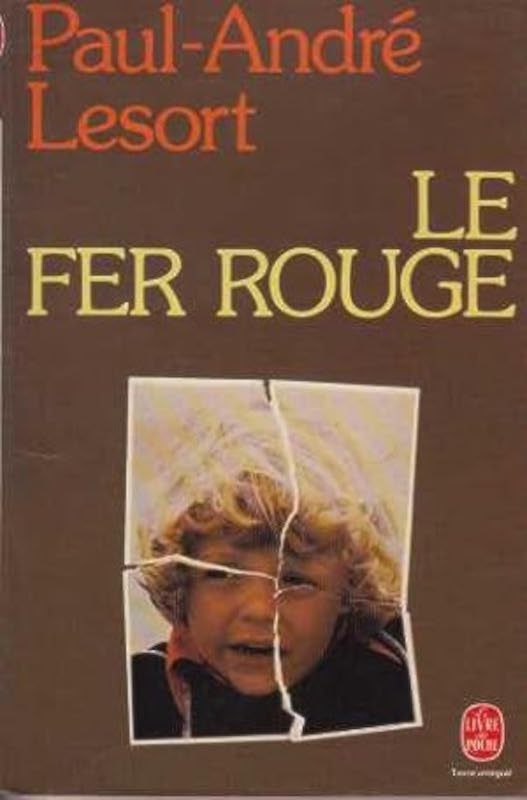


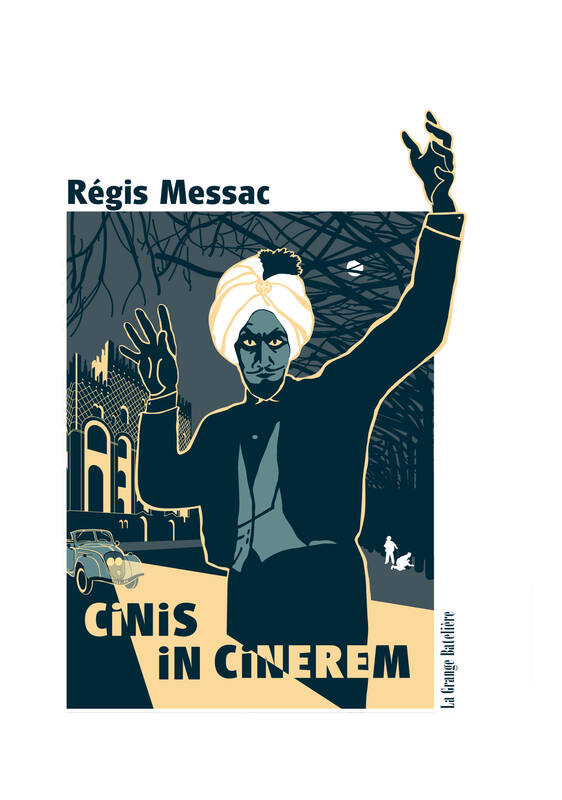

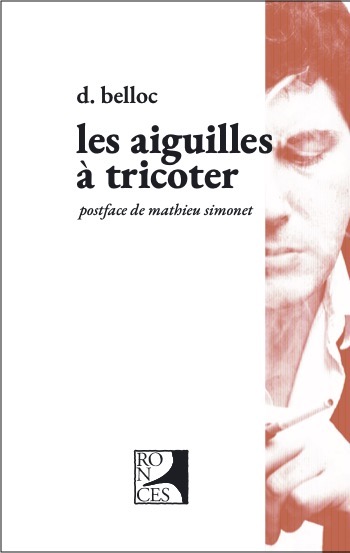
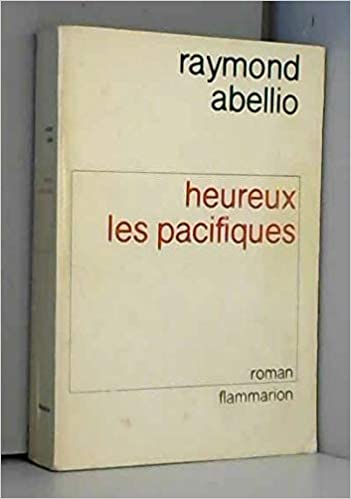
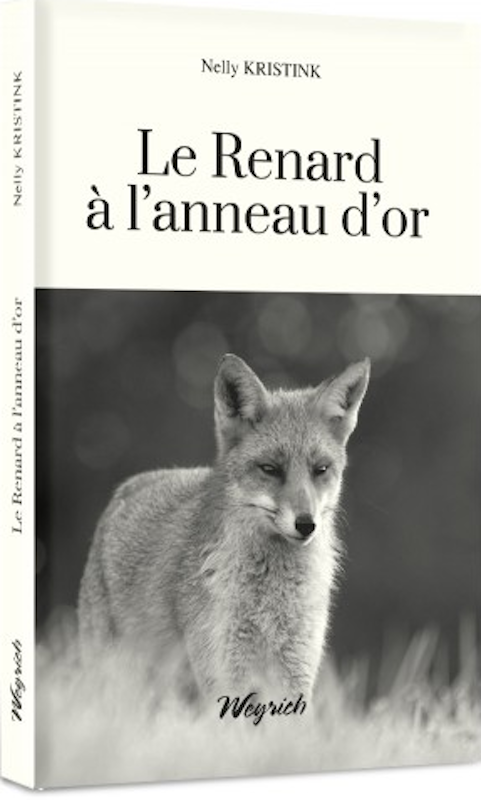
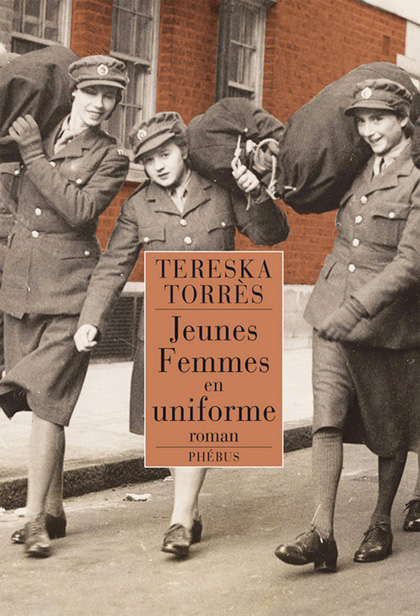
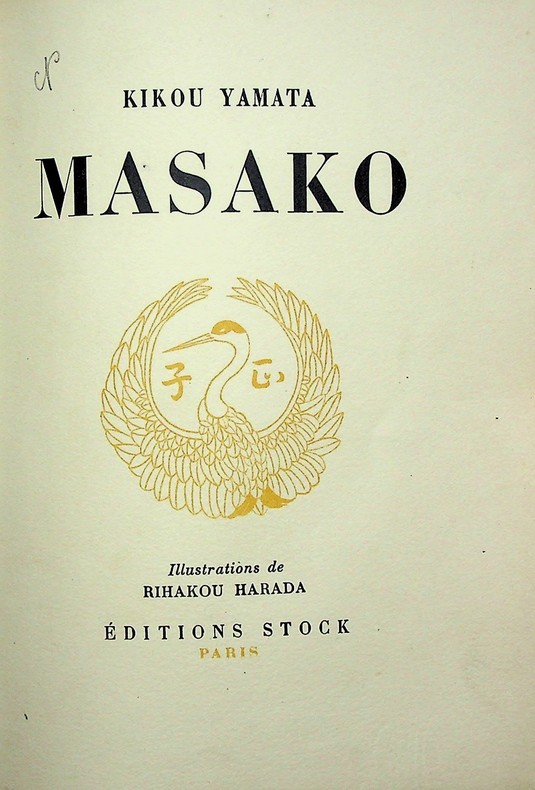
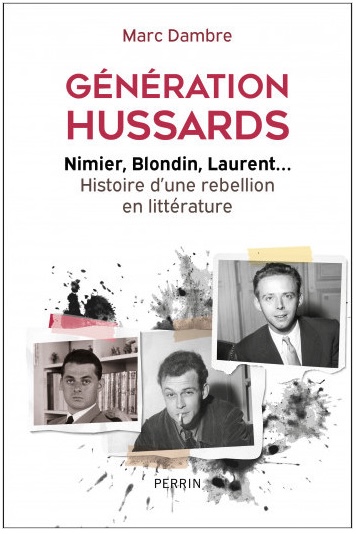
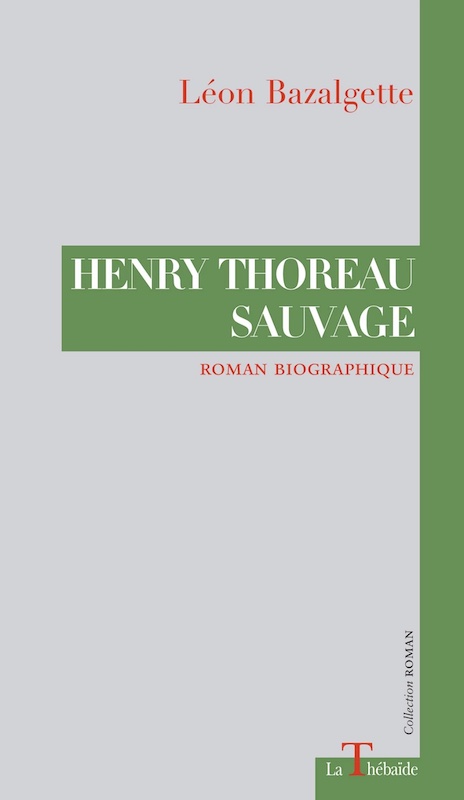

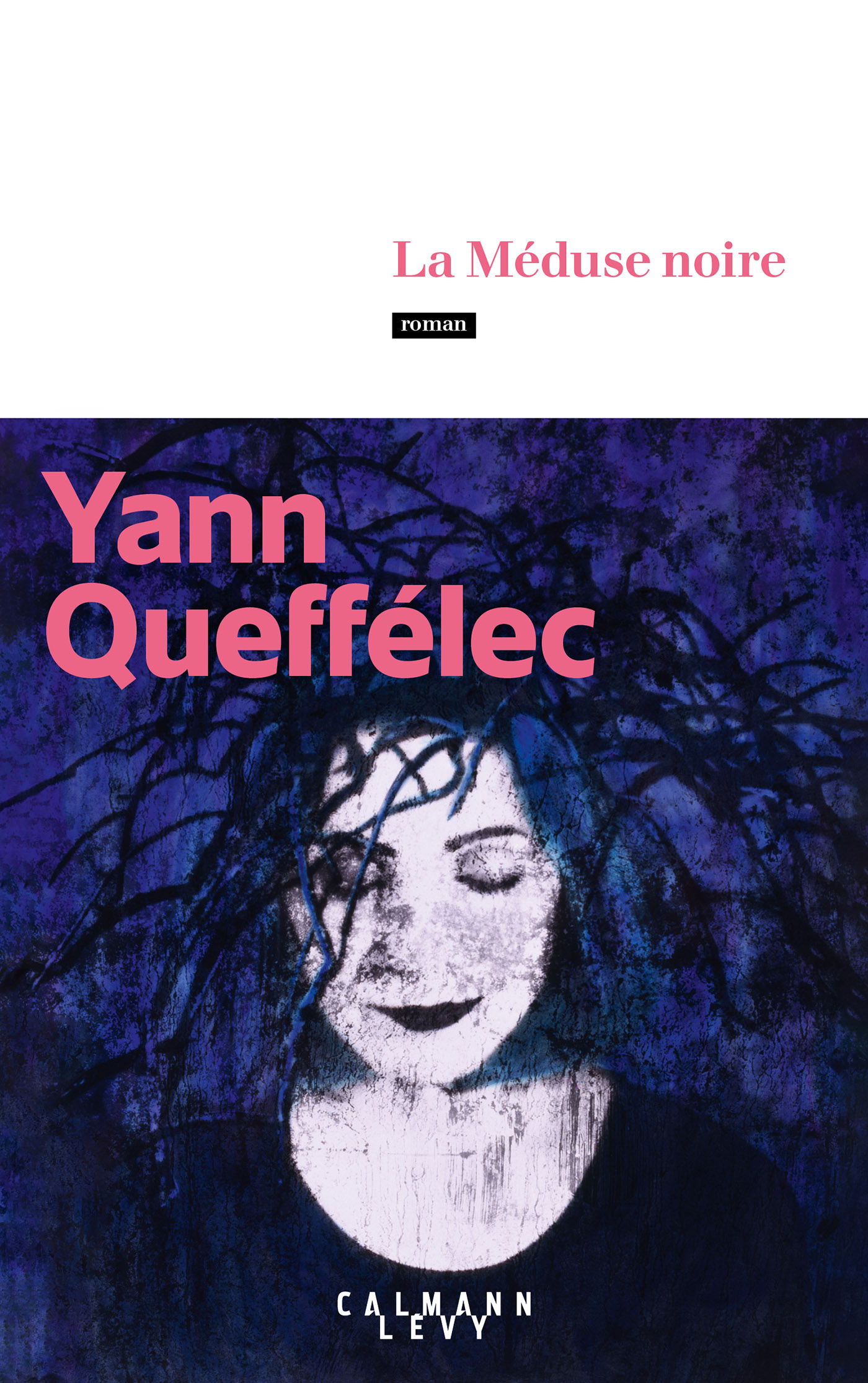


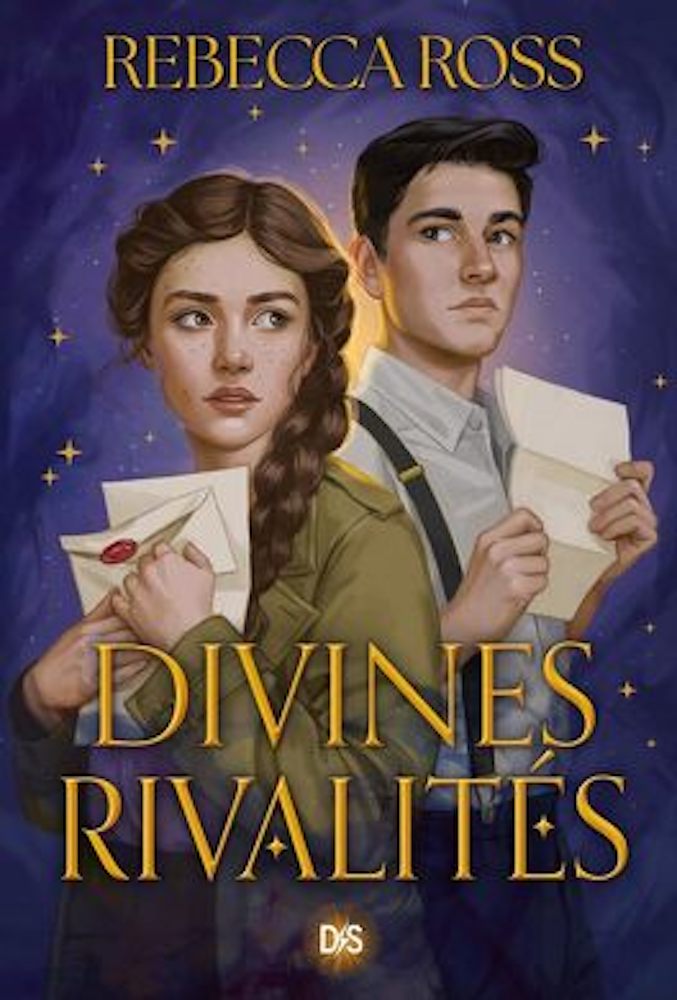



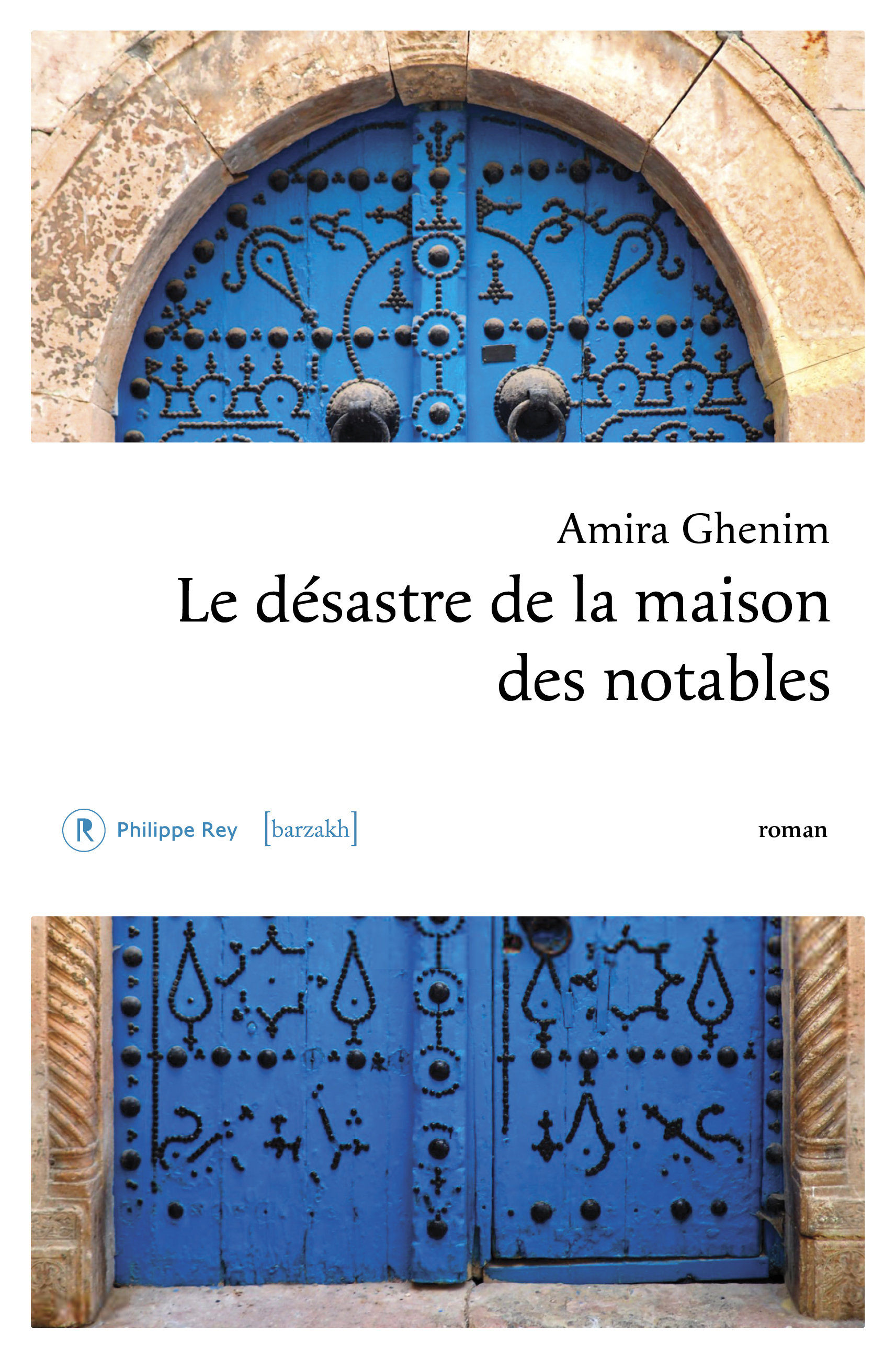
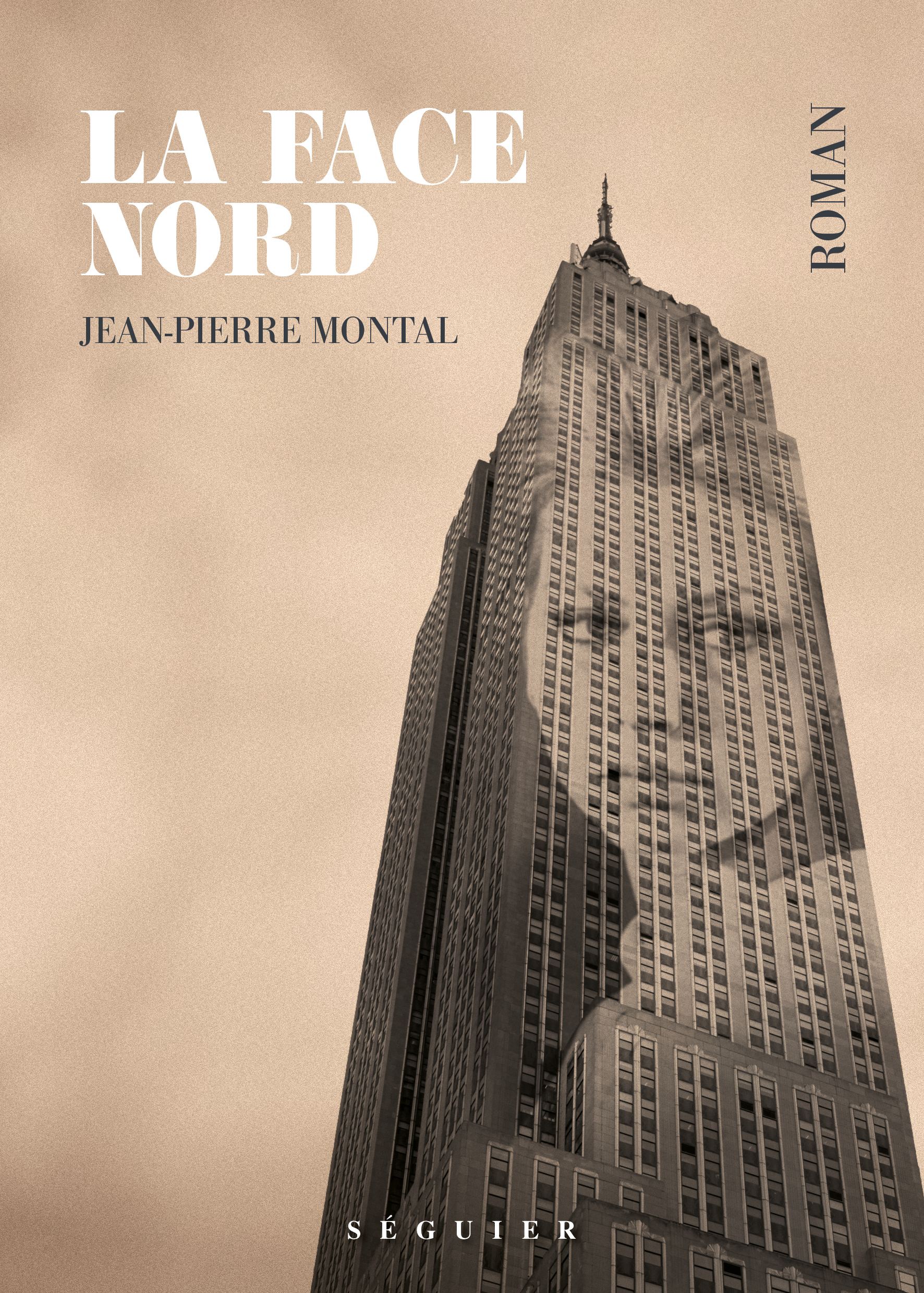



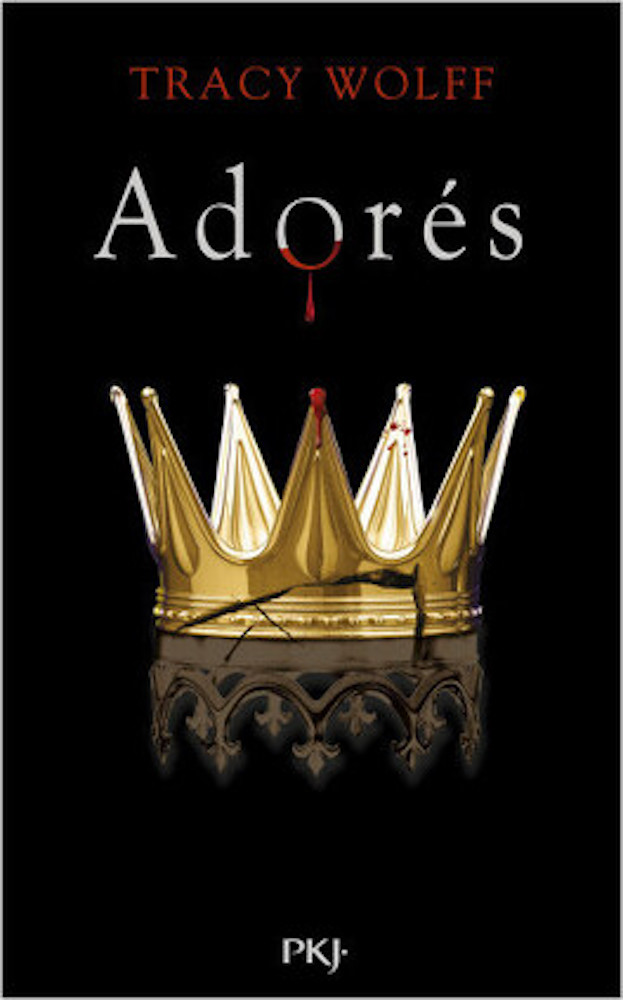
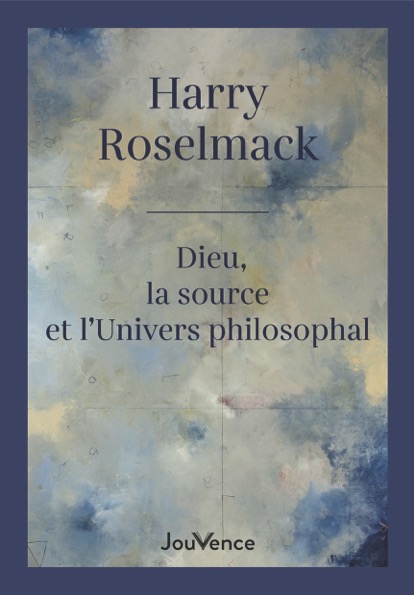
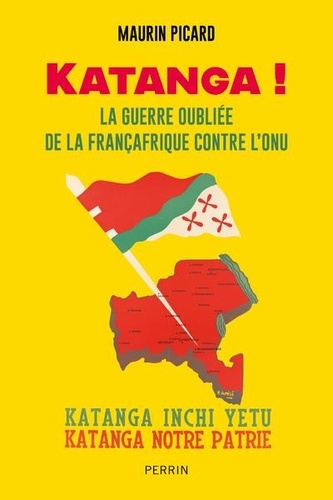

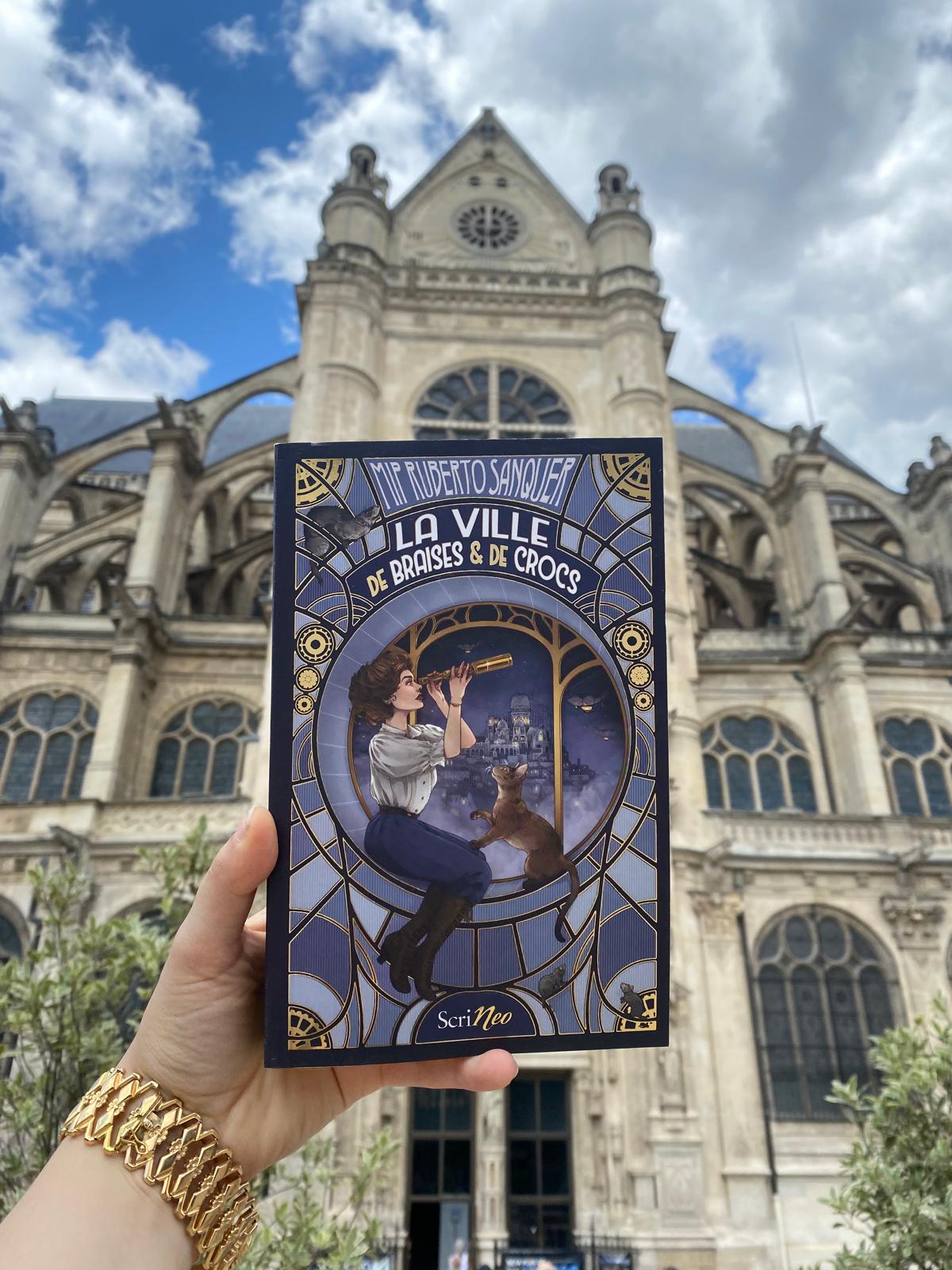
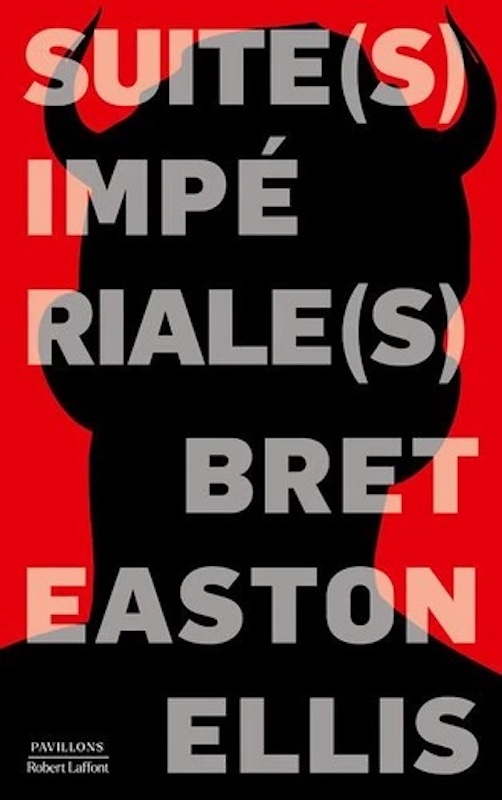




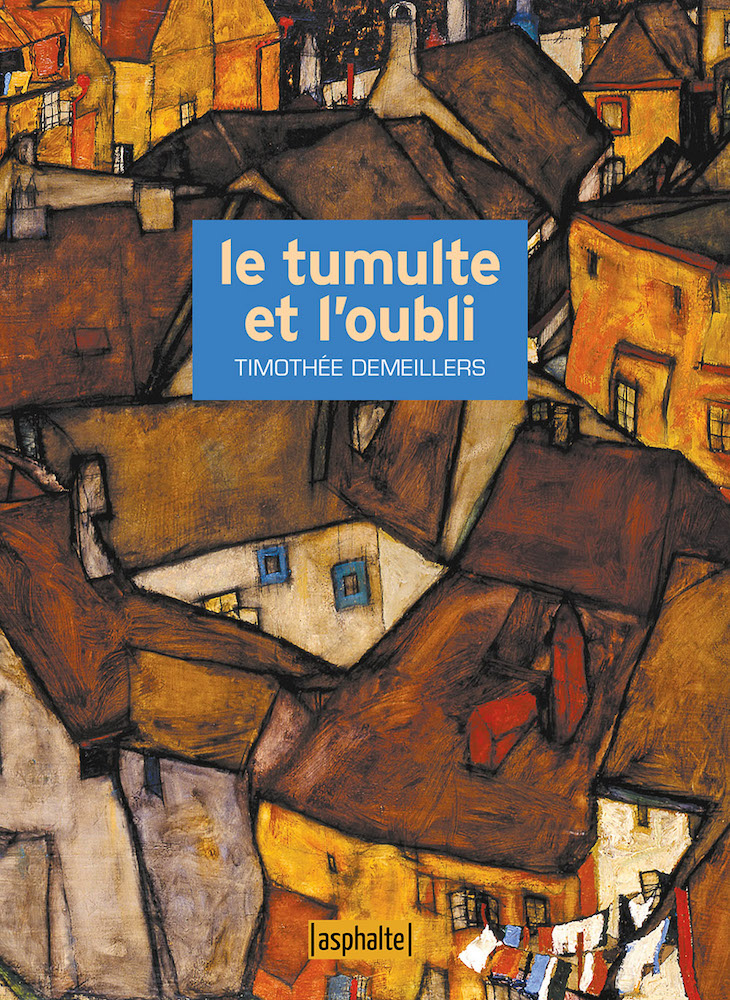


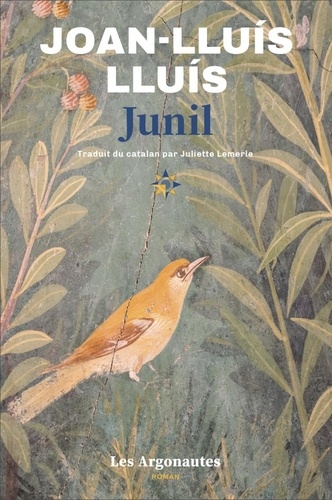

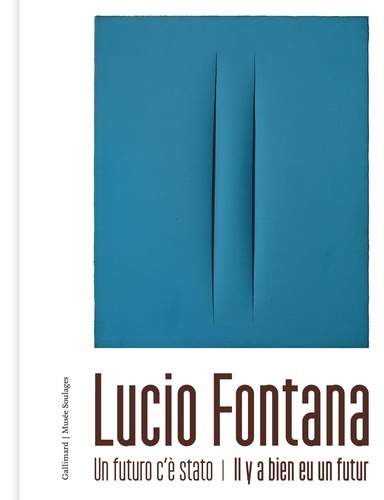


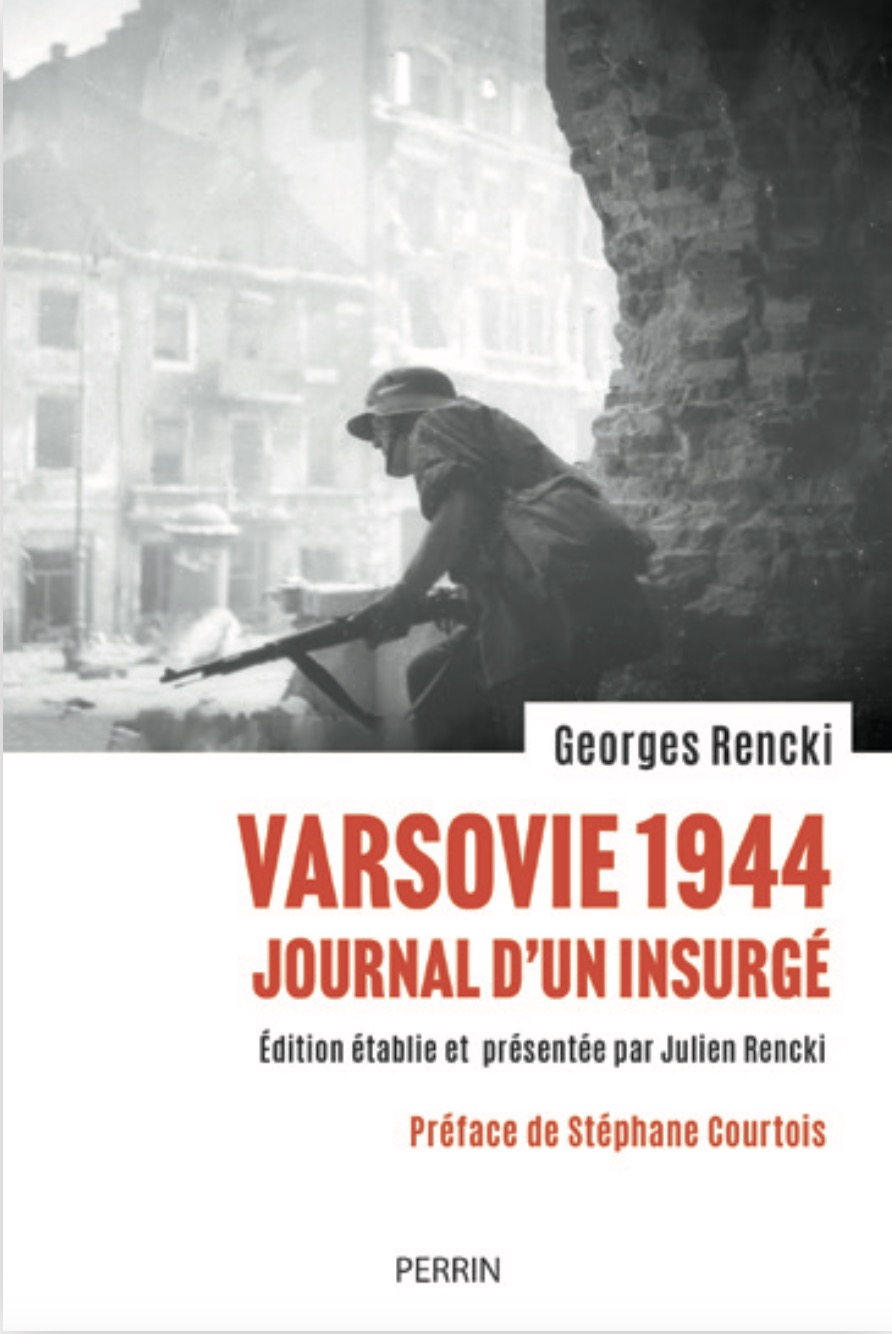
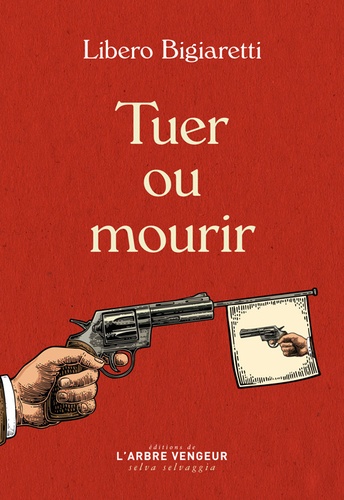

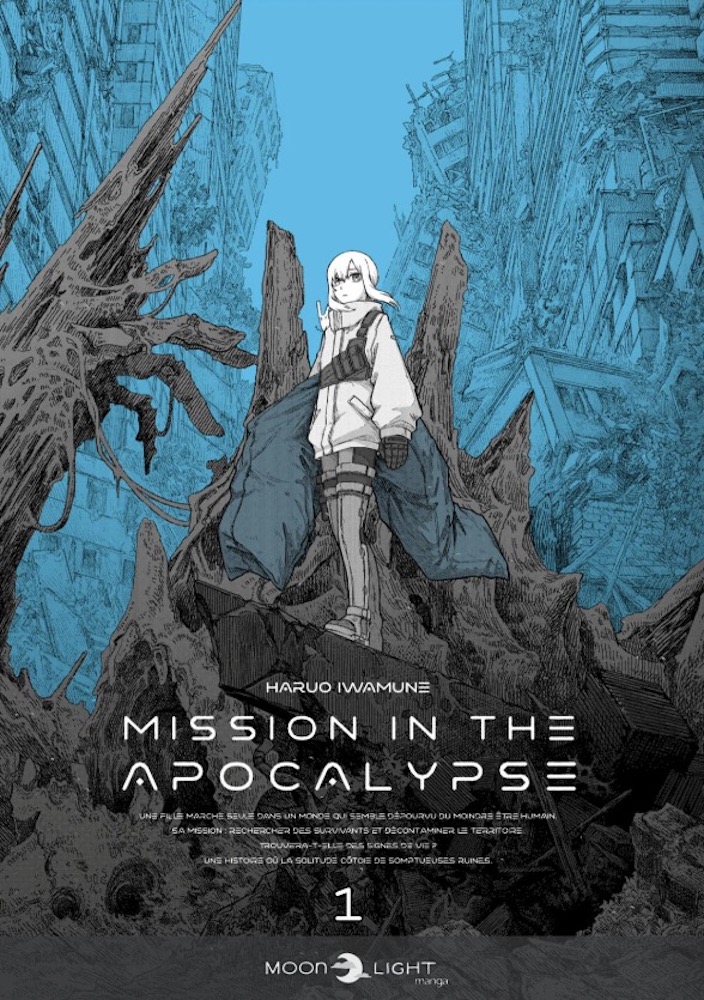


Commenter cet article