Notes de voyages : "Tristes tropiques", de Claude Lévi-Strauss
« Je hais les voyages et les explorateurs » : ceux qui ont connu cet été, cher Hervé, les moustiques dingues, les méduses sur les plages, les colibacilles dans la salade, l’artisanat local industriel, les bouchons sur les autoroutes, les nuits d’attente à la gare Montparnasse, les bagarres d’aéroport, les flammes léchant le camping, les locations bancales et les notes salées souscriront à cette déclaration désabusée qui ouvre Tristes tropiques.

Pour ma part, je suis resté à la maison et je me suis dépaysé en lisant ce grand livre de Claude Lévi-Strauss. Ce n’est pas un roman, mais à sa parution, en 1955, les jurés Goncourt ont songé à lui décerner leur prix, tant l’ouvrage est divers, coloré, humain, et trempé dans une prose tantôt chirurgicale, tantôt luxuriante.
Par Laurent Jouannaud
On ne brûle que ce qu’on a adoré et Claude Lévi-Strauss déteste les voyages après avoir voyagé loin et longtemps. Son livre nous conduit au Brésil, mais aussi en Inde, au Pakistan, aux Antilles, à New York. Jeune agrégé de philosophie, alors qu’il s’ennuie en lycée, on lui propose en 1934 d’aller enseigner la sociologie à l’Université de Sao Paulo et de faire accessoirement de l’ethnographie : « Les faubourgs de Sao Paulo sont remplis d’Indiens, vous leur consacrerez vos week-ends. » Mais il n’y a pas de vrais Indiens en ville. S’il y en a encore quelque part, c’est en Amazonie. Robinson part dans la jungle à la recherche de Vendredi. C’est le Mato Grosso, la « grande brousse », sur le pourtour du bassin amazonien.
Lévi-Strauss raconte ses quatre années d’aventure au cœur du Brésil. Il y a des pistes où les camions s’ensablent ou s’enlisent. « Mais toujours domine une impression d’immensité : le sol est si uni, les pentes si faibles que l’horizon s’étend sans obstacles jusqu’à des dizaines de kilomètres : une demi-journée se passe à parcourir un paysage contemplé depuis le matin, répétant exactement celui traversé la veille, de sorte que perception et souvenir se confondent dans une obsession d’immobilité. » Ailleurs, on avance à cheval : « Je me rappelle seulement des heures de chevauchée saccadée par l’amble de nos montures. » Il y a des crocodiles, des termites, des piranhas, des serpents (« nous entendîmes un froissement : c’était un boa long de sept mètres que notre conversation avait réveillé »), ou des oiseaux qu’on peut toucher car ils n’ont jamais vu d’hommes et n’ont pas peur. La forêt inspire des pages magnifiques : « Vue de l’intérieur, cette masse confuse devient un univers monumental », à plusieurs degrés, depuis le sol jusqu’ « aux étages aériens », « vastes coupoles, tantôt vertes, tantôt effeuillées, mais alors recouvertes de fleurs blanches, jaunes, orangées, pourpres ou mauves ».
Il y a des fleuves dont le moindre a déjà 100 mètres de large, ou des rapides qu’il faut franchir à pied : on décharge, on sort la pirogue de l’eau, on la transporte à la main après les rapides, on transporte les bagages, on recharge, on repart sur le fleuve, jusqu’au prochain rapide. Avant la nuit, on défriche un coin de forêt pour bivouaquer, on sort les hamacs et Lévi-Strauss cale les pans de sa moustiquaire avec son revolver, comme dans un roman de Malraux. Parfois on dort allongé par terre, comme les indigènes, ou appuyé à un tronc d’arbre sous la pluie battante, ou sur un monceau d’épis de maïs qui fournissent une couche confortable : « Tous ces corps oblongs glissent les uns contre les autres et l’ensemble se modèle à la forme du dormeur. » On mange ce qu’on a emporté : bolachas (pain de farine sans levain agglomérée avec de la graisse). On mange ce qu’on trouve en chemin, du singe, par exemple : « Il suffit d’une balle dans leurs troupes bondissantes pour abattre à coup presque sûr une pièce de ce gibier ; rôtie, elle devient une momie d’enfant aux mains crispées, et offre en ragoût la saveur de l’oie. » Il y a les bananiers sauvages, appelés pacovas, ou les noix du Brésil, les toquais, grosses noix triangulaires, à pulpe laiteuse et bleutée. Ou les koros, « larves pâles qui pullulent dans certains troncs d’arbre pourrissants. » On boit l’eau des marais, et le maté « qui contient un alcaloïde analogue à ceux du café, du thé et du chocolat, mais dont le dosage explique peut-être la vertu apaisante en même temps que revigorante ». Pour aller chez les Nambikwara, l’expédition utilise des bœufs pour le transport du matériel ; ils ont chacun un nom : Piano, Chicolate, Taruma, Lavrado, Salino, Rochedo, Motor, etc., Lévi-Strauss égrène leurs 29 noms. Il aime les animaux : Lucinda, un petit singe femelle, s’est entichée de lui et s’accroche définitivement à sa botte gauche lors de son expédition chez les Tupi-Kawahib ; il la ramènera en France.
Le but, c’est de rencontrer des tribus sauvages : « Dans quel ordre décrire ces impressions profondes et confuses qui assaillent le nouvel arrivant dans un village dont la civilisation est restée relativement intacte ? » Ces tribus ont pour nom Caduvéo, Bororo, Nambikwara, Mundé, Tupi-Kawahib, et elles sont dans cet ordre d’éloignement, du sud du Brésil jusqu’aux confins de l’Amazonie. Il ne s’agit pas de faire de l’ « ethnologie du dimanche ». A 500 km de Sao Paulo, au fleuve Parana, il y a déjà des Indiens, mais « à ma grande déception, les Indiens du Tibagy n’étaient donc, ni complètement des vrais indiens ni, surtout, des sauvages ». Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Lévi-Strauss croise pas mal d’Indiens en chemin, mais ce sont des Indiens depuis longtemps en contact avec les immigrants européens.
Ces peuples fascinent Lévi-Strauss. « Adorable civilisation », dit-il en parlant des Caduvéo. Ce n’est pas un mot d’ethnologue mais le mot d’un homme qui s’incline devant ses frères. L’auteur déplore que les différences entre individus, entre cultures, au lieu de susciter le respect de l’autre suscitent des hiérarchies et des classements. Lévi-Strauss observe et analyse : « Chez les Bororo, je m’étais convaincu de l’exceptionnel degré de raffinement, sur le plan sociologique et religieux, de tribus considérées jadis comme dotées d’une culture très grossière. » Il voulait rencontrer « les premiers habitants du Brésil, qui auraient été soit oubliés au fond de leur brousse, soit refoulés peu de temps avant la découverte ». Il ne les trouvera pas : l’être humain forme toujours déjà une société avec ses règles. « Il manque l’empreinte de Vendredi ». Les groupes qu’il a rencontrés, divers par leur physique et leurs dialectes, résolvent de façon différente la question politique (chef, pas de chef) ou la question sexuelle (polygamie, famille nucléaire, homosexualité). L’homme est partout divers. Il n’y a pas de premier homme, pas d’enfance de l’humanité. C’est comme le Big-Bang, mon cher Hervé, il recule sans cesse, il y a certainement quelque chose avant.
Tristes Tropiques, ce ne sont pas uniquement les aventures d’Indiana Jones. L’auteur se livre évidemment à quelques savantes analyses structuralistes sur les sociétés indiennes. Les motifs de décoration obéissent à « un dualisme qui se projette sur des plans successifs comme dans un salon de miroirs : hommes et femmes, peinture et sculpture, représentation et abstraction, angle et courbe, géométrie et arabesque, col et panse, symétrie et asymétrie, ligne et surface bordure et motif, pièce et champ, figure et fond. » La disposition des cases d’un village ne se fait pas au hasard mais correspond aux relations de parenté. Il y a la description minutieuse des lois du mariage entre membres des tribus, ou celle des rapports complexes entre morts et vivants. Il y a des croquis explicatifs. Il y a la reproduction à la main des motifs qui illustrent les murs des cases, ou celle des divers empennages des flèches, ou celle des décorations sur cuir ou sur poteries. Il y a la description précise de telle ou telle préparation culinaire. On voit comment sont construites les cases, rondes ou carrées, avec toit en pente ou sans pente, avec cloison fixe ou mobile. Il n’y a pas grand-chose à décrire au point de vue vestimentaire. Les indiens sont le plus souvent nus, avec parfois un pagne, ou une sorte de châle sur les épaules. Sauf l’étui pénien pour les mâles, dont Lévi-Strauss décrit en détail la confection : « Les deux côtés d’une feuille fraîche de bananier furent arrachés de la nervure centrale et débarrassés du rebord extérieur coriace, puis pliés en deux dans le sens de la longueur. En imbriquant les deux pièces (d’environ sept centimètres sur trente centimètres) l’une dans l’autre, de façon que les pliures se rejoignent à angle droit, on obtient une sorte d’équerre faite de deux épaisseurs de feuille pour les côtés, et de quatre au sommet où les deux bandes s’entrecroisent ; cette partie est alors rabattue sur elle-même selon sa diagonale et les deux bras coupés et jetés, si bien que l’ouvrier n’a plus entre ses mains qu’un petit triangle isocèle formé de huit épaisseurs ; celui-ci est arrondi autour du pouce, d’avant en arrière, les sommets des deux angles inférieurs sont sectionnés et les bords latéraux cousus à l’aide d’une aiguille de bois et de fil végétal. » J’ai l’impression que l’auteur s’amuse avec le lecteur ! En tout cas, la sexualité ne semble pas plus naturelle là-bas qu’ici.
Tristes Tropiques, c’est un fourre-tout. L’auteur y raconte comment, démobilisé après l’armistice de 1940, révoqué de l’Education nationale parce qu’il est juif, il a décidé de quitter la France, avec la grosse malle où il a gardé les notes qui vont lui servir à écrire sa thèse et, un jour, Tristes Tropiques ; c’est son seul bagage, qui éveille partout la méfiance. Lévi-Strauss nous fait réfléchir : « Un voyage s’inscrit simultanément dans l’espace, dans le temps et dans la hiérarchie sociale.» En changeant de pays, nous changeons d’année : certaines régions sont le passé des nôtres, ou leur avenir. Pauvres ici, nous sommes riches et donc puissants là-bas, ce qui rend impossibles « la bonne foi, le sens du contrat, la capacité de s’obliger. » Lévi-Strauss a déjà la claire conscience du prix que notre civilisation fait payer aux autres cultures : « L’ordre et l’harmonie de l’Occident exigent l’élimination d’une masse prodigieuse de sous-produits maléfiques dont la terre est aujourd’hui infectée. Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité. »
Lévi-Strauss perçoit que l’unification, la mondialisation, sont en marche. C’est une tendance profonde. Les différences entre populations ne sont que l’effet d’un retard qui sera bientôt comblé : « Quand il était encore jeune, le plus Ancien monde esquissait déjà le visage du Nouveau. Je me méfie donc des contrastes superficiels et du pittoresque apparent ; ils tiennent parole trop peu de temps. Ce que nous nommons exotisme traduit une inégalité de rythme, significative pendant le laps de quelques siècles. » La vie urbaine semble notre destin depuis déjà Babylone et Athènes.
Les indiens vivent en se pliant à leur environnement : nous voulons transformer le nôtre et dépasser les limites naturelles. Lévi-Strauss s’interroge : « Quelles usures, quelles irritations inutiles ne nous épargnerions-nous pas si nous acceptions de reconnaître les conditions réelles de notre expérience humaine ? » Se plier aux limites ou les dépasser ? Vaincre la nature ou s’y soumettre ? Vaste question.
Il y a des réflexions passionnantes sur Rousseau (j’aimerais relire Les Confessions, mais c’est si long !) et des remarques étonnamment actuelles sur l’Islam, une religion qui ne se laisse pas faire. Il y a un éloge de la montagne « à vaches », qu’on parcourt à pied, sans équipement. Je retiens les réflexions de l’auteur sur l’écriture. Dans cette technique géniale qui a permis à la science de grandir en se sédimentant, l’auteur voit la matrice du pouvoir absolu : « Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l’asservissement. L’emploi de l’écriture à des fins désintéressées, en vue de tirer des satisfactions intellectuelles et esthétiques, est un résultat secondaire, si même il ne se réduit pas le plus souvent à un moyen pour renforcer, justifier ou dissimuler l’autre. » Et j’ai relevé, cher Hervé, cette notation qui me rend un peu triste : les Nambikwara n’ont qu’un mot pour dire joli et jeune, et un autre pour dire laid et vieux.
En fouillant sur YouTube, je suis tombé sur une interview de Lévi-Strauss par Pivot. Lévi-Strauss explique qu’il a commencé à rédiger en 1939, après ses aventures amazoniennes, un roman, intitulé Tristes Tropiques. Il a vite compris qu’il n’avait pas assez d’imagination pour être romancier. Il a abandonné. Quinze ans plus tard, sur un coup de colère, il écrit en 4 mois un livre protéiforme et lui donne le titre pressenti pour sa tentative romanesque avortée. C’est avec lui que j’ai fait au mois d’août, chez moi, tous les matins, un grand voyage dans l’espace et dans le temps, sans moustiques ni boa. C’est le miracle de la littérature.
P.-S. :
1) Après ce livre, Claude Lévi-Strauss a encore beaucoup voyagé ! On ne se refait pas.
2) Appâté, j’ai commencé à lire une biographie de Claude Lévi-Strauss : Emmanuelle Loyer, Lévi-Strauss, Flammarion, 2015. Passionnant.

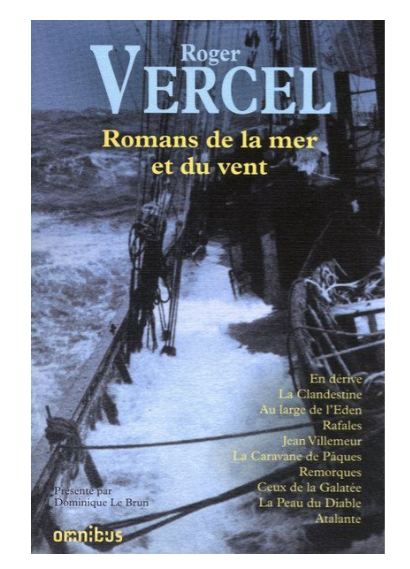
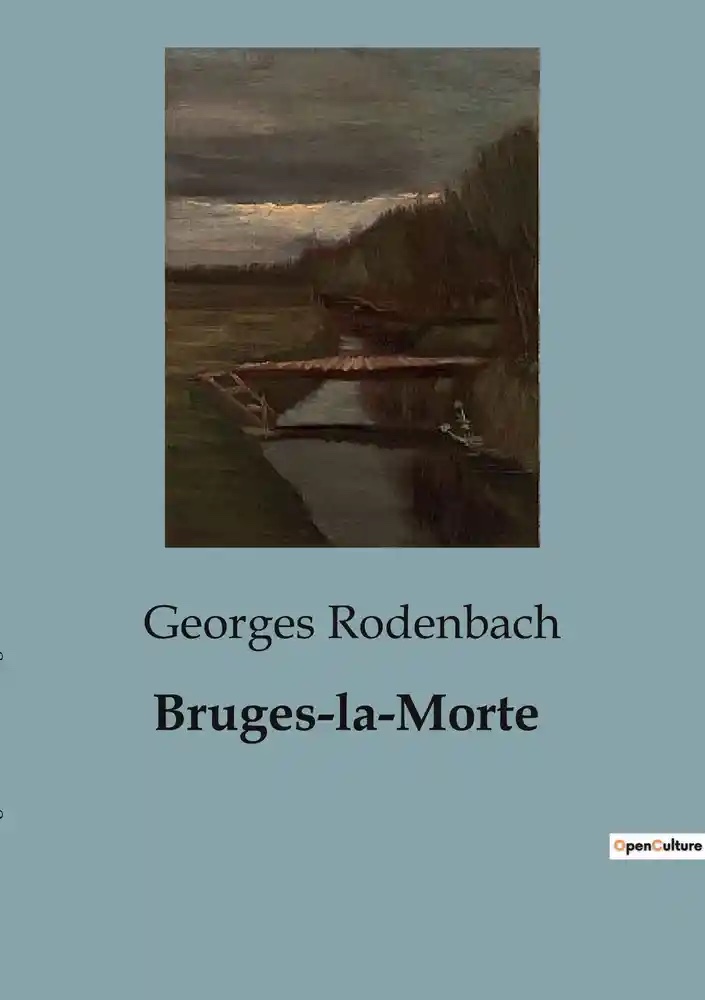
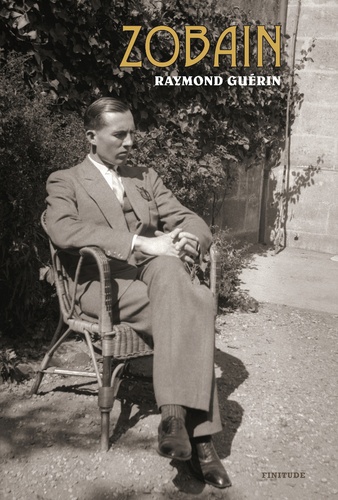
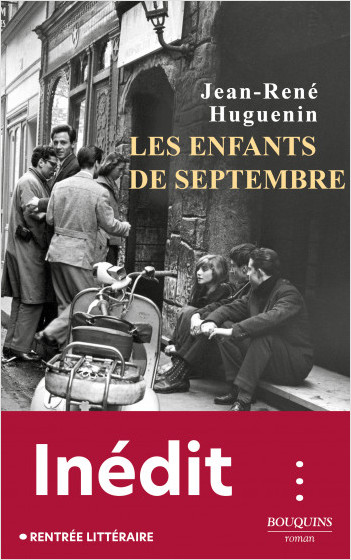
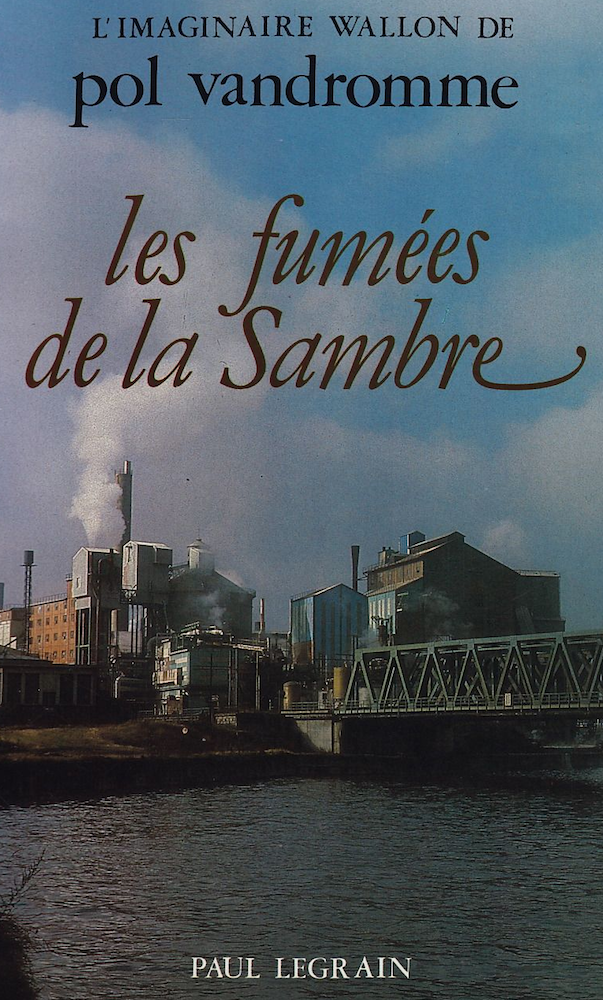
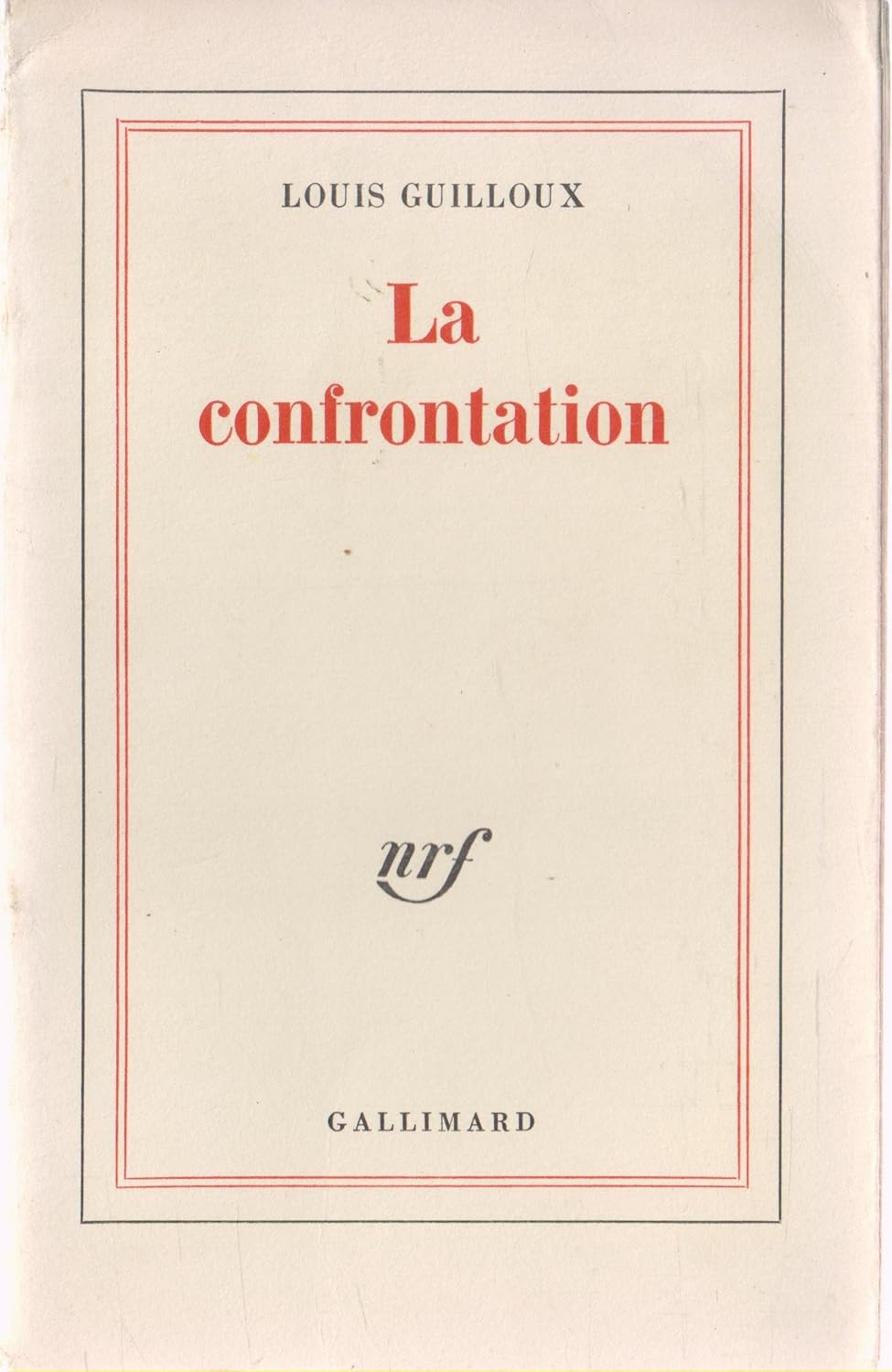
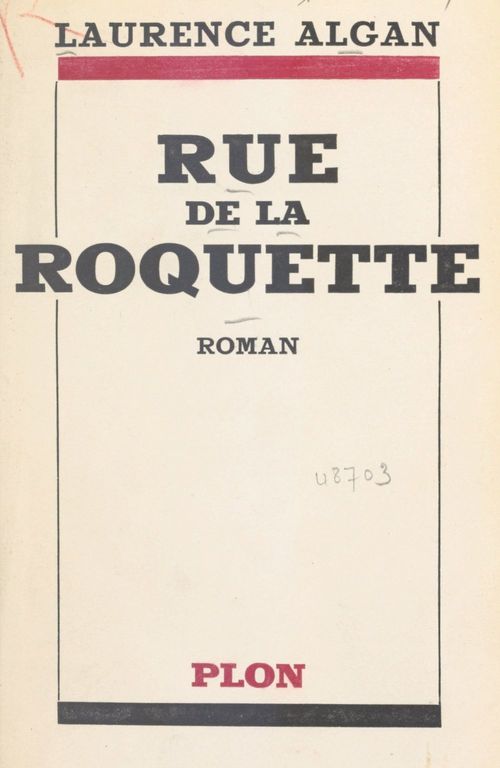
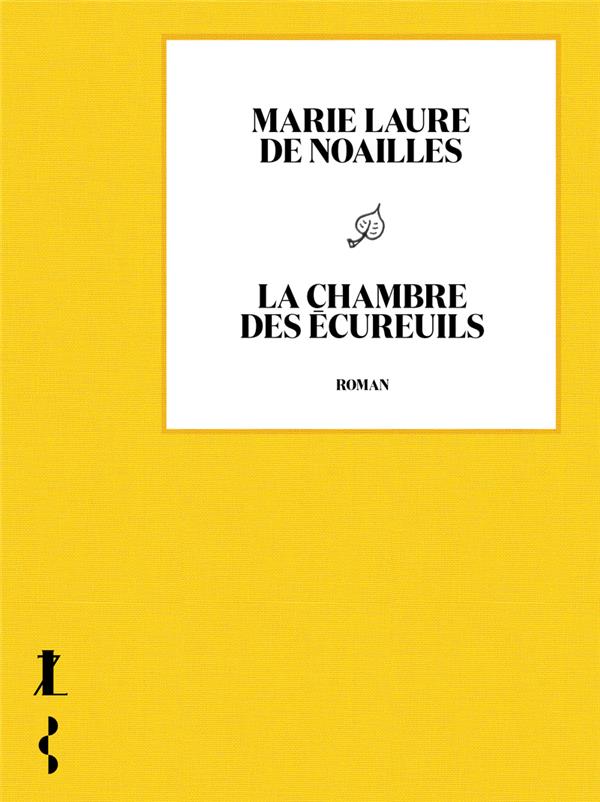
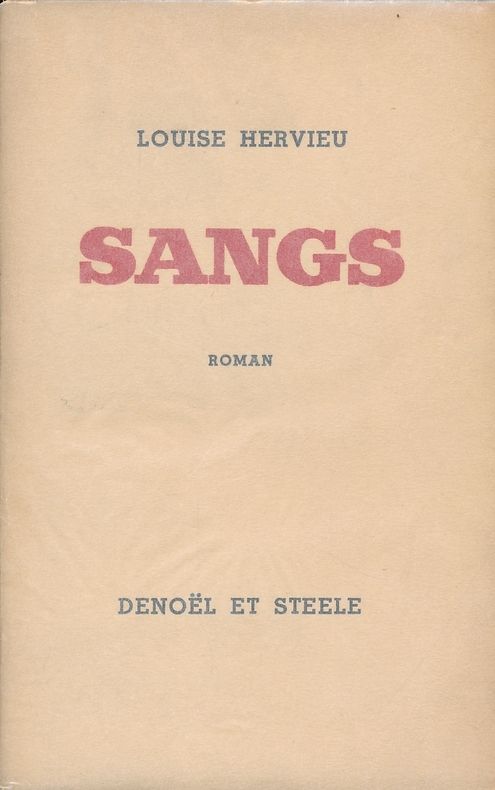
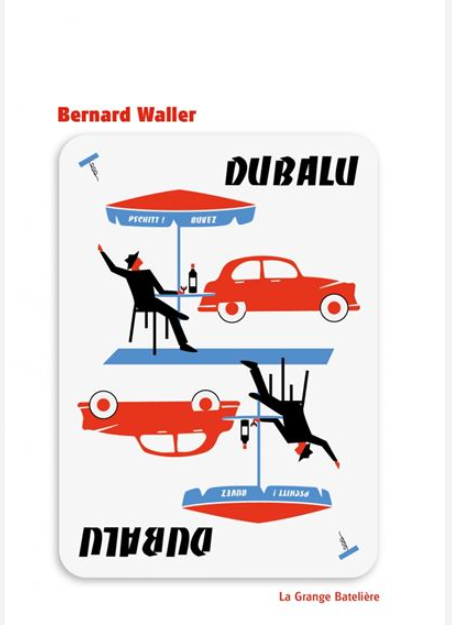
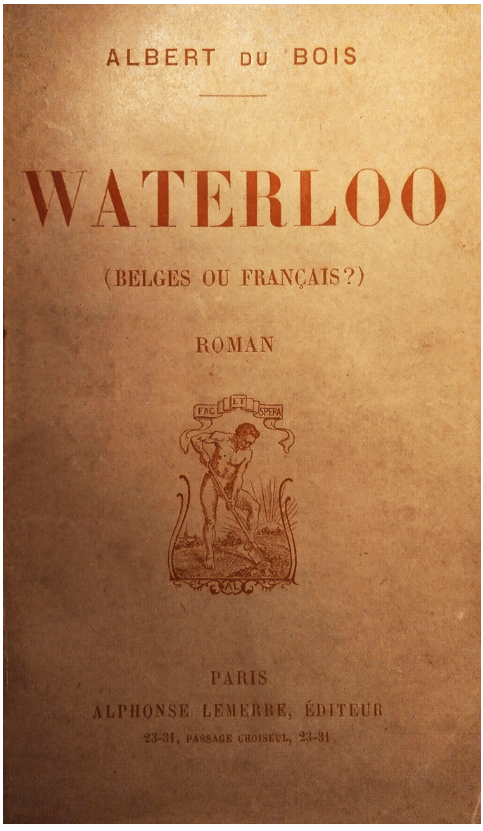
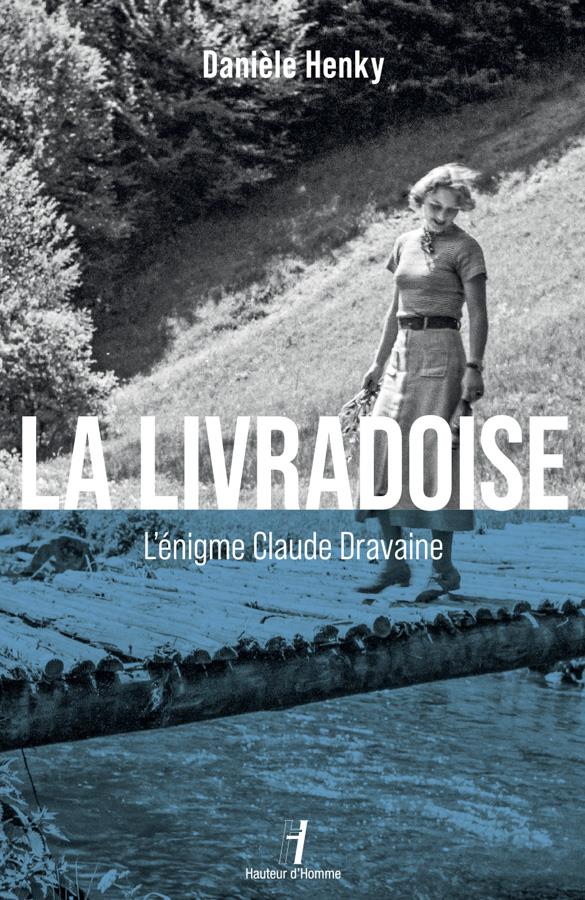
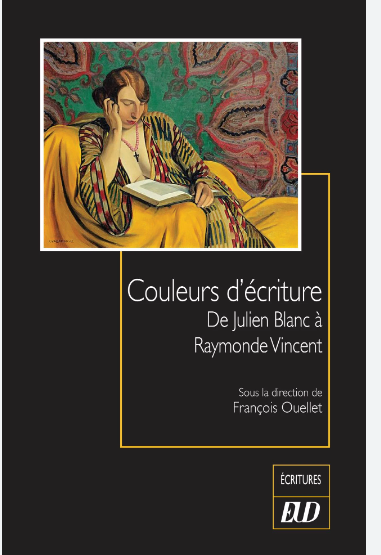
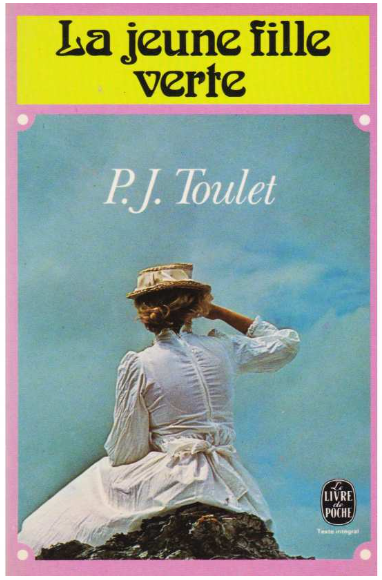
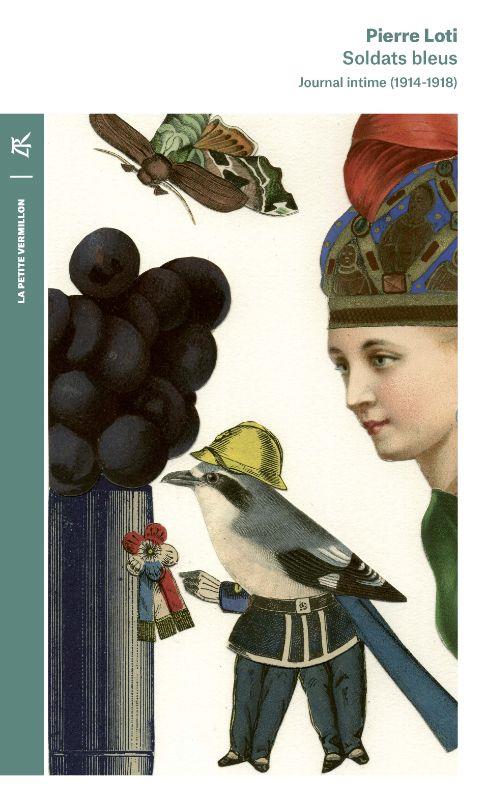
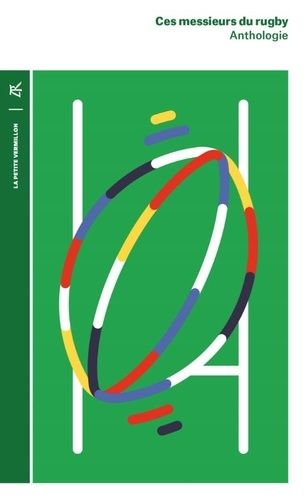
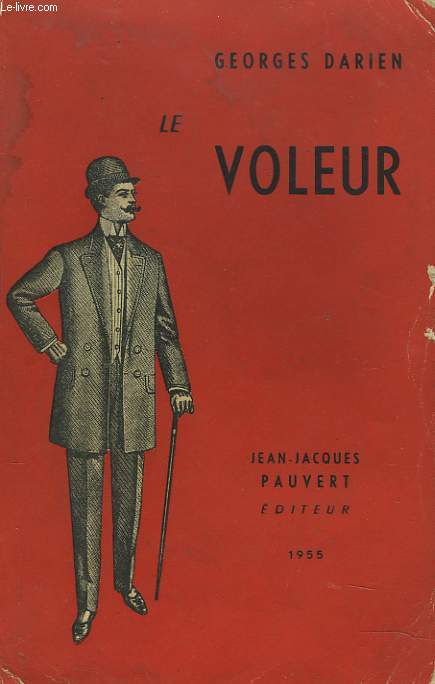
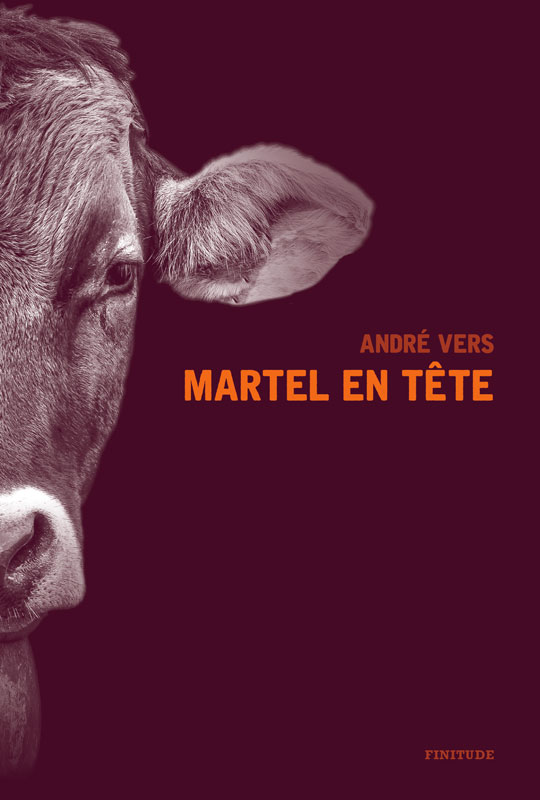

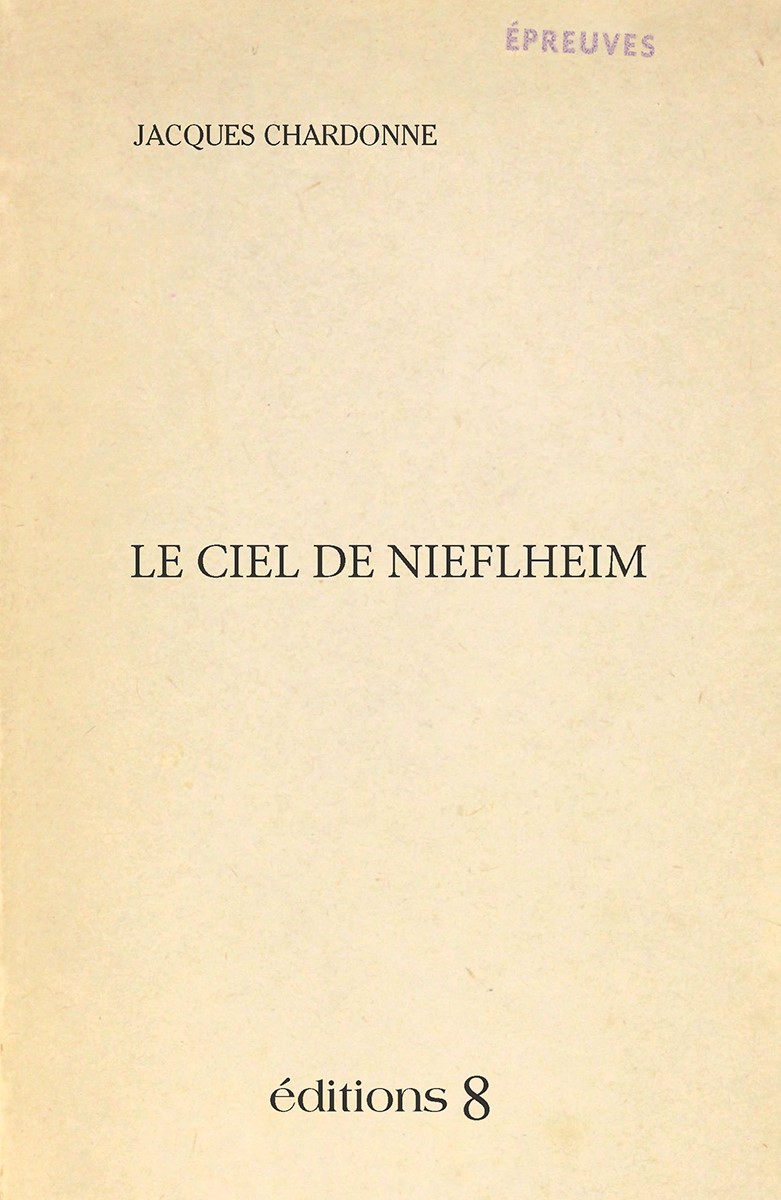
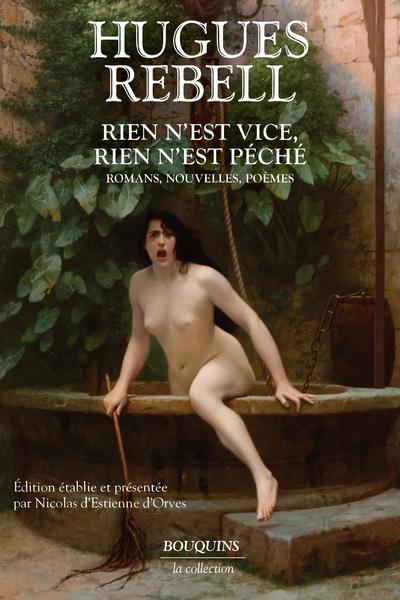
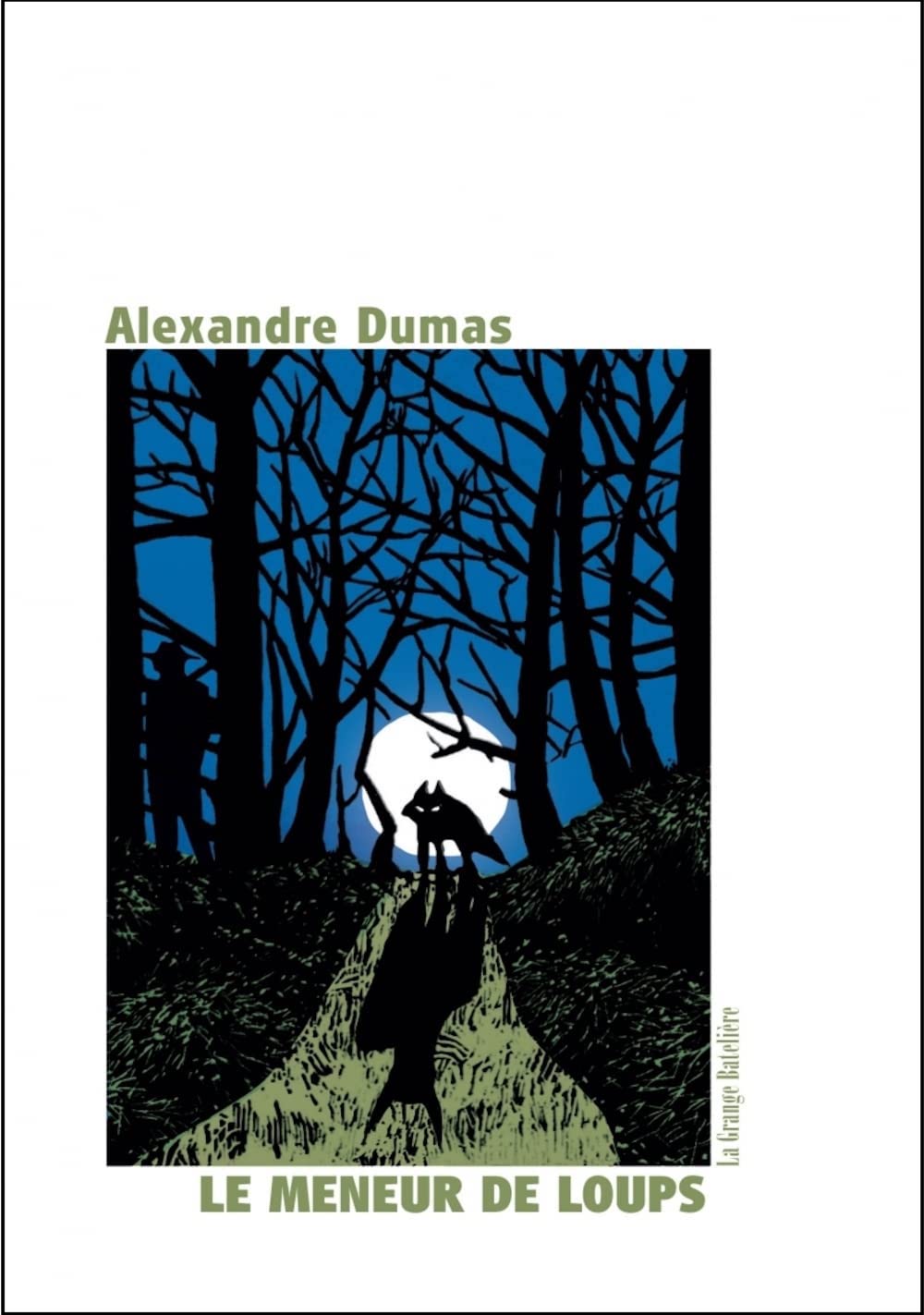
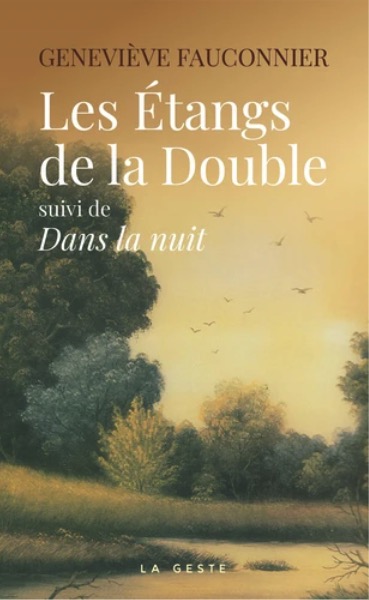
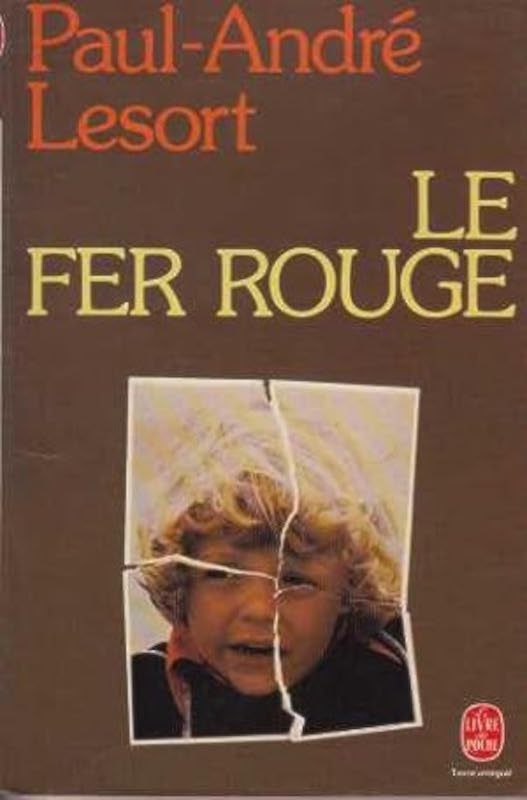

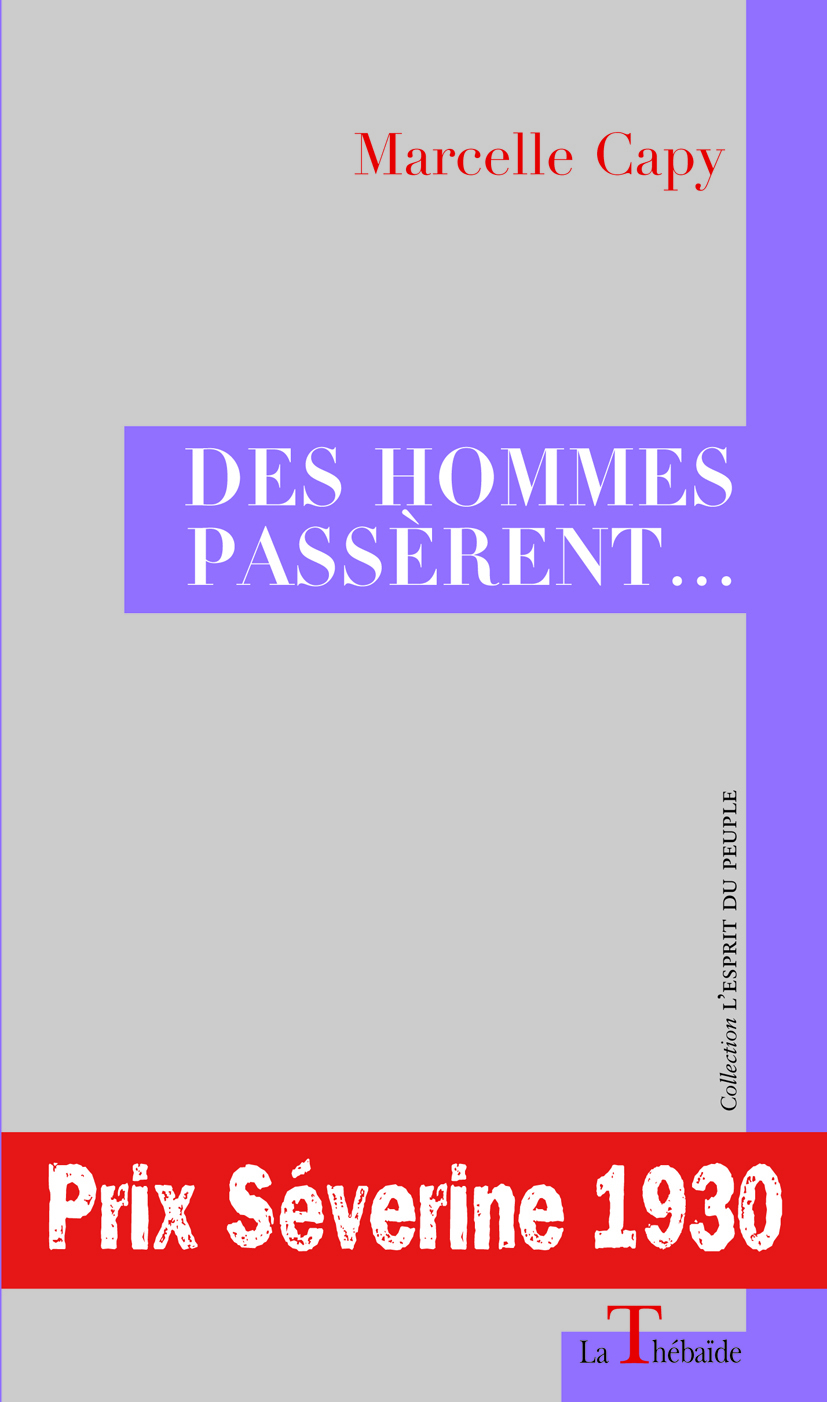
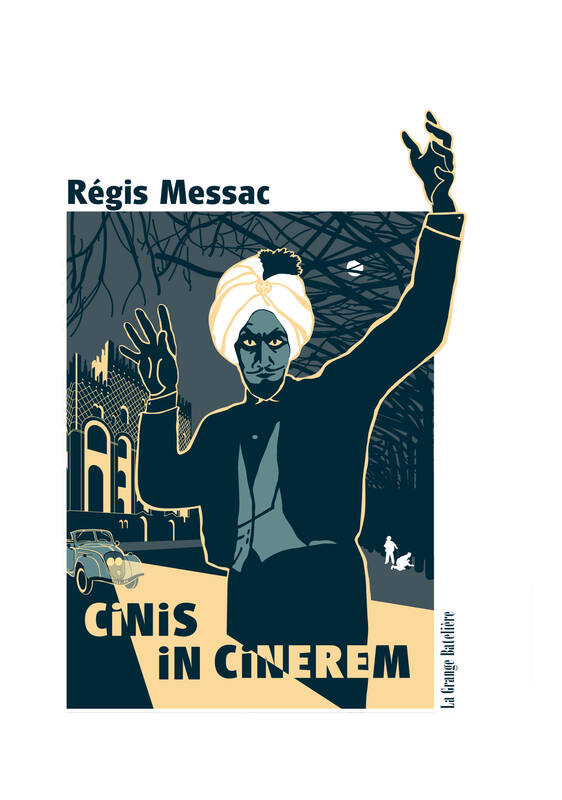
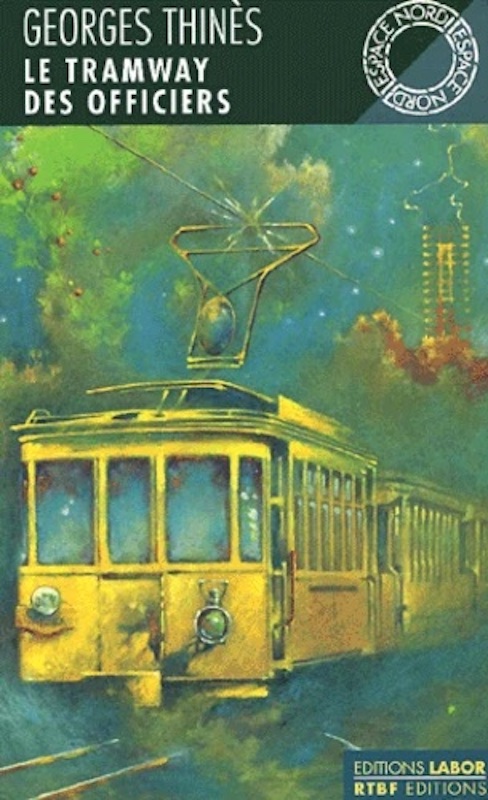
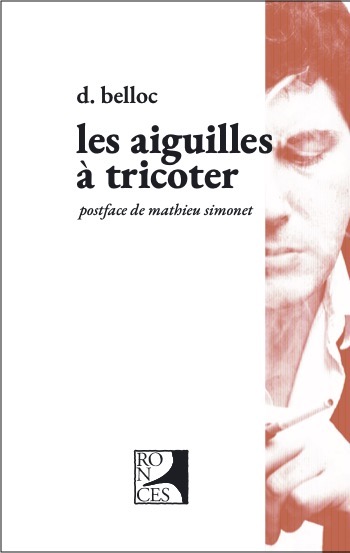
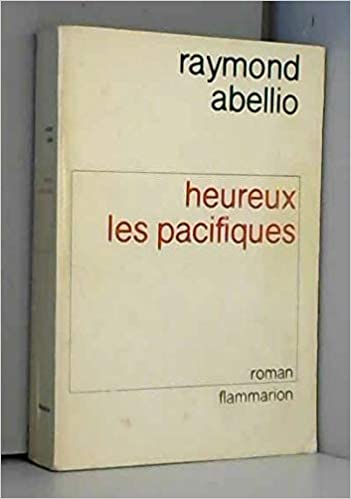
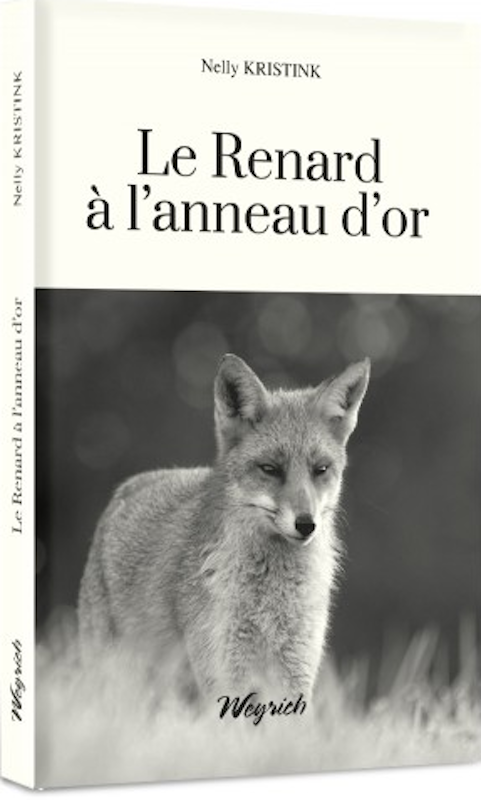
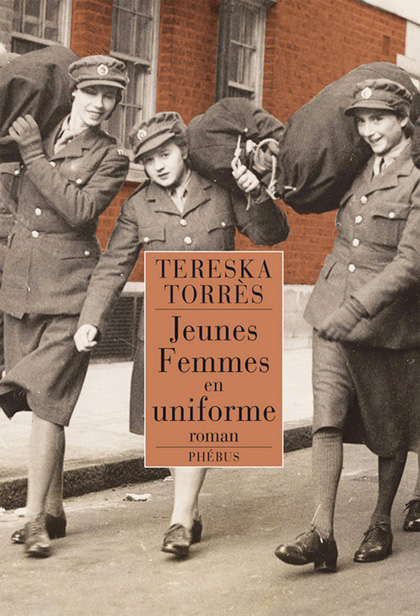
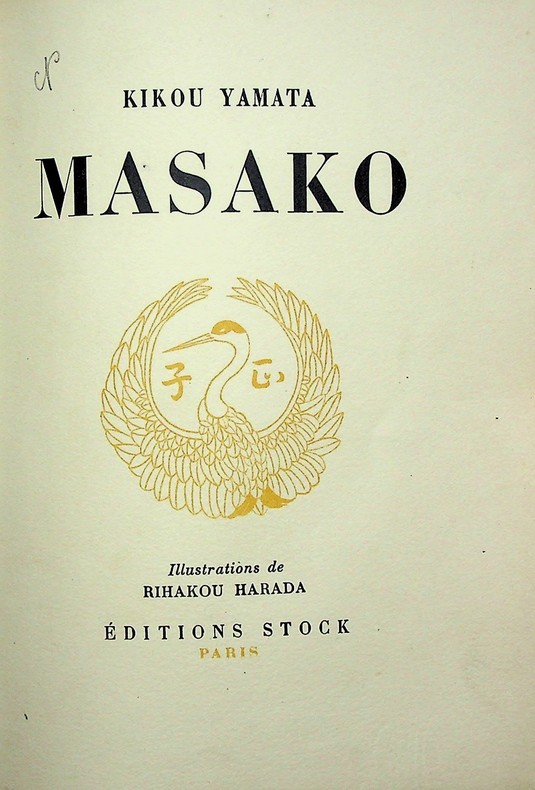
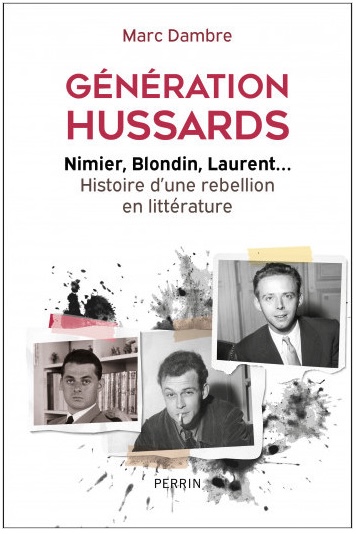
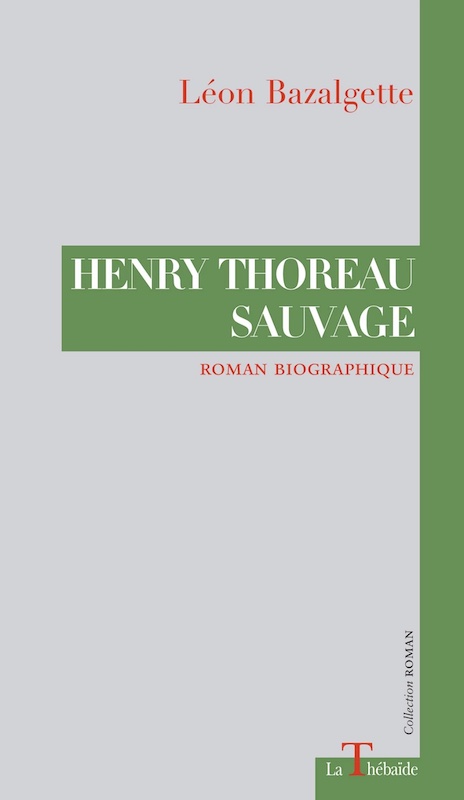
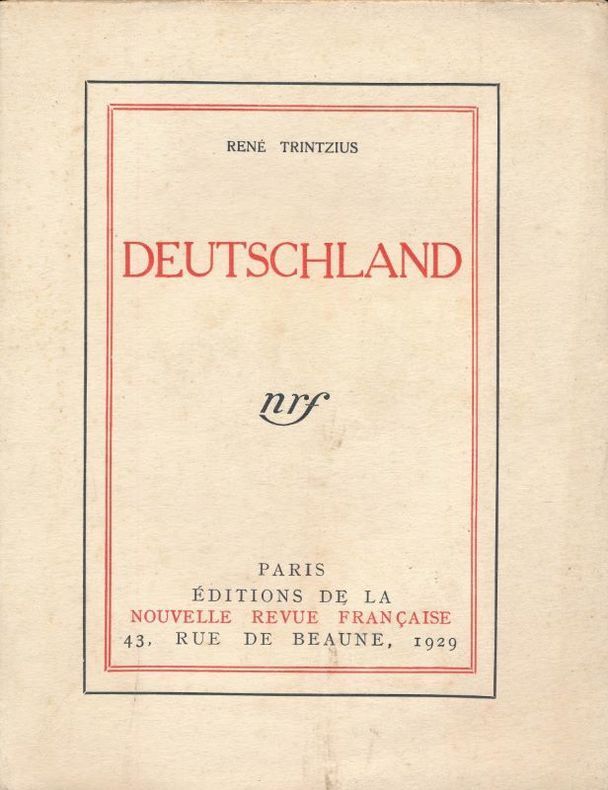
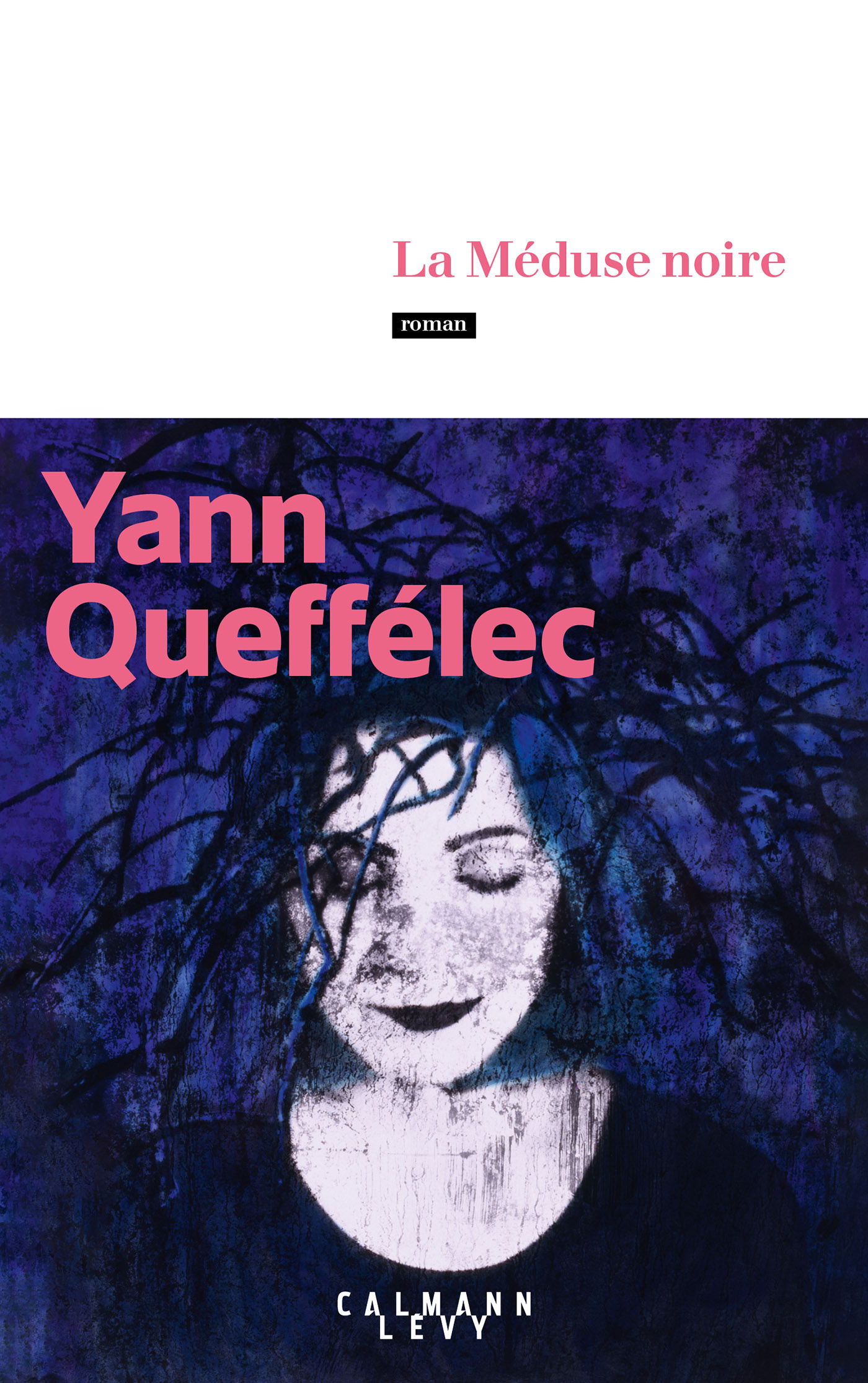
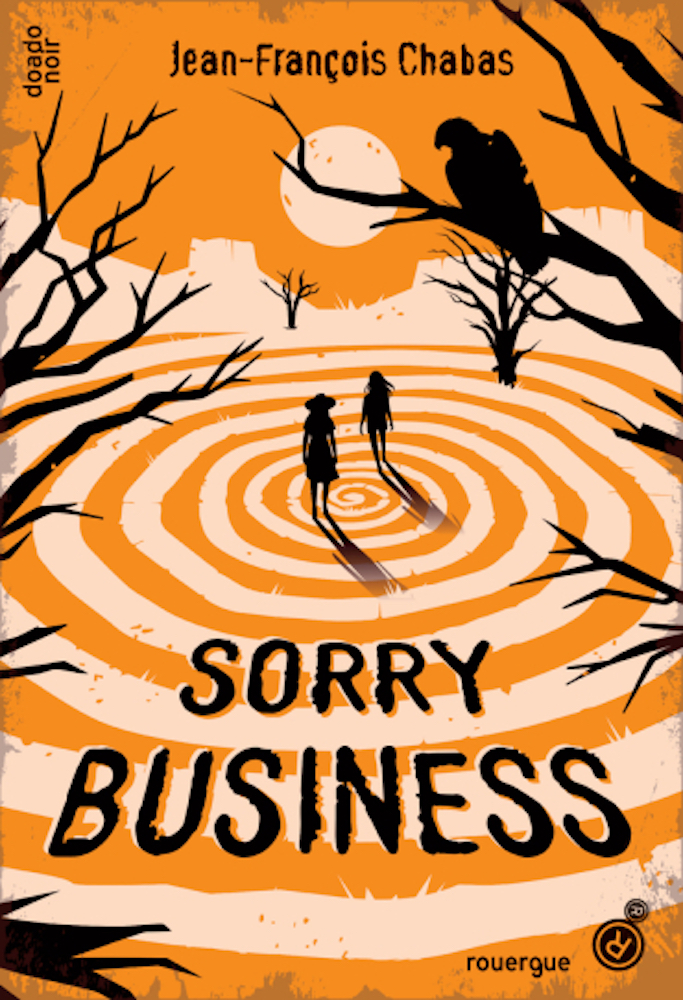
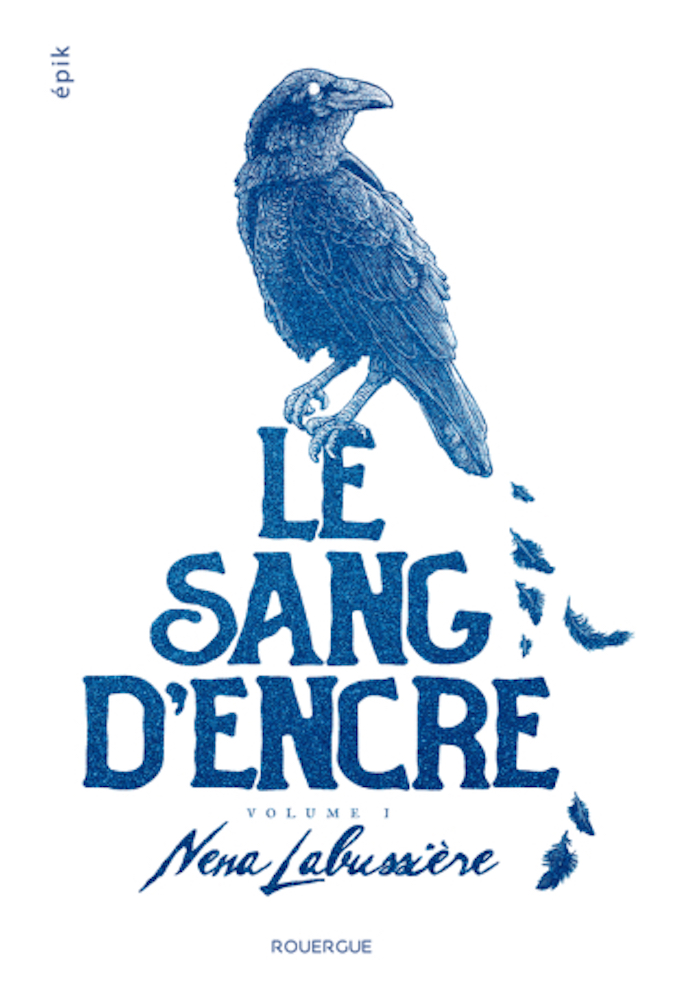
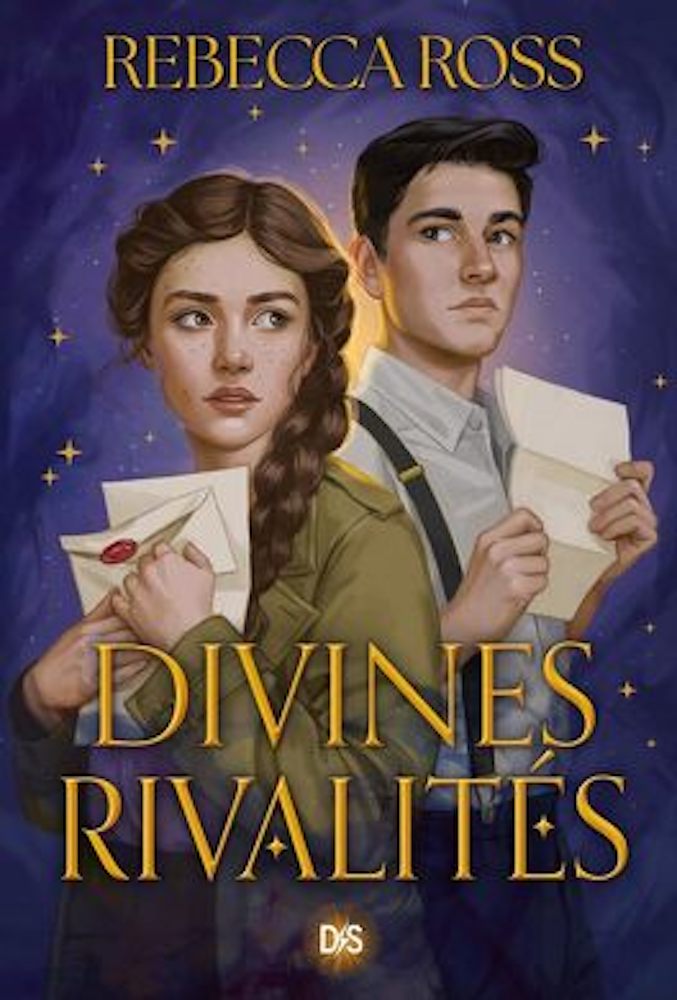
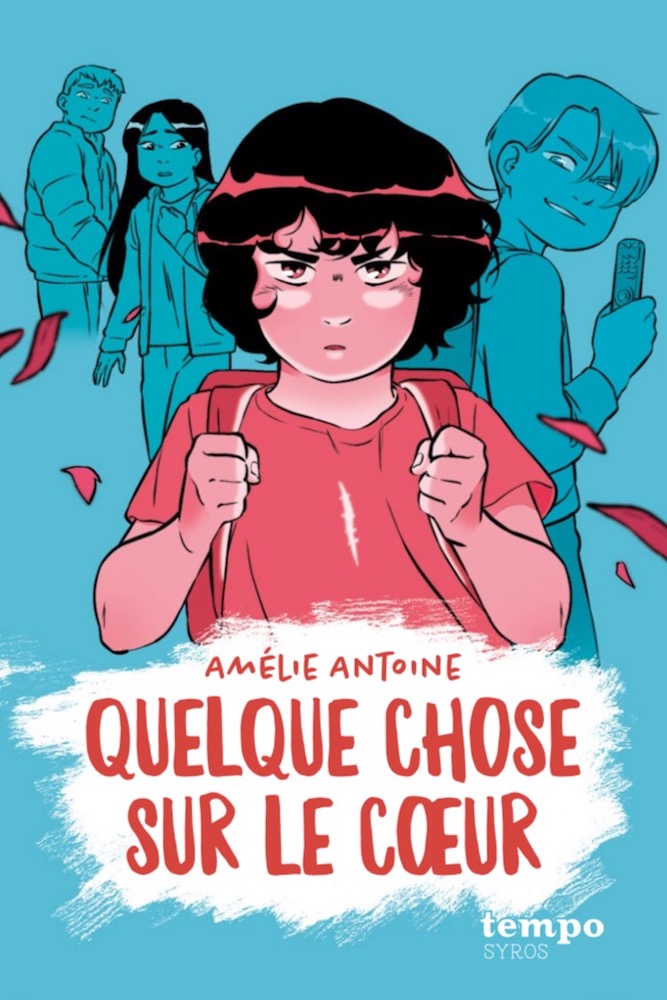

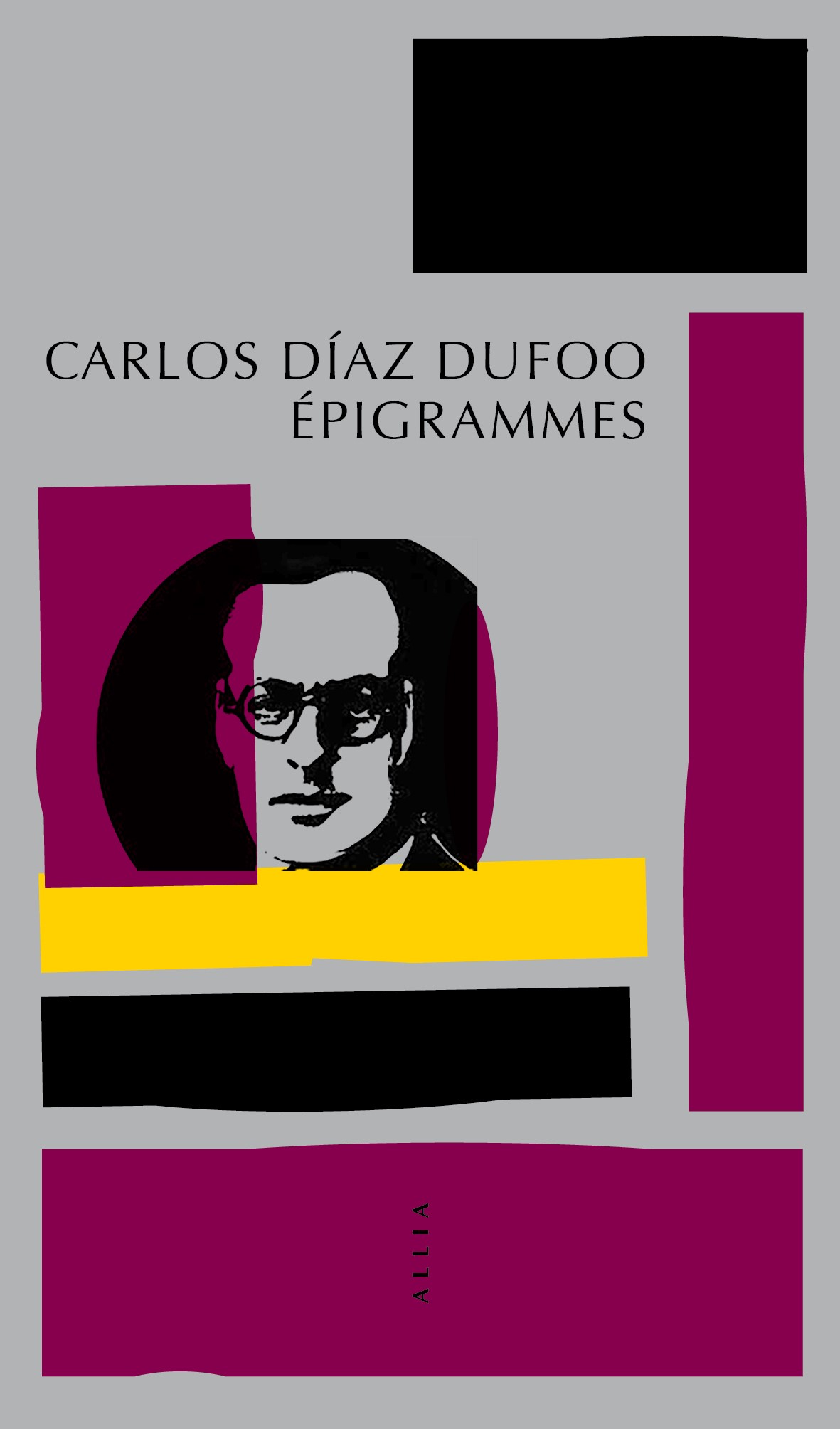
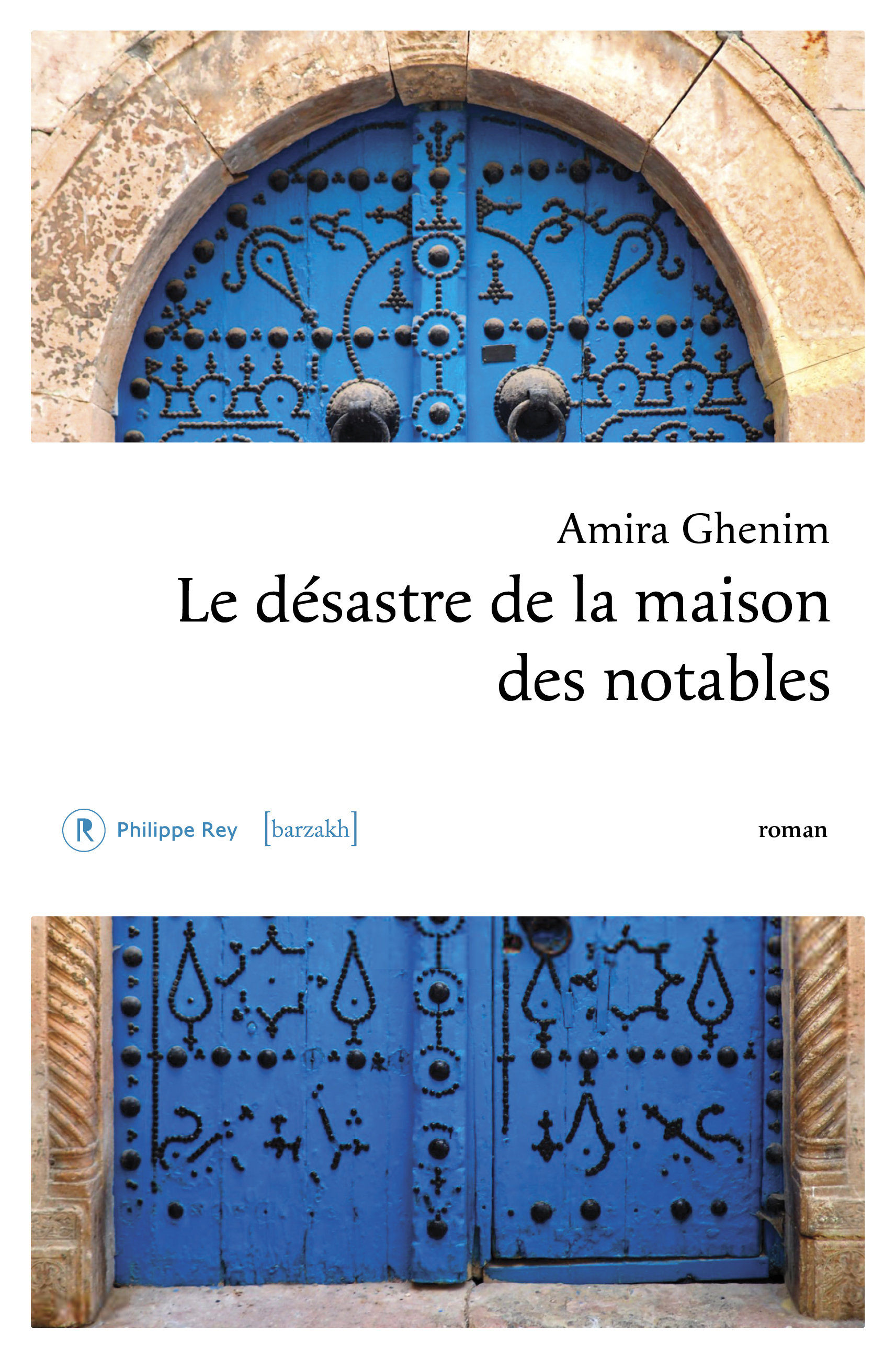
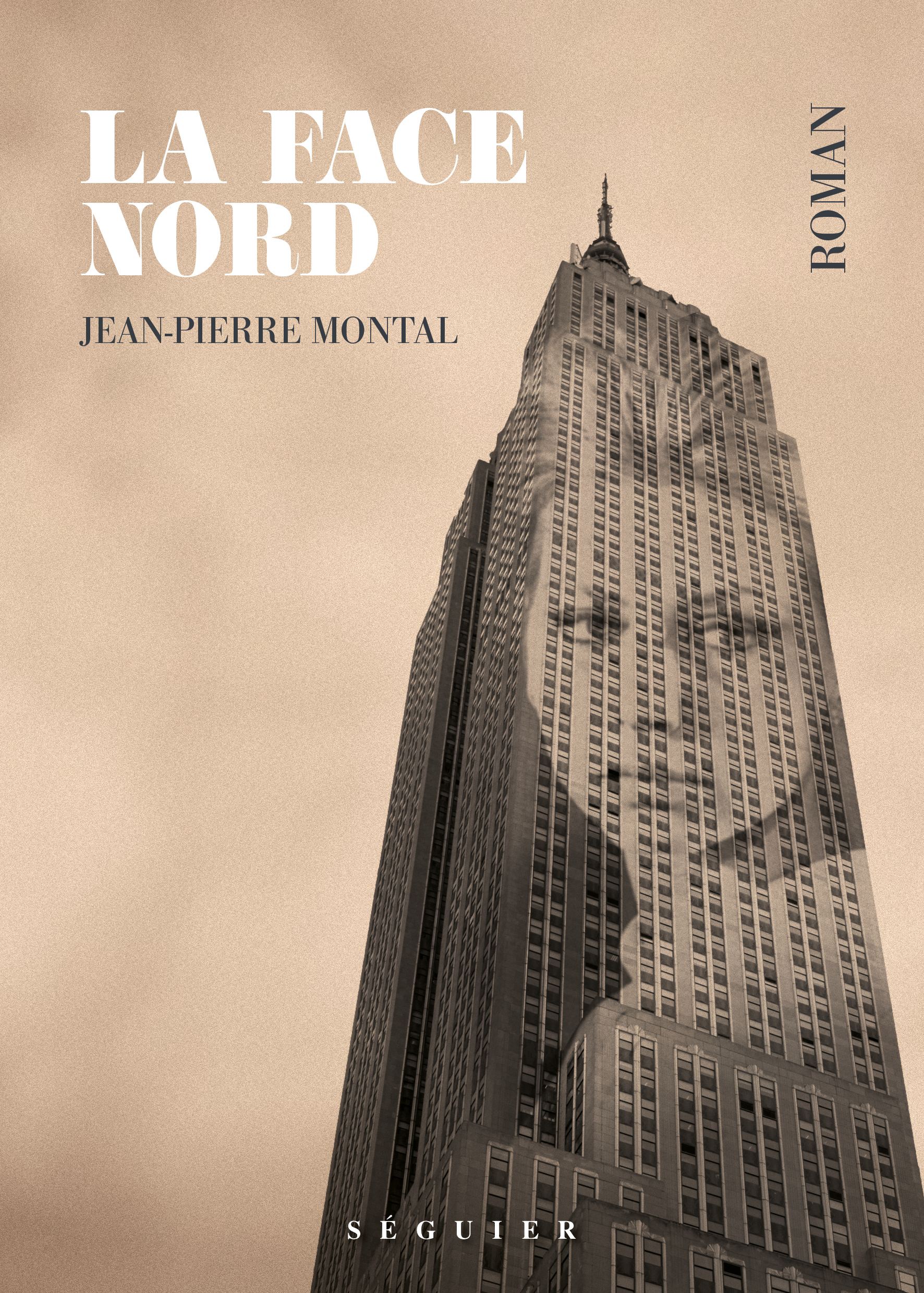
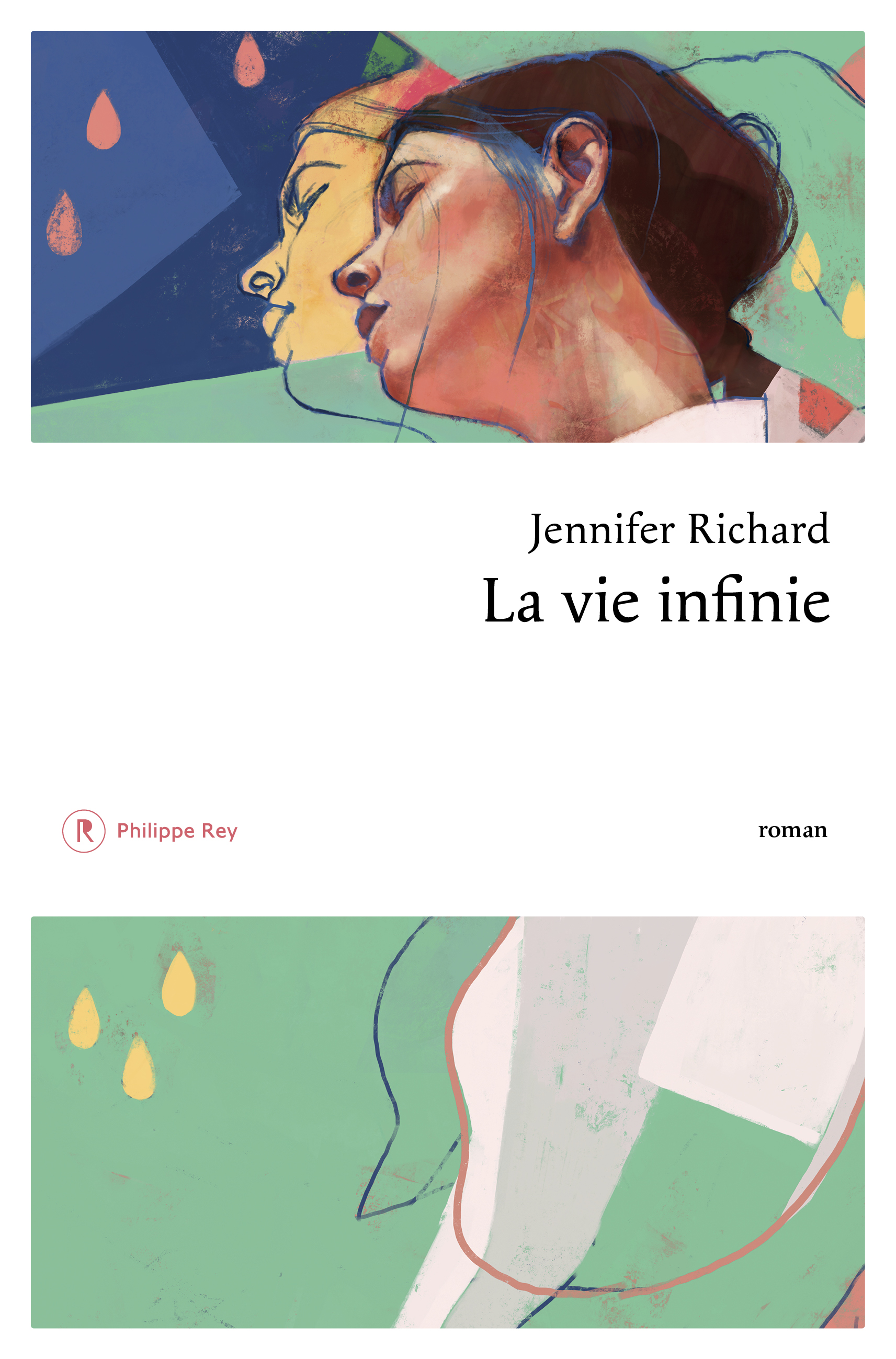
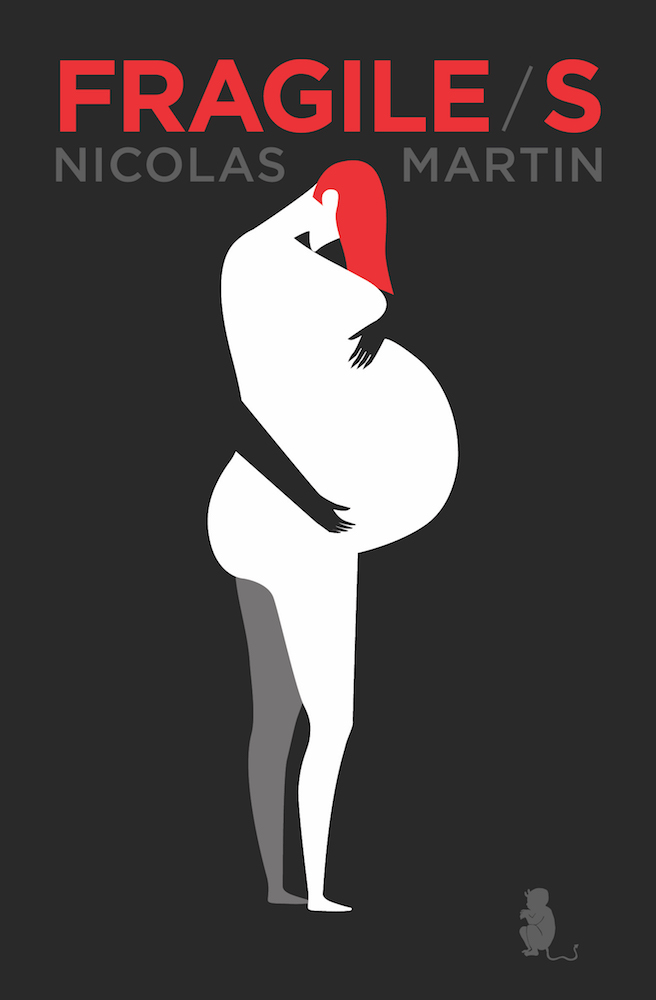

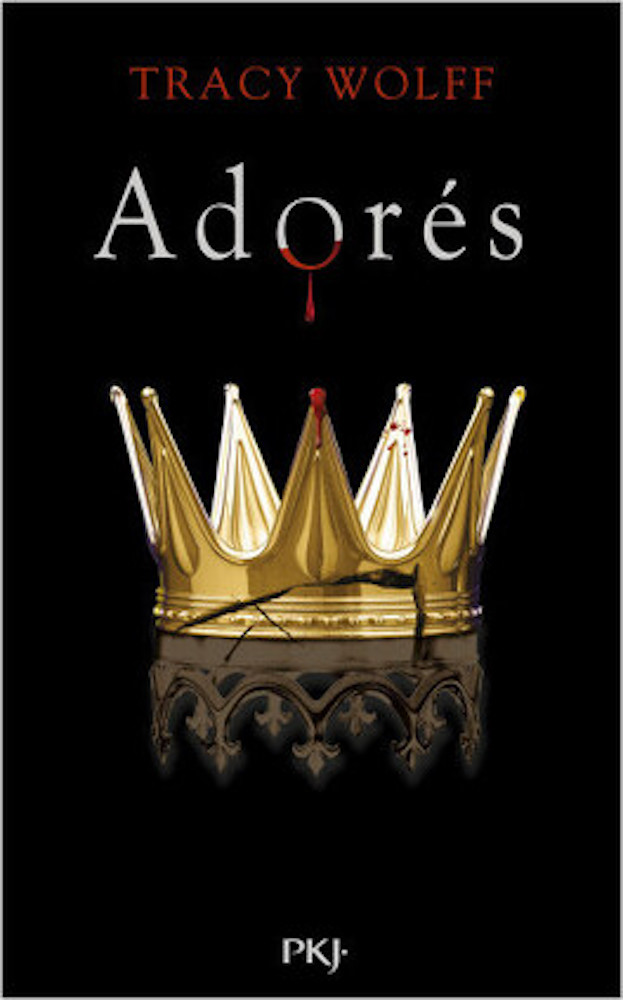
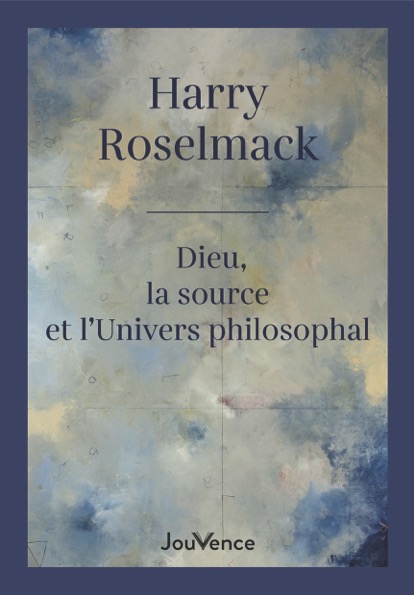
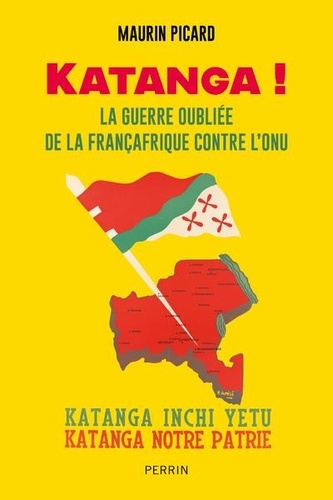
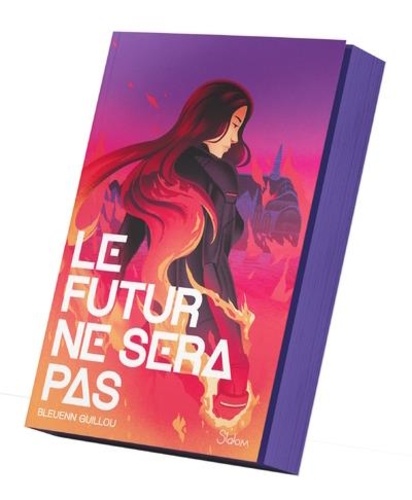
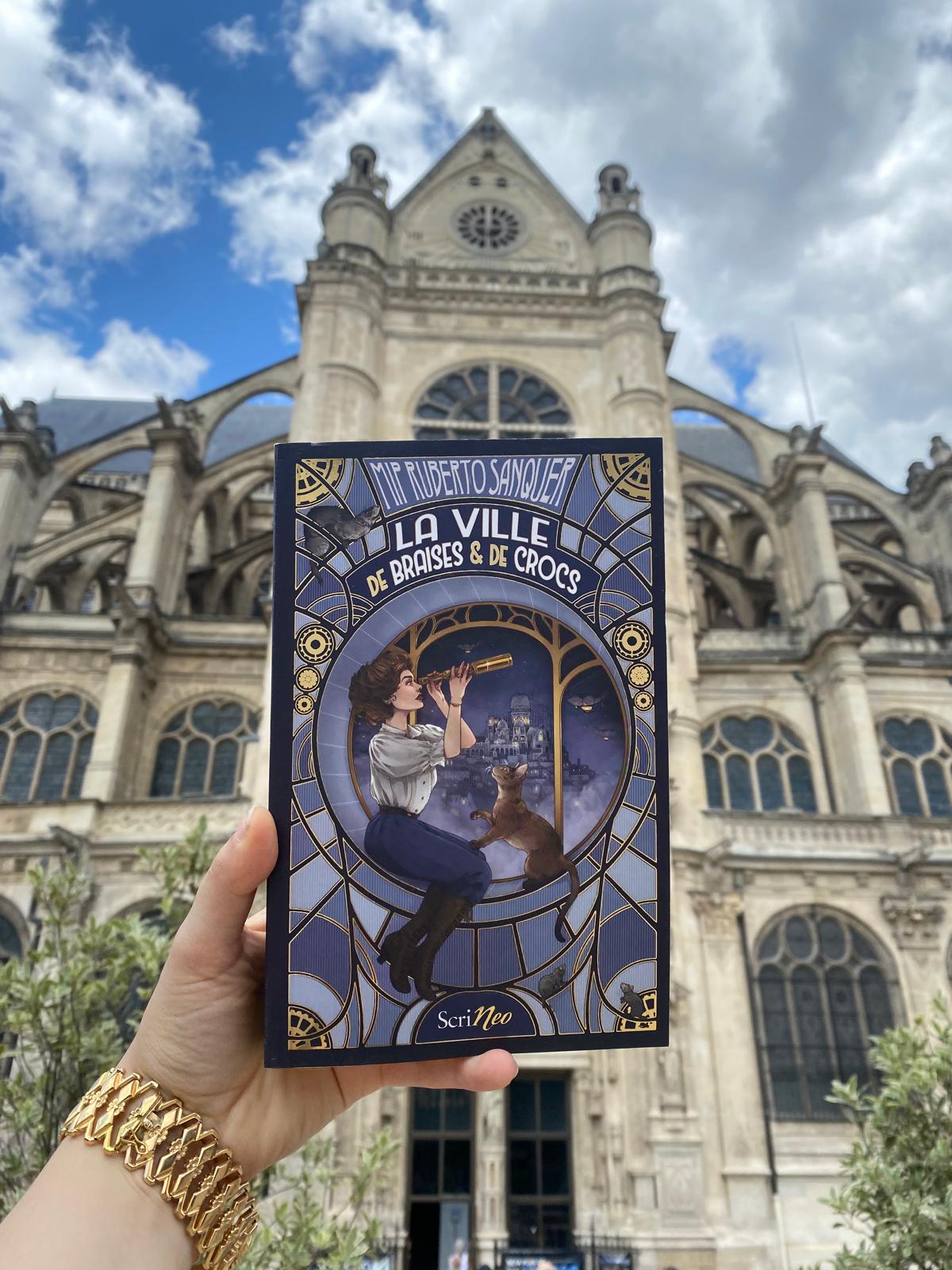
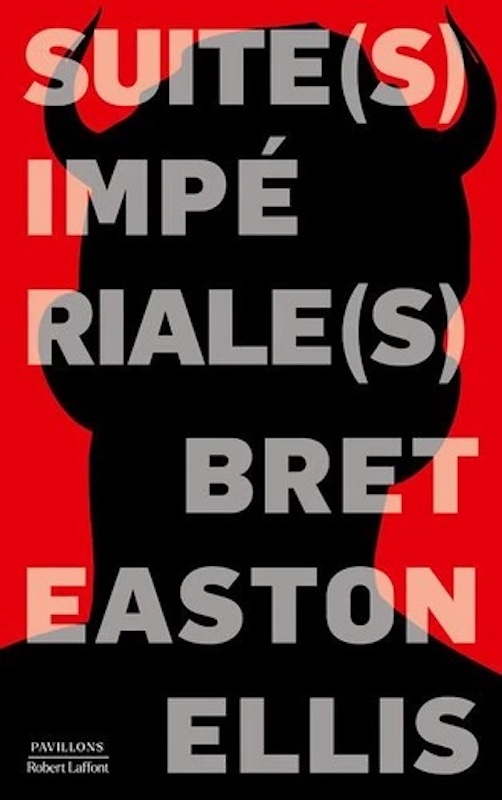


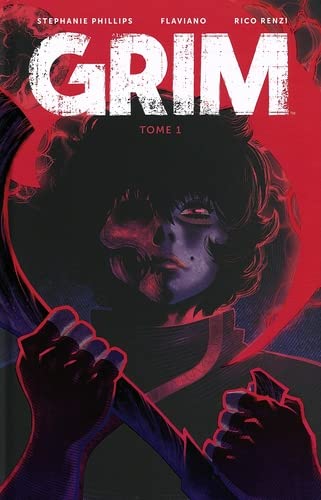
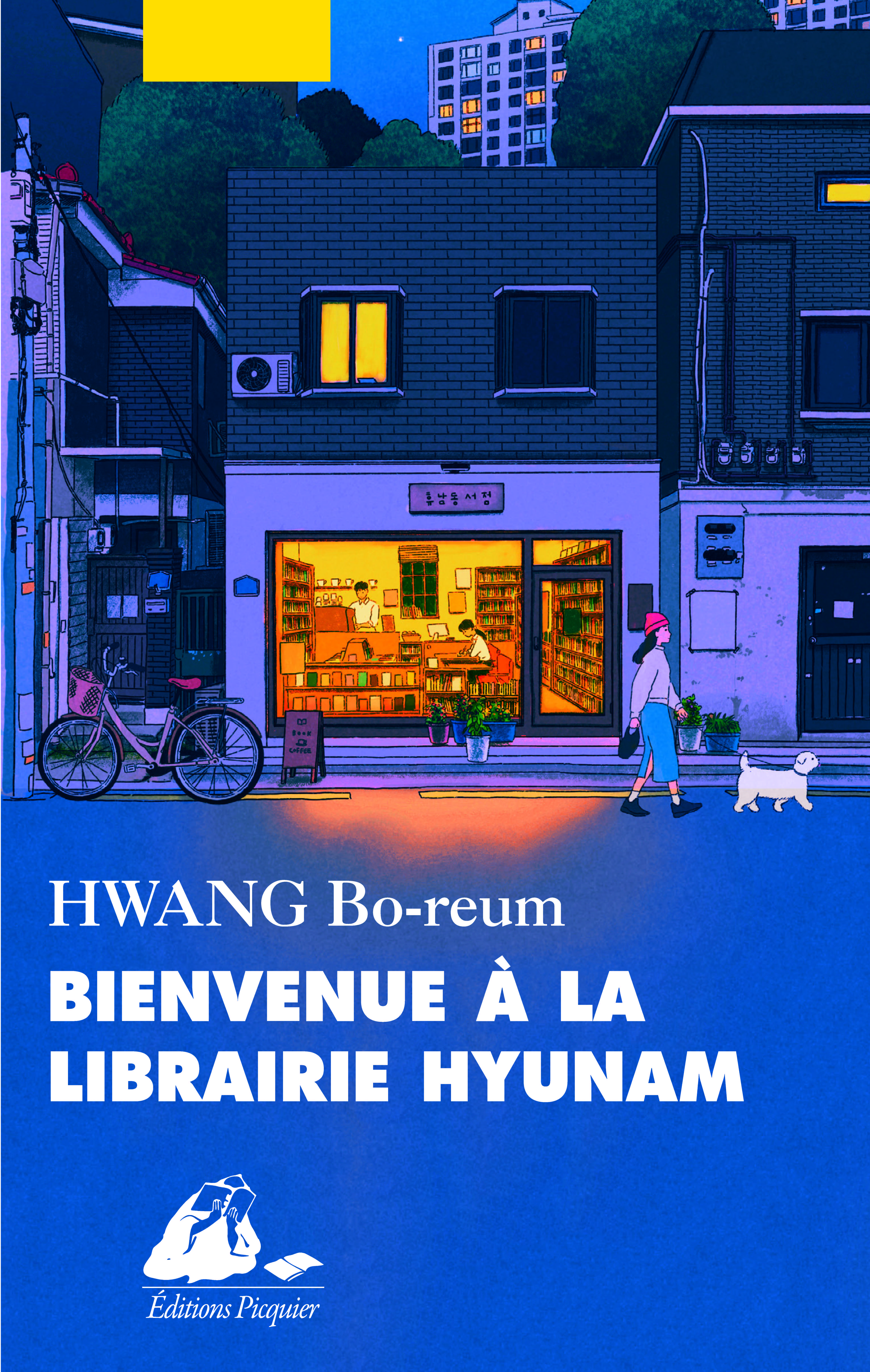
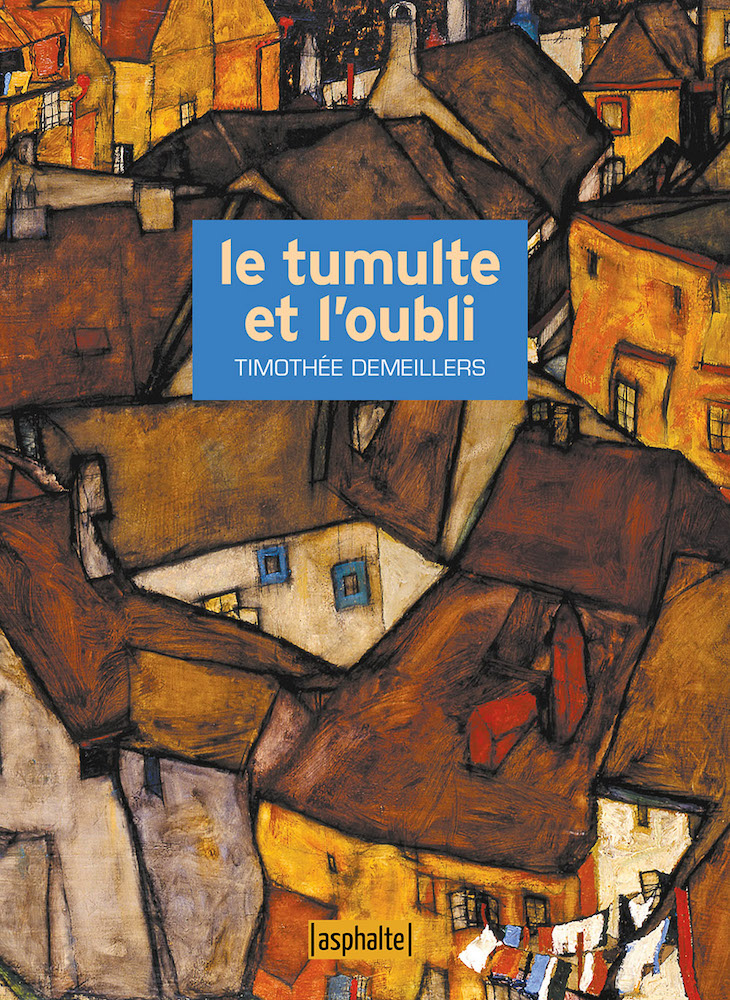
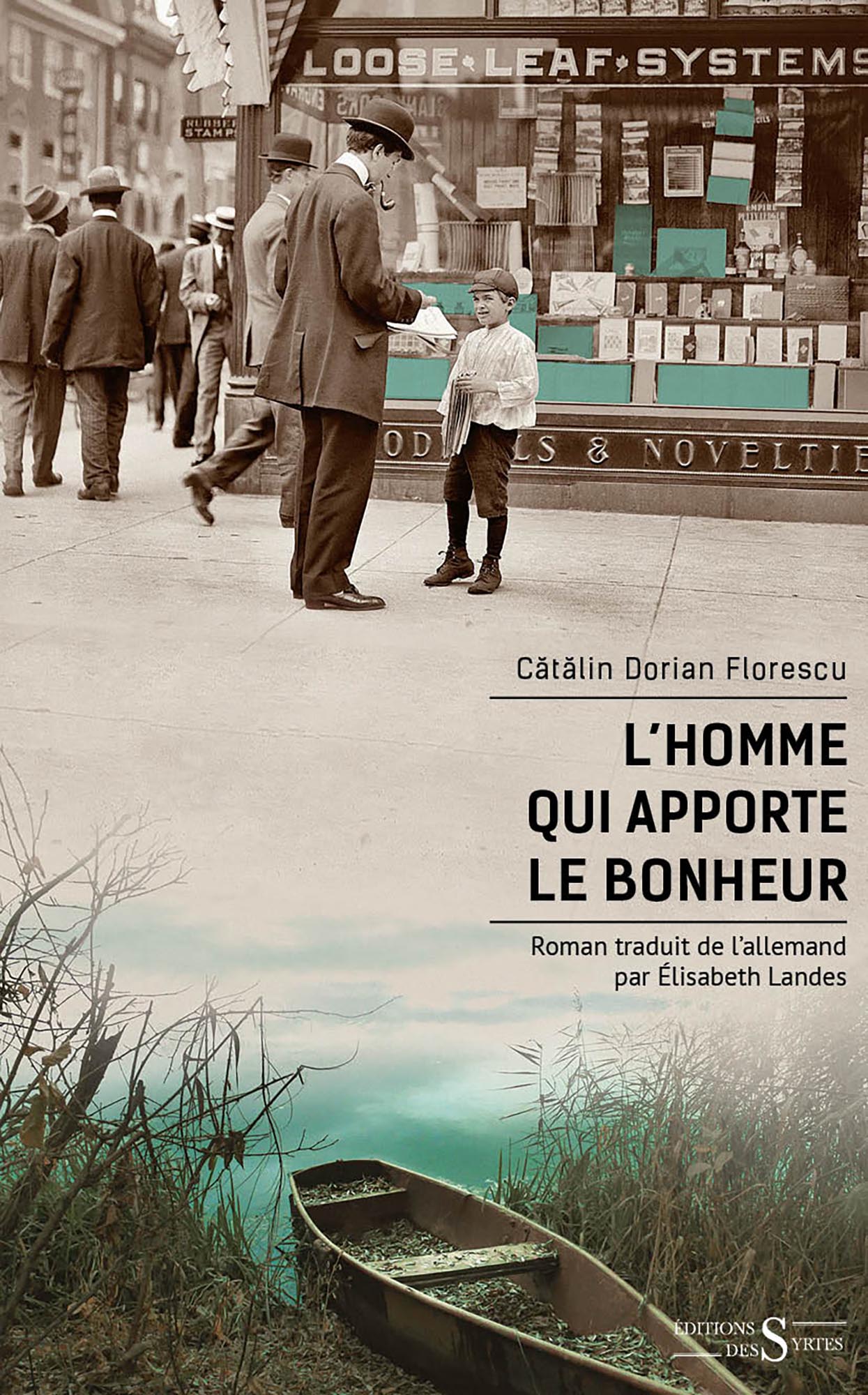
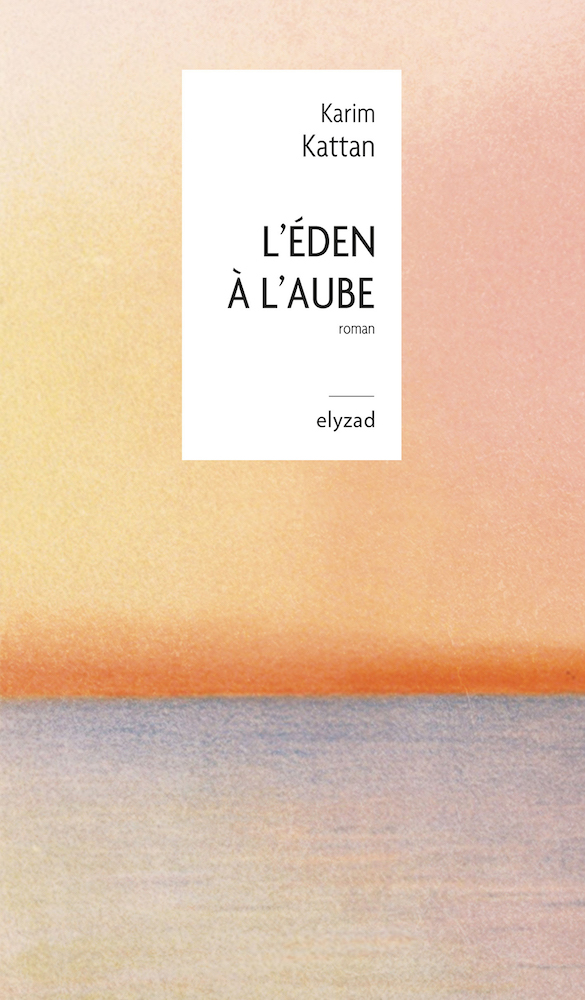
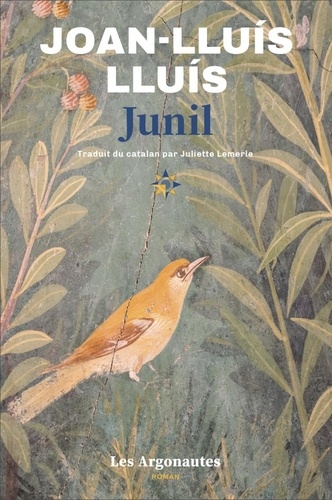
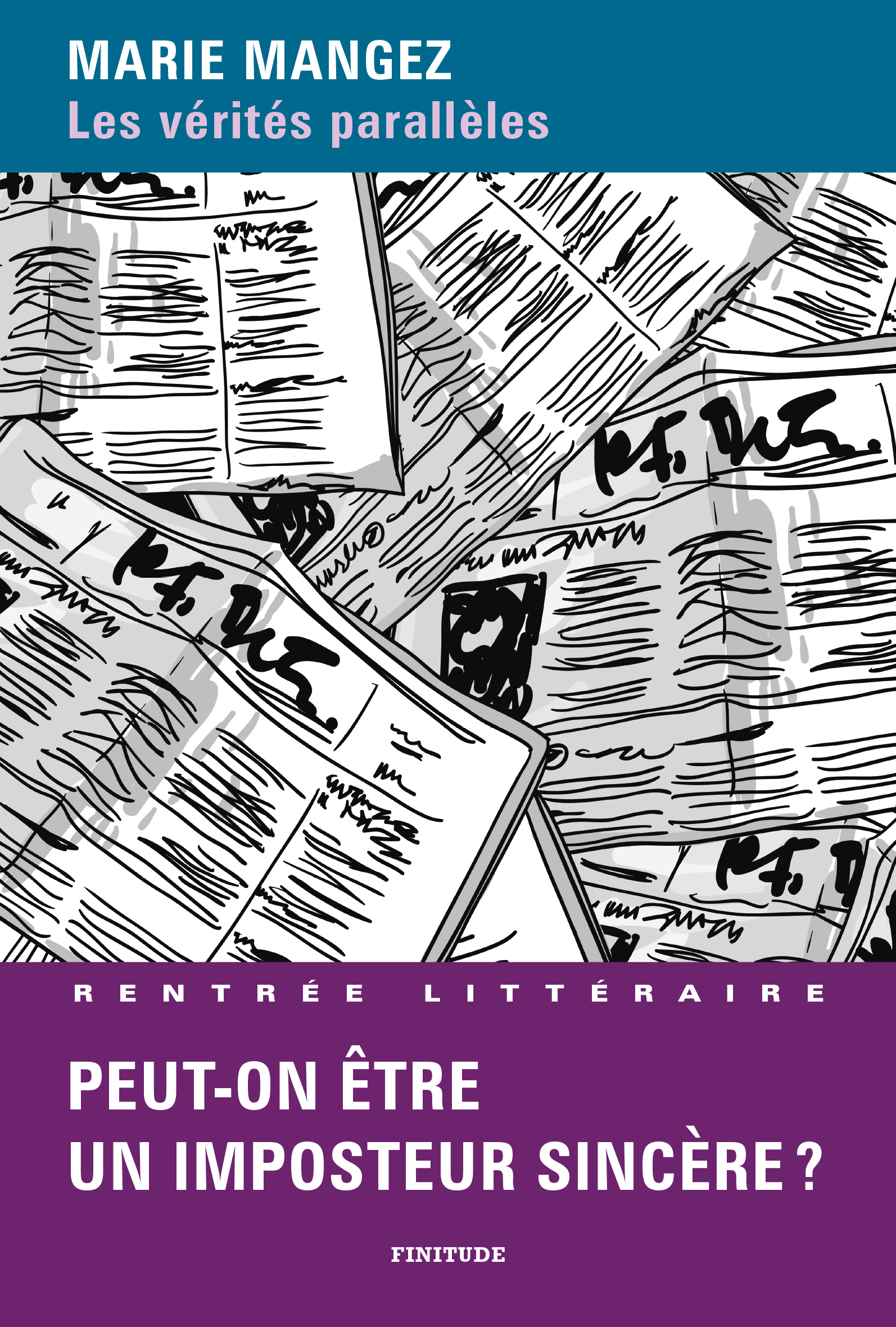
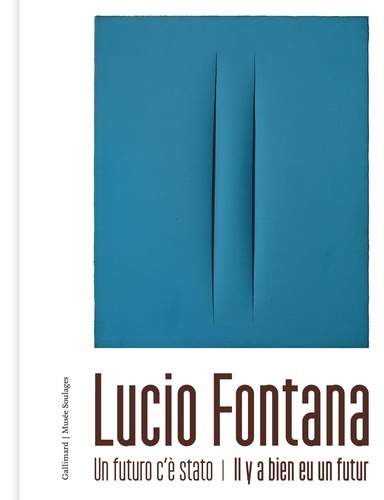

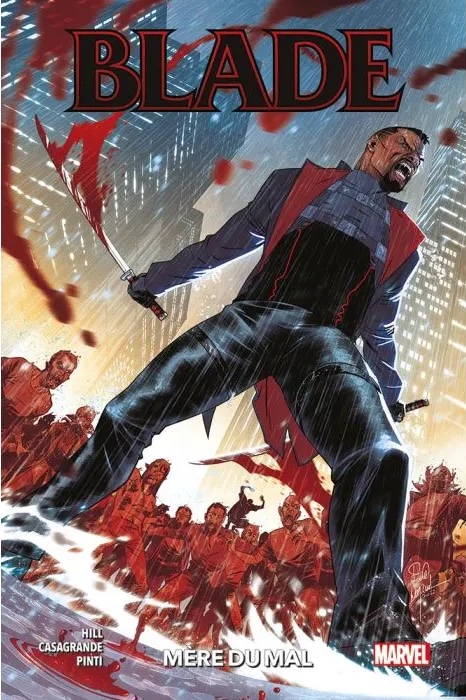
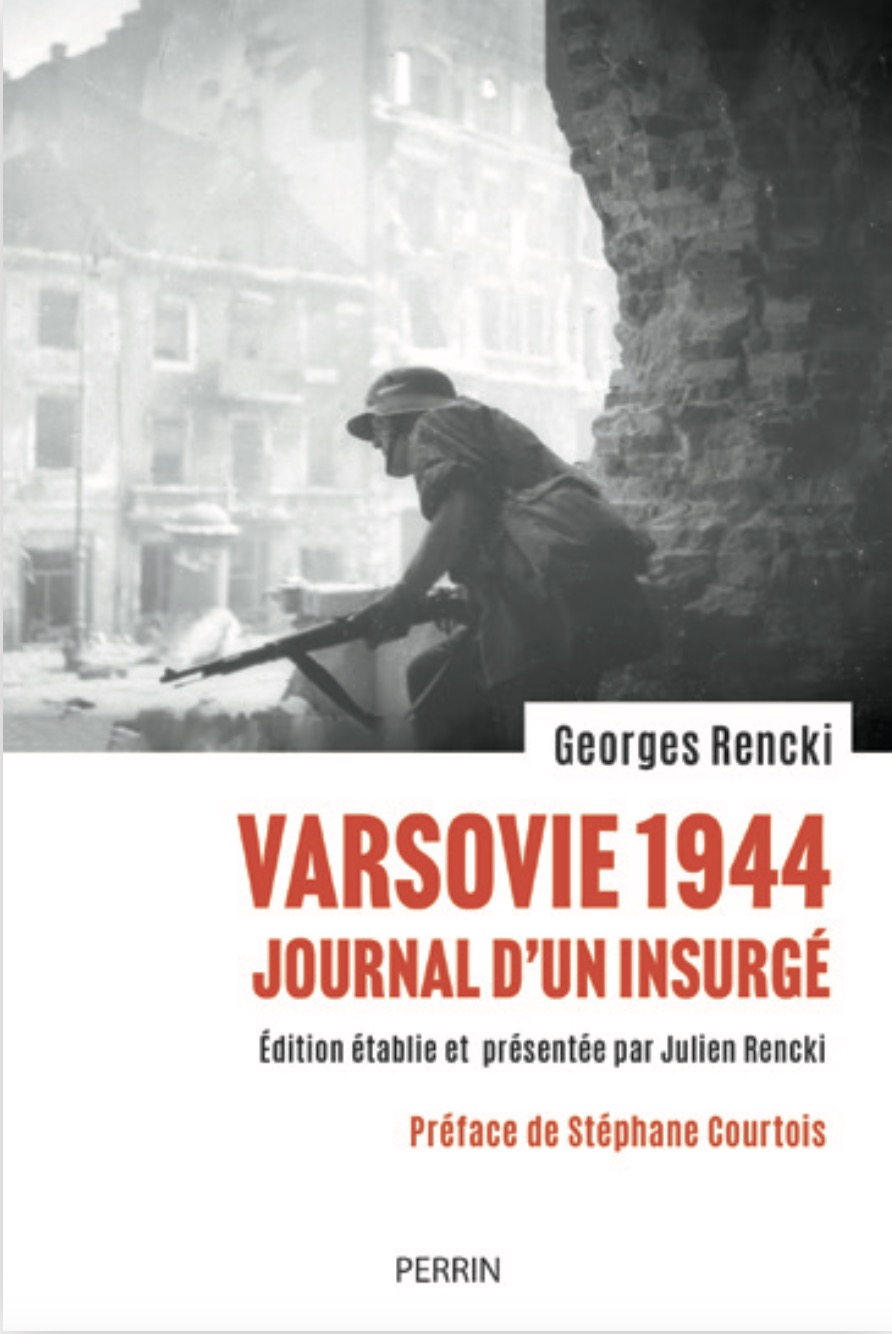
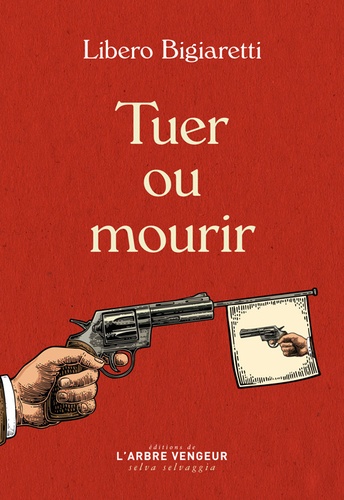
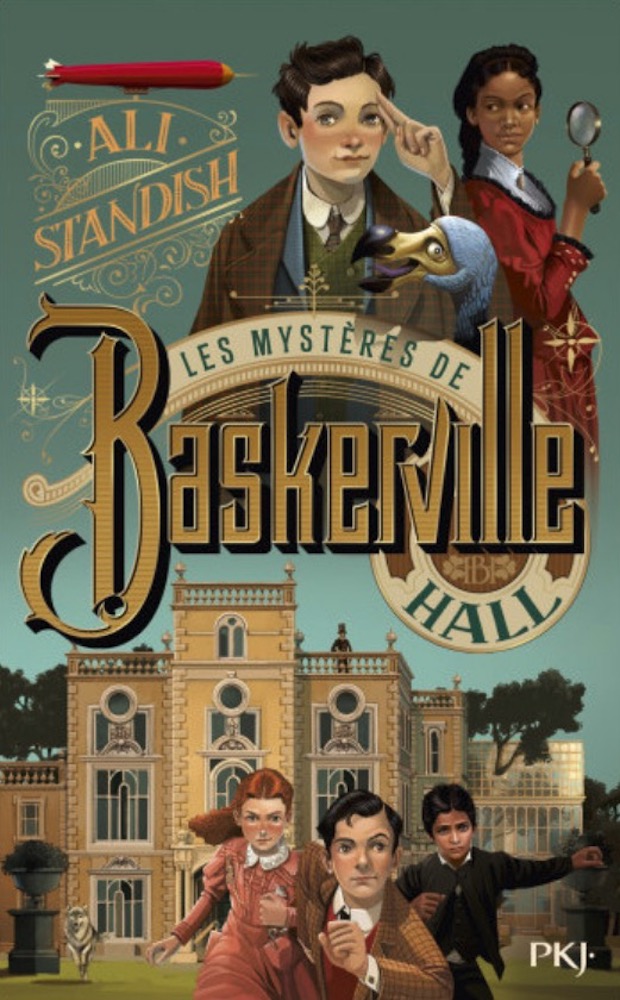
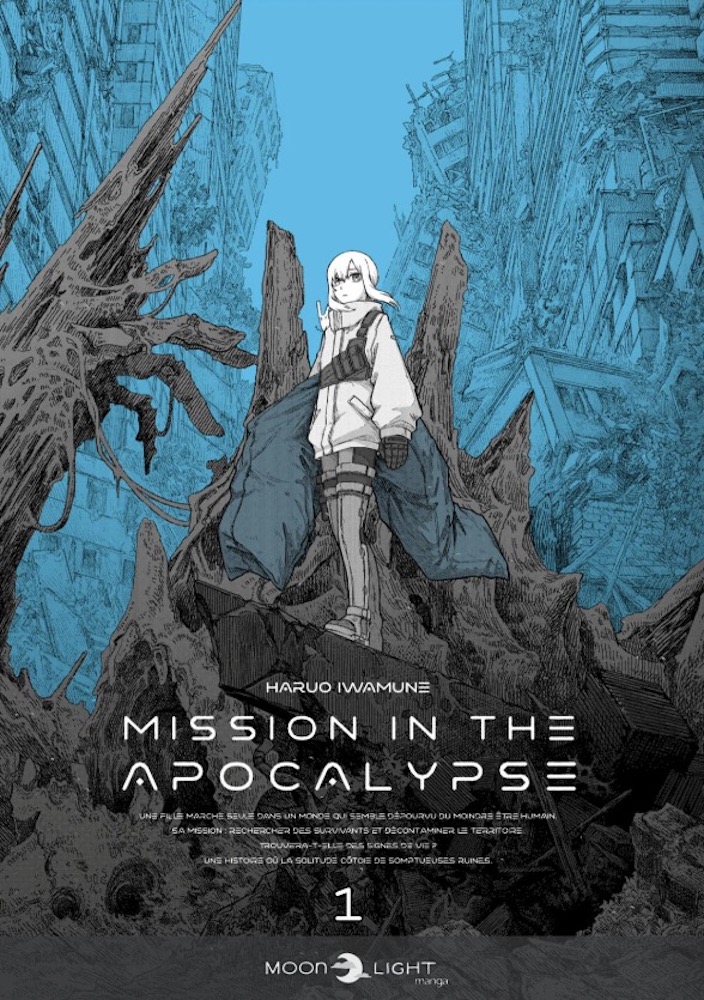
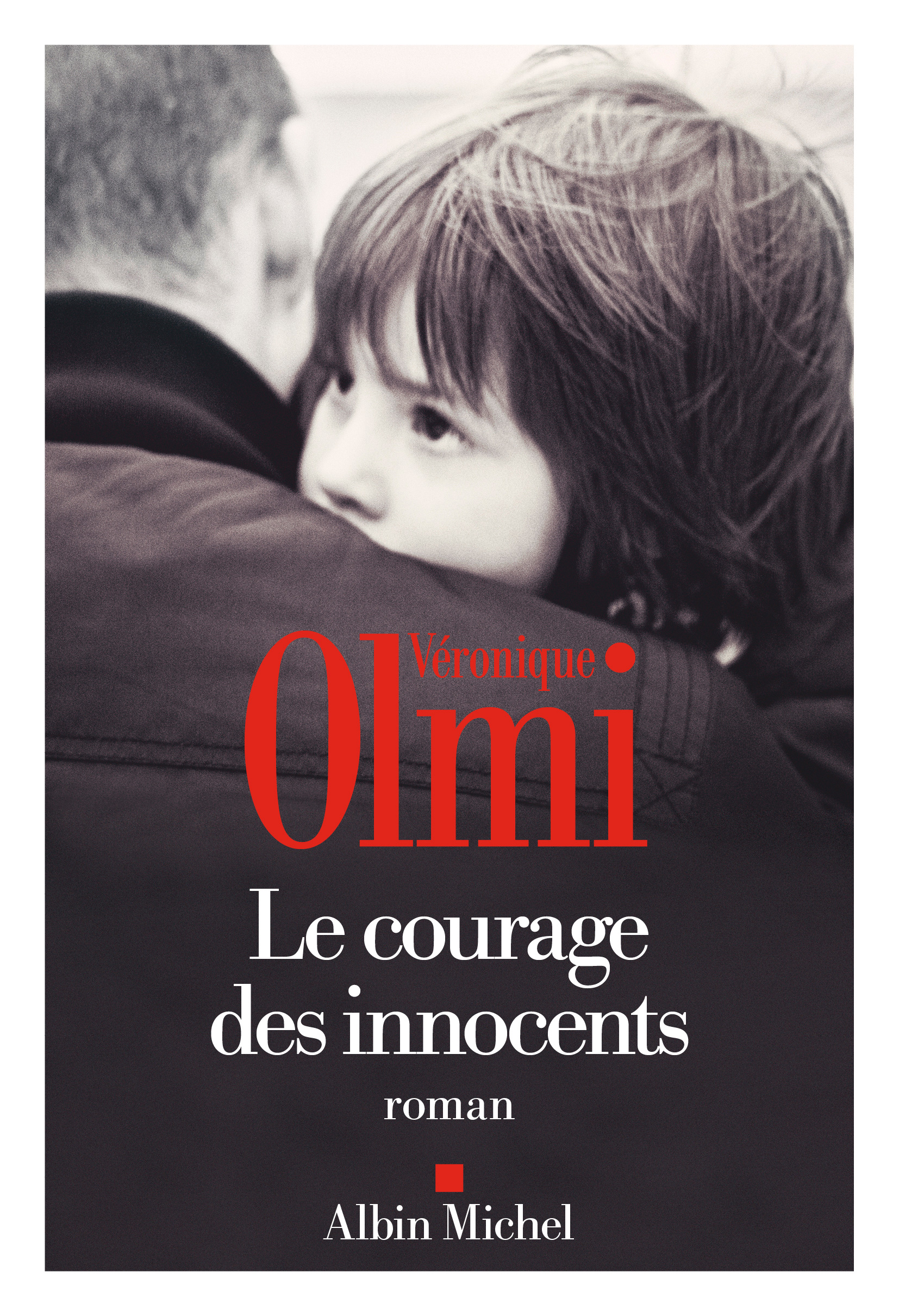
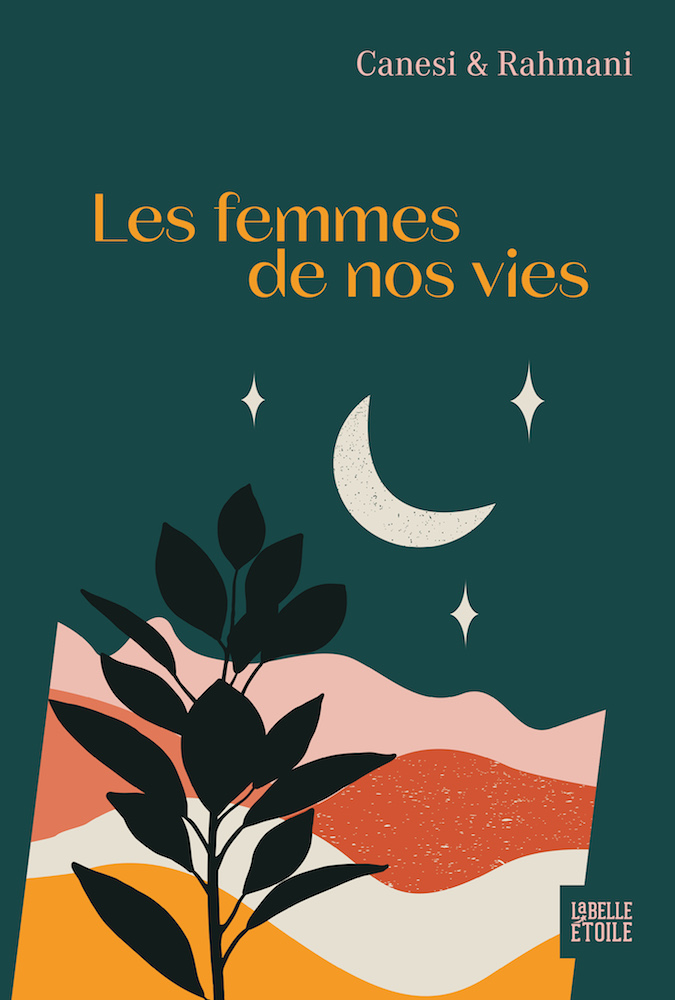
Commenter cet article