Les Ensablés - "Clavel soldat" de Léon Werth (1878-1955)
Mon cher Hervé, je me suis toujours demandé qui pouvait être Léon Werth à qui Antoine de Saint-Exupéry a dédicacé Le Petit Prince. Je découvre qu’il a publié une trentaine de livres sur une quarantaine d’années, de 1909 à 1948, et que son activité de journaliste a duré jusqu’à sa mort . C’est bien un ensablé. Clavel soldat et Clavel chez les majors, publiés en 1919, sont deux romans sur la guerre de 14-18. J’ai lu Clavel soldat, un récit terrible de 380 pages. André Clavel, le personnage central, est appelé en juillet 1914 à défendre la France comme des centaines de milliers d’autres hommes. Le roman raconte ses douze mois au front, de la mobilisation à sa première permission qui lui permet de rentrer à Paris. Le texte fait alterner la description du champ de bataille et les réflexions de Clavel.
Le 17/12/2017 à 09:00 par Les ensablés
Publié le :
17/12/2017 à 09:00
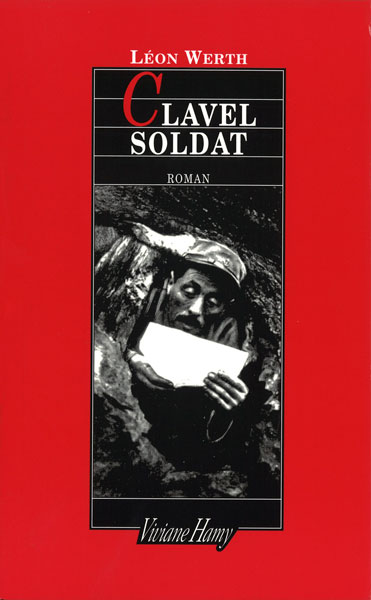
Note de voyage de L.Jouannaud
La guerre divise l’espace en zones différentes : les tranchées, le cantonnement, l’arrière, le reste de la France. Dans les tranchées, on risque sa vie : les balles fusent et les obus tombent. Les conditions de vie sont très dures. Le bruit est épouvantable. On passe des journées avec les pieds, les jambes dans l’eau. Il fait froid. On dort coincé dans des trous creusés dans les parois des tranchées. On ne se lave pas pendant des semaines. Il y a des puces et des poux. La tranchée s’étire devant les tranchées ennemies, à quelques mètres. On vit courbé pour ne pas être cible. Et régulièrement, il faut partir à l’assaut pour gagner du terrain: on quitte sa tranchée, on court vers la tranchée d’en face. Ceux qui quittent en premier le boyau savent qu’ils vont être fauchés par la mitraille. Les blessés agonisent lentement, en hurlant.
Ceux des tranchées sont relevés après quelques jours : ils sont alors au cantonnement, derrières les tranchées. Mais ils restent à portée des obus allemands qui régulièrement pilonnent la ligne de front. Qui entend le sifflement de l’obus et son impact n’est pas mort, mais celui qui est à côté de lui peut déjà l’être. Au cantonnement, on est au sec, à l’abri, mais rien ne résiste à un obus qui touche de plein fouet une casemate renforcée ou une cave aménagée. La mort n’est jamais loin. Au cantonnement, c’est l’ennui. Des heures à attendre d’être renvoyé aux tranchées. Mais on s’ennuie aussi dans les tranchées où l’on attend l’assaut.
A l’arrière proche, il y a le haut-commandement, les hôpitaux, les troupes fraîches. On y vit dans l’ombre de la guerre. C’est de là que partent les ordres. C’est de là que part la propagande. Le soldat et l’officier sont deux catégories humaines différentes, traitées différemment. Dans les deux catégories, il y a des lâches et des courageux. Les petits gradés qui font appliquer à la lettre le règlement suivent ce règlement et passent en premier au sortir de la tranchée : ils meurent eux aussi. Les hauts-gradés ne vont pas au front : ils donnent les ordres et organisent la guerre. Clavel en fait un portrait impitoyable : « les officiers sont dorés, hors du troupeau. »
Enfin, il y a le reste de la France. A la différence de la seconde guerre mondiale qui a touché toutes les régions et Paris, la première guerre reste limitée au Grand Est et au Nord. Partout ailleurs, c’est la paix. Quand le permissionnaire rentre chez lui, il dérange l’ordre qui y règne sans lui. Il est devenu étranger. On lui demande de la belle humeur, du patriotisme, du panache, de l’optimisme, de la haine pour le Boche. On s’amuse à Paris, le commerce va, les femmes sont faciles : « V’là l’arrière, des salles [de cinéma] pleines, des femmes pleines, des types pleins. Pleins aux as. »
Léon Werth a fait la guerre . Il décrit ce que d’autres témoins, d’autres romanciers et les historiens ont eux aussi raconté. Il écrit en phrases sèches. Le récit est chronologique, mais il n’est pas organisé. C’est une succession d’images aussi précises que possibles. Le lecteur a l’impression d’être avec lui au front, et de voir ce qu’il a vu. Il n’y a pas de mise en scène.
C’est un œil sec qui enregistre les banalités et les horreurs quotidiennes. Werth ne trie pas. Je ne vais pas trier moi non plus : « On ne regarde plus où tombent les obus. On ne sait même plus s’ils sont boches ou nôtres » ; « la mer de boue » ; « tous les visages sont bouffis d’insomnie » ; « la paille [sur laquelle on dort] est souillée de crachats, de boue, de débris d’aliments, de linges sales, d’urine aussi quelques fois, mais c’est de la paille quand même » ; « il avance, sa bougie à bout de bras, il voit un corps sans tête, plus loin une bouillie d’os et de cervelles. C’est la tête, mais elle est près des pieds d’un autre cadavre» ; « au pied des murs s’étalent des dégueulis de vin glacé » ; « un soldat devenu fou pénètre dans tous les abris pour y chercher sa femme » ; « un rat est pris dans la ratière.
Le curé Evariste ouvre la trappe et le tue à coups de trique » ; « les deux majors viennent d’amputer sur la paille un pied qui ne tenait plus que par quelques lambeaux de chair » ; « un obus tomba dans les tranchées, toucha six hommes, faucha douze jambes » ; « il n’y a que le vin, la boue et les cadavres, les uns vivants, les autres morts ». Et Clavel rencontre d’autres hommes qui ne deviennent jamais ses amis : Prou, Pasteau, Rouillon, Rivoire, Contrel (« Qu’est-il en temps de paix ? »), Corbini, Vernay, Mourèze, etc.
Il ne s’agit pas seulement d’objectivité, mais d’un style. Werth évite le commentaire, le jugement, l’indignation. Les faits ne parlent-ils pas d’eux-mêmes ? Soldats et officiers pillent et volent (ils sont en France, et pillent ceux qu’ils sont venus défendre). Il y a des déserteurs, il y a ceux qui trouvent une planque, il y a ceux que la peur paralyse, il y a ceux qui se mutilent. Il y a celui qui cherche les prostituées les plus basses pour attraper une maladie vénérienne, et être réformé. L’approvisionnement en vin est une préoccupation centrale. Dans les tranchées, on fait ses besoins dans une boite de conserve ou sur le plat d’une pelle, et on jette le tout aussi loin que possible. Les soldats se volent entre eux. Un commandant explique que pendant une marche, ou un défilé, on ne s’arrête pas pour uriner : « Il faut apprendre à pisser en marchant, sergent. Vous ne serez pas le premier auquel j’aurai appris ça. » (Je suppose qu’il en est encore de même le 14 juillet).
Dans certains secteurs, on ne se tire plus dessus, on se parle, on échange des cigarettes, à l’insu des gradés. Les soldats jouent aux cartes, aux dames, aux échecs, car l’ennui est mortel : « L’ennui qui, désormais, nous suit partout, est en nous, qui ne s’apaise jamais même pendant une attaque, l’ennui plus fort que la peur, l’ennui qui entre en nous comme le froid, l’ennui qui ne fait plus qu’un avec nous-mêmes ! » Quel soulagement quand les obus ennemis tombent plus loin que soi (« Mais les autres, là-bas ? ») ! Quand on annonce un mort aux familles, on parle de balle en plein front, mort héroïque et propre, même si les balles ou l’obus ont déchiqueté le corps. L’Allemagne est traître, brutale, agressive, mais c’est exactement ce qu’on disait il y a dix ans, dans les mêmes journaux, de notre alliée d’aujourd’hui l’Angleterre, la perfide Albion de naguère. Le courrier est ouvert, la censure empêche la vérité de passer.
Les communiqués du GQG mentent en multipliant les pertes de l’ennemi et en cachant ses propres morts. Il y a les « mêmes dogmes, sophismes, arguments interchangeables, abstractions inconsistantes, rhétorique », des deux côtés. Et on recommande aux permissionnaires « de ne pas faire de récits terrifiants qui ne serviraient qu’à amollir le courage de leurs auditeurs et à diminuer la confiance du pays dans une victoire finale, qui est certaine » ; on leur recommande aussi de se reproduire, « que tous travaillent à augmenter le nombre de leurs enfants, ils se conduiront en bons français ». Vraiment, cette guerre grise aura touché le fond de l’ignominie, sans aucun des hauts faits militaires et des évidences morales qui ont marqué le second conflit mondial.
Clavel connaît le front et le cantonnement. Il fait son devoir : il obéit aux ordres mais il réfléchit plus que les autres. Ses amis appelaient Clavel l’« anarchiste ». « De souche et de formation bourgeoise », il travaillait dans un ministère. Il est parti en « soldat de l’an II ». Un ami révolutionnaire lui a dit : « C’est la guerre de la civilisation. C’est la dernière guerre. » Clavel l’a cru. En 1793, an II de la République récemment instaurée, les conscrits se sont battus pour la liberté (contre les monarchies), pour l’égalité (contre les aristocrates), pour la fraternité (libérer les autres peuples). Assez vite, Clavel comprend qu’il est le jouet de quelques intérêts privés et du nationalisme. A vrai dire, il est difficile de tout comprendre et de bien comprendre : « Où sont mes idées claires ? Ne sont-elles pas illusoires ? » Faire son devoir, est-ce obéir ? Obéir, est-ce faire son devoir d’homme ? Clavel obéit, comme les autres : « L’obéissance est accrue par la diminution même des individus, par la croissante perfection de leur inertie. Les hommes sont maintenant dociles comme des machines. »
Ce roman sur la guerre de 14-18 est tombé dans l’oubli. Barbusse, Dorgelès, Céline, Giono sont encore lus, mais pas Werth. Il manque à ce roman ce que Léon Werth n’a pas voulu y mettre : le romantisme du combat, la camaraderie du front, le courage intrépide, l’amour de la patrie. Ces ingrédients n’y sont pas : « Le courage militaire est simple et facile. Il suffit d’aller en avant. Toujours en avant. Jusqu’à ce que la guerre soit finie ou qu’un obus vous coupe en deux. Un aveugle ou un enfant en colère en sont capables. » Clavel n’aime plus ses camarades, ses compagnons de misère, qui ne détestent la guerre que sous les obus et l’oublient devant un quart de vin : « Hommes d’obéissance, esclaves sans amour et sans haine, je ne puis plus vous aimer. » Quant à l’amour de la patrie, il est difficile à distinguer des « pensées nationalistes qui préparent les guerres ».
Un romancier en dit toujours plus que ce qu’il a vu. Un écrivain bavarde, ou brode, ou remplit les blancs, sans parler de ceux qui enjolivent et mentent. Léon Werth essaie de rester au plus près des faits et des choses. Clavel, son personnage et alter ego, note les effets qu’un « écrivain héros » pourrait tirer de certaines scènes, et Werth se refuse à les écrire. Il est davantage journaliste que romancier. Avant d’écrire, il essaie de voir la réalité sans voiles ni idéologie. Difficile, parce que la pensée truquée et le faux langage interprètent la réalité : « On dirait que la guerre crée spontanément les idées qui lui sont nécessaires. » Les hommes ne veulent pas soulever les mots pour voir ce qu’il y a en dessous, pas plus en temps de paix qu’en temps de guerre. On parle d’héroïsme, de courage, de patrie : « C’est une politesse à l’universelle convention, à l’universelle légende, au mensonge mou qui se transmet de génération en génération et qui est le plus sûr aliment à la bêtise universelle. »
Clavel soldat sera apprécié des connaisseurs et par les témoins, mais cette peinture sans concession éloignera, semble-t-il, le grand public. On avait beaucoup parlé de Werth pour le Goncourt, en 1913, avec La chambre blanche, un roman biographique où il décrivait un séjour à l’hôpital. Avec Clavel soldat et sa suite, Clavel chez les majors, Léon Werth quittait le rayon bourgeois des librairies, et il n’y est plus revenu. « Je suis un raté. Je ne me le dissimule pas. Littérairement, je n’existe pas. Avant la première grande guerre, j’étais un écrivain émergent. (…) Mais quand mes deux livres de guerre montrèrent que je ne me voulais point héros, on me repoussa de partout. Le conformisme guerrier de 1914 à 1918 fut plus puissant que ne furent les conformismes qui lui succédèrent », écrivait Werth en 1952 .
J’ai lu l’excellente biographie rédigée par Gilles Heuré : L’insoumis, Léon Werth 1878-1955, Editions Viviane Hamy, 2006.
Léon Werth est au front de septembre 1914 à août 1915. Il sera réformé en 1915 pour maladie. Il restera un antimilitariste et un pacifiste convaincu.
Cité dans L’Insoumis, op.cit., p. 306.
Léon Werth - Clavel Soldat - Editions Viviane Hamy - Grand Format : 9782878580440 - 23,50€ / Poche : Collection Bis - Viviane Hamy - 9782878582215 - 11,20€
Clavel Soldat
Paru le 01/12/1993
384 pages
Editions Viviane Hamy
23,50 €
Clavel Soldat
Paru le 11/01/2006
375 pages
Editions Viviane Hamy
11,20 €



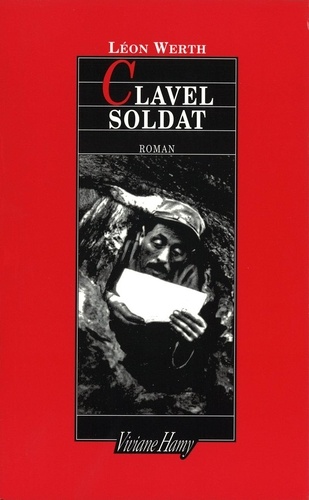
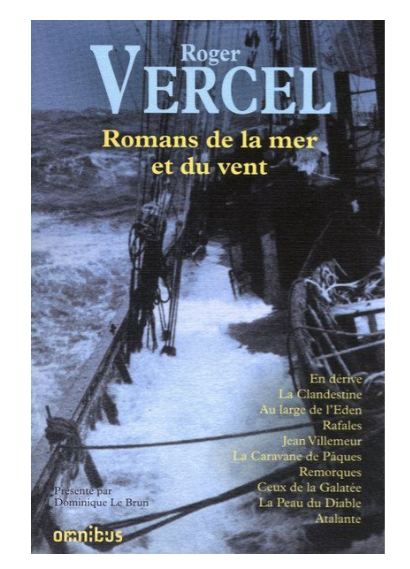
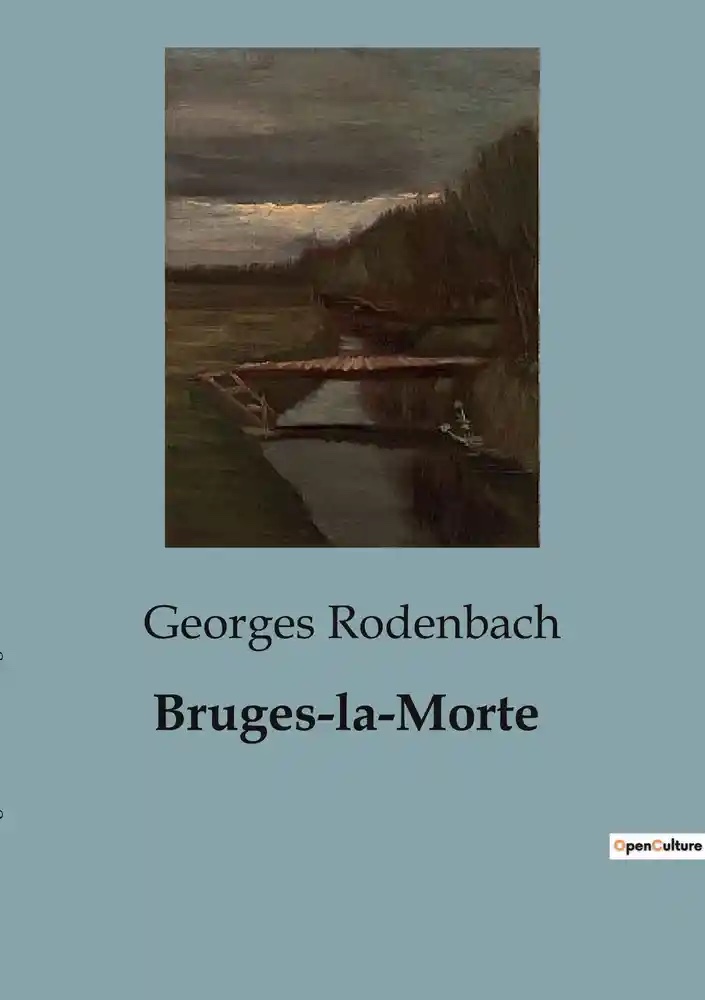
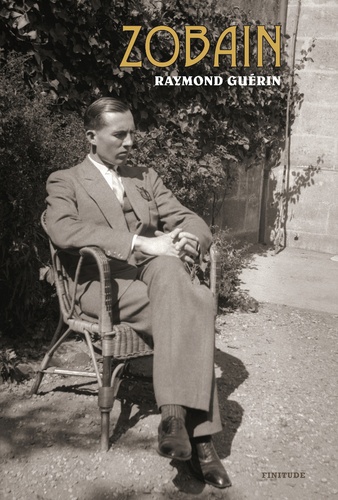
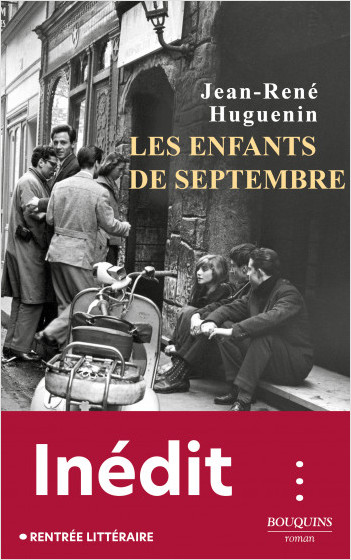
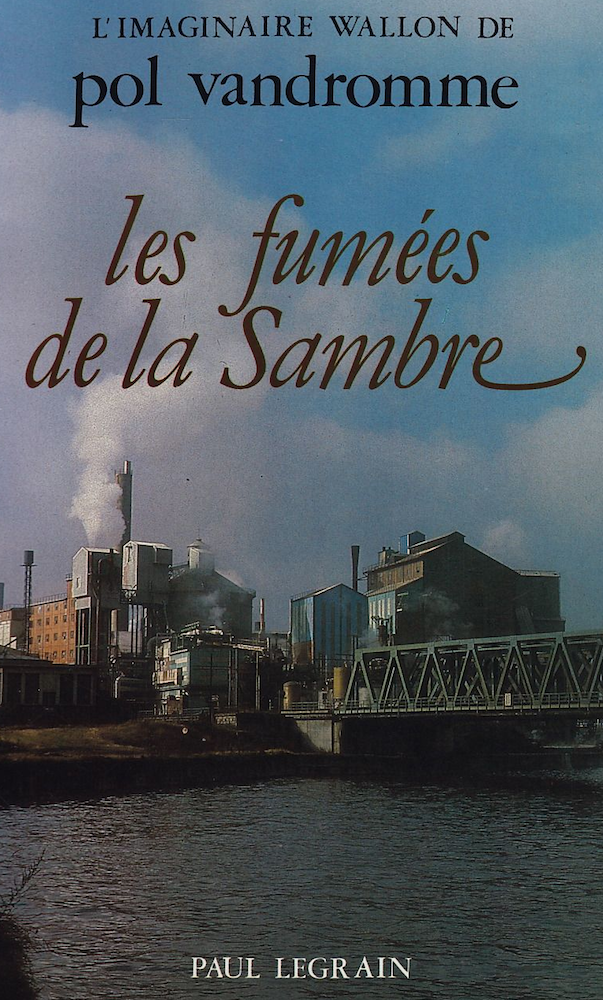
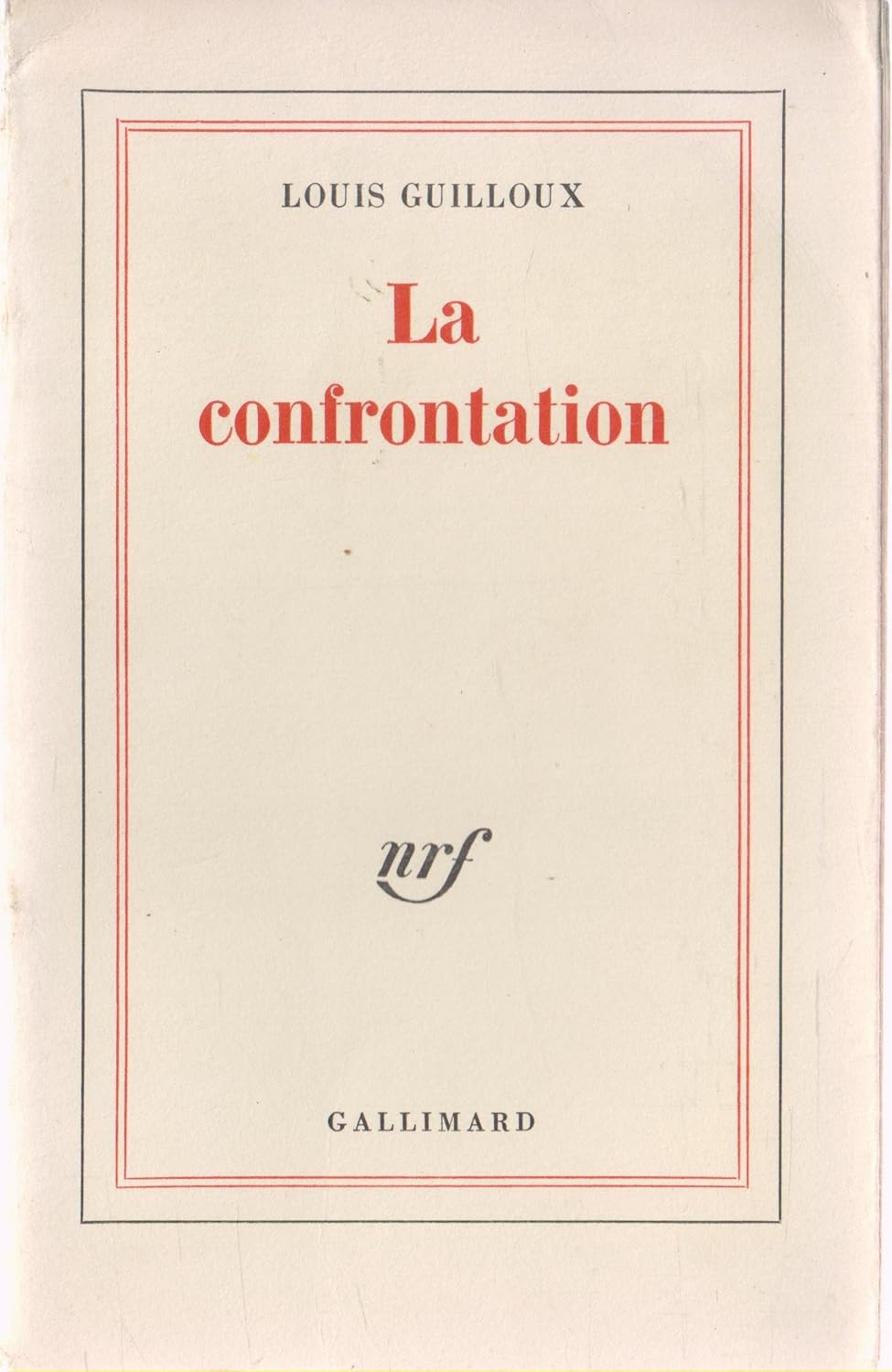
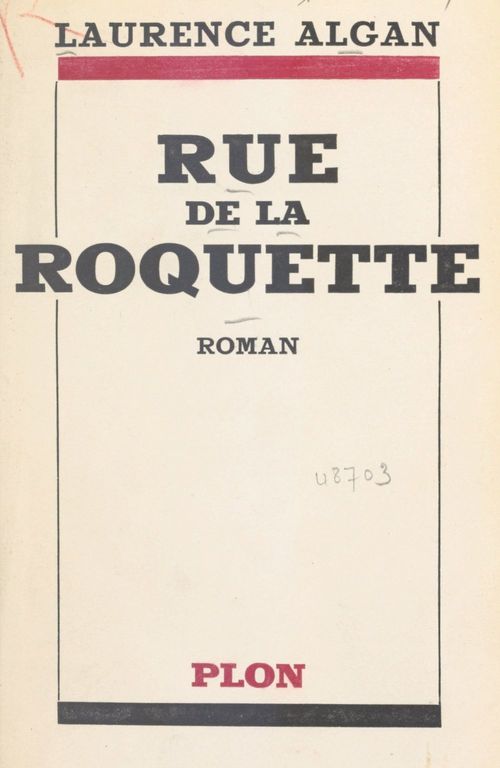
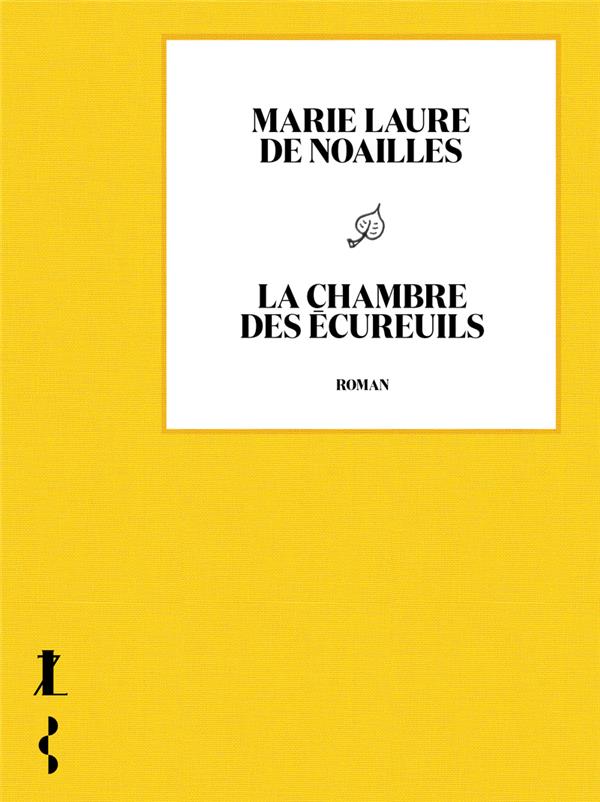
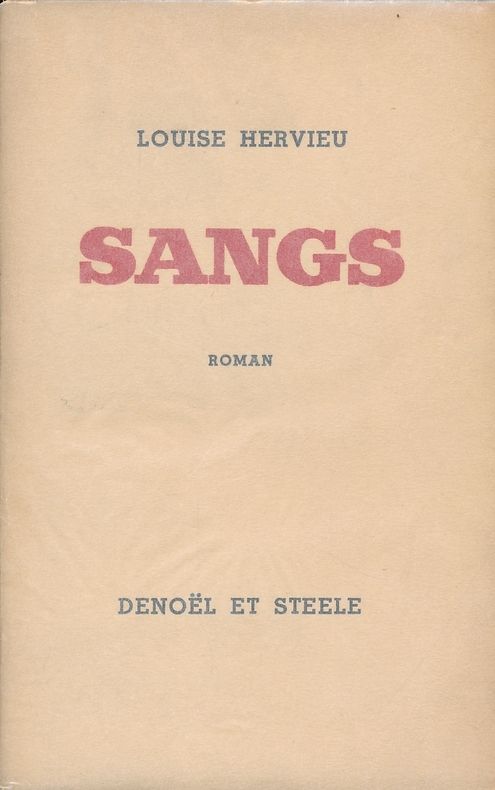
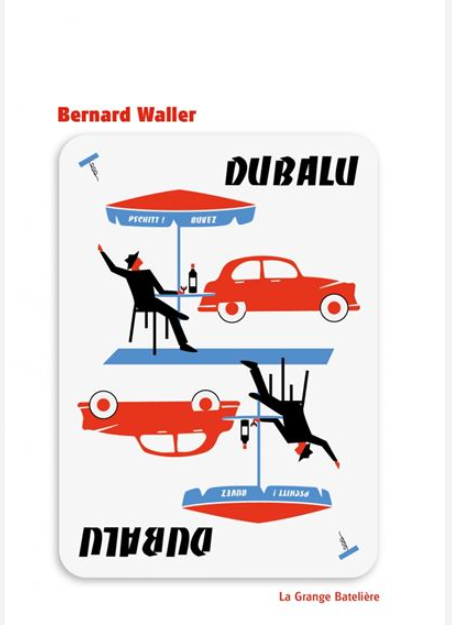
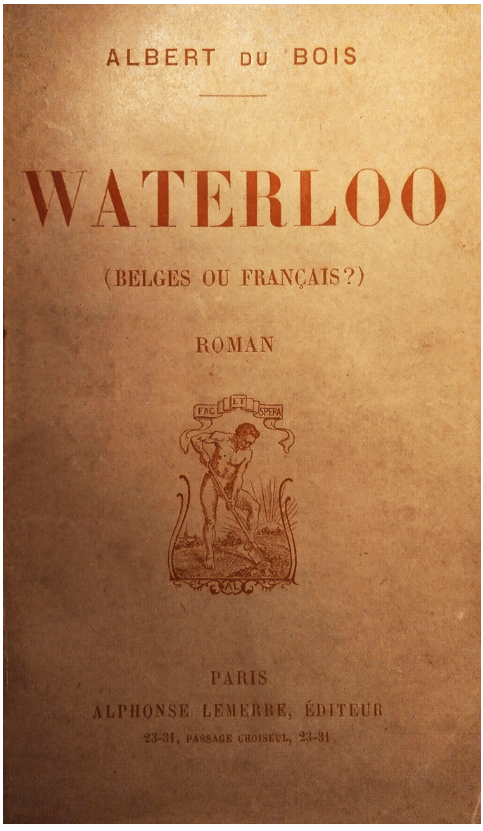
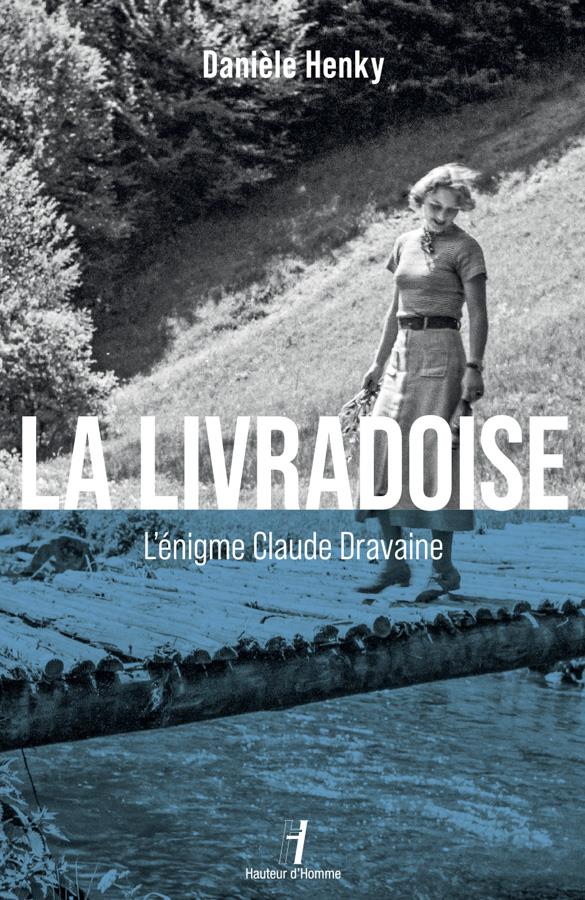
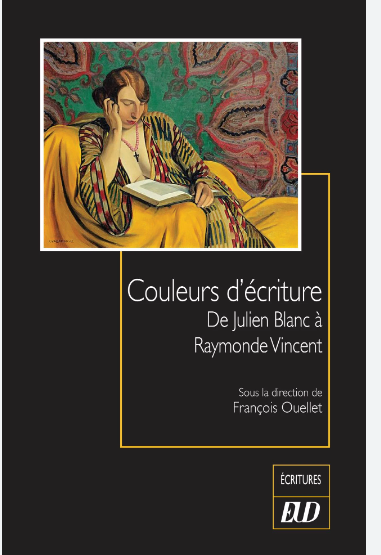
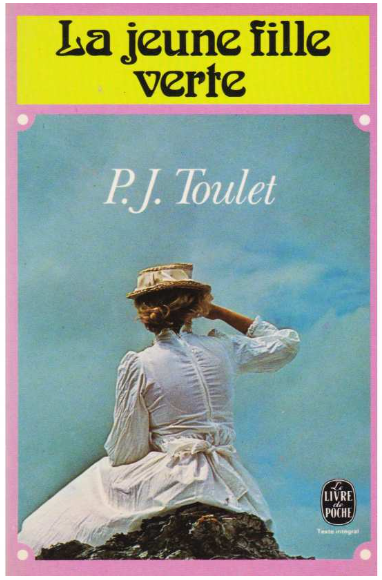
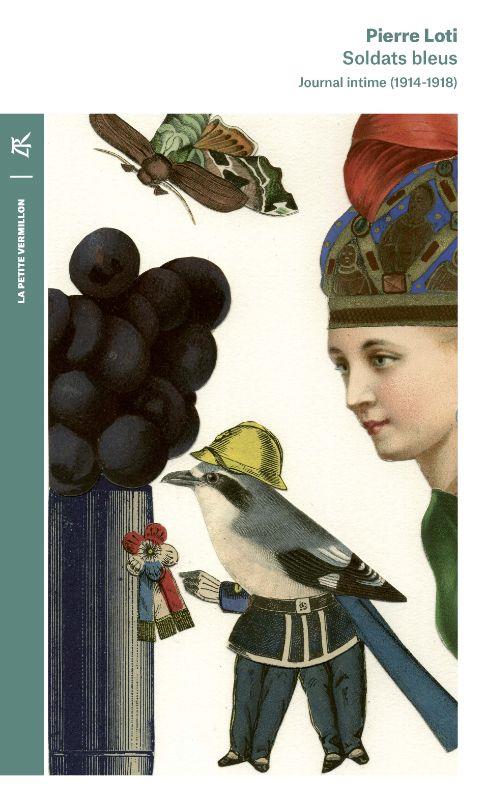
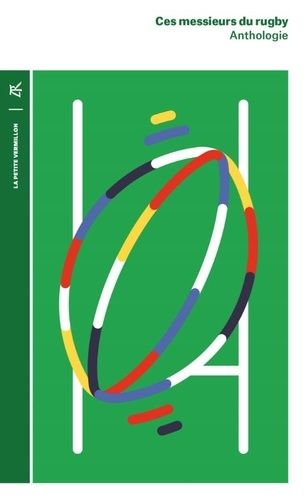
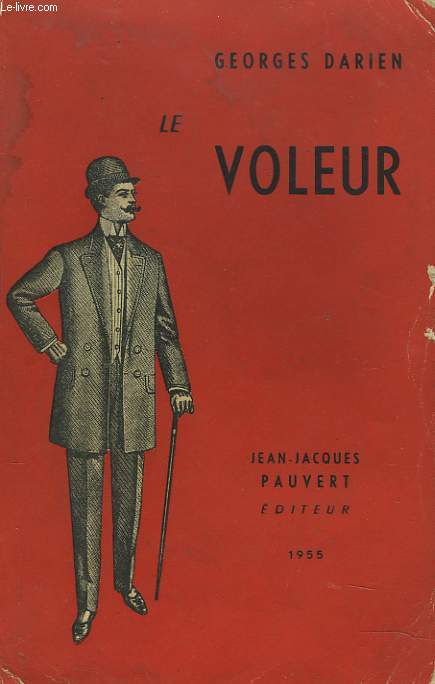
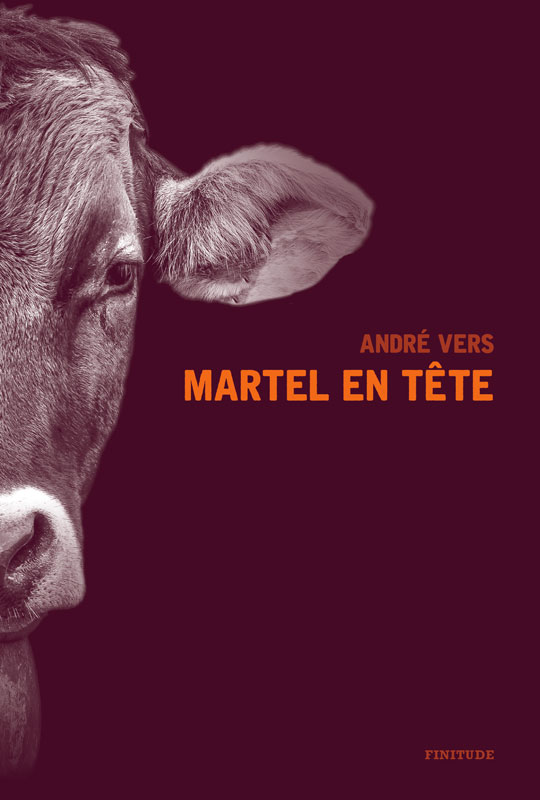

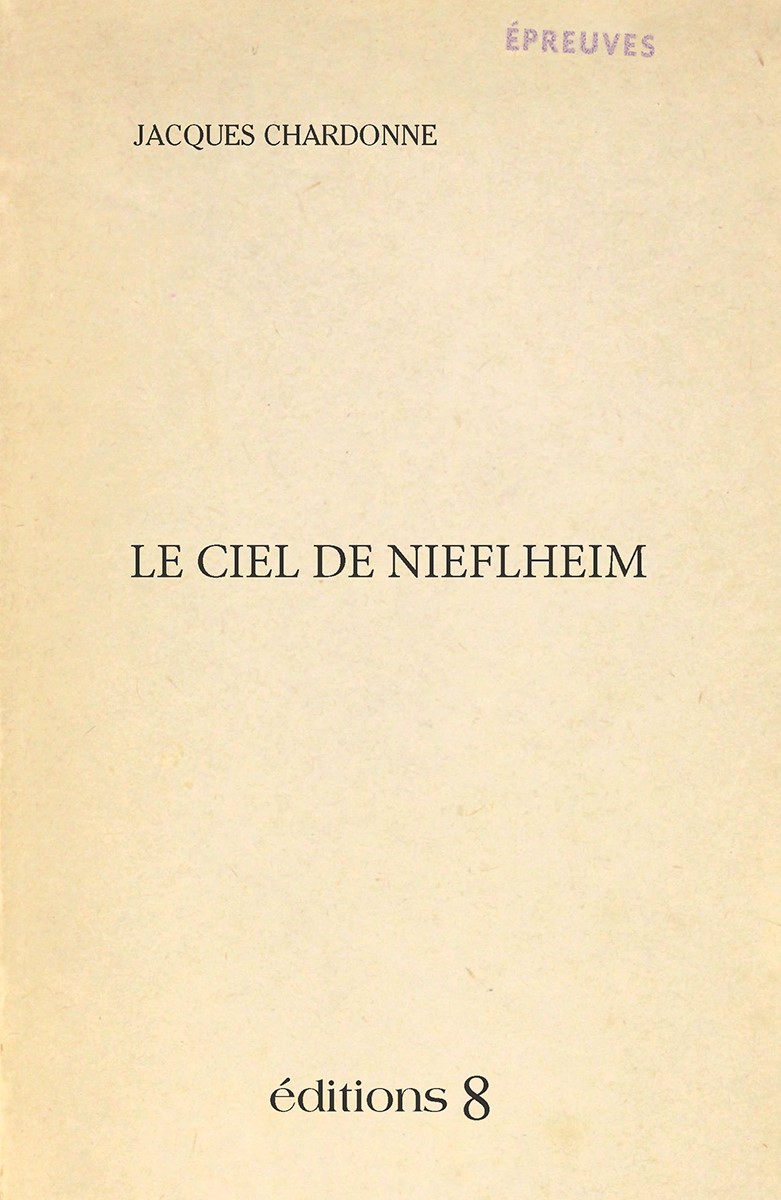
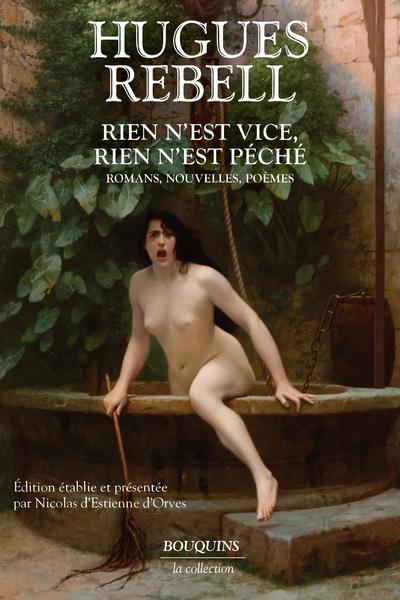
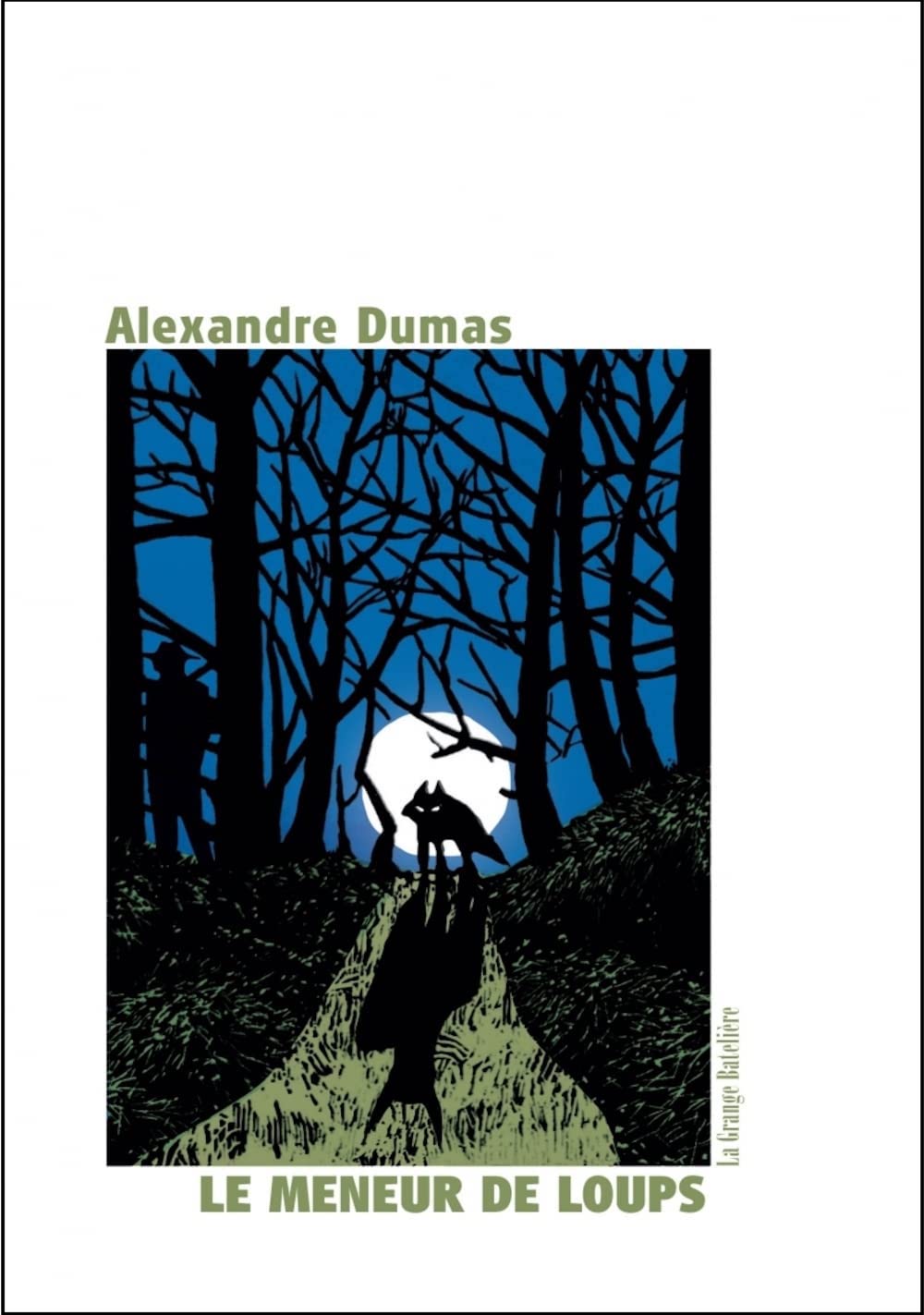
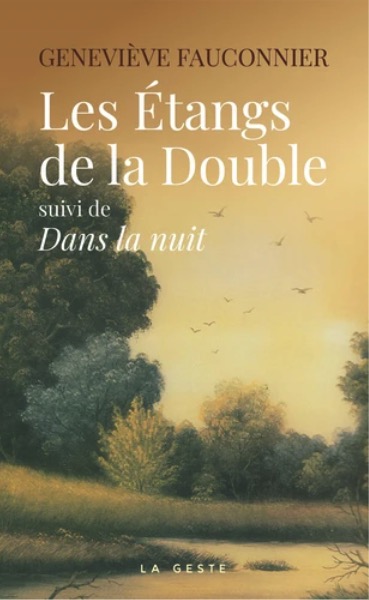
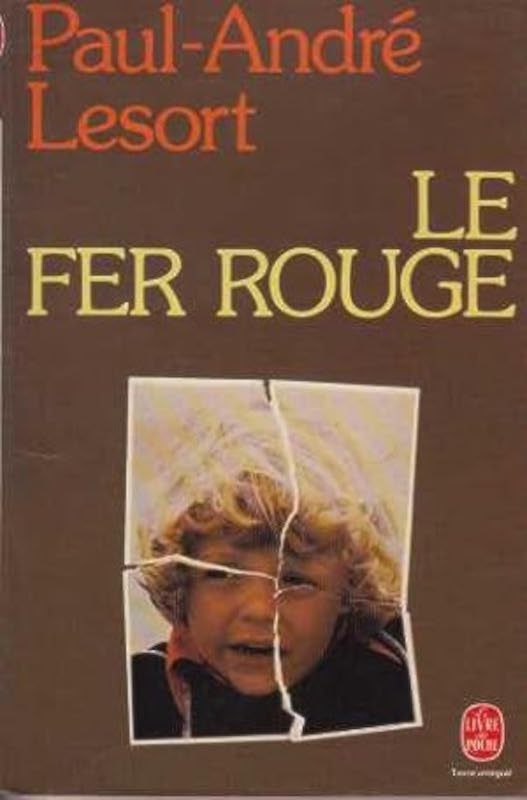

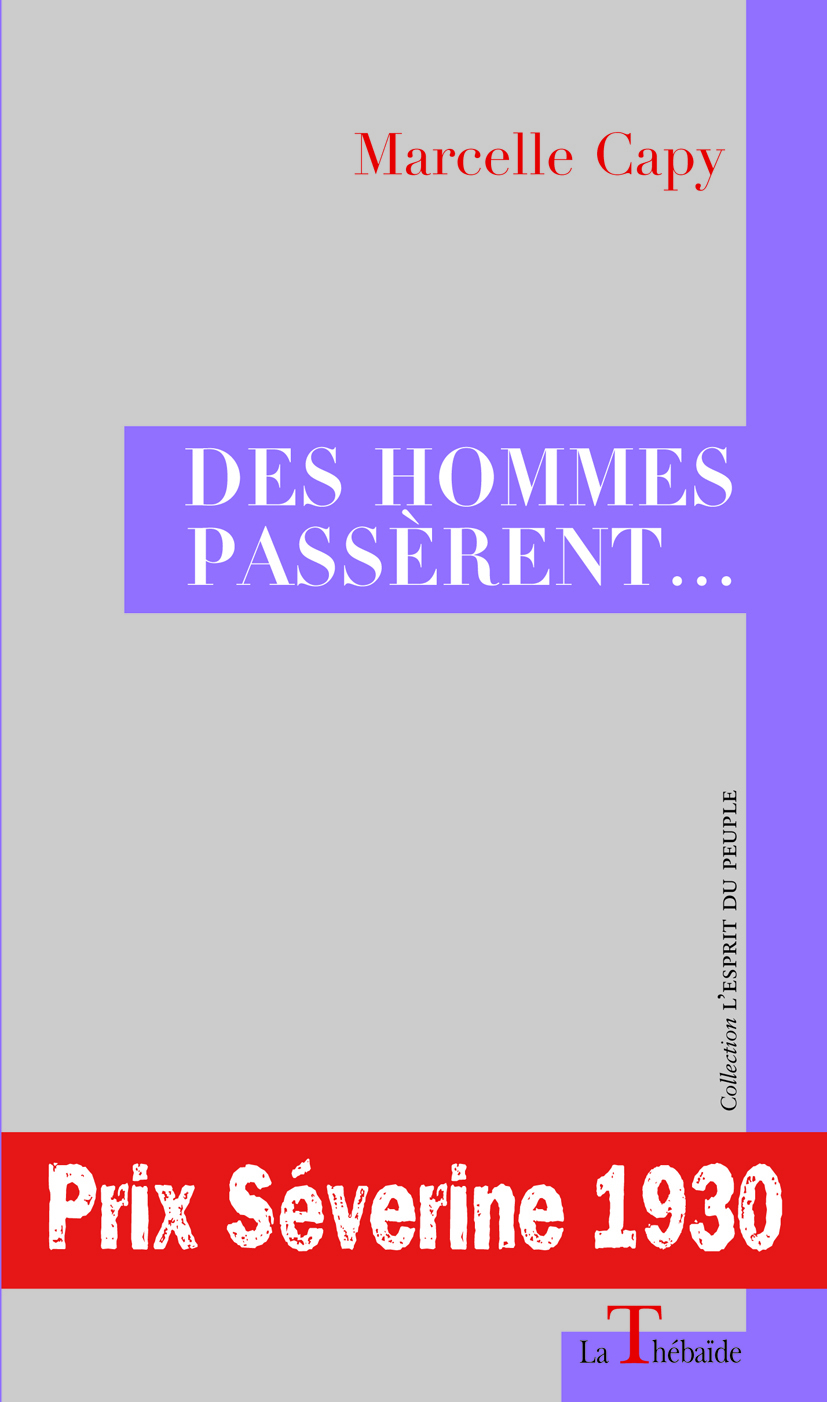
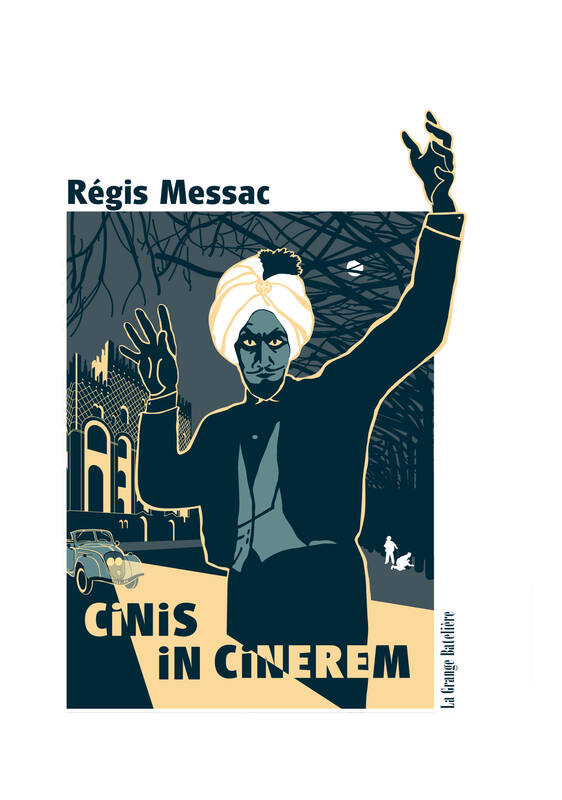
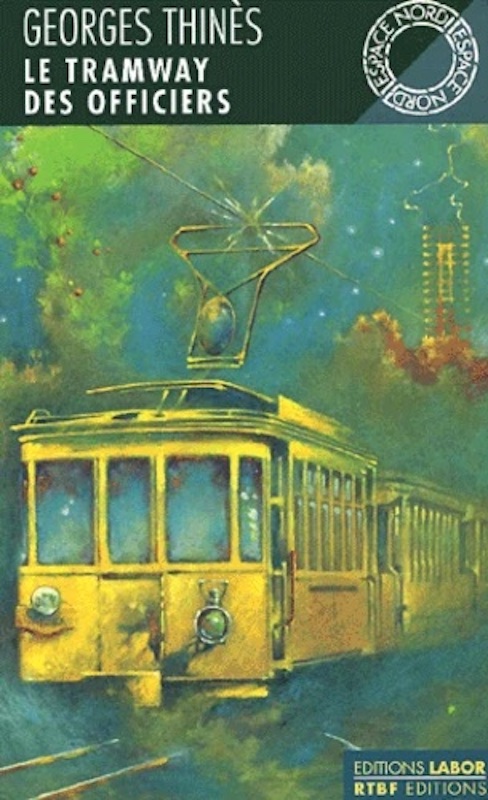
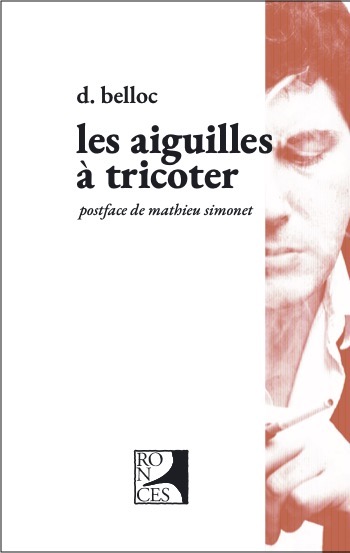
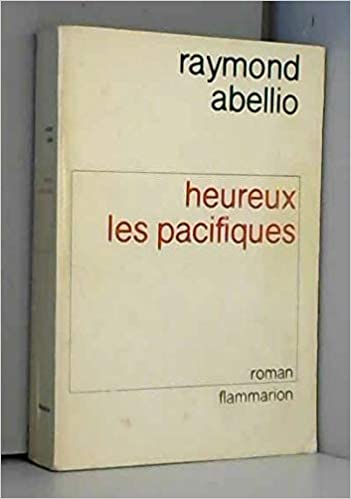
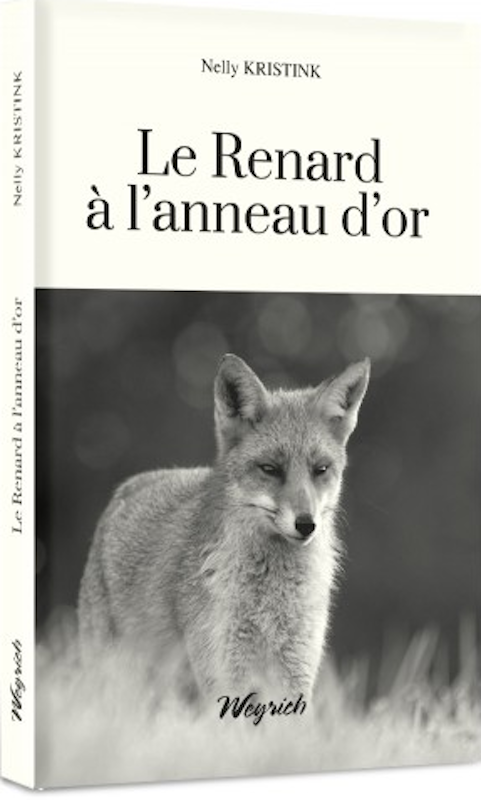
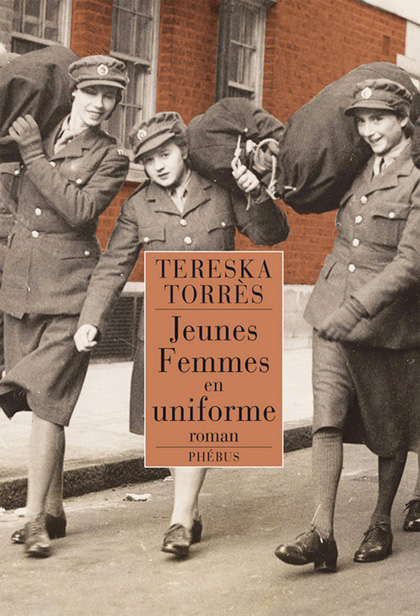
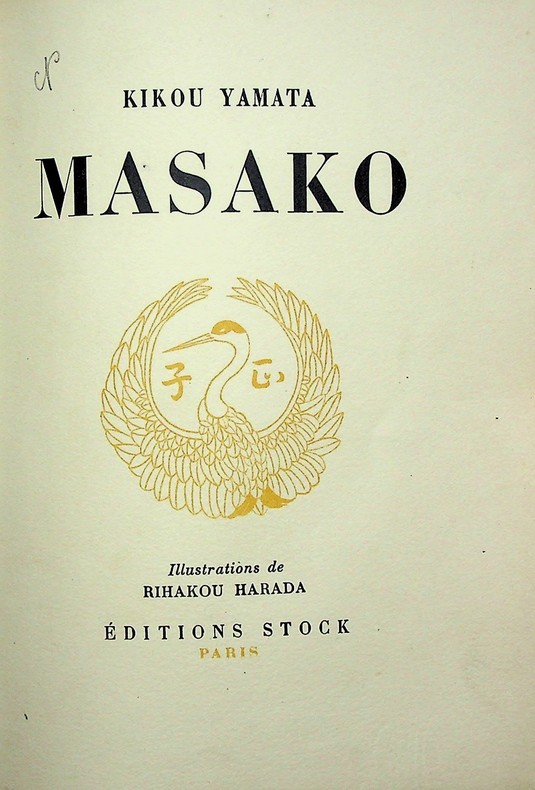
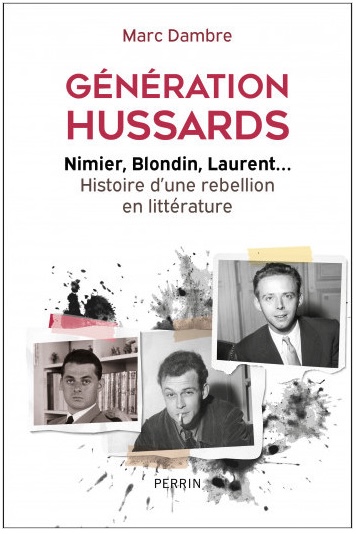
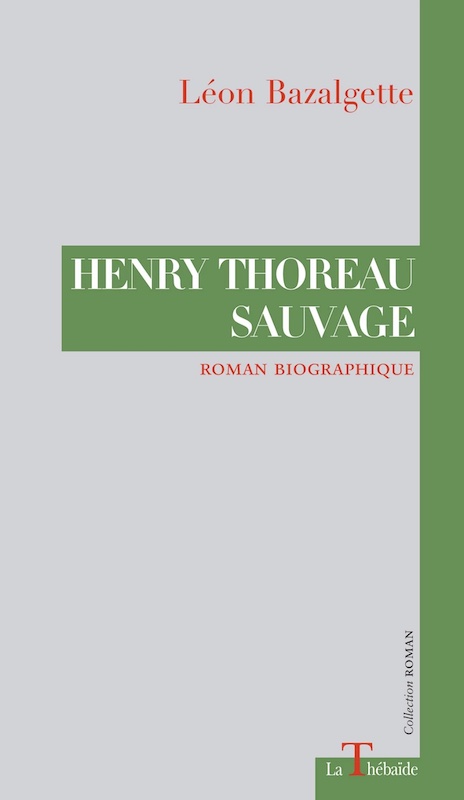
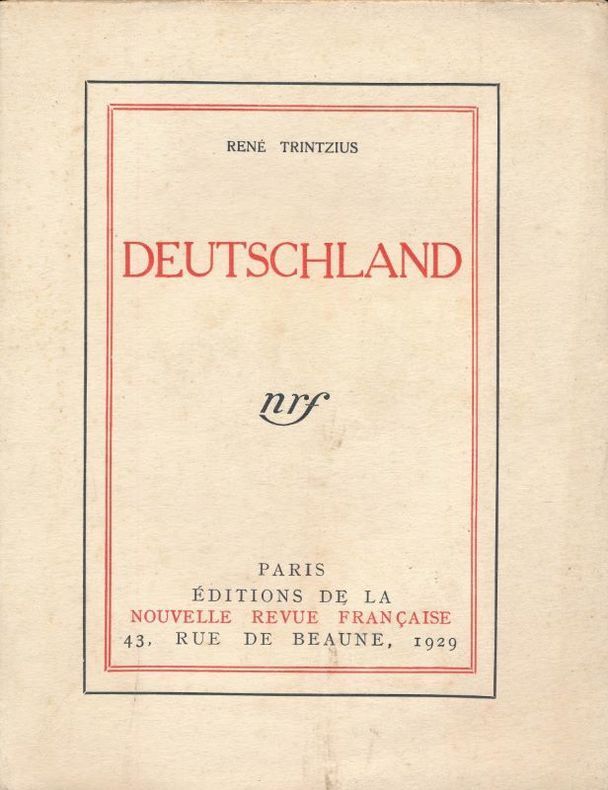
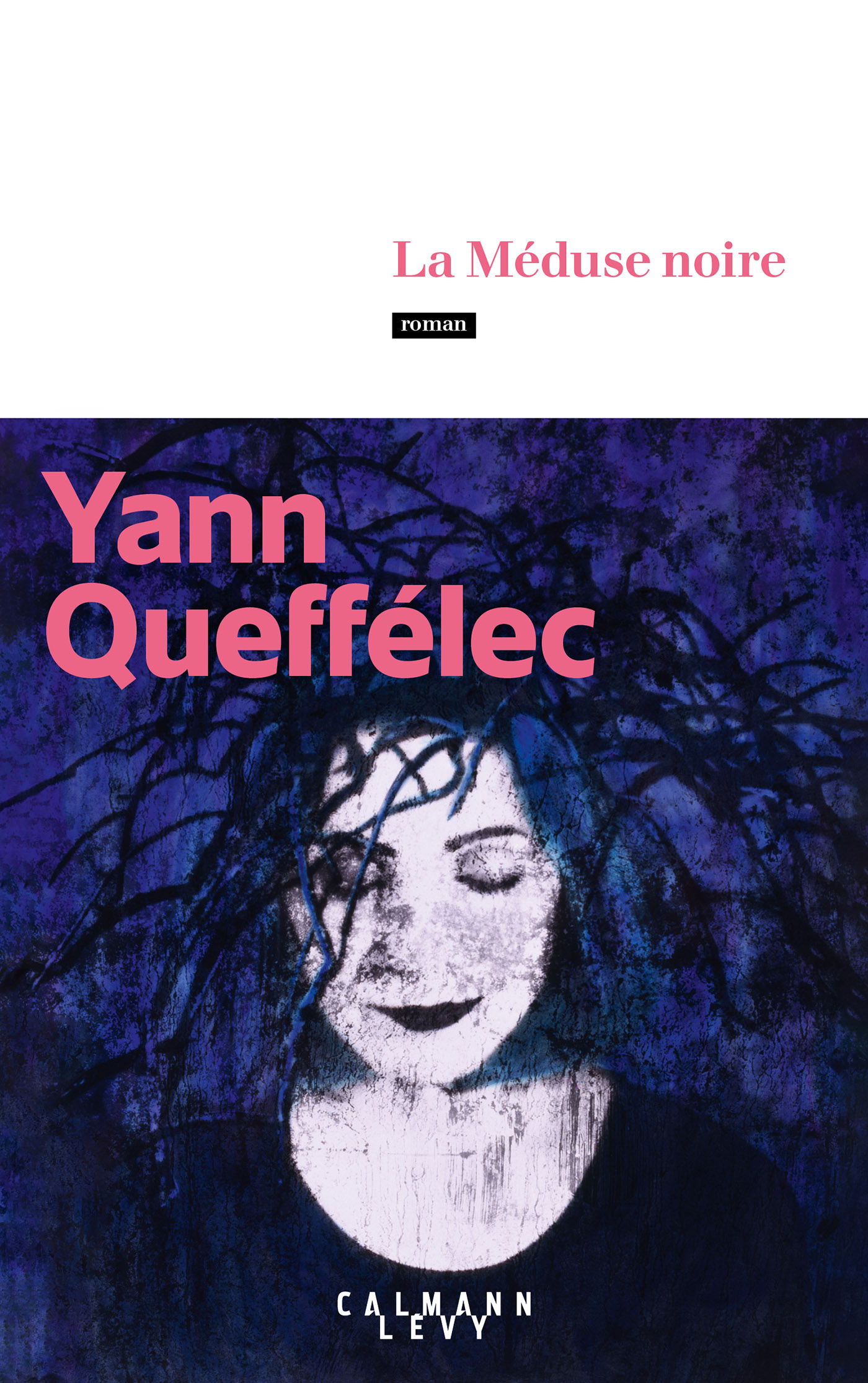
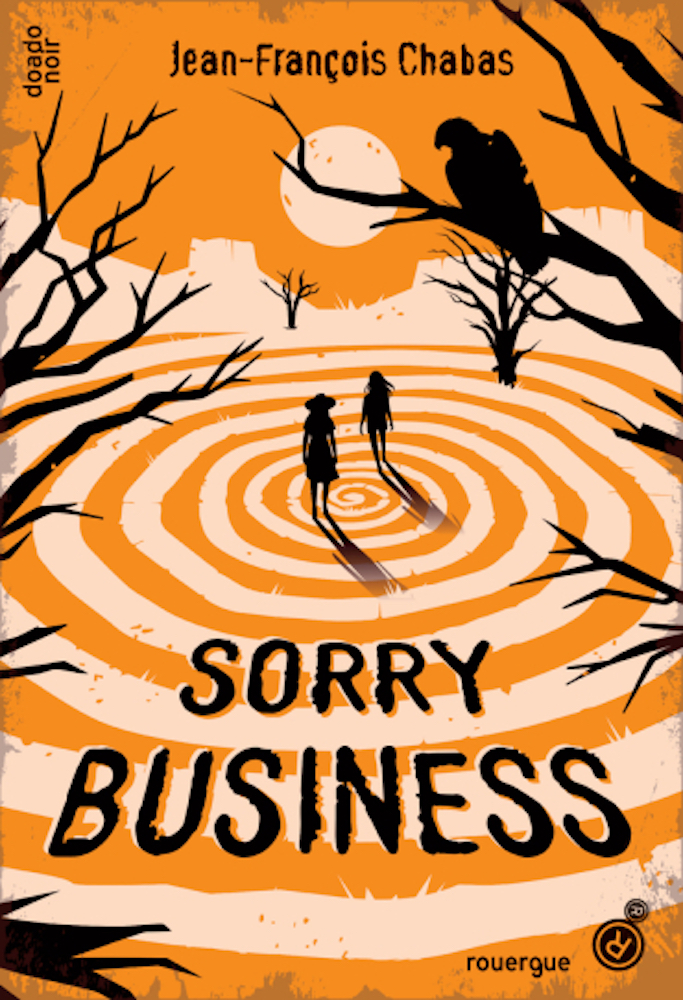
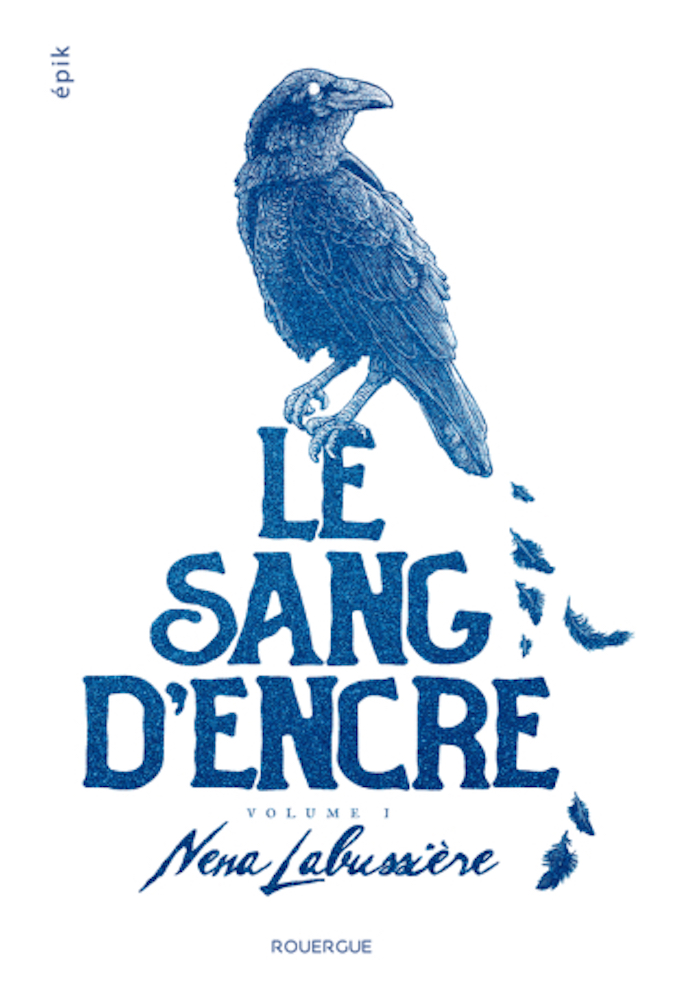
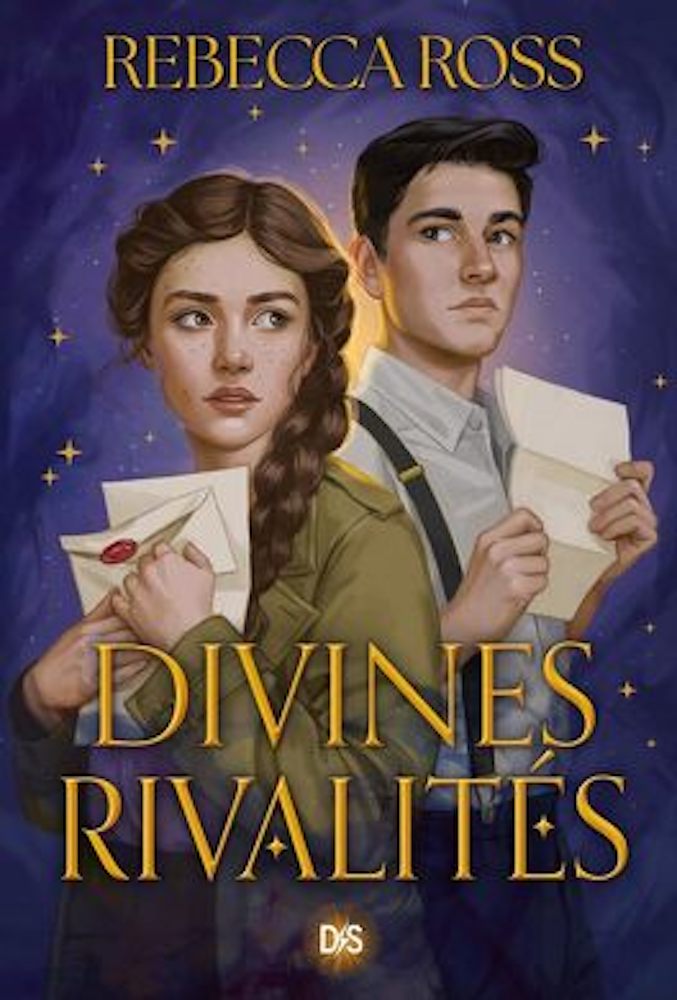
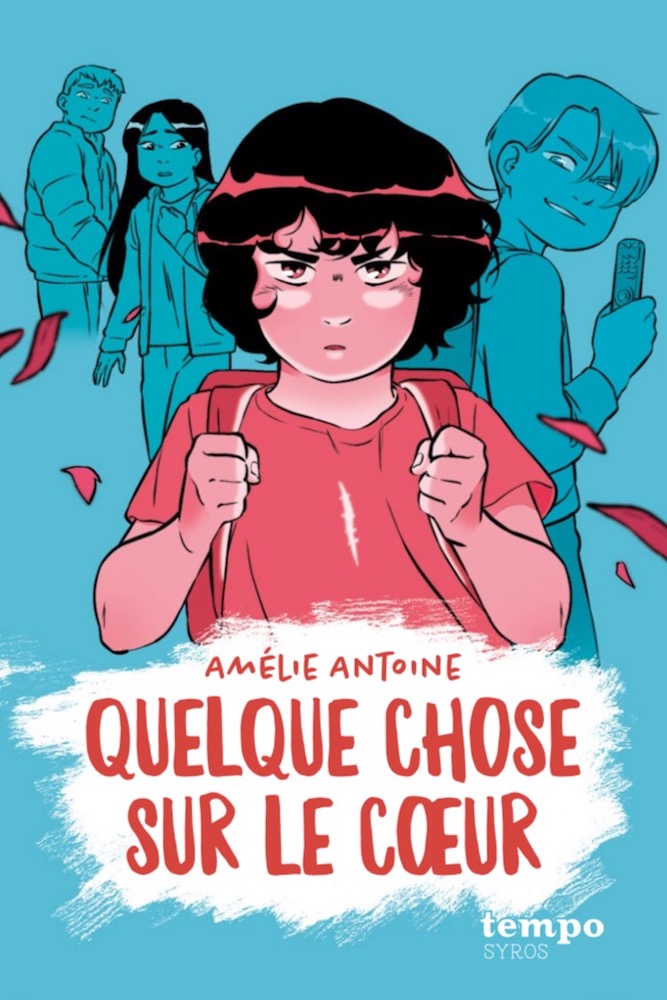

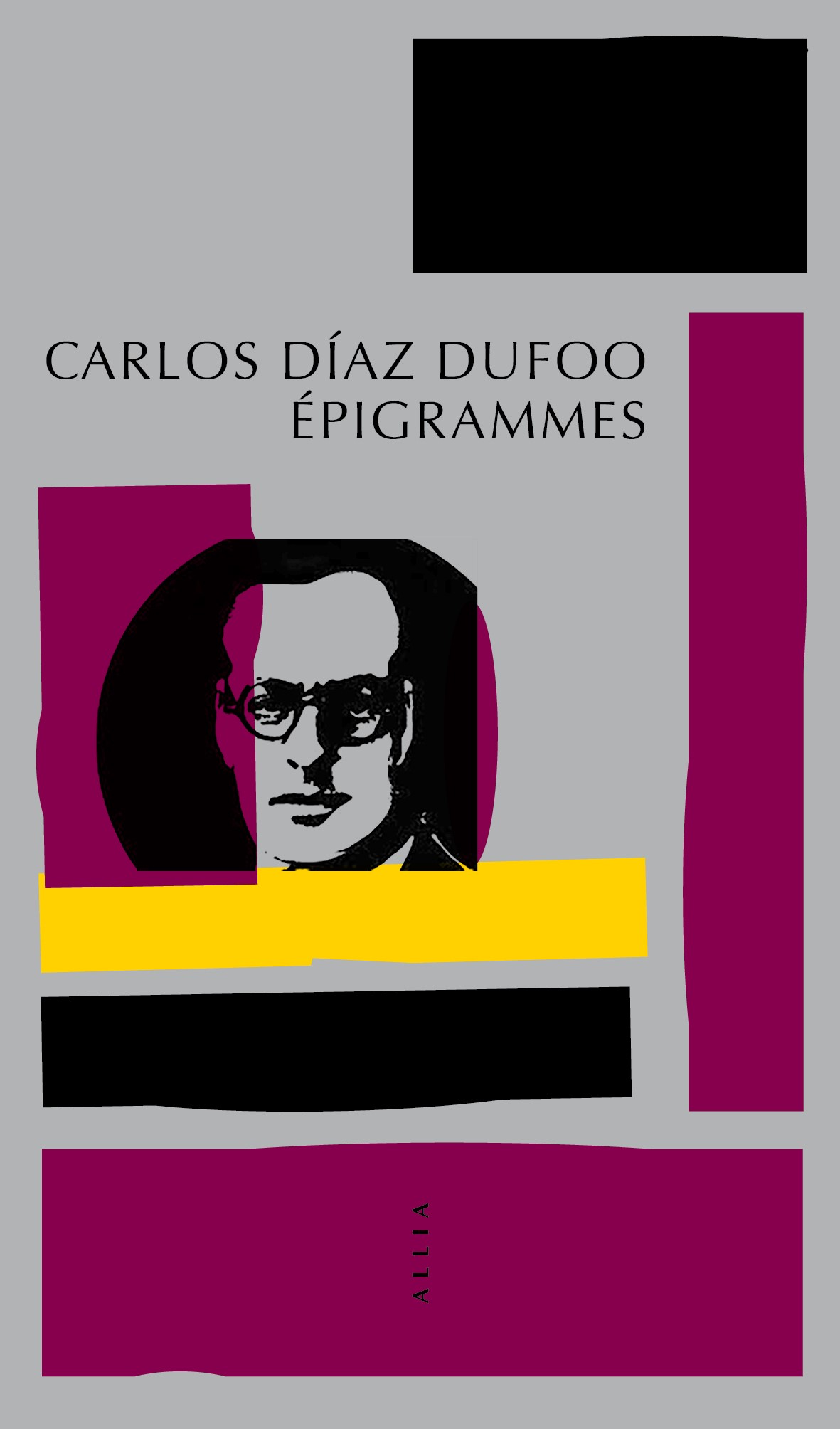
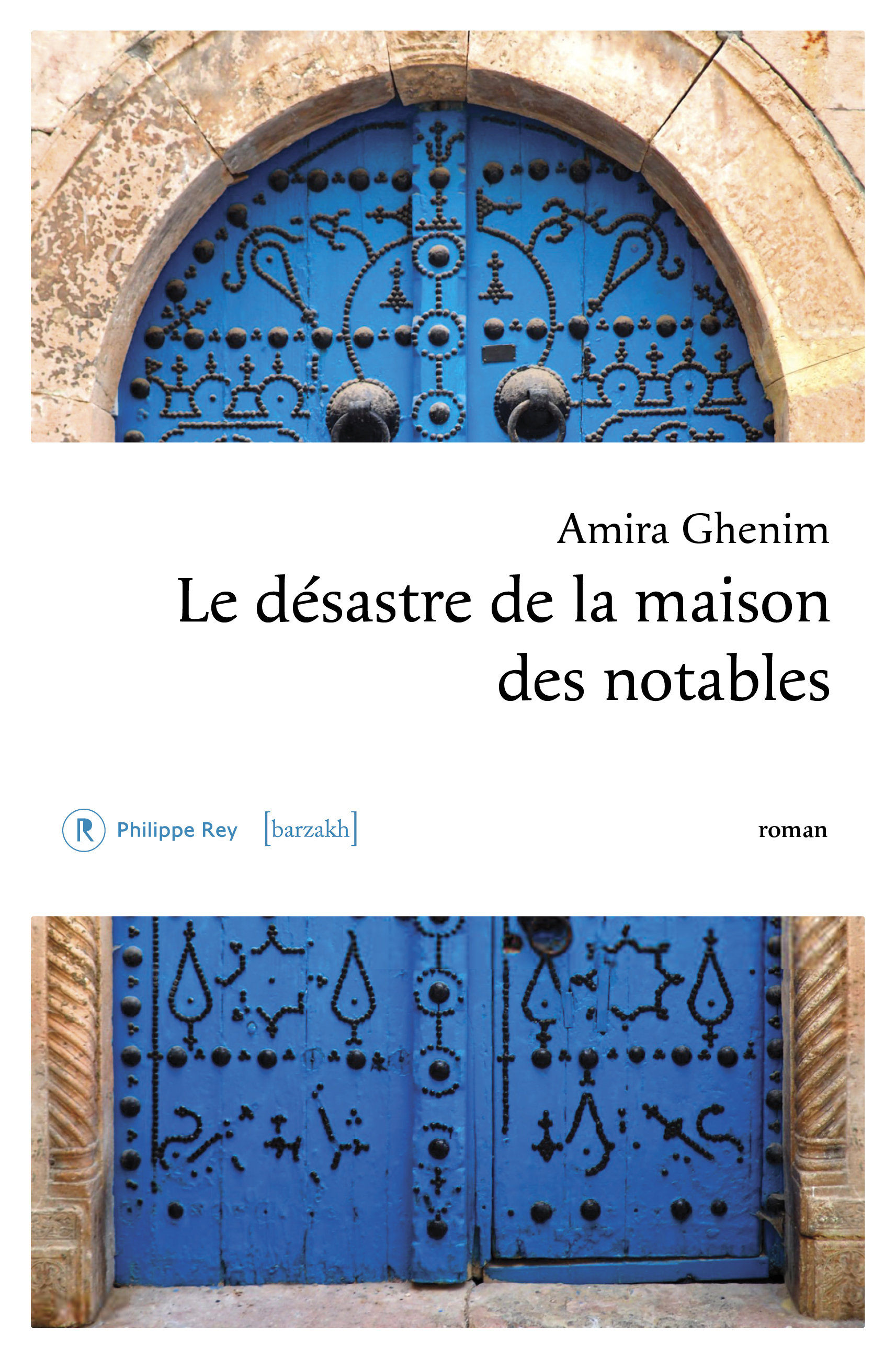
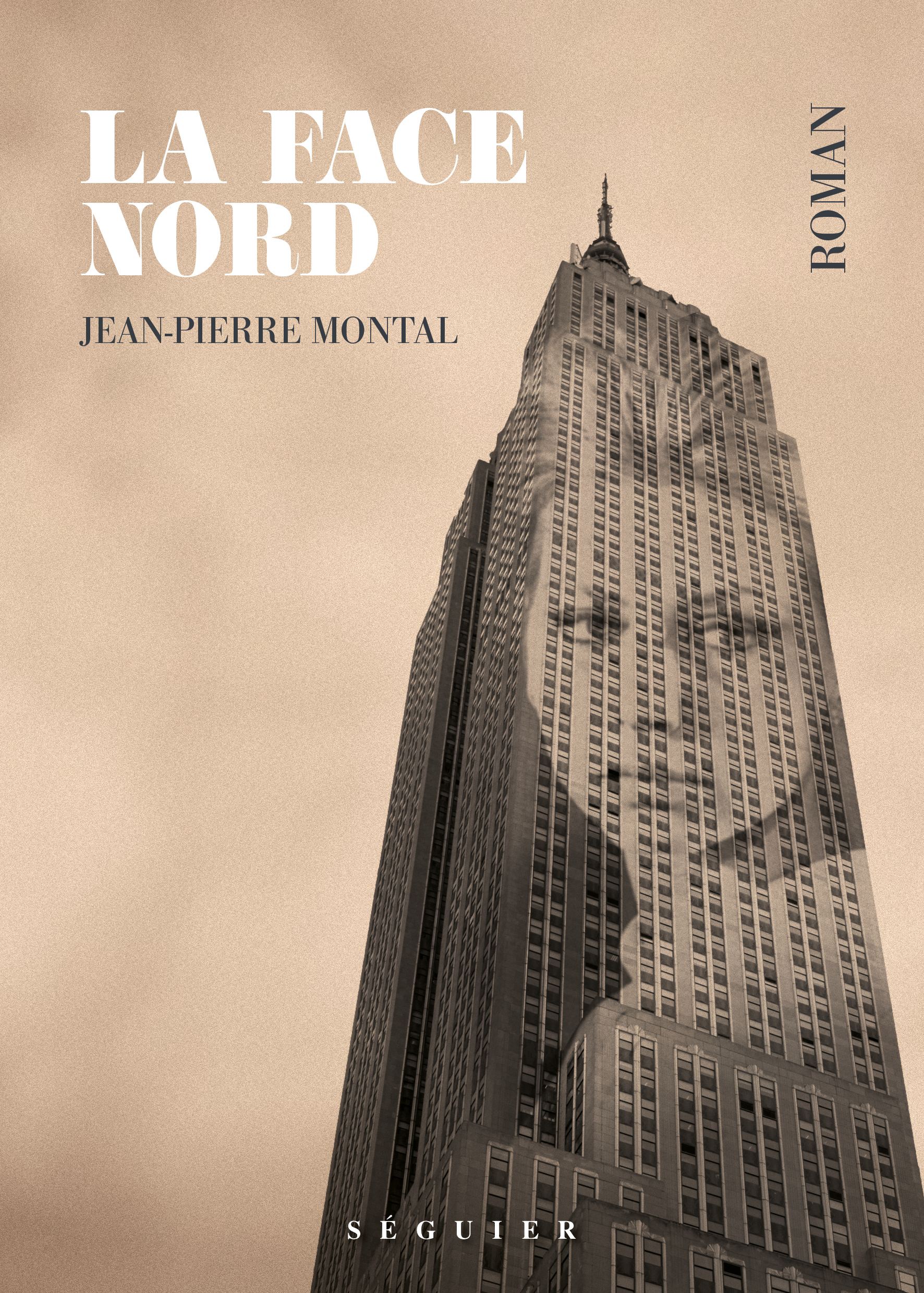
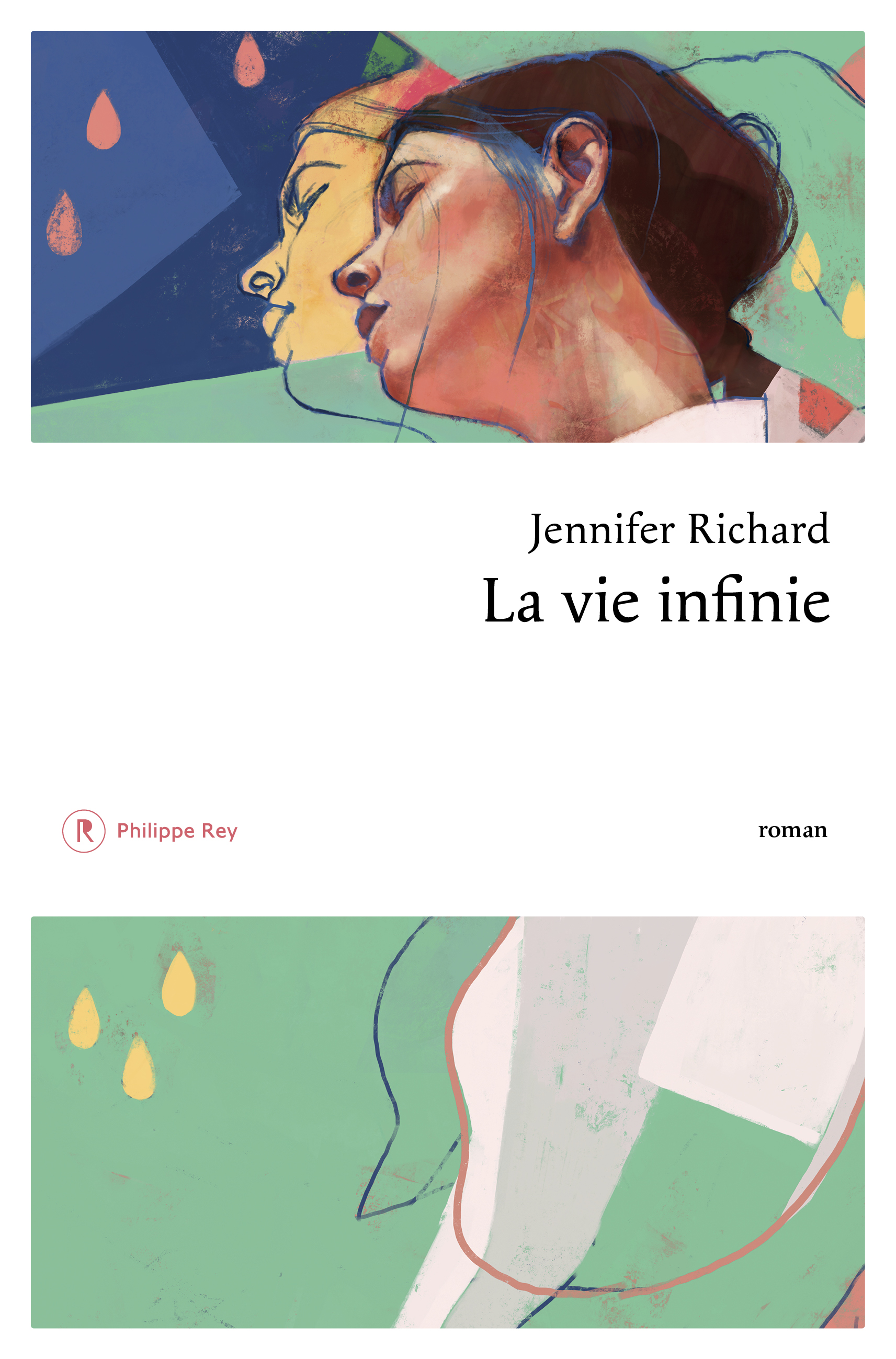
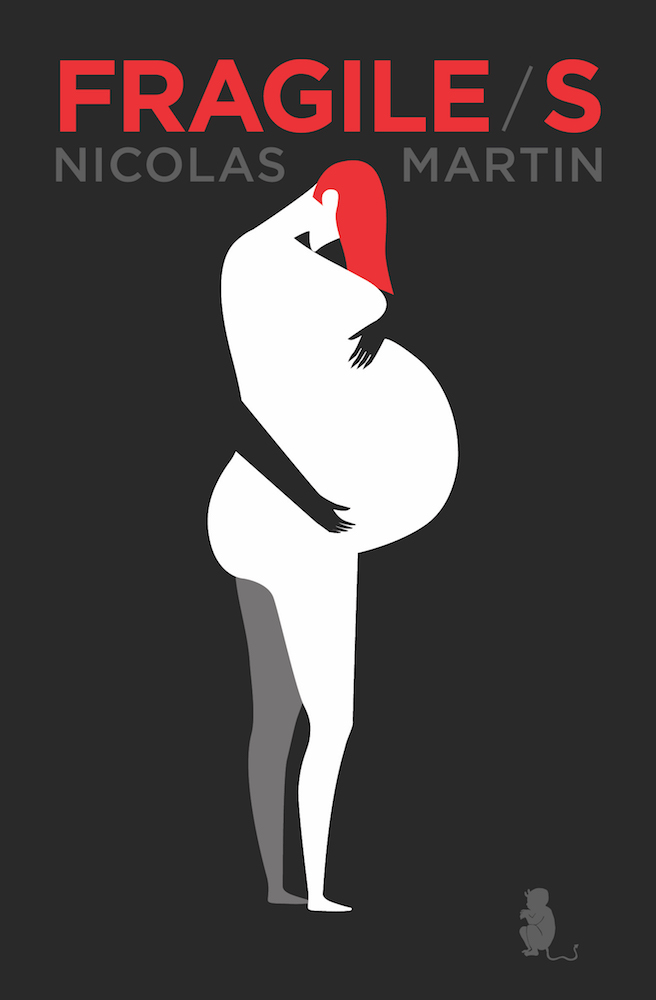

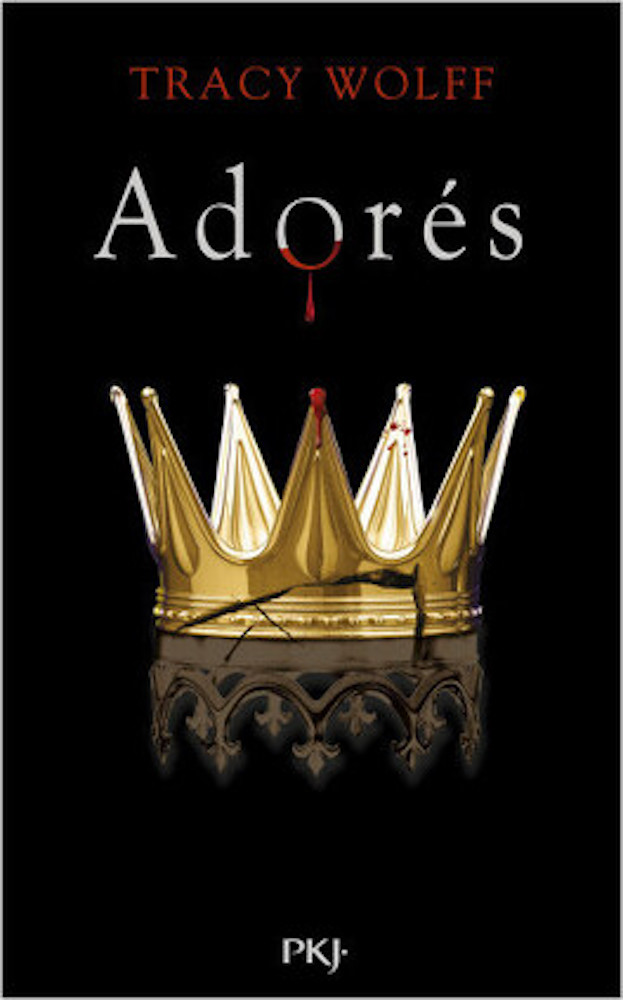
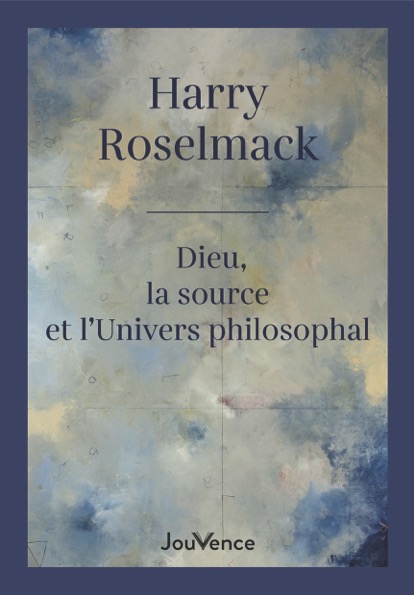
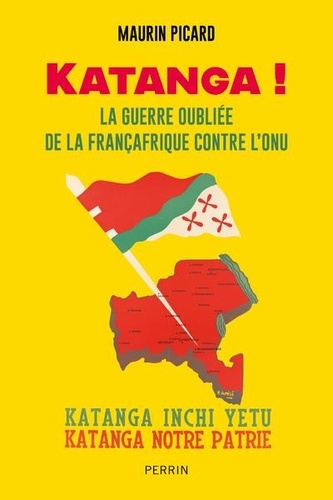
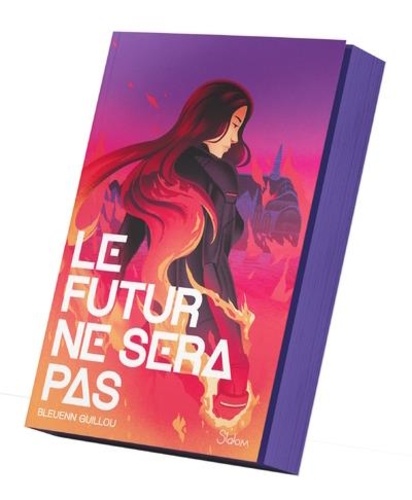
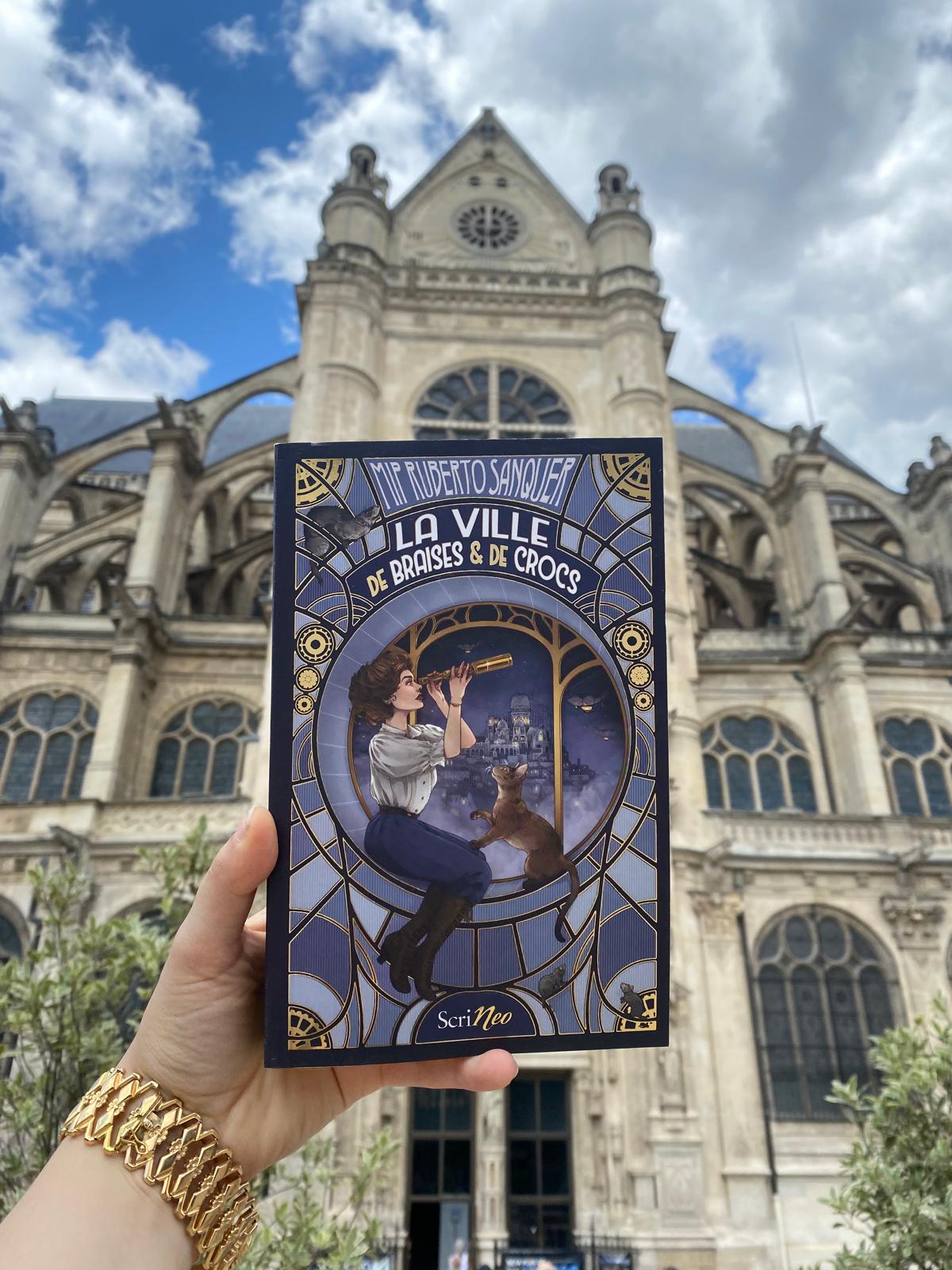
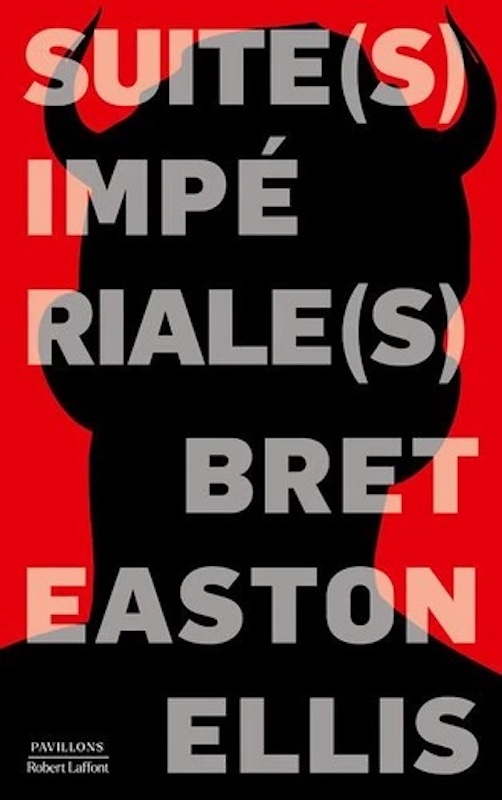


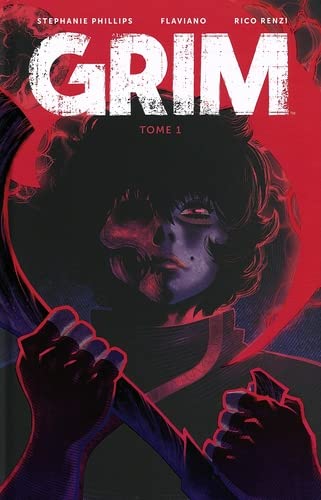
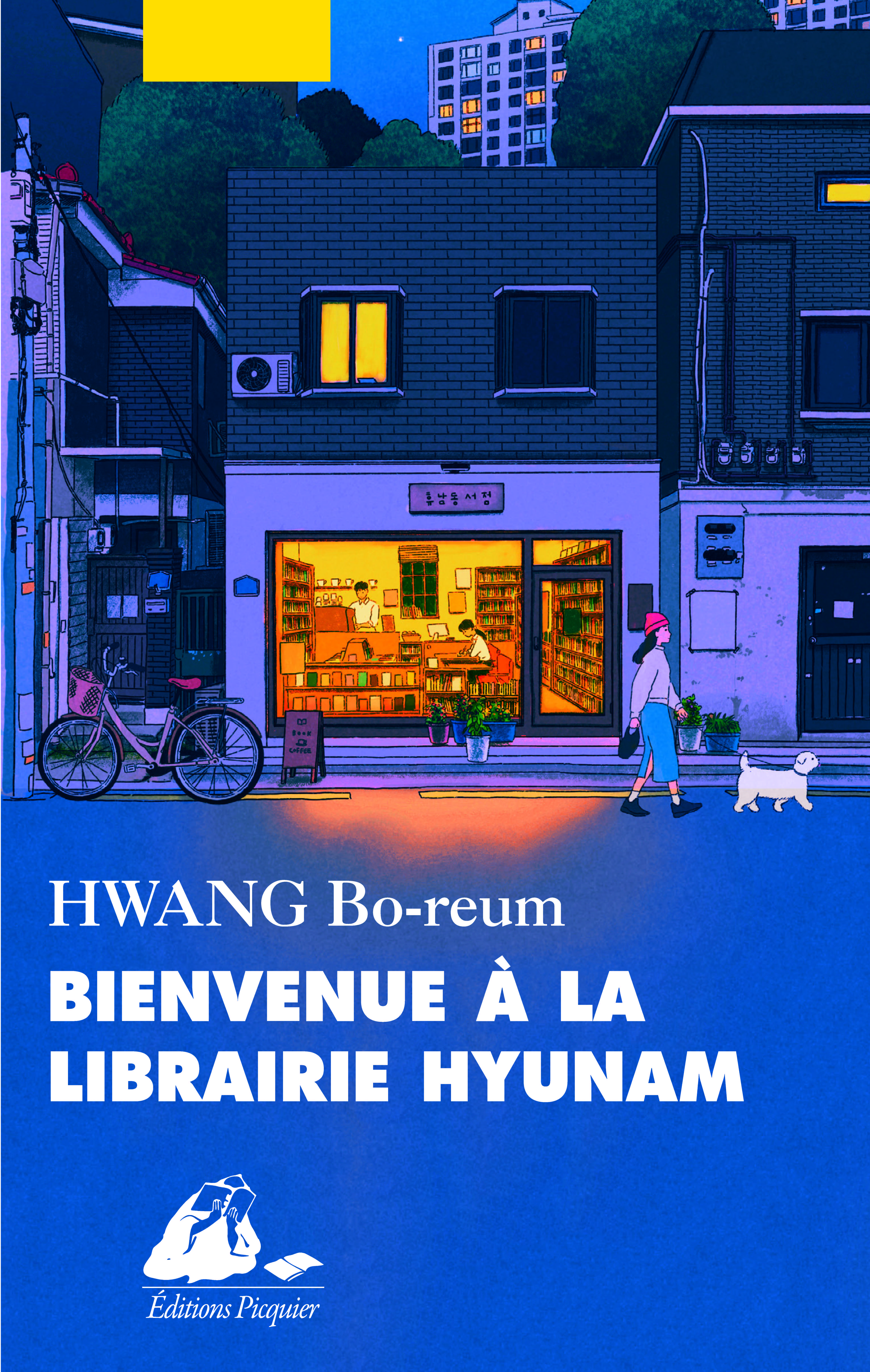
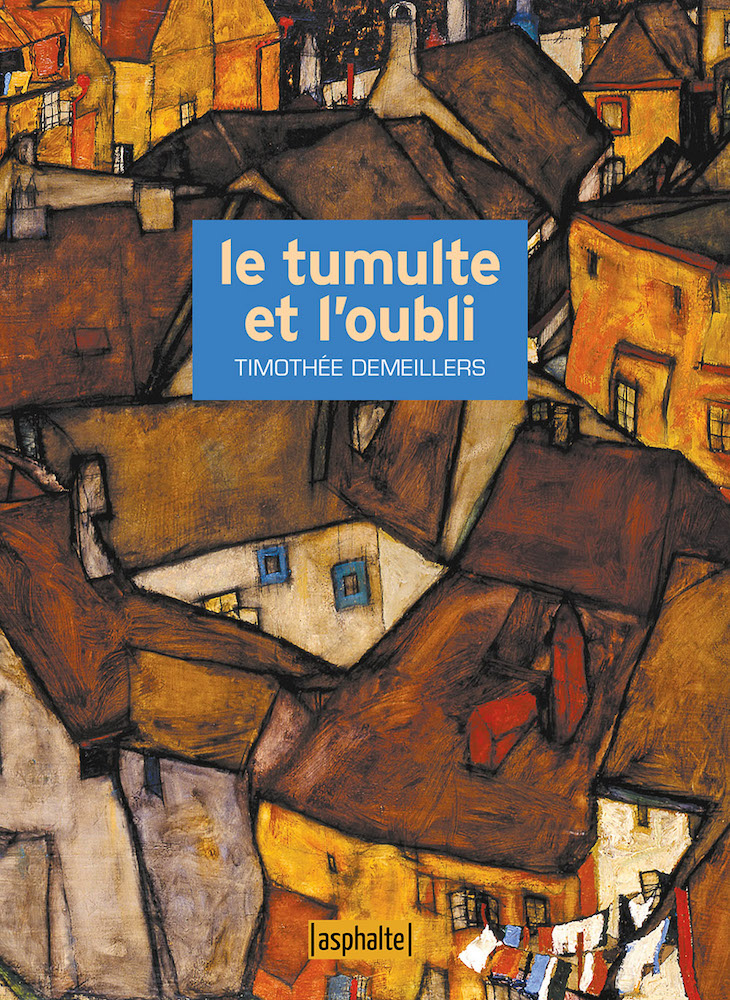
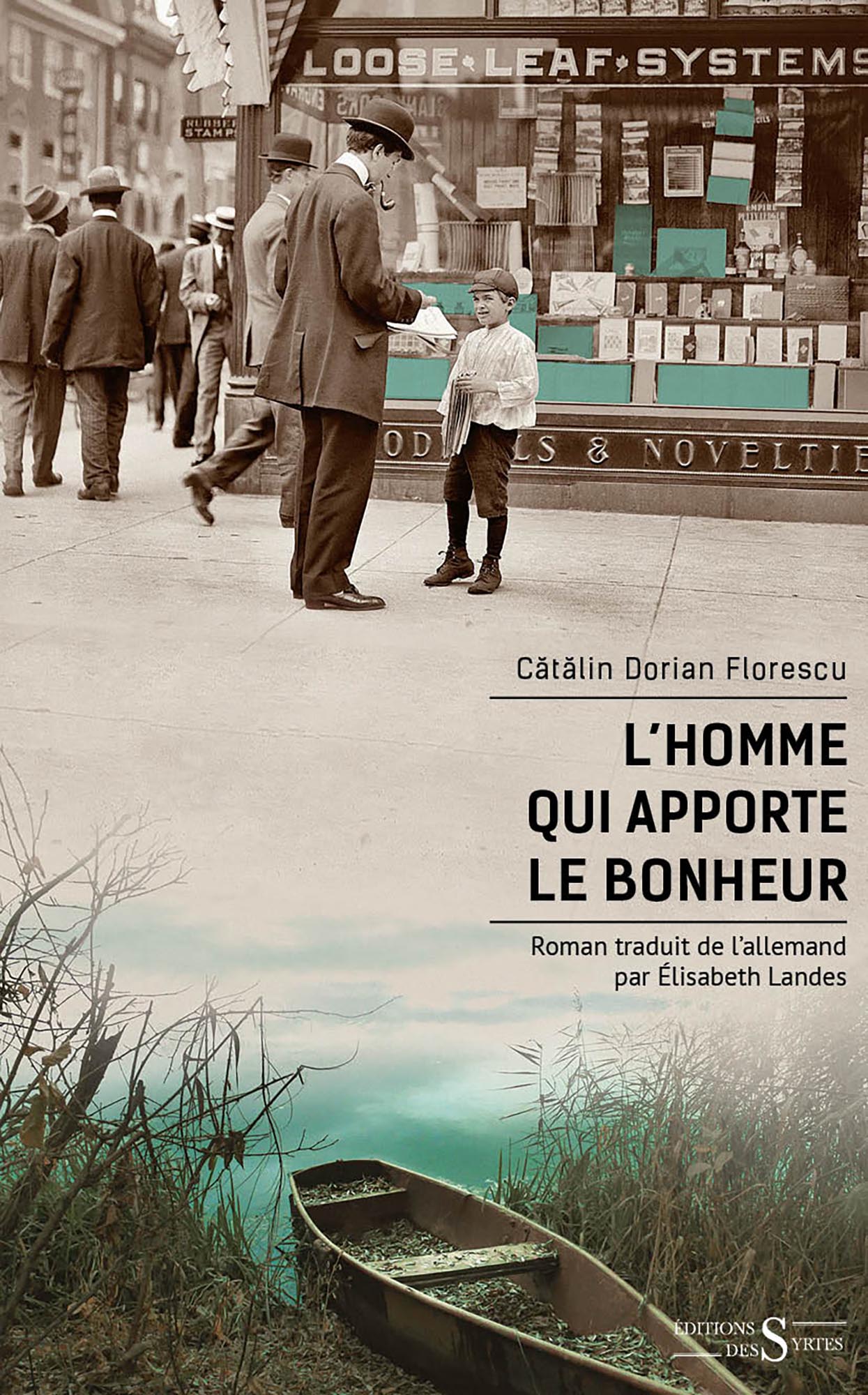
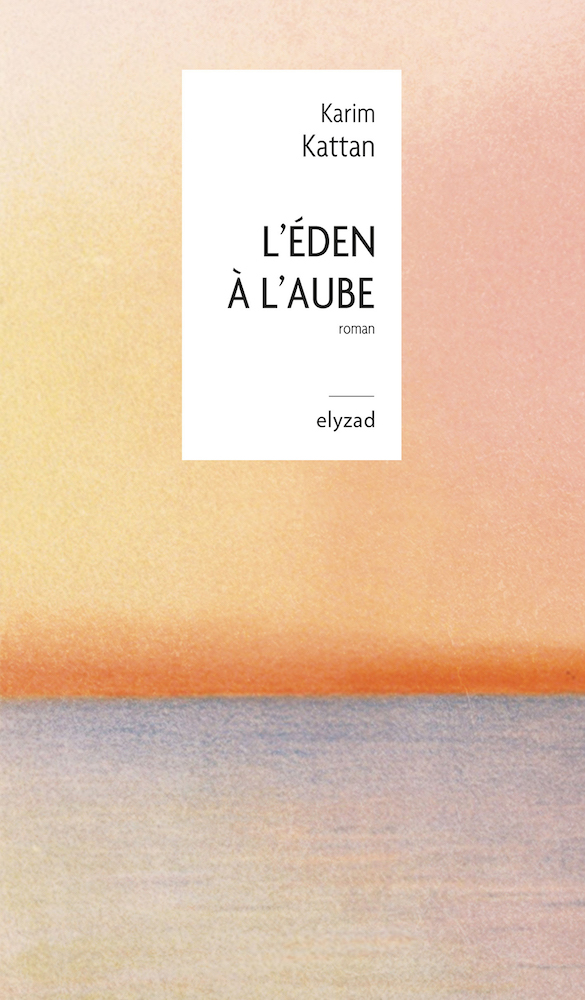
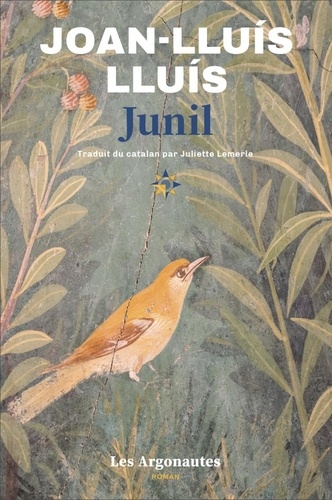
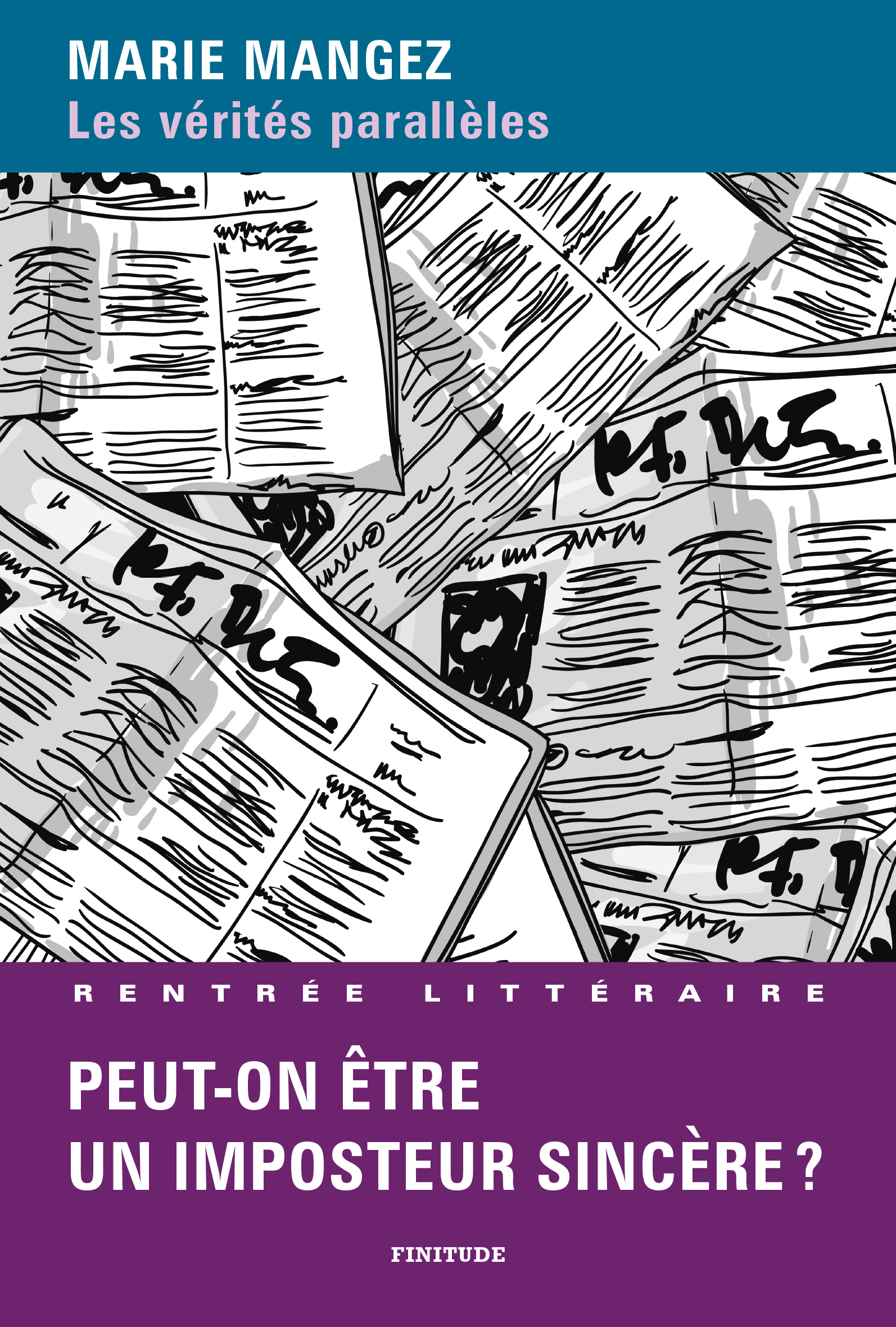
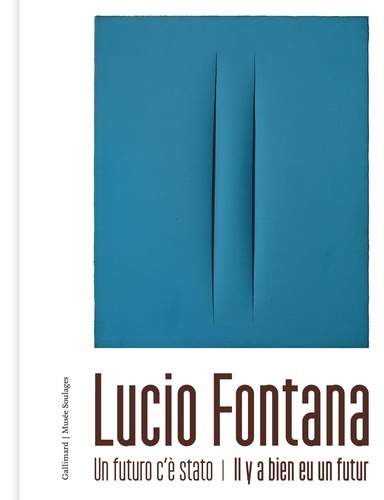

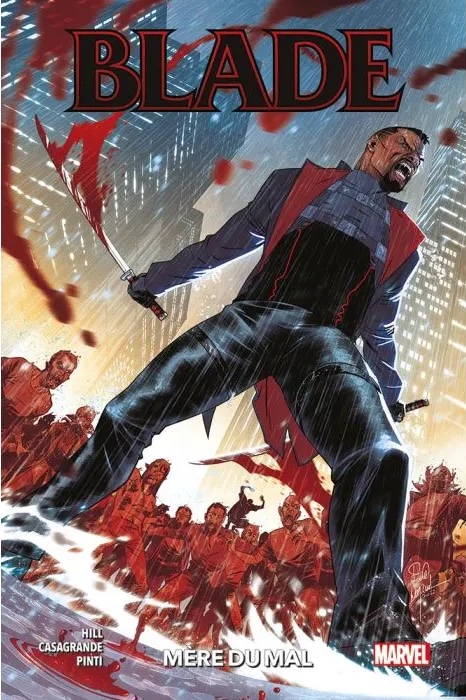
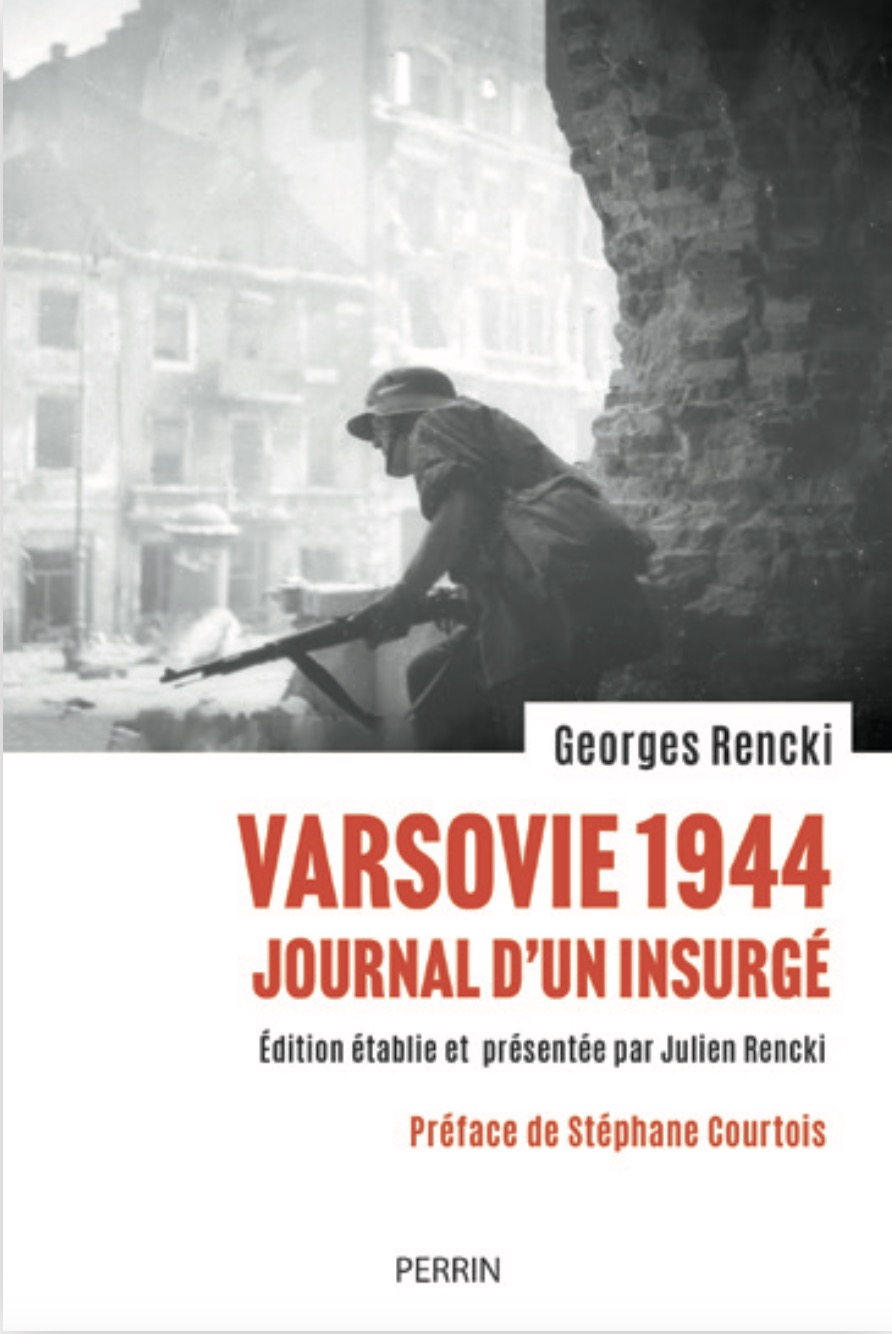
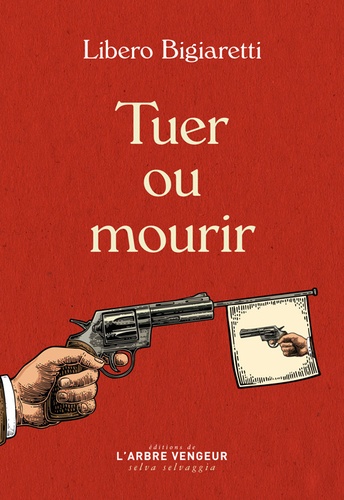
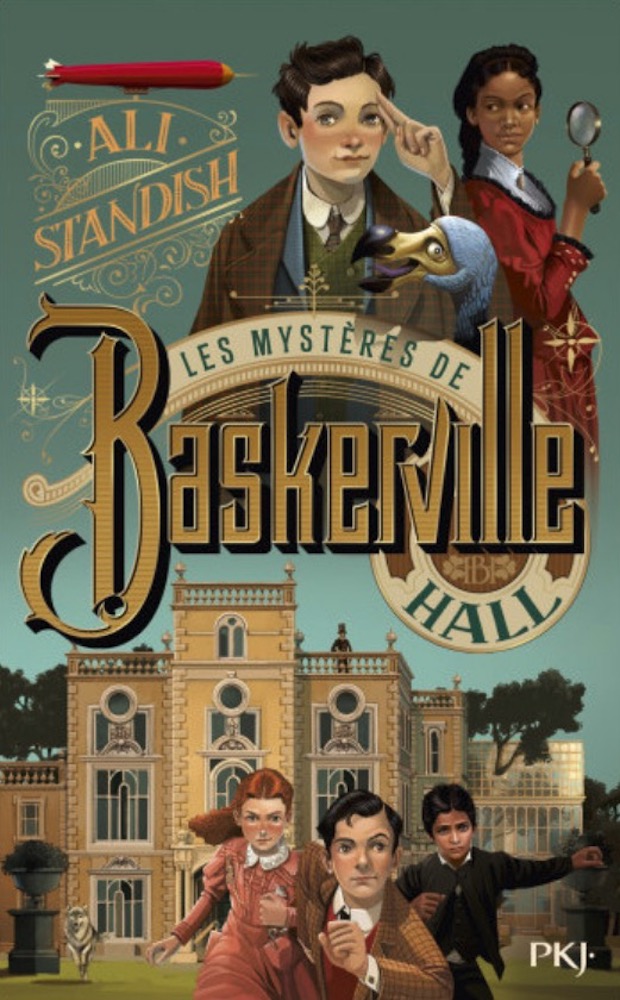
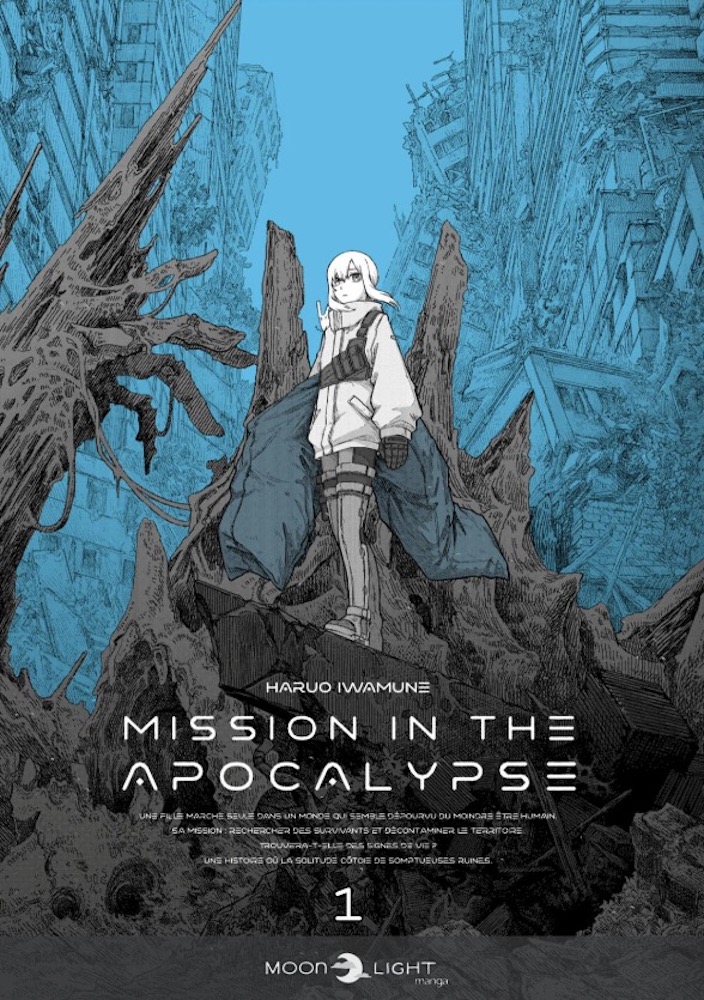
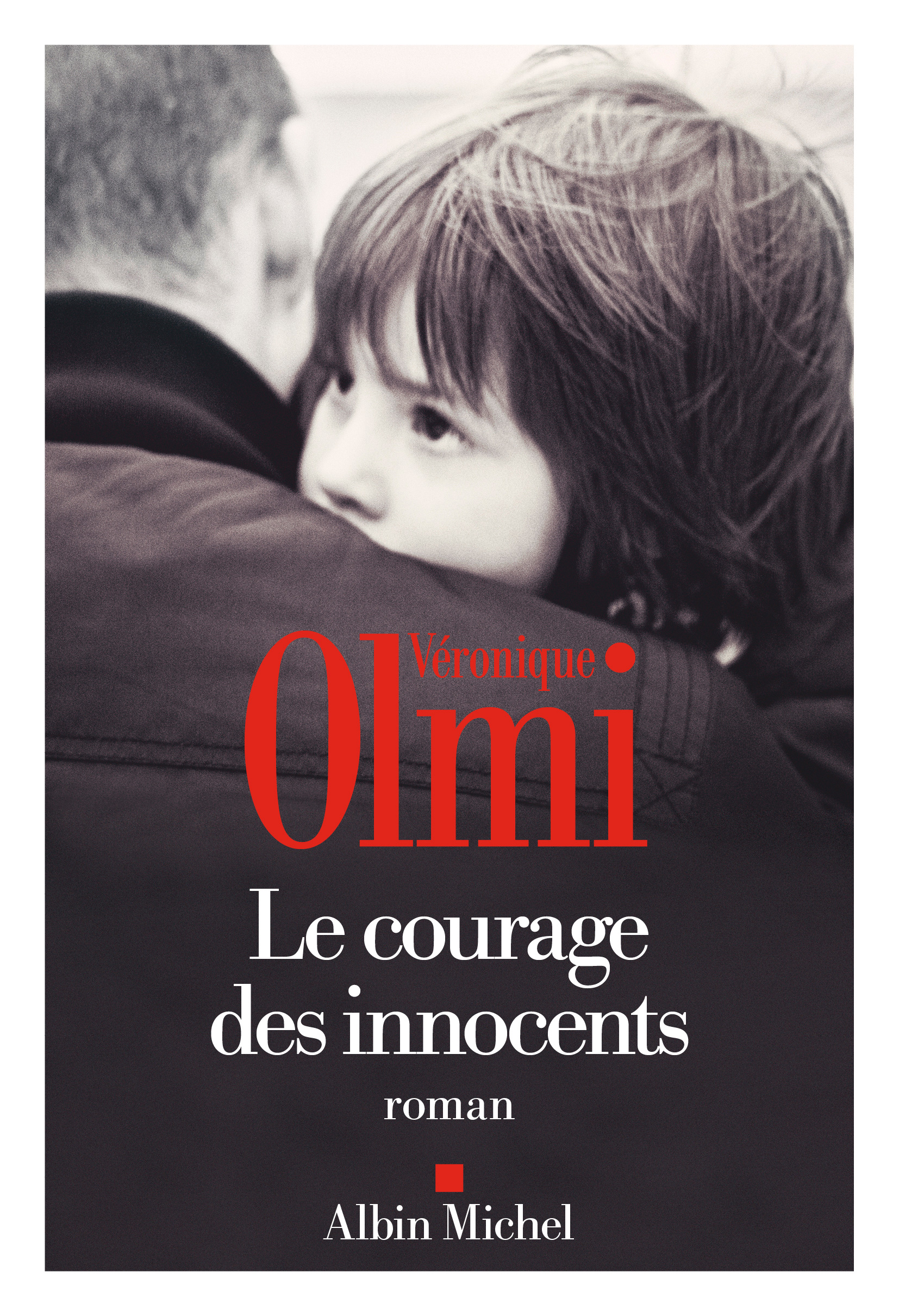
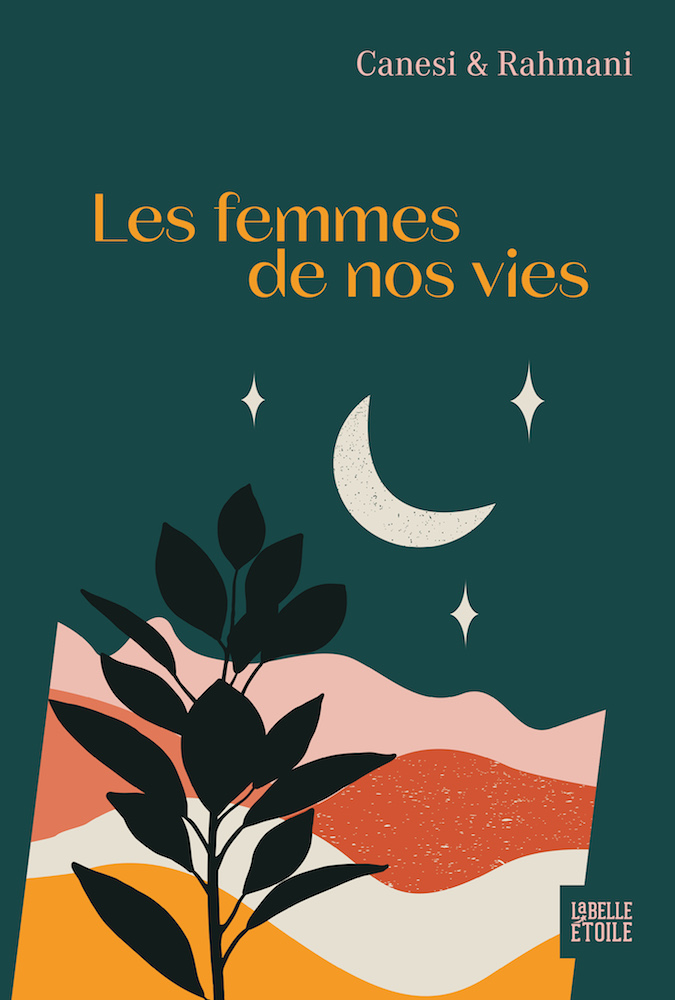
Commenter cet article