Les Ensablés – “Souvenirs d’un vieux Romain” de Pierre de Nolhac
Chers lecteurs des Ensablés, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'Antoine Cardinale nous livrera désormais régulièrement ses chroniques sur les historiens d'art oubliés du vingtième siècle, dont la qualité des contributions remarquables ont été à la fois historiques et littéraires. Il a bien voulu nous envoyer ce petit texte d'introduction qui nous explique ses intentions:
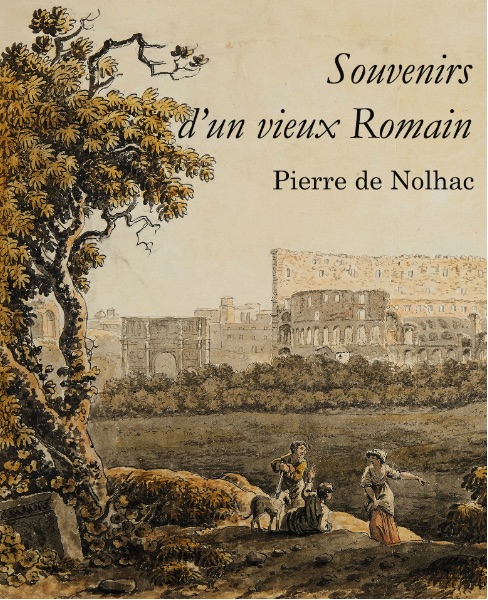
« Que le public considère la qualité du sujet et la pureté de mon intention, qui ne fut pas de chercher la gloire de l’écrivain, mais de célébrer le génie et de raviver le souvenir [de ceux dont] les noms et les œuvres ne méritaient pas d’être, comme ils l’étaient, engloutis par la mort et l’oubli »b (Giorgio Vasari 1550).
Les historiens d’art ont toujours éprouvé une difficulté certaine à trouver leur place : leur sensibilité, si naturelle lorsque l’objet ressort de la création artistique ne trouve pas grâce aux yeux du positivisme scientifique ; les partisans de l’histoire sociale vomissent leur esthétisme ; les artistes eux-mêmes ont toujours vu avec méfiance les historiens entrer dans leurs ateliers.
Antoine Cardinale s’efforcera à sa manière de rester dans la ligne de l’auteur des Vies : « les noms et les œuvres » des figures qu’il évoquera sont ceux de savants, de connoisseurs et d’écrivains. On espère que Les Ensablés leur seront un havre et qu’enfin, Vasari et sa descendance auront trouvé leur public.
Les Ensablés – « Souvenirs d’un vieux Romain » (1922) de Pierre de Nolhac (1859-1936), par Antoine Cardinale
Je tiens entre les mains « Souvenirs d’un vieux Romain » de Pierre de Nolhac, dans l’édition originale de 1922. Cet exemplaire est dédicacé par l’auteur à Henri Bordeaux et cette dédicace évoque un ami commun [pour Henry Bordeaux / qui y retrouvera Maurice Faucon], dont nous reparlerons je l’espère ensemble, un jour. Le livre n’est pas coupé, dont il faut conclure et déplorer que personne ne l’a ouvert ni lu. Je vous propose d’en couper les pages ensemble : celui qui révolutionna Versailles redonne vie pour nous à un jeune homme dont « la jeunesse est là-bas, près du Tibre latin », et par là, à la parenté italienne de l’art français.
« Laissez en paix ce musée ! »
Le jeune homme qui revient d’Italie en 1887 après y avoir passé neuf années se présente à Paris au concours du Cabinet des Estampes. Il y est fort mal préparé, étant plus versé dans l’humanisme de la Renaissance italienne que dans les procédés de la gravure : il échoue. Il doit trouver une situation : un poste se libère à Versailles et un ami lui glisse : « C’est fort peu payé, mais on est logé et l’air est bon ! ». Il se décide pour cette sinécure dirigée par un conservateur qui n’entend rien changer et ne surtout pas réveiller ce château et l’avertit sèchement : « Ecrivez des livres si cela vous amuse mais laissez en paix ce musée qui n’intéresse personne.Je n’ignore pas les richesses que nous avons ; mais il n’est aucun moyen de les mettre en valeur ; croyez-moi, n’en ébruitons pas l’existence ! ».
Il ne prêtera attention ni aux nonchalants conseils de l’un, ni aux ordres de l’autre.
On écarquille les yeux en lisant ce qu’était alors le palais des rois de France . Emile Zola en fit la visite en 1874 et prédit avec jubilation que « le château croulera dans un dernier hoquet du vent » . Et en effet ce n’est alors plus rien qu’une immense bâtisse à l’abandon, dépouillée depuis longtemps de son mobilier, de ses tableaux même, au milieu d’un parc que la nature reprend à l’art.
Dans les attiques, glacés en hiver, brûlants l’été, pourrissent les Nattier et les Largillière ; les grands tableaux de Van der Meulen, déplacés, ont été élargis par d’immenses ciels hideux ; outils et sacs de plâtre s’entassent dans ce qui fut les bains de Louis XV, sa merveille de cheminée de marbre rouge et ses bas-reliefs ; près du Grand Canal le grand bateau ponté de Marie-Antoinette pourrit dans un hangar ; dans un entrepôt que l’administration ne sait plus situer, s’abiment les grandes statues de Girardon et Coysevox ; ultime avanie, le conservateur Charles Gosselin, ne peut empêcher le Louvre de s’emparer du Couronnement à Notre-Dame de David.
Une Société départementale des amis des Arts a pris possession des appartements du Dauphin ; au rez-de-chaussée on a improvisé un temple protestant, juste revanche sans doute de l’abolition de l’Edit de Nantes ! Un colonel occupe les petits appartements de Louis XV et dans sa salle à manger aux délicats vernis Martin graillone et fume un vilain fourneau en fonte ; un autre s’est annexé la bibliothèque de Mme du Barry ; cent fonctionnaires, petits et grands, habitent au palais –il est si agréable de jouir d’un logement chez le Roi ! - en confient les clés à des amis, et s’y créent même à l’occasion de commodes garçonnières, ce qui donne lieu à des scènes de boulevard, les conservateurs croisant parfois au détour d’un couloir de jeunes et jolies personnes peu accordées au décor.
Aussi extraordinaire que cela paraisse, simple « Bâtiment civil », le Château n’est pas classé comme un Monument historique : c’est un palais de la République, qui ne sert que tous les sept ans, lorsque le Congrès se réunit pour élire le président de la République ; le parc sert de récréation municipale aux habitants de Versailles et accessoirement, le château abrite le musée que Louis-Philippe a créé en l’honneur des grandes figures de l’Histoire de France.
Le tournant du destin a lieu en 1891 : l’impératrice d’Allemagne souhaite visiter le Château. La République, née de la défaite de 1870, ne saurait lui faire l’honneur d’une visite officielle mais ne peut non plus s’offrir le luxe d’un affront diplomatique. L’impératrice ne saurait prendre le temps d’un conservateur, on daigne affecter un jeune attaché à sa visite : ce sera le jeune Pierre de Nolhac ; il se tire de ce piège avec brio et tact, ravissant l’impératrice par sa déférence et son savoir, transformant ainsi le cauchemar diplomatique en triomphe républicain.
En sachant ne pas compromettre le gouvernement tout en lui en faisant revenir le mérite politique, son nom, dès l’année suivante, en 1892, est marqué pour un avancement fulgurant au poste de conservateur en chef. Dans ce coup d’éclat, il signale les qualités qui feront de lui pour près de quarante ans, le « gouverneur de Versailles » : sens des relations publiques, habileté politique conjuguée à une passion pour l’art des dix-septième et dix-huitième siècles et une conception intransigeante de la conservation. Il va mettre tous ces dons au service de l’ambition immense de projeter le château dans ce vingtième siècle qui s’annonce.
Le gouverneur de Versailles
Pierre de Nolhac va se donner corps et âme à cette tâche : restituer au Château ses décors, son mobilier, ses jardins. Il faut pour cela rassembler des budgets administratifs, mobiliser les donateurs et à ces fins mobiliser l’opinion.
Pour commencer, il faut amadouer des ministres rendus nerveux par cette réhabilitation du palais des rois de France, il crée donc une salle de la Révolution où il fait accrocher le Marat de David et la Fête de la Fédération de Hubert Robert. Pour rallier le public américain et ses riches donateurs il procède à l’identique et ouvre une salle de l’Indépendance américaine autour des statues de Washington et du marquis de Lafayette par Houdon.
C’est une époque héroïque qui lui permet au prix de combats incessants contre la paresse administrative, les méfiances politiques et les perpétuelles controverses de rendre son éclat –et pour tout dire sa gloire- au Château. Comme il l’a souligné lui-même, les archives royales sont abondantes et laissent peu de zones d’ombres sur les architectures, les aménagements, les décors même ; pour bien faire il suffisait d’aller puiser à la source ce que ni les conservateurs précédents, ni les historiens eux-mêmes n’avaient daigné faire : Versailles avant de Nolhac avait dû se contenter de vivre à travers les erreurs de Dussieux -desquels ouvrages Pierre de Nolhac déclare avec sévérité que « rien n’y manque, sauf l’exactitude »-ou celles plus raffinées des Goncourt d’une part et les élucubrations et les légendes de Jules Michelet d’autre part.
Cette « reprise de Versailles sur le sentiment français » -comme l’évoquera Maurice de Régnier dans la Cité des Eaux, lequel compte avec Maurice Samain, la comtesse de Noailles et Montesquiou, parmi les grands auxiliaires littéraires de cette vogue- , Pierre de Nolhac en conduisit obstinément la vogue, persuadant au Faubourg Saint-Germain de consentir à partager avec la République l’éclat de cette résurrection, apprenant aux politiciens combien Versailles ajoutait à la gloire du « régime populaire ». La visite du tsar et de la tsarine en 1896 laissa à cet égard une trace profonde : en passant leur soirée dans les appartements même où, cent ans auparavant, la famille de France écouta la menace de l’émeute, il sembla qu’une faute avait été lavée et que du passé sanglant et triste renaissaient, fortes et joyeuses, Versailles et la patrie française.
Toutes les têtes couronnées d’Europe tenaient, par quelque ancêtre, à la famille royale. Dans le sillage du tsar, ils se pressent tous à Versailles. Pierre de Nolhac les y accueille, en fait publier dans les journaux les comptes-rendus et les bonnes histoires.
La reine d’Italie est éblouie par sa visite, promet « quelque chose » et rend généreusement un chef d’œuvre, le portrait de la duchesse de Bourgogne ; pour ne pas être en reste l’archiduc d’Autriche fait envoyer de magnifiques dessins tirés de l’Albertine ; Guillaume II lui-même fait rechercher dans ses châteaux et restituer les meubles portant l’étiquette « Cabinet de la Reine à Versailles » ; les familles royales d’Angleterre et d’Espagne bien sûr ; le roi Ferdinand de Bulgarie, qui rêva de ceindre la tiare impériale de Byzance ; et le plus savant d’entre tous, le grand-duc Nicolas Michaïlovitch ; la princesse Mathilde et l’impératrice Eugénie ; le vieux duc d’Aumale quant à lui aime à contempler dans le salon des Batailles le tableau d’Horace Vernet dans lequel un jeune capitaine, qui lui ressemble assez, emporte à la tête de ses chasseurs d’Afrique la smala d’Abd-el-Kader.
Tous se piquent de reconnaître les lieux, sur la foi de traditions de famille ou de souvenirs lointains : le conservateur laisse dire et ne rectifie rien : il faut se garder de reprendre aux Grands la possession de l’Histoire. C’est l’époque où selon le mot d’Anatole France, jamais les savants ne furent plus aimables.
Toujours occupé mais exact, satisfaisant à toutes les obligations mais ordonné et précis dans son service, Pierre de Nolhac, sans déroger aux traditions de compétence et d’indépendance de son corps, su avec intelligence céder au plaisir d’être recherché : les modes qu’il lance, les grands personnages qu’il accueille, les fêtes auxquelles le Tout-Paris se presse, obéissent à une seule et obsessionnelle idée : sauver Versailles.
Il sut faire, sinon le « métier de l’Etat », en tout cas ce métier dans l’Etat, en tirer le parti le meilleur, et durer.
Il faut une fin et c’est l’Histoire qui se charge de la mise en scène. Le 28 juin 1919, Pierre de Nolhac conduit les délégués allemands à la signature du traité de paix. Les gardes républicains, sabre au clair pour rendre les honneurs aux déléguées des nations amies, ont reçu l’ordre de remettre au fourreau au passage des vaincus. « Je n’oublierai jamais l’ordre donné à notre approche et répété de salle en salle à mesure que nous avancions et le bruit que fait l’acier en rentrant au fourreau ».
Six mois après ce moment de gloire et d’humiliation qui contenait toutes les menaces de l’avenir, Pierre de Nolhac cédait sa place de conservateur à André Pératé.
Les Regrets
Son œuvre à Versailles fut essentielle ; mais il lui fallut, pour la mener à bien, avant toute chose se créer une compréhension approfondie de l’œuvre que fut Versailles : il lui fut indispensable pour cela de reprendre le fil de l’art français depuis que Léonard, maître Roux, le Primatice et jusqu’au Bernin en personne firent connaître le miracle italien. Il lui fallut surmonter la mode, qui avec Ruskin interdisait de rien considérer au-delà de la mort de Raphael ; surmonter surtout l’enseignement officiel qui flétrissait l’école française du dix-septième siècle sous le nom d’académisme.
Car c’est dans ces dispositions d’esprit, c’est prisonnier de ces préjugés de mode et de formation que le jeune conservateur aborde le sujet devant Puvis de Chavannes. Le grand peintre laisse sévèrement tomber : « C’est un bien grand tort. Vous vivez parmi les chefs d’œuvre de l’art français et vous refusez de les connaître. Regardez-les et tachez de les comprendre ».
Mais comment le pouvait-il ? « Mon ignorance de l’art français était extrême. Quand l’écolier de province rencontrait Le Brun, Mansart, Girardon dans une page de Voltaire, ces noms ne lui disaient rien alors que toutes les figures du grand siècle étaient pour lui familières et respectées. On pouvait passer ses examens secondaires sans connaître le nom d’un artiste. Notre formation était de première main mais tendait à nous rendre dédaigneux de l’art de notre pays ».
Cet art français, si proche de la sophistication italienne et cependant plus juvénile, est plus juste dans l’élégance : d’une netteté remarquable d’exécution, pour reprendre l’expression de Walter Pater, plus adapté peut-être à l’art décoratif. Cet art français, en son inspiration italienne, qui était mieux placé que le jeune érudit qui passa neuf ans à la Vaticane pour en démêler le sens ?
Comment comprendre Lemoyne, Le Sueur, Le Brun bien sûr ; comment juger de l’émancipation de l’art français à partir de Watteau, comment en mesurer la tendance vers l’Antique qui fait de Boucher une parenthèse charmante, entre Lemoyne à David, mais une parenthèse qui ne résume pas l’art français du dix-huitième siècle ; comment sentir, concevoir et formuler ces vérités sans avoir à l’esprit les chefs d’œuvre de l’Italie ? Comment, en un mot ignorer les trésors de Rome, Florence et Naples quand il faut se pencher sur l’ambition de ceux, sculpteurs, doreurs, architectes et maîtres- maçons, peintres, ferronniers, fontainiers, qui voulurent « ravir à l’Italie le sceptre des arts ».
Car comme le souligne Voltaire, si le siècle de Louis XIV fut entre tous les âges d’or, celui qui approcha le plus de la perfection, c’est que ce temps-là naquit « au temps de la gloire de l’Italie », temps dans lequel, ajoute Voltaire, « tout tendait à la perfection ». Et c’est aussi un tout que Versailles, une oeuvre d’art totale dans laquelle Pierre de Nolhac, dont l’ex-libris porte à la fois les images de Versailles, vu des jardins et de Saint Pierre, vue de la colonnade, sut repérer tous les échos des Muses italiennes. Les eaux de la villa d’Este renvoient aux cent fontaines du parc, le chef d’oeuvre de Le Nôtre aux jardins du Palatin, le peuple de statues du parc à celui des jardins Boboli.
Laissons la parole à Pierre de Nolhac pour évoquer ce qui devint pour lui la passerelle entre France et Italie : « …pour remplacer une habitation… il voulut créer pour la génération suivante un type plus grandiose encore et d’un art plus somptueux. Des achats successifs étendent d’abord les propriétés….annonçant à cette région déshéritée qu’elle va être dotée d’une merveille «.
Parle-t-il ici du palais que Louis XIV tira de ce château dont « un simple gentilhomme ne voudrait pas tirer vanité » comme le disait Bassompierre en 1627 ? Non pas : mais le Palais Farnese, dont il nous faut maintenant parler.
Car c’est cette merveille qu’évoque de Nolhac : le palais Farnese, car je n’ai nul doute qu’il en sentit, le temps venu, le rapport profond avec Versailles, les deux palais étant l’image, non abstraite, languissante ou fade l’un de l’autre, mais comme une réflexion vivante. Il ne faut certes pas faire du palais Farnese la préface du Grand Livre de l’art français.
Mais Pierre de Nolhac réalisa combien le Grand Siècle et le projet de Versailles empruntèrent à ce programme : une demeure immense et magnifique dressé au milieu de ses jardins, qu’on devra au choix des meilleurs architectes, rempli de ce que l’art de son temps pouvait donner de plus sublime. A l’imitation des papes qui de Paul III à Urbain VIII, pendant un siècle et jusqu’au milieu du dix-septième siècle, voulurent remettre Rome au cœur du monde par l’éclat des arts –rappelons que le chantier de Versailles commence en 1661- , à leur imitation Louis XIV poursuivit un plan identique, en l’amplifiant de façon inouïe et en le concentrant sur cinquante ans.
Certes le chantier du palais Farnese débute tôt dans le seizième siècle, mais l’achèvement définitif date de 1589 –l’inscription sur la loggia haute, tournée vers le fleuve, ne nous le laisse pas ignorer- et la décoration intérieure, la galerie, chef-d’œuvre des Carrache, n’est achevé qu’en 1608.
Et combien ce palais est proche de la France : avant d’en devenir l’ambassade, ce qu’elle est encore aujourd’hui, le cardinal Alexandre Farnese y accueillit somptueusement le cardinal Jean du Bellay, qui était accompagné de son cousin Joachim ; le second étage abritait le bibliothécaire des Farnese, ce fameux Fulvio Orsini, auquel de Nolhac consacra de passionnants travaux . Le vieux conservateur de Versailles donne les plus belles pages de ses Souvenirs au palais où il fréquenta au temps de sa jeunesse romaine : il réussit à mêler dans un modèle de prose une sensible évocation personnelle et une vibrante reconstitution historique. Il fallait en passer par la fabuleuse collection Farnese, apprendre de l’art des Carrache, et méditer sur l’architecture du palais dont Michel-Ange apporta à Paul III le dessin, avant de pouvoir comprendre le projet démesuré du Roi Soleil.
Car si Rome fut le lieu de la révélation et de la connaissance, Pierre de Nolhac en évoque aussi de plus personnels souvenirs, des souvenirs pleins de reconnaissance : Tièdes soleils, langueurs des printemps d’Italie ! / C’est vers vos souvenirs que le cœur se replie / Doux mois qui remplissiez notre jeune chemin , vers charmants qui font écho à la dédicace des Souvenirs : COMMUNI PATRIAE/HOSTES GRATVS/ET MEMOR.
Suivons les pas du jeune étudiant qui trouve les portes de la Vaticane closes, pour cause de Vigile de Pentecôte ou de quelque « Mystères joyeux » qu’aimèrent à représenter nos vieux peintres, et qui s’entend dire : « Oggi e festa, signor ! …Au dehors sonnent les cloches de Saint-Pierre, le soleil dore la colonnade et se joue dans les fontaines. Puisque c’est fête, on va célébrer le saint du jour dans une osteria de la campagne, où le déjeuner sera gai et le vin digne d’Horace, à moins qu’on ne préfère monter à Albano, pour aller lire au bord du lac, sous les chênes verts… »
Comme on reconnaît encore mieux le vieux Romain dans cet écrit manuscrit qui relate un voyage en Italie en 1894 avec son épouse Alix, et qui conserve toute sa naïveté et sa fraîcheur : on ne peut à la lecture de ce carnet, garder aucun doute : le conservateur de Versailles est encore amoureux de Rome. « …la malle étant déjà à la gare, nous avons été à l’Ara Coeli pour notre dernière visite romaine. Alix a aperçu le Forum, si beau sous le soleil de printemps, avec son couronnement de ruines et elle n’a pu se décider à partir. Je ne me suis pas fait longtemps prier pour lui obéir. Nous avons renvoyé d’un jour encore, et comme l’ami Angelo était avec nous, nous avons étudié à trois et consciencieusement les ruines augustes. C’est bien là une reprise de Rome, qui a resserré sur nous sa chère étreinte. La reverrons-nous jamais ? Ou bien la vie nous séparera-t-elle à présent pour toujours de la chère Ville ? »
Refermons maintenant Les Souvenirs d’un vieux Romain. Pendant notre lecture, un billet de remerciement de la main de l’auteur en est tombé et il est écrit, d’une plume élégante, à l’intention, encore une fois, de Henri Bordeaux : Avec mes remerciements pour l’aimable Maison Morte; la date nous est inutile : la Maison Morte est publiée au mois de janvier 1922. Il est adressé du 158 boulevard Haussmann. C’est l’adresse du musée Jacquemart André : c’est que depuis peu Pierre de Nolhac est le conservateur où l’appelle naturellement sa passion de l’art français et de l’art italien. Dans un de ces derniers entretiens auquel il ne faut rien rajouter, il déclare alors : « Vous parlerez de moi lorsque je n’y serai plus ; vous direz que le vieil humaniste a bien travaillé, mais n’est-ce pas, vous direz surtout qu’il fut un poète ! ».
M.Ferrand Ils ont sauvé Versailles, Perrin, 2003.
La résurrection de Versailles, Souvenirs d’un conservateur, Plon, 1937
Emile Zola, Nouveaux contes à Ninon, G.Carpentier, 1874
La perte du yacht, présent à la Reine qui avait coûté soixante mille livres au galant Contrôleur des Finances, M. de Calonne, fut irrémédiable ; seul le décor de proue aux armes royales put être récupéré et restauré, il est aujourd’hui exposé au Musée de la Marine à Paris.
Louis Dussieux, Le Château de Versailles, Bernard, 1881.
Parmi les visiteurs illustres de Versailles, le plus érudit et le plus francophile des Romanov eut aussi le destin le plus tragique : le grand-duc Nicolas fut massacré par les bolcheviks, au milieu de ses livres et de ses collections. On trouva sur son bureau son dernier envoi : il était destiné à Pierre de Nolhac et contenait les lettres de Catherine de Russie à son ambassadeur auprès du roi de France.
Le cavalier Bernin demeura en France, dans la deuxième partie de l’année 1665, à l’invitation du roi de France . Selon M.Lalanne, le découvreur du Journal de Chanteloup, « cet éloge (e molto galante quel que se fatto qui) eut quelque influence sur la détermination de Louis XIV d’y établir sa résidence » ( Journal de Voyage du cavalier Bernin en France, Gazette des Beaux-Arts, 1885, p.157).
ALEX.CARD.FARNESIVS VICECAN. /EPISCOPUS OSTIENSIS /AEDES A PAVLO III PONT.MAX. /ANTE PONTIFICATVM INCHOATAS/PERFECIT AN. MDXXCIX
La bibliothèque de Fulvio Orsini, F.Vieweg, 1887 ; Les collections d’antiquité de Fulvio Orsini, Mélanges de l’Ecole française de Rome, 1884. Sur les études « italiennes » de Pierre de Nolhac, on citera notamment Erasme en Italie, Klincksieck, 1888.
Souvenirs d’un vieux Romain, H.Floury, 1922, p. 63
Carnet manuscrit, Voyage en Italie de 1894, retranscrit par Martine Hedou.
Maurice Levaillant, Pierre de Nolhac, RVH 1957, p. 19

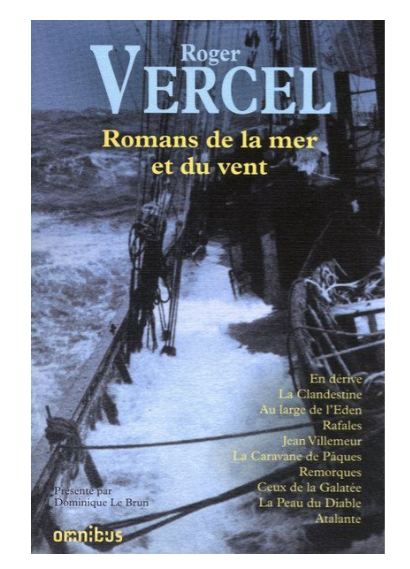
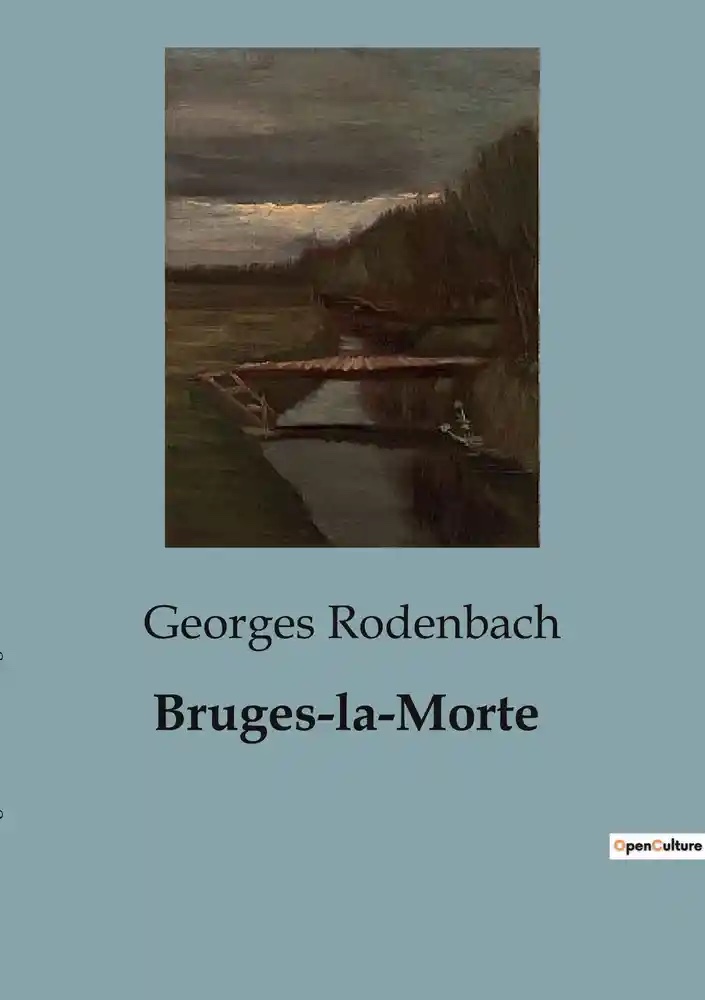
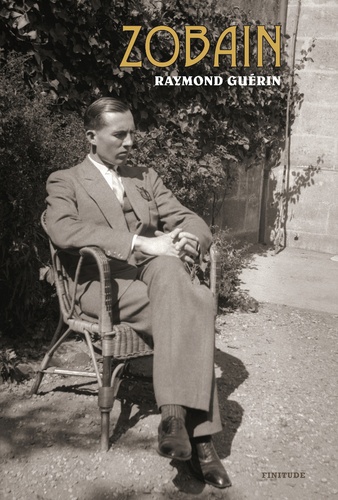
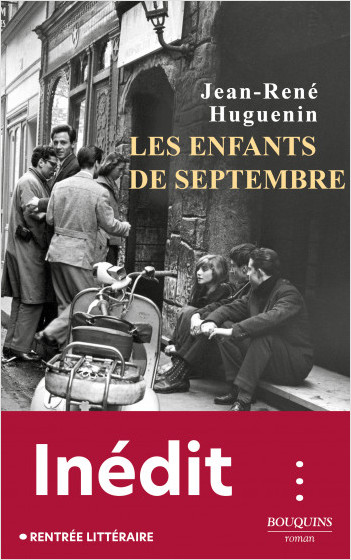
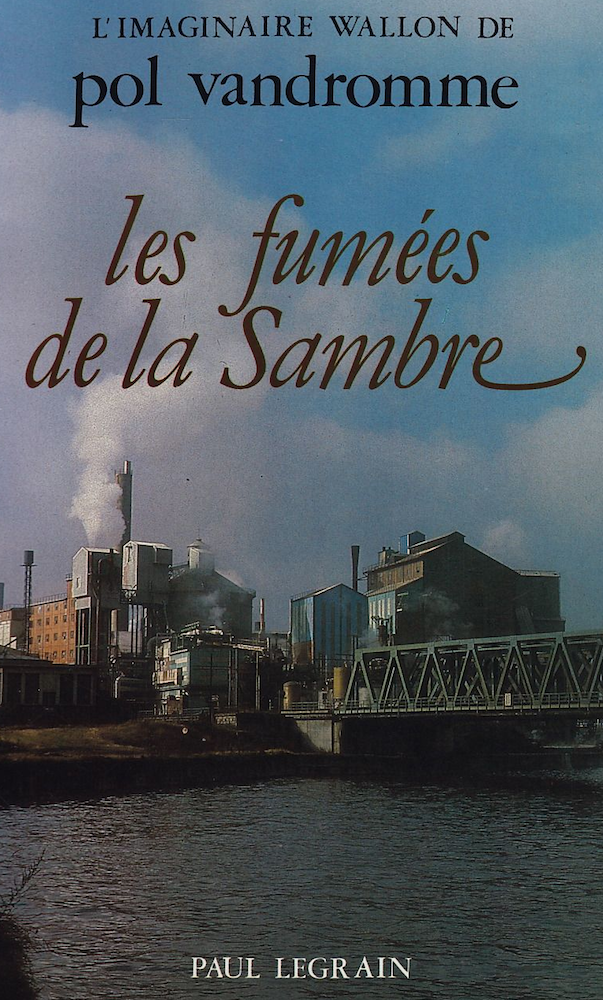
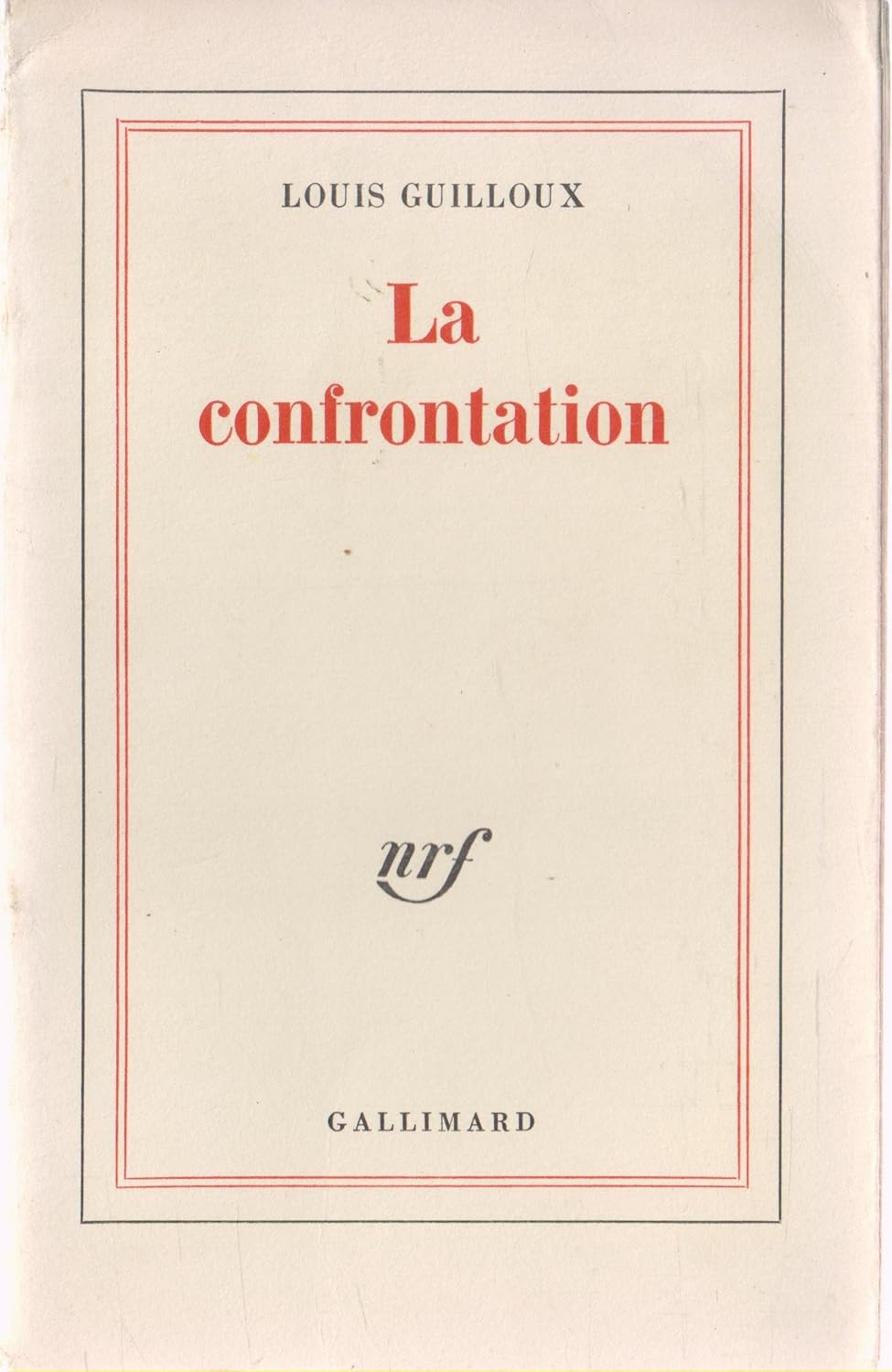
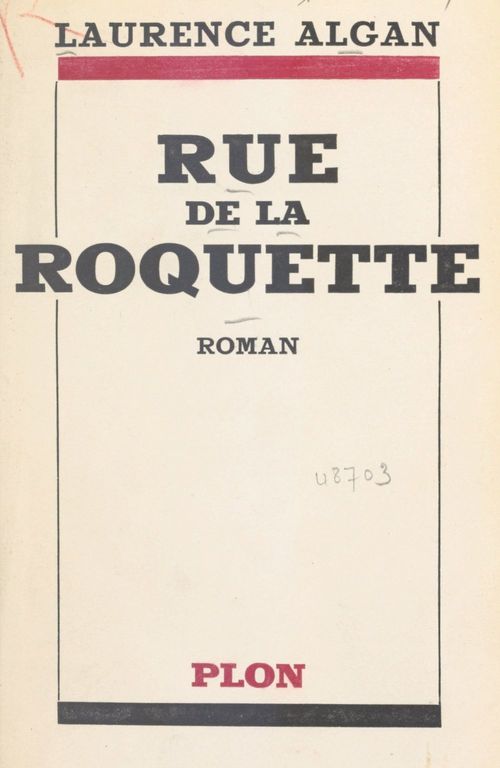
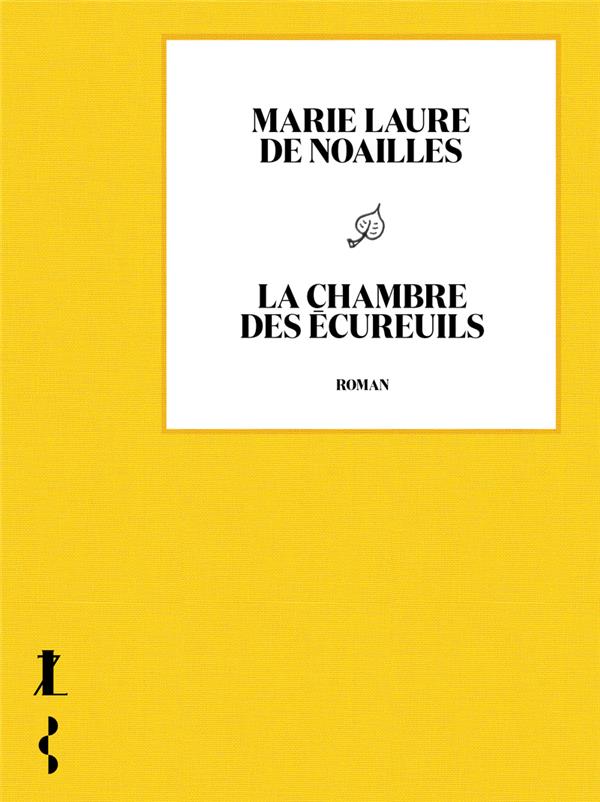
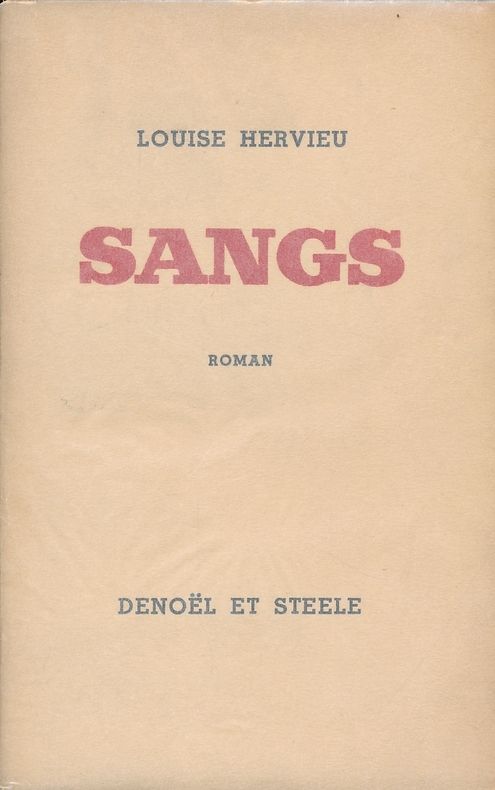
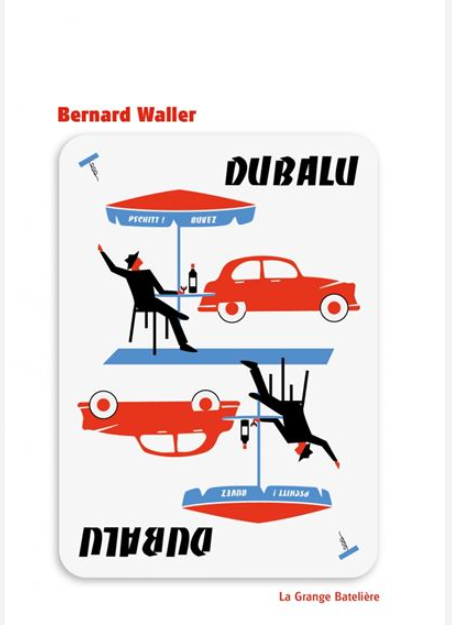
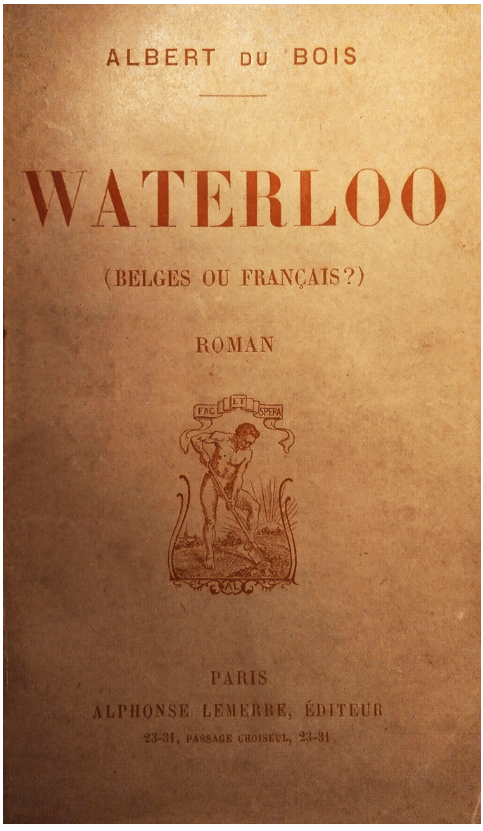
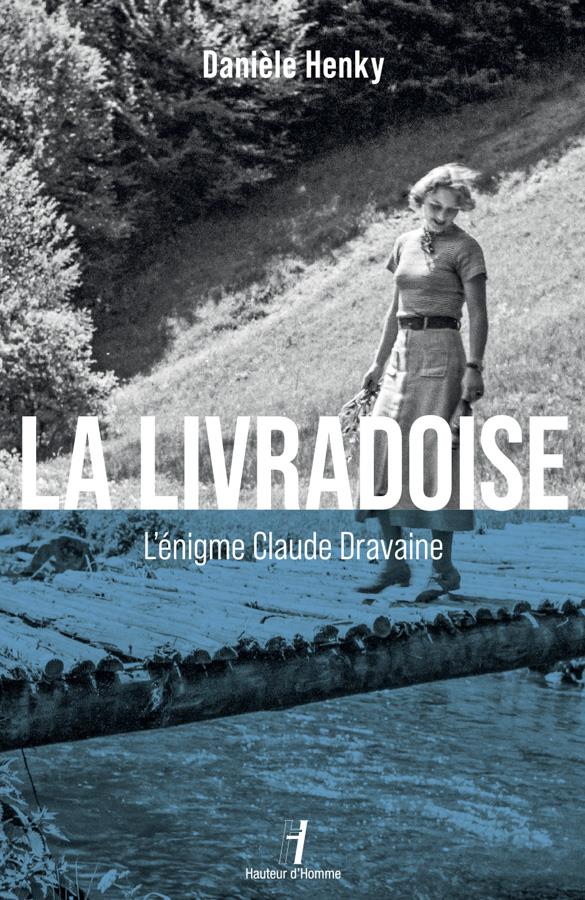
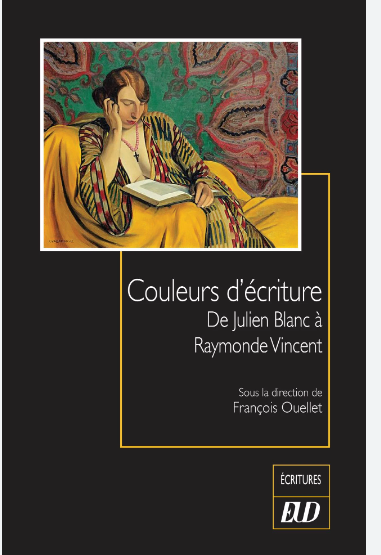
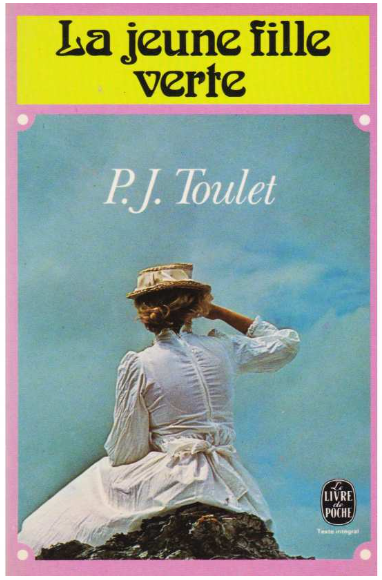
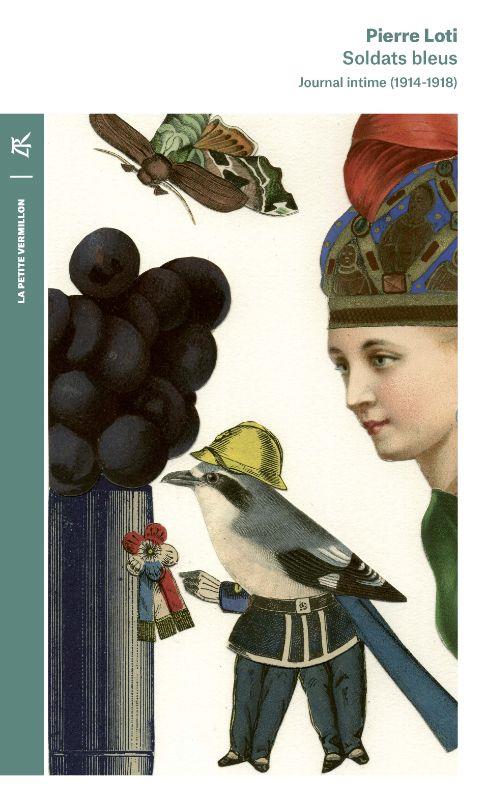
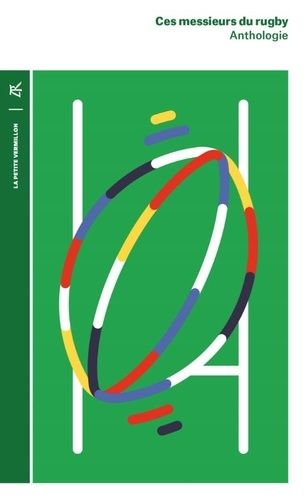
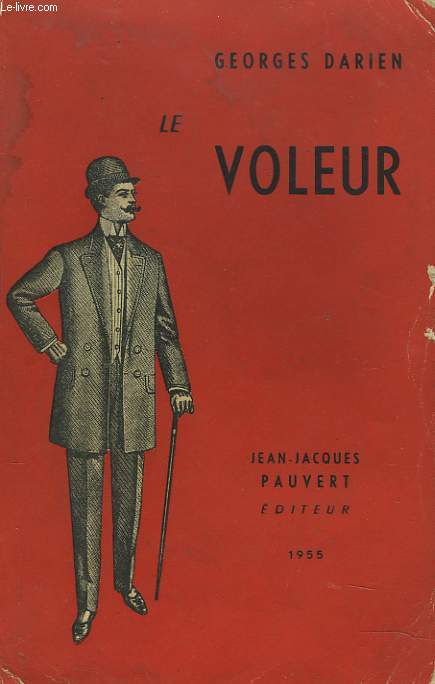
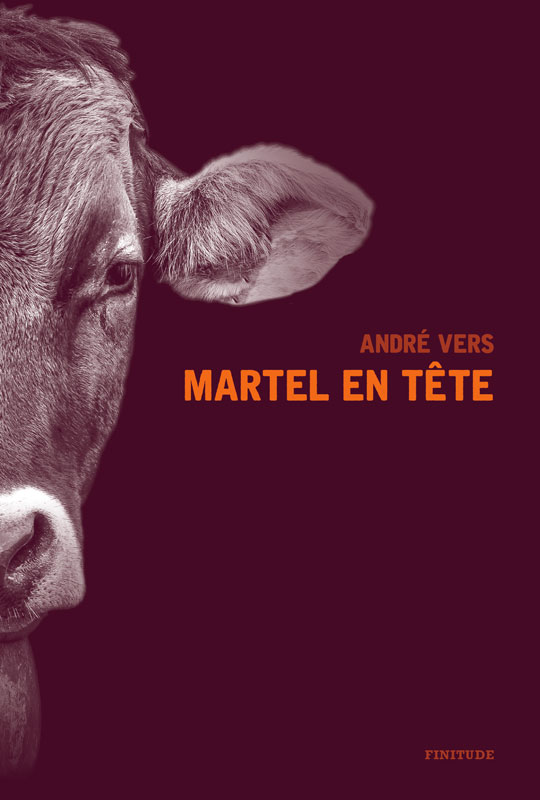

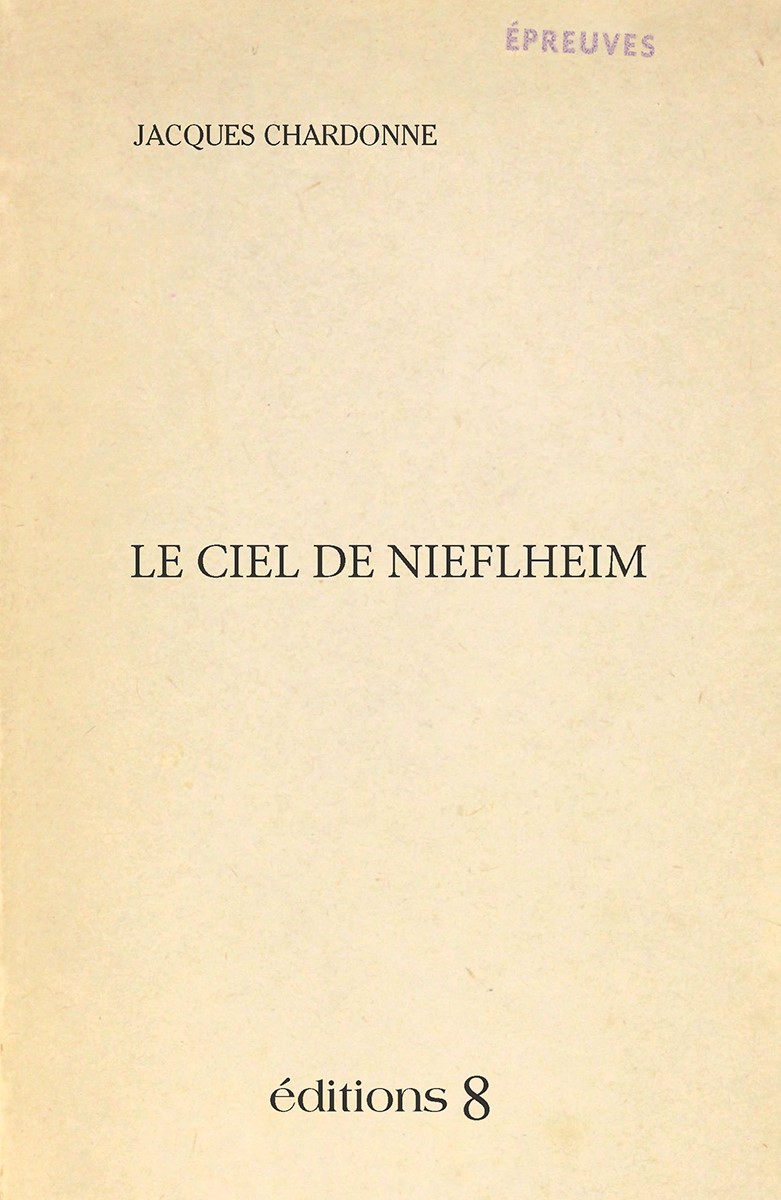
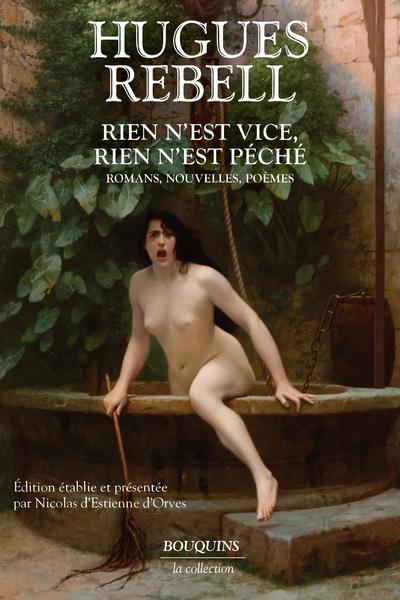
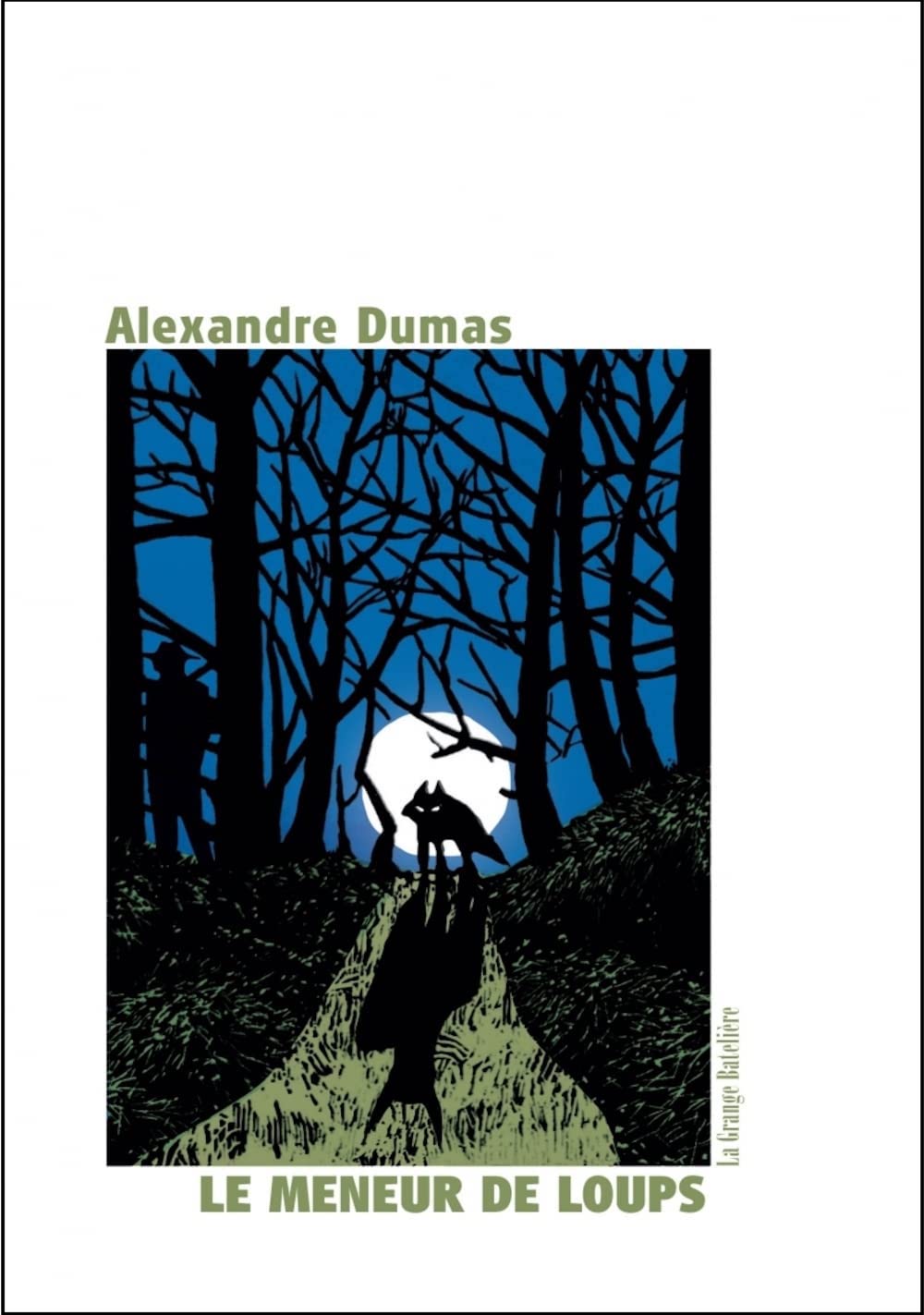
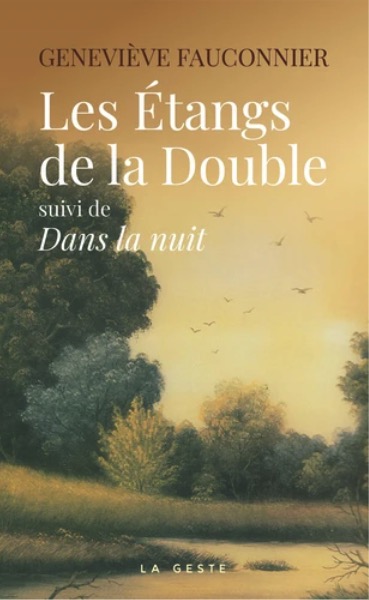
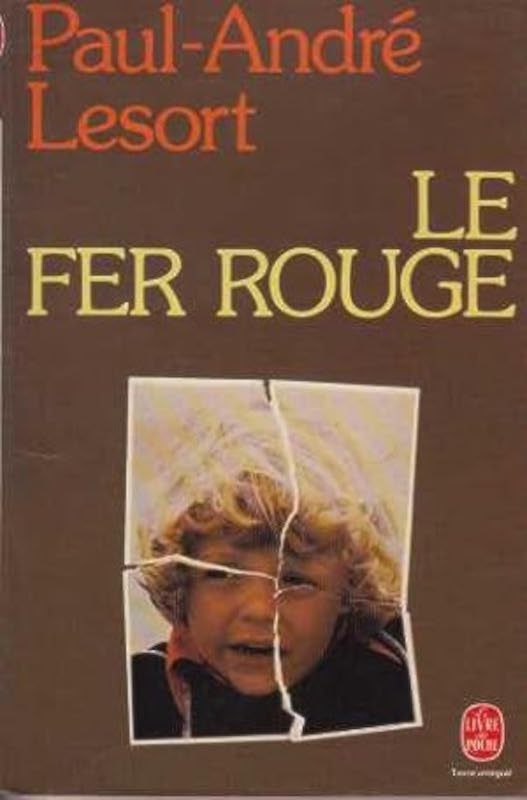

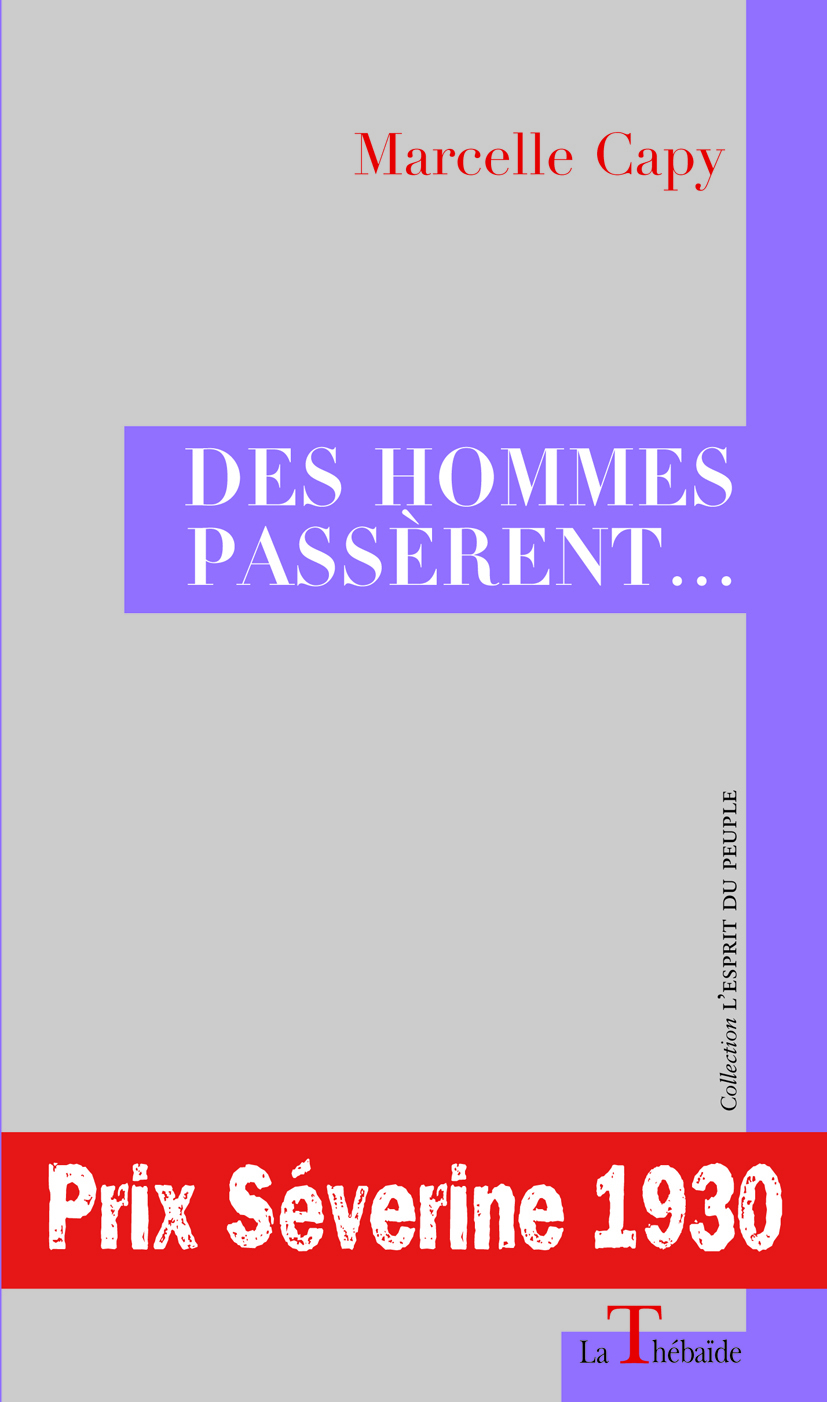
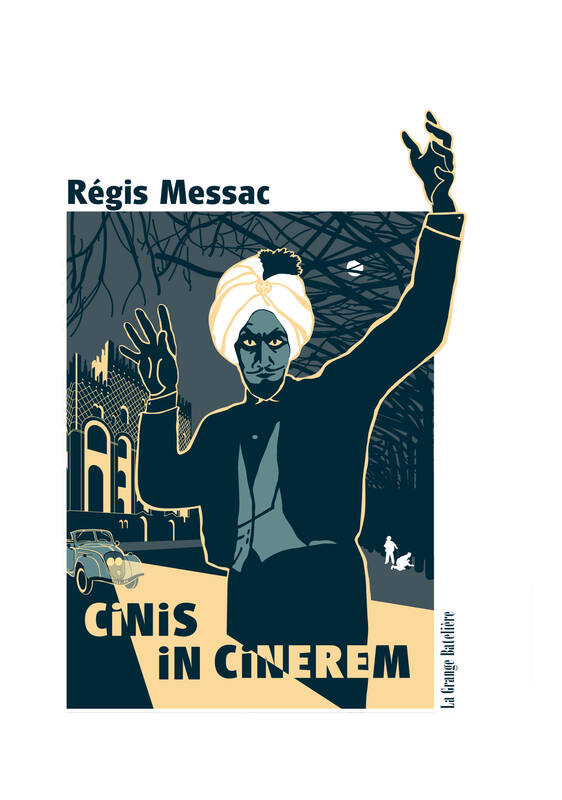
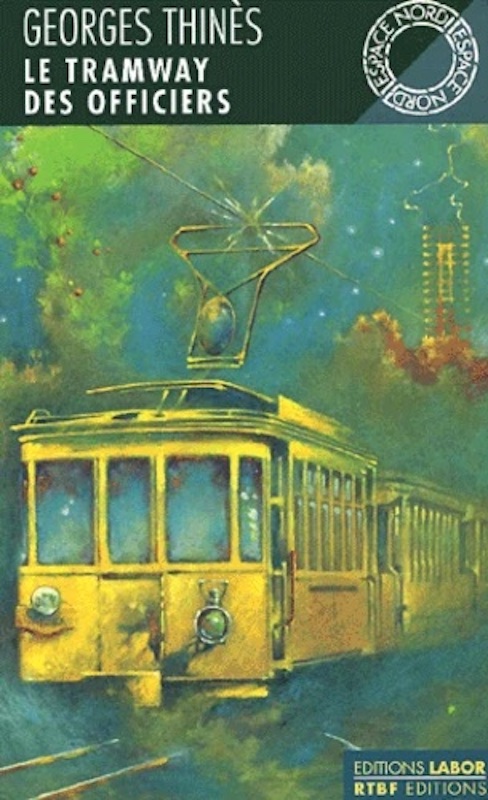
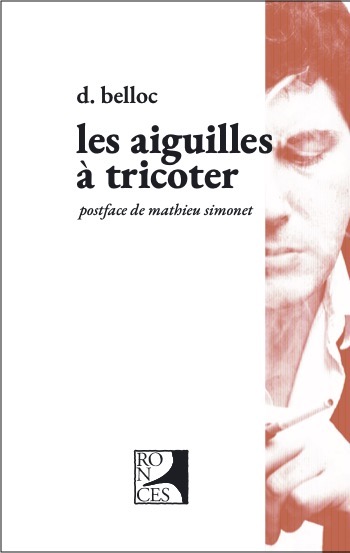
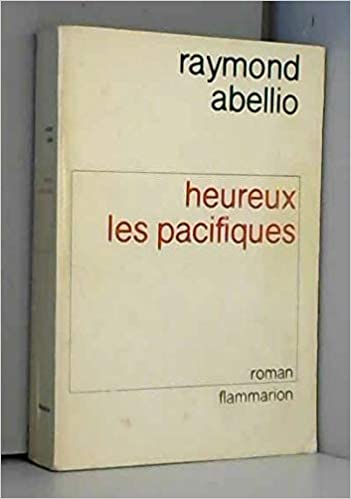
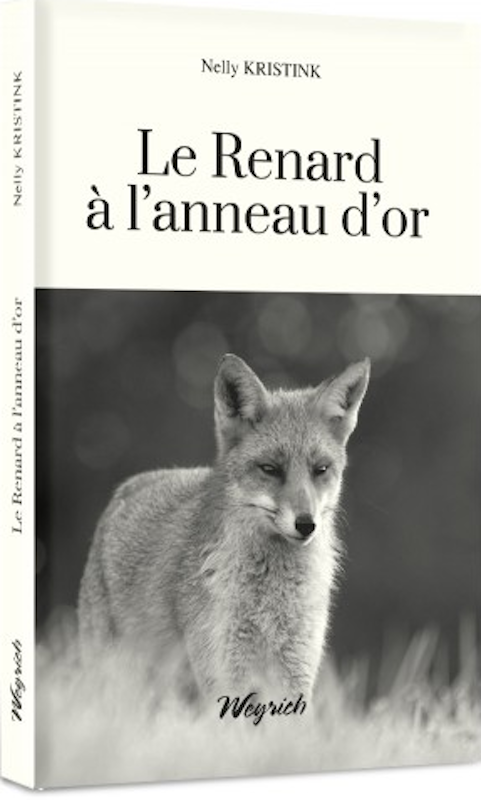
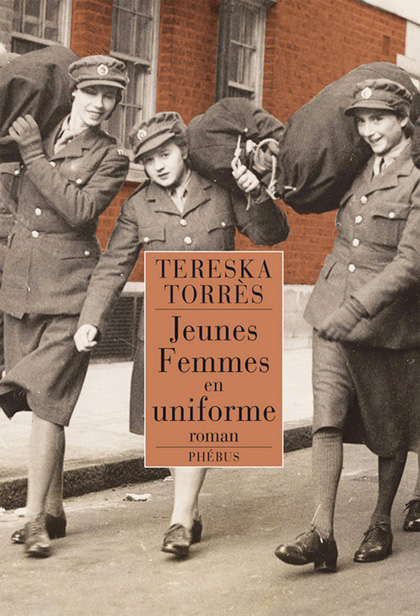
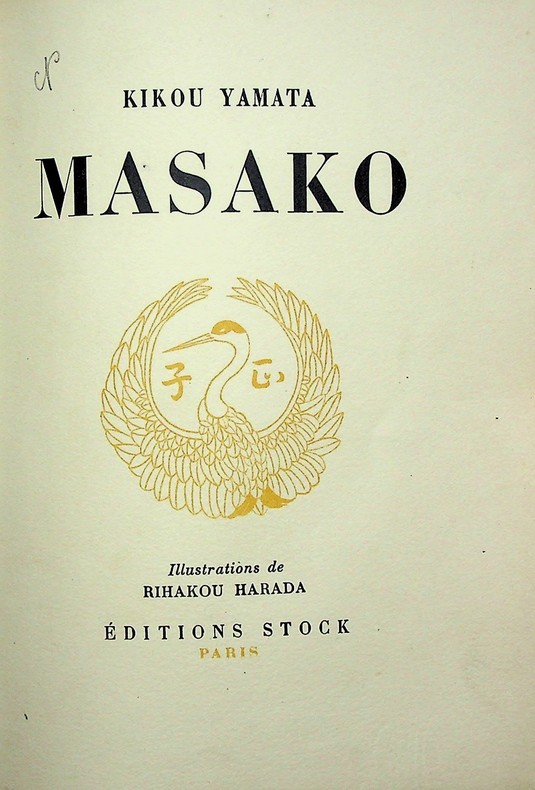
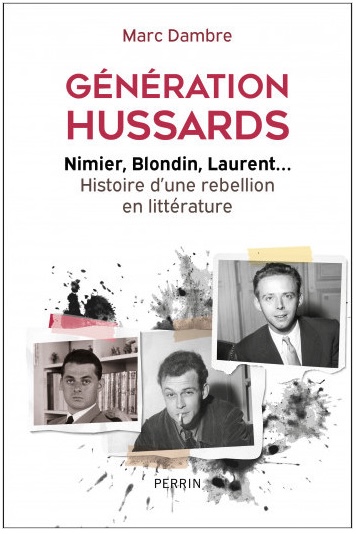
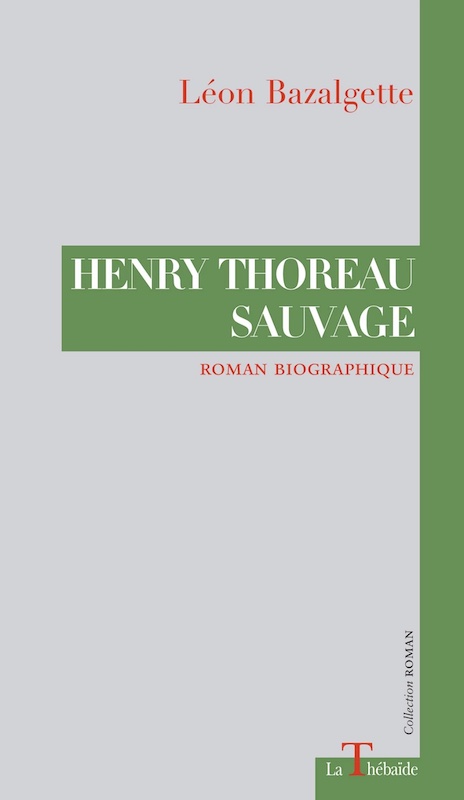
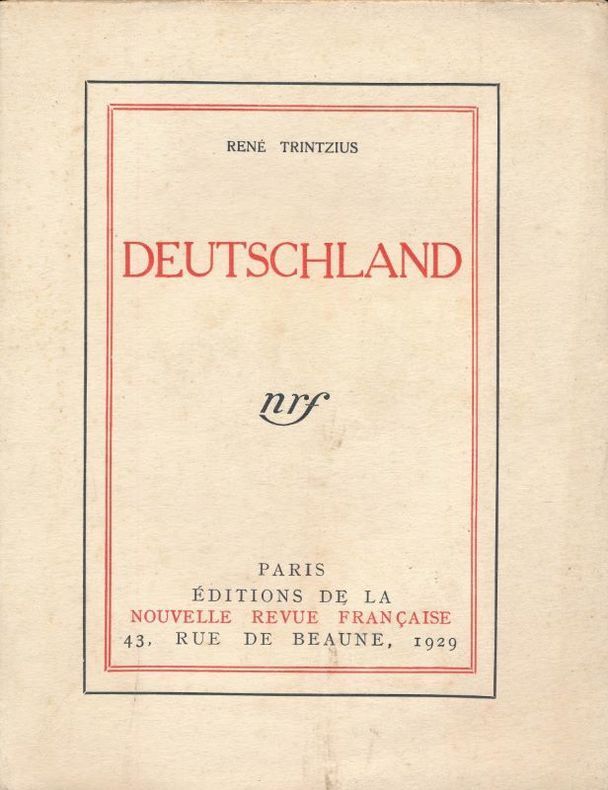
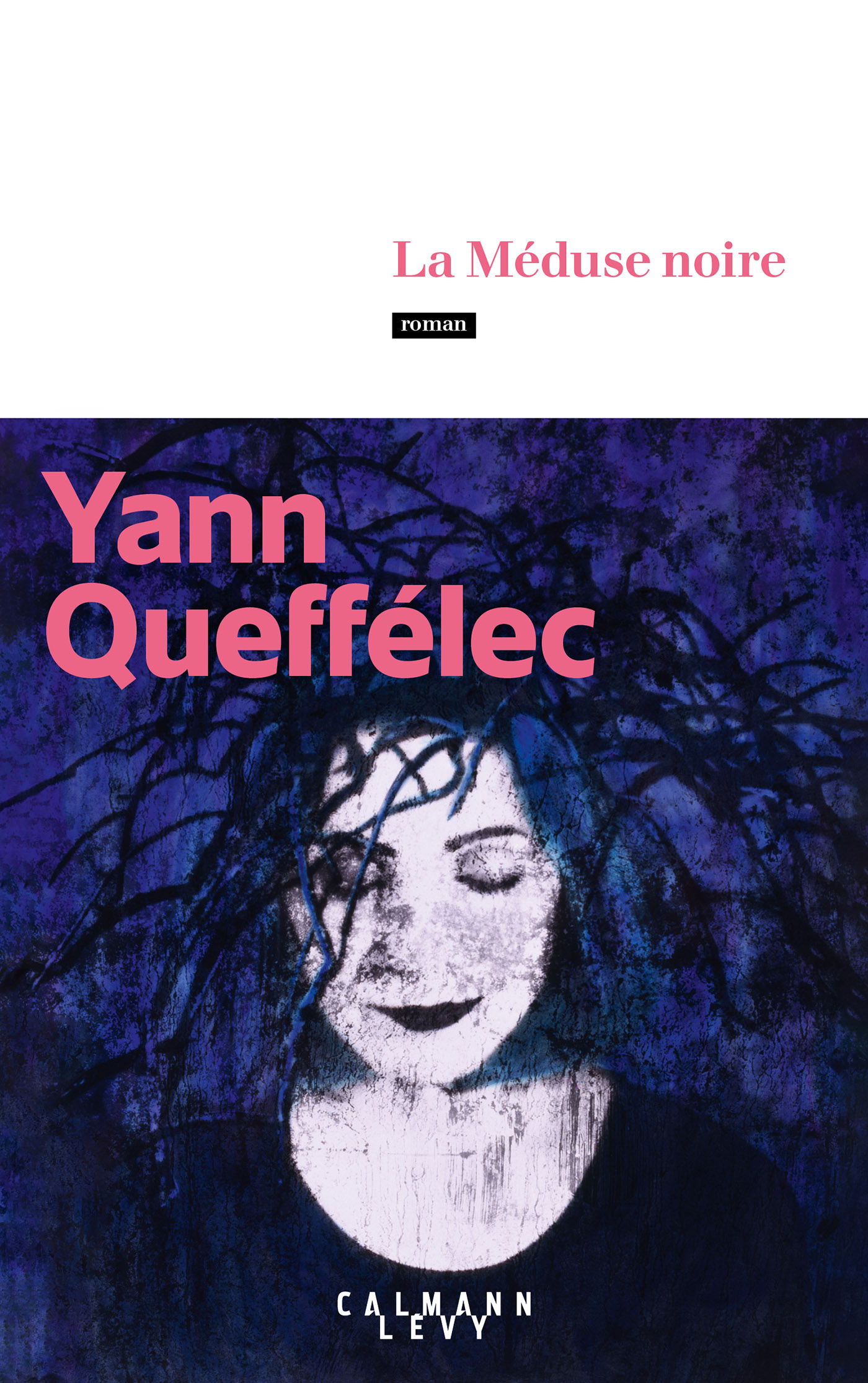
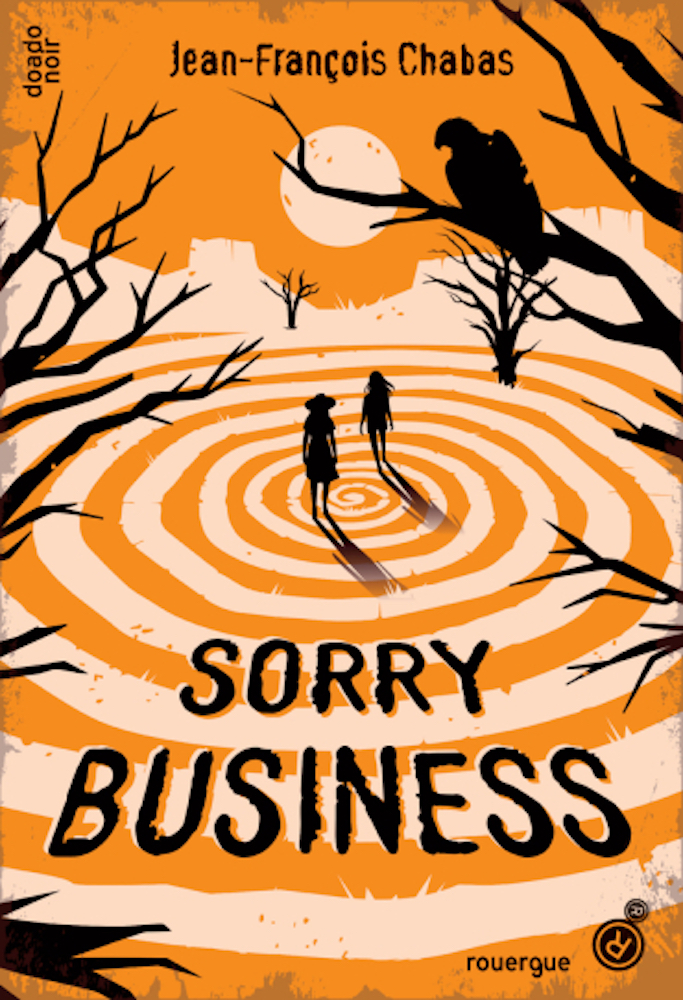
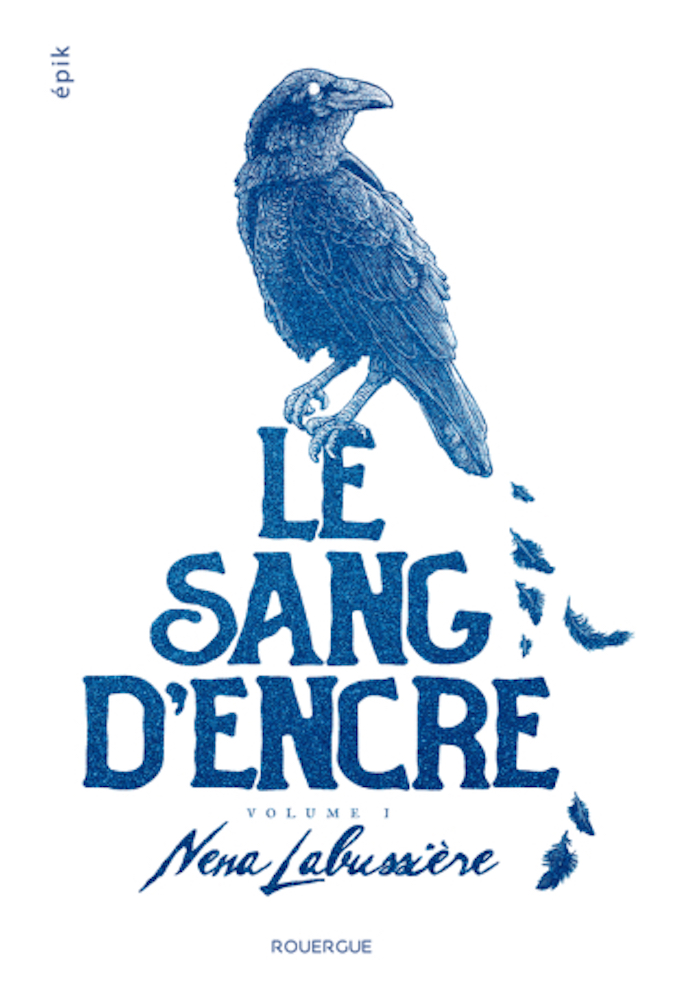
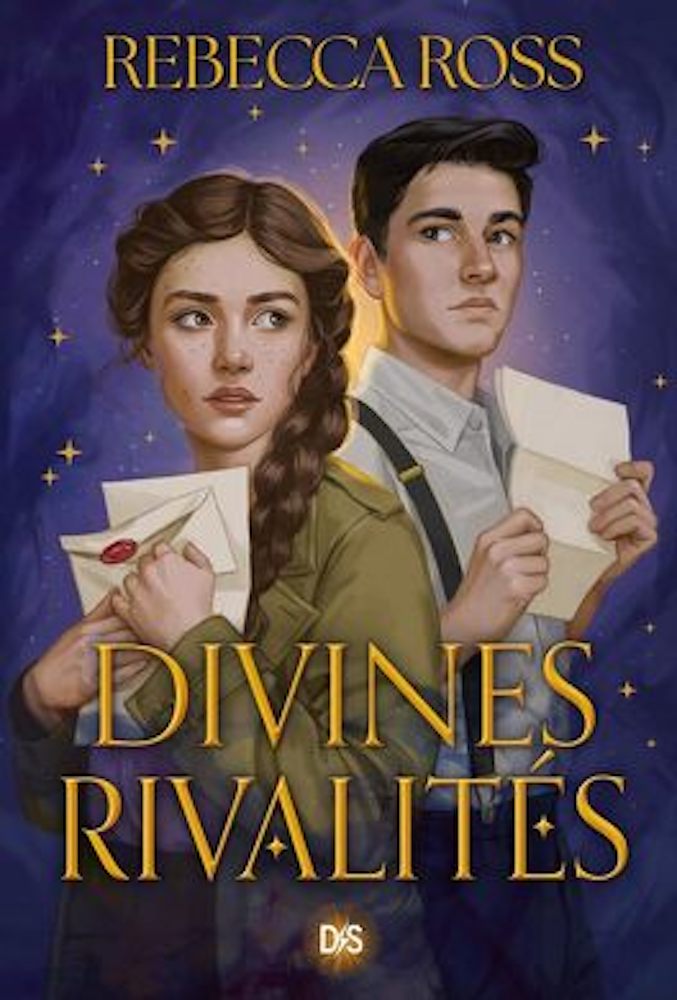
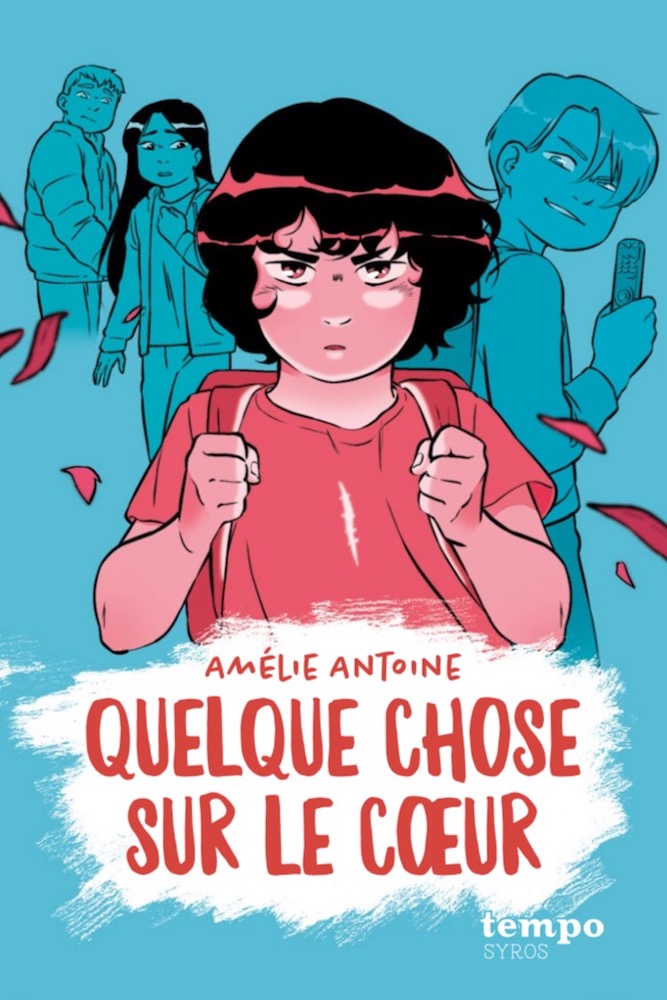

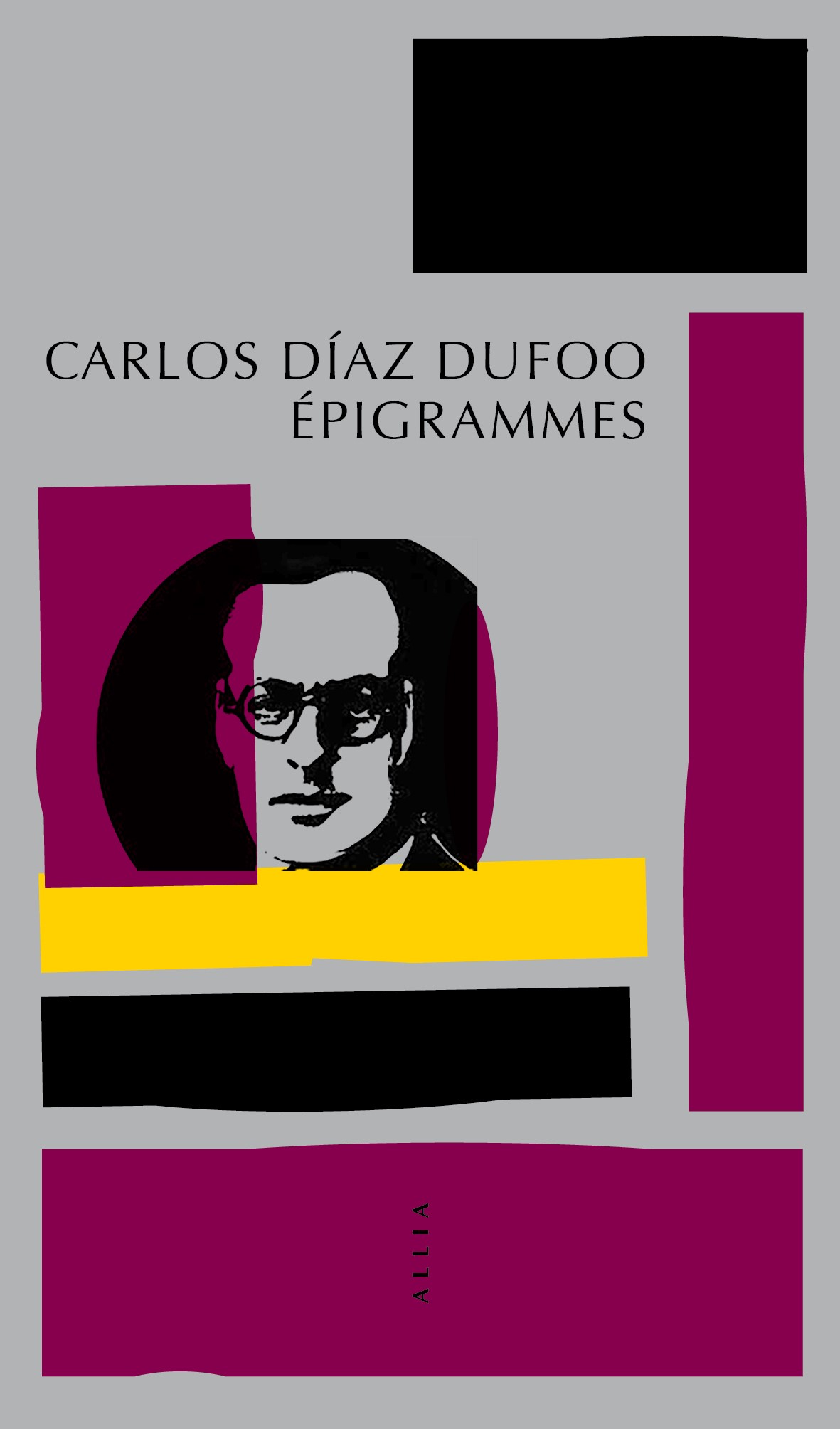
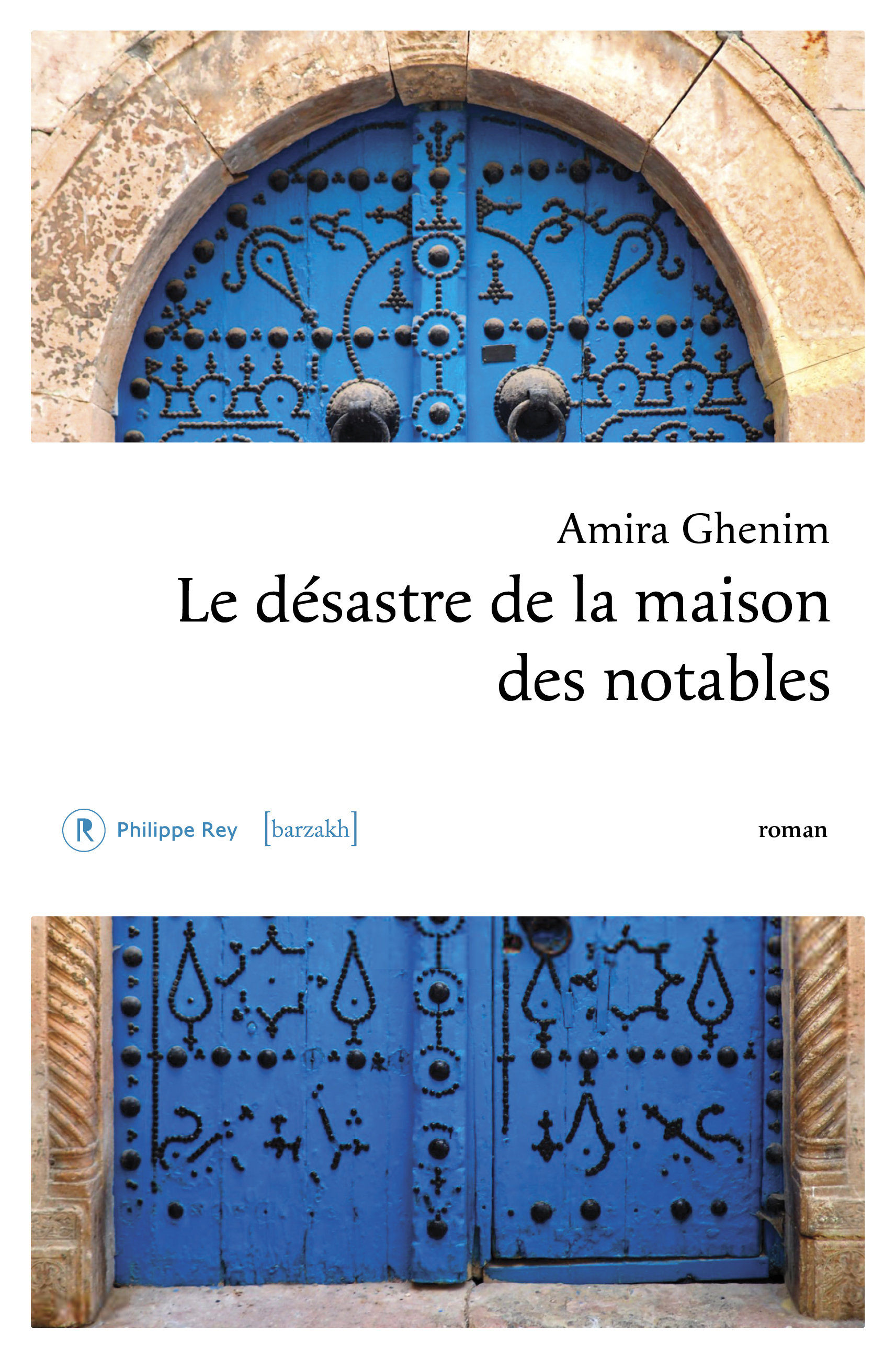
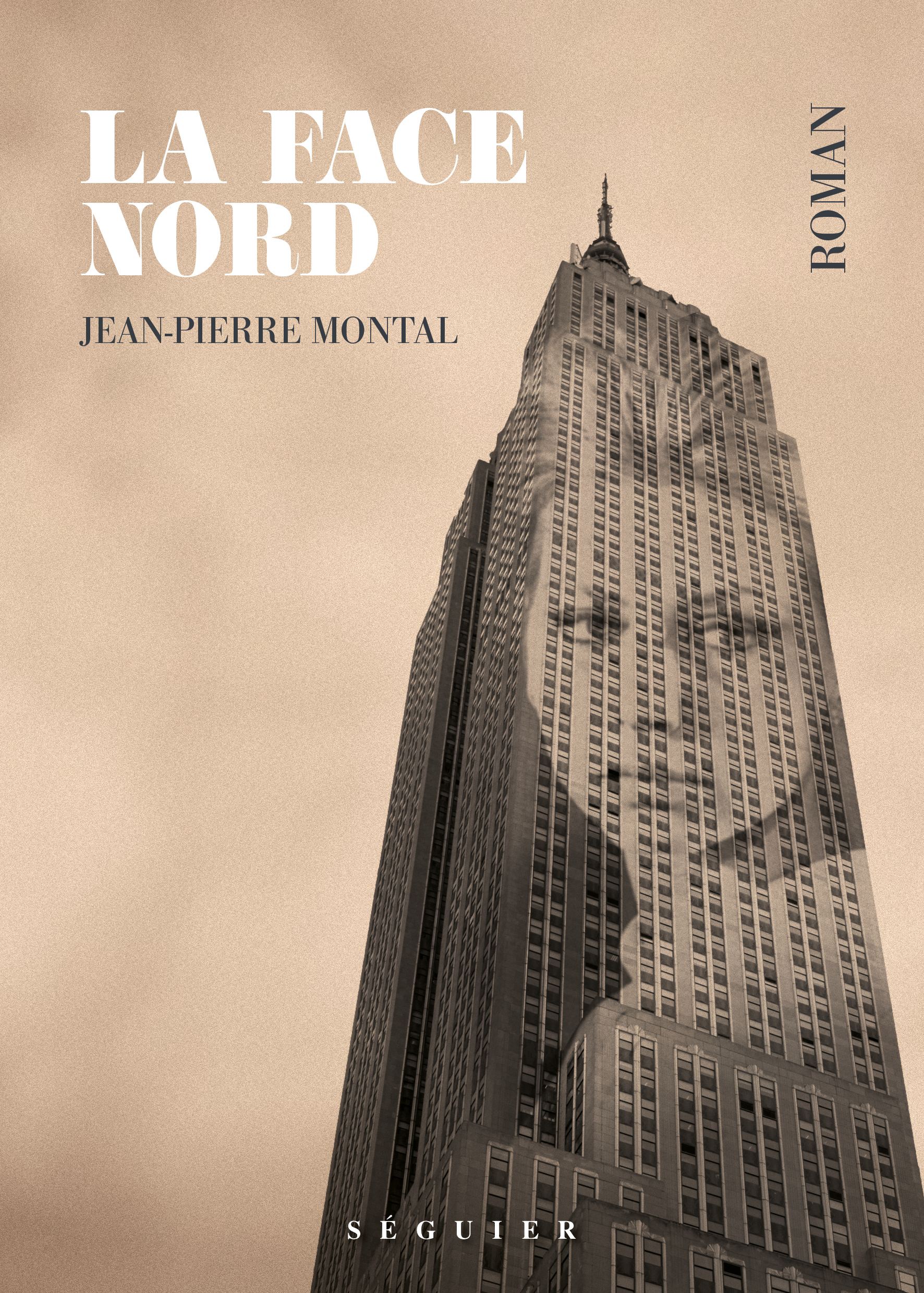
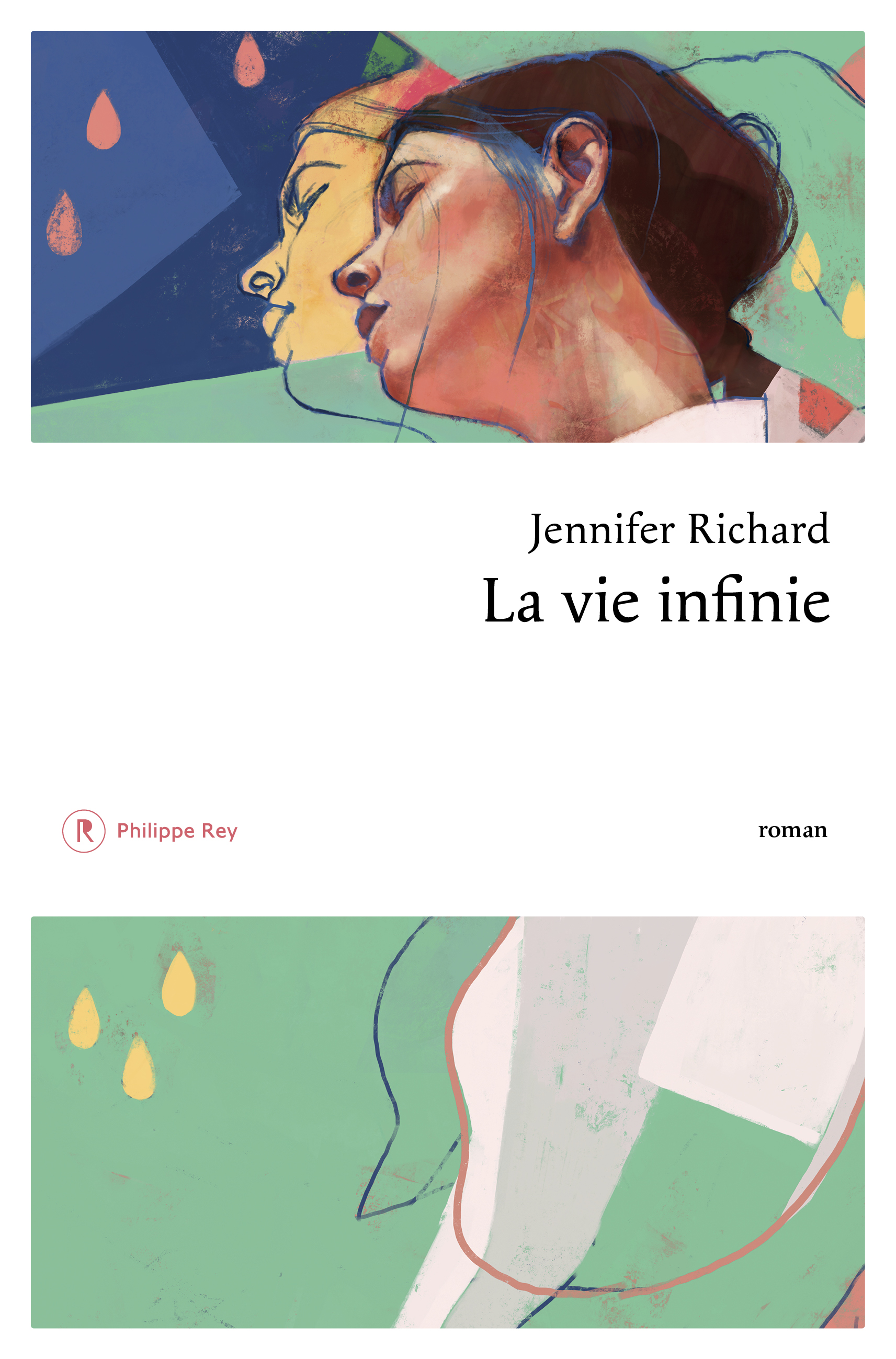
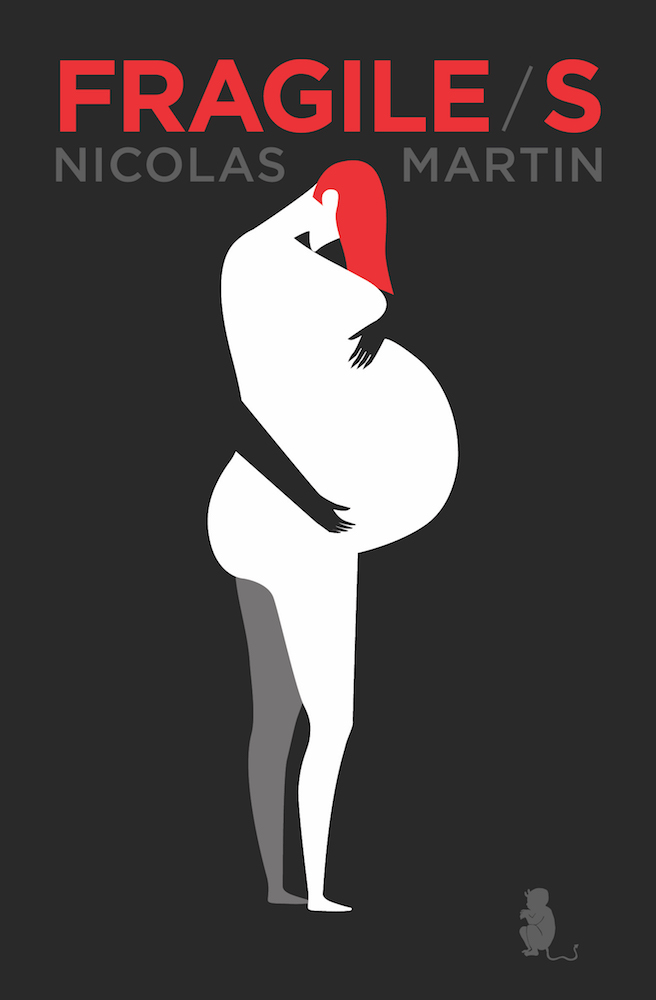

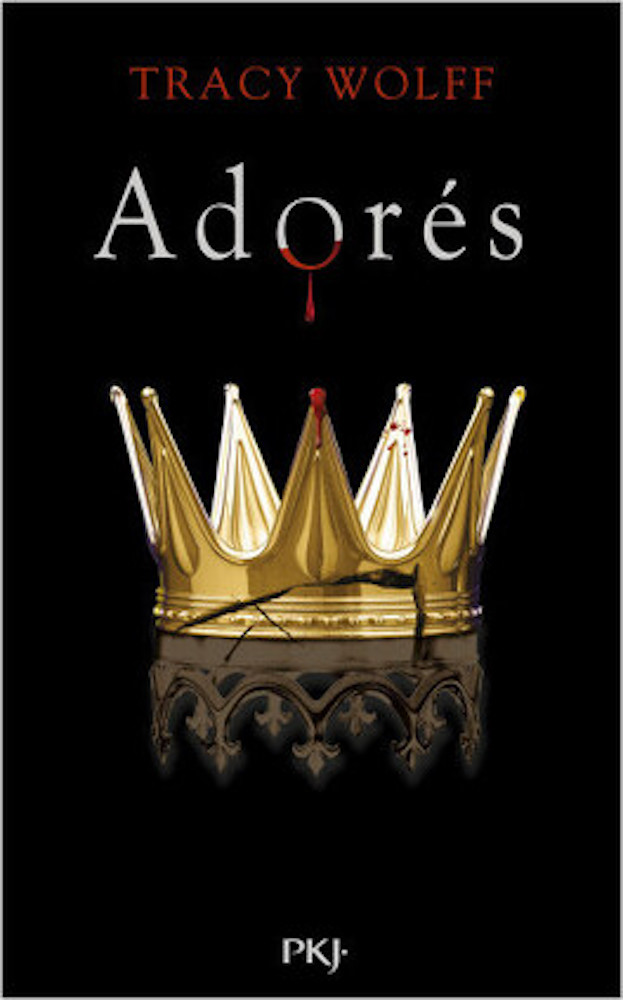
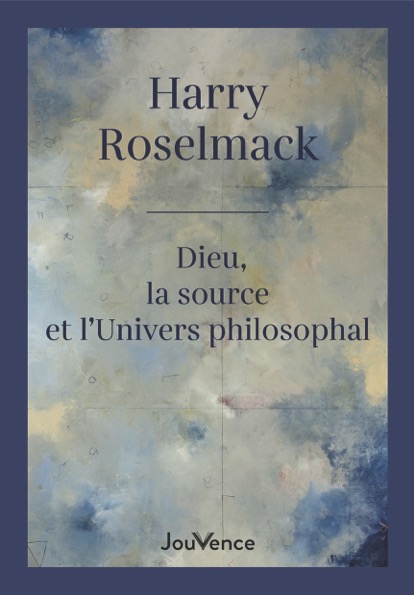
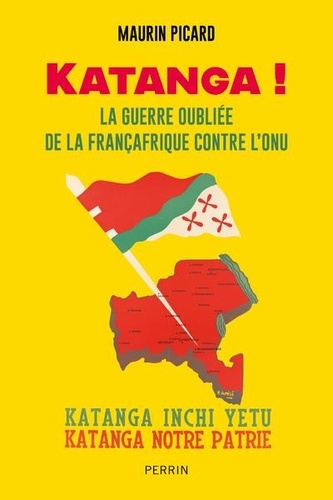
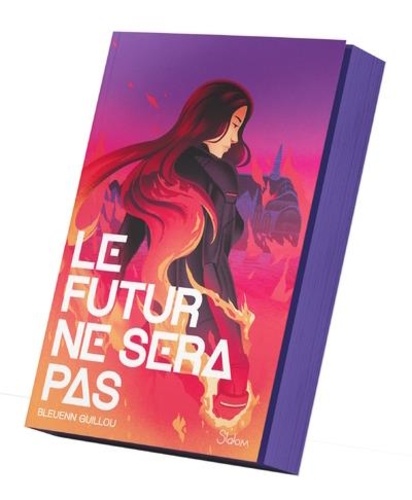
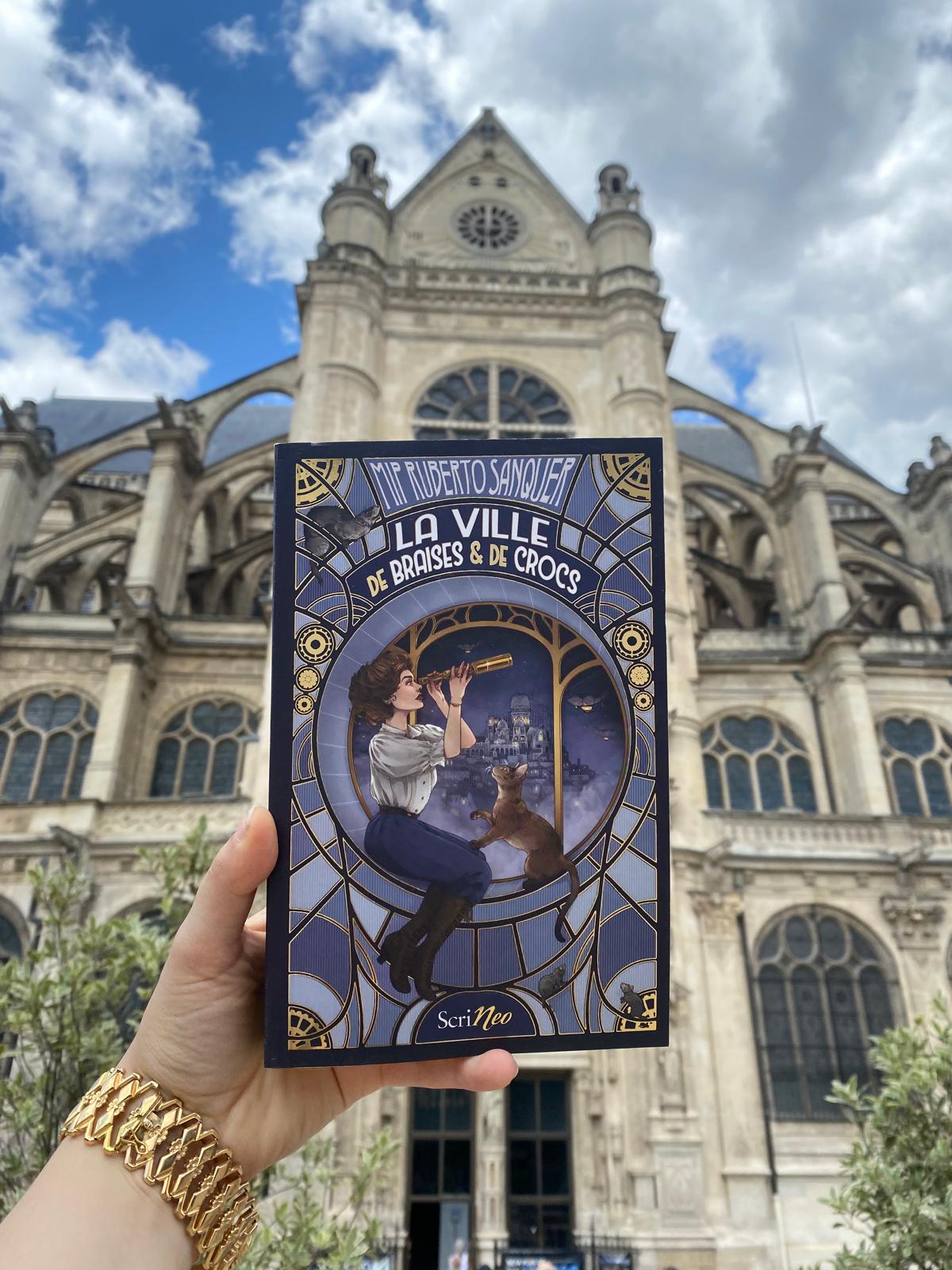
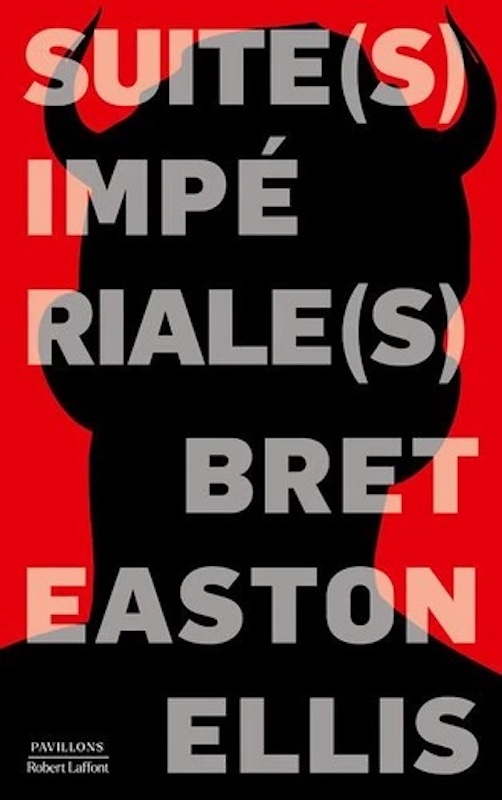


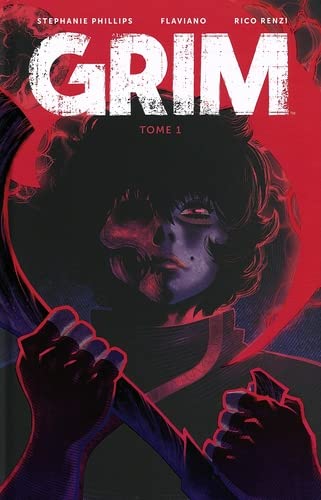
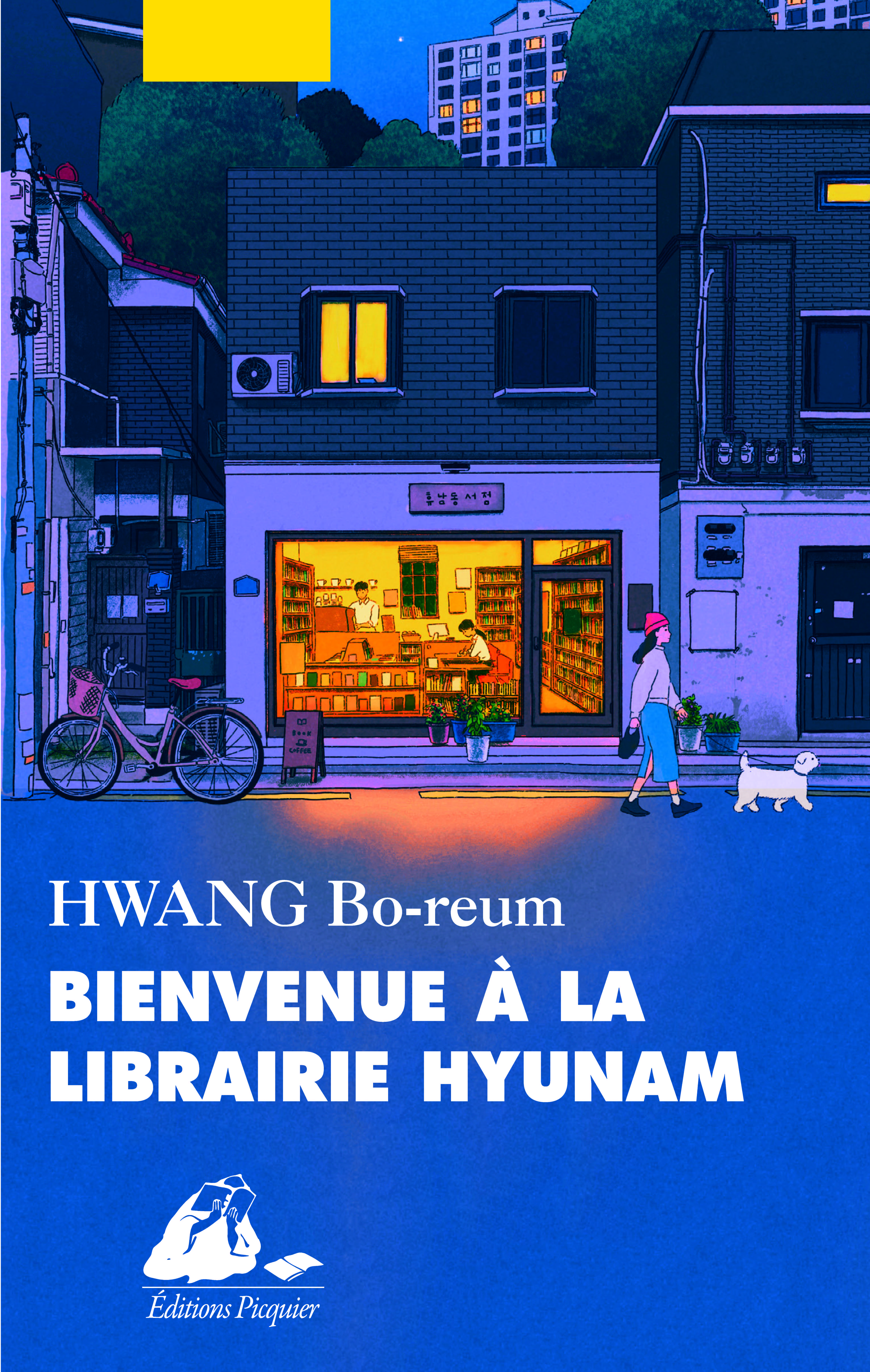
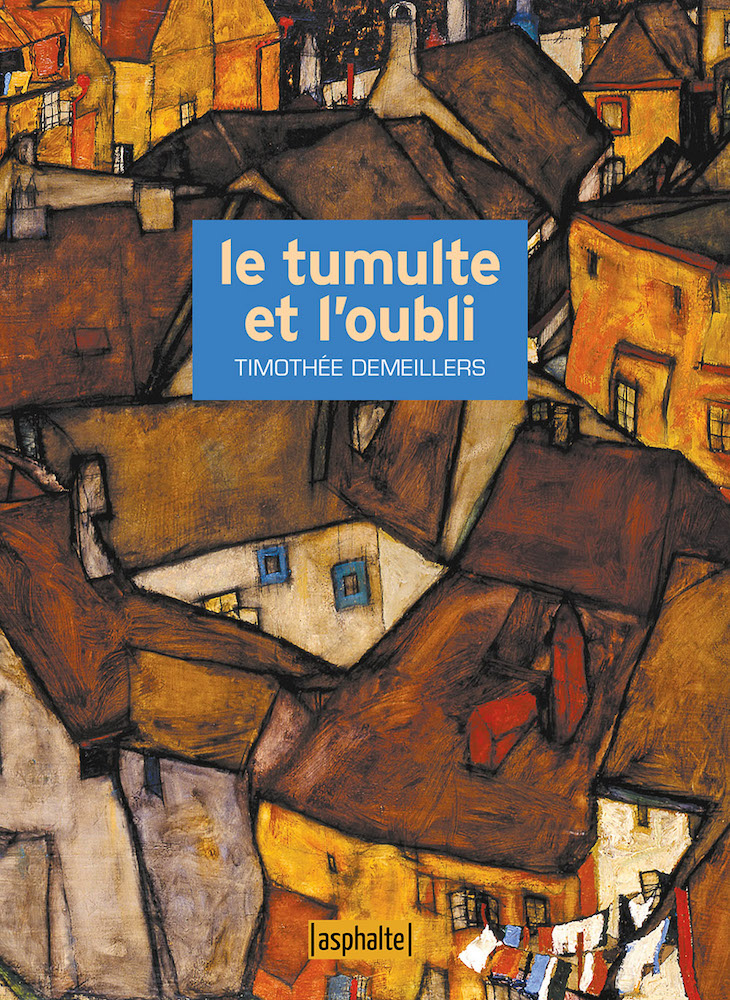
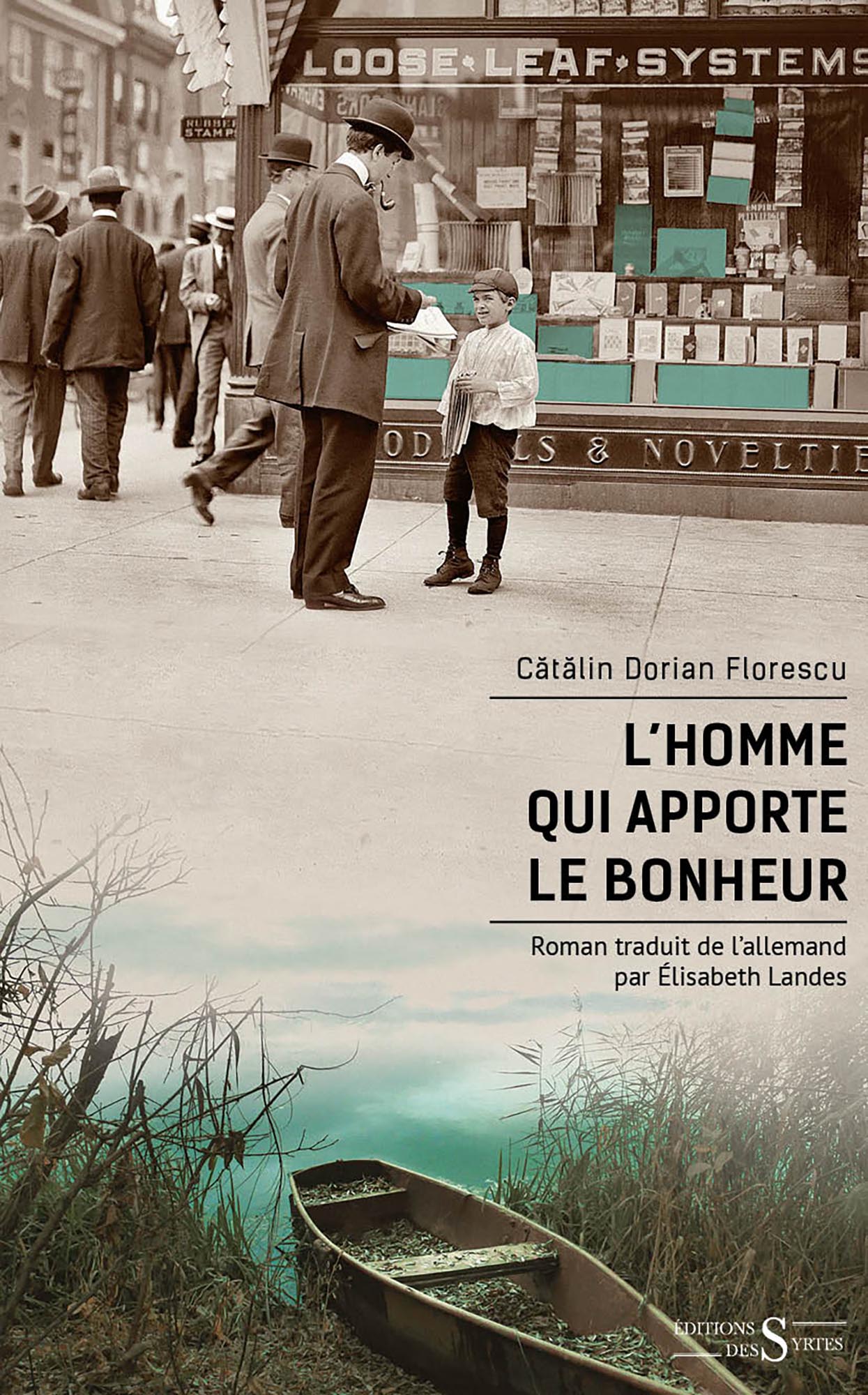
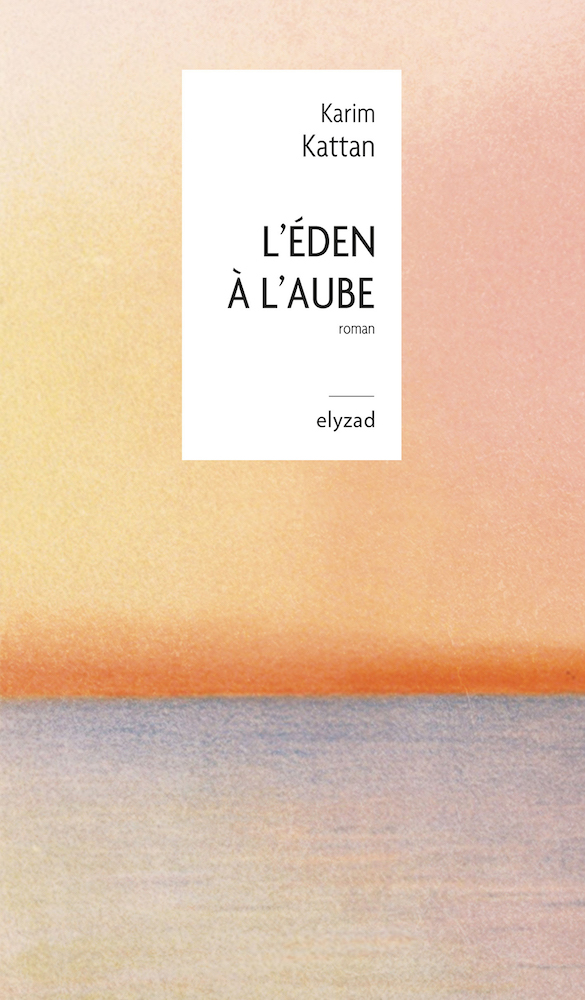
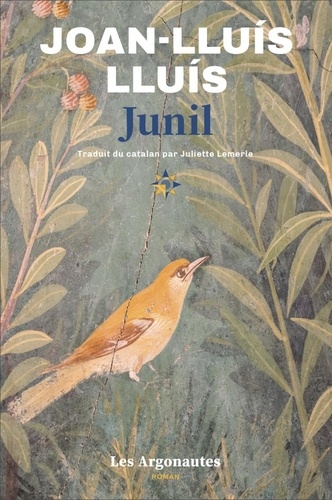
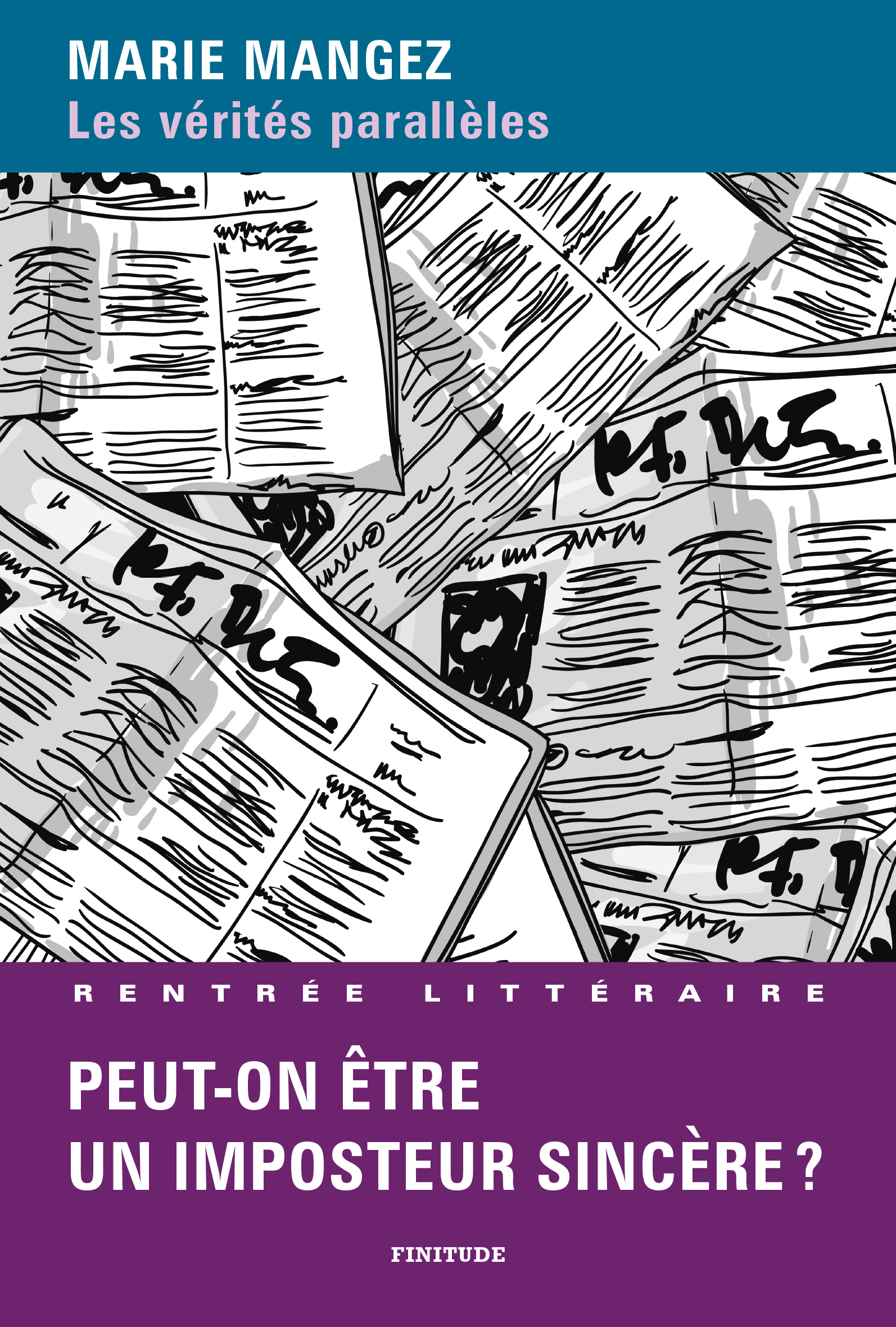
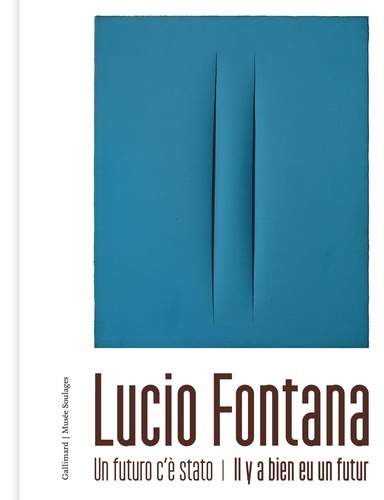

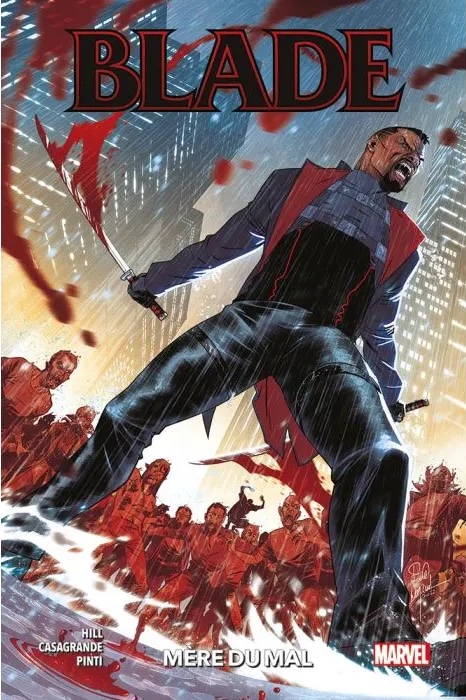
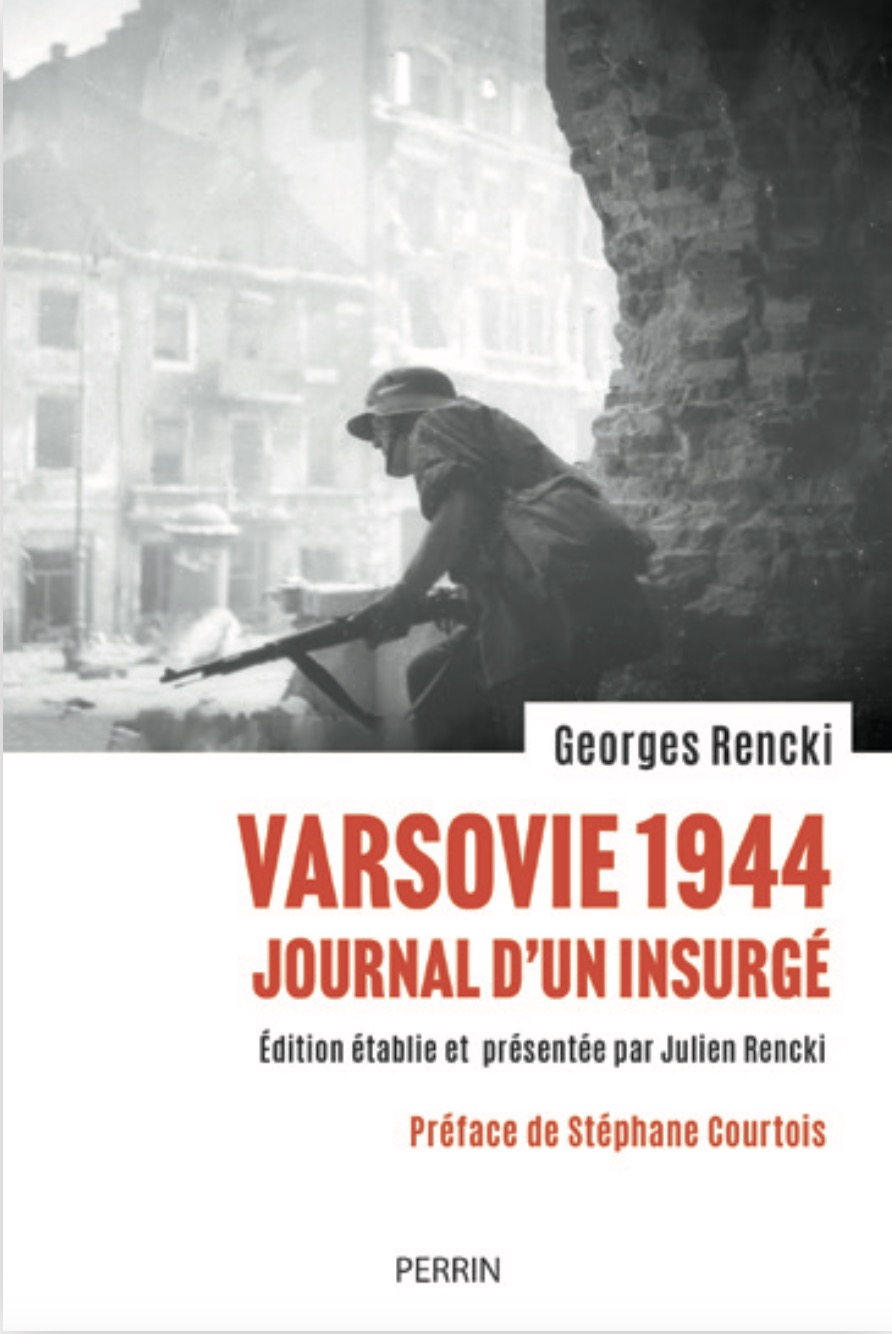
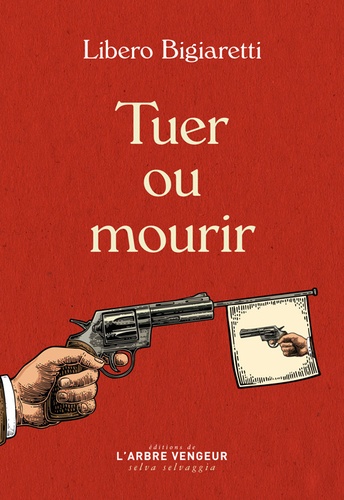
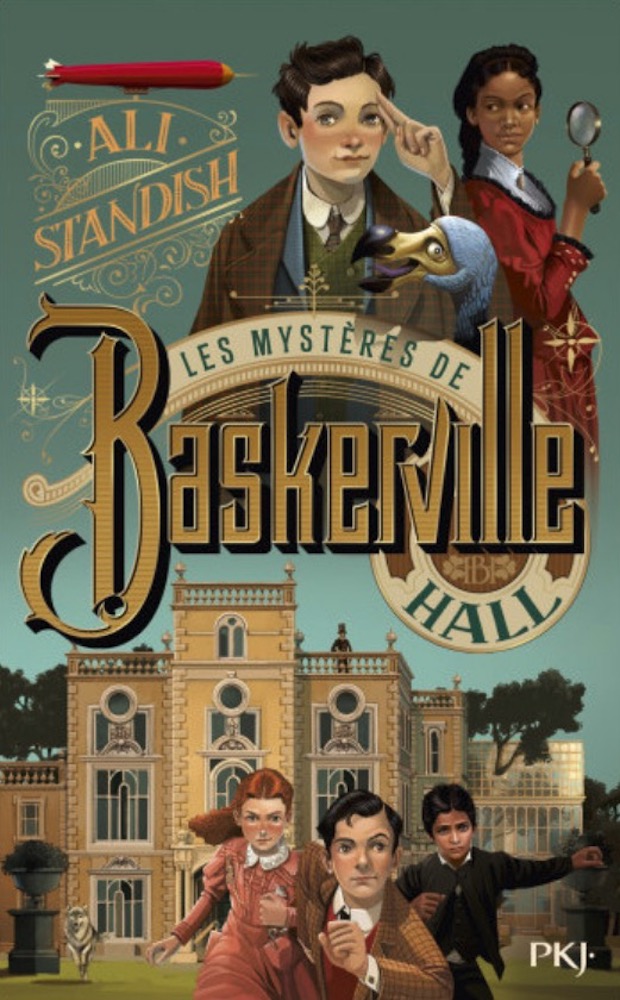
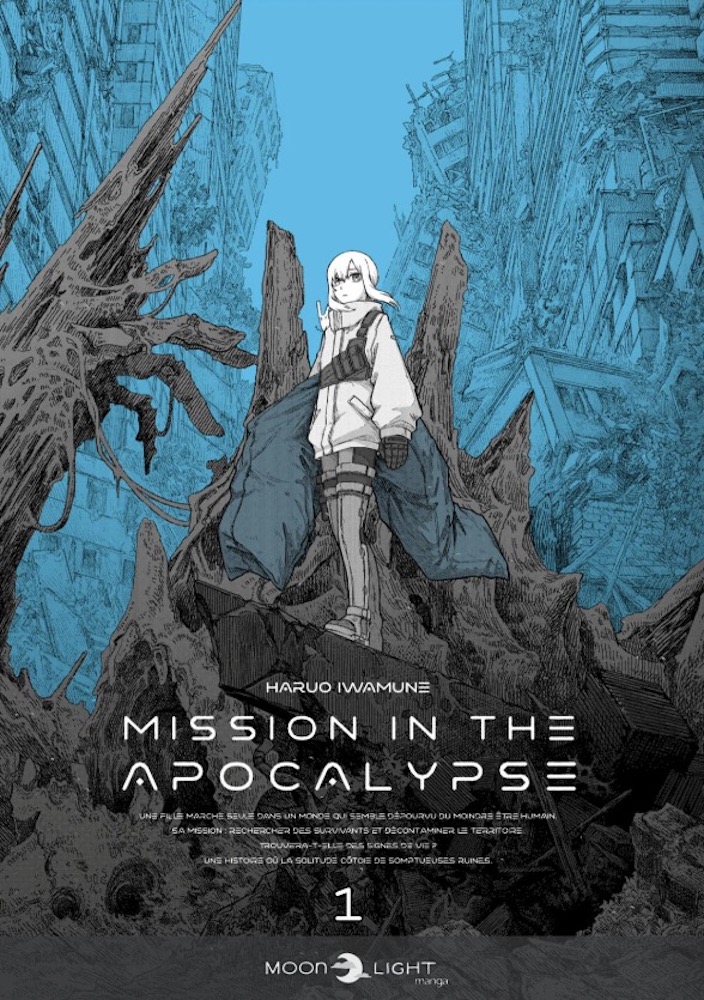
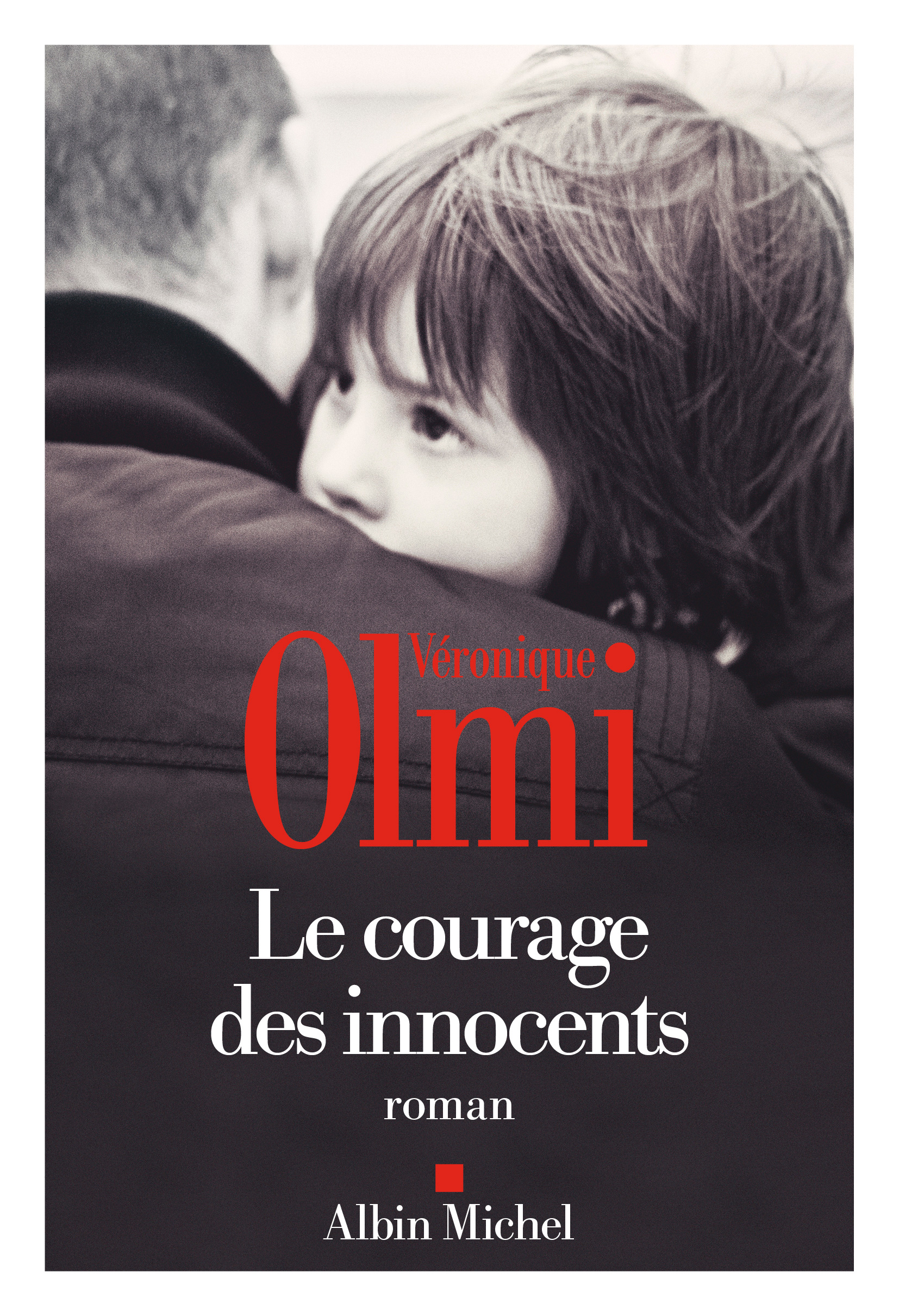
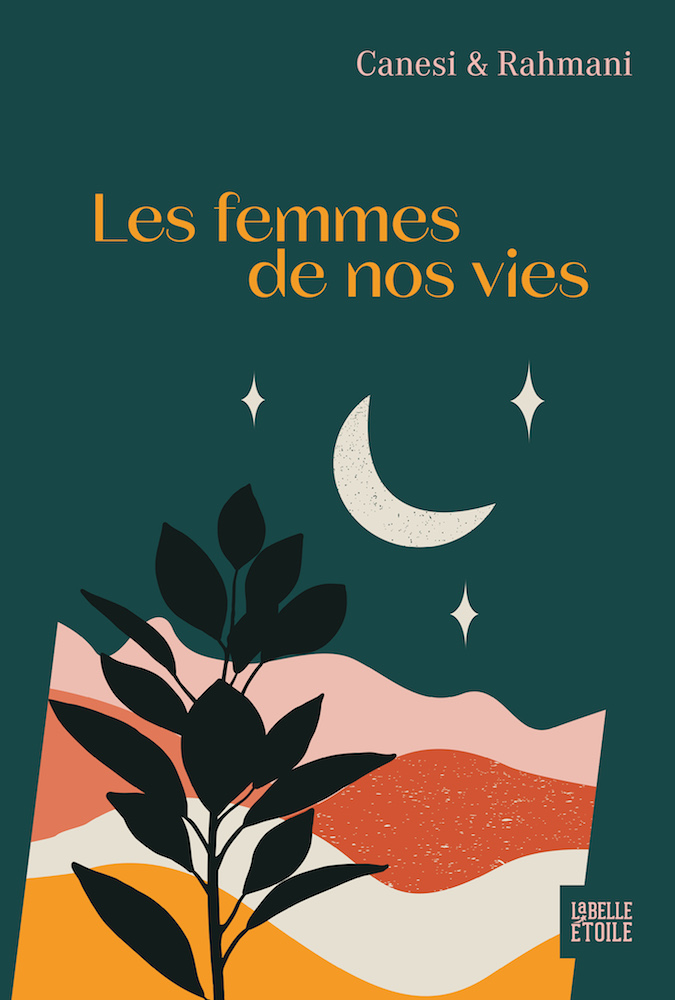
1 Commentaire
Christine Belcikowski
07/06/2018 à 07:58
Mais quelle merveilleuse idée de chronique ! Merci à Antoine Cardinale.
On trouve Le château de Versailles : histoire et description, ici :
Tome 1 : https://archive.org/details/lechateaudeversa01duss
Tome 2 : https://archive.org/details/lechateaudeversa02duss