VanRah, créatrice de manga français, au pays des mythes légendaires
Avec Stray Dog et Ayakashi, Mortician est la troisième série de VanRah à paraître chez Glénat. Elle fait partie des pionnières du manga français, et participait à la conférence « Devenir mangaka en France » proposée par la maison lors de la Japan Expo au début du mois. Nous l’avons rencontrée par la suite pour revenir plus en détails sur son parcours hors du commun.

Mes séries ne rentrant dans aucune case, elles se sont vu refuser de partout, Stray Dog inclus. Les refus étaient le plus souvent accompagnés de commentaires péjoratifs sur mon travail, sans pour autant me donner de pistes pour améliorer mes titres. Mais je ne me suis pas laissé aller, j’avais pleine confiance en mes personnages, en leurs histoires et je voulais comprendre ce qui n’allait pas, ce qui manquait pour être publiée. Alors, un peu par dépit, j’ai commencé à envoyer des dossiers à l’étranger et notamment aux États-Unis, grâce au tremplin de la maison pour laquelle je travaillais déjà en temps qu’encreuse.
J’ai posté les premières pages de Stray Dog, la version encore brouillonne, sur la plateforme d’auteurs indépendants InkBlazers et en l’espace d’un mois, j’étais première du site en termes de fréquentation et d’audience. Stray Dog récoltait plus d’un million de pages vues par jour. Alors forcément, ça a fait réagir l’éditeur américain qui m’a contactée et qui est devenu mon premier éditeur sur la série.
Contrairement à d’autres mangakas, je ne présente pas une ébauche de projet aux éditeurs, je remets des séries clé en main. L’éditeur n’a pas de droit de regard à proprement parler sur ce que je propose. Or, de manière générale, ils ont l’habitude d’accompagner un projet dans sa construction, de donner leur avis afin de façonner les titres en fonction des attentes du public. Or si l’on prend l’exemple de Stray Dog, la série était déjà très avancée aux États-Unis et les attentes du public étaient déjà remplies. Accepter mon titre, c’était donc prendre un risque supplémentaire pour l’éditeur.
Mais encore une fois je n’ai rien lâché. Et tout a fini par se débloquer suite à ma rencontre avec Izu [Guillaume Dorison, NDLR], le coauteur d’Ayakashi. Il avait un scénario et il cherchait un univers graphique pour le mettre en image. C’est en convention qu’il a flashé sur mon style et c’est ensemble que nous nous sommes rendus une nouvelle fois chez Glénat. Grâce à lui, j’ai pu rencontrer l’ancien directeur éditorial, Stéphane Ferrant, à qui j’ai pu présenter une nouvelle fois Stray Dog.
Petite anecdote amusante, il se trouve qu’il lisait déjà ma série en ligne. Alors quand il a vu mes planches la toute première fois, il a cru à un plagiat ! Il a sorti son portable pour me montrer quel artiste j’étais censé copier et la page qu’il m’a montrée… c’était la mienne ! Au final j’ai envoyé mon dossier 4 fois chez Glénat, mais c’est la première fois que je tombais au bon endroit et j’étais ravie. Si j’avais choisi Glénat plus qu’aucune autre maison, c’est qu’à l’époque ils publiaient la majorité des mangas que je suivais comme Bleach, DGray Man ou encore Kenshin.
Dans un comics, on peut stopper sa lecture à tout moment et la reprendre plus tard. En revanche, on quitte rarement un manga en plein milieu d’un chapitre. La mise en page y est bien plus vivante et dynamique, on y est tenu en haleine. Qui plus est, ce qui m’intéresse, c’est de construire mes histoires pour qu’elles puissent être lues comme si l’on regardait un film au cinéma.
C’est aussi pour ça que mes mangas contiennent autant de pages. Ce n’est pas courant de voir des tomes si épais, comme Stray Dog 3 qui dépasse les 450 pages… Mais chaque case est construite comme un close-up, un screenshot du film qui se déroule dans ma tête au moment de l’écriture. Ainsi tant que le film n’est pas terminé, il reste des choses à dire et des pages à dessiner.
Mon stand me sert aussi à présenter les titres que je suis en train de construire, de les présenter en avant-première à mon lectorat. C’est un vrai petit laboratoire, je montre ce sur quoi je suis en train de travailler et avant même d’avoir pleinement abouti les titres, je peux avoir des retours sur ce qui plaît et ce qui plaît moins. Grâce à ce genre de critiques, je décide ce que je peux me permettre de défendre dans l’immédiat et ce qui mérite d’être retravaillé pour pouvoir le présenter plus tard.
Car même si je raconte toujours la même histoire, l’angle et la manière de raconter changent à chaque édition. Je retravaille en permanence mes titres, je reviens à chaque fois sur ma copie afin d’être la plus précise possible. Quand mes lecteurs passent au stand pour me demander si ce qu’ils ont acheté et lu en autopublication deux ans auparavant est semblable à ce qu’il trouve aujourd’hui chez Glénat, je peux leur répondre que non, ça n’a rien à voir avec le premier jet.

Par exemple, il y a une cinquantaine de pages additionnelles exclusives dans le tome deux de Stray Dog, car la réaction d’un des personnages a été mal interprétée et a déstabilisé les lecteurs américains et je ne voulais pas que la situation se reproduise en France.
C’est une scène de combat entre Tarot et Toru qui nécessitaient plus d’explications. C’est là que les commentaires de la plateforme américaine m’ont permis de retravailler le passage de manière pertinente pour dissiper la confusion. Et c’est vraiment efficace puisqu’avec la version américaine, le personnage de Tarot était détesté par les lecteurs jusqu’au tome 3 qui apporte des éclaircissements alors qu’en France, grâce aux ajustements, il a tout de suite été adopté par les lecteurs.
C’est aussi pour ça que je tenais autant à être publiée en France. C’est très valorisant de voir ses titres ainsi suivis à l’étranger, mais rencontrer son public, échanger avec ses lecteurs et recueillir leurs impressions devient vite compliqué quand des milliers de kilomètres vous séparent d’eux. Sans parler de la barrière de la langue. J’ai beau très bien comprendre l’anglais, je fais partie de ces Français incapables de le parler...
Ce sont mes lecteurs et leurs retours qui font évoluer mon travail et mes séries. Même si je suis publiée, je ne me considère toujours pas comme une professionnelle. Il me reste encore beaucoup à apprendre et à améliorer alors je prends en compte toutes critiques allant en ce sens.
En contrepartie, les Américains sont bien plus expansifs et font énormément de commentaires lorsque je publie des planches. D’ailleurs si mes lecteurs français pouvaient entendre mon appel et s’exprimer un petit peu plus j’en serais ravie (rires), leur avis me manque et j’apprécie d’autant plus de l’entendre en convention.
Il y a aussi une bien-pensance aux États-Unis qui n’est pas la même en France. Je m’y suis heurté après avoir utilisé une expression relativement utilisée en France qui existe aussi là bas. Dans Stray Dog, pour qualifier un personnage en complète autarcie, qui ne communique pas, un des personnages dit : « C’est un autiste dans son coin ». De nombreux lecteurs américains m’ont envoyé des messages, car ils étaient choqués que j’utilise l’autisme dans ce contexte. J’ai préféré changer l’expression en français pour ne pas risquer de blesser qui que ce soit.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Avec Izu, nous avons voulu faire un manga qui parlait de sujets dont nous étions friands et dont nous aimons parler et même si nous avons poussé le vice avec une immense documentation, ce n’était pas dans le but d’adapter. C’est plutôt pour s’assurer que si un jour nous avions un regard japonais sur la série, nous n'étions pas trop éloignés de la vérité et que le lecteur puisse s’y retrouver.
En allant sur une convention, j’ai déjà repéré des stands avec des illustrations très similaires aux miennes. Mais le pire, c’est quand je me suis rendu compte qu’une artiste s’était fait publier chez Delcourt en reprenant NeverenD. Même panel de personnages avec des noms différents, mêmes illustrations, même organisation, bien qu’elle y ait ajouté son trait d’auteur, ça n’en devenait pas quelque chose d’original pour autant.
La situation a été très compliquée à démêler, car à l’époque, je n’étais pas encore publiée sur le sol français et ça a été terrible de passer pour la plagieuse pendant des années quand ce travail m’appartenait. Et je sais qu’aujourd’hui encore il y a certains de mes travaux qui circulent sans mon autorisation, alors si cette directive est réellement un outil supplémentaire permettant aux auteurs et créateurs de conserver leur originalité et de préserver leur réputation, je ne suis pas contre.
Mais c’est dommage de devoir en arriver là, ça peut aussi très bien se passer. De temps en temps, je fais moi-même des illustrations reprenant des œuvres qui m’ont particulièrement plu. Mais en amont je demande toujours l’autorisation à l’auteur de reprendre son dessin. Un petit mail pour expliquer les choses et demander la permission, ça ne coûte rien.
Et il faut bien entendu attendre la réponse. Enfin si l’artiste accepte et que l’illustration est vouée à être partagée alors je prends la peine d’identifier la source originale en dessous pour faire un peu de pub à la personne qui m’a inspirée, indiquant aux gens que je ne suis pas à l’origine de l’illustration. Ça ne coûte rien, mais peu de gens le font parce que ça remet probablement en cause leur créativité...

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Lorsque j’avais sorti une fan fiction basée sur l’univers de Kingdom Hearts par exemple, j’avais bien précisé que certains personnages étaient tirés d'un univers qui ne m’appartient pas. Même si tout le reste est une création personnelle, j’ai bien conscience que les créateurs sont en mesure de récupérer ce que j’ai fait et ce ne sera pas un souci, c’est annoncé.
Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Souvent en convention, je croise des stands qui ne présente que du fan art sans une once de création originale. Beaucoup se défendent en assurant qu’ils ont redessiné avec leur style, certes, mais encore une fois, ça n’en fait pas une création originale pour autant. Ces stands font recette grâce à des personnages qui ne leur appartiennent pas, sur des droits d’auteur qui ne leur appartiennent pas non plus et qu’ils ne reverseront d’ailleurs jamais. À ce niveau-là, j’appelle ça du plagiat.
Avec le fan art, on va dire qu’il y a une sorte de charte intégrée. On peut réaliser de petites choses, et s’octroyer le droit de les vendre à raison de 20 % de la totalité du stand. Quand on dépasse cela, ça devient de la contrefaçon. À partir du moment où la recette est importante alors qu’on a ajouté son nom d’artiste sur un concept qui ne nous appartient pas, pour moi ça devient du vol.
Je dirais que je distingue trois degrés de fan art : l’hommage, la copie et pire encore, le vol. Lorsque l’on rend hommage au travail d’un artiste, on ne se met pas en avant en tant qu’auteur et on ne vit pas des recettes. C’est fait par les fans, pour les fans et si l’envie d’aller plus loin se fait sentir, on demande l’autorisation. Ça s’est vu avec Huke, l’illustrateur de Black Rock Shooter. À la base, c’est un fan art de la vocaloid Miku Hatsune version rock qui est finalement devenue un manga. Mais il a fait les choses dans l’ordre, il a demandé l’autorisation et ça a marché.







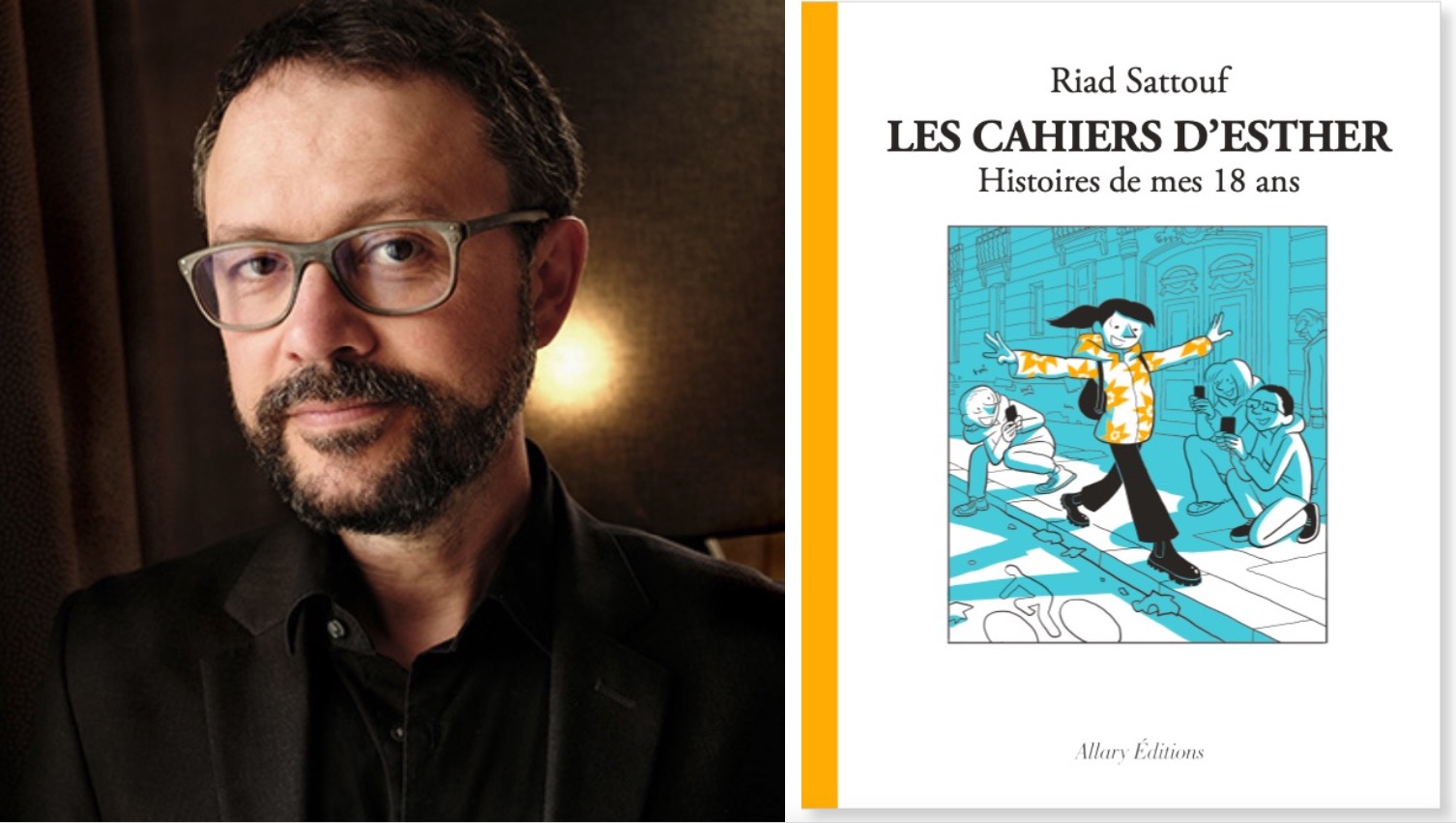











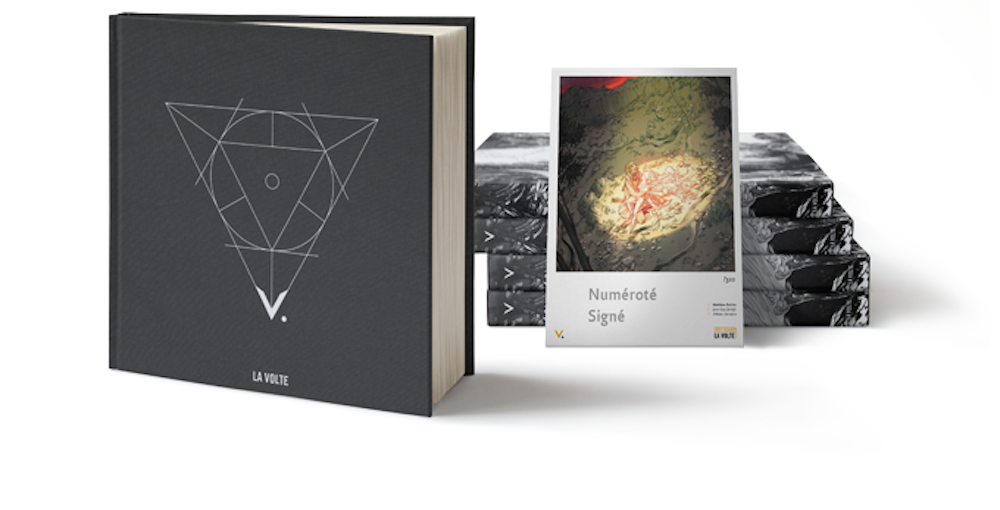

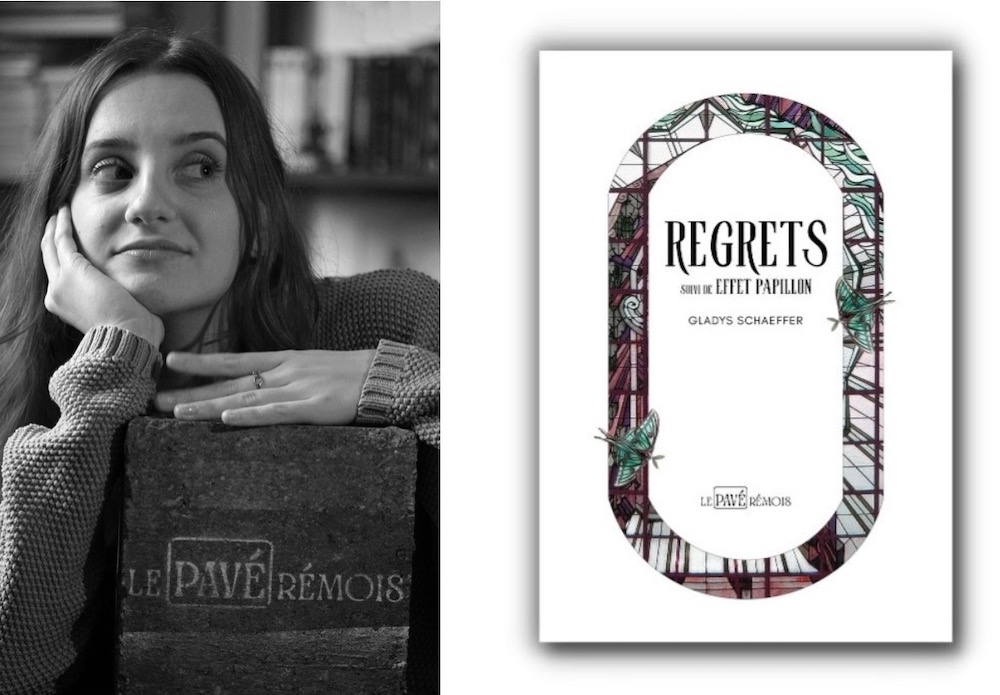

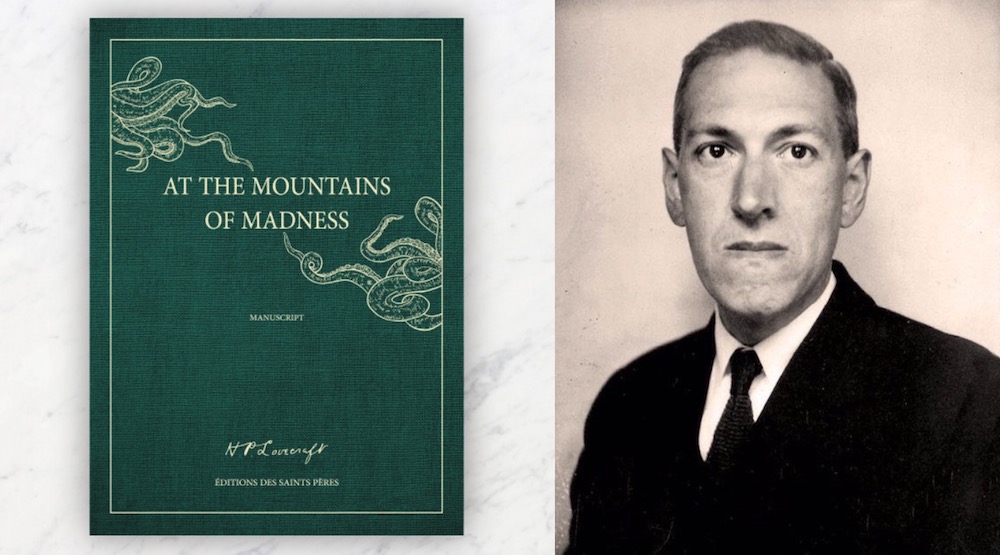







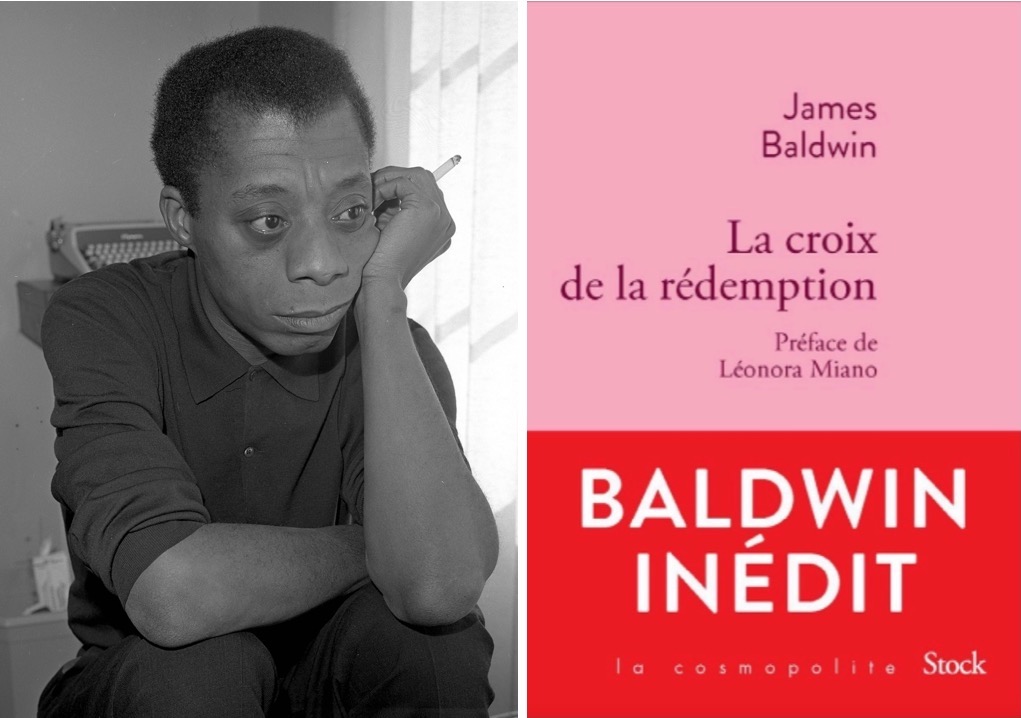







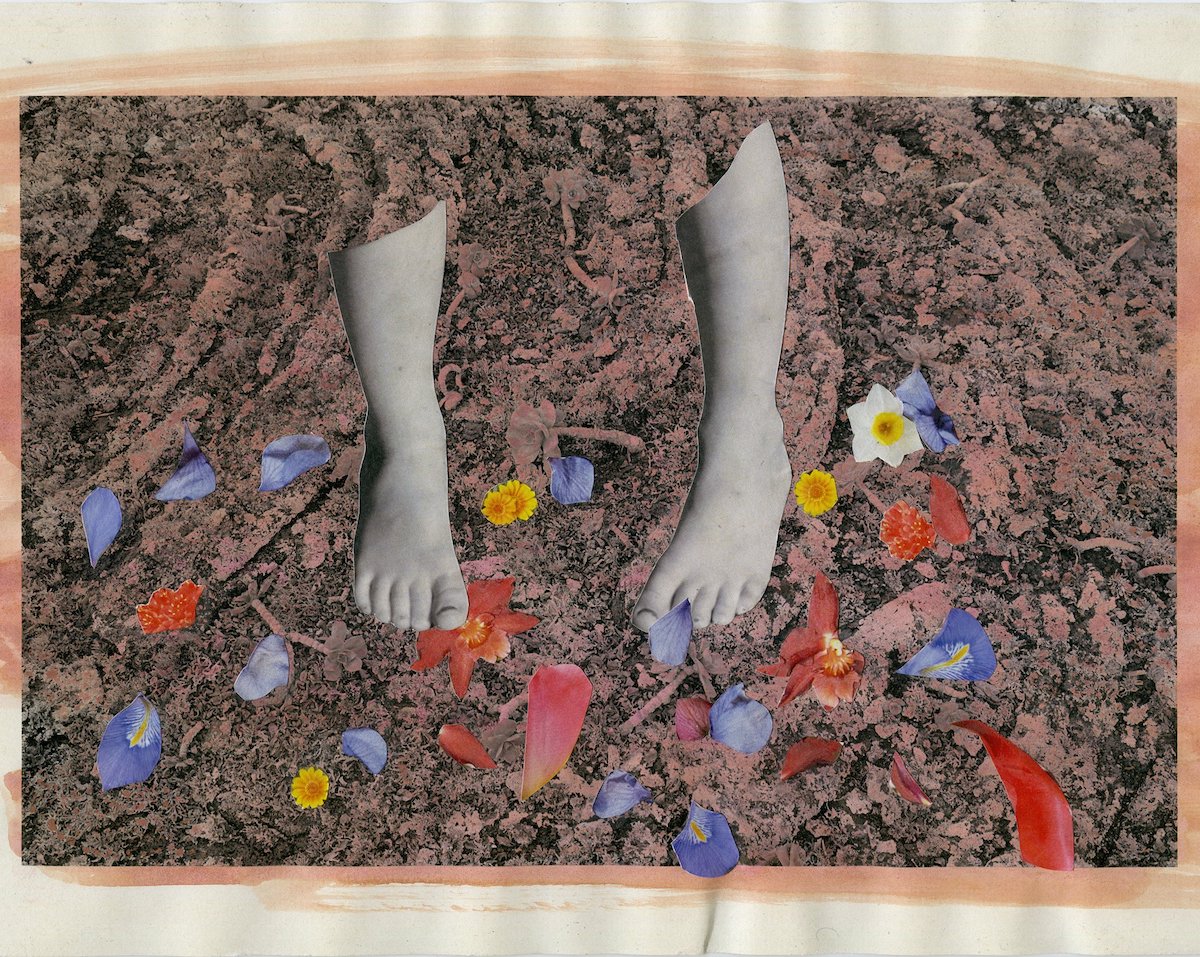














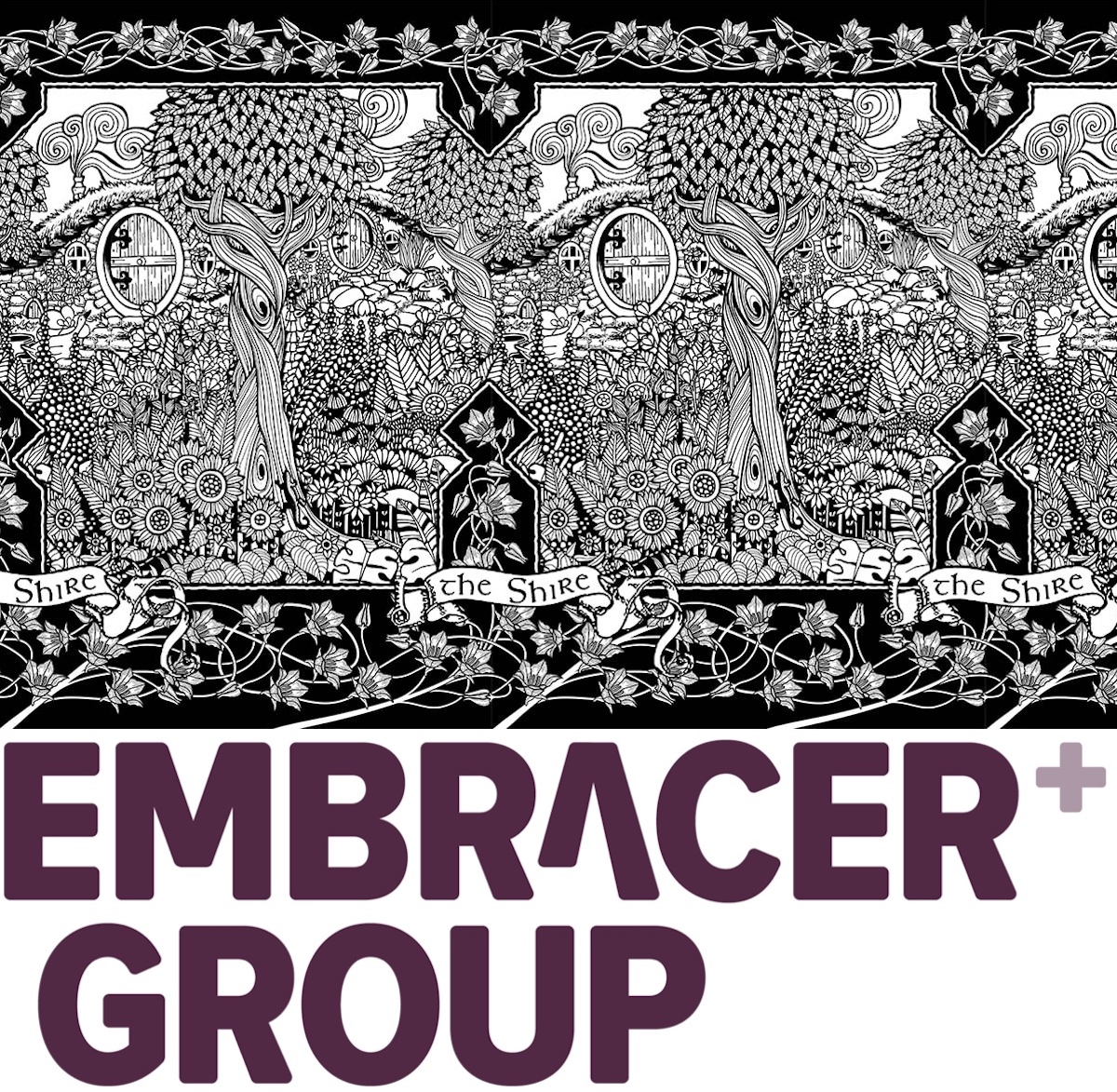














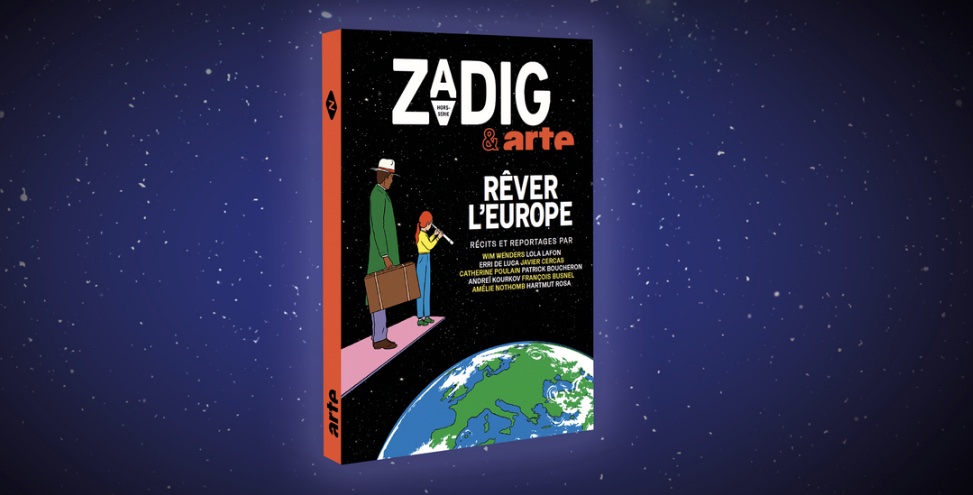




Commenter cet article