Les Ensablés – "Miroir du temps" d'André Suarès (1868-1948)
Paru aux éditions Bartillat, Miroir du temps est un recueil d’articles d’André Suarès - certains inédits - de préfaces, de fragments de correspondance, voire de documents plus intimes encore, comme le testament de l’écrivain : peu de livres permettront de saisir aussi complètement un auteur qui sort lentement d’un oubli et dont les plus connaisseurs parmi les lecteurs ne pouvaient citer que le Voyage du Condottiere.
Ce recueil de textes parvient à restituer, en marquant la chronologie, les thèmes qui habitent son oeuvre. Des thèmes dont l’actualité permet de rendre cet auteur à son temps tout en le ramenant au nôtre. André Suarès écrivit toute sa vie le manifeste d’un art nouveau, qu’il souhaitait tout à la fois classique et régénérateur ; à l’imitation aussi de ce Speculum majus, ce Miroir dans lequel Vincent de Beauvais mit toutes les certitudes du Moyen-Age et qui voulut, selon Louis Gillet, « lier en système tout l’héritage des connaissances venues de l’Antiquité, le legs intellectuel de la Grèce, avec les vérités de la Révélation ».
Après avoir lu avec attention l’érudite préface de M.Barsacq, les amateurs feront de Miroir du temps l’avant-propos nécessaire aux œuvres de ce grand écrivain : toute la diversité, toutes les contradictions de l’écrivain, et l’essence de son style, sont là.
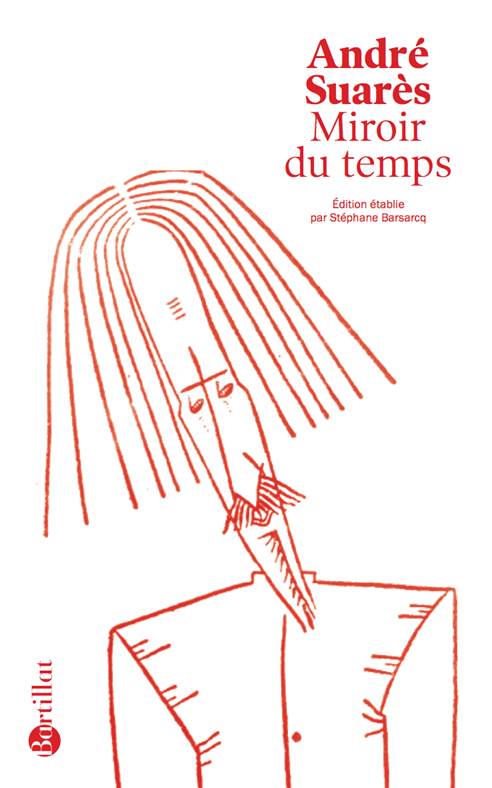
Où il n’y a ni forme, ni ordre, il n’y a rien. (André Suarès)
Une inépuisable curiosité
Dans son choix de textes, cet ouvrage n’écarte ni la question des origines, ni celle de cet éclectisme, par lequel l’écrivain tenta de faire vivre ensemble son aspiration à un art moderne et sa foi inébranlable dans l’art ancien ; ni cette formidable curiosité dont le sommaire de cet ouvrage nous donne le vertigineux résumé : Pétrone et Suétone ; Ronsard et Bossuet ; Charles Péguy, Bourdelle ; saint Paul et saint Augustin ; mais aussi la Peinture, la Danse et la Musique, Céline, Dostoïevski et d’Annunzio.
Il serait facile de mettre en avant, à travers son inépuisable curiosité, l’universalité de Suarès : ce mot flatte l’homme paresseux du XXIème siècle et il sonne pour lui comme la délectable promesse de réconcilier sans effort le tout et ses parties, de jeter des ponts prodigieux entre des productions que rien en réalité n’apparente, de marier le trivial et le sublime, de toujours en somme éviter le conflit et de jouer en somme la hiérarchie des œuvres au bonneteau de la mode.
Dans ce qui nous paraît une dispersion, André Suarès voulut au contraire voir un effort noble, paradoxal, et nécessaire : il reconnut d’ailleurs chez Léonard de Vinci cette ambition : Léonard est la preuve que l’artiste ne peut pas se répandre en tous sens, s’il veut s’accomplir dans une œuvre, mais il n’y a pas de générosité plus grande que de courir un tel risque. André Suarès a voulu courir ce risque, et cet ouvrage nous fait sentir l’organisation et le programme d’une œuvre dont il est difficile souvent de saisir le fil.
La tentation classique
Comme nous l’indique la citation de René Girard qui ouvre la préface de ce livre, c’est au « grand art classique » que Suarès aspirait. Et qu’il comptât pour y entrer sur la Fureur, comme le dit René Girard, ne doit pas totalement nous surprendre. Cet homme du Livre se sentait de force à donner à son pays, à son siècle, des institutions et peut-être même une religion ! Sa prose prend parfois des accents prophétiques, avec une forte tendance aux questions sociales, et un penchant pour l’utopie qui rendait impraticables les routes politiques qu’un sens moral élevé ouvrait devant lui. Il conciliait, avec le naturel du fanatique, le pessimisme hautain du présent et une confiance théologique dans l’avenir. Et, cela dût-il nous surprendre, c’est une attitude parfaitement classique : Racine, Bossuet aspirèrent toujours à donner une forme religieuse à l’art classique, qui n’y est pas entièrement contenu mais qui le marque fortement, et qui lui donne un accent parfaitement reconnaissable.
La disparition de Suarès de l’horizon littéraire, peut-on l’interpréter comme le rejet de la greffe de l’esprit classique sur celui du XXème siècle ? Car sa tentative fut de faire rentrer l’esprit classique dans ce siècle (1). On se trouverait bien mal, après M. Fumaroli, après Georges Steiner et tant d’autres esprits brillants, de vouloir définir l’art classique, ses canons et la hiérarchie de ses œuvres, et notamment ce que le classicisme emprunta aux différents climats : il fut en France, national, monarchiste, rénovateur chez Charles Perrault mais conservateur chez Boileau. En Italie en revanche ce classicisme fut antiquisant, historicisant, d’esprit républicain et marqué par une forte sensibilité aux arts plastiques. Suarès emprunte beaucoup à ce classicisme italien, qui transformait peu l’idéal humaniste des XVème et XVIème siècle qui forma le royaume de l’Homme renaissant (2).
Il était, il me semble, convaincu que le goût classique pouvait dominer le siècle à condition qu’il sût en affronter la nouveauté ; pour cela, il fut attentif à ne pas méconnaître les audaces de l’art de son temps. Dans le Voyage de Céline par exemple, il sut voir les caractères barbares et chrétiens, le message de Charité et le grouillement lugubre du cloaque. De même, avec une audace qui aujourd’hui nous échappe peut-être, il soutint Wagner, le rattachant à la vieille recherche classique : La grandeur de Tristan est effrayante. Tristan est conçu comme Phèdre ou Bérénice, un entretien acharné des passions face à face.
Il y eut en effet, au tournant du siècle, une aspiration, un retour extraordinaire du goût classique. Consulté sur le sujet (3) Marcel Proust, si circonvolutif, si subtil, s’exprime catégoriquement : Tout art véritable est un art classique mais dans sa courte réponse, n’explicite rien. Paul Valery, au même moment, en donne une définition élastique, voyant dans le « grand art » l’engagement de toutes les facultés de l’artiste et la mobilisation de toutes les facultés de l’amateur. Peut-être était-il nécessaire que cette aspiration nouvelle au classicisme en passât au préalable par un inventaire sans concession du XIXème siècle.
Le romantisme, cette maladie de jeune homme, avait relégué au magasin d’accessoires le théâtre classique ; la peinture du Grand Siècle pourrissait dans les greniers d’un Versailles abandonné, mais alors que la génération de 1820 naissait romantique, la génération de 1840 commençait à se déprendre de ce goût maniaque du contraste pour le contraste, de l’amoncellement de détails expressifs ou de la complaisance dans l’horrible (4). La littérature française se fragmentait en naturalisme, réalisme, symbolisme ; le romantisme devint une sorte de religion à laquelle on voulait bien croire mais dans laquelle on ne communiait plus guère, toute d’emprunt et de pure apparence. S’il confesse encore une tendresse pour les romantiques tardifs, il est sans pitié pour les Pères fondateurs. Dans Chateaubriand il scrute le chrétien et le monarchiste et ne trouve nulle sincérité dans le premier et peu de convictions dans le second ; enfin, donnant toujours à entendre un largo assai funèbre qui donne les mêmes couleurs aux landes bretonnes, aux forêts des Florides et à la Terre Sainte et qui finit par faire de ses déplorations une lassante ritournelle.
Après cet inventaire, André Suarès proposa une profession de foi du classique, ce que ni Proust, ni Valery ne se risquèrent à formuler : La culture est une autre nature, plus parfaite et plus vraie, qui dans l’homme accompli prend le pas sur la nature brute et sur l’homme imparfait. Pour lui, il existe une loi nécessaire qui nous rapproche des siècles passés. Cette loi rend visible, explique et unifie la succession des temps historiques, et dans ce cadre, le goût, les écoles et les techniques évoluent sans se renier. Cette confiance dans la culture, ce credo du continuum des siècles sont les colonnes du temple classique.
Les Classiques trouvaient à s’appuyer sur la religion de la Faute pour racheter l’infirmité humaine. Suarès ne trouve en lui qu’un fonds de nihilisme et de scepticisme qu’il tient de la génération de 1840, celle qui s’incarne en Anatole France. Ce dernier ne proposait qu’une voie spirituelle bien rétrécie : que l’Homme apprenne seulement à connaître sa triste et nulle condition. A renier l’espérance qui est dans la voie chrétienne, on s’interdit de rejoindre l’inspiration qui fut celle de la voie classique, on s’interdit d’entrer dans le temple.
Le retour à l’antique
C’est pourquoi Pétrone, fixé dans le doute salutaire et la sagesse d’Epicure incarna idéalement la tentation finale d’André Suarès. C’est le seul portrait où paraît une admiration sans conditions : des vingt lignes que Tacite réserve à la mort de Pétrone, il tire toute une philosophie, et construit un moment tragique sur lequel on pourrait modeler toute une vie : Les idées et l’expérience du monde n’ont pas labouré ce front. Elles n’y ont pas laissé la trace de l’effort, ni les marques de la défaite. Sur le front de Pétrone, je ne lis point la hauteur ni la mélancolie de la sérénité. Il a l’éclat de la grande intelligence, pour qui la vie est un plan à bien lire : la tranquille possession de soi, l’ordre dans les souvenirs, la promptitude dans le choix que l’action propose ; la volonté toujours prête. C’est le portrait d’une intelligence supérieure, d’un goût éclairé, faisant de sa sagesse, sans passion, sans mystique, un secret, et de ses mépris un talisman pour tenir l’infirmité du monde à distance.
Cette féerie de la vie heureuse, cette morale aristocratique, que Pétrone emporte avec lui, Suarès la retrouve dans le dessin et le frais coloris des Muses de Véronèse. « Des trois la plus séductrices, l’une, au fond, est assise et pince du théorbe. Près d’elle, la plus belle, debout, chante en lisant le texte dans un livre, qu’elle appuie sur son beau ventre d’ambre. Elle est longue, fine, et ces tendres seins ronds ont le galbe de la coupe et la fermeté souple du fruit. La plus charmante, au premier plan, vêtue de brocart à ramages d’or et de soie changeante plus étroitement que toutes les autres, joue d’une viole couchée sur ses genoux. Elle tourne le dos ; mais sa figure ravissante regarde, en souriant à peine, de profil ; à qui sourit-elle, cette Vénitienne d’Athènes et de Paris ? Elle a les traits les plus délicats et les plus nobles, une ligne exquise de long calice, un port d’anémone et de candide iris. Et sa chair, parce qu’elle est voilée, est celle que l’on désire ».
Tout lui plaît, tout lui est de plain-pied dans le monde antique. Ainsi lorsqu’il trouve aux vieilles légendes de la Rome ou de la Grèce ce tour barbare, cet air de contes pour enfants, atroces et naïfs à la fois, ce fond de magie un peu ridicule, mais inquiétant encore. Là encore, il est dans l’esprit des classiques : Il faut toujours interpréter l’antique. Euripide et Eschyle le faisait déjà, et face à l’âpreté et parfois à l’obscénité de l’Histoire romaine et de l’Histoire sainte, Racine et Corneille les imitaient. Le point de vue du lycéen André Suarès dont l’Eloge d’Homère emporta le premier prix du Concours général et « saisit d’admiration » Anatole France, ce point de vue ne varia jamais.
Avec quelle délectation savante il retourne à ses préférences (2) ! Laissons-le nous plonger dans la double vie de ce Suétone écrivant les Portraits et menant l’enquête, interrogeant les archives secrètes de l’Empire et les derniers survivants pour retrouver les vérités formidables et atroces du siècle de Tibère et Néron : Gaius Suetonius Tranquillus, calme et sérieux, impénétrable, ayant travaillé avec l’empereur, sort du cabinet, comme tous les soirs, à la même heure. Du même pas, du même air assuré, il se rend à l’office des postes et transmet les ordres attendus. Il confie aux courriers les dépêches qu’il vient de libeller, touchant l’impôt d’une province, les mouvements d’une légion, ou seulement l’achat d’une statue, la recherche de quelque manuscrit rare. Et l’on pense qu’il a fini sa journée. Elle commence au contraire. Il sait entrer dans les lieux interdits. Il est habile à faire parler les vieux eunuques plissés par la rancune, à confesser les vieux esclaves ».
Des grands auteurs, il sut cependant faire un inventaire plein de discernement. Il porte un jugement sans aménité sur l’honnête et suave Marc-Aurèle comme disait Renan, incapable de décider du rôle qu’il lui fallait jouer sur la terre, et ne sachant s’il faut que la pitié commande à l’implacable application de lois ou l’ordre implacable de l’Empire aux conseils de la tolérance. Saint Augustin ? Suarès se confessera chrétien dans son testament - je suis fidèle à toute la beauté chrétienne – mais il n’a pas de mots assez durs pour le Père de l’Eglise. Saint Paul ? Il le met en scène devant l’Aéropage, mais sans beaucoup de tendresse.
Inscriptions
Qu’eût-il souhaité enfin ajouter à l’art ancien, qu’eût-il fallu ajouter au vieux corpus pour que la greffe prît ? Peut-être tient-on la réponse : La liberté est mon essence écrit-il dans une lettre. Ce mot de liberté, spécialement chargé de la transmission de choses vagues, et au sujet duquel Paul Valery se demandait avec ironie, qui de la philosophie ou de la police, avait commencé le débat, Suarès souhaitait que les artistes en fissent constamment le choix. Il y voyait la condition nécessaire pour acclimater l’idéal classique à l’esprit du temps. Que lui manqua-t-il, sinon d’écrire cette œuvre qui pût illustrer et défendre son approche de l’art ancien et qu’il n’écrivit jamais ?
Dans sa préface, Stéphane Barsacq nous propose trois manières délicieuses d’approcher André Suarès et je laisse aux lecteurs le soin de les découvrir. Je me permets d’en ajouter une quatrième, qui est tout uniment d’aborder à cette île-continent de la littérature par Miroir du temps.
Sur la foi de l’intéressante biographie de M.Pariente nous pensions connaître l’épitaphe, très conforme à son image de poète maudit, que l’écrivain voulut voir graver sur sa pierre tombale (5). Il semble que cet écrivain singulier se proposait en réalité différents textes pour entrer dans son au-delà et M.Barsaq nous permet de lire en quelque sorte le projet officiel, celui qui figure dans le testament de l’écrivain. L’inscription qu’il souhaita sur sa « dalle aux Baux » est toute simple : Il ne vécut que pour l’amour et la beauté.
(1) Antoine de Rosny La culture classique d’André Suarès, Garnier, 2019
(2) [Il] a voulu l’héritage des siècles amoureux et guerriers, les trésors de la passion et de l’art, le royaume de l’Homme renaissant. Gabriel Bounoure, cité par S.Barsacq, Préface.
(3) Enquête sur le classicisme, La Renaissance, 1921
(4) Rolland Chollet, Préface au Colonel Chabert, Rencontres, 1959
(5) Laissez-moi loin de toute route / Si seul que j’ai toujours vécu/ Que le ciel et le vent écoutent / Mon silence de grand vaincu.

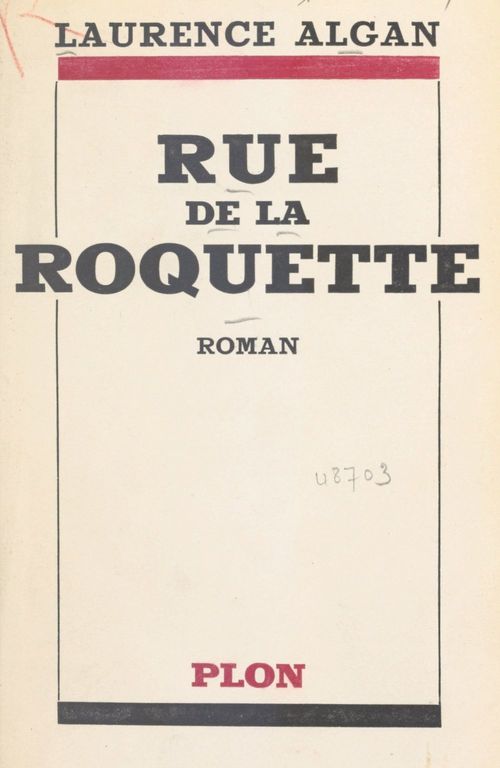
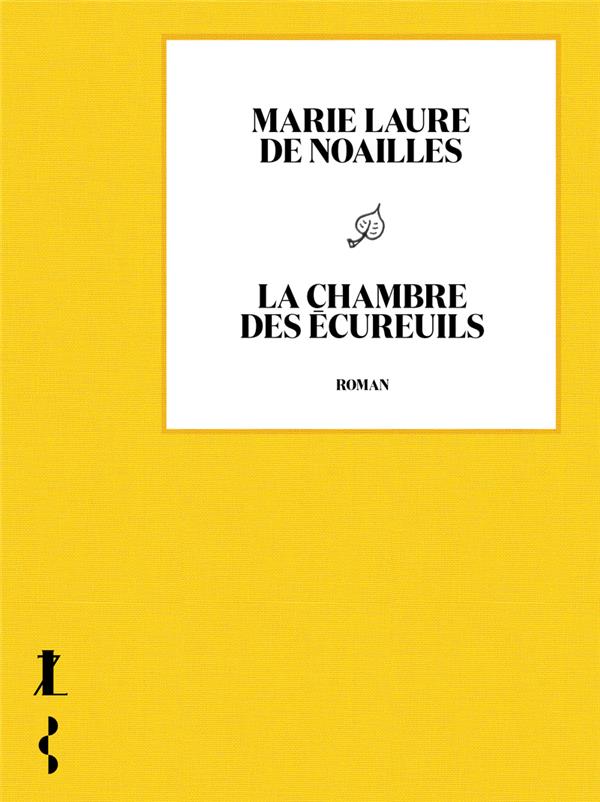
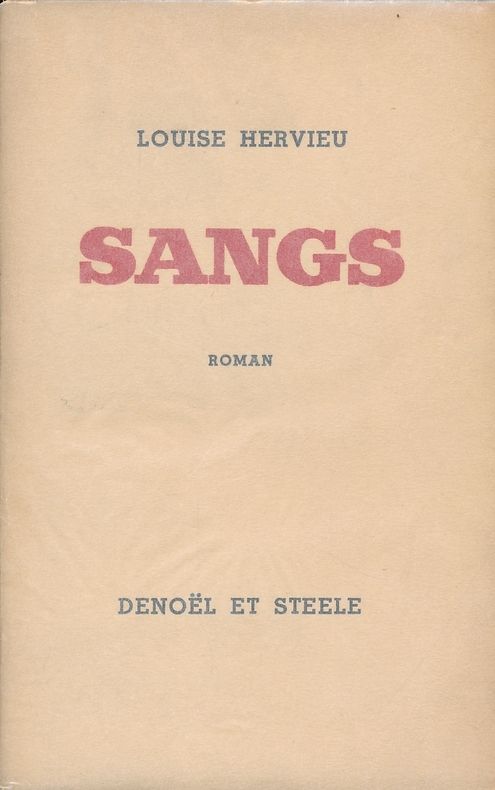
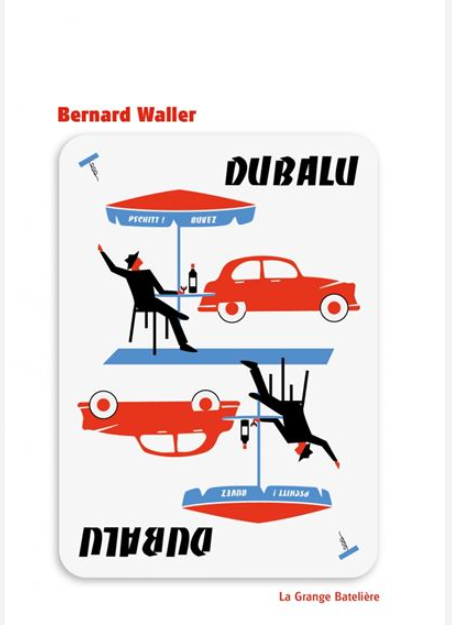
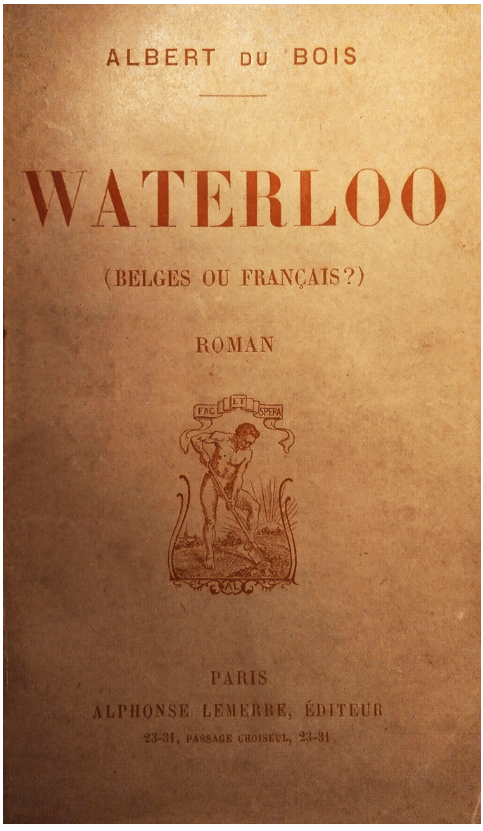

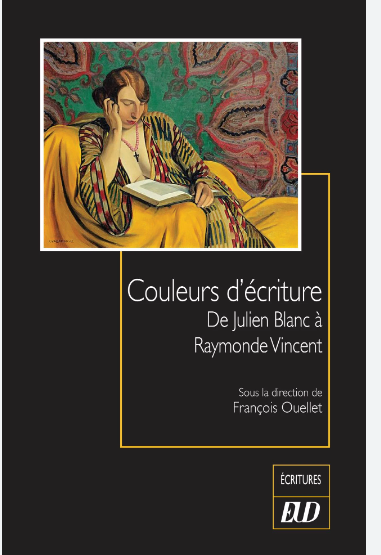
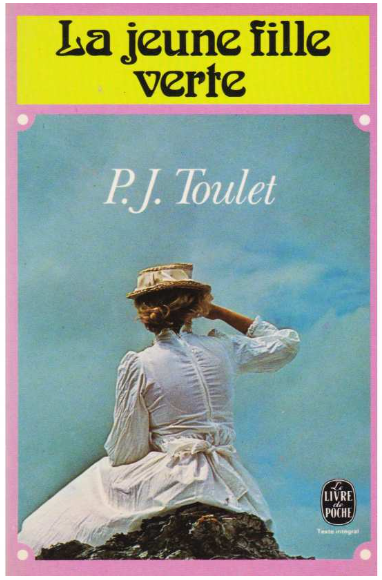
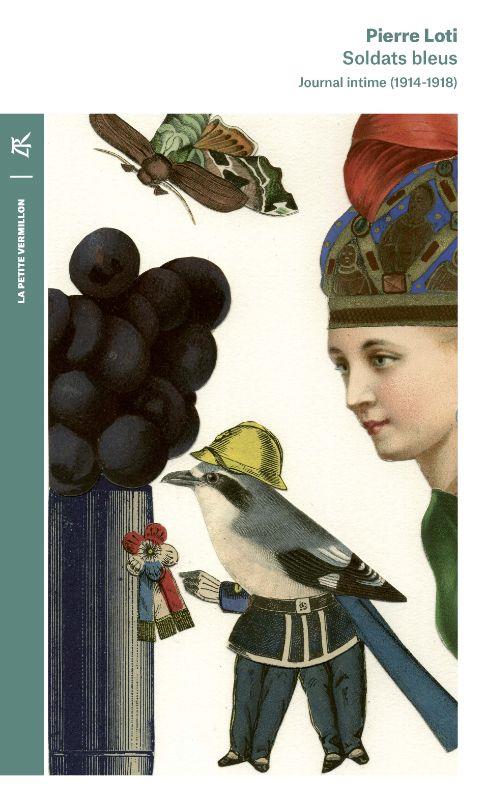
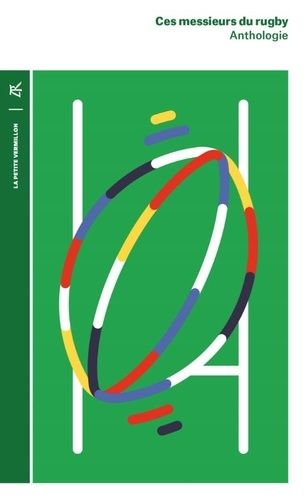
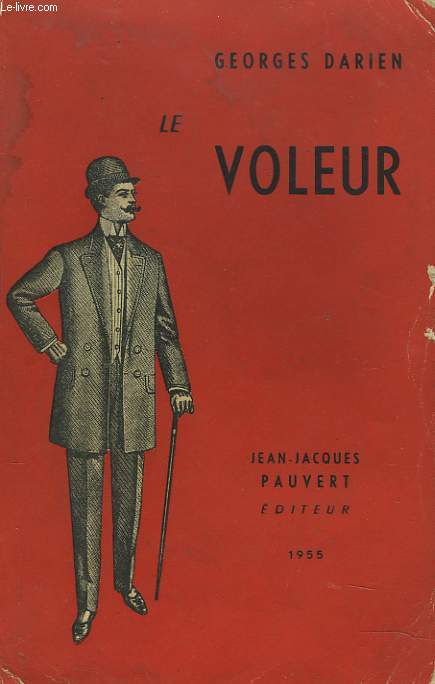
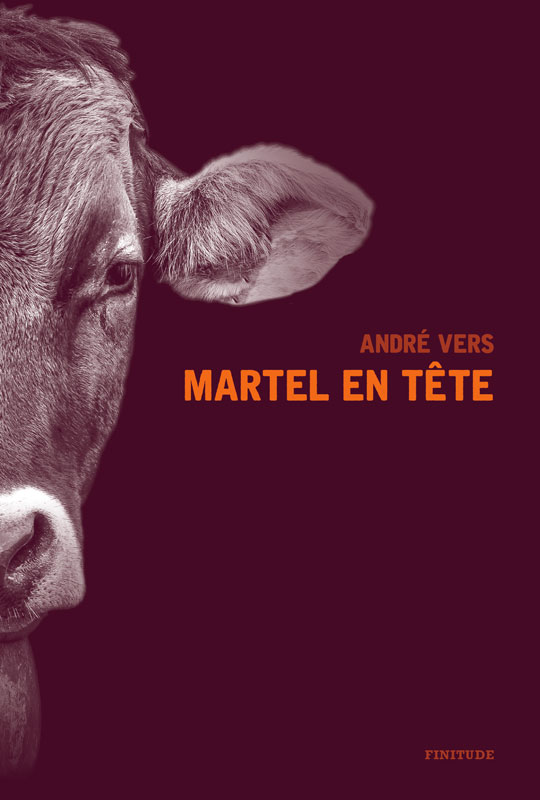

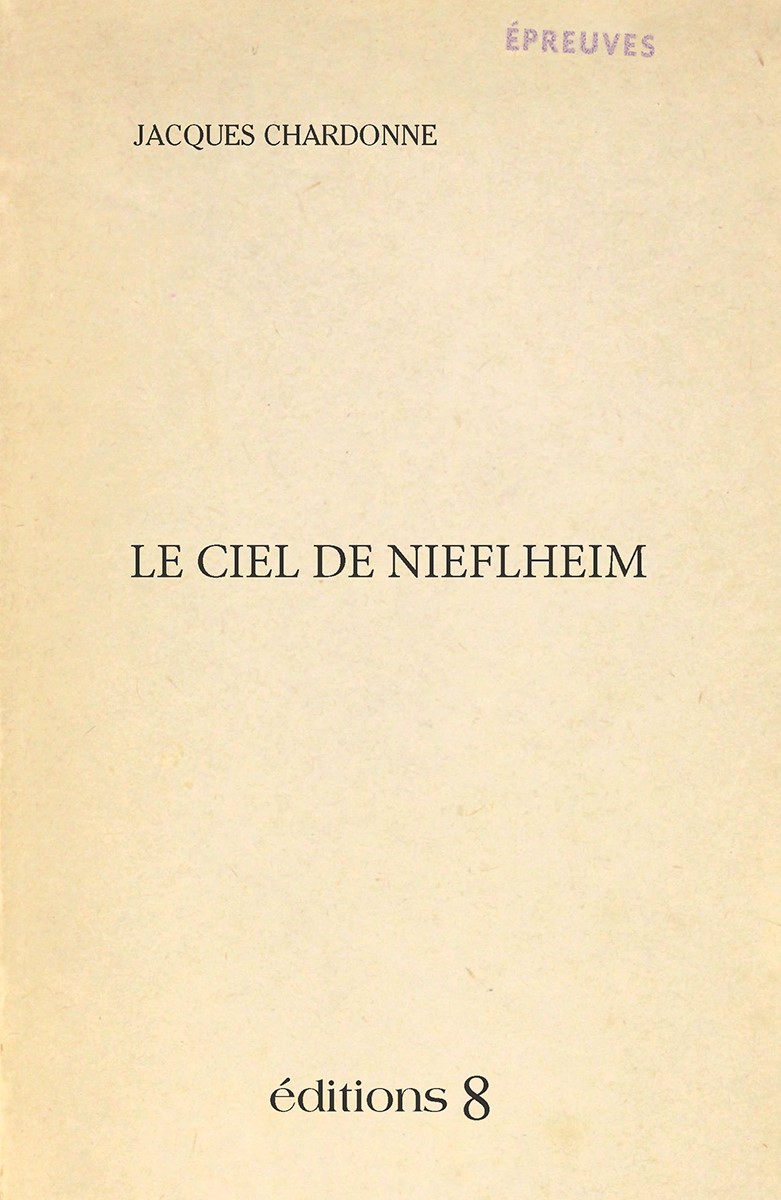
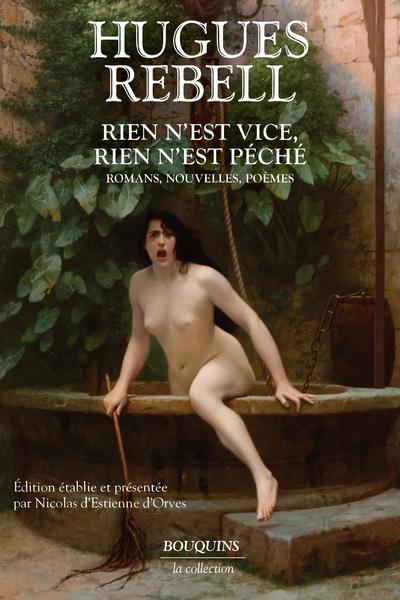
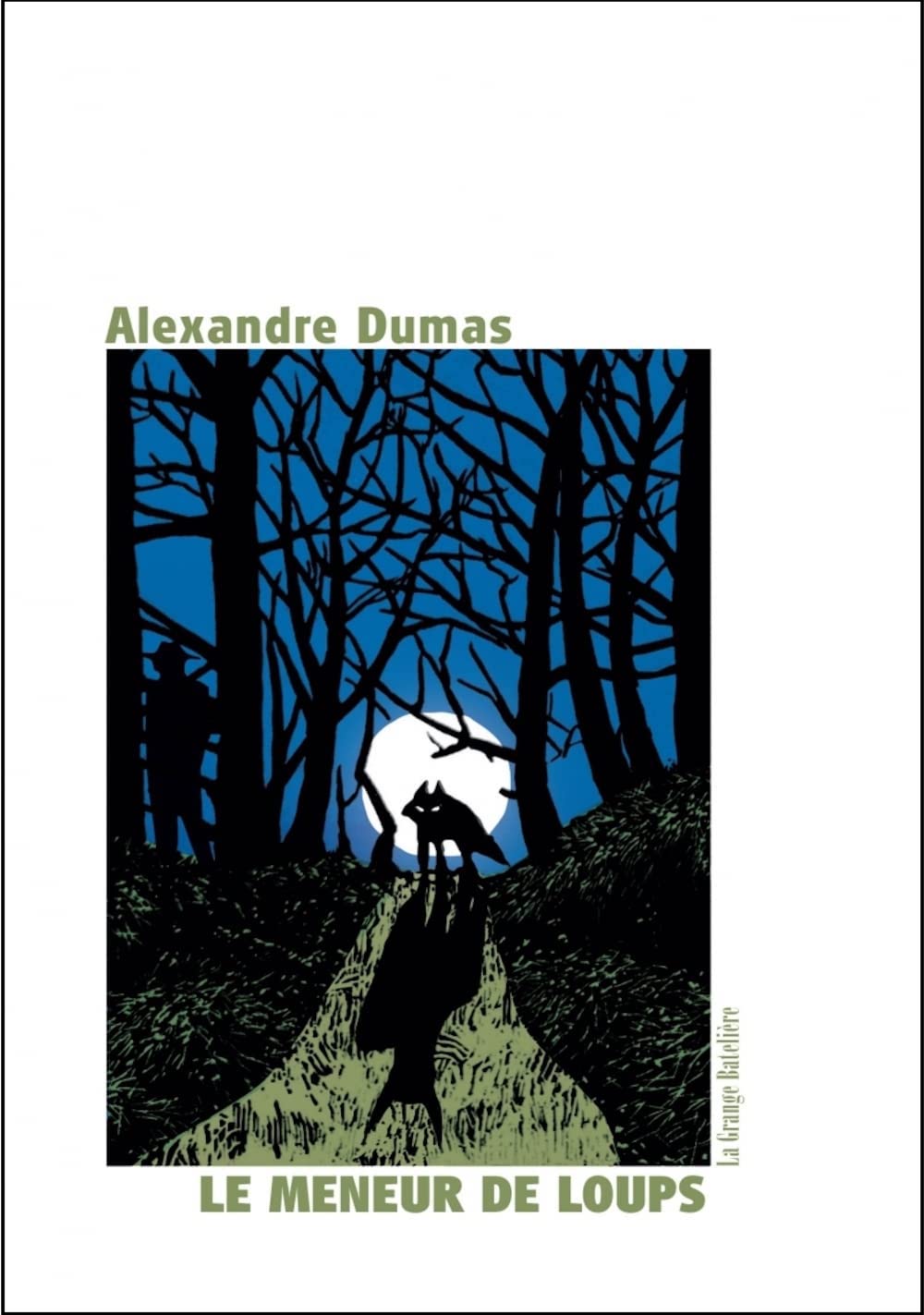

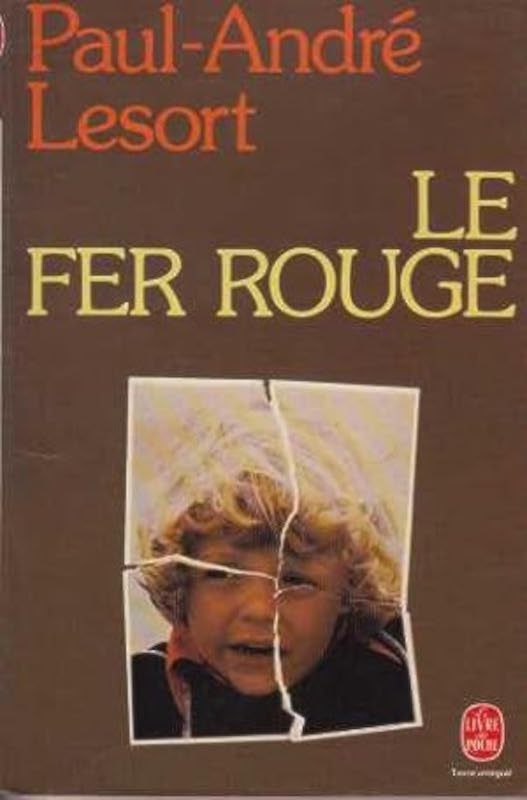


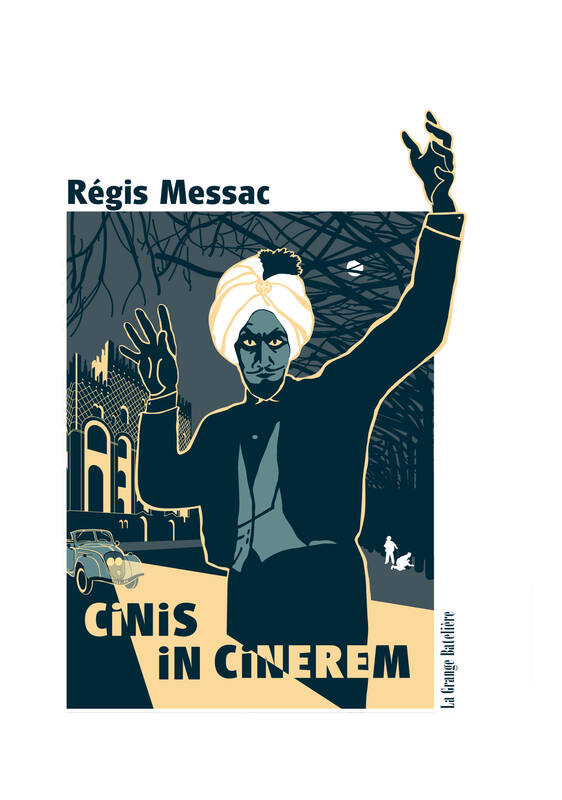

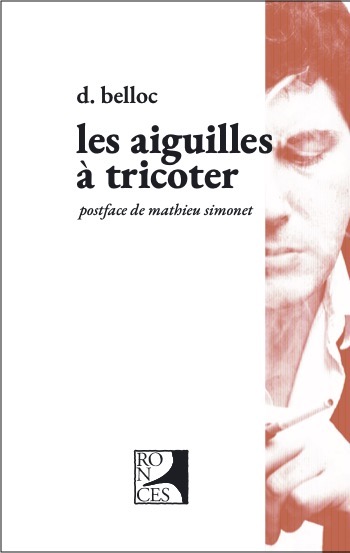
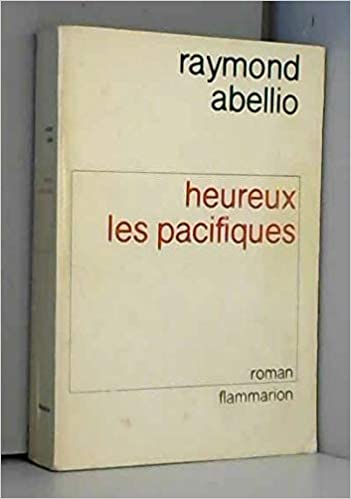
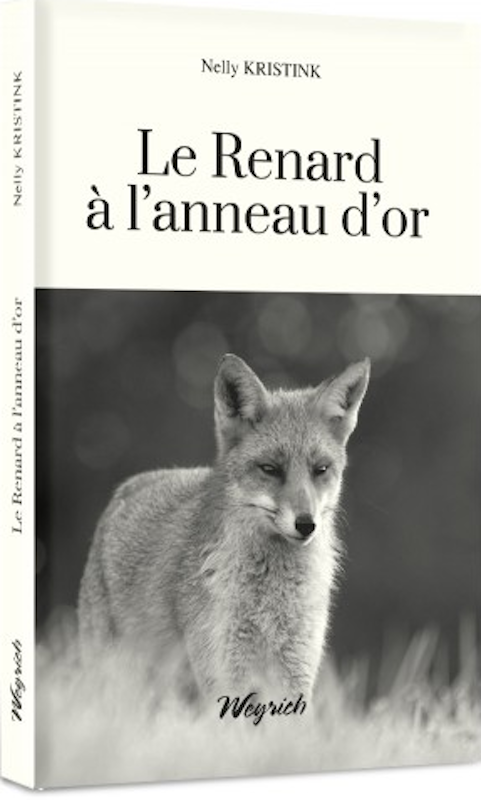
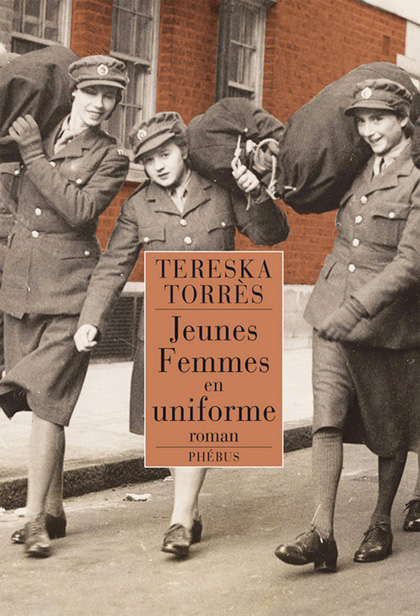
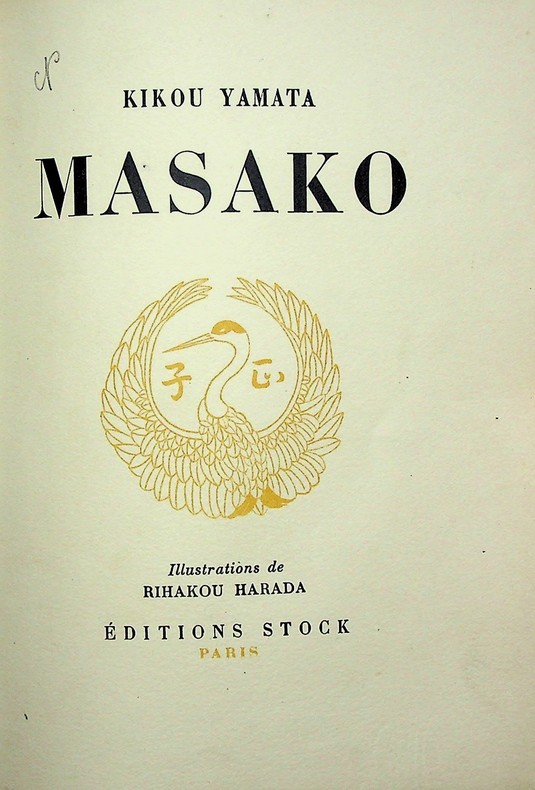
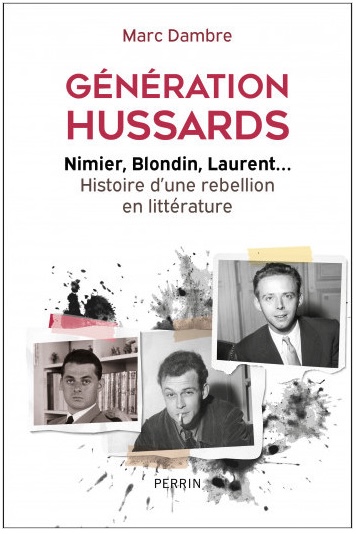
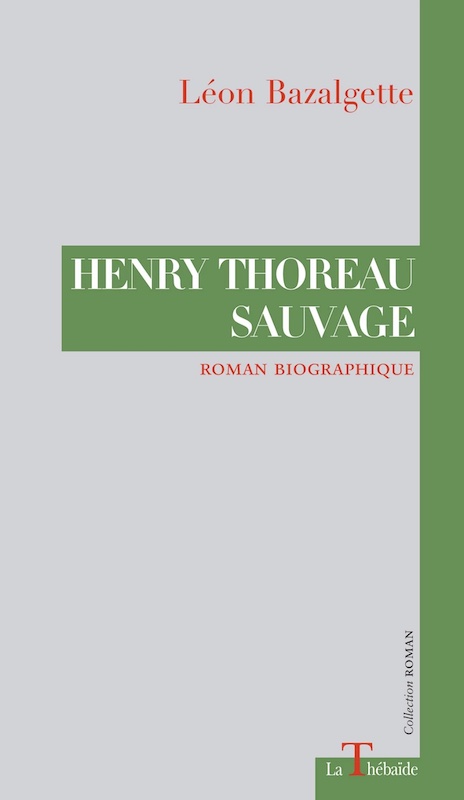

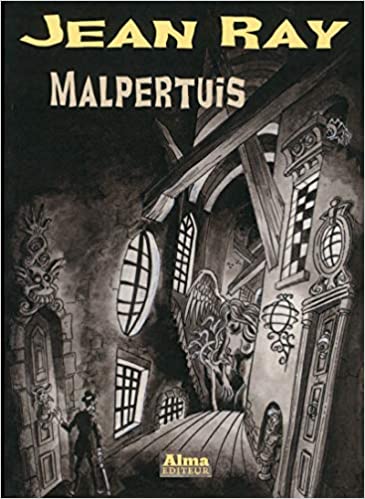
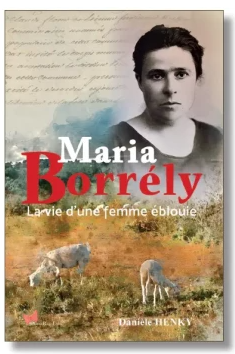
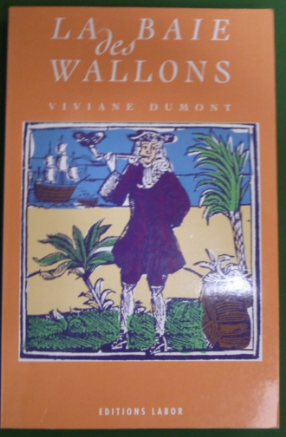

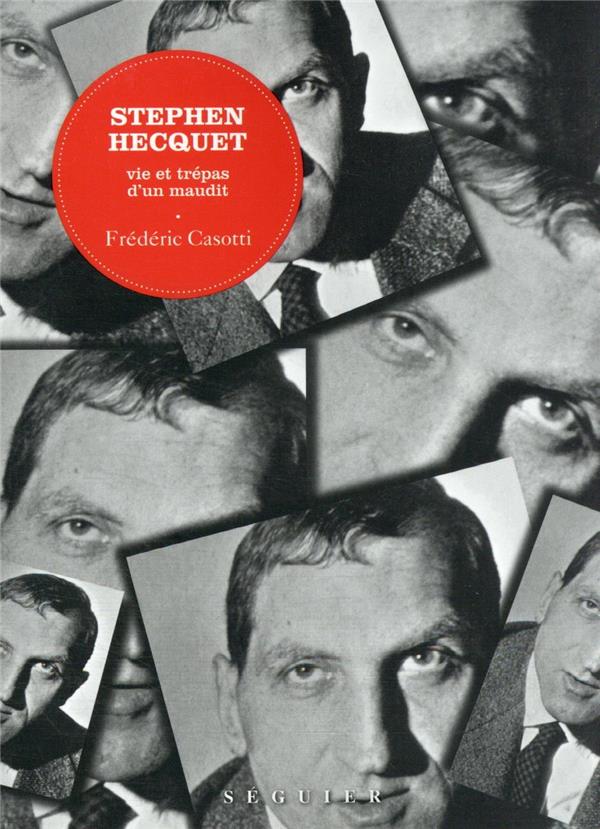


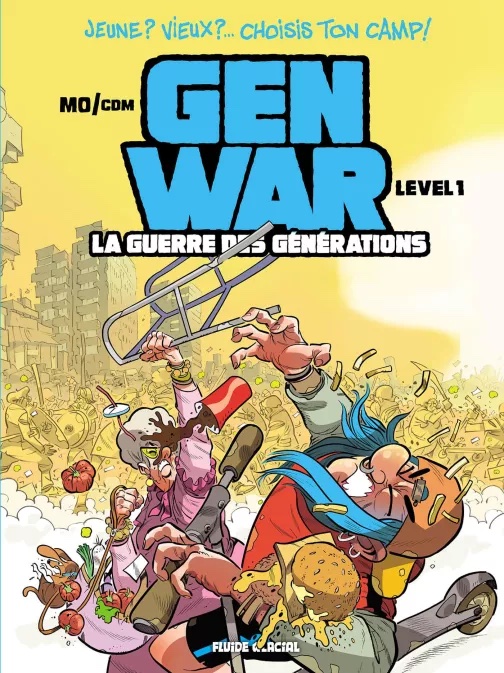



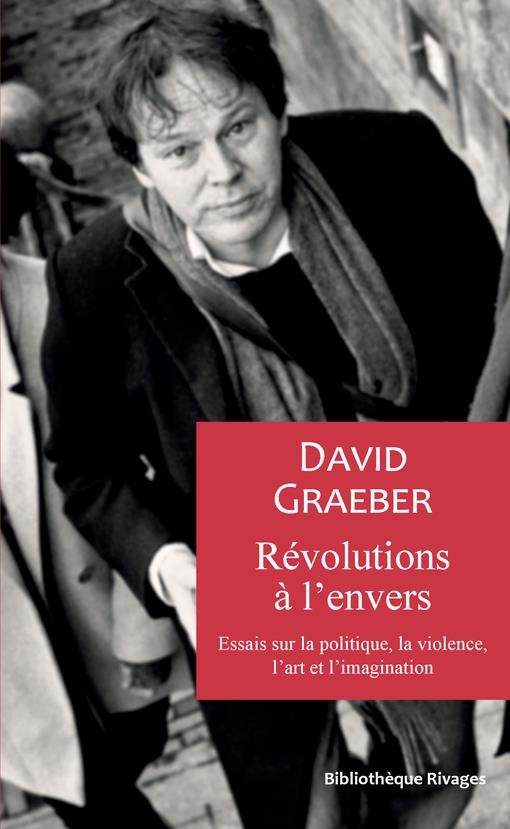
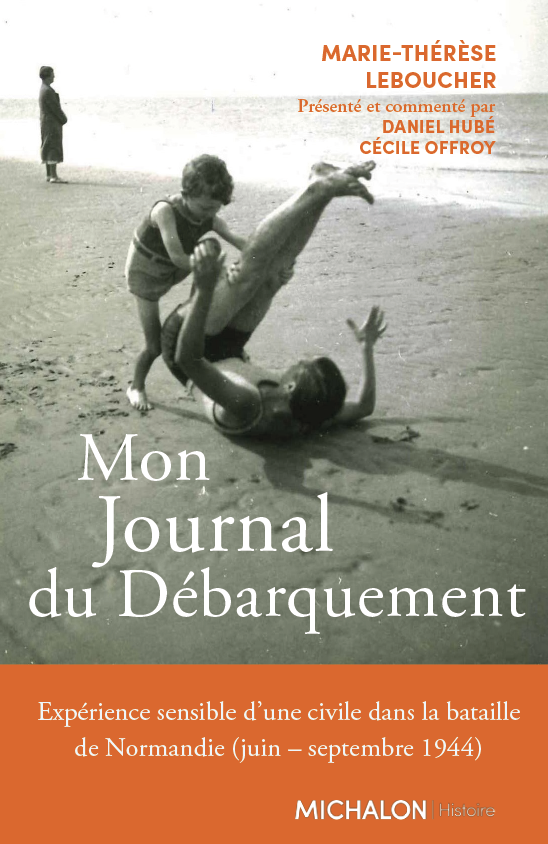




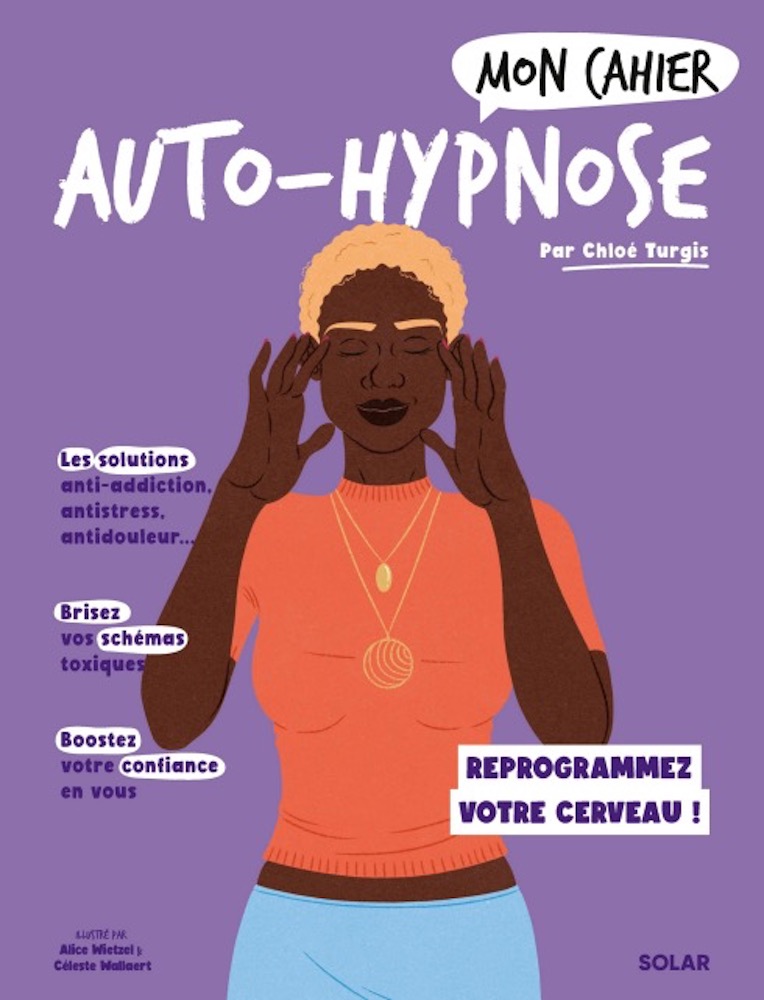
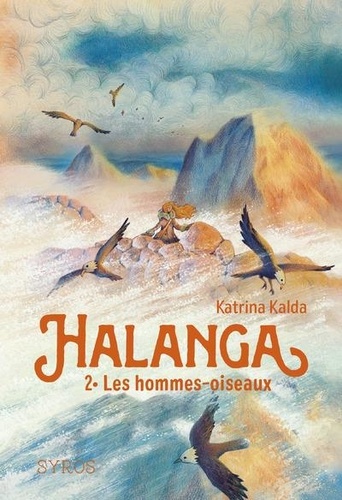
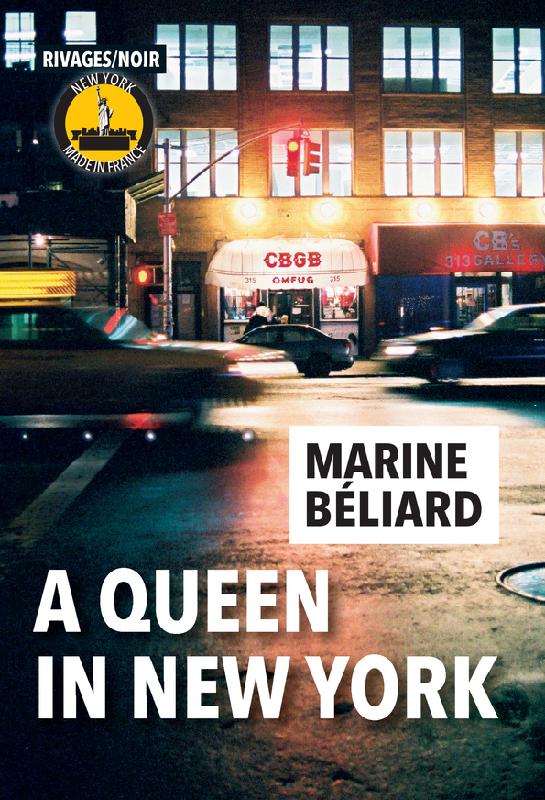



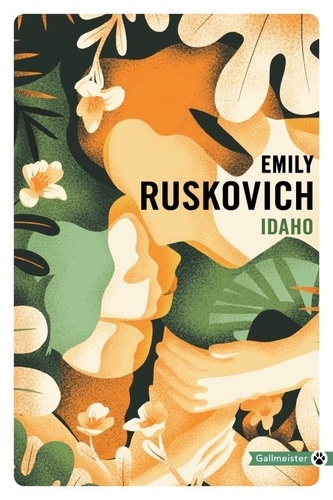
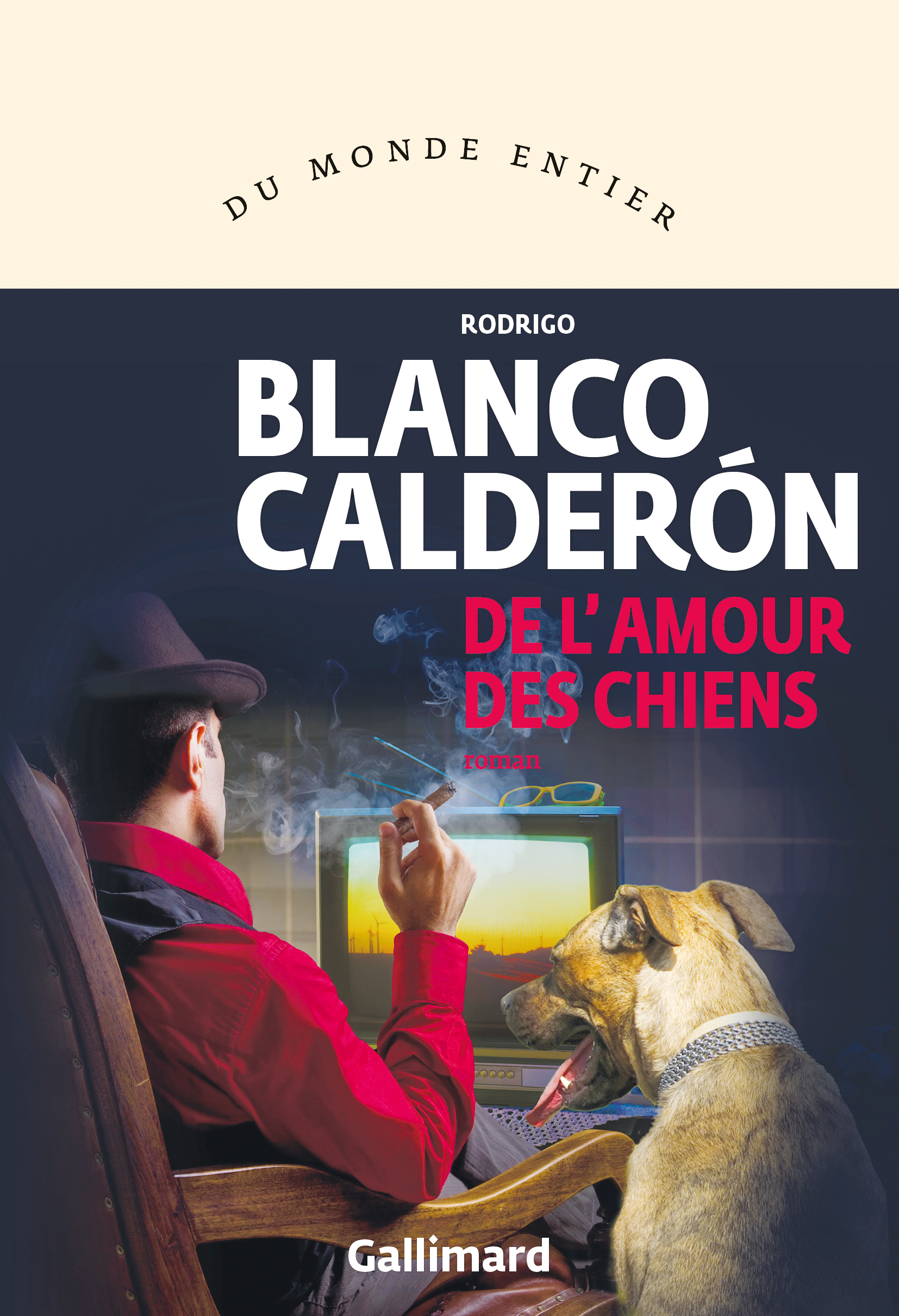





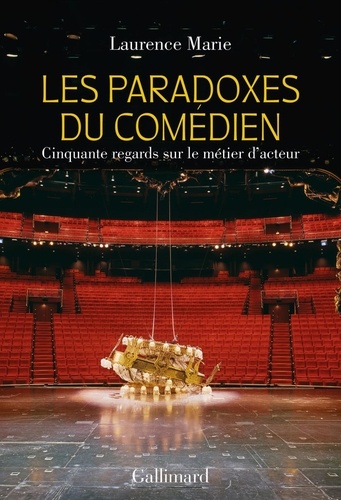
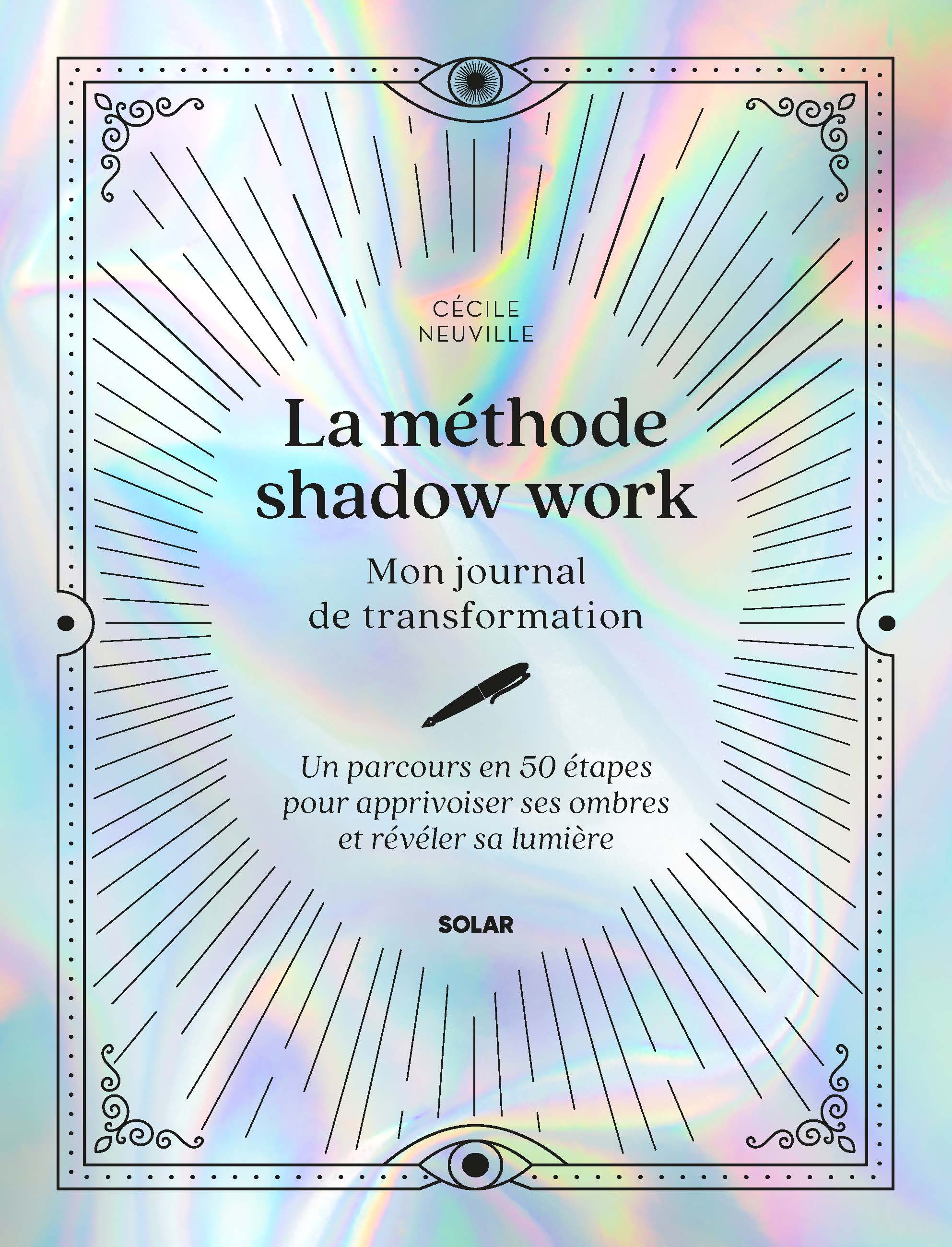


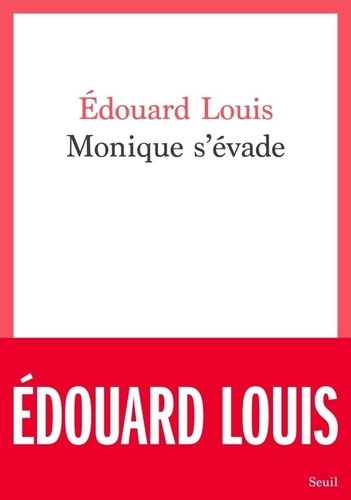
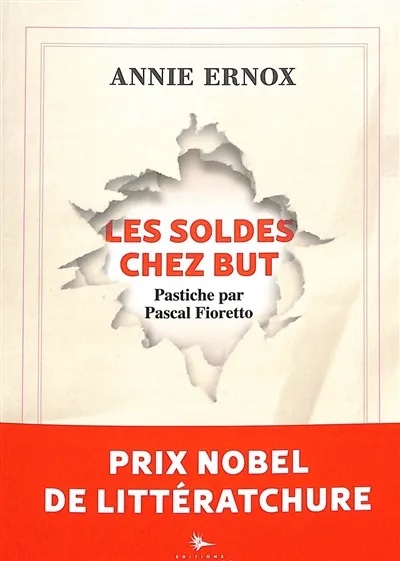
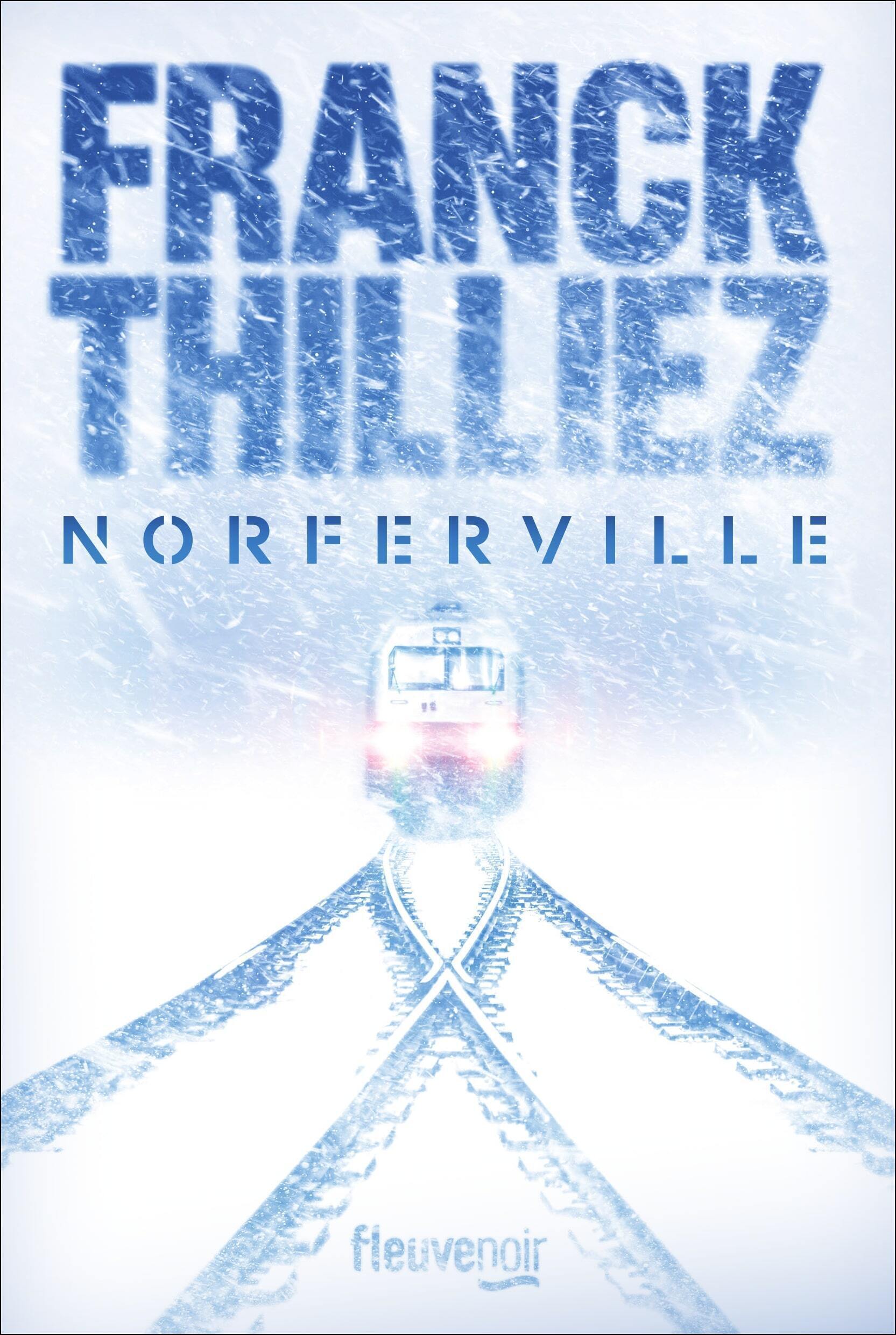
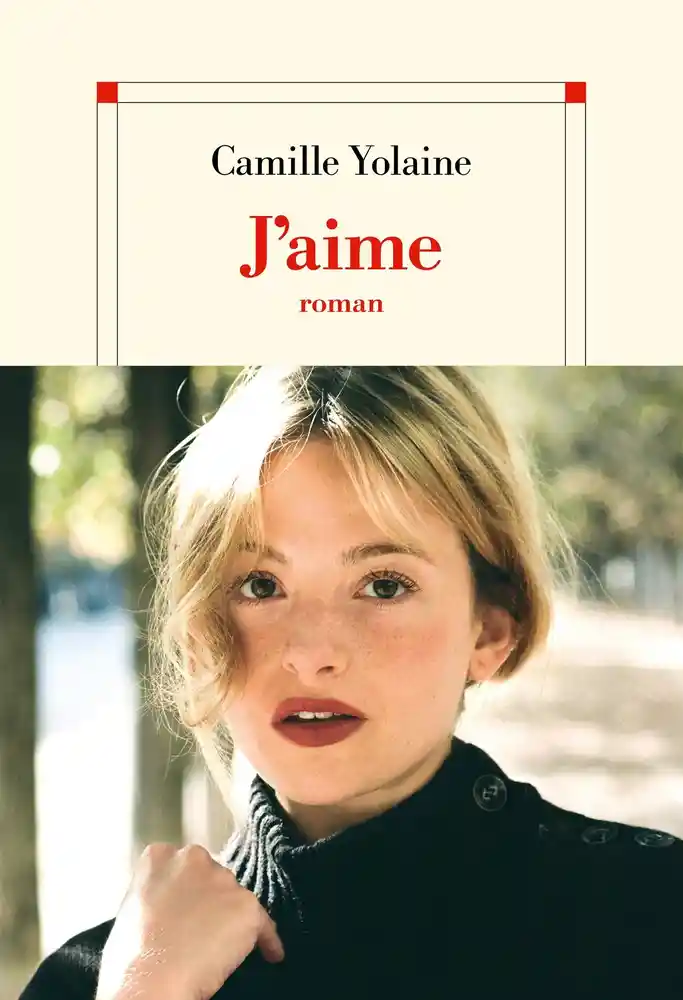
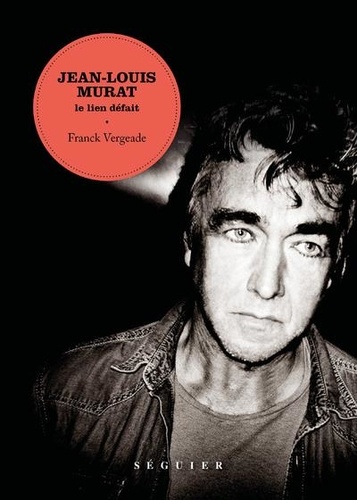
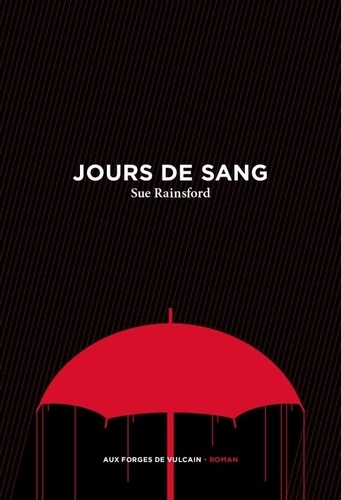


1 Commentaire
dugommier
09/04/2020 à 22:04
Heureusement que je n'avais pas lu ce commentaire avant d'attaquer "Le voyage du condottiere" qui m'attendait depuis des années ; sinon je ne l'aurais pas lu. Un texte pareil est à mes yeux le sommet du snobisme. Cela me rappelle les commentaires des premiers de classe de français qui étaient souvent les lèche-bottes lunettards de service. Désolé, mais la poésie de ce demi-juif, comme il se nomme, m'a beaucoup touché, et cela, bien que je fasse de l'allergie cutanée à la lecture des alexandrins et autres vers bien trop rigides pour notre siècle.