Les Ensablés - Notes de voyage : "Le dîner en ville", Claude Mauriac (1914-1996)
J’ai lu cet été, mon cher Hervé, un très bon roman de Claude Mauriac. Son père, François, est immortalisé (1933) et nobélisé (1952), mais lui, Claude, pourrait bien peu à peu s’ensabler. Pourtant Le dîner en ville est une très belle réussite : c’est un roman qui décrit le parisianisme mondain que l’auteur a beaucoup pratiqué.
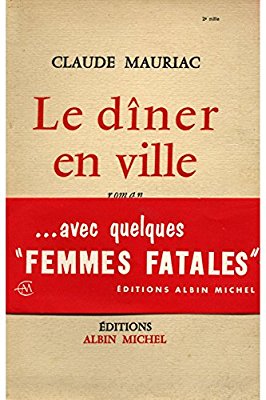
Par Laurent Jouannaud
L’idée est simple : il s’agit de raconter la soirée de huit convives autour d’une table. Il y a le couple qui invite et ses six invités, avec un extra et l’employée de maison qui assurent le service. Ils sont à table et se parlent, nous écoutons ce qui se dit ce soir-là : la conversation est au centre du roman, c’est du théâtre. Mais l’auteur nous donne à lire en même temps les pensées muettes des convives : le dit et le non-dit alternent alors en spirales divergentes car chacun pense plus et autrement qu’il ne veut parler. Ce dîner devient alors une comédie drôle, grinçante, pénétrante.
- 19 : Consommé en tasse.
« Un dîner en ville pareil à tous les dîners en ville. A moins d’événements imprévisibles, il ne se distinguera pas dans notre souvenir de ceux, si nombreux, auxquels nous avons assisté. » Il n’empêche qu’un dîner est chose sérieuse : chaque participant sera juge et accusé, acteur et spectateur, sujet et objet, c’est inévitable, les convives le savent.
- 38 : Champagne et pain grillé.
Ce ne sont pas des amis, ce sont des relations. Un dîner intime ou exceptionnel ? Non, un élément de routine sociale, « à l’image de tous les dîners en ville, depuis plus de vingt ans que je vais dans le monde. » Et, ce soir-là, il ne se passera rien de particulier : ni couple qui se déchire, ni discussion politique violente, ni rencontre amoureuse décisive. Il y a bien un jeune homme, conscient de « l’éphémère complicité d’une réunion s’ajoutant à la durable connivence de notre classe » : il pourrait faire scandale, mais il est très bien élevé. C’est une soirée mondaine comme une autre, entre gens du même milieu. Rien d’essentiel ne sera dit pendant ce dîner aux chandelles, sur l’île Saint-Louis, à Paris.
- 50 : « Les superbes poissons ! - De simples mulets… - Et comme les plats sont joliment décorés. »
Il ne s’agit pas de ridiculiser un rite établi ou de condamner la bourgeoisie. On pourrait de même décrire « le repas d’entreprise », « le thé au foyer des anciens » ou « le banquet de la classe 1997 ». Ce roman se veut descriptif : nous sommes dans la sociologie plus que dans la caricature ou la critique. D’ailleurs, les convives, vus de près, ne se ressemblent guère. C’est le même monde mais dans sa diversité élémentaire. Il y a un homme d’affaires fortuné de 60 ans, un scénariste à succès et un écrivain directeur de journal qui ont la cinquantaine, le très jeune fils de famille et ami de la famille, une actrice canadienne qui monte, une mondaine de 60 ans (« on se demande pourquoi on continue à l’inviter »), la jeune maîtresse de maison et Mrs Osborn, une belle femme de quarante ans dont le mari, absent, travaille dans le cinéma : « Cette table ronde est le noyau autour duquel s’est coagulé notre clan éphémère. Tant que durera ce repas, échappant à l’indifférence éprouvée en général les uns à l’égard des autres, même si nous nous disons amis, nous communierons dans la même entente provisoire, euphorique et veule. »
- 119 : « Ce champagne est d’un bon ! »
La conversation évite les thèmes qui fâchent. On parle de livres, de films, d’Histoire. La culture fait le fond de la conversation. On se lance les grands noms : admirable Balzac !, Aragon, Einstein, Gide, Napoléon Bonaparte, Amiel et Nietzsche, Racine, Mallarmé, « l’éblouissement proustien », Jouhandeau, Odon de Horvath, Diderot, Bergson, Malraux, Joë Bousquet (« J’ai compris que ma vie était la vie de ma blessure avant d’être la mienne »), Gérard Manley Hopkins (« …Hopkins ? Qui est-ce ? »), « les émerveillements dus à Dostoïevski, à Joyce, à Kafka », encore Proust et re-Proust, Herculanum et le musée de Naples, etc. Il y a du vernis : une invitée confond Julien Green et Graham Greene. Il y a aussi des discussions serrées, sur le paradoxe de Pasternak, par exemple. Et deux convives connaissent bien Proust : « La Prisonnière parut à quelle date ? – 1923 ». Et, en effet, influencé par Anatole France, Proust a fini par influencer France qui lui survit de deux ans, comme le sait l’écrivain lettré. Gigi, la doyenne, et le riche financier connaissent l’Histoire de France dans les détails. Conversation brillante et apprêtée : l’un cherche à placer les bons mots de Tristan Bernard, un autre a appris par cœur des citations. Et la belle quadragénaire peut enfin étonner l’assistance, « une occasion de briller à mon tour », en expliquant que le canard cancane, le jars jargonne, le lapin clapit, la perdrix cacabe, le pinson ramage, la cigale craquette et le geai cajole : « ils sont épatés ».
- 161 : « Voici enfin le plat de résistance. Volailles précieuses. »
- 169 : « Enfin, c’est à mon tour d’être servi. Ces pintades ont l’air si bonnes. »
On raconte des anecdotes, on évoque des voyages, on convoque des connaissances communes. Aux personnages présents s’ajoutent les personnes qu’ils connaissent et qu’ils ont connues, si bien qu’au cours de la soirée des dizaines de figures viennent peupler le roman : « Je l’ai rencontré, Sydney Spring, chez les Bötrel ; du temps des Meilleuse ; avez-vous des nouvelles de Marie-Prune ? Paulette Cruchet, vous savez qu’elle habite Athènes ? Louise Branche, mon amie qui habite New York ; j’ai croisé l’autre jour Liliane Decker ; vous étiez chez les Picquard ? je l’avais rencontrée chez les Peyresaubes ; vous vous habillez chez Rémon ? j’étais invitée à Cannes chez les Visseaux ; un drôle de type ce Pierre Blingaux ; le très avare Zerbanian ; ce malheureux Rico ; ce vieux Breillac ; Saint-Palpoul qui me fut toujours assez indifférent ; j’aurais voulu être Lucine de Brouges ; Raymond Frôlet, un camarade à moi ; chez les Peagson ; peut-être pourriez-vous me donner des nouvelles du pauvre Bibi ? -Bibi, quel Bibi ? - Bibi Chartrettes, bien sûr. » Plus ces noms sont nombreux, moins ils ont d’importance ; ce sont des figurants interchangeables.
- 217 : « Nous en sommes arrivés à ce moment des dîners en ville où le champagne efface les pudeurs et les craintes habituelles. »
On parle, on écoute, mais chacun se parle à lui-même : la soirée en ville s’emboîte dans le monologue intérieur que chaque conscience produit sans cesse. Ce repas n’interrompt pas le drame que représente son existence pour chaque être humain. Chaque convive a ses obsessions, ses douleurs, ses petits ou lourds secrets qui remontent, plongent, remontent à la surface pendant la soirée : certains souvenirs sont implacables. Le financier est préoccupé par ses actions (« On a introduit en coulisse les actions Bertzinger ») et par sa virilité défaillante. Mrs Osborn pense à Zig, son chien qu’elle a laissé seul, et à son amant. La starlette qui n’a pas pris son bain de soleil ce matin pense à son bronzage, à sa peau, à ses seins (« Surtout que je sois bien brune en arrivant à Megève »). Et elle revit sans cesse un traumatisme ancien, un viol, qu’elle veut faire payer à chaque mâle. L’écrivain et le scénariste cherchent un sujet, ébauchent et brodent sans cesse des phrases, des scènes ou des images, sans rapport avec la soirée qu’ils vivent. Gigi revit par bribes la liaison qu’elle a eue il y a longtemps avec le scénariste (qui a vingt ans de moins qu’elle). La maîtresse de maison ne pense qu’à ses enfants, le sens de sa vie, « mon corps et mon esprit n’étaient occupés que d’eux », comme ils sont doux, comme ils sont chauds, comme ils l’aiment, et comme elle se fiche de ce repas qui a pourtant lieu chez elle. Et le lecteur jouit de son omniscience : our une fois que l’on n’est pas dupe ! Le mensonge et l’hypocrisie sont bien le terreau de la vie sociale, c’est confirmé, mon cher Hervé.
- 230 : « Voilà des céleris exquisement préparés. »
Ces huit personnages se regardent, les bras se frôlent, les jambes se touchent. Martine, oui, a subi une légère opération : son nez est plus court, mais personne n’en parlera. Chacun a une valeur érotique, les femmes surtout. On flirte avec le voisin de gauche, puis de droite. Gigi se désespère car le jeune homme l’ignore, et la starlette mesure exactement ce qu’elle peut sur chaque homme présent. Chacun sait qu’il ne sait pas tout des autres : qui a été l’amant de qui à cette table ? Et puis, la vraie Vénus de la soirée, c’est la domestique, Armande, « celle dont le rayonnement sexuel est le plus intense », qui sert les convives sans soutien-gorge, « indiscrètement décolletée », « manque de correction qui étonne dans une maison comme celle-là », et que le maître de maison honore régulièrement.
- 273 : « Le choix des chèvres est magnifique. Ronds et roux, les secs petits crottins de Chavignol et quelques Saint-Marcellin moins dorés voisinent avec les vertes pyramides tavelées des Valençay et de longs, d’onctueux Sainte-Maure marbrés de fauve. »
Les convives peuvent s’ennuyer par moment (« Je suis là sans y être. Bercé par ces conversations auxquelles je ne prends plus part. »), mais pas le lecteur qui domine la table entière, entend tout, voit tout, comprend tout. Et puis l’auteur sollicite le décor pour nous distraire. On entend courir les enfants des voisins, quelqu’un joue du piano quelque part. Sans le faire exprès, le serveur heurte le commutateur, la salle s’éclaire, les convives se voient comme en plein jour, à nu presque, pour quelques secondes. Plus tard, on voit passer sous les fenêtres un bateau-mouche illuminé, que l’on verra redescendre une heure après, brève diversion sur laquelle comptent les maîtres de maison. Il y a une intervention des pompiers dans le quartier, un homme promène son chien sur le quai. Il y a d’autres vies ailleurs…
- 293 : « Votre dîner était merveilleux. Et cet entremets ! Il a l’air sensationnel. Sensationnel ! - Une glace, chère Madame, une petite glace. »
Les personnages ont légèrement bougé au cours de la soirée. A ce jeune homme timide et roux, finalement, la starlette trouve du charme, et Gigi aimerait le déniaiser alors même qu’elle le trouvait si bête. Lui-même, qui se jugeait inculte, réévalue sa jeunesse en entendant ces conversations insipides. La mère, fidèle à ses enfants et à leur père qui la trompe, se dit qu’elle devrait prendre un amant, puisque son mari a des maîtresses. Le scénariste a poussé le flirt très loin avec elle (tout le monde s’en est rendu compte) mais maintenant il fait marche arrière. L’écrivain, qui est le maître de maison, juge son œuvre littéraire modeste, se sait observateur consciencieux, recompte ses maîtresses, se promet désormais d’être plus fidèle. La starlette a compris que l’homme important pour sa carrière n’est pas là, c’est le mari absent de la quadragénaire : attention à ne pas gâcher ses chances par un faux-pas. Et Gigi se sent mieux : son drame (l’âge et la solitude) demeure, mais elle s’est montrée ce soir à la hauteur.
- 308 : « Les jolies poires ! - Tenez, je vous recommande celle-ci. Elle ne paie pas de mine mais elle est exquise. C’est une Beurré Superfin. - Et celle-là ? - Baronne de Mello. Cette autre a un nom un peu drôle : Alexandrine Drouillard. Je vous signale aussi ces Délices de Lowenjoul… »
On a dit et ruminé des banalités vraies : « l’amour délivre des amours », « nous croyons vivre alors que nous survivons », « ce sont les hommes, vous, moi, nous tous qui sommes étonnants », « l’argent est une protection ». Les critiques et les piques étaient prudentes et superficielles : qui sait qui dînera avec qui la semaine prochaine ? Il n’y a pas de divergences de fond entre convives. Il y a eu de longs apartés réussis. Par moments -« le moment où on se laisse aller à parler de n’importe quoi n’importe comment »- le brouhaha empêchait toute conversation véritable, on s’emballait : « l’alcool donne de l’importance à l’inessentiel. » Tout le monde parlait en même temps, personne n’était exclu, chacun était concerné. Soirée réussie.
- 317 : « La fumée de nos cigarettes. »
- 331 : « Mes longs doigts dans l’eau tiède où flotte une rondelle de citron. »
Et puis « ces phrases vaines se dissipent heureusement aussi vite que la fumée de nos cigarettes. » S’est-on tout dit de ce qu’on pouvait se dire ? Non, puisque le repas n’est pas fini : il faut continuer à parler. Mais qui dit cigarette, dit cancer. Et la conversation rebondit. Cancer ? Maladie ? Soigneurs ? Cures miraculeuses ? On connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qu’un guérisseur a soigné, ou qui est mort. Et du cancer à Dieu, il n’y a qu’un pas : « Moi, il y a longtemps que je ne crois plus. - Il y a une grande différence entre dire que l’on n’a plus la foi et ne l’avoir plus. - Suis-je plus près du Christ que je ne le pense ? – La mort ne devrait pas nous faire peur puisque nous ne cessons de mourir. » La conversation flambe à nouveau, bouquet métaphysique.
- 338 : Café.
- 339 : « Bertrand se lève et Martine en fait autant. Les chaises glissent mal sur le tapis. Nous sommes debout… »
Le repas s’achève, le roman s’achève aussi. Belle unité de temps et de lieu. Construction simple et claire. En même temps, il y faut une lecture attentive : les paroles sont introduites par un tiret, et les pensées des convives par trois points, on ne sait pas toujours qui parle ou qui pense. Les monologues s’interrompent, s’étirent, reprennent. Les dialogues s’enjambent, se croisent, s’ignorent. Tel convive se tait, disparaît puis revient dans la conversation. Il n’y a pas de centre ni de héros ni d’action à proprement parler. De fixe et stable, il ne reste que « le haut philodendron, admirable avec ses larges feuilles dentelées et sombres, avec tout au faîte, le vert tendre d’une pousse neuve », sur lequel les yeux de chacun finissent toujours par se poser. C’est l’époque du Nouveau Roman, dont Mauriac est proche : « Ce prétendu nouveau roman dont nous sommes quelques-uns à défendre le principe n’a plus rien de romanesque au sens traditionnel du mot. L’imagination y a moins de part que l’observation », se dit Bertrand l’écrivain.
Un convive constate : « Quel dîner ils nous ont offert ! Et du champagne tout le temps. » Je reprends la formule à mon compte : Le dîner en ville de Claude Mauriac, c’était du champagne tout le temps.
Sic.
Je lis en ce moment le journal de Matthieu Galey que les Ensablés ont chroniqué. Galey a fréquenté les Mauriac et a connu le Tout-Paris. Je lis au 18 décembre 1970 : « Dîner mondain ici, avec Edmonde [Charles-Roux], les Nourissier, les Privat, Ch. de Rivoyre, Fr. Mallet-Joris+Delfaux, Kanters et Banier. (…) Que reste-t-il de cette soirée ? Rien, rien, rien. »

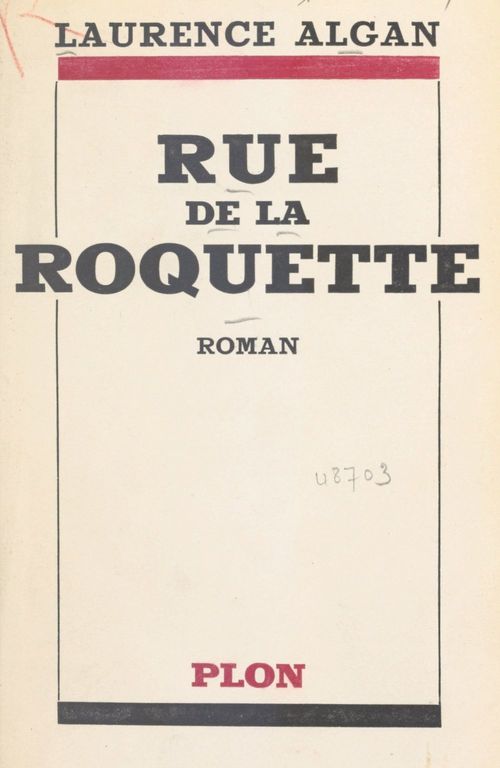
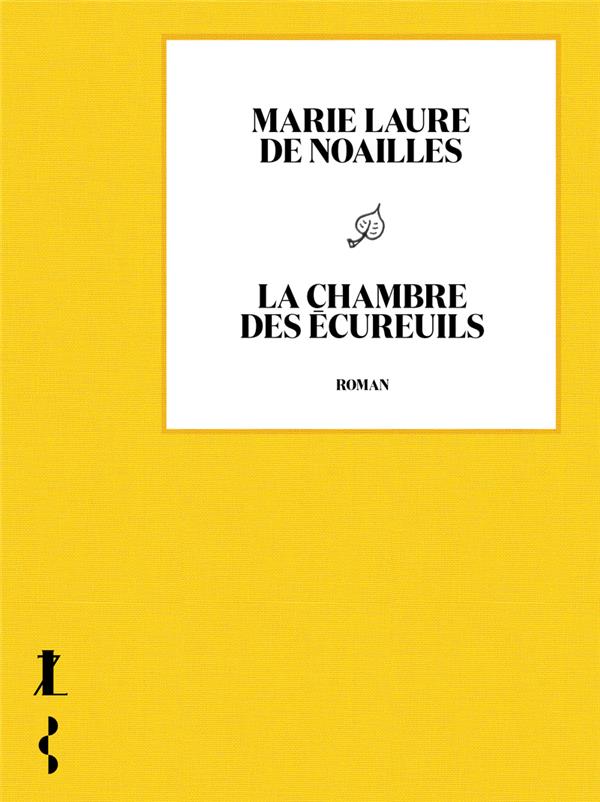
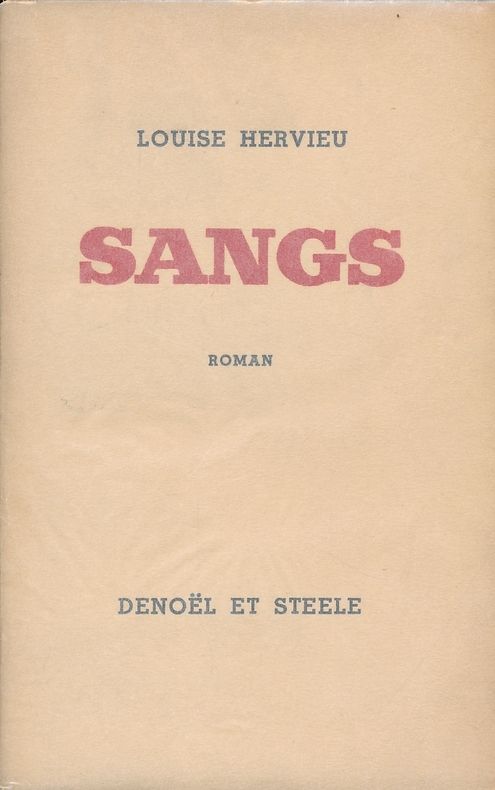
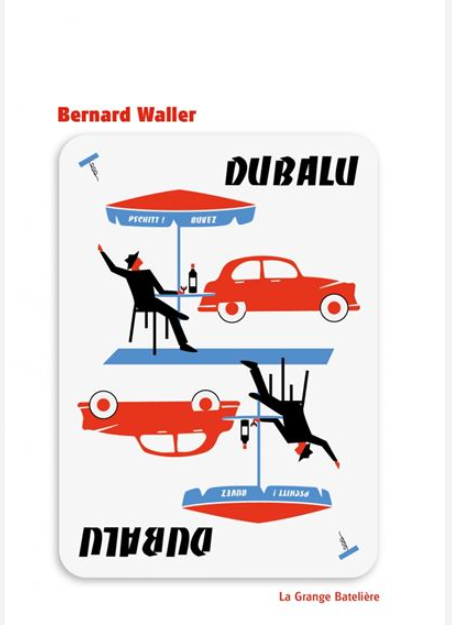
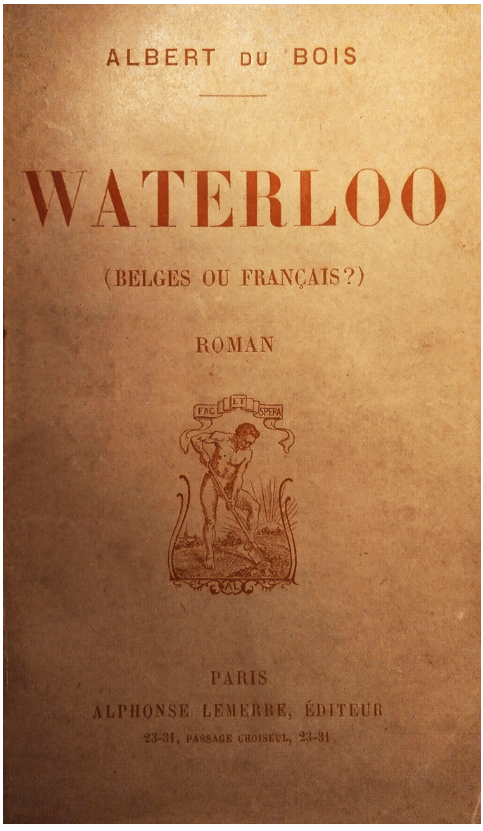
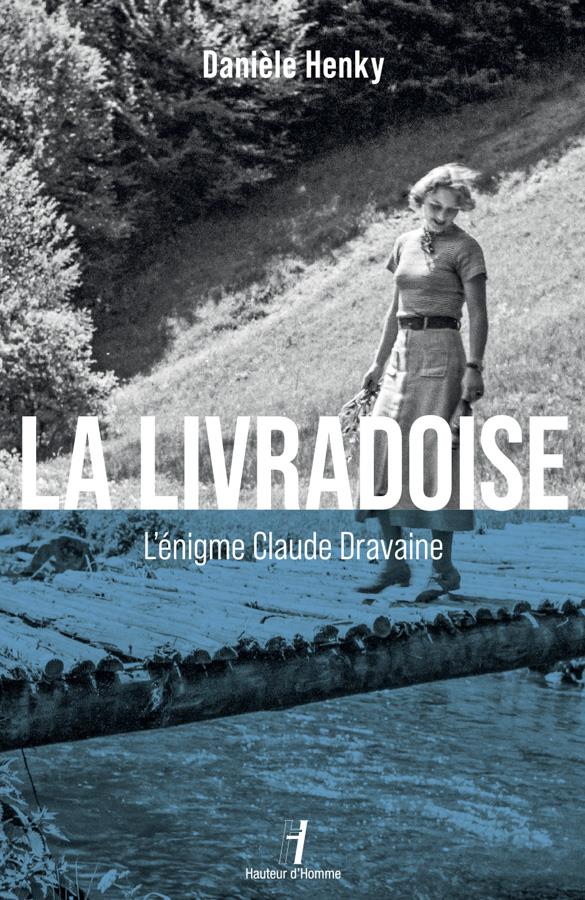
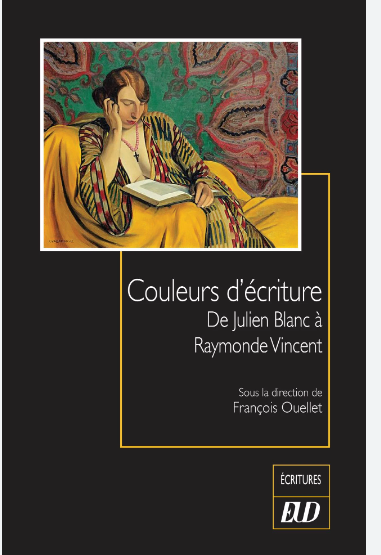
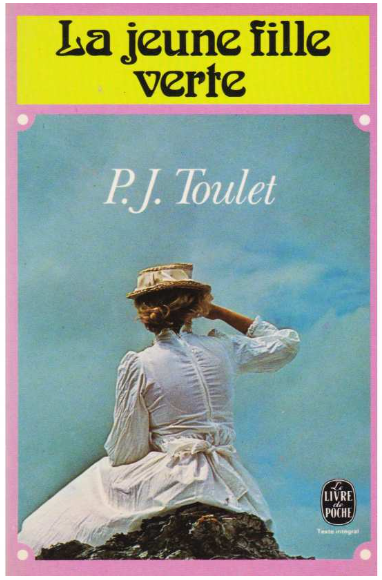
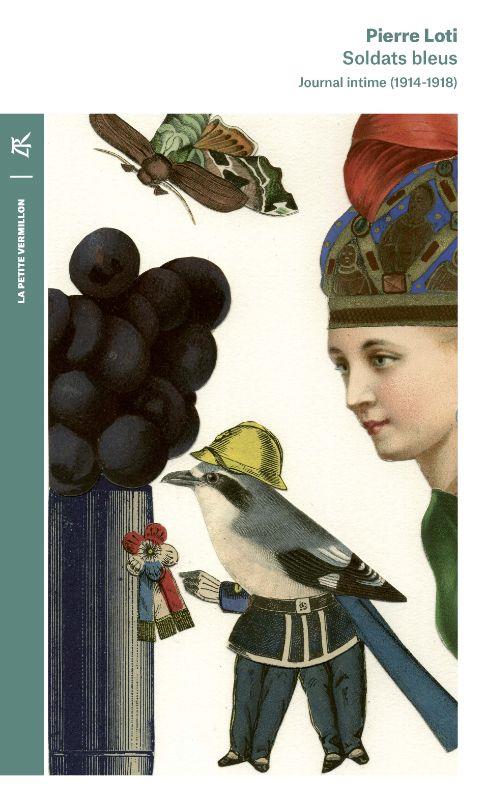
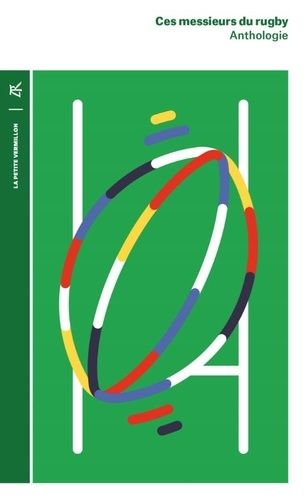
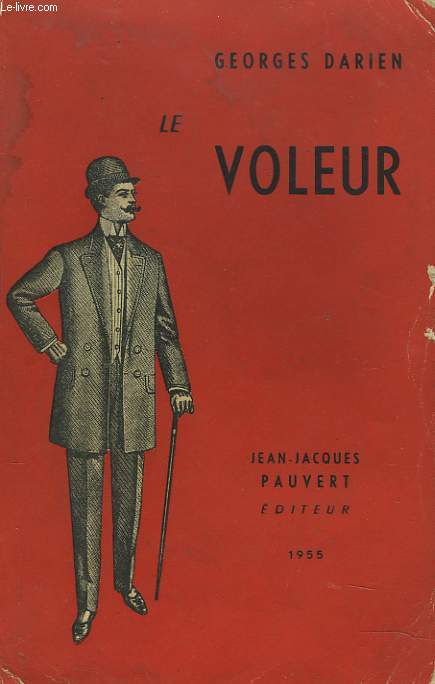
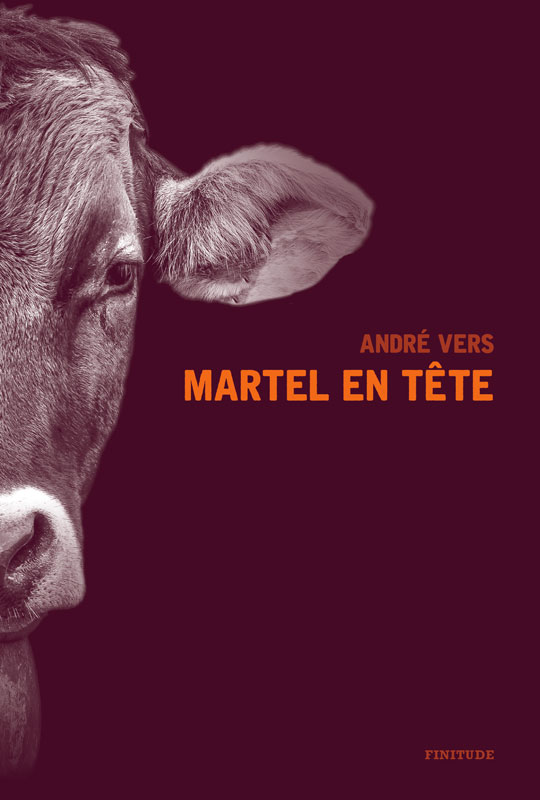

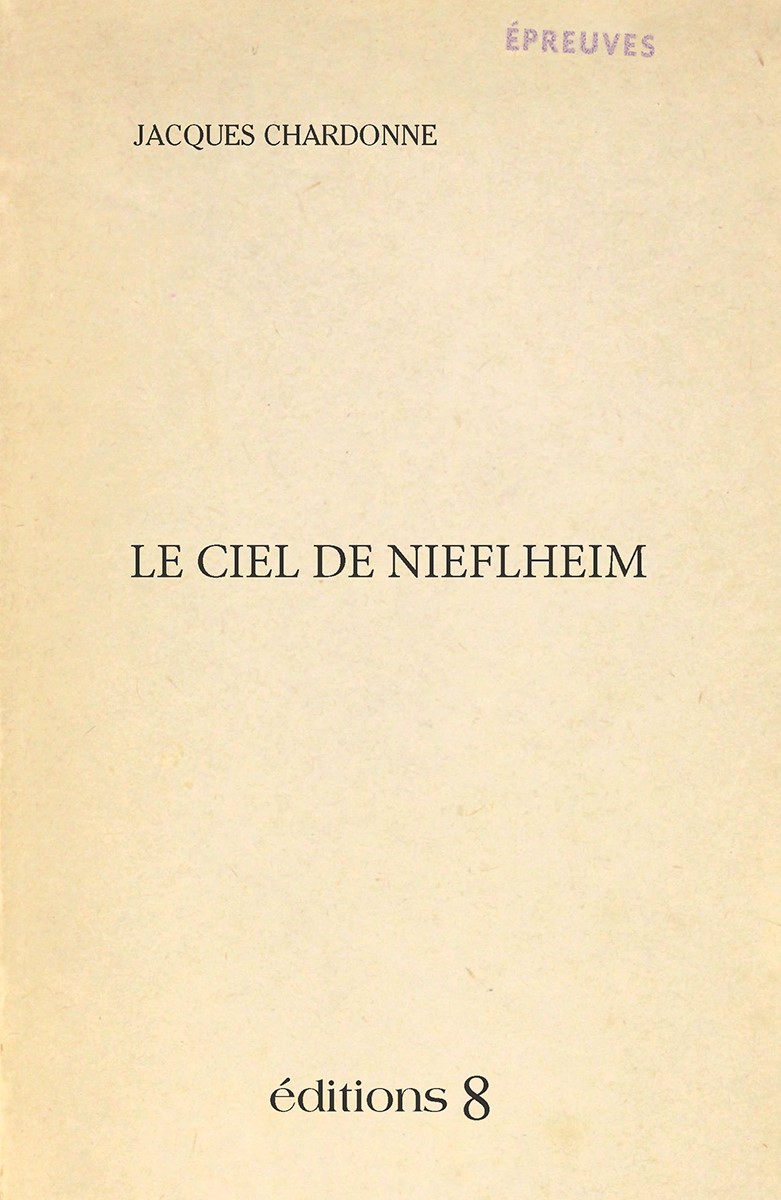
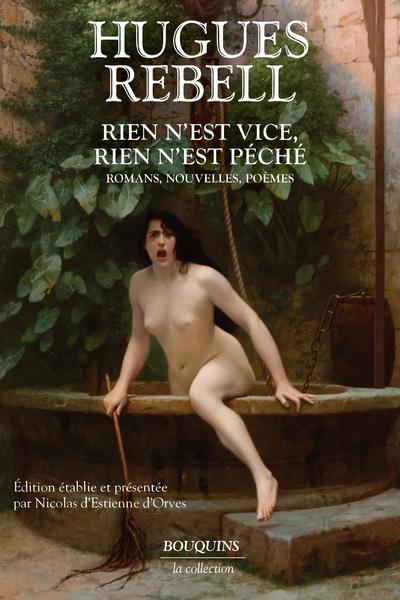
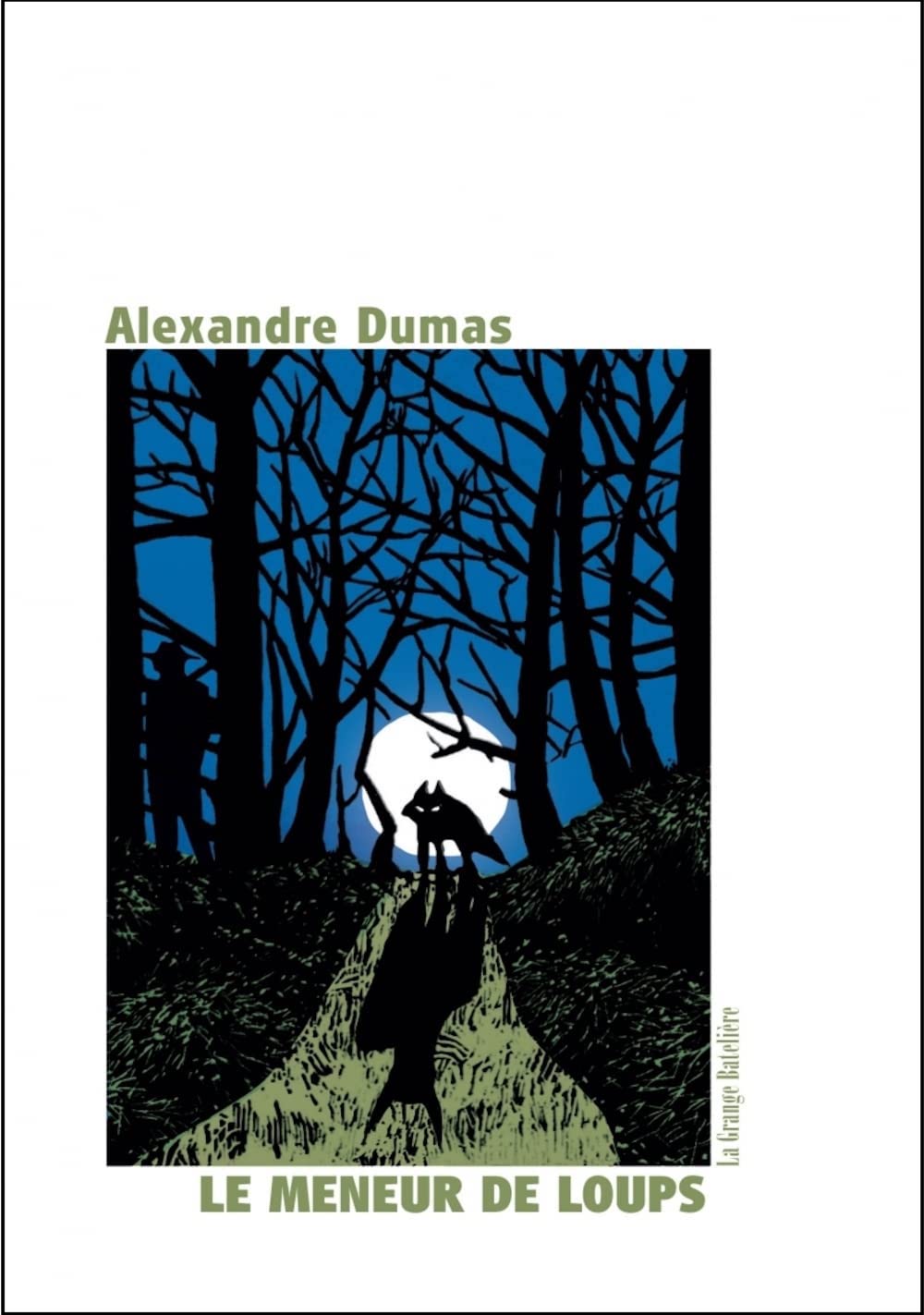
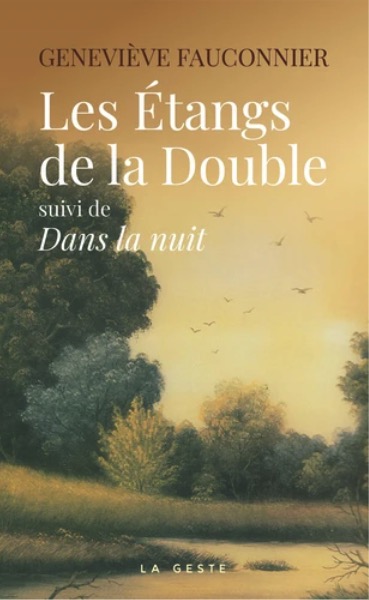
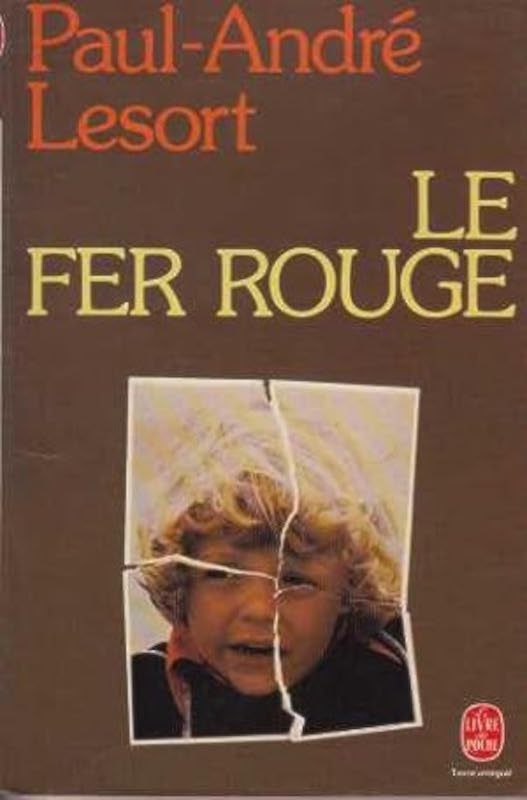

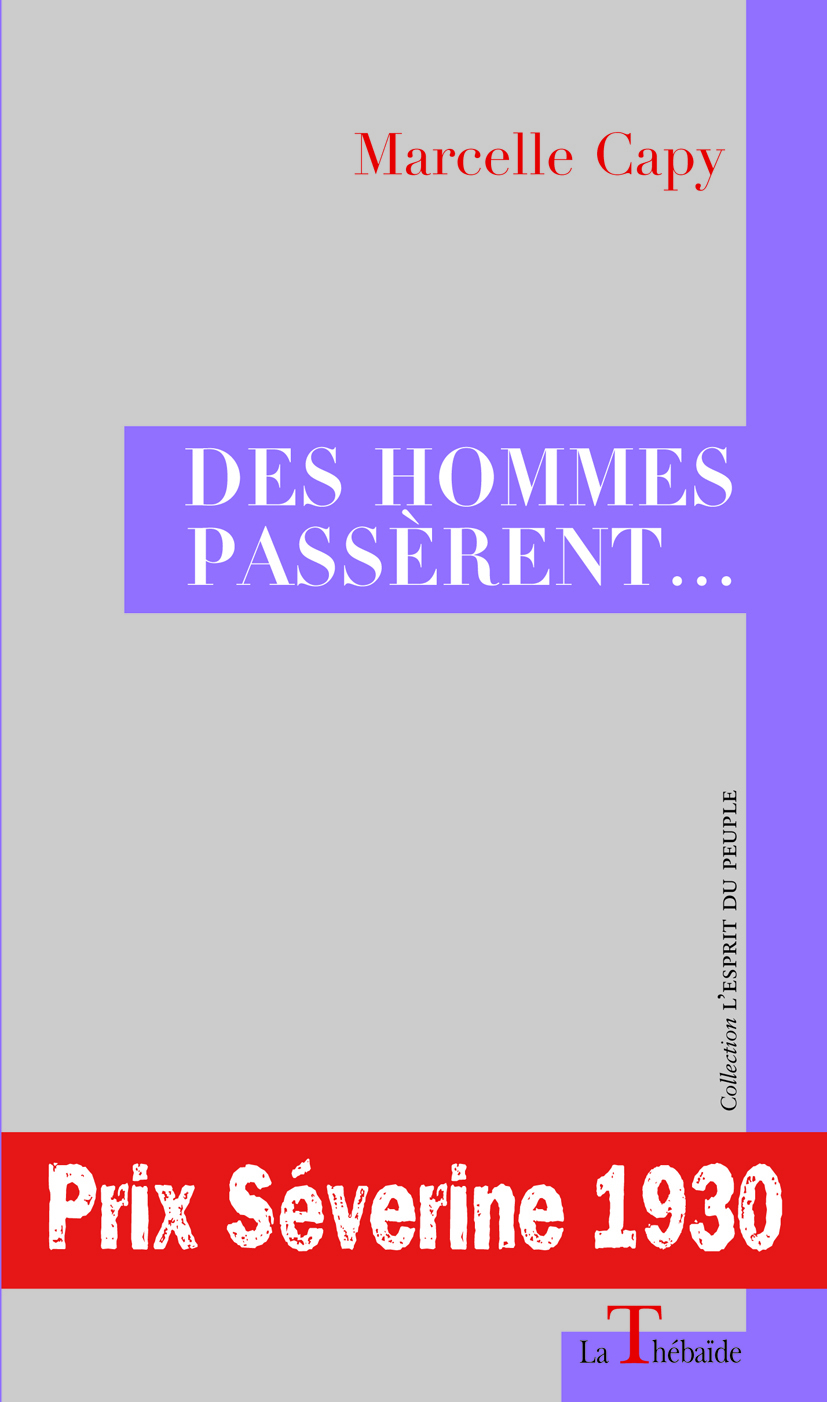
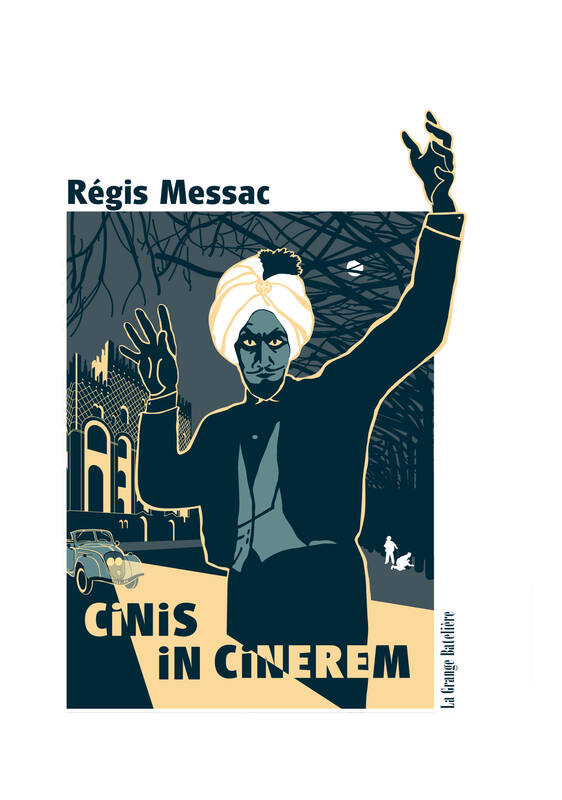
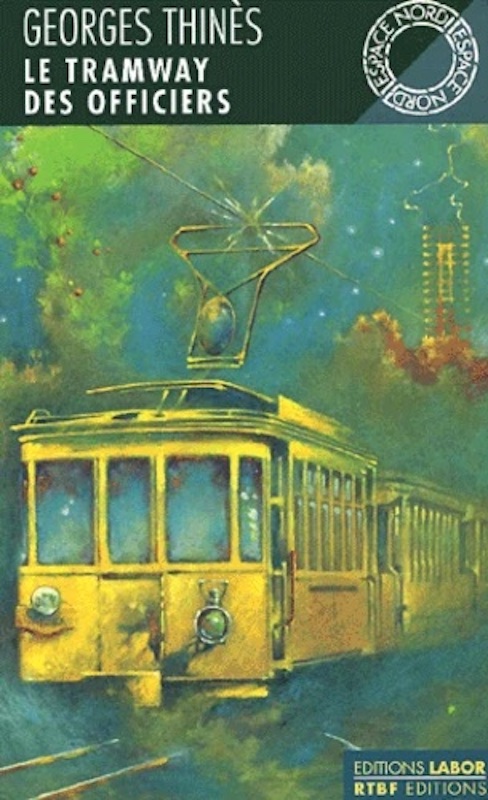
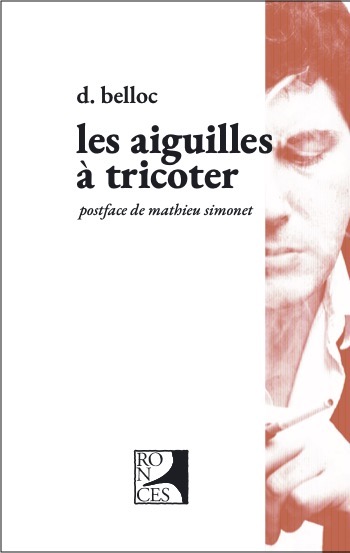
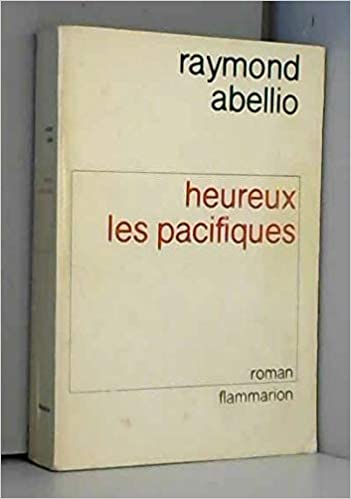
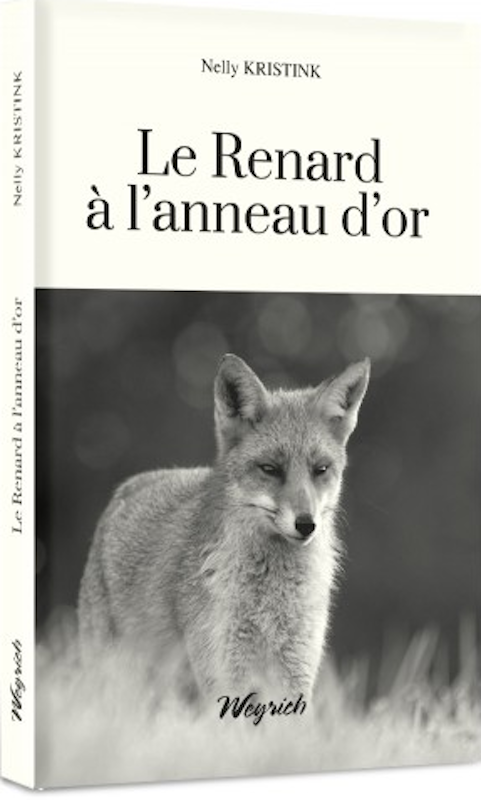
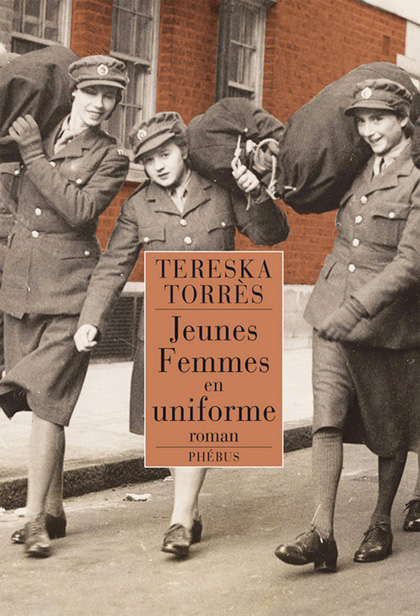
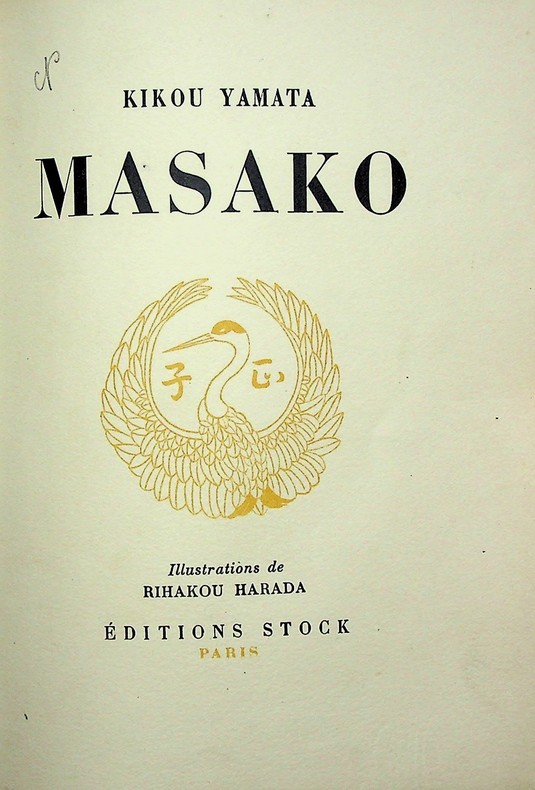
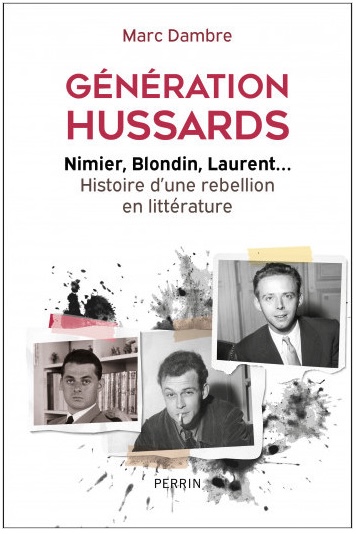
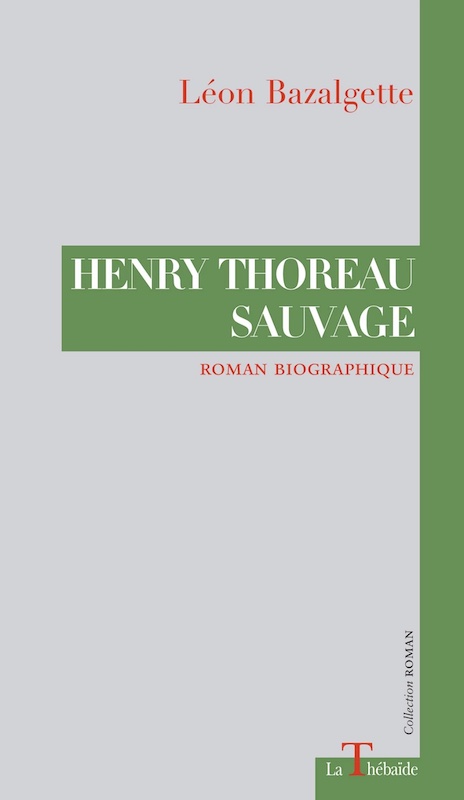
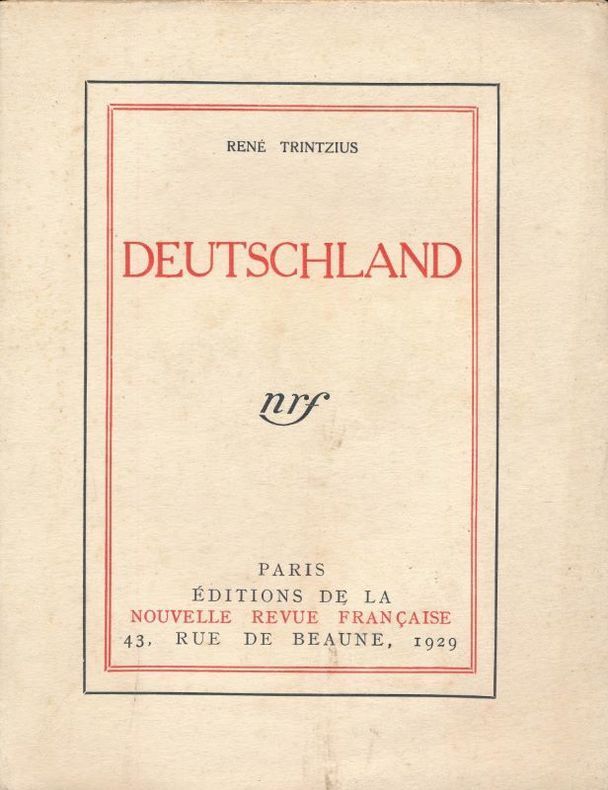
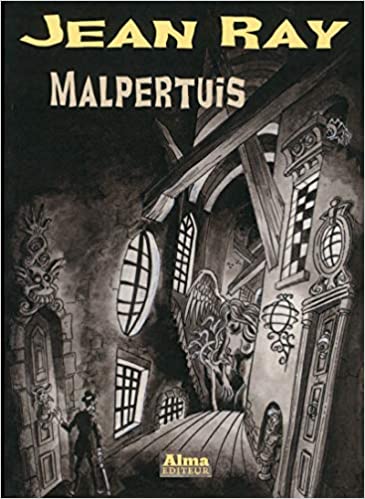
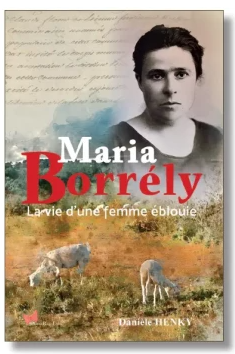
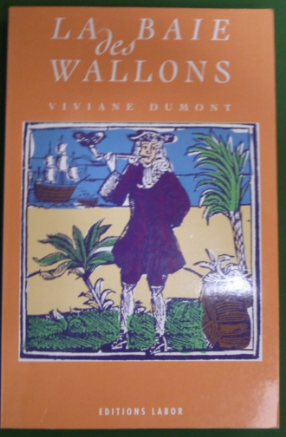
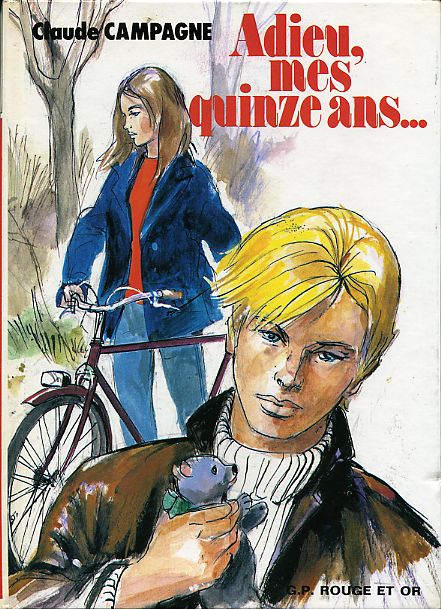
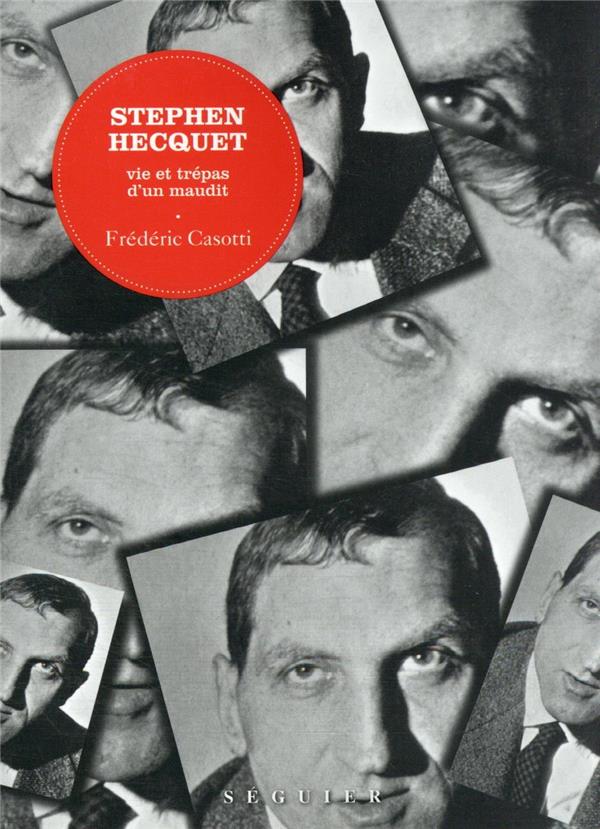
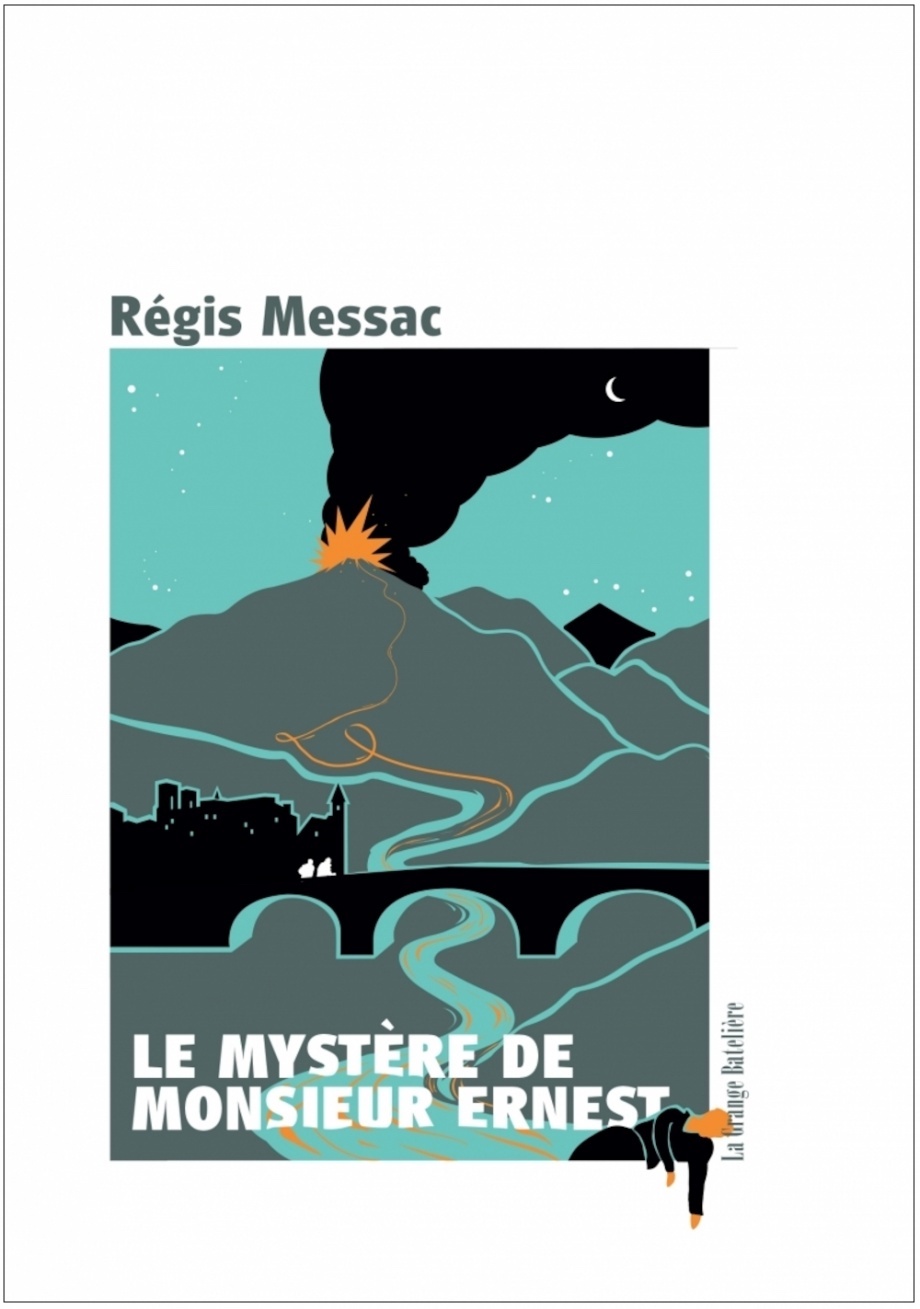
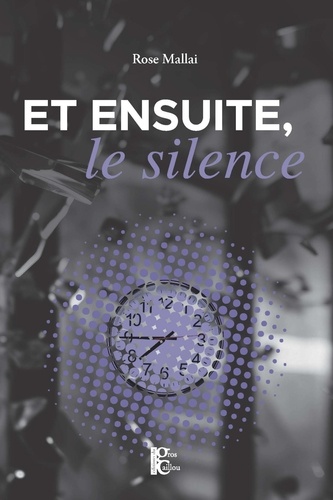
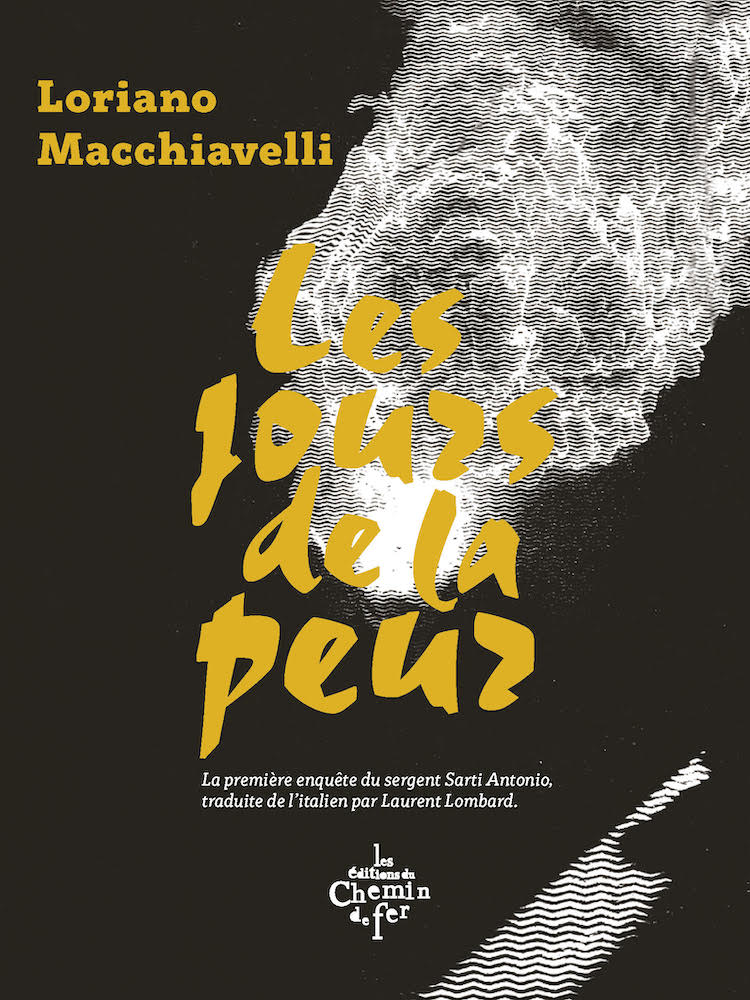

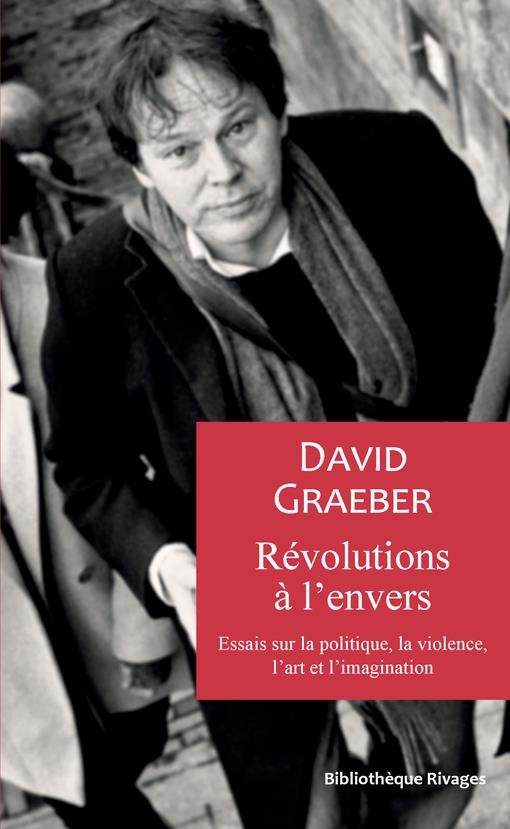
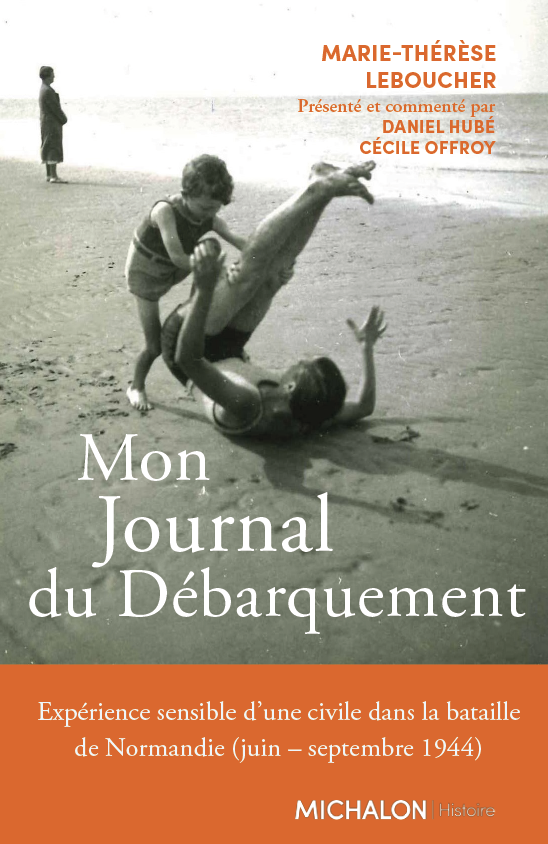
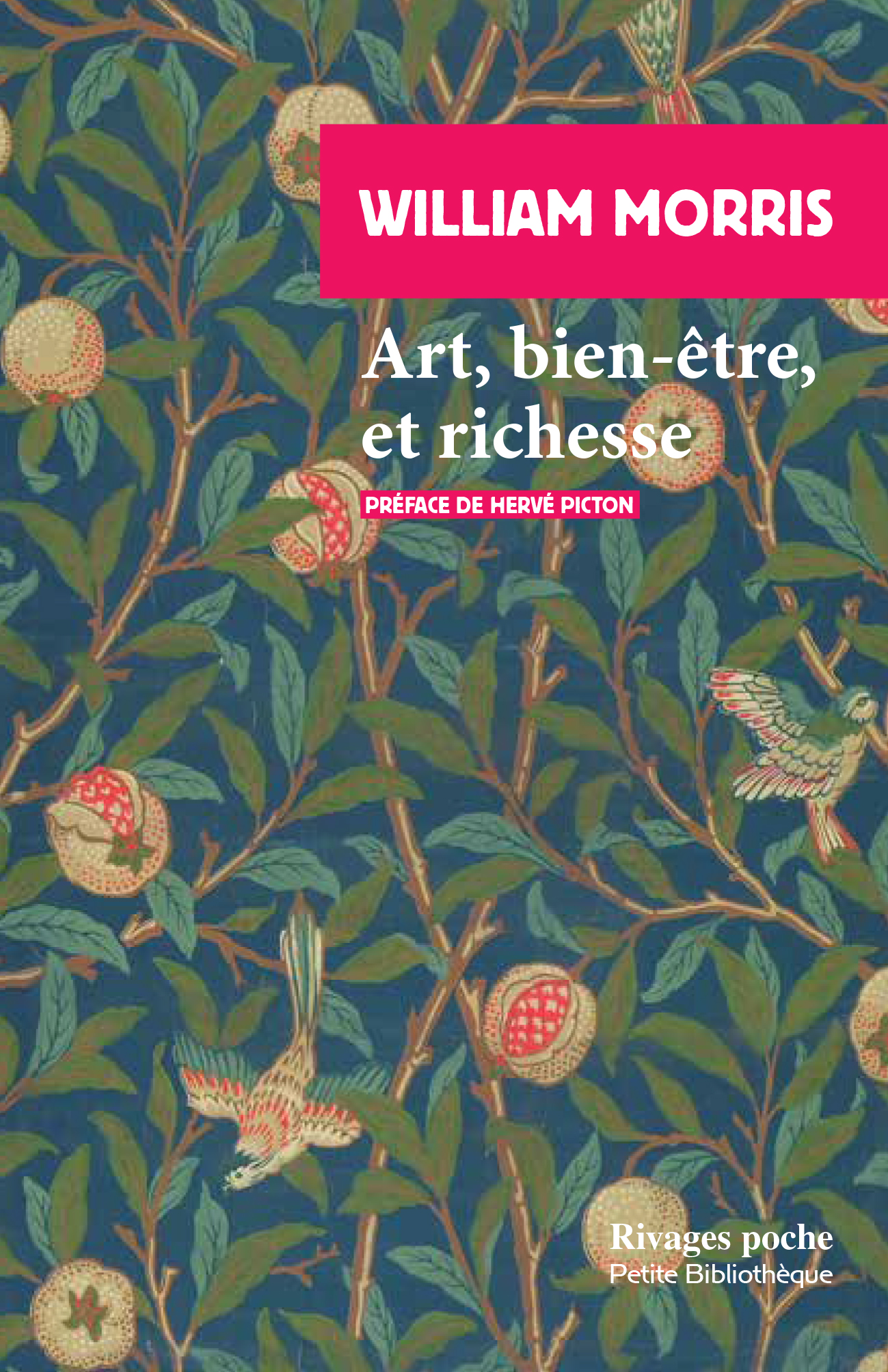

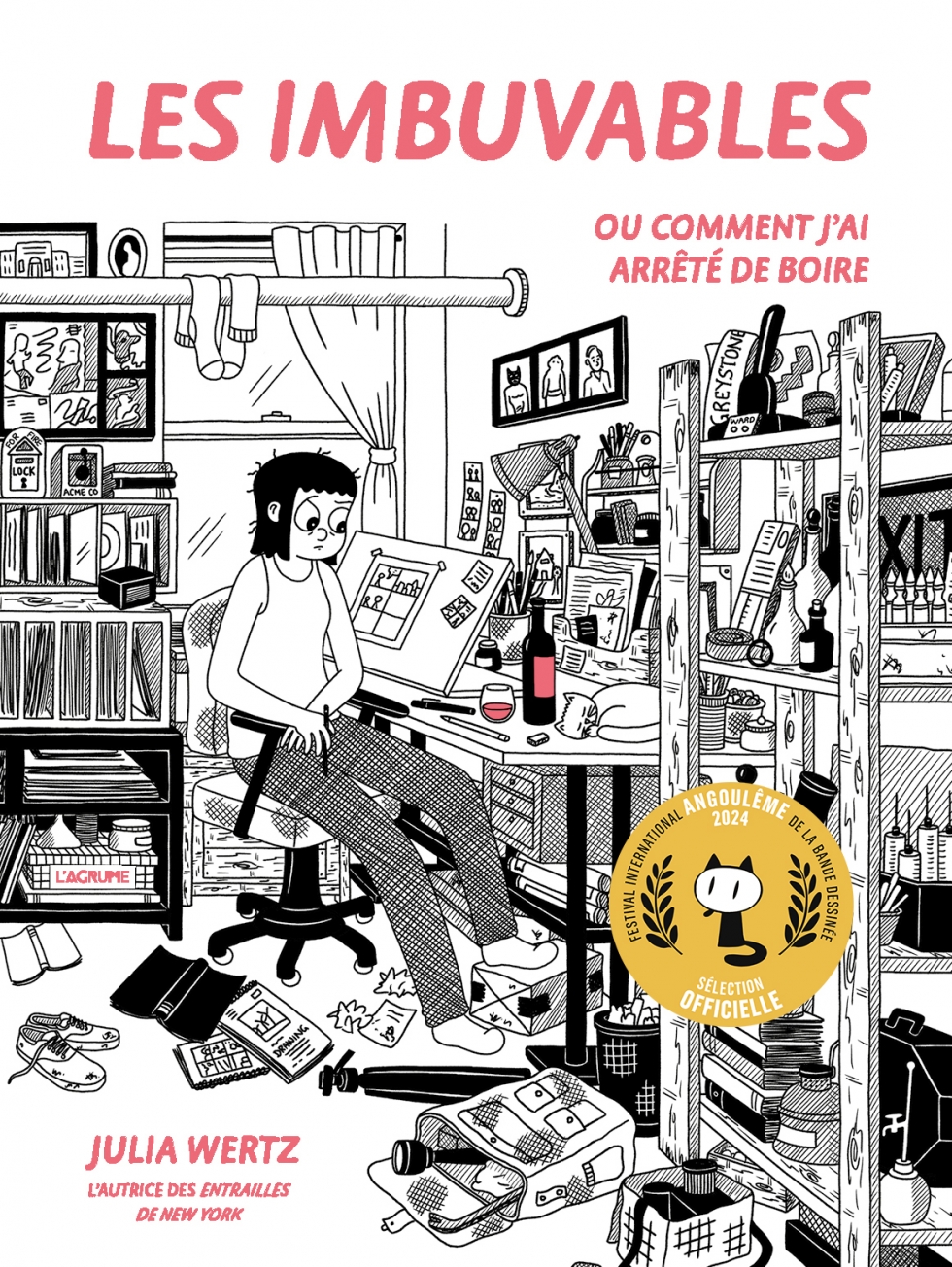
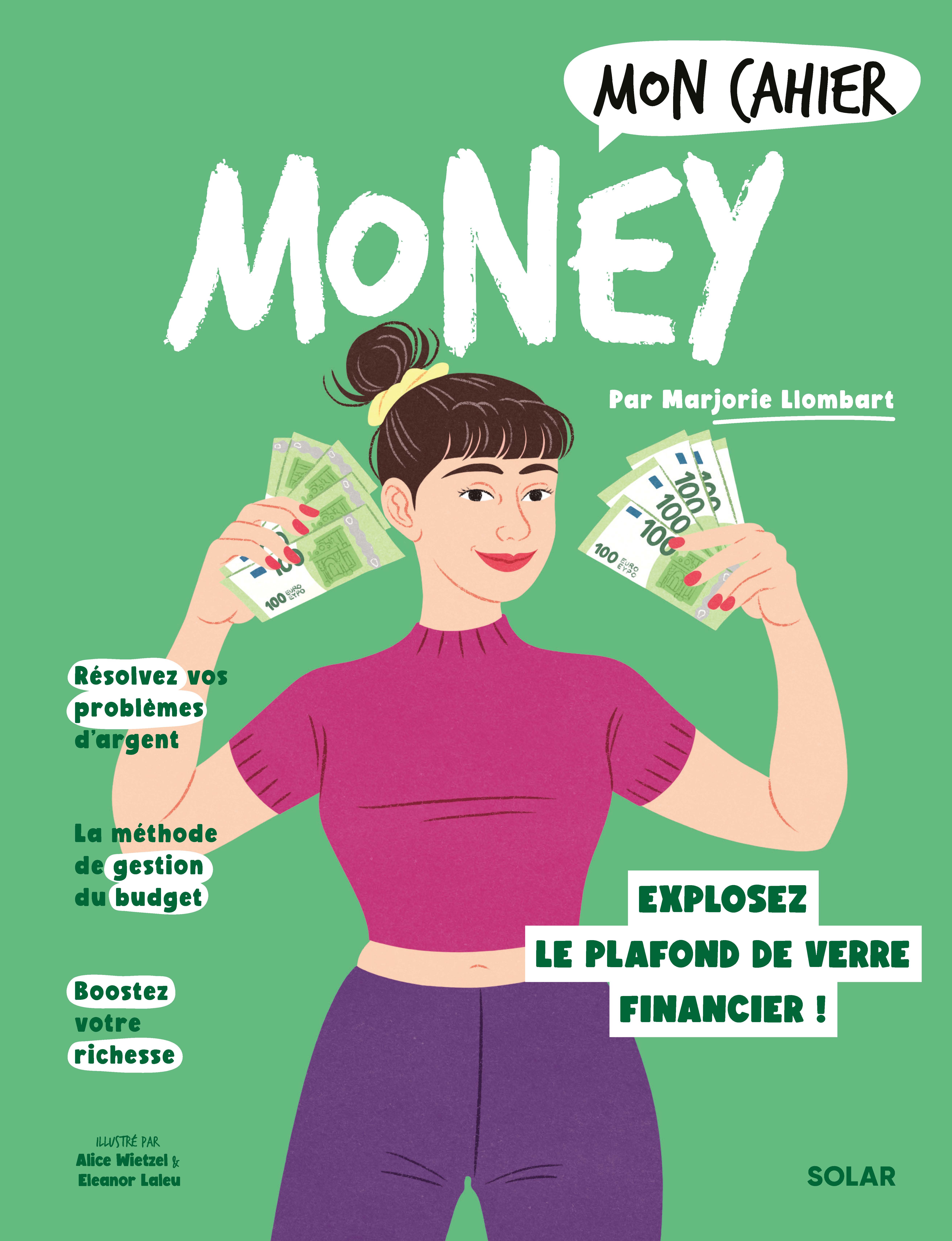
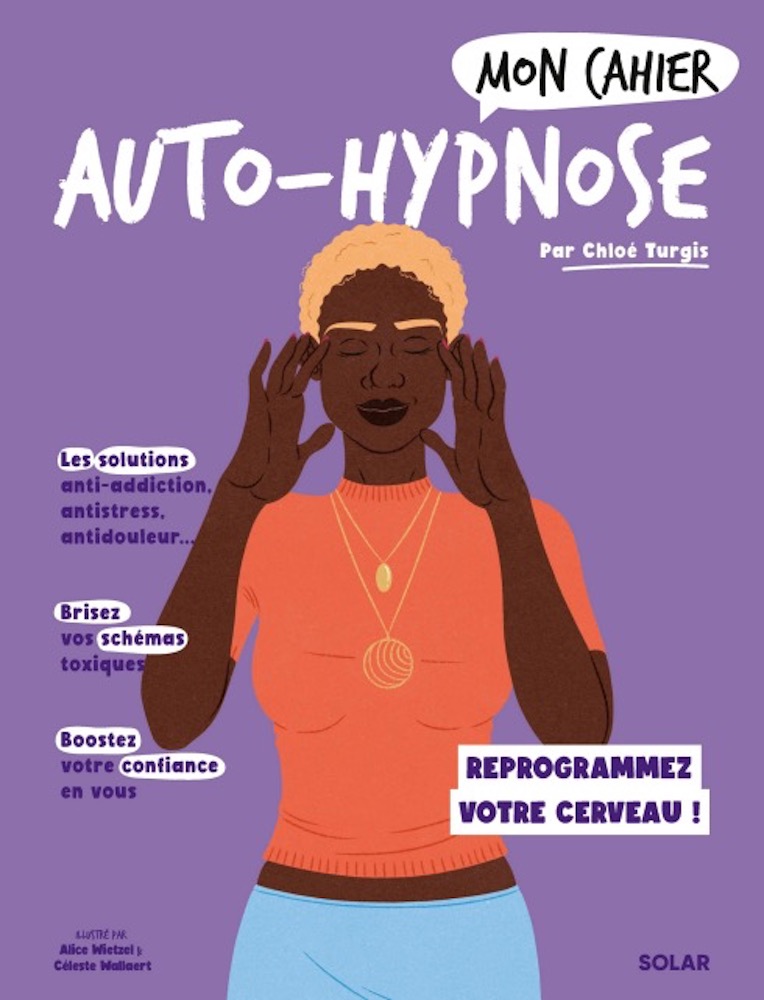
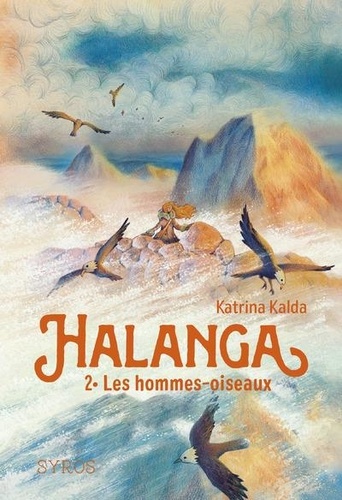
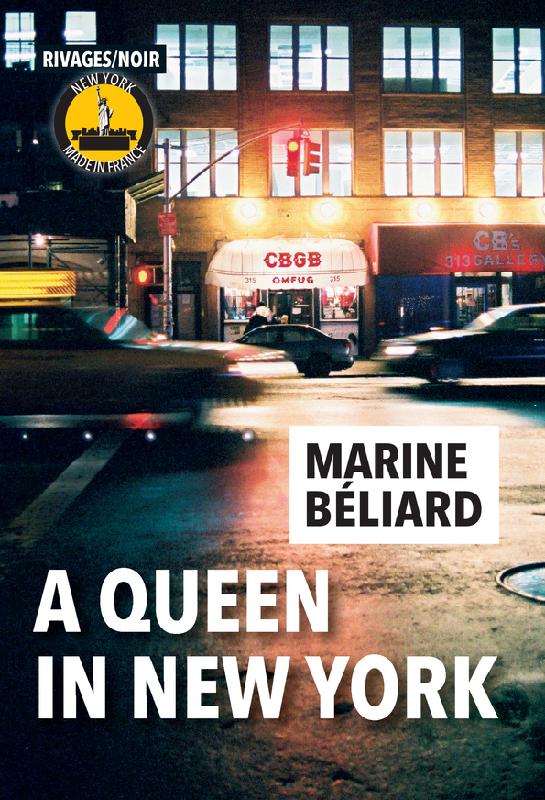
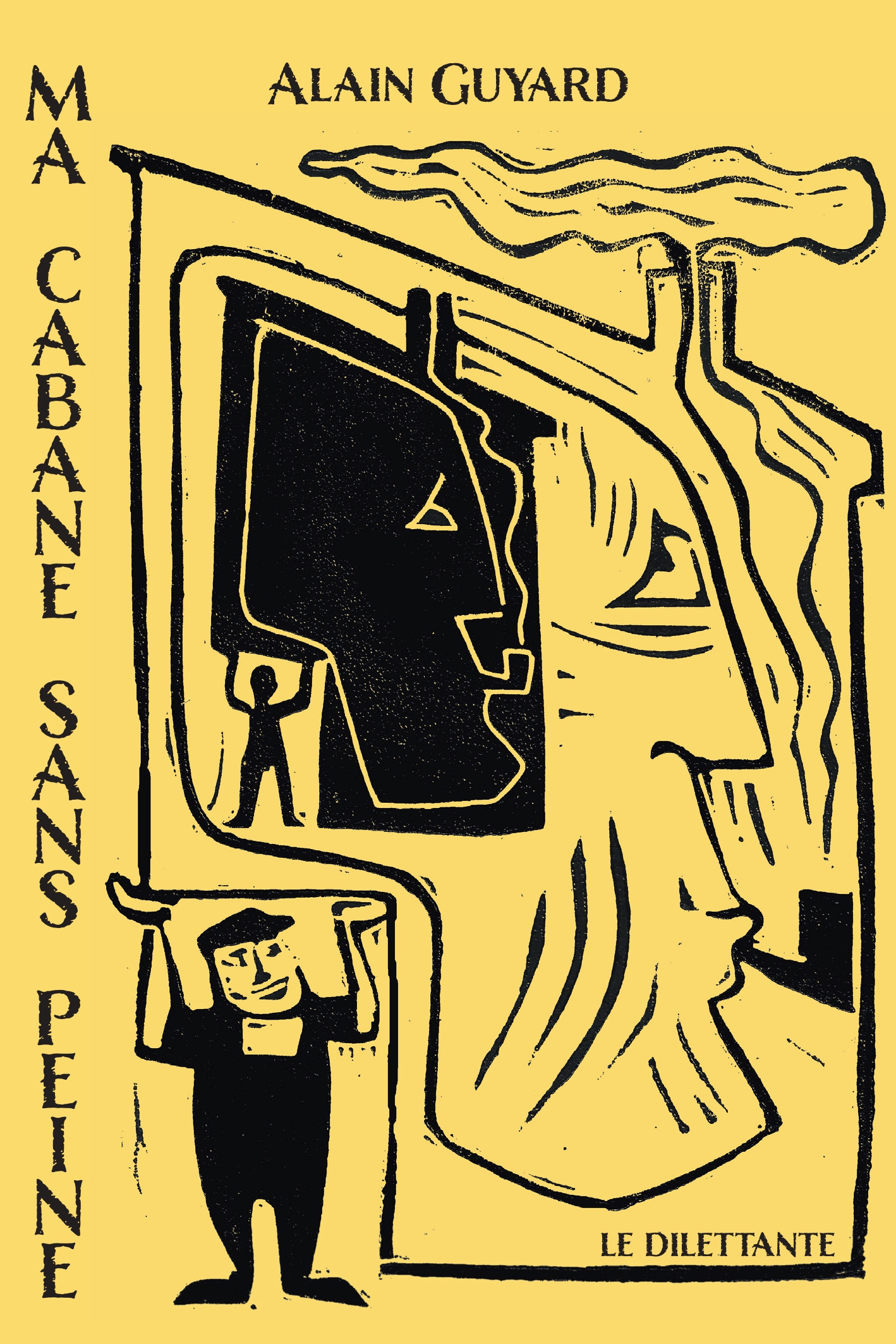
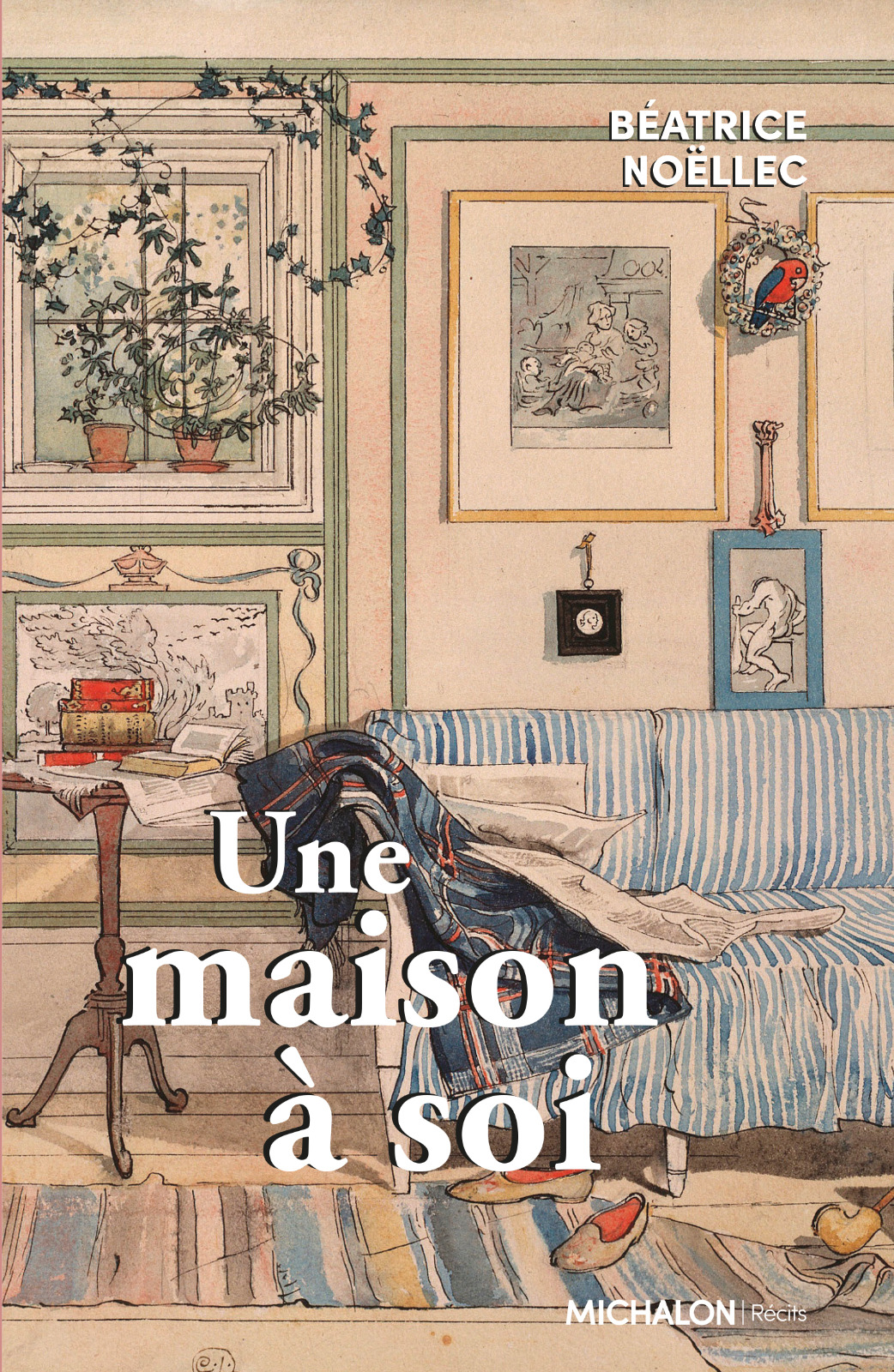
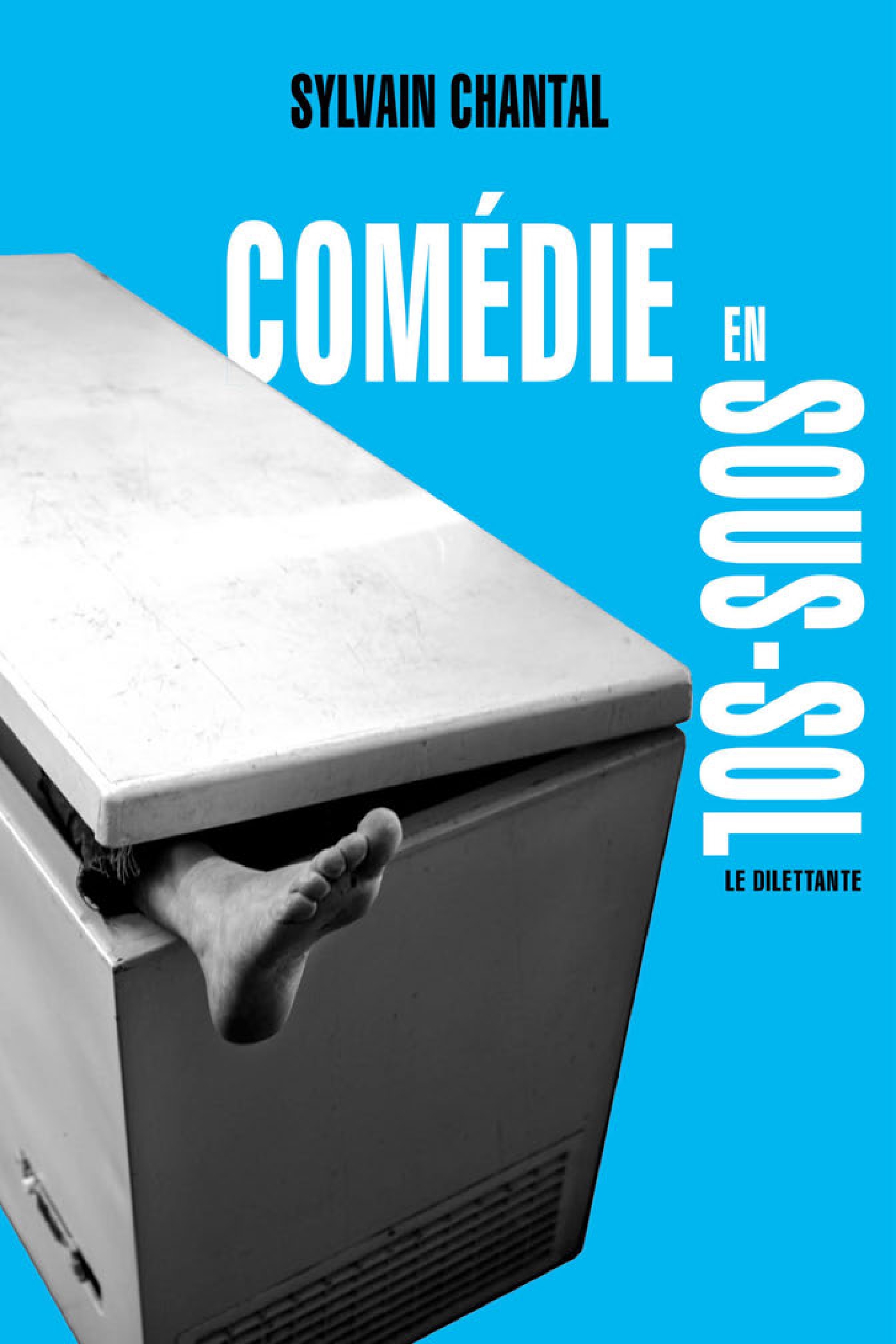
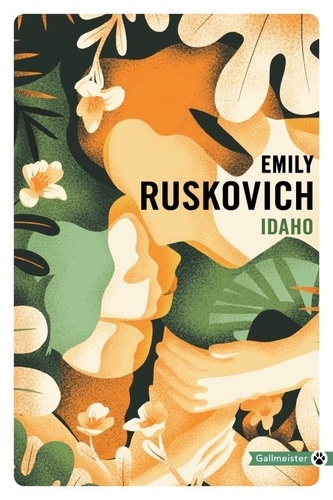
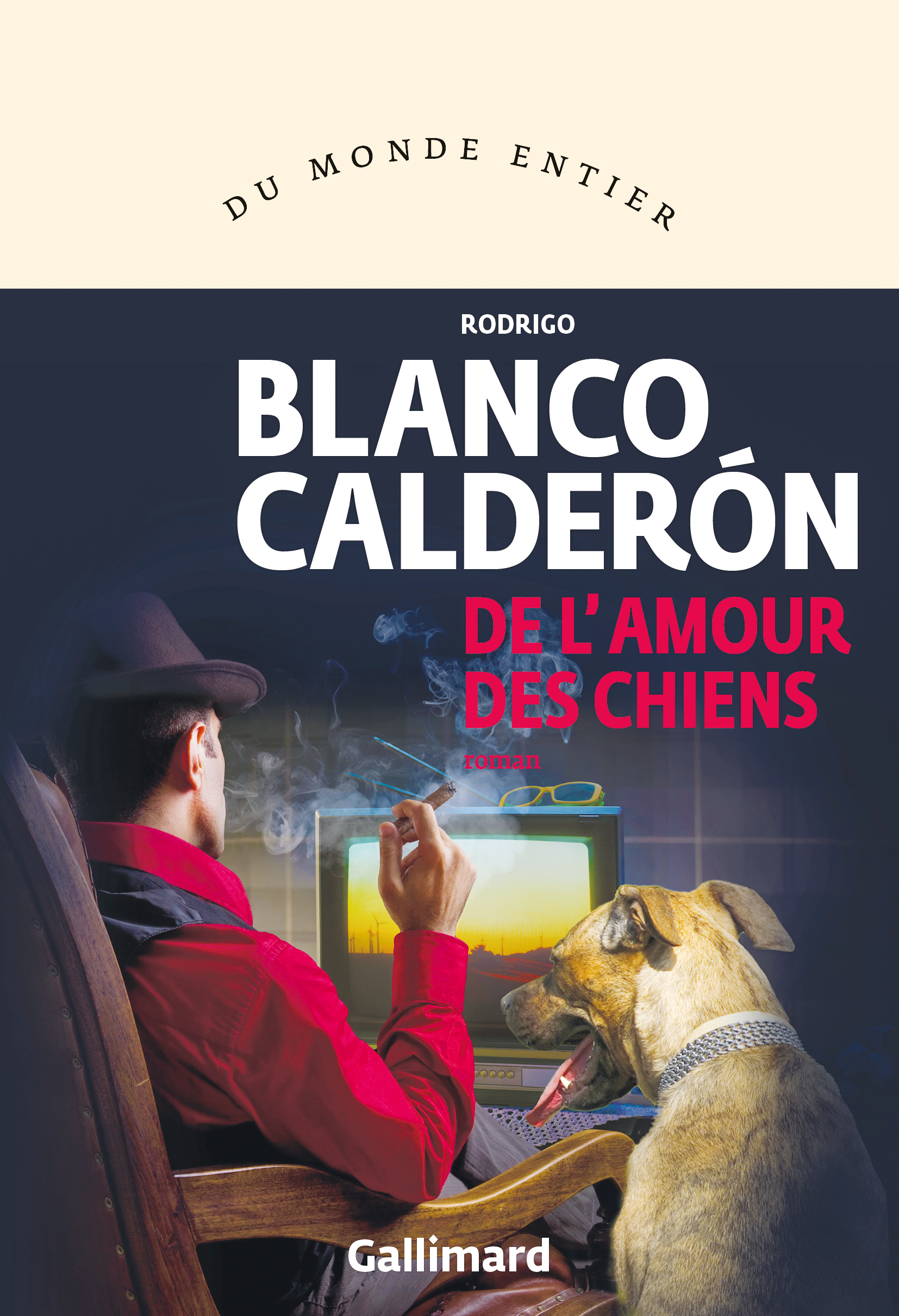

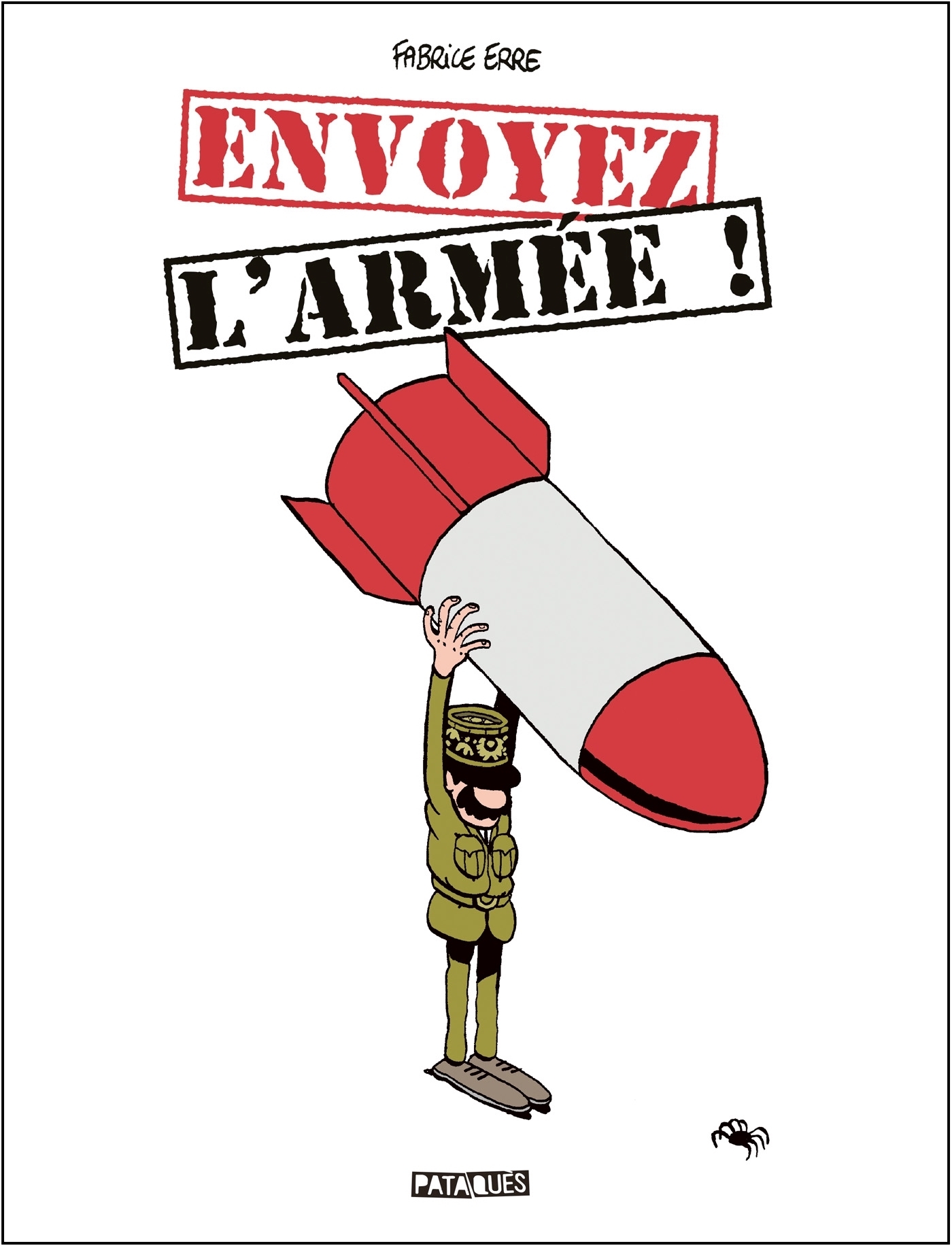
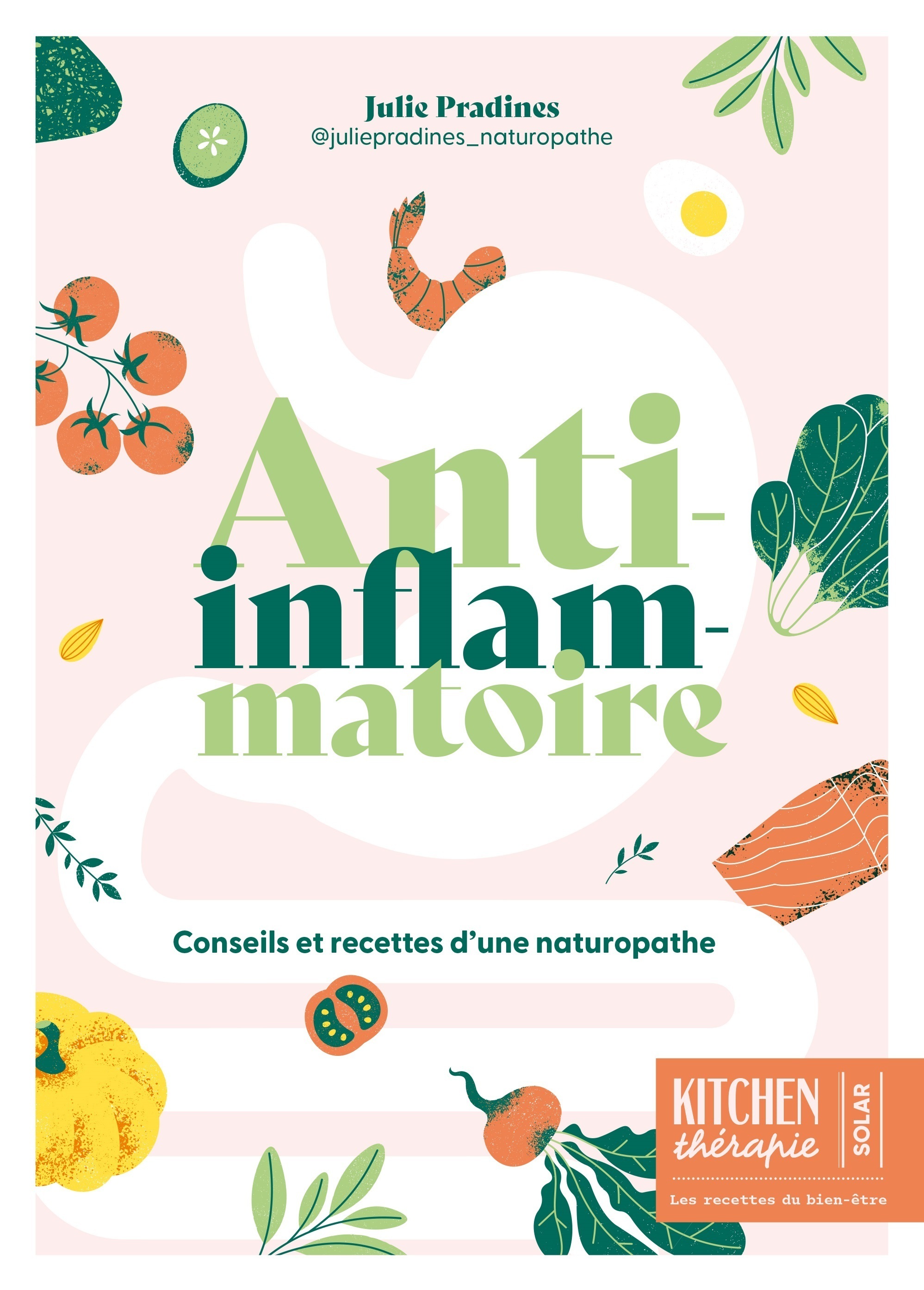
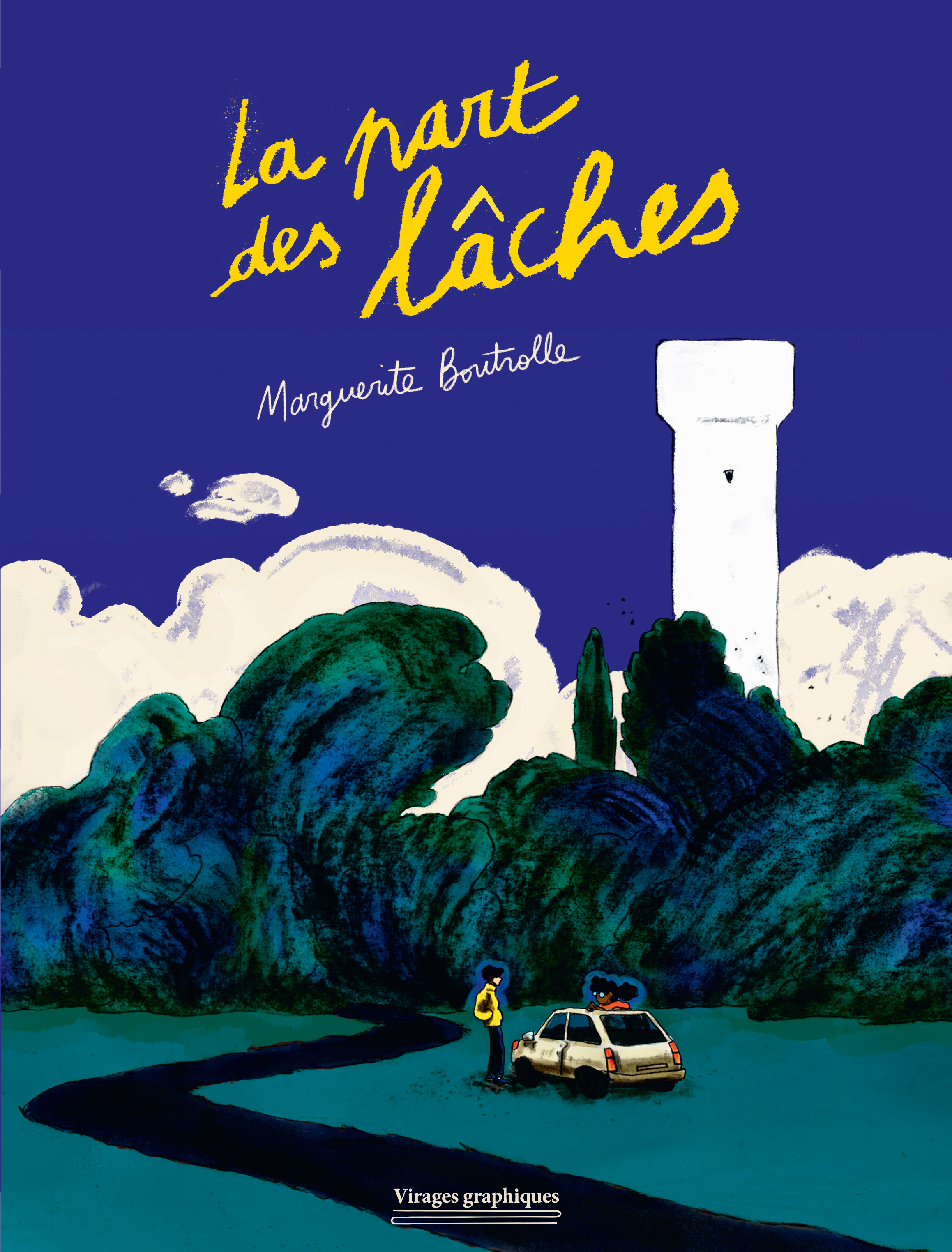

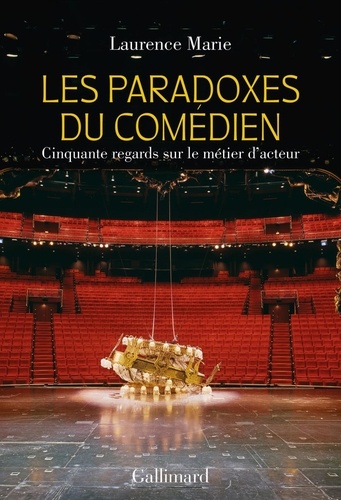
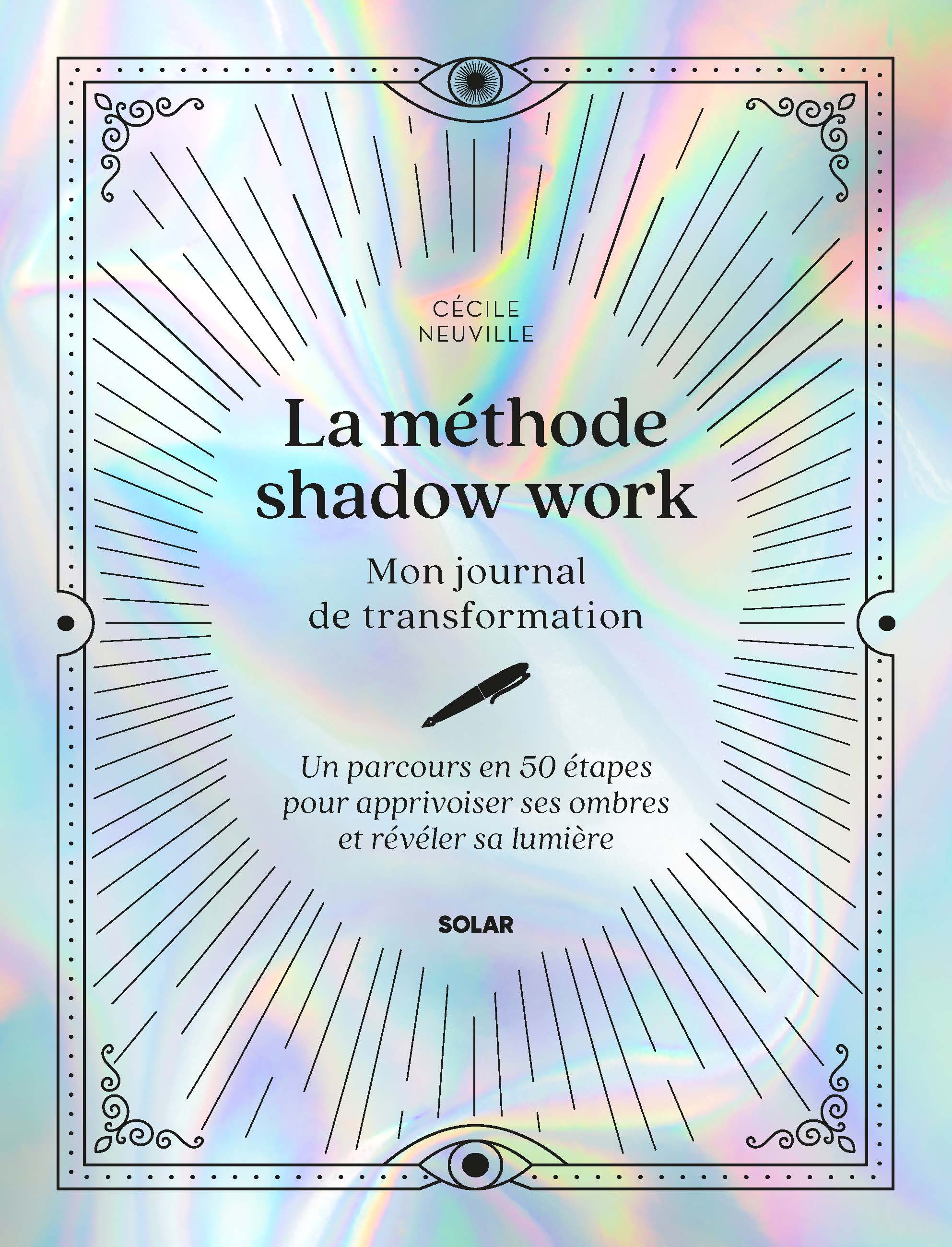
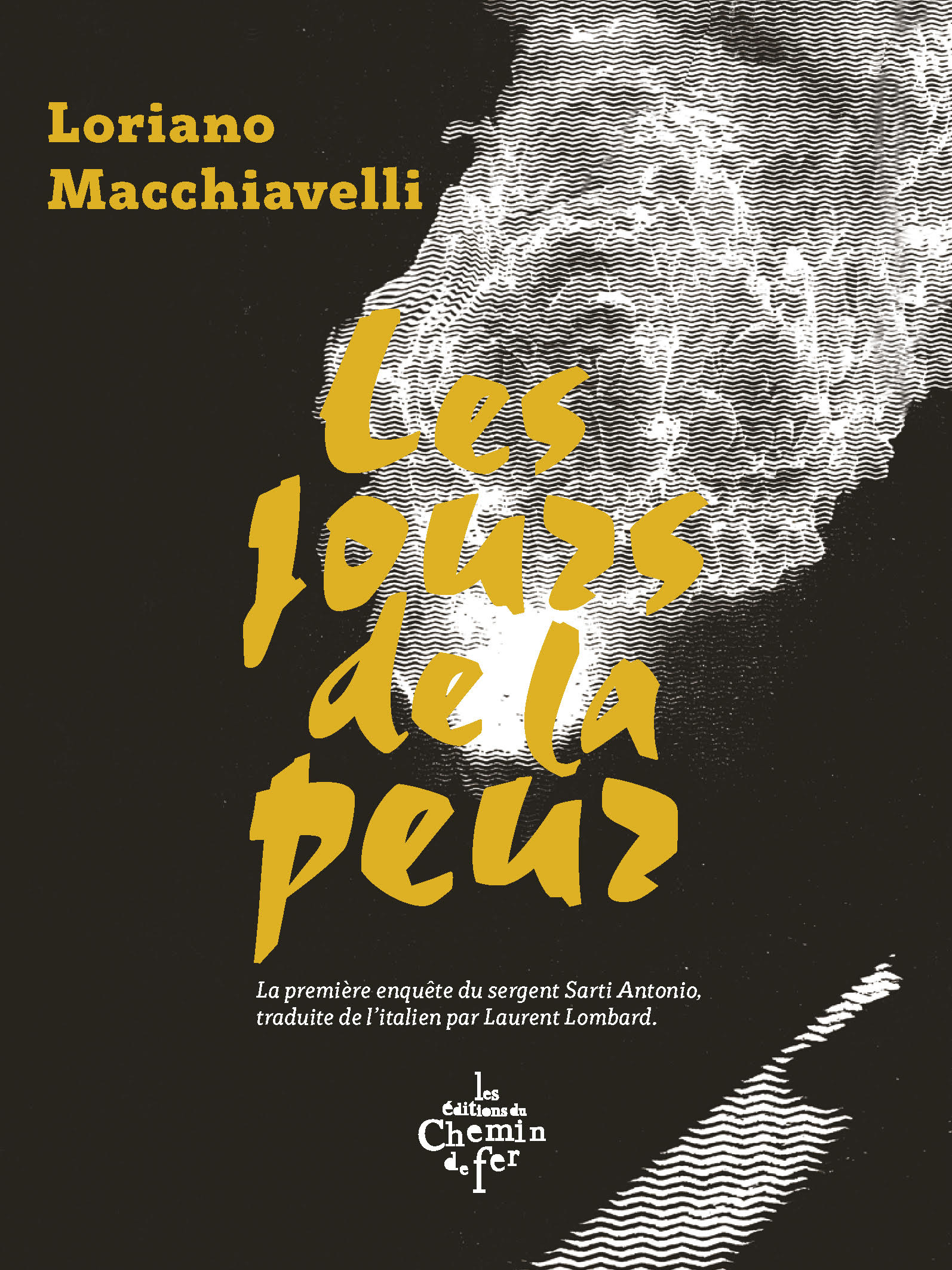
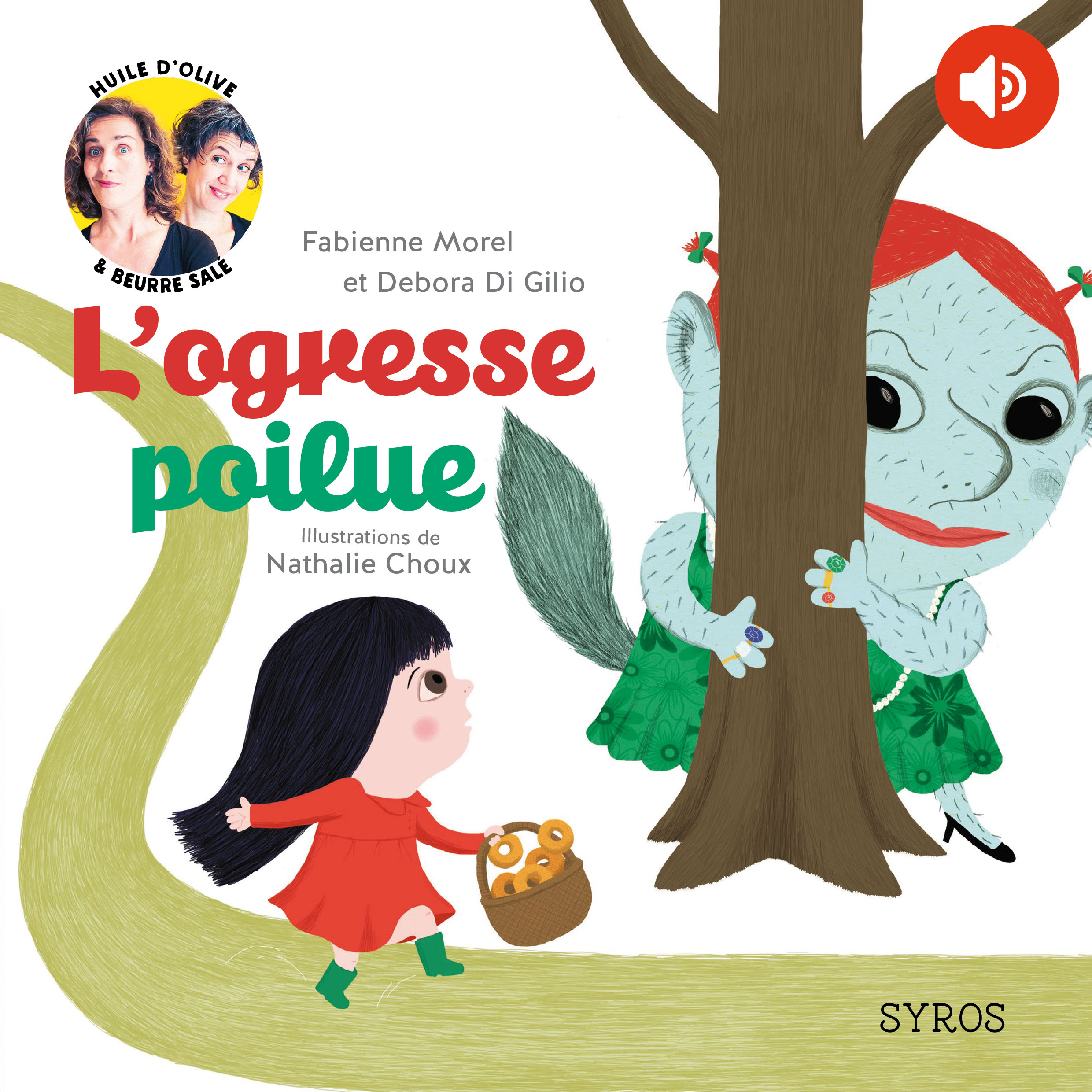
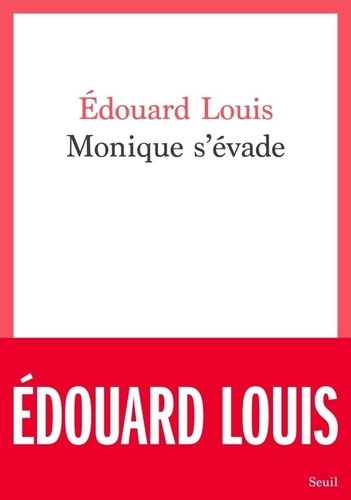
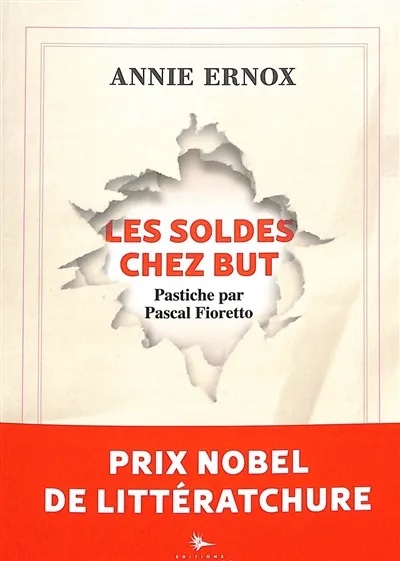
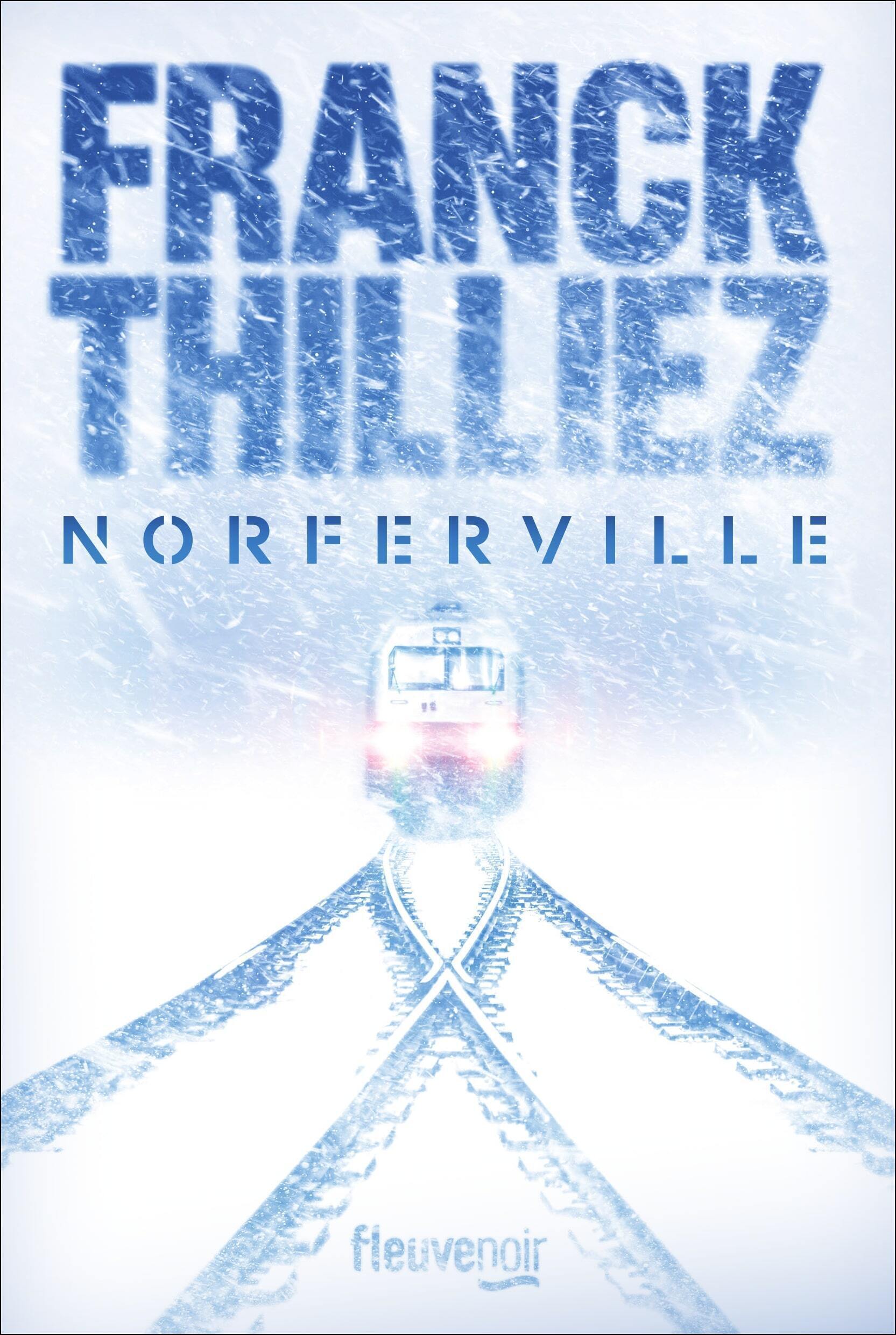
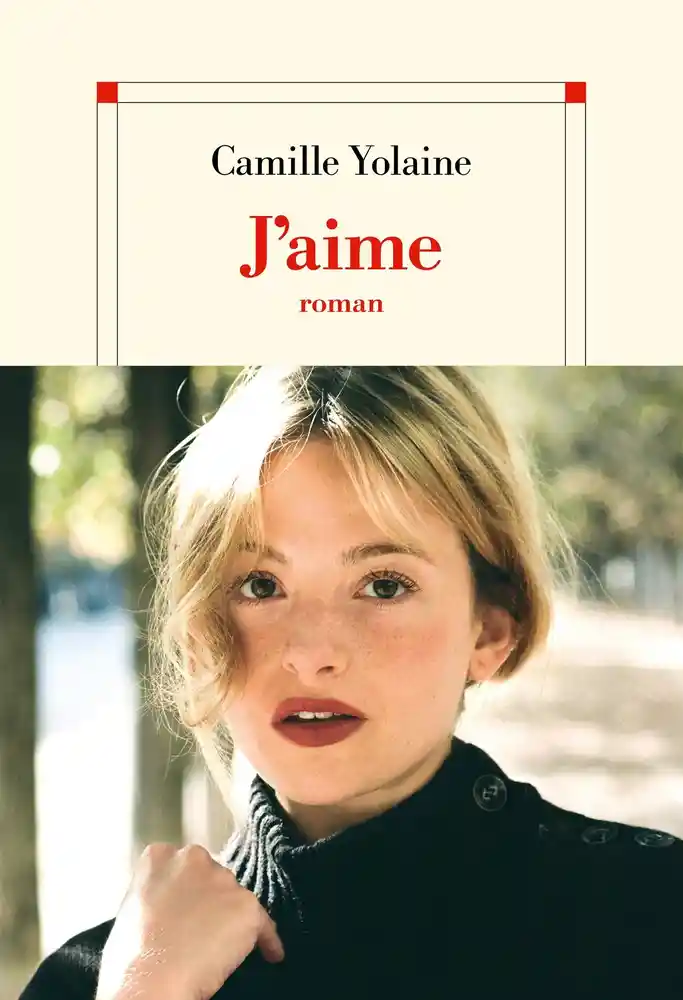
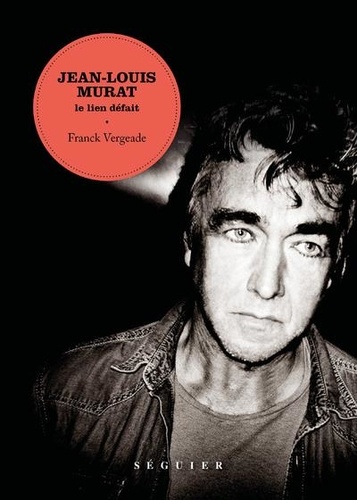
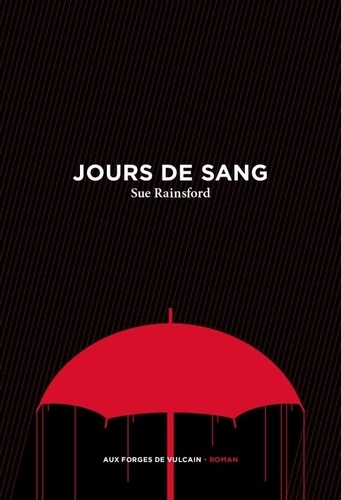
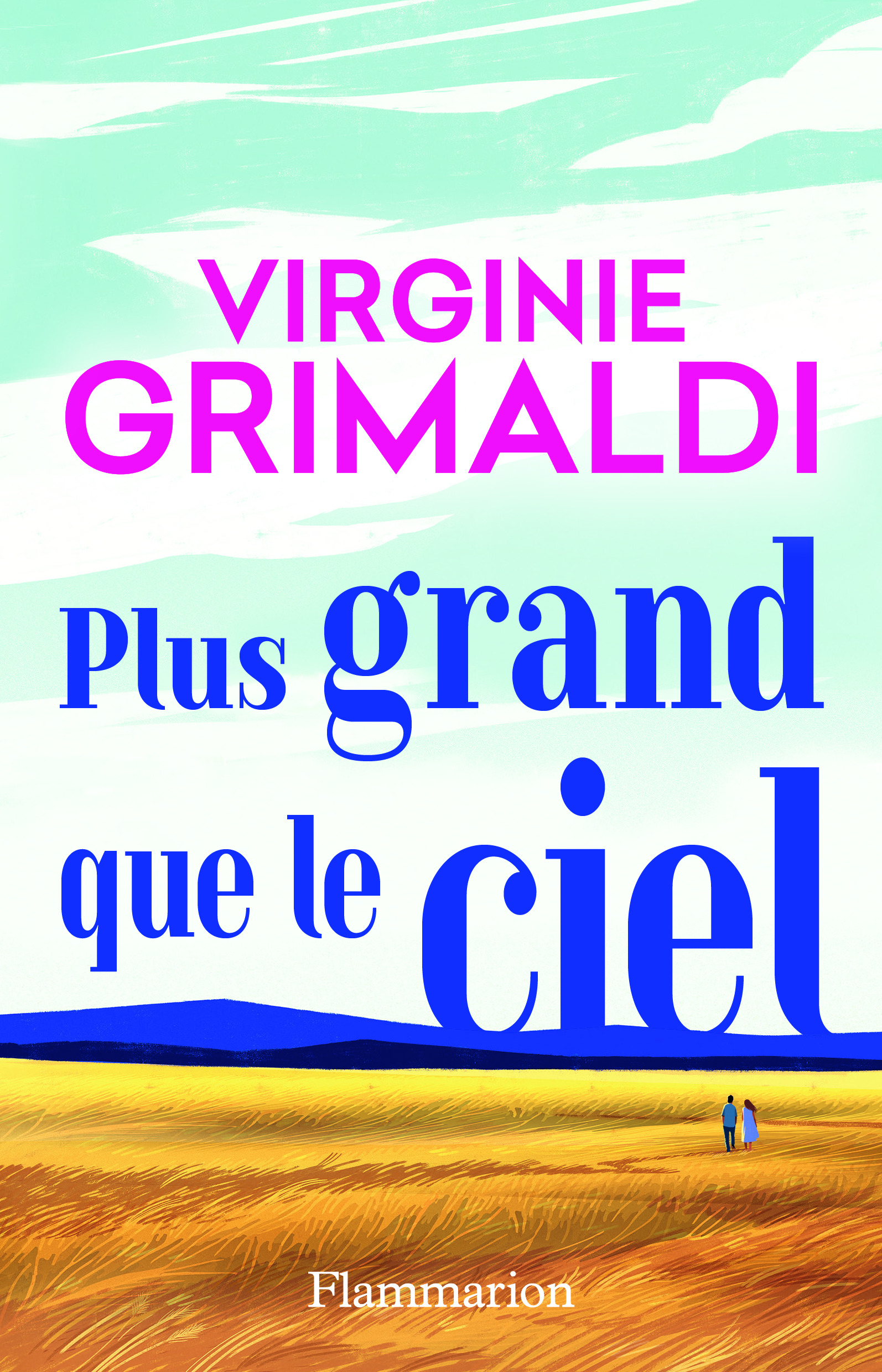
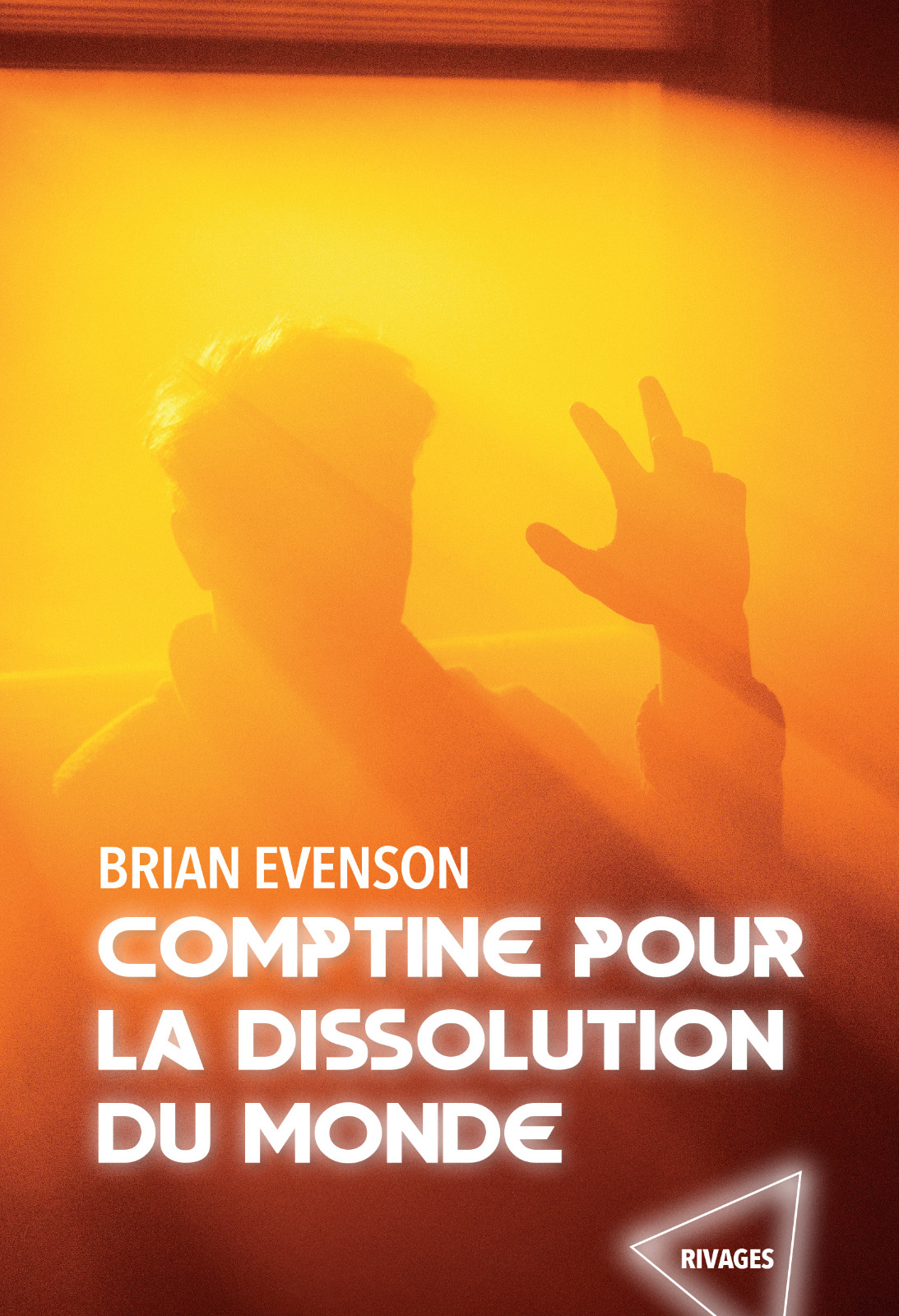
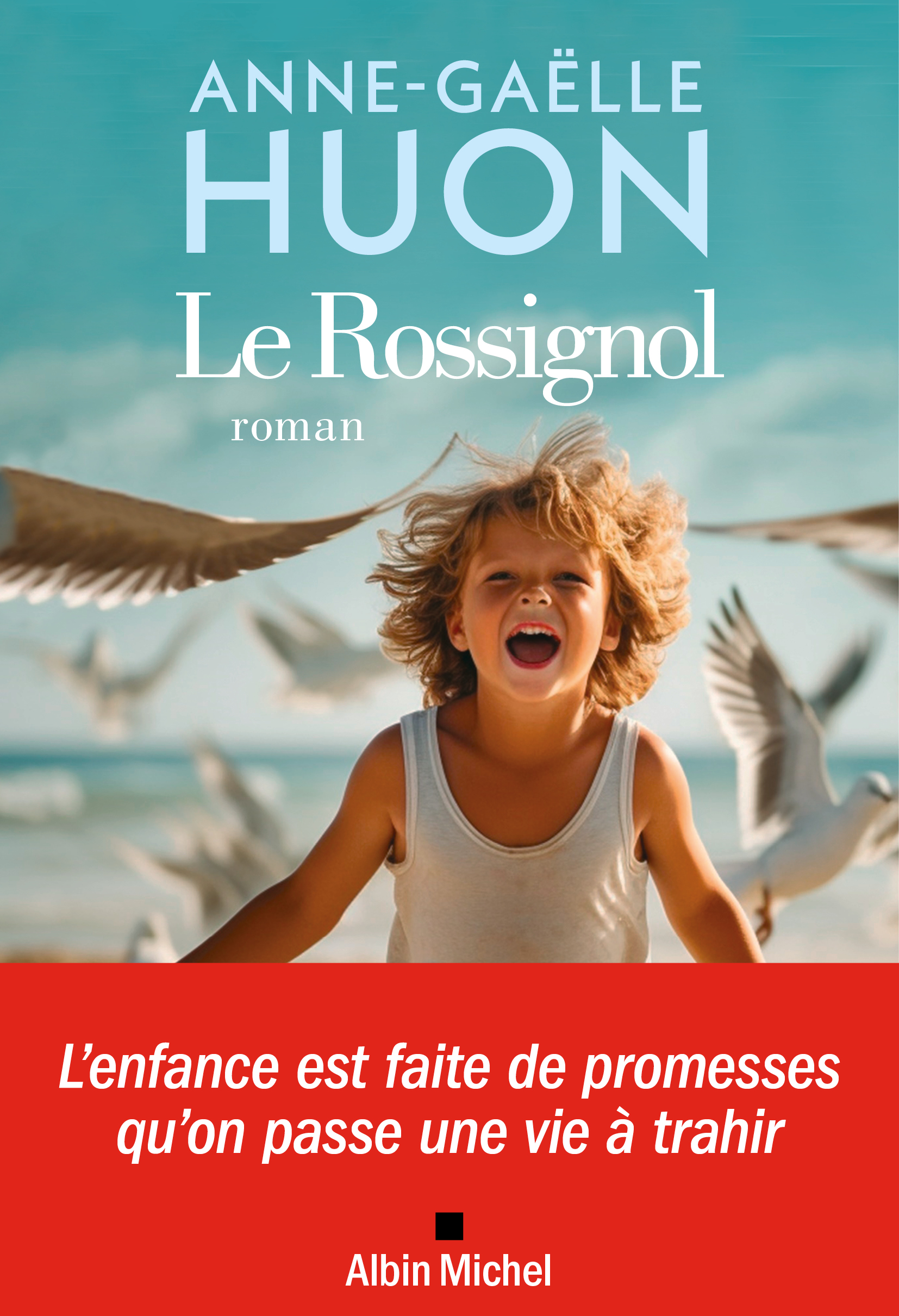
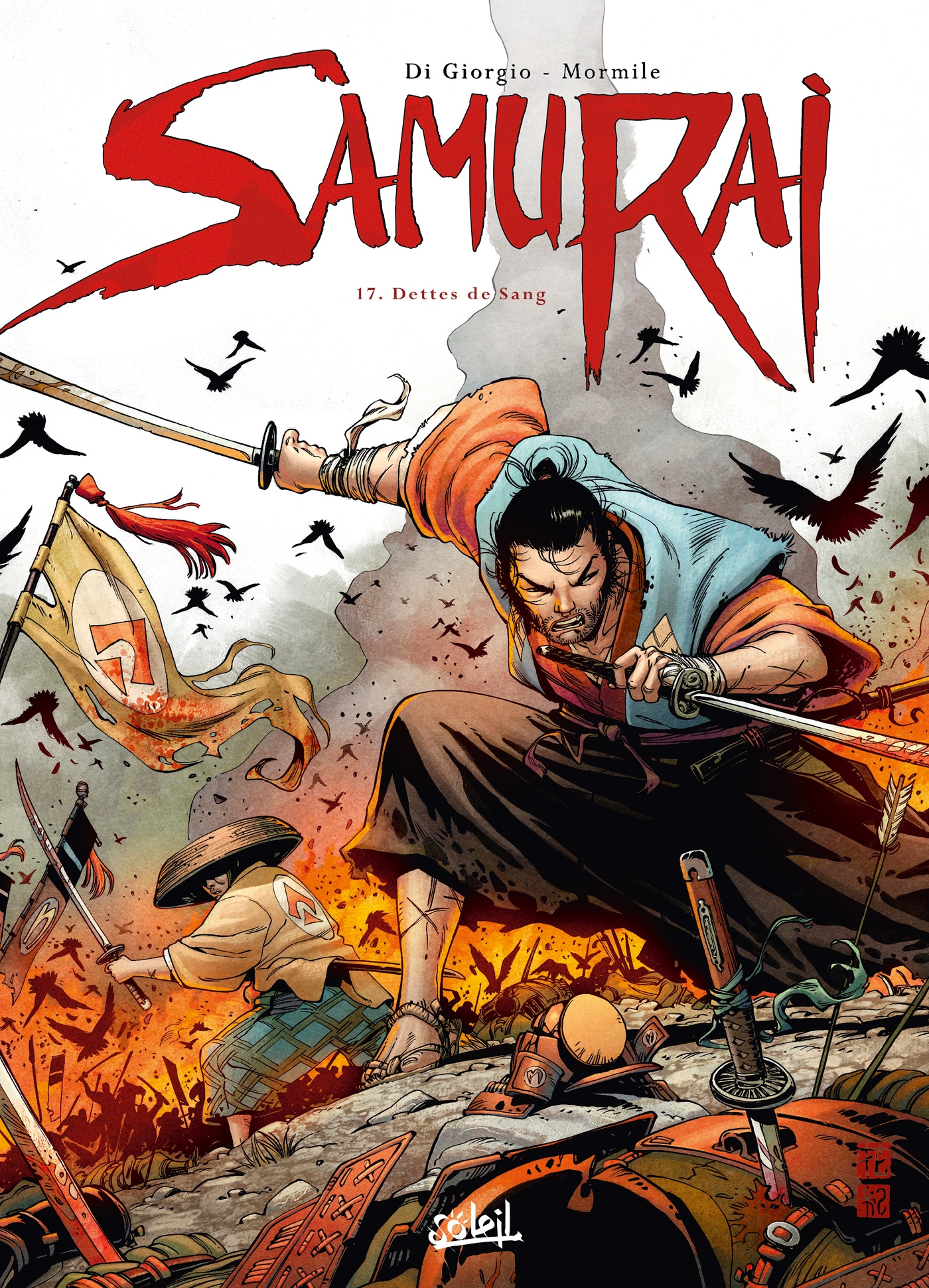

1 Commentaire
Aristarque
07/12/2020 à 22:49
Ingénieuse innovation technique ; mais le résultat est nul : c'est filandreux, interminable, irréaliste...