Papa est mort en lisant le monde, de Jon de Lorett : entre deux mondes
Voici un roman d’une sobriété classique : l’action tient en vingt-quatre heures dans un appartement. C’est la règle des trois unités selon Boileau : « Qu’en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli. » Mais l’unité de ton est mise à mal : c’est une tragi-comédie conjuguant le macabre et l’humour, le chagrin et le sourire. Ce mélange réaliste fait l’originalité de ce récit sans temps… mort.
Le 04/10/2017 à 16:33 par Auteur invité
Publié le :
04/10/2017 à 16:33

C’est une fin bien peu dramatique pour un sexagénaire : il s’éteint d’un seul coup (infarctus ou anévrisme), en lisant son journal, un vendredi matin. Une belle mort, comme on dit : « Il était posé sur la table. Oui, la tête posée sur le journal qui était grand ouvert », a expliqué la femme de ménage qui l’a découvert. Voilà qui va perturber le week-end de Jon, son fils, qui avait prévu autre chose. Son père vivait seul, séparé de sa femme ; ses deux autres enfants, le frère et la sœur de Jon, ne sont pas sur place : c’est donc à Jon de garder le mort jusqu’au lendemain, jusqu’à ce que la famille se rassemble une dernière fois. Cette veillée, en tête à tête avec le défunt, oblige Jon à regarder en face le présent et à revivre des bribes du passé.
Que faire en attendant le jour suivant ? Jon téléphone aux pompes funèbres qui vont envoyer quelqu’un préparer le corps. Il prévient son frère et sa sœur. Il prévient son ami Ludovic qu’ils ne pourront pas se voir ce soir. Il fouille l’appartement : s’il y avait un testament ? de l’argent caché ? Il ouvre les armoires et les tiroirs, épluche le carnet d’adresses : il n’y a aucun secret de famille, mais les relevés de banque de son père lui réservent une petite surprise.
S’il y avait des secrets, ce serait dans l’ordinateur que Jon essaie en vain de débloquer en imaginant des mots de passe. Vers midi, Jon se fait à manger : son père avait des provisions. Le soir, il mangera une excellente paella (« Les moules sont charnues, leurs coquilles noires et laquées, on dirait de petits cercueils. ») que lui a apportée la femme de ménage, vieille habituée de la famille. Il hésite à ouvrir une bouteille de vin : « Si j’ouvre une bouteille de vin, est-ce qu’on m’accusera de n’avoir pas de chagrin et de ne pas aimer papa ? » Et puis, à intervalles réguliers, il rend visite au cadavre : « Je le regarde encore, présent, absent, entre deux mondes. »
Cette mort le fait réfléchir : « J’essaie de faire le point, sauf que le point se déplace sans cesse. » Il a des griefs contre son père : son père préférait son frère et sa sœur ; son père manquait de charisme ; son père, enseignant, a vécu sans gloire et sans panache ; son père n’a pas su garder sa femme, la mère de Jon ; son père ne s’est jamais engagé contre l’injustice et lisait Le Monde, journal de bourgeois frileux. Le fils s’érige en juge. De quel droit ? Qui a une dette envers l’autre, le fils ou le père ? Jon, entiché de philosophie (de cogito ergo sum à l’Etre heideggerien), reprend une formule de Sartre dans Les Mots : « Le lien de paternité est pourri. »
Toute autorité est pourrie aujourd’hui, c’est-à-dire sans fondement légitime, et le père semblait le savoir. Cette apparente démission a cependant montré au fils ce qu’est la tolérance et l’indépendance d’esprit. S’aimaient-ils ? « Le fil était ténu entre nous, il n’était pas cassé, il n’a jamais cassé. Nous l’avons voulu ténu, lui et moi, et tel le veut l’époque. » Bref, « papa n’est plus, il est un peu plus absent aujourd’hui qu’hier, c’est tout. » C’est sa mère qui était présente, « lumineuse », « photovoltaïque ». Il n’empêche que Jon versera trois fois des larmes au cours de cette journée et de la nuit.
Ses ruminations sont interrompues par la visite d’une voisine qui apporte deux parts de gâteau à son père (« Quand je fais de la pâtisserie, je lui en apporte. Il n’est pas malade au moins ? »), par un coup de téléphone de sa mère (« Laurent, c’est toi ? — Ah ! C’est toi maman ? — C’est toi, Jon ? Ton père n’est pas là ? — Papa est mort ce matin, assis devant son bureau, en lisant le journal »), par un coup de téléphone de Ludovic, et plus tard, par la visite du même Ludovic qui apporte du champagne. L’arrivée du thanatopracteur, que Jon surnomme Jack l’éventreur, donne lieu à une scène étrange que je vous laisse découvrir (elle est évoquée en quatrième de couverture). Et le fleuriste fait lui aussi diversion en livrant des glaïeuls blancs.
Pourquoi des glaïeuls ? Parce qu’ils « bandent longtemps ». Et bien sûr, il y a cet exemplaire du Monde que Jon se met à lire pour chercher l’article assassin, puis pour passer le temps, et dont il complète les mots croisés commencés part son défunt père. Du coup, le roman passe du microcosme au macrocosme : le lecteur aura fait le tour du monde avant l’aube, du malheur des pauvres aux malheurs des éléphants. De Lorett est dur avec le grand quotidien français, le journal de « l’injuste milieu ». Le père de Jon tenait particulièrement au supplément littéraire du Monde : le fils le feuillette et de Lorett donne deux ou trois coups de patte (peut-être inutiles) à la production littéraire du jour.
Ce monde va mal. Un fait divers en est la preuve : un kamikaze a précipité un avion airbus contre une colline des Alpes, s’envoyant lui et 149 passagers dans la mort. C’est le fait divers authentique du 24 mars 2015. Voilà un acte de désespoir, estime Jon, et qui annonce bien d’autres tueries du même genre. Jon a lu Marx, il a la trentaine, il est avocat, il milite encore pour le peuple, il devait aller le samedi matin à une importante réunion du « Comité », un groupuscule d’extrême gauche. Mais il a des doutes aujourd’hui : la violence révolutionnaire est-elle d’une nature différente de la violence instituée ? Son père était sceptique, athée, laïc : s’il avait eu raison ? Si cet individualisme que Jon condamne était la seule défense possible ? Y aura-t-il un jour des lendemains qui chantent ?
Ce père qui vécut et mourut sans bruit, a-t-il au moins été heureux ? Eh bien non. L’agrégé ès lettres avait un violon d’Ingres : il écrivait des romans dont aucun éditeur n’a voulu et dont les manuscrits sont soigneusement rangés à la cave. Le fils les y cherche, il les feuillette, et son jugement est sans appel : « Sur quoi pouvais-tu écrire, papa ? Tu n’as connu ni la guerre, ni la misère, ni le déclassement social, ni la maladie. Toi, tout blanc, ni pédé, ni boiteux, ni tubard, ni chômeur, même pas fils de divorcés, tu ne pouvais écrire sur rien et ce que tu as écrit n’est rien. Zéro en littérature ! Le comble pour un prof de lettres ! » Avis aux écrivains en herbe.
Cette nuit de veille réserve au fils et au lecteur encore quelques surprises : elle se finit dans la douleur, l’insomnie et… la poésie. De Lorett achève sur un trait d’humour ou de dérision. Quand Jon se réveille le samedi matin après une courte nuit (« Papa, papa ! — Papa ne m’entend pas, il est bien mort, c’est pour toujours, ça ne changera plus, il ne s’agissait pas d’un rêve »), il descend acheter des croissants (« Papa se plaignait de leur mauvaise qualité, trop gras et feuilletés »), et Le Monde, pour avoir la solution des mots croisés. Tel père, tel fils ?
Fiction, témoignage, autofiction ? Impossible à dire, les trois genres à la fois, et l’interview de l’auteur qu’on peut lire sur ActuaLitté ne donne pas la réponse. En tout cas, voilà une oraison funèbre qui ne manque pas d’air : « Il se pourrait qu’il fasse beau, bien que papa soit mort. La vie continue, évidemment, il y a chaque jour des morts sauf qu’on n’y pense jamais. »
Laurent Jouannaud
Jon de Lorett – Papa est mort en lisant le monde – L’Éditeur – 9782362011085 – 16 €
Papa est mort en lisant Le Monde
Paru le 25/08/2017
240 pages
L'Editeur
16,00 €




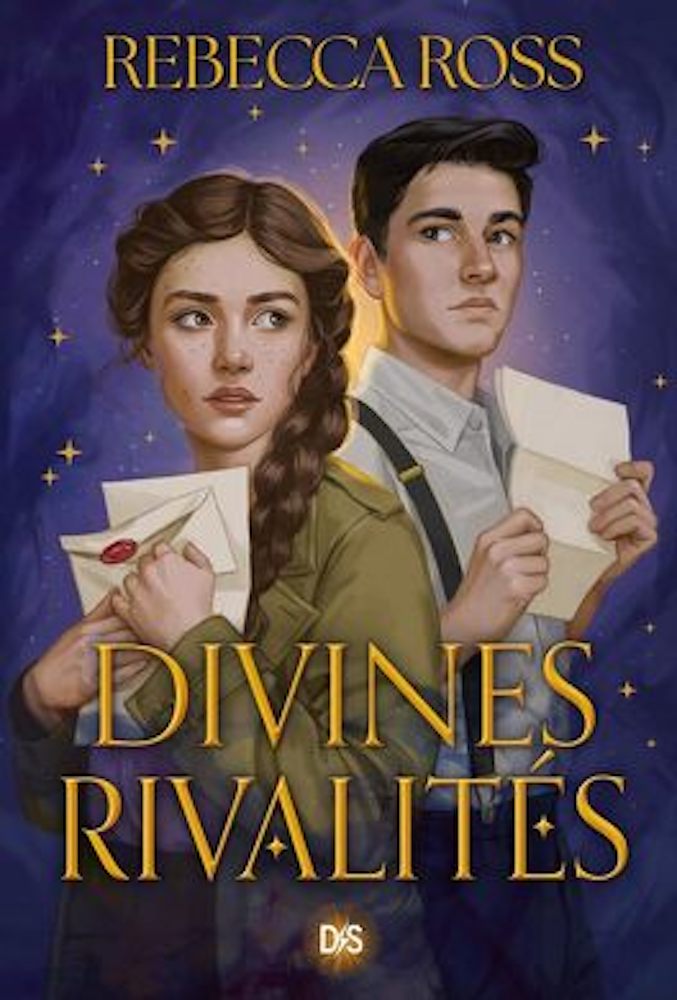
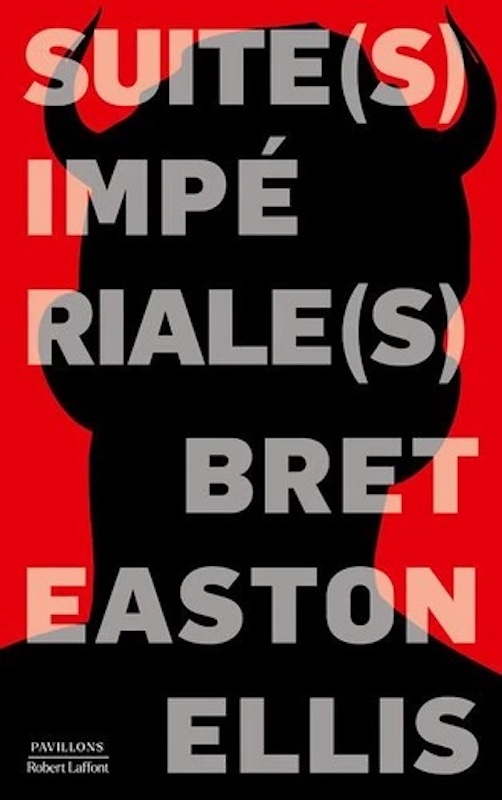

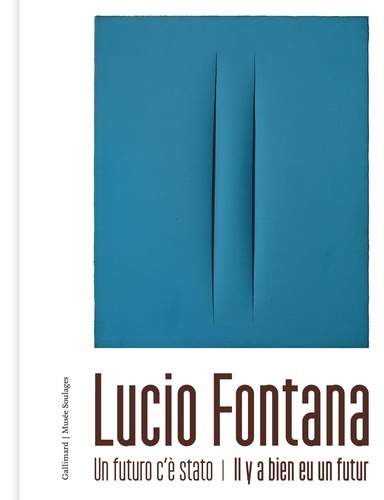

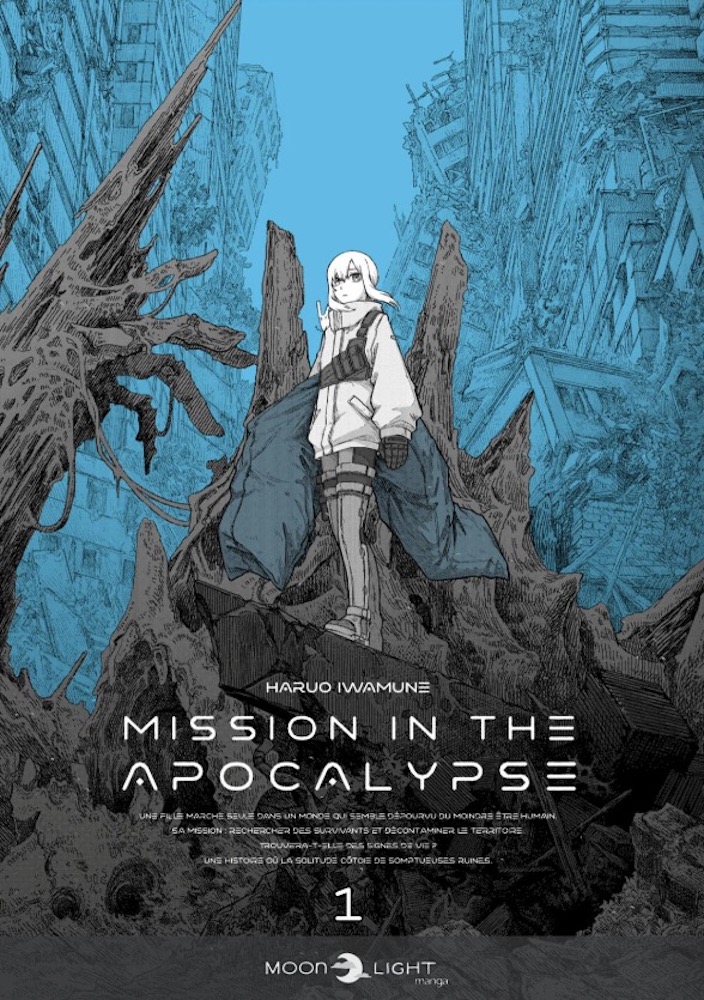
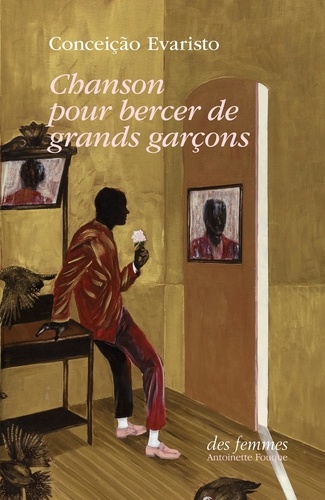
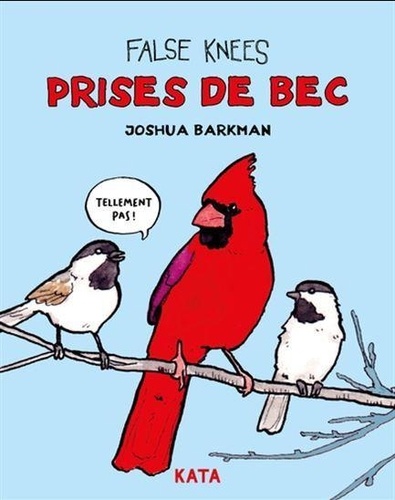
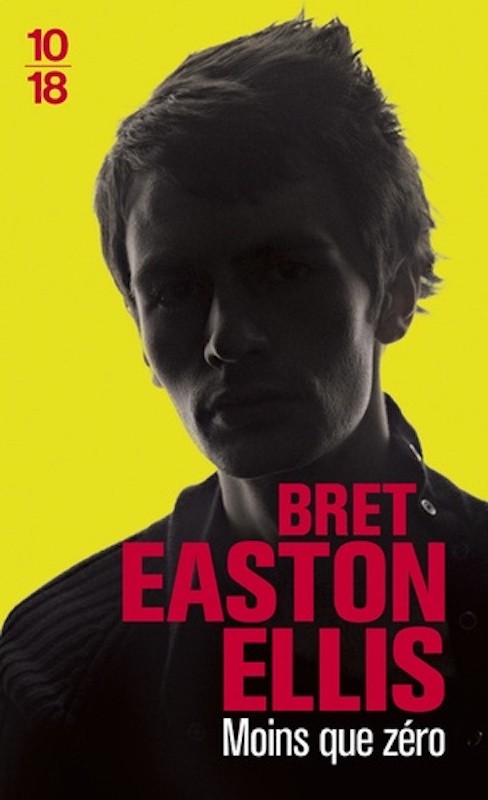

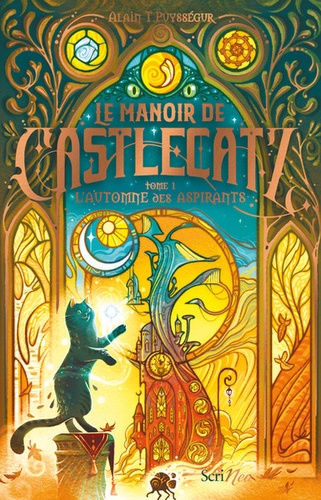

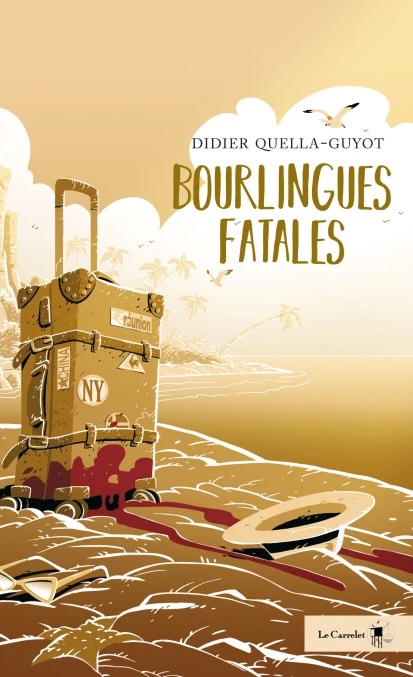

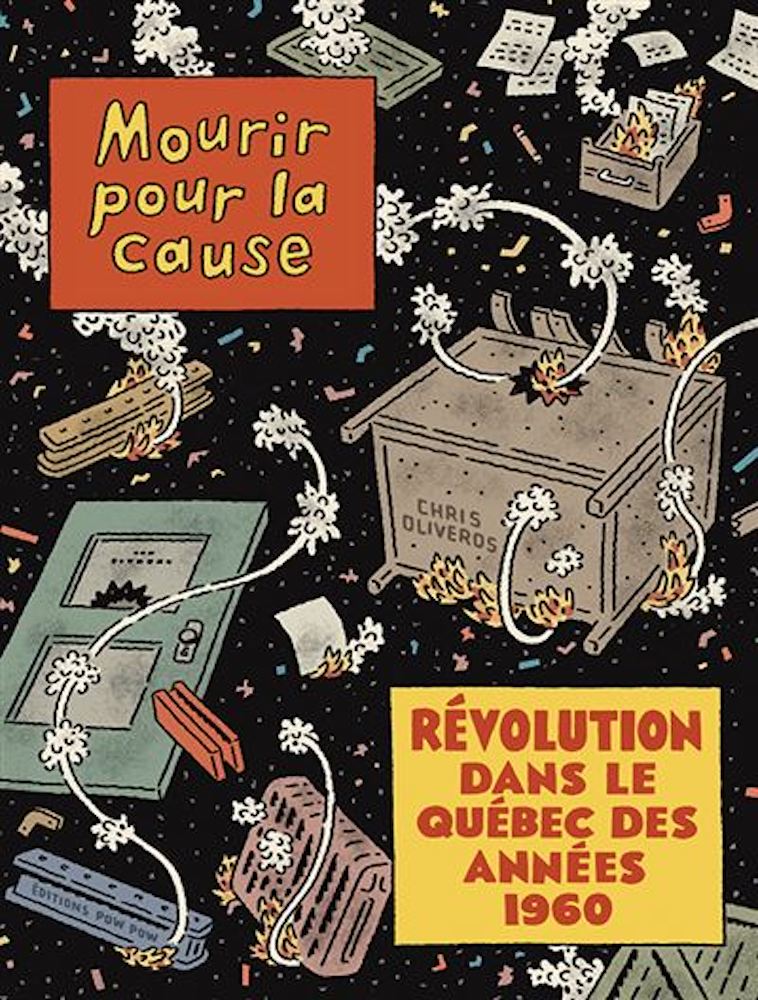
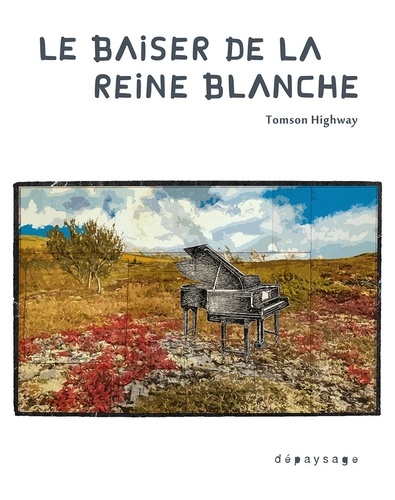
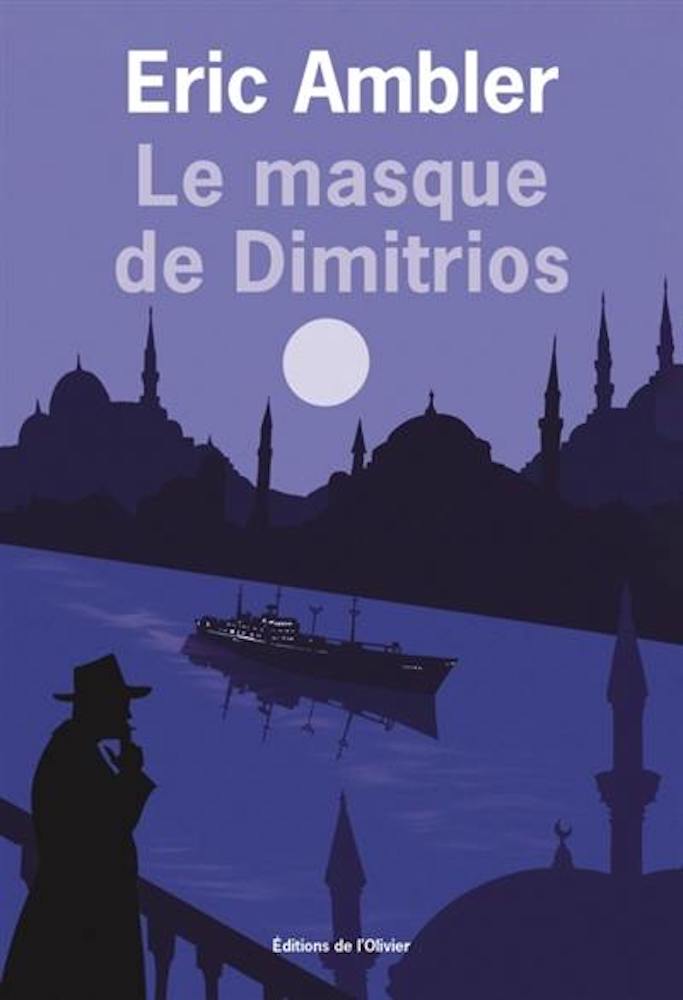
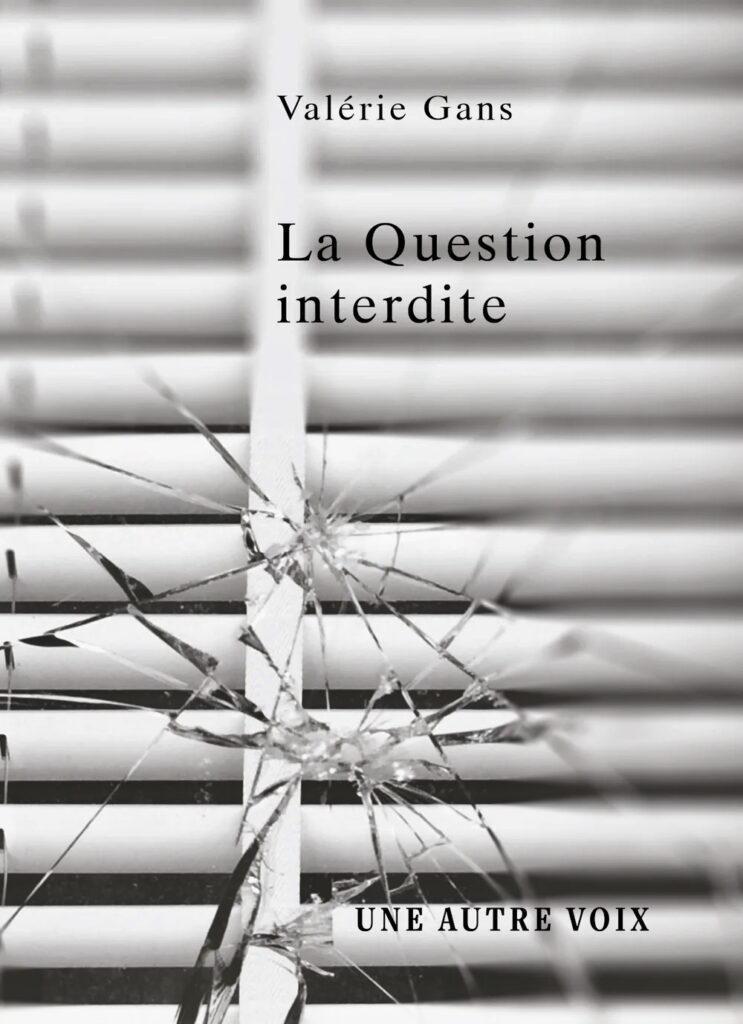
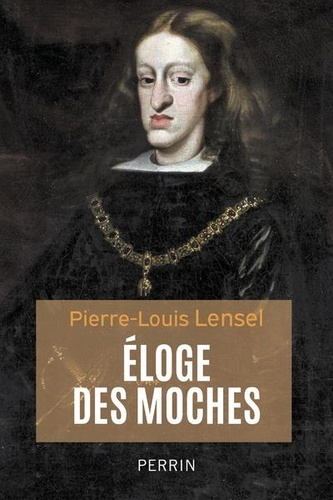
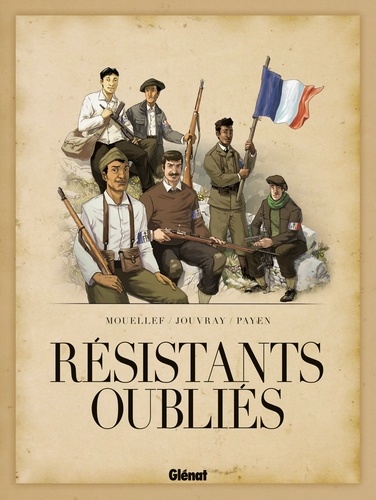

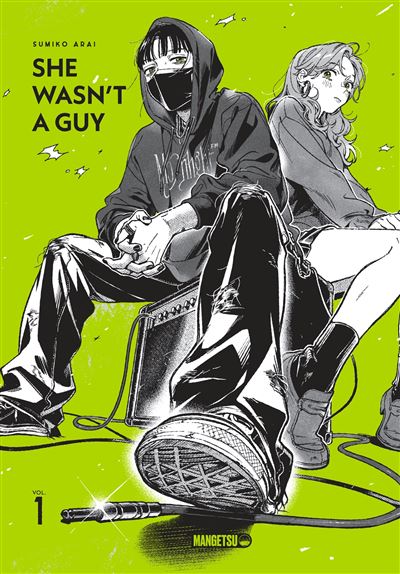
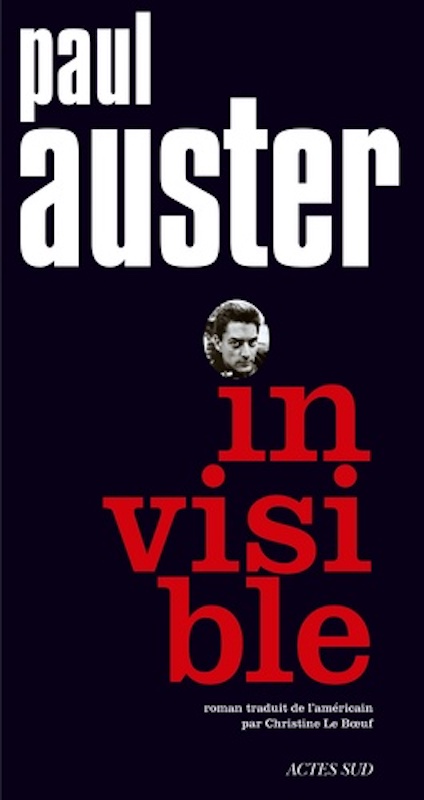
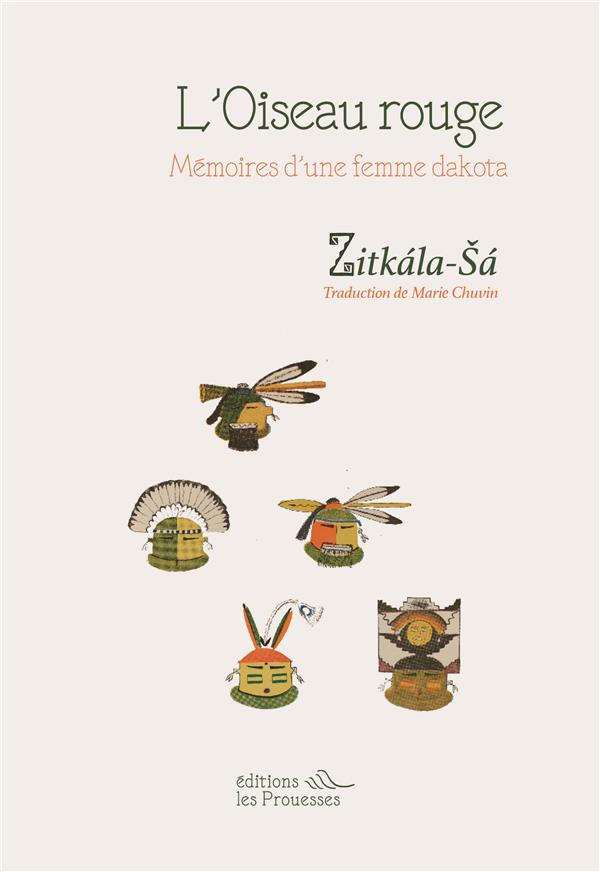


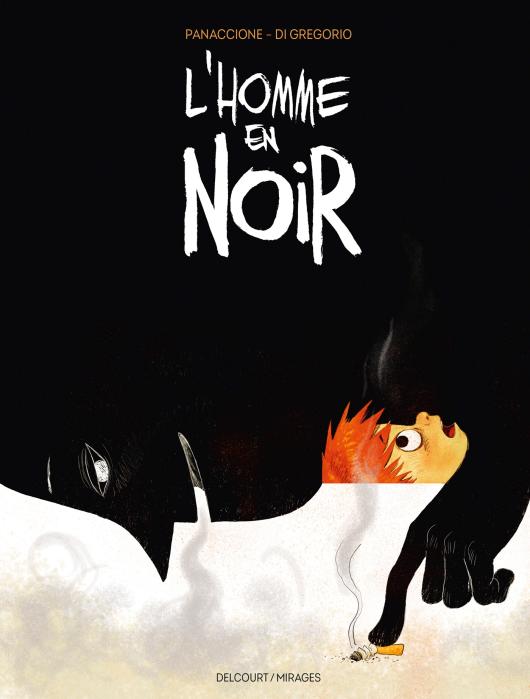



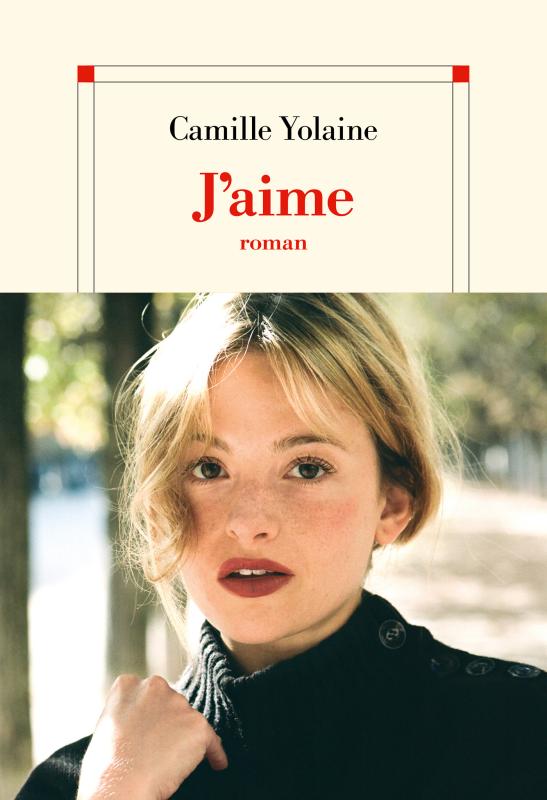
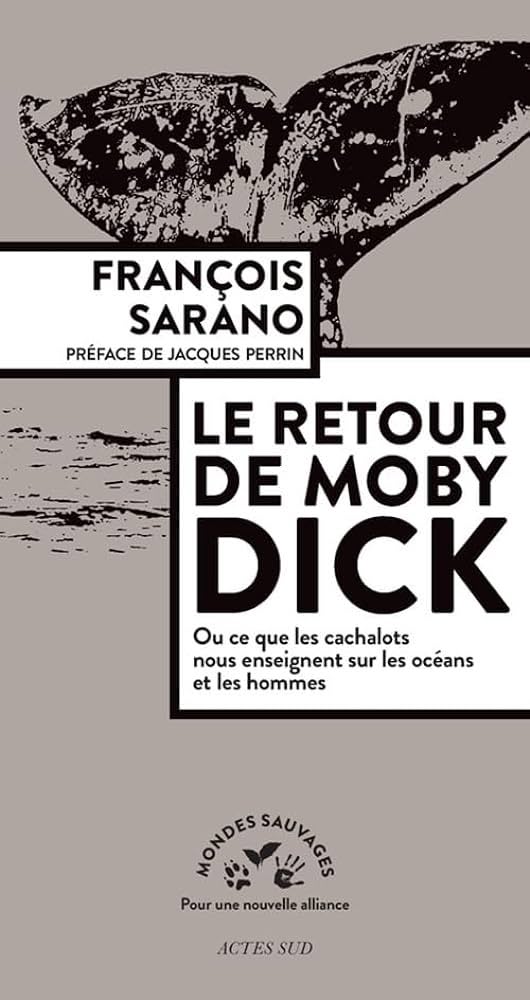




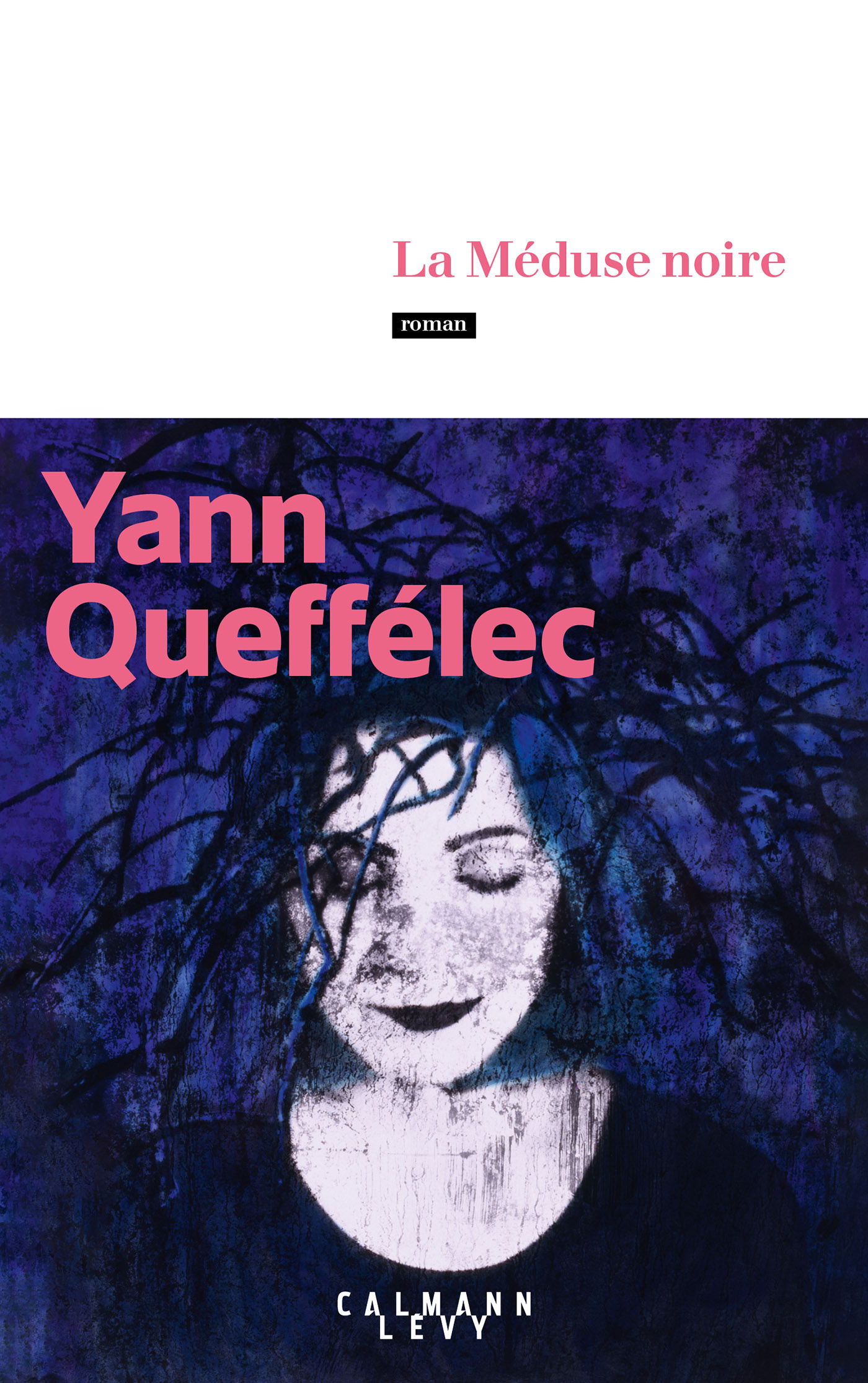




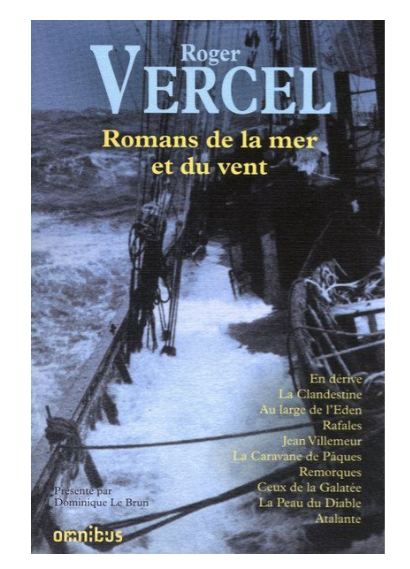

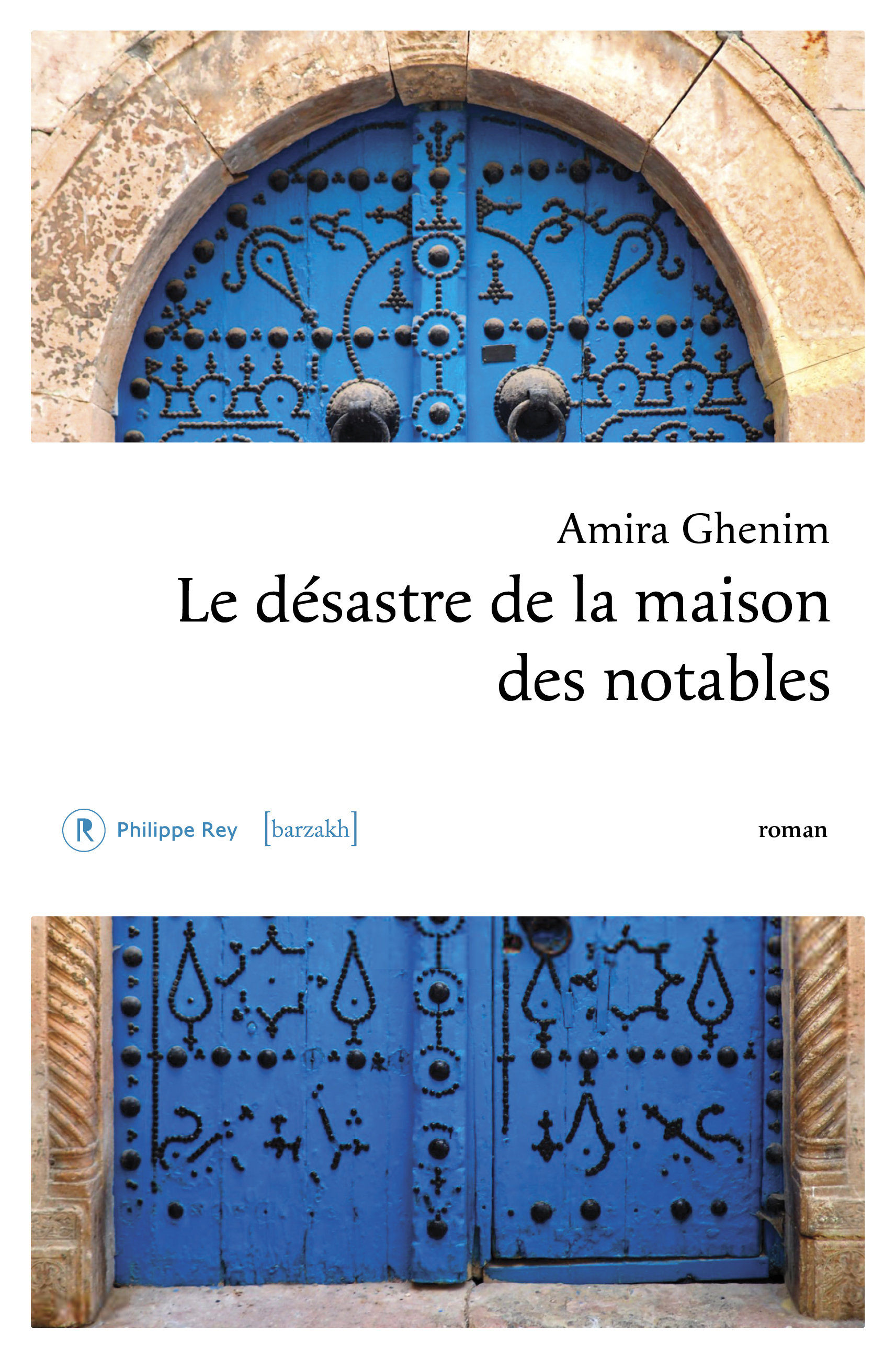
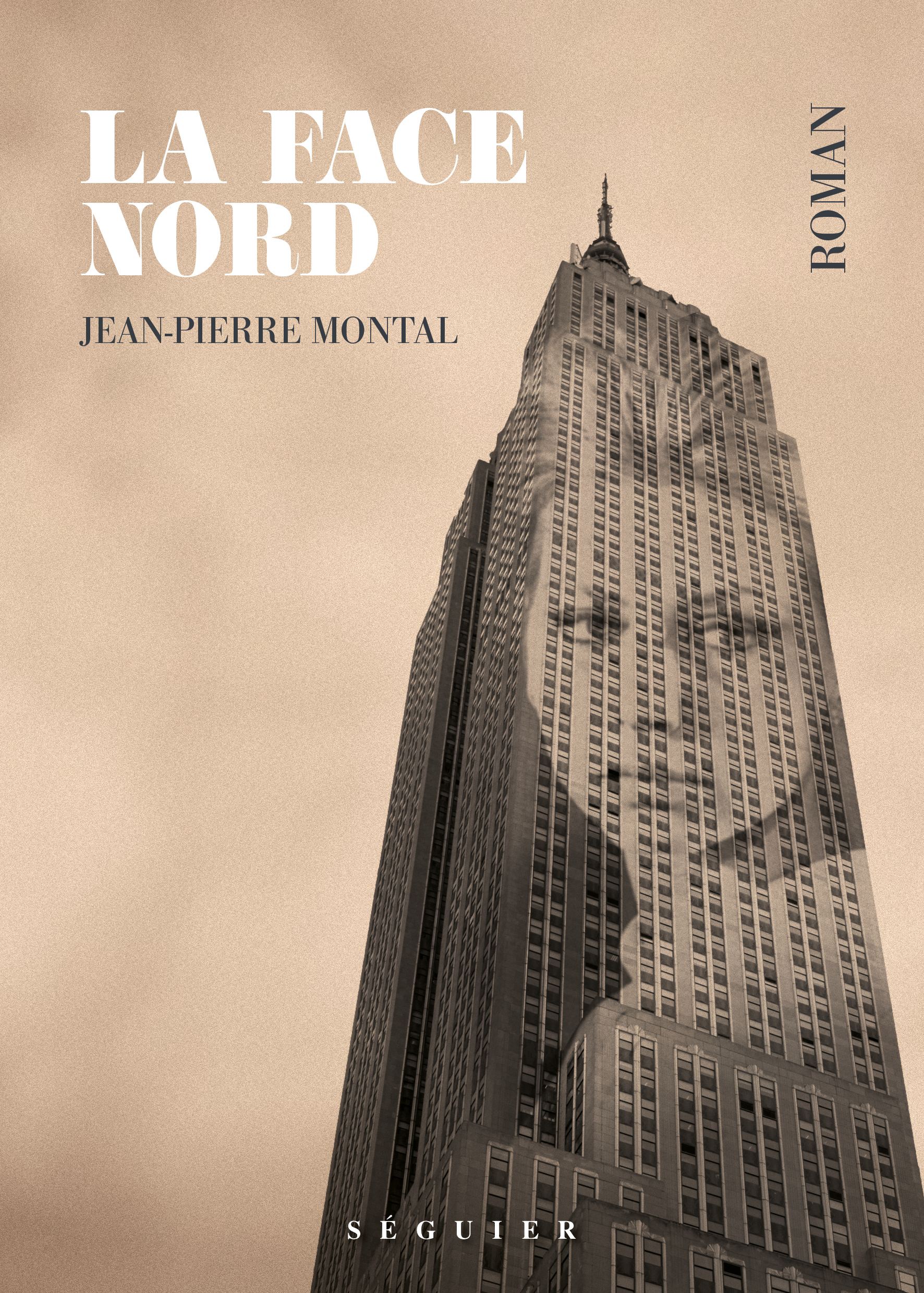



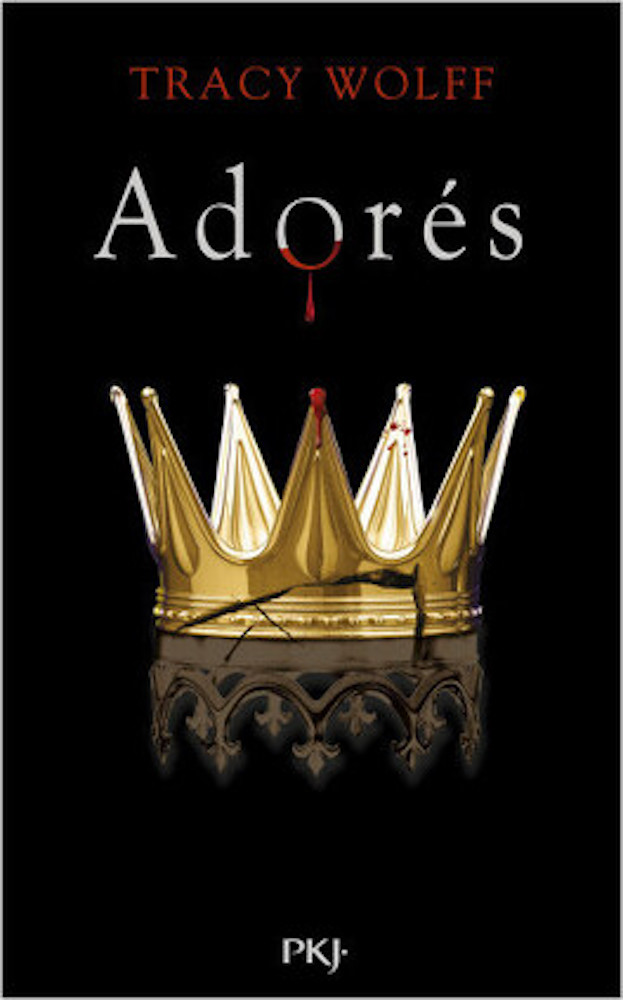
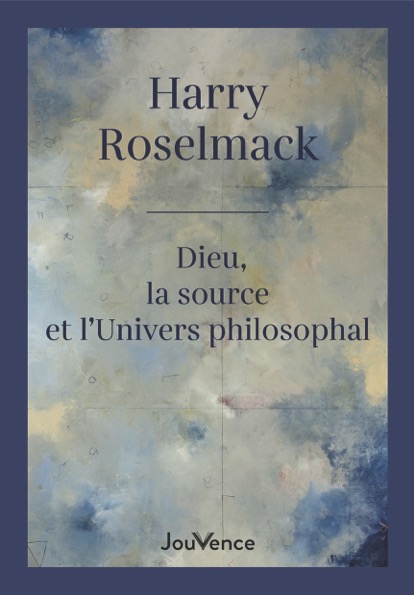
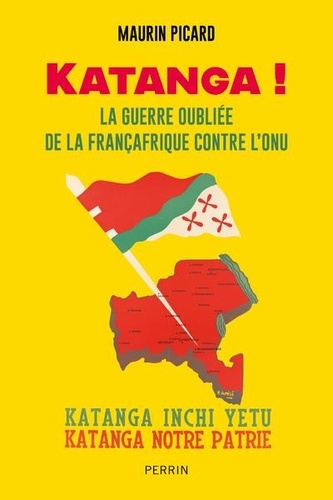

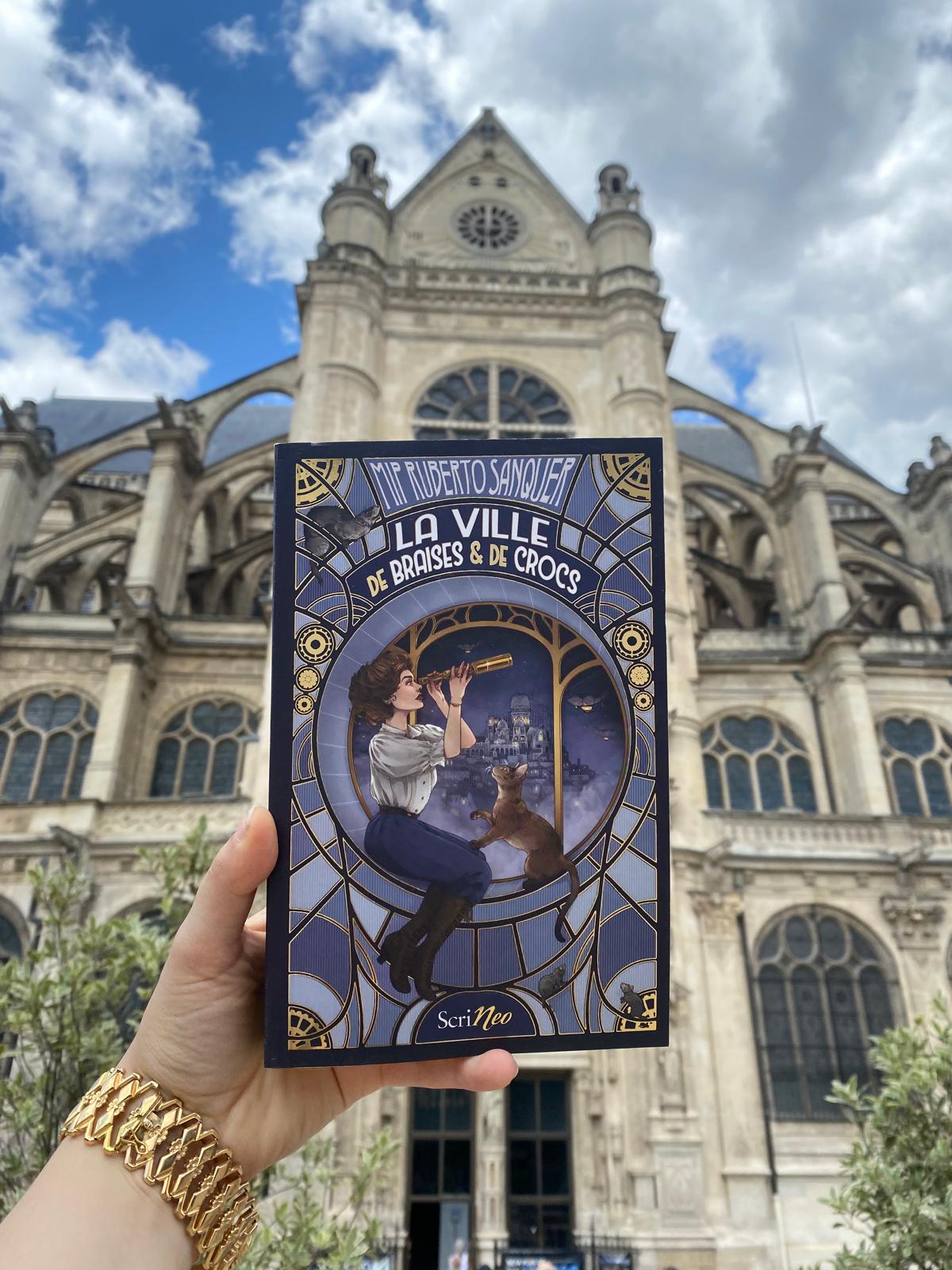



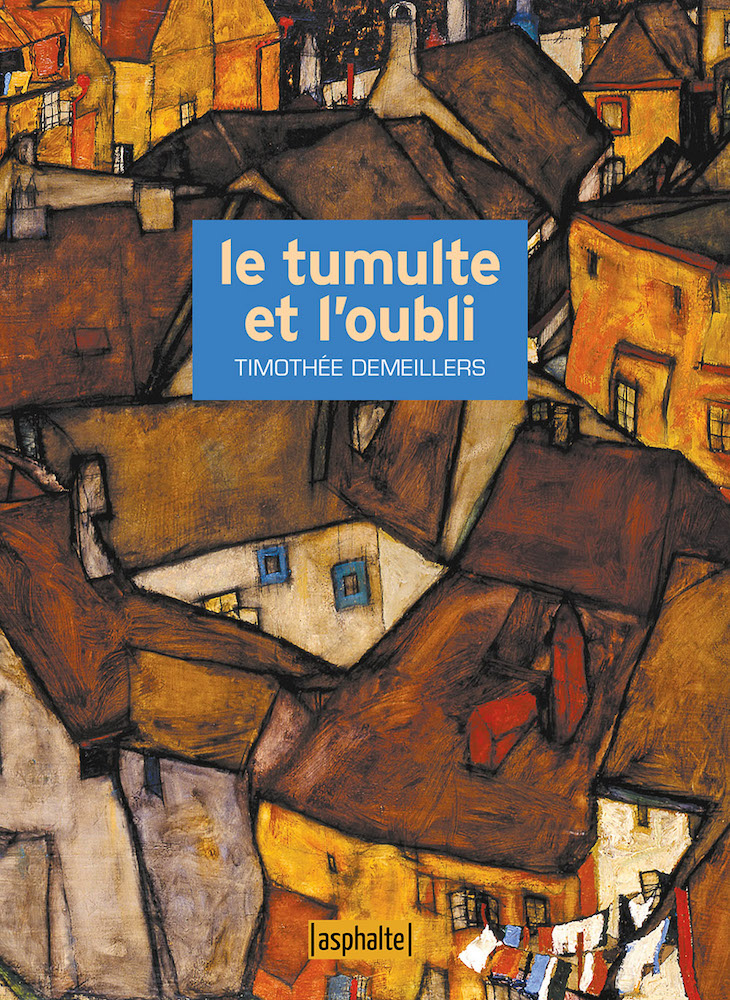


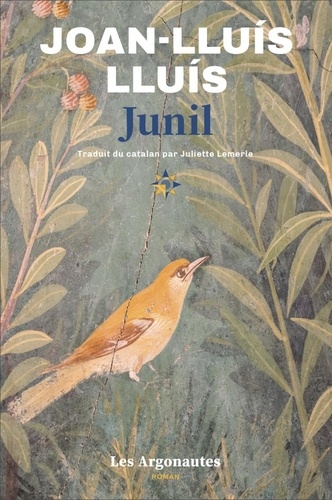


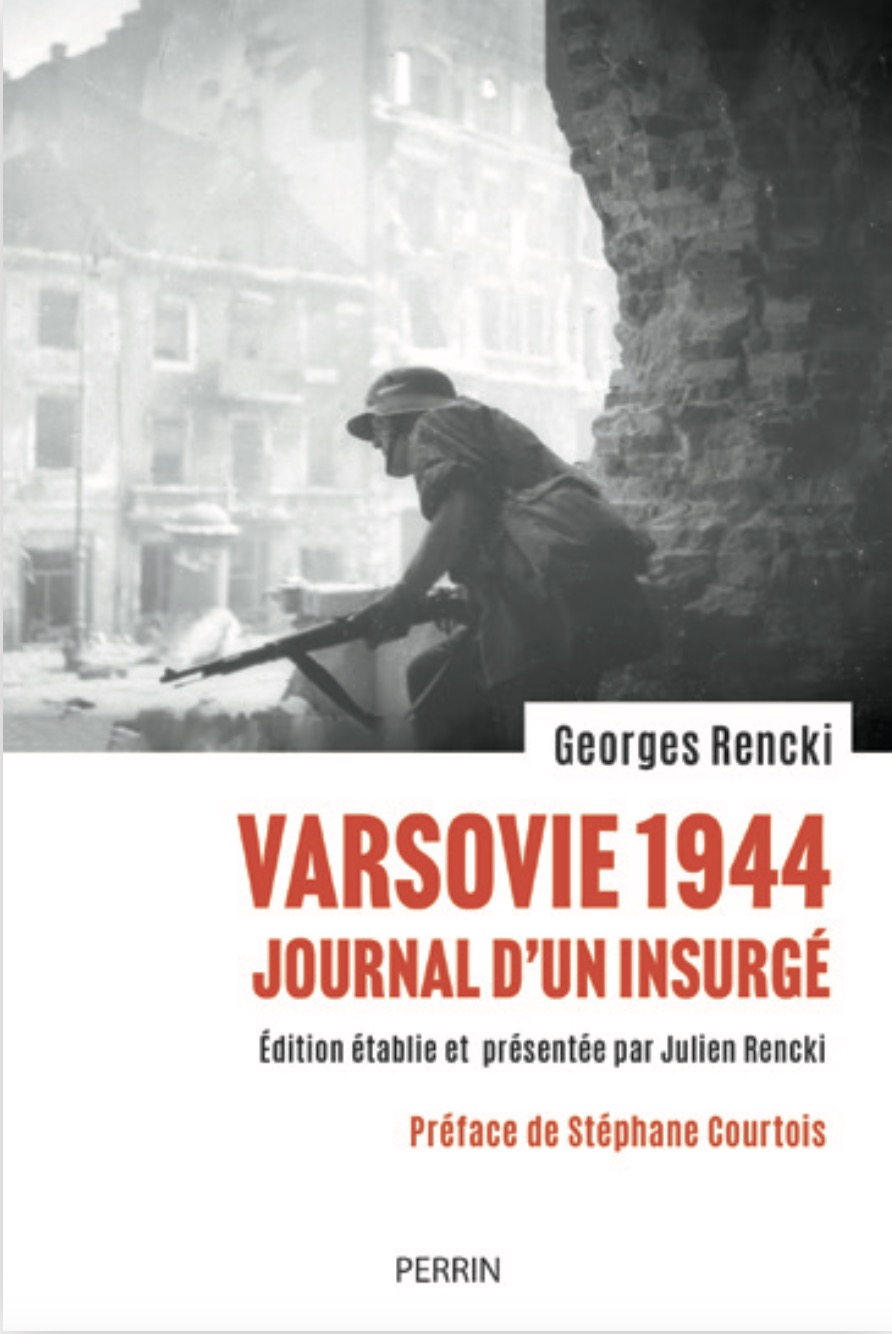
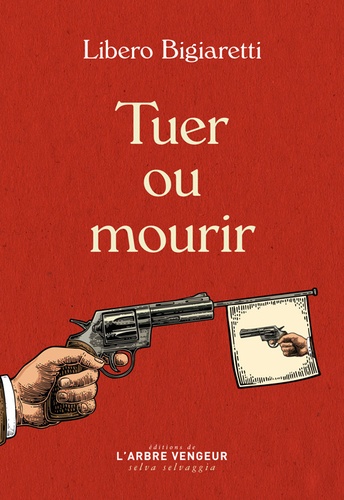




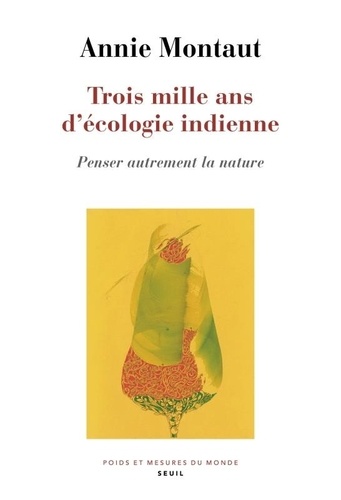
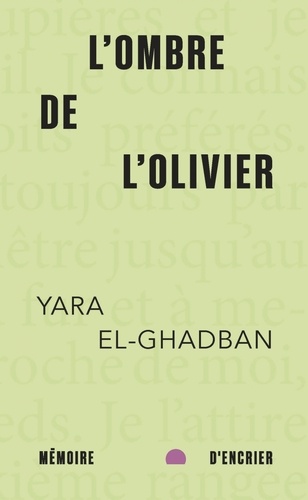
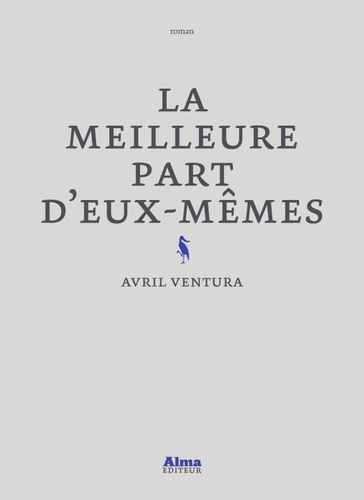

Commenter cet article