Clément Bénech, ou la photographie chez les iconoclastes
ESSAI - Aux iconoclastes donneurs de leçons qui sont à l’esthétique du roman ce que les Pharisiens sont à l’éthique aristotélicienne : une police triste, méchante, désincarnée et, d’une certaine façon, dangereuse, Clément Bénech, qui publie aux éditions Plein Jour Une essentielle fragilité, répond : « D’une part, je vous emmerde. D’autre part, laissez-moi vous expliquer… »
Le 01/02/2019 à 08:27 par Auteur invité
Publié le :
01/02/2019 à 08:27

La voix de Clément Bénech dans le ciel de la littérature contemporaine est un objet volant de mieux en mieux identifié mais qui n’en est pas moins incomparable. C’est une voix lente et amusée. Tranchante. Tranchée. Imaginez la lame d’un couteau papillon dans la main d’un aristocrate, à l’heure du thé. Il y a en lui une insouciance réactionnaire et comme un tremblement métaphysique déguisé en naïveté. On l’imagine dans une bibliothèque, sous des ruines interstellaires, autant qu’à la terrasse d’un Starbucks, avec cette énergie enthousiaste et insolente qui était celle de Radiguet pendant la Grande Guerre. Une sensibilité généreuse.
Et cette culture qui le caractérise, organique, intemporelle, choisie, accessible. Comme dit le proverbe « la culture c’est comme la confiture » : quand on a trop, on en donne. Bénech nous invite à un grand goûter dans l’herbe, en compagnie d’André Breton, Julien Gracq, Régis Debray et pourquoi pas Shaquille O'Neal. Il y a chez lui une empreinte, une langue, un décalage qui ne sont qu’à lui. Le ton est primesautier mais la tessiture profonde. On est dans l’époque, et un peu à côté. On le connaît pour ses romans chez Flammarion, mais voilà son premier essai : Une essentielle fragilité, aux éditions Plein Jour. Sous-titre : Le roman à l’ère de l’image.
Dès les premières pages, il s’évertue à démontrer que la littérature n’est pas un jeu, et qu’il n’y a pas, donc, de règles prédéfinies. La littérature n’est pas une morale. On ne peut pas « tricher ». Mettre des images dans un roman, ce n’est pas « tricher », parce que « la triche », en littérature, n’existe pas.
Le conatus catégorique
Bénech croit aux catégories en matière d’art, dont la vocation n’est pas d’imperméabiliser les pratiques mais de savoir ce qu’on peut demander à chacune d’entre elles. Le roman et la photographie sont tous les deux « un mode de connaître, un mode de transmission du réel » (p. 120). Aussi ne s’agit-il pas de mélanger l’art du roman et celui de la photographie en un même tout indifférencié, mais de les faire dialoguer par une pratique « bicamérale », c’est-à-dire une pratique qui aura eu lieu à la fois, et tout autant, dans la chambre lumineuse du romancier et dans celle, noire, du photographe.
Bénech ne veut pas que le romancier devienne photographe ou le photographe romancier, mais qu’on puisse être l’un et l’autre. Autrement dit, il ne souhaite pas « mélanger les genres ». Au contraire, il préconise de délimiter clairement les frontières fragiles et nécessaires de chaque catégorie, de sorte qu’elles puissent persévérer dans leurs singularités. C’est en territorialisant la photographie et le roman que nous serons en mesure de les faire co-exister, et, encore mieux, co-insister, pour sauver (ou « re-présenter » c’est la même chose) l’essentiel.
Voici un paragraphe qui résume magnifiquement cette idée (p. 109) :
Or quand c’est un carré de réel, le diamant d’une sensation ou une expérience unique qui appellent à être sauvés, le canot de sauvetage le plus adapté peut être le mot ou l’image, selon son degré de précision (c’est-à-dire, en l’occurrence, d’abondance). C’est comme si, pour transférer un liquide — une substance — d’un récipient à un autre, le langage tenait tantôt de la louche, tantôt de l’écumoire.
Qu’est-ce que l’image apporte au roman ?
La littérature, nous dit Bénech, c’est l’art du temps. Le roman permet de dire ce qu’on ne peut pas montrer, et en particulier ce que Debray nomme « l’interdit », « la possibilité », « le programme », « le projet ». Autant de choses qui échappent aux photographes. « Il y a toujours quelque chose d’absent qui nous tourmente » disait Camille Claudel. C’est précisément ce « quelque chose » que les romans et les poèmes s’attellent à faire sentir et ressentir, et, cela, en parlant. Le roman retient, suggère, dévoile, étend, insère, ouvre le temps… en parlant.
L’image, c’est l’art de l’espace. Elle montre, rend, donne l’espace. Elle sait voiler, extraire, délimiter… en se taisant. Elle sait surtout se taire, quand le roman ne fait que parler. C’est pourquoi elle peut être pour le roman non pas un recours ou un secours, mais la possibilité d’une halte et éventuellement d’une expérience, comme lorsque Ulysse trouve sur le chemin d’Ithaque un lieu inconnu et propose à ses compagnons d’y accoster pour s’y reposer et l’explorer.
En partant d’une interview de W. G. Sebald, seul écrivain à avoir systématisé l’insertion de photographies dans ses romans, Clément Bénech explique en effet que la photo dans le roman, en plus d’avoir une fonction testimoniale — i.e. prouver grâce à une photo que tel ou tel élément décrit avec des mots existe bien dans la réalité (fonction que je crois pour ma part tout à fait inutile, même si Bénech la défend) — en plus de cette fonction, la photo dans le roman peut avoir une fonction retardatrice en opérant au sein du roman une pause, ou une fonction expérimentale, en faisant vibrer le texte : sortie de la chambre noire, elle devient chambre-écho.
Les romanciers iconoclastes ont oublié le lecteur, à qui Bénech donne le nom de « Perceptor ». Le lecteur humain, à l’inverse du lecteur idéal, n’est peut-être pas après tout contre une petite pause ou une expérience inattendue. Le romancier iconoclaste, finalement, est à lui-même sa propre icône, son propre sujet d’adoration, s’il croit que son seul art a suffi, suffit, suffira. Cela ne signifie pas que tous les romanciers devraient insérer des photos dans leurs romans, mais que tous ceux qui diront « c’est interdit » sont des moralisateurs qui feraient mieux de cultiver les haricots de leurs jardins en laissant Bénech planter dans le sien si ça lui chante des graines de baobab histoire de voir si ça peut « prendre » et « pousser ». Hein, on sait jamais…
Le style Bénech
Clément Bénech est drôle. Ceux qui le connaissent le savent, et ne seront pas étonnés de rencontrer dans cet essai un chercheur d’or qui fait de la musculation, un électrosensible à Fesseheim et une soutenue légèreté mise au service de cette fragilité essentielle à laquelle, nous dit-il, tient la véritable littérature. Pour signifier que le romancier peut déléguer à la photographie ce qu’il est incapable de faire lui-même, Bénech répond finalement aux iconoclastes que « refuser qu’un art emploie un outil dans lequel il n’excelle pas serait comme interdire à Superman de marcher sous prétexte qu’il sait voler » (p. 121)
En plus d’être drôle, l’auteur d’Une essentielle fragilité sait trouver des aphorismes et des métaphores qui relèvent son essai, comme on dit du piment qu’il « relève » un plat. Ce sont ces métaphores, ces aphorismes, ces anecdotes, ces traits d’esprit qui différencient l’essai en question des pantalonnades universitaires, auxquelles la pensée de Bénech est ce qu’un cheval est à un tricycle : « Avancer c’est bien, mais l’allure, hein, le style ! »
Les absents
En refermant le livre, j’éprouvais deux manques, l’un qui était le bienvenu, et l’autre peut-être plus regrettable. Le manque bienvenu, c’est le lecteur. Bénech ne cite pas d’étude de réception. Même s’il nous dit qu’il ne s’adresse pas au lecteur idéal mais au lecteur tel qu’il est, « Perceptor » reste imaginé, rêvé, supputé. En fait, c’est Clément Bénech, Perceptor. Pour savoir vraiment ce que reçoit et comprend « le lecteur » quand il trouve une image dans un roman, il faudrait enquêter auprès d’un échantillon représentatif, organiser des « focus groups », utiliser des technologies de « eye-tracking », etc., mais à quoi bon ? La naissance de l’auteur doit se payer l’anéantissement du lecteur, c’est à ce prix je crois qu’on peut écrire un roman et y insérer, ou non, des photographies : en oubliant que quelqu’un lira, regardera, commentera. Pardon, mais on s’en fout. Cela ne plaira peut-être à personne, et alors ? L’art n’est pas une démocratie, ou bien Marc Levy est un génie. En littérature, le lectorat choisit toujours Barabbas.
Le deuxième manque, plus regrettable à mon avis, c’est la religion. Bénech l’évoque rapidement mais on aurait bien aimé avoir quelques-uns de ses traits d’esprit à propos de telle religion qui considère que le texte est saint tout en interdisant la représentation par l’image, ou à propos de cette autre religion dont le messie n’écrit jamais rien mais trace des signes sur le sol au moment où on lui demande s’il faut lapider ou non la femme adultère. Il y aurait peut-être eu des pistes intéressantes à explorer, car si la littérature n’est pas un jeu, si elle n’est pas un « divertissement » au sens pascalien, c’est, il me semble, parce qu’elle sait poser la question de Dieu mieux encore que la musique, la peinture, la danse, la sculpture, le cinéma et… la photographie. Son conatus tient à l’Homme mais de Dieu.
Finalement…
Il faut lire Clément Bénech, ses romans, son essai. Il faut le suivre dans ses lectures, sur Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, dans ses élucubrations humoristiques, poétiques et philosophiques, et questionner avec lui l’art du roman, qui n’aura rien à craindre de l’image tant qu’on n’interdira pas formellement les images d’y pénétrer. Ce qu’il faut craindre, en matière d’art, c’est la morale. Le vrai ennemi de l’esthétique, c’est l’éthique. C’est le principal message de cet essai.
Clément Bénech - Une essentielle fragilité : le roman à l'ère de l'image – Plein Jour - 9782370670427 – 13 €
[NDLR : Guillaume Sire a publié plusieurs romans à la Table Ronde, chez Plon et dernièrement aux éditions de l'Observatoire le très remarqué Réelle, dont nous vous parlions ici.]
Dossier Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée
Une essentielle fragilité. Le roman à l'ère de l'image
Paru le 18/01/2019
174 pages
Plein Jour
13,00 €




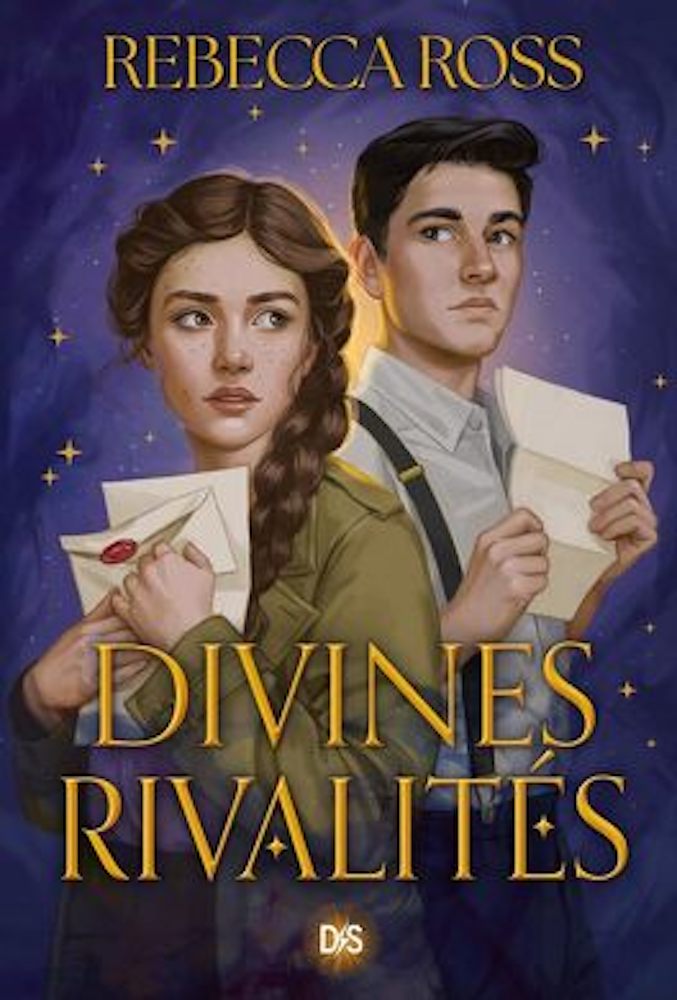
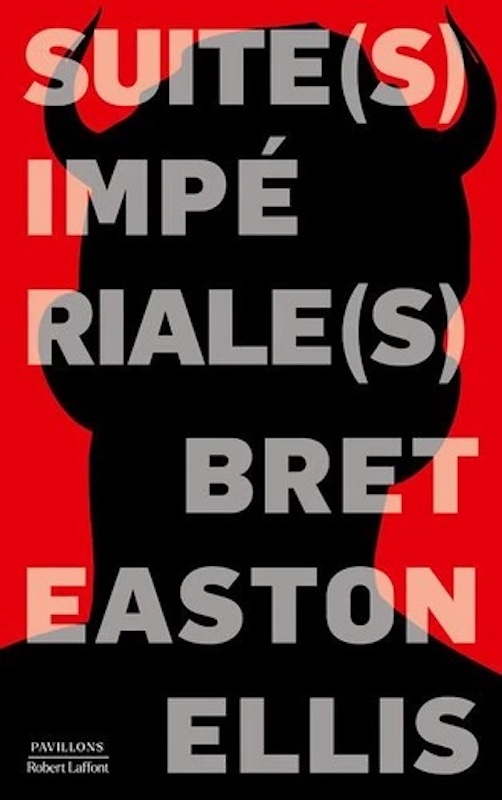

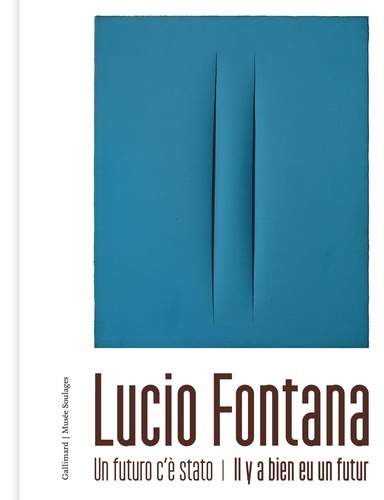

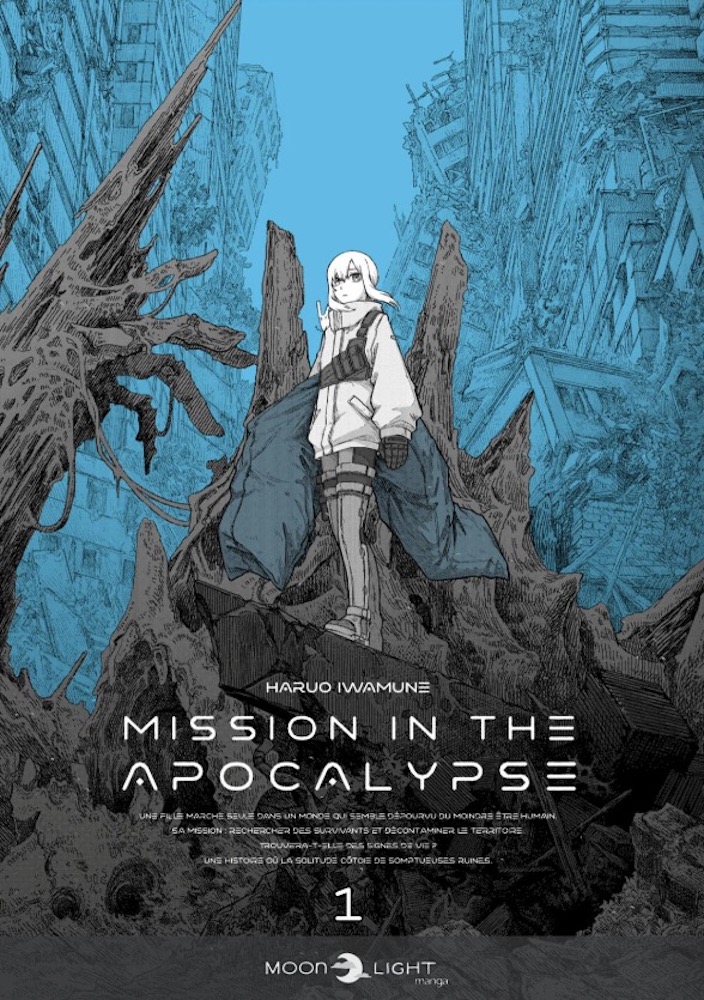
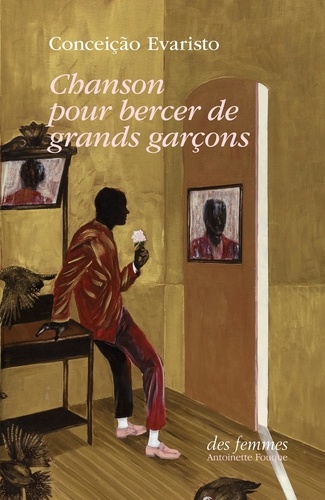
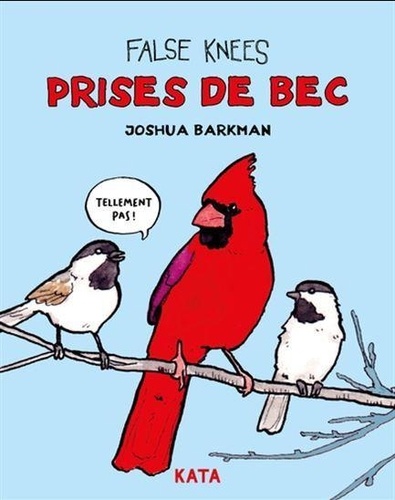
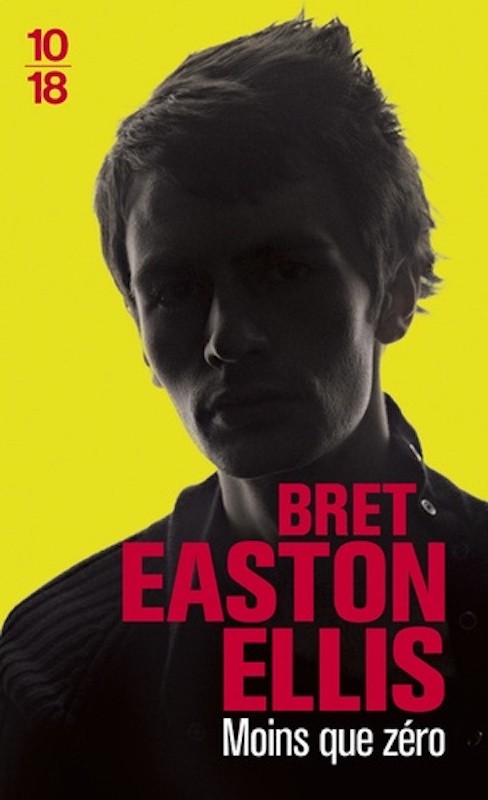

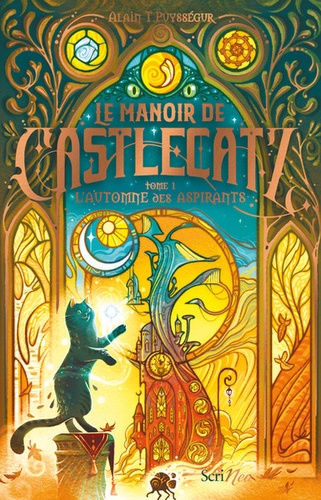

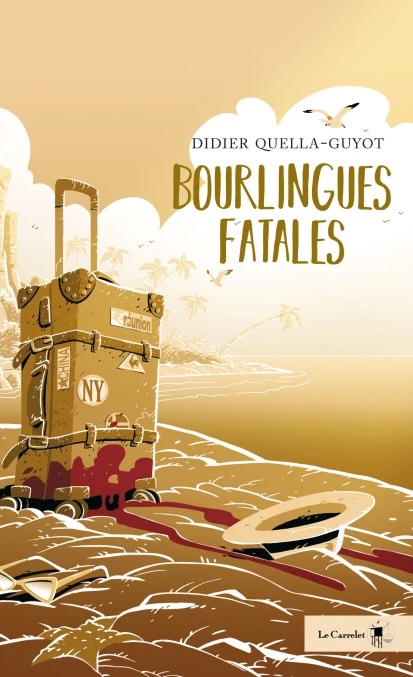

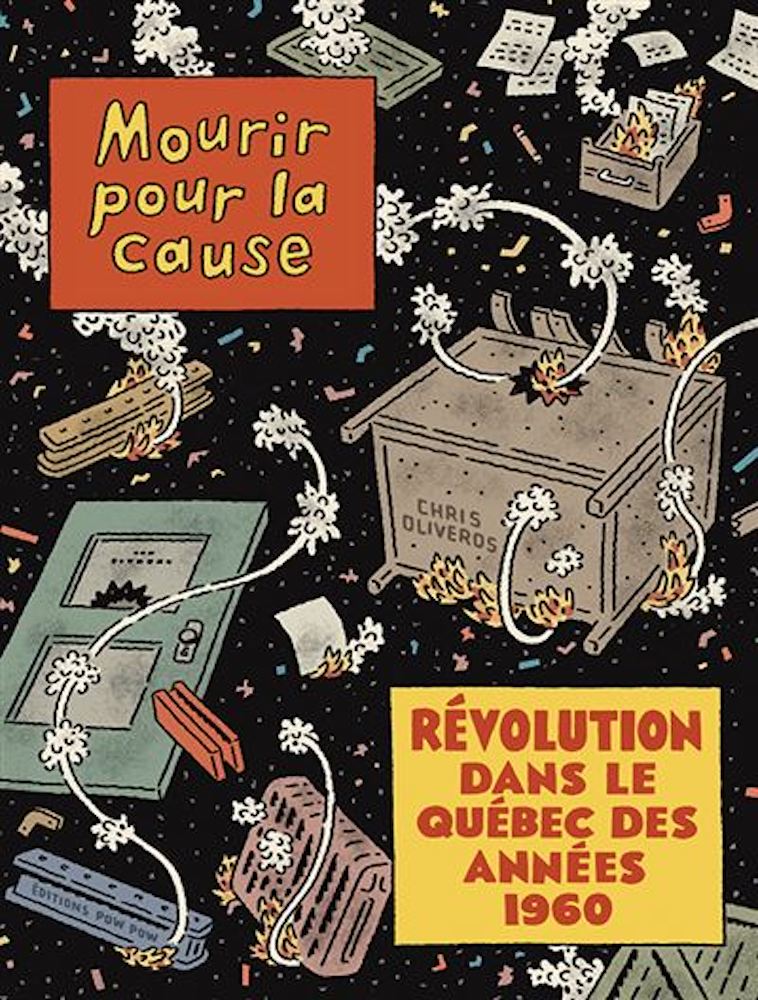
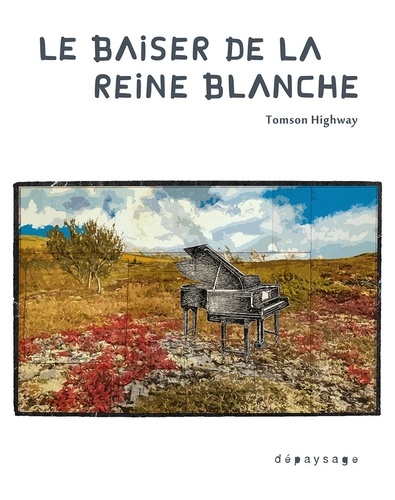
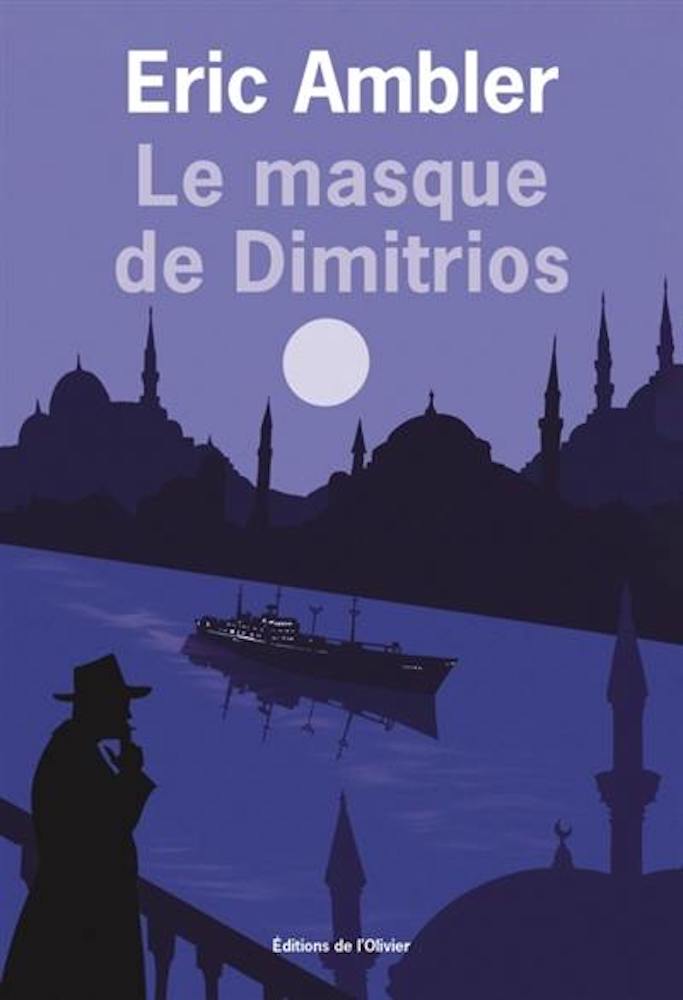
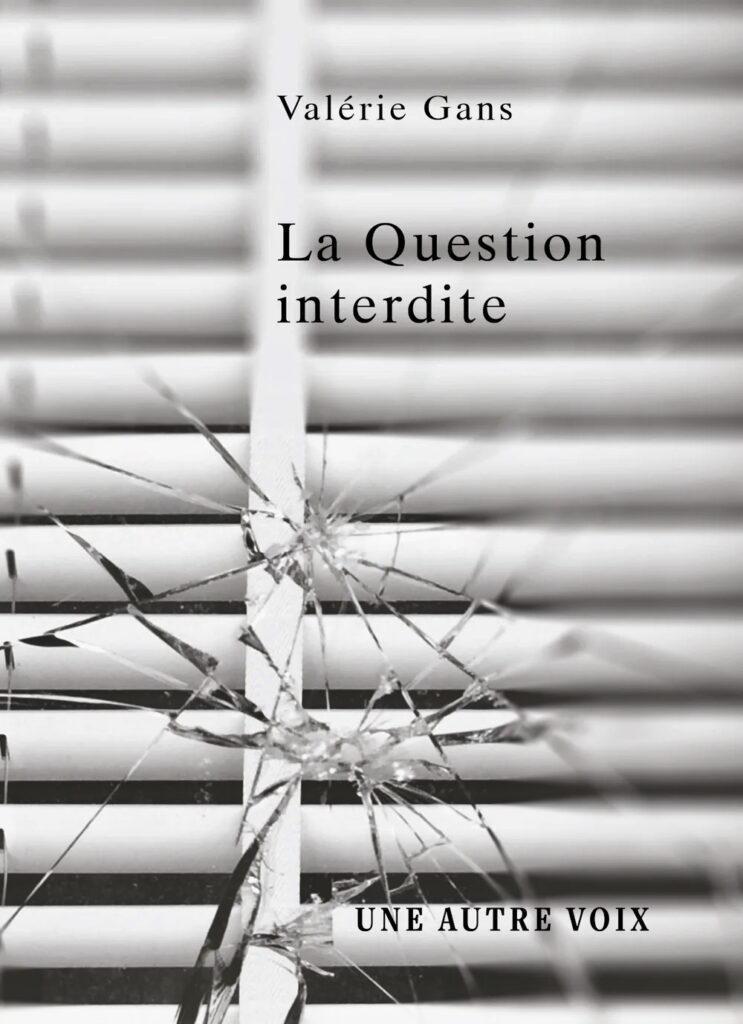
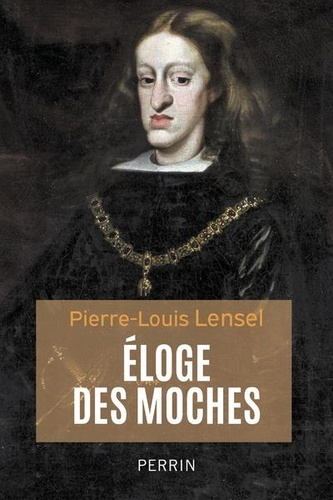
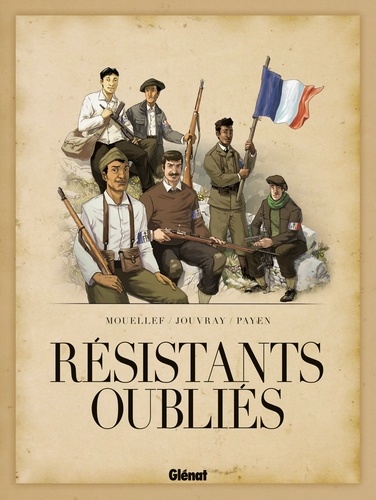

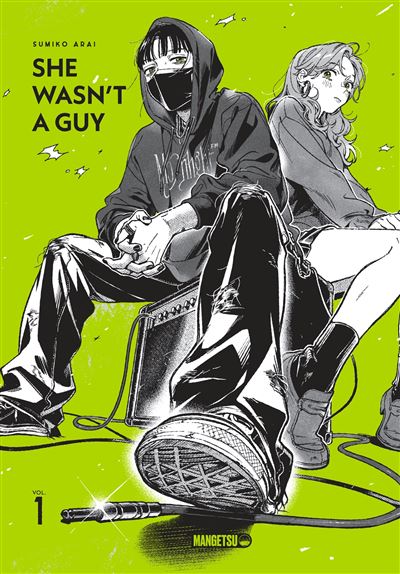
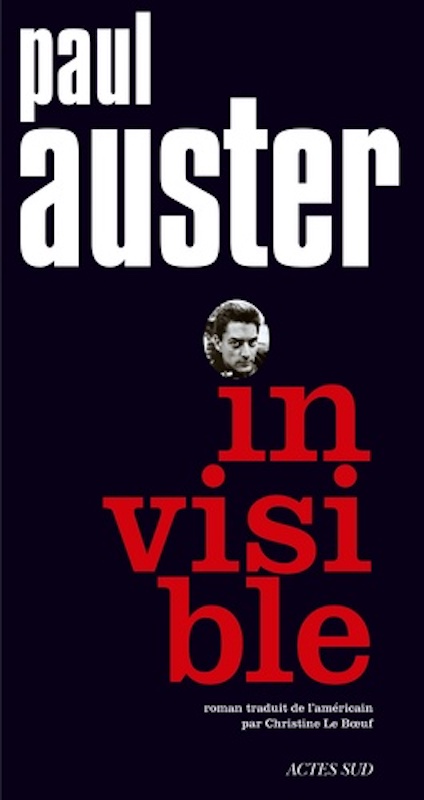
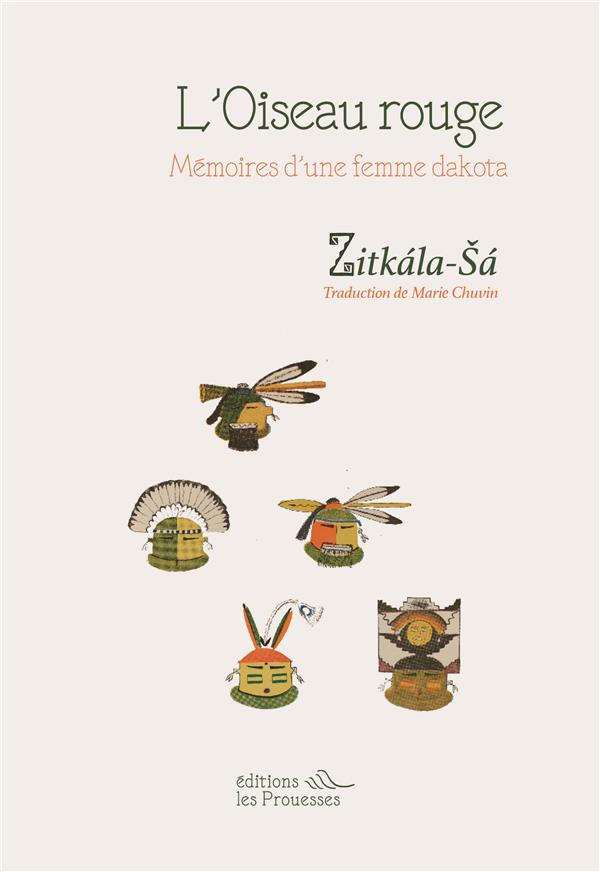


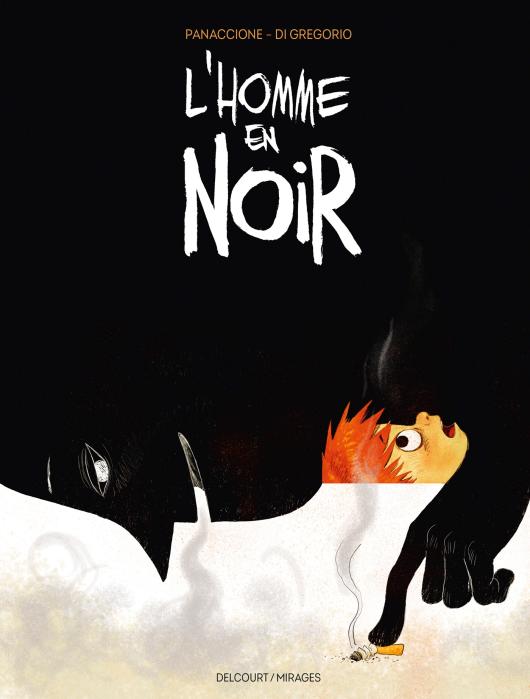



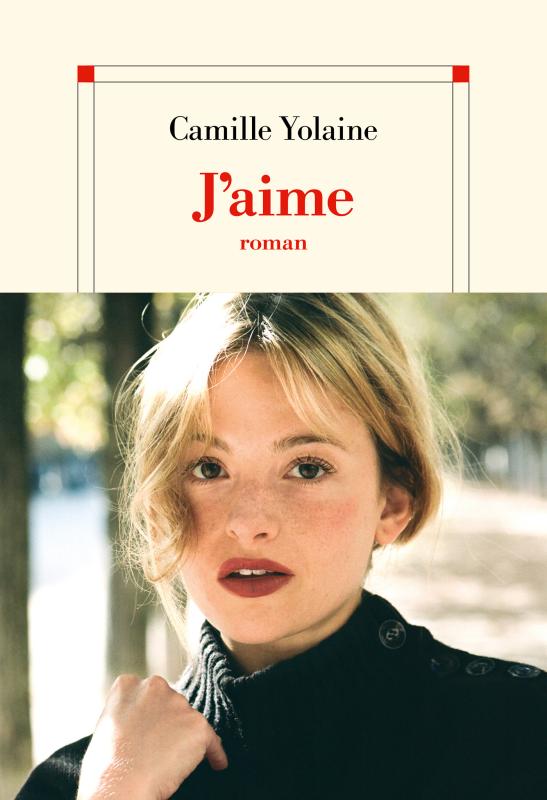
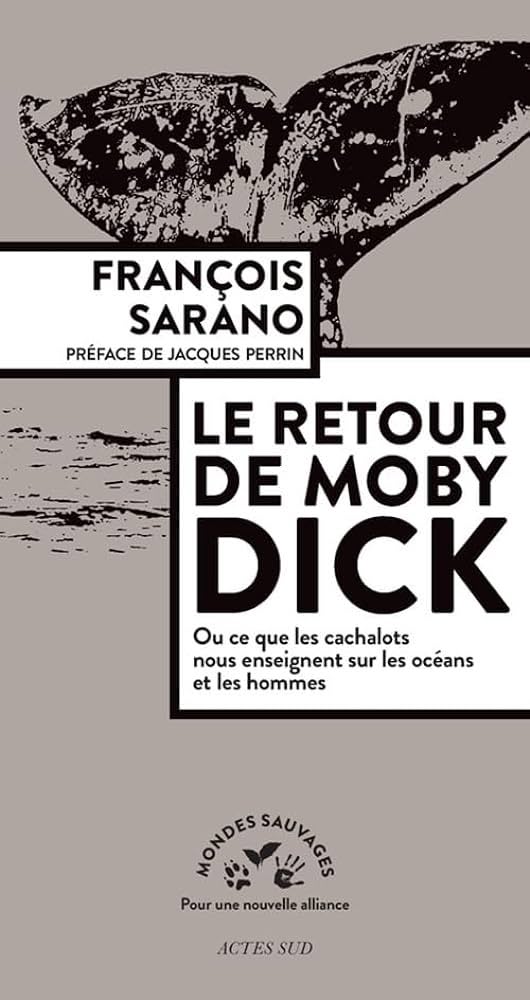




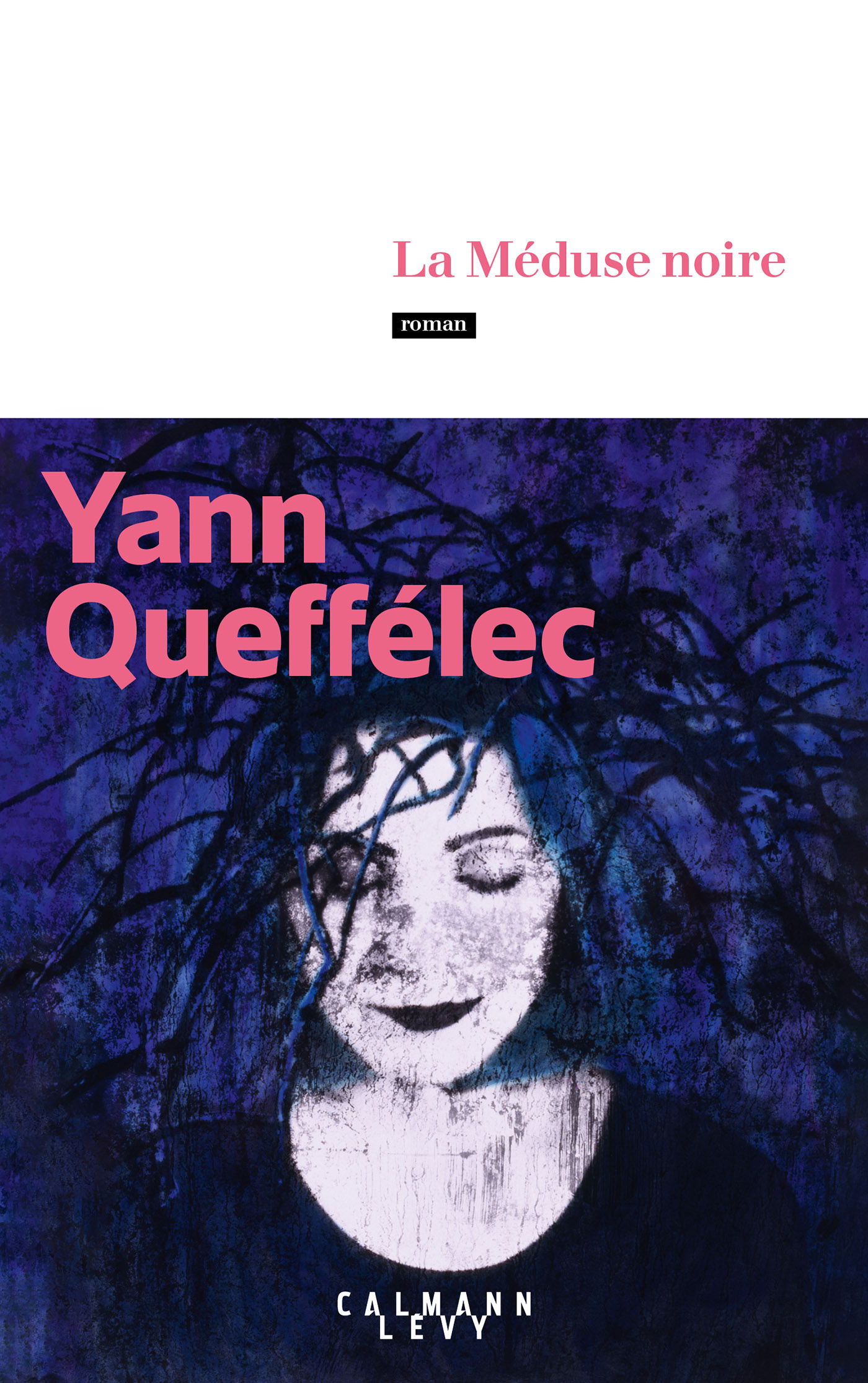




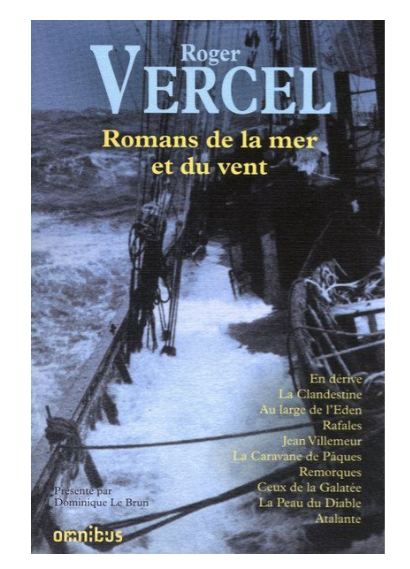

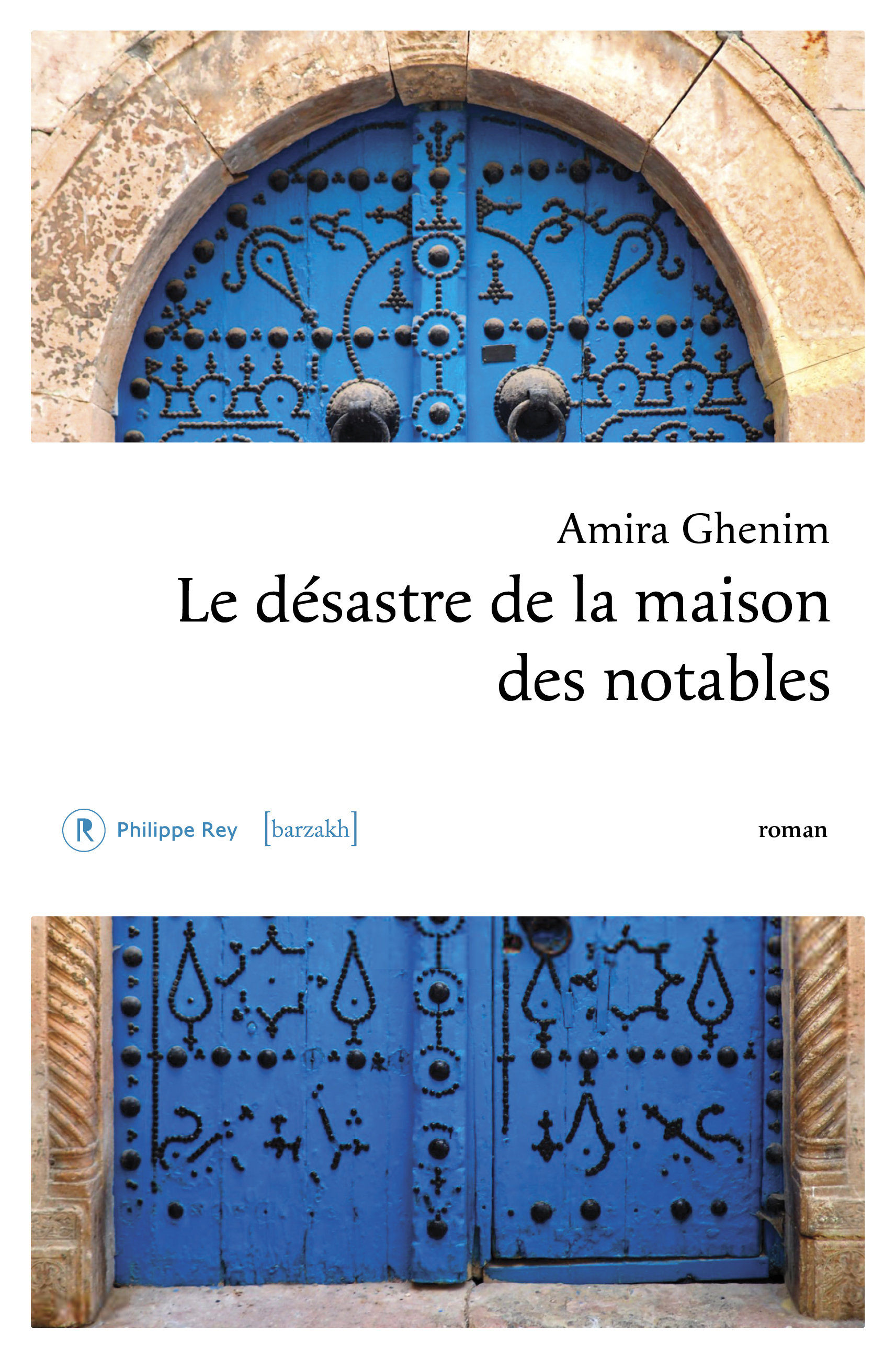
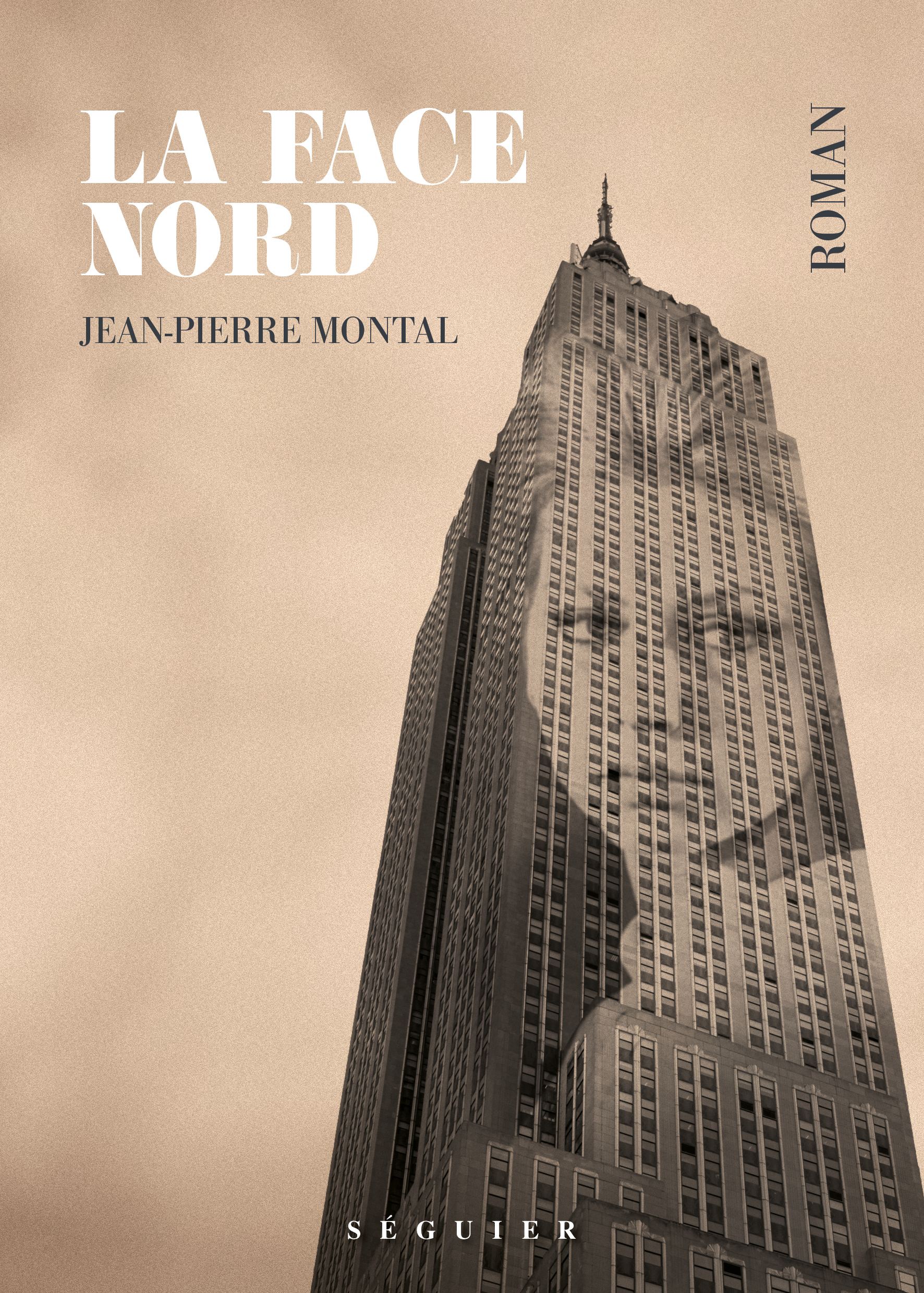



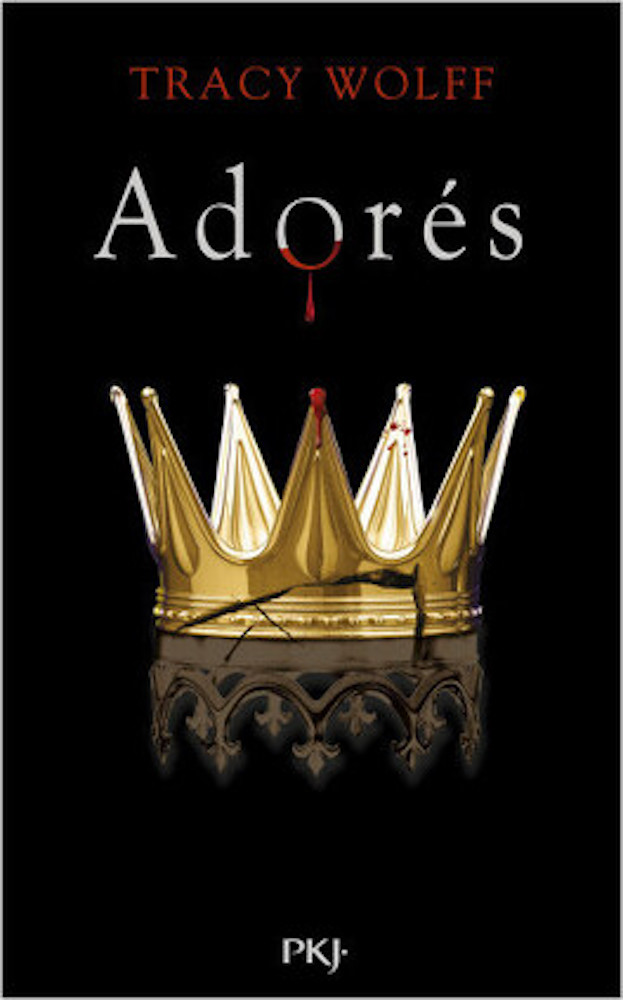
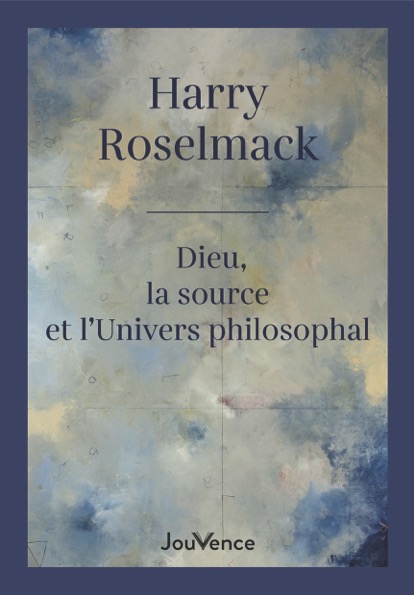
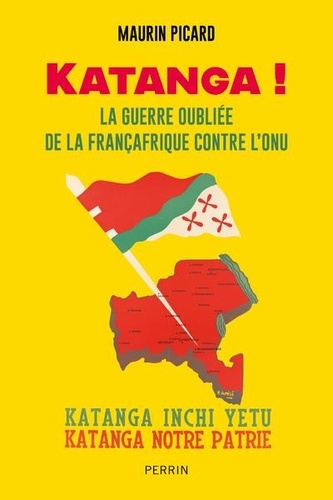

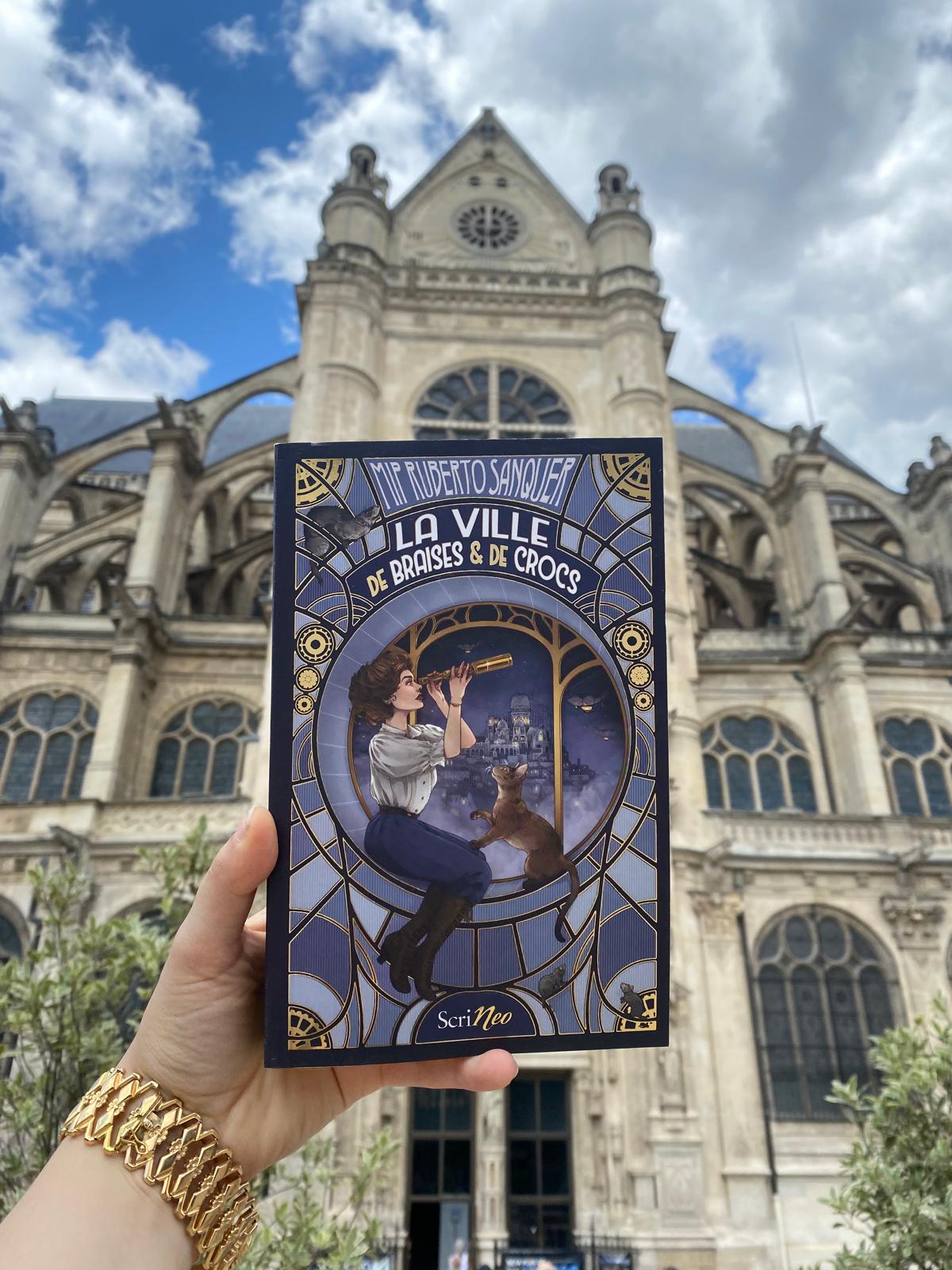



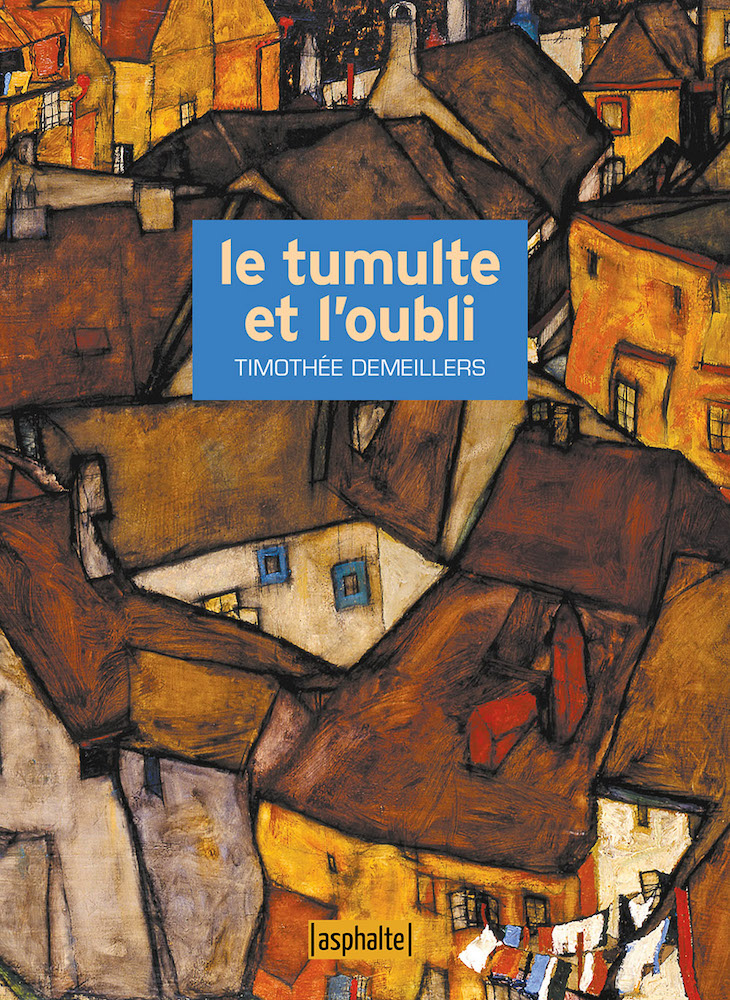


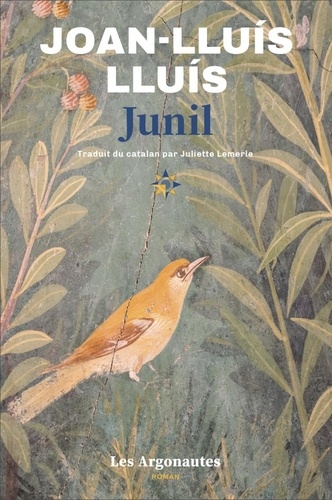


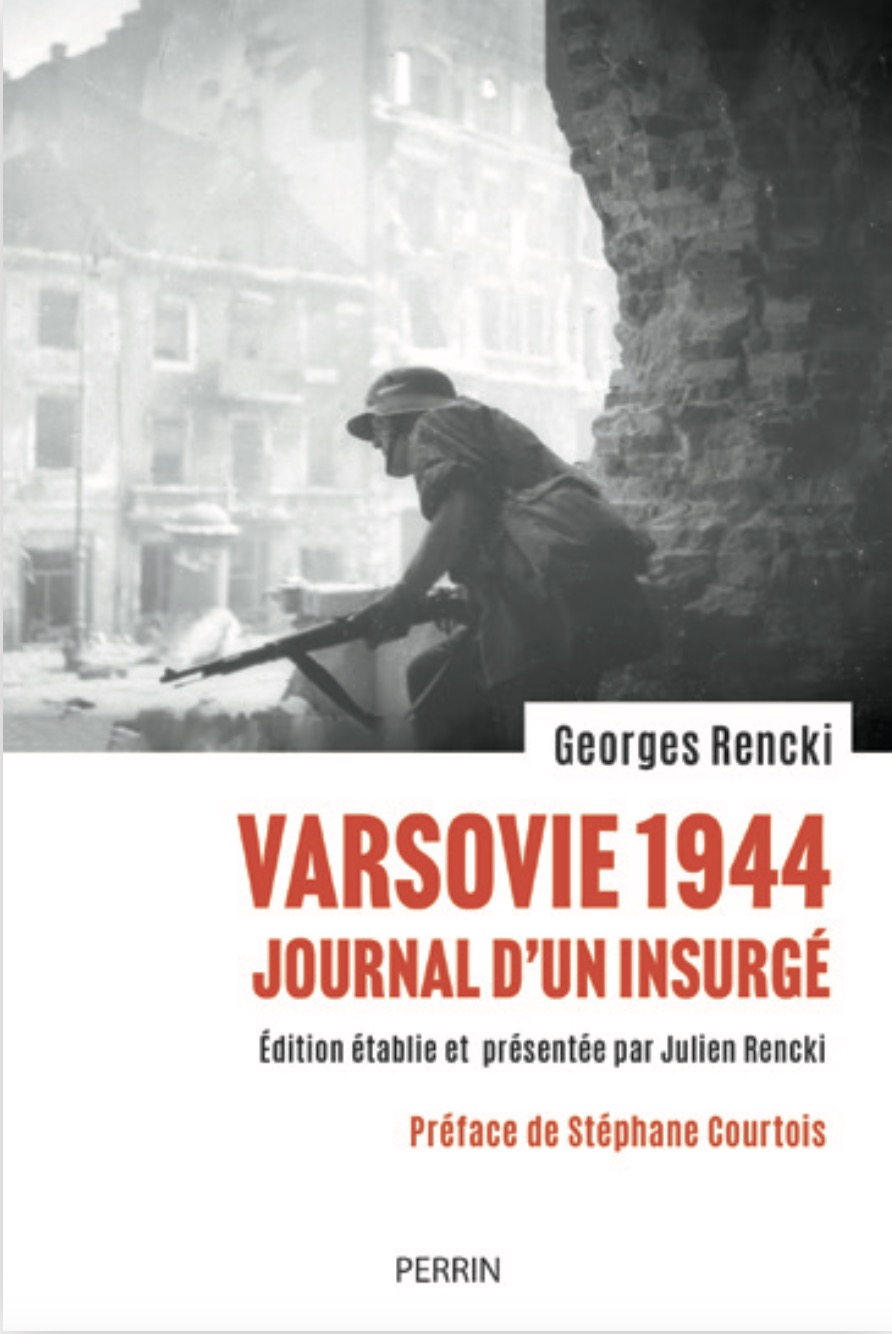
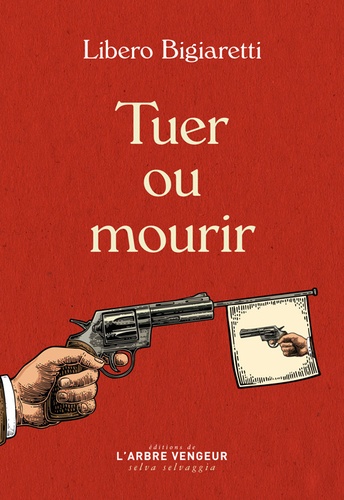




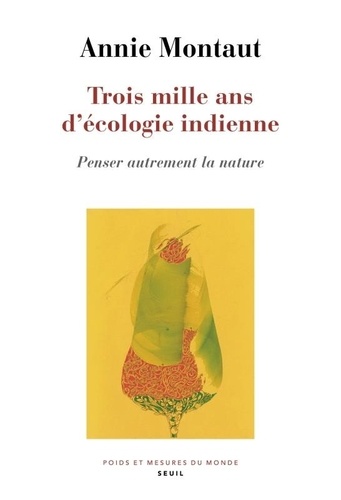
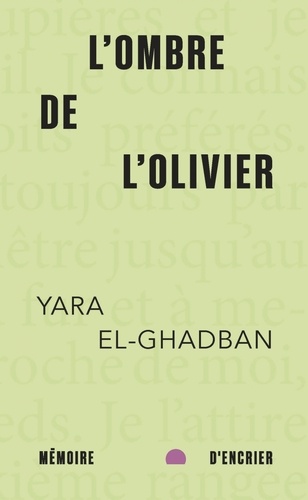
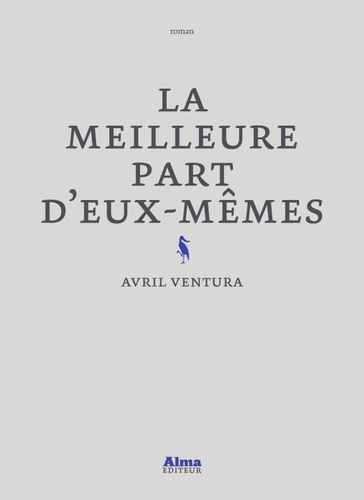

Commenter cet article