100 tableaux pour découvrir Auguste Renoir
À l’occasion de l’exposition « Renoir, père et fils » qui se tiendra au Musée d’Orsay du 06 novembre au 27 janvier 2019, les éditions du Chêne publient Les 100 tableaux qui racontent Renoir par Pascal Bonafoux, critique et historien de l’art, commissaire d’exposition et professeur des universités émérite d’histoire de l’art.

Si 100 tableaux peuvent raconter Renoir, il ne faut, en revanche, pas essayer d’analyser les tableaux de l’artiste. De l’aveu même de ce dernier, « si on pouvait expliquer un tableau ce ne serait pas de l’art. »
Renoir, figure majeure de l’impressionnisme, certes. Mais l’a-t-il seulement souhaité ? On lui a reproché d’être entré dans cette case, puis on lui a reproché d’en sortir. Est-il trop difficile d’admettre que Renoir voulait juste être libre ? « […] ne vous figurez pas que je vais vendre mon indépendance à qui que ce soit, c’est la seule chose à laquelle je tiens : le droit de faire des sottises. » Et quelles belles sottises !
Pierre-Auguste Renoir naît à Limoges le 25 février 1841. Il a déjà un frère et une sœur. En 44, toute la petite famille prend la direction de Paris où, si l’on manque de tout, personne ne manque de rien.
À 13 ans, le petit Auguste a déjà un pinceau en main, il peint sur des porcelaines. À 18 ans, il est peintre chez un fabricant de stores, c’est également à cet âge qu’il commence à peindre des cafés parisiens, une vingtaine au total.
De petits boulots en rencontres amicales fortuites, hébergé à droite et à gauche, tissant des amitiés avec Monet et bien d’autres, Renoir vivote. L’argent fait défaut, mais pas la fougue et, tant qu’il y a de quoi peindre, il y a de l’espoir.
En 1870, Renoir expose deux de ses toiles au Salon de peinture et de sculpture, plus communément appelé « Le Salon », il s’agit de Baigneuse au griffon et de Femme d’Alger. Deux toiles où le goût du peintre pour Courbet et Delacroix se fait sentir, « en 1870, il chante encore les chansons d’autres peintres… » Il faut dire que Renoir voue un réel intérêt aux peintures de Delacroix. Déjà dans les années 1860 ça lui a coûté sa place dans l’atelier d’Émile Signol à l’École des beaux-arts. Signol, « Grand Prix de Rome en 1830, membre de l’Institut depuis 1860, élu alors au premier fauteuil de la section peintre de l’Académie des beaux-arts », se veut l’héritier de David, autant vous dire que Delacroix n’est pas réellement en odeur de sainteté, malheureusement (?) pour Renoir.

Bal du moulin de la galette
Enfin tout le monde n’a pas une dent contre Delacroix et au milieu – au mieux des critiques négatives, au pire de l’indifférence – une voix déjà, celle du critique Henry Houssaye, suggère de retenir le nom de M. Renoir.
La première Exposition impressionniste se tient en 1974, Renoir y expose La Parisienne, la critique « officielle » le dézingue, lui et les impressionnistes en général. Soit.
Comme il faut bien se nourrir, Renoir propose, en 1875, à ses amis, de vendre quelques toiles lors de ventes aux enchères à l’hôtel Drouot. C’est un fiasco, mais ça lui permet tout de même de faire la connaissance d’un certain M. Choquet qui, grâce à un bel héritage, est réputé pour être l’un des grands collectionneurs de tableaux de Paris, du monde selon Renoir. Il apprécie particulièrement les œuvres des impressionnistes. Ça fera toujours un peu d’argent de gagné et un réseau (comme on dit maintenant) qui s’étoffe un peu plus.
En 1873, Renoir peut enfin se louer un atelier au 35 rue Saint-Georges. Ce n’est pas le grand luxe certes, mais ça n’empêche pas de repeindre le monde avec les amis. « Comment ne pas considérer l’atelier de la rue Saint-Georges où Renoir a vécu jusqu’en 1882, […], comme l’un des lieux fondateurs de l’impressionnisme ? »
C’est en 1876 qu’il réalise une de ses toiles les plus connues, Bal au moulin de la Galette. Peinture vive et pleine de gaieté, elle est exposée l’année suivante et sans surprise de nouveau dénigrée. Mais, comme pour La Parisienne,certains y voient un vrai talent, et pas n’importe qui. Georges Rivière écrira le 6 avril dans L’Impressionniste, Journal d’Art : « Ce tableau à pour l’avenir une partie très grande que nous tenons à signaler. […] Que ceux qui veulent faire de la peinture historique fassent l’histoire de leur époque, au lieu de secouer la poussière des siècles passés. » Il sera suivi par un certain Émile Zola qui écrira dans Le Sémaphore de Marseille, le 19 avril, que ce tableau est « une grande toile d’une intensité de vie extraordinaire. »
Une rencontre va faire pencher la balance du côté de la reconnaissance, celle de Madame Marguerite Charpentier. Femme instruite, tenant salon tous les vendredis où l’on peut croiser Flaubert, Tourgueniev, Daudet, Barbey d’Aurevilly, Maupassant, Clémenceau, etc. En 1875, Monsieur Charpentier avait déjà acheté trois toiles de Renoir puis commandé un portrait de sa femme, qui avait plu. En 1878, c’est Madame Charpentier elle-même qui commande une toile la représentant avec ses deux filles. Renoir l’exécuta en un mois. « Mme Charpentier ne se contenta pas de tenir son grand portrait en montre chez elle, pour le faire admirer par ceux qui la fréquentaient, elle voulut qu’il fût au Salon officiel […]. Elle se mit en campagne à cet effet » et elle n’est pas de celle à qui on dit « non ».
« Et la critique alors renonce à la vindicte. » Rien de nouveau sous le soleil…

Le déjeuner des canotiers
Ayant fait du portrait sa spécialité, Renoir n’en ignore cependant pas les dangers, « il faut bien admettre que le portrait est un genre singulier. Parce qu’il est celui d’une vanité qui pose devant une ambition. » Quels que soient ses modèles, un Renoir se doit de rester un Renoir, et pourtant ils ont été nombreux ses modèles, outre les anonymes et membres de la famille, il a portraitisé : Monet, Sisley, Cézanne, Wagner, Mallarmé, Rodin et bien d’autres.
À 38 ans, Renoir a des rêves de grandeur. Il a conscience de vieillir et sait qu’il n’aura peut-être plus la force, dans quelques années, de s’attaquer à une grande toile. Alors il se lance, « il faut de temps en temps tenter des choses au-dessus de ses forces ». C’est ainsi que naît Le Déjeuner des canotiers en 1881. Achetée, chèrement, par son ami et marchand d’art, Paul Durand-Ruel, cette toile sera exposée en 1923 à New York, où ce dernier refuse, dans un premier temps, de la vendre. En juin, il finit cependant par la céder au critique d’art américain Duncan Phillips pour 150 000 dollars, « jamais aucune toile de Renoir n’a été vendue un tel prix. Le New York Herald précise même que ce n’est le cas d’aucune autre peinture moderne. »
Si Renoir était mort en 1923, il a néanmoins touché une belle somme d’argent grâce à l’achat de Durand-Ruel en 81, ce qui lui a permis de voyager un peu, l’Algérie, l’Italie. C’est à Rome qu’il « tombe amoureux » de la peinture de Raphaël, peinture quelque peu éloignée, semble-t-il de l’impressionnisme, mais Renoir reste sans voix face à la force qui s’en dégage, au point où l’on craint une « raphaëlite » aigüe tant sa peinture se transforme.
Qu’importe à Renoir ! Où est-il écrit qu’on ne doit pas travailler les lignes, les formes, quand on est censé appartenir au courant « impressionniste » ? Et pourquoi ne pas mélanger les styles, comme dans ce tableau, Les Parapluies, réalisé en deux temps, 1881 puis 1886, où le peintre se moque des conventions, des modes. Toile qui semble être une « métaphore du propos de Renoir qui, dans une même toile, donne à voir deux temps de son style, de ses styles qui sont une même cohérence ».
Renoir n’écoute que lui et grand bien lui en a pris puisqu’en 1892 l’État, sous l’impulsion de Mallarmé, lui commande un tableau pour l’exposer au musée du Luxembourg.

Les baigneuses
Est-ce le fait que cela soit une commande officielle qui donne tant de mal à Renoir ? Il fera cinq ou six versions des Jeunes filles au piano, pour finir par donner celle qui, selon lui, sera la « moins bien des cinq ou six. »
Renoir vieillit, avec l’âge il ne s’inquiète plus de plaire à qui que ce soit, et si son ami Durand-Ruel lui fait parfois le reproche de tomber dans la facilité, notamment avec certaines de ses natures mortes, le facétieux Renoir lui répond : « mais si je ne vendais que des bonnes choses, je mourrais de faim ! »
Le fait est que ça devient de plus en plus douloureux pour lui de peindre. Ses mains sont très abîmées, ses doigts noueux, perclus d’arthrose. Mais il est inconcevable d’arrêter de peindre et mieux vaut ne pas l’embêter sur ce sujet, comme en fera les frais un journaliste qui lui demanda comment il faisait pour continuer à peindre, réponse « avec ma queue ! » Peintre et poète…
Néanmoins, il faut trouver des solutions pour le soulager. On imagine un système de cordes afin qu’il puisse faire monter et descendre, sans trop forcer, ses toiles.
Peindre pour rester en vie, mais nul n’est immortel. Renoir meurt le 3 décembre 1919.Le Salon d’Automne de 1920 expose, entre autres de ses toiles, Les Baigneuses, qui suscitent de nouveau les rires. Auraient-ils ricané s’ils avaient su que Renoir avait jeté ses dernières forces dans cette toile ?
« La douleur passe, Matisse ; mais la beauté demeure. Je suis parfaitement heureux et je ne mourrai pas avant d’avoir achevé mon chef-d’œuvre. » Beau livre remarquable au demeurant, Pascal Bonafoux, par une écriture nette, précise et néanmoins feutrée, nous donne l’impression d’être au musée sans quitter notre canapé !
Pascal Bonafoux – Les 100 tableaux qui racontent Renoir – Editions du Chêne – 9782812317941 – 29,90 €
Les 100 tableaux qui racontent Renoir
Paru le 19/09/2018
260 pages
Editions du Chêne
29,90 €



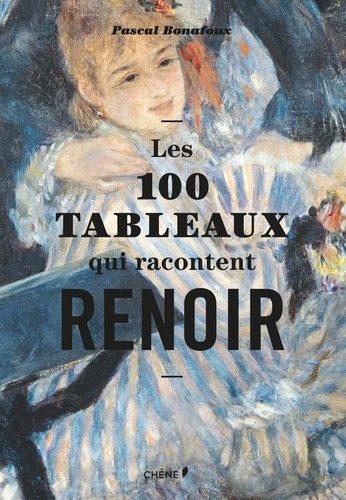
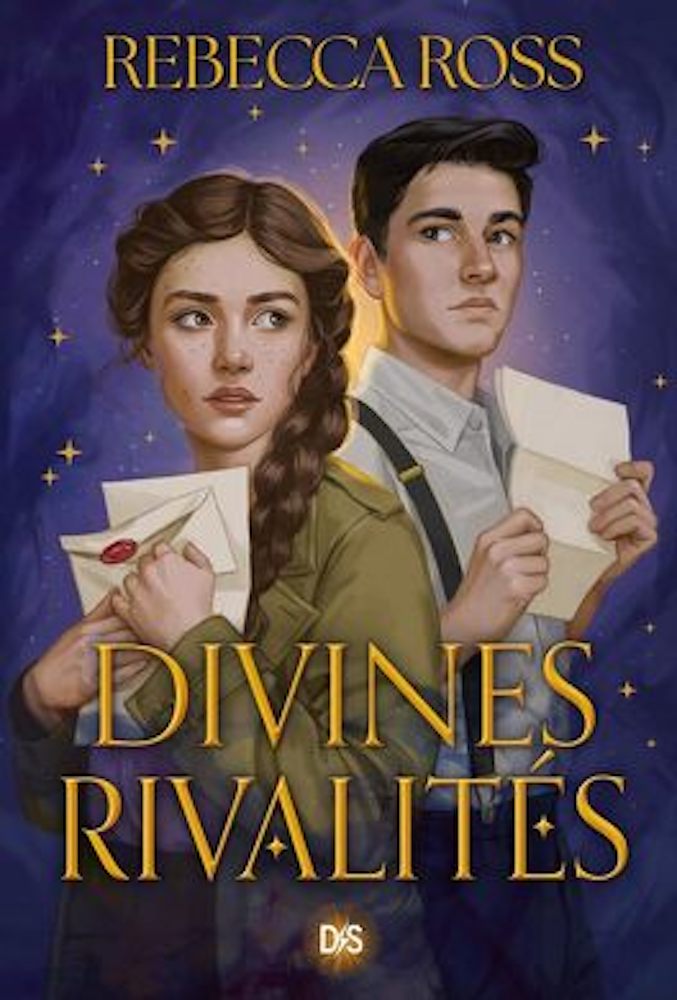
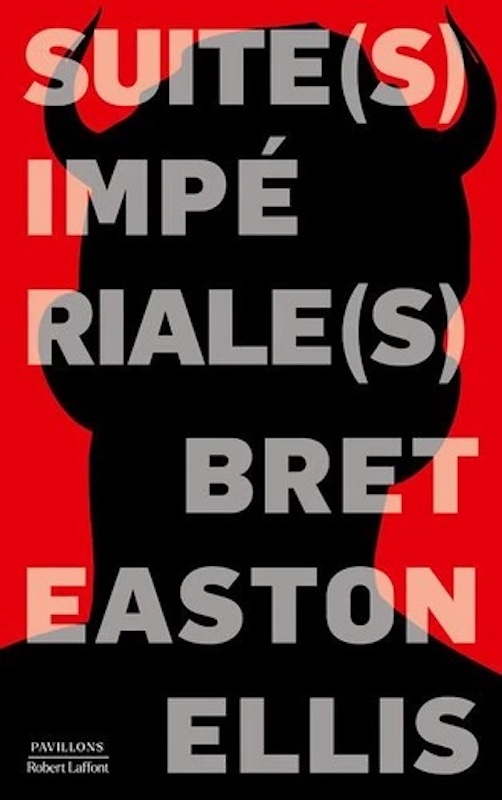
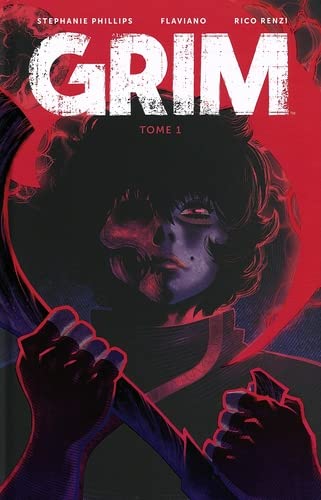
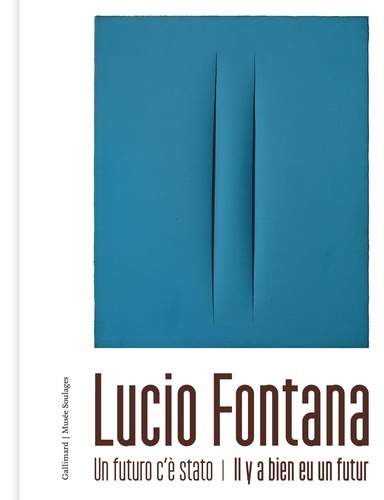
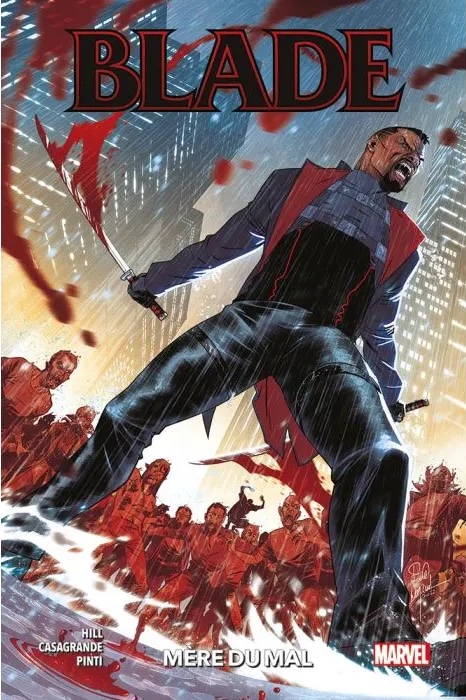
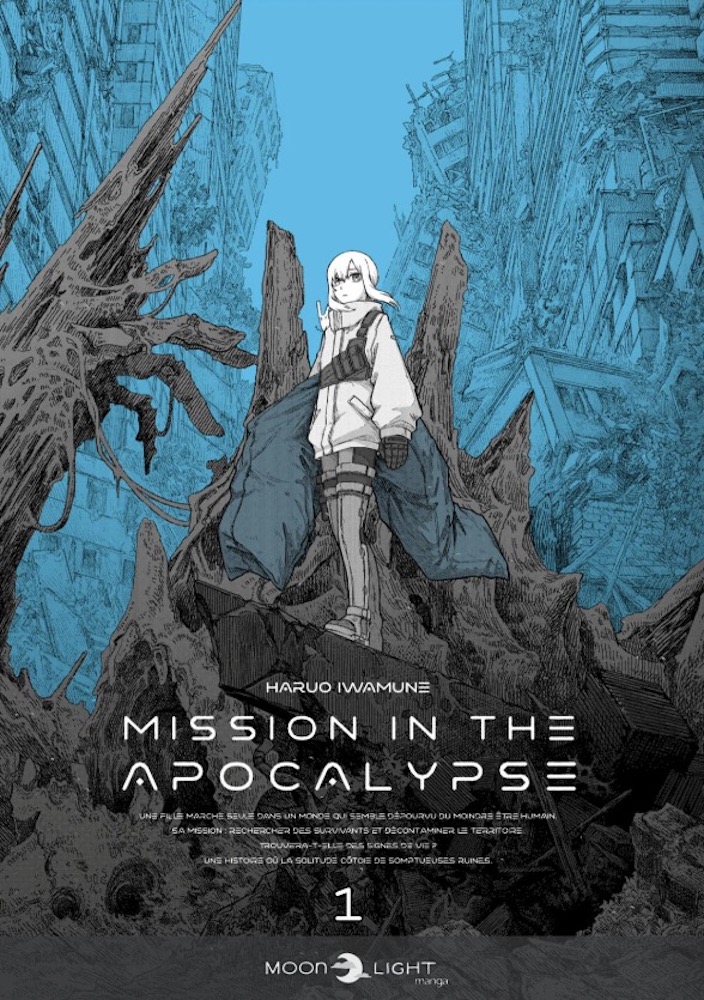
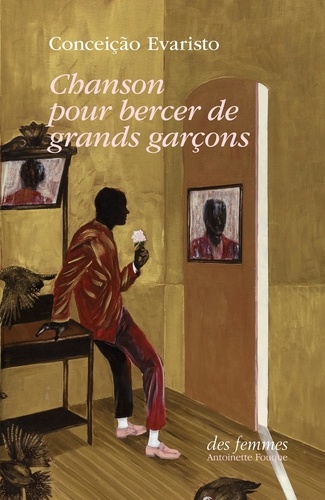
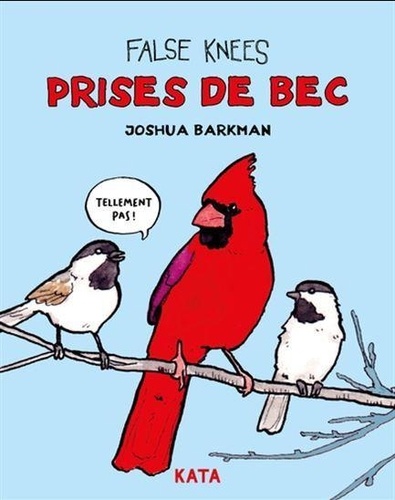
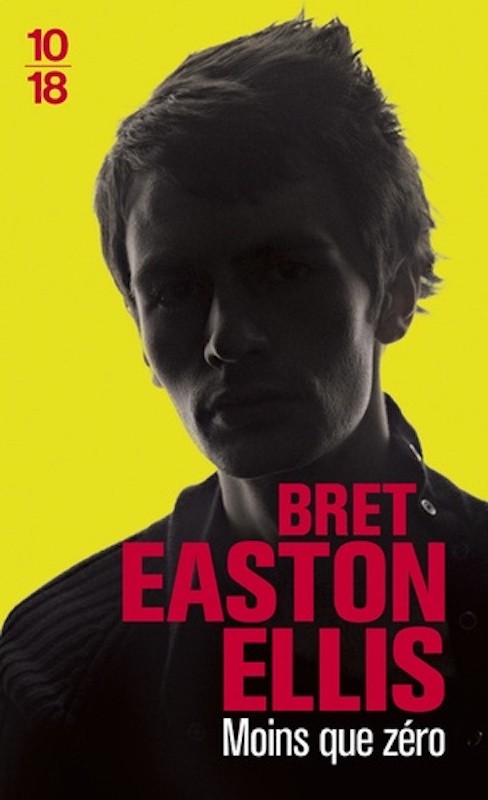
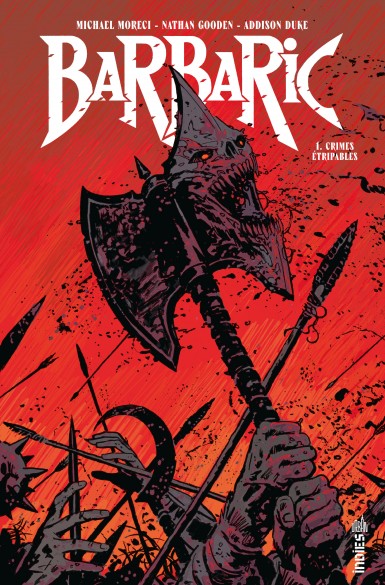
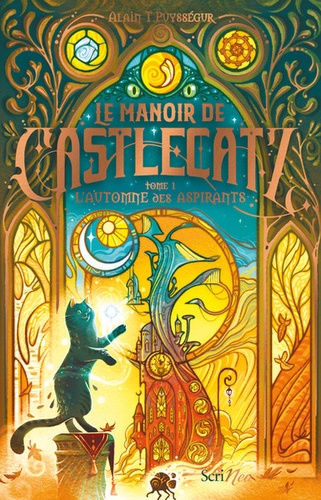
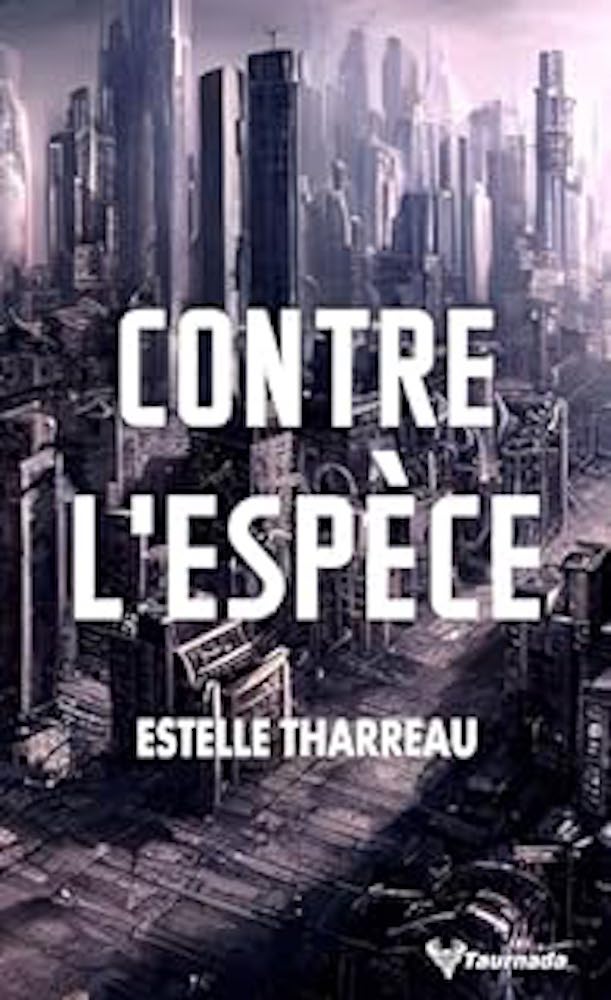
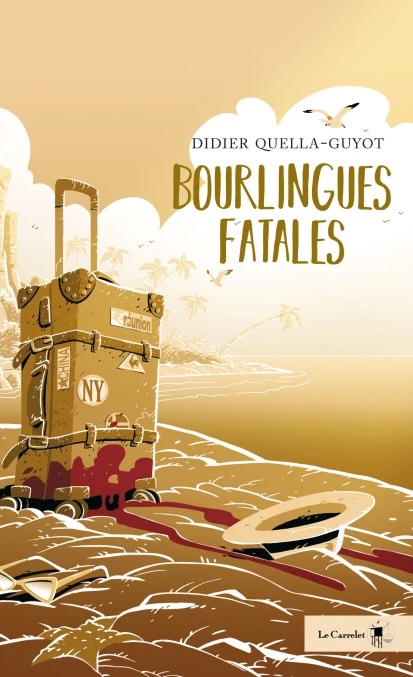
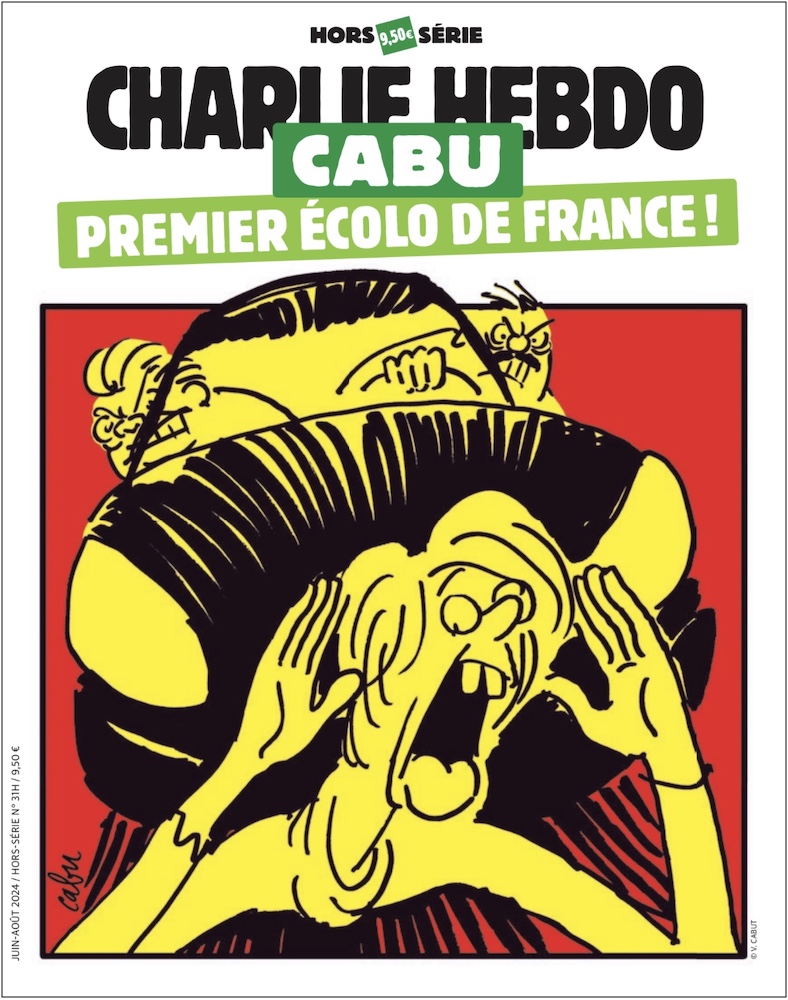
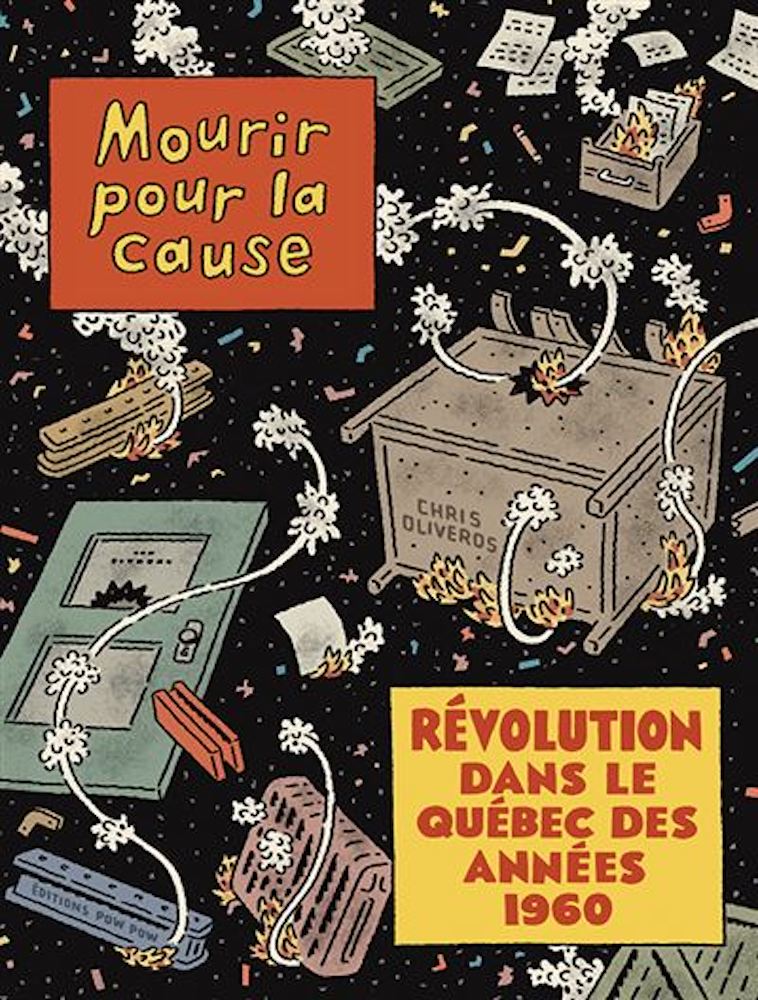
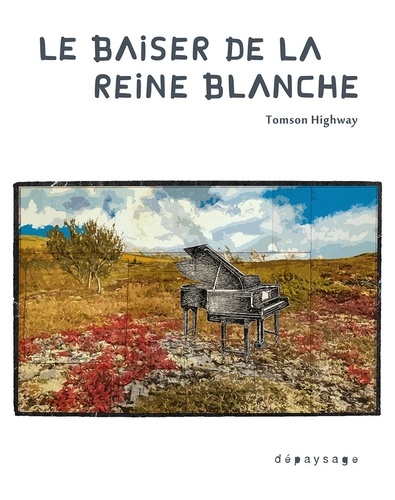
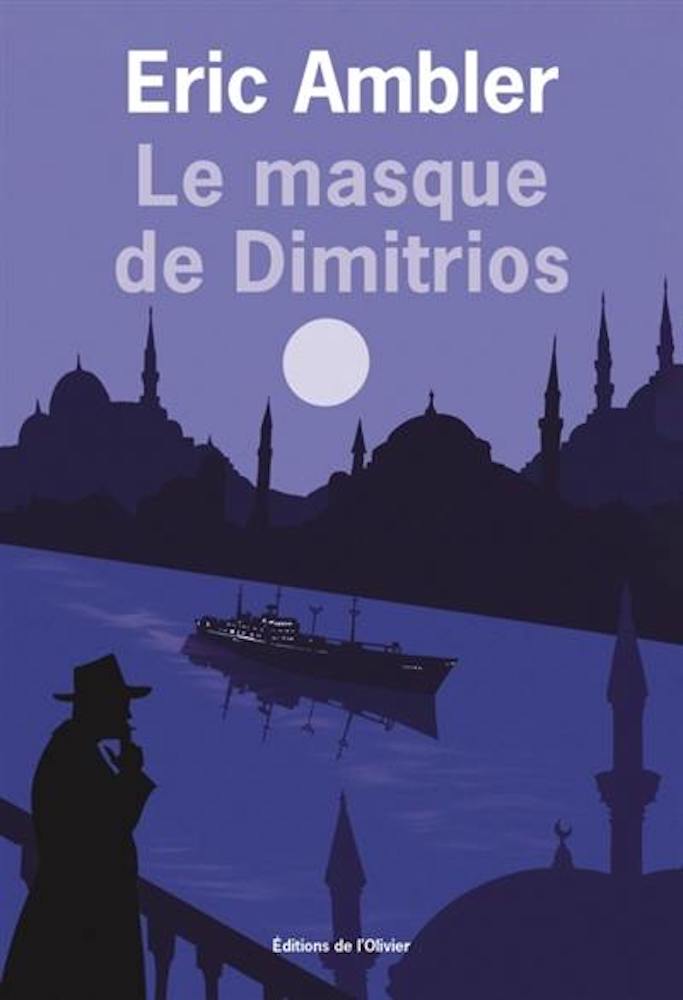
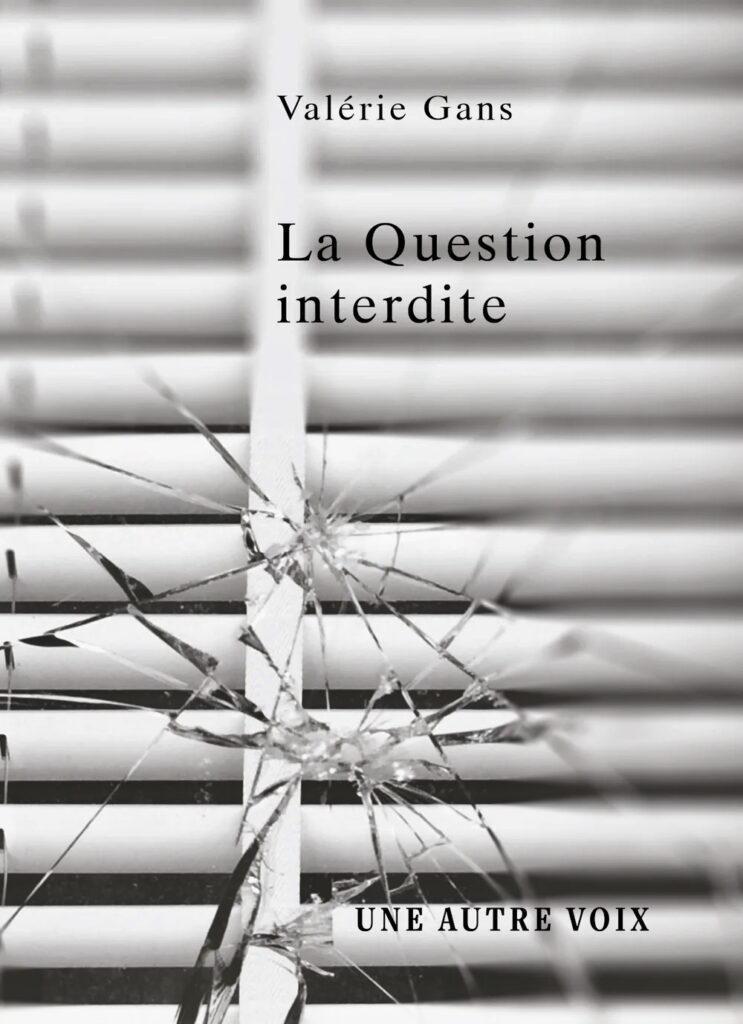
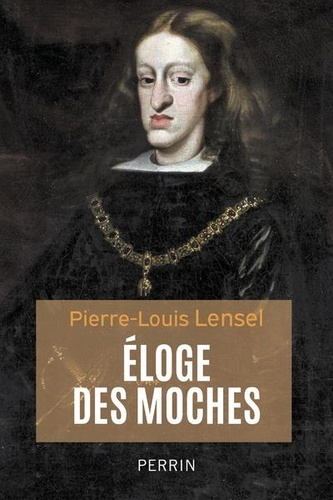
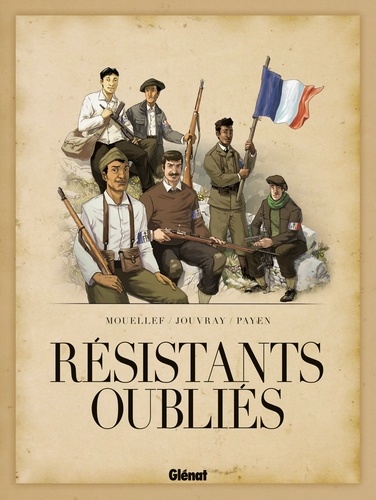
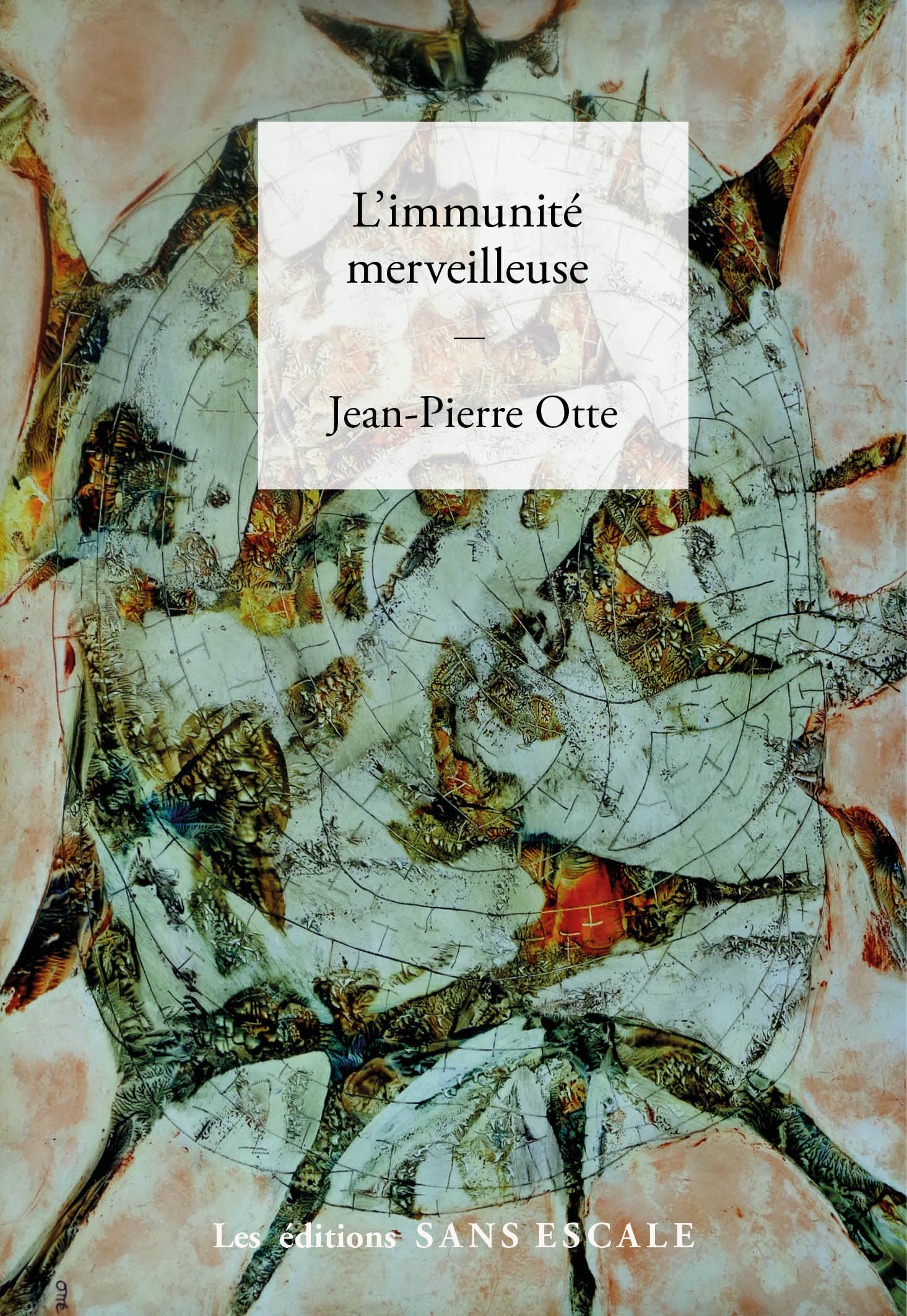
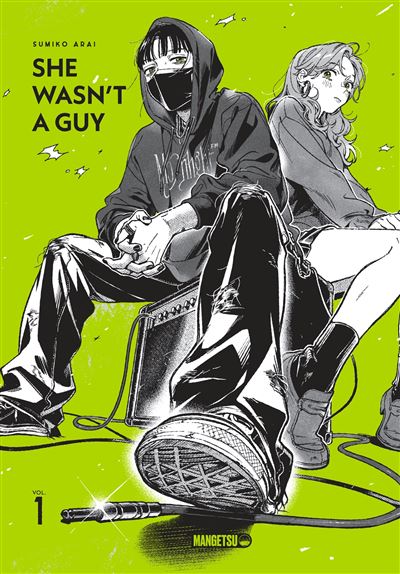
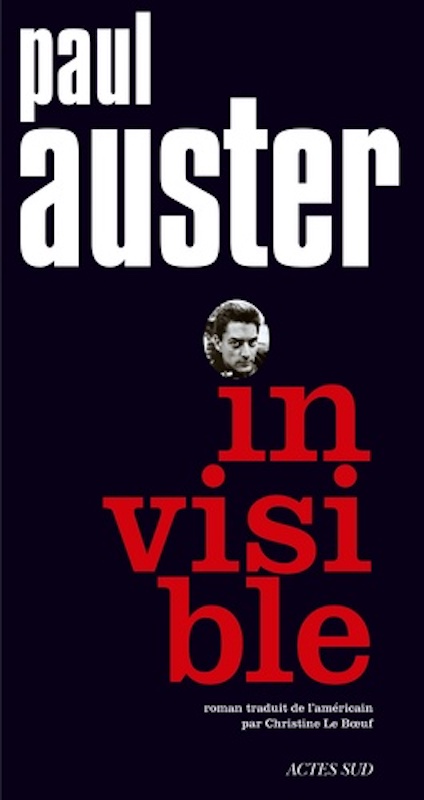
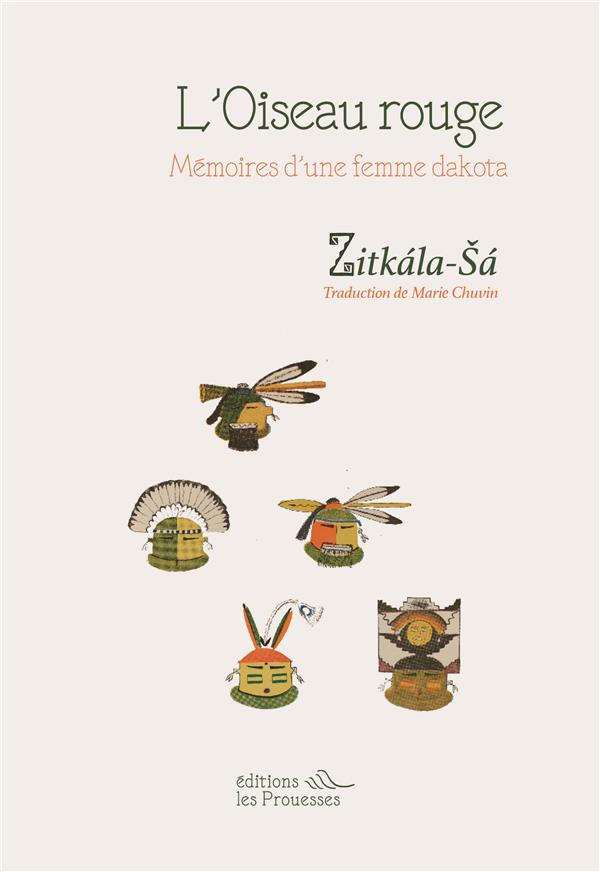
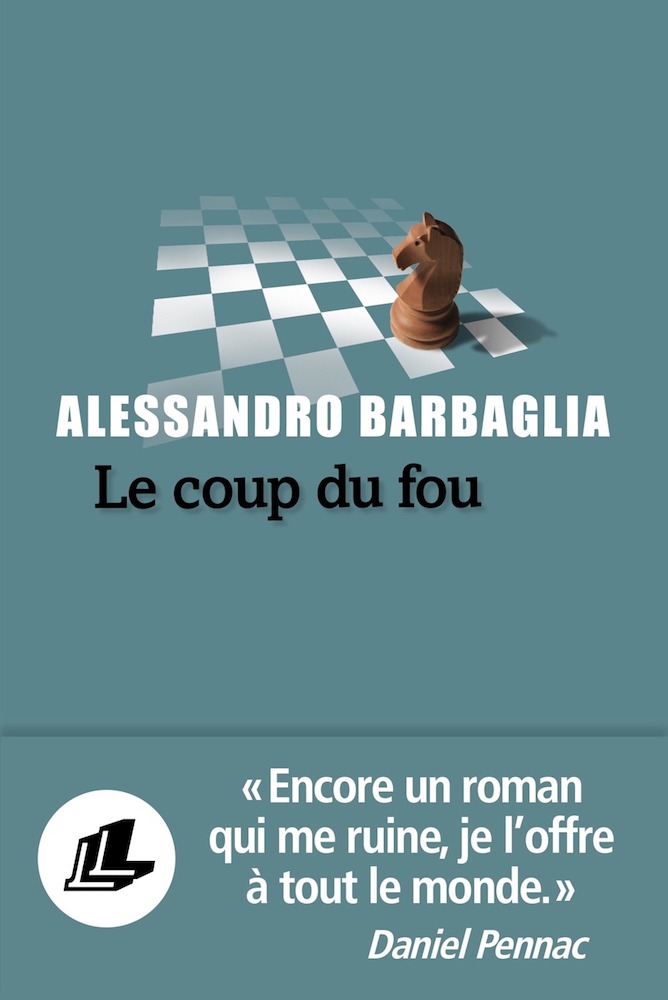
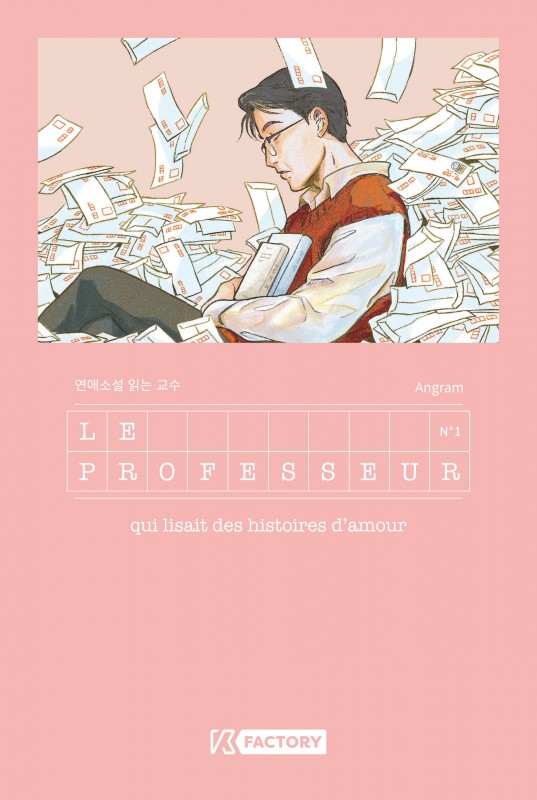
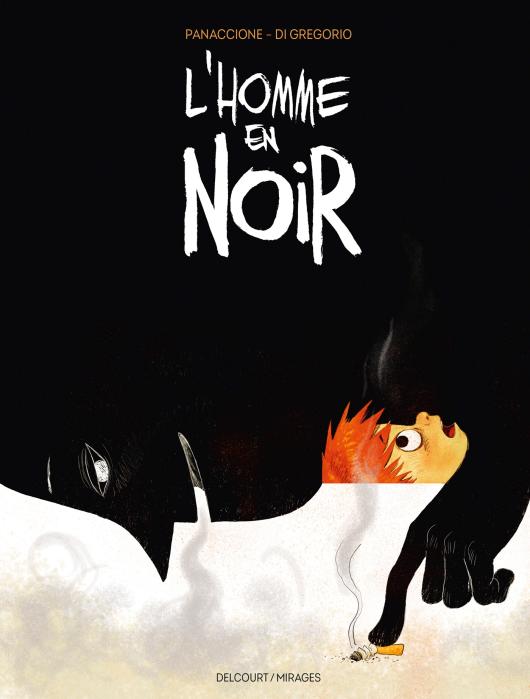
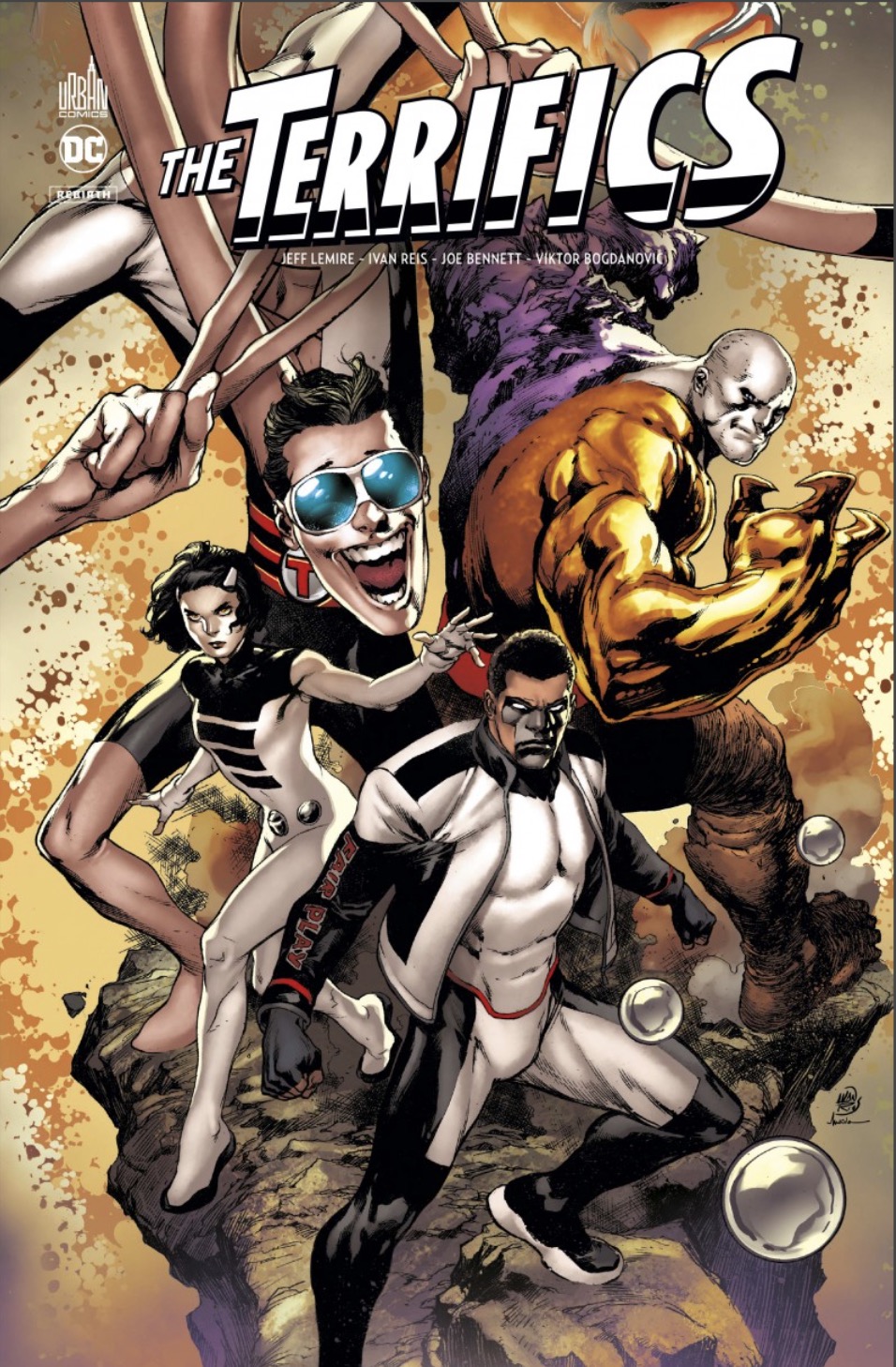
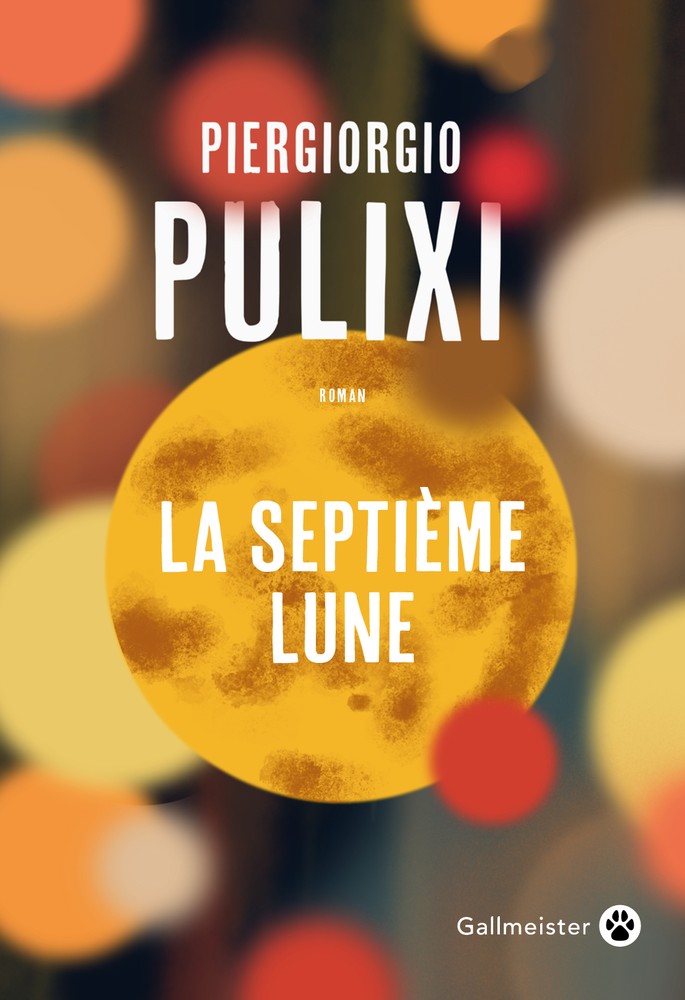
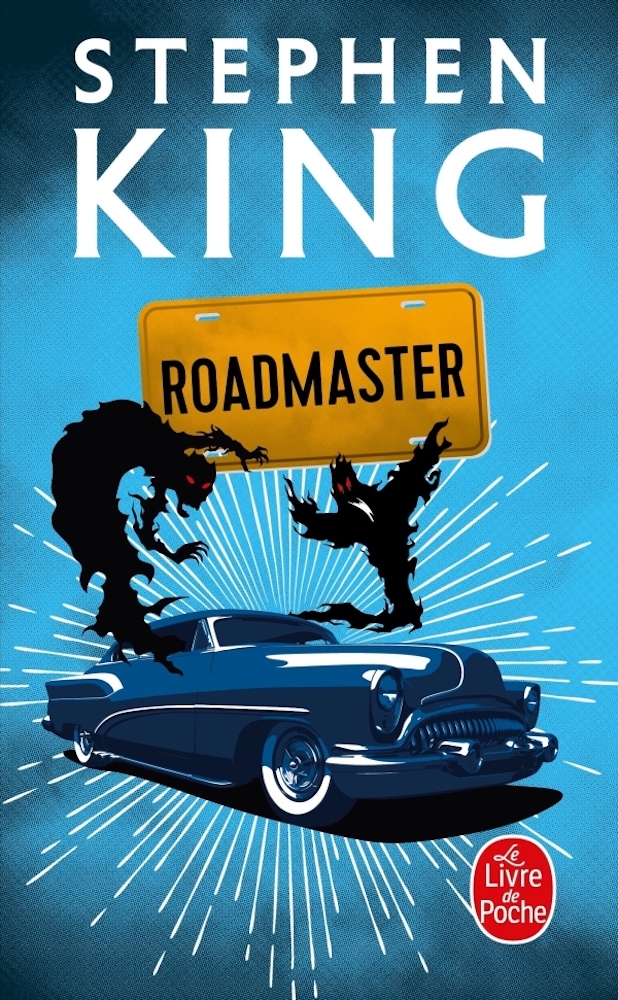
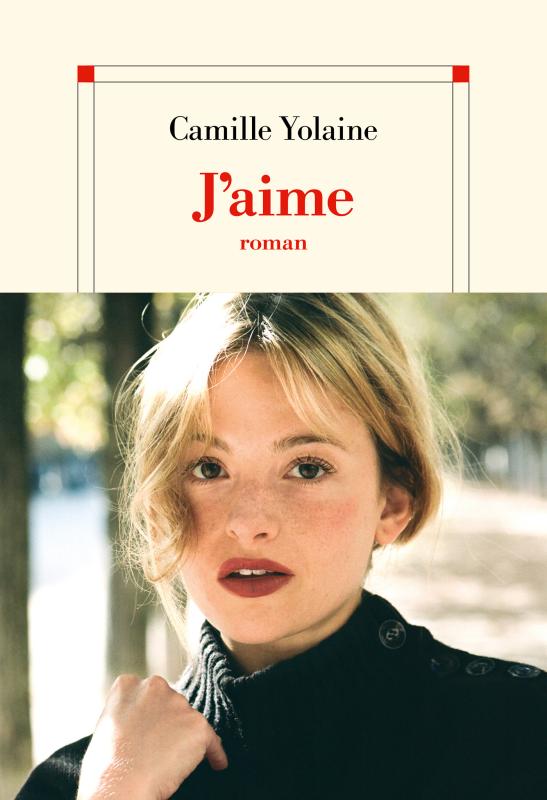
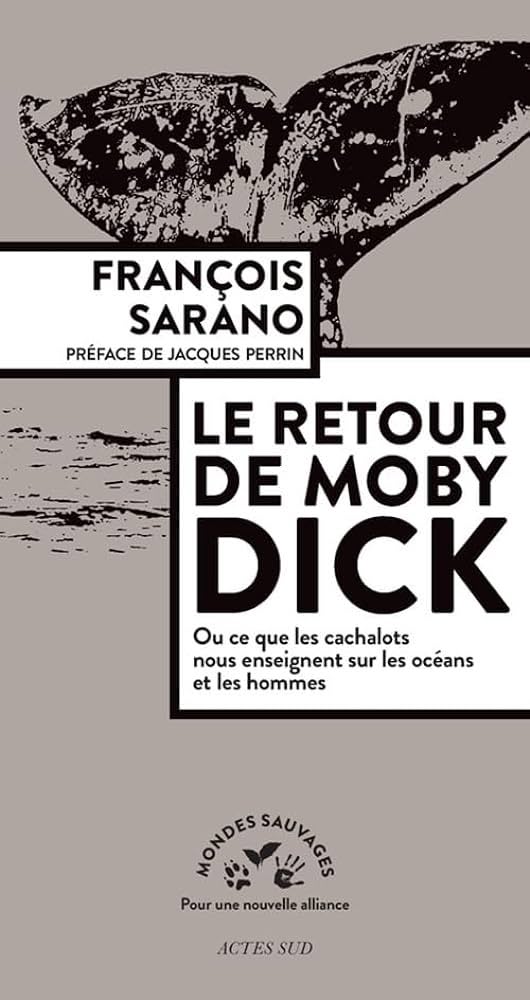
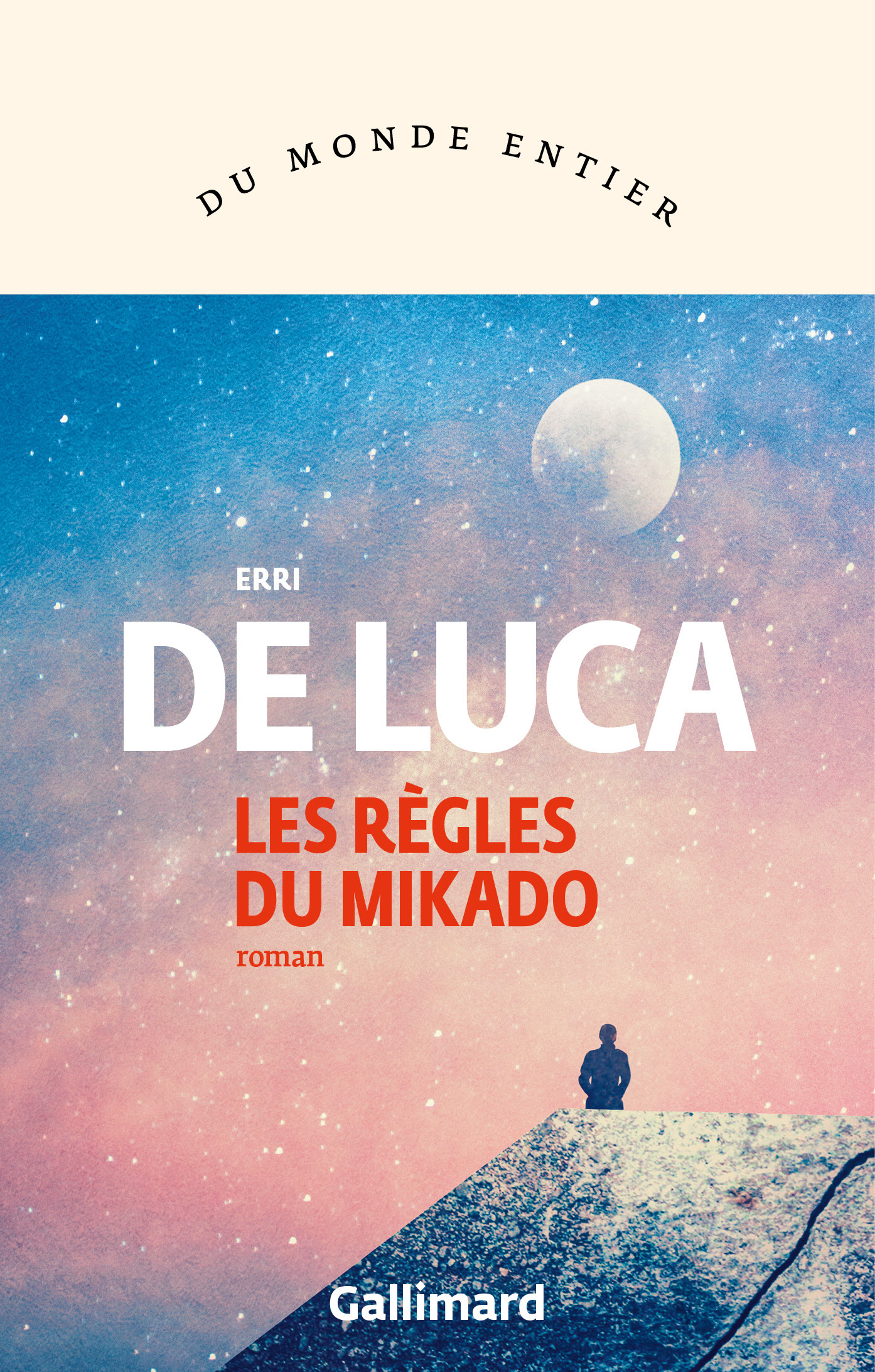
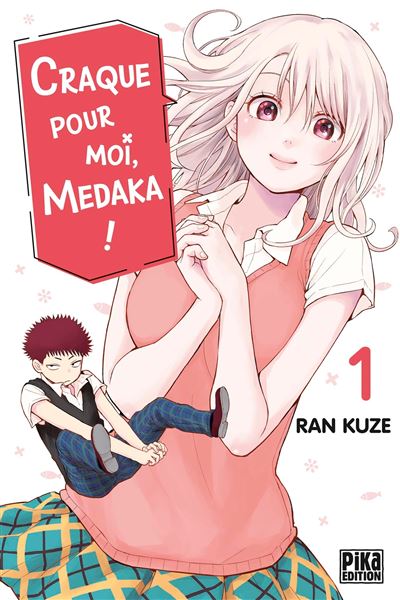

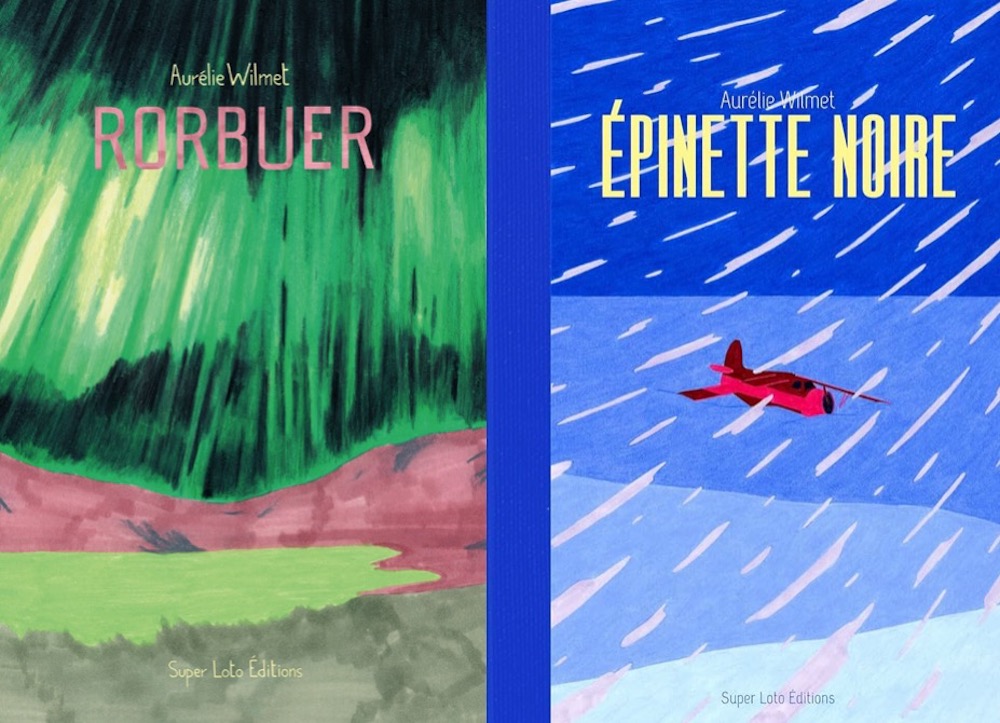
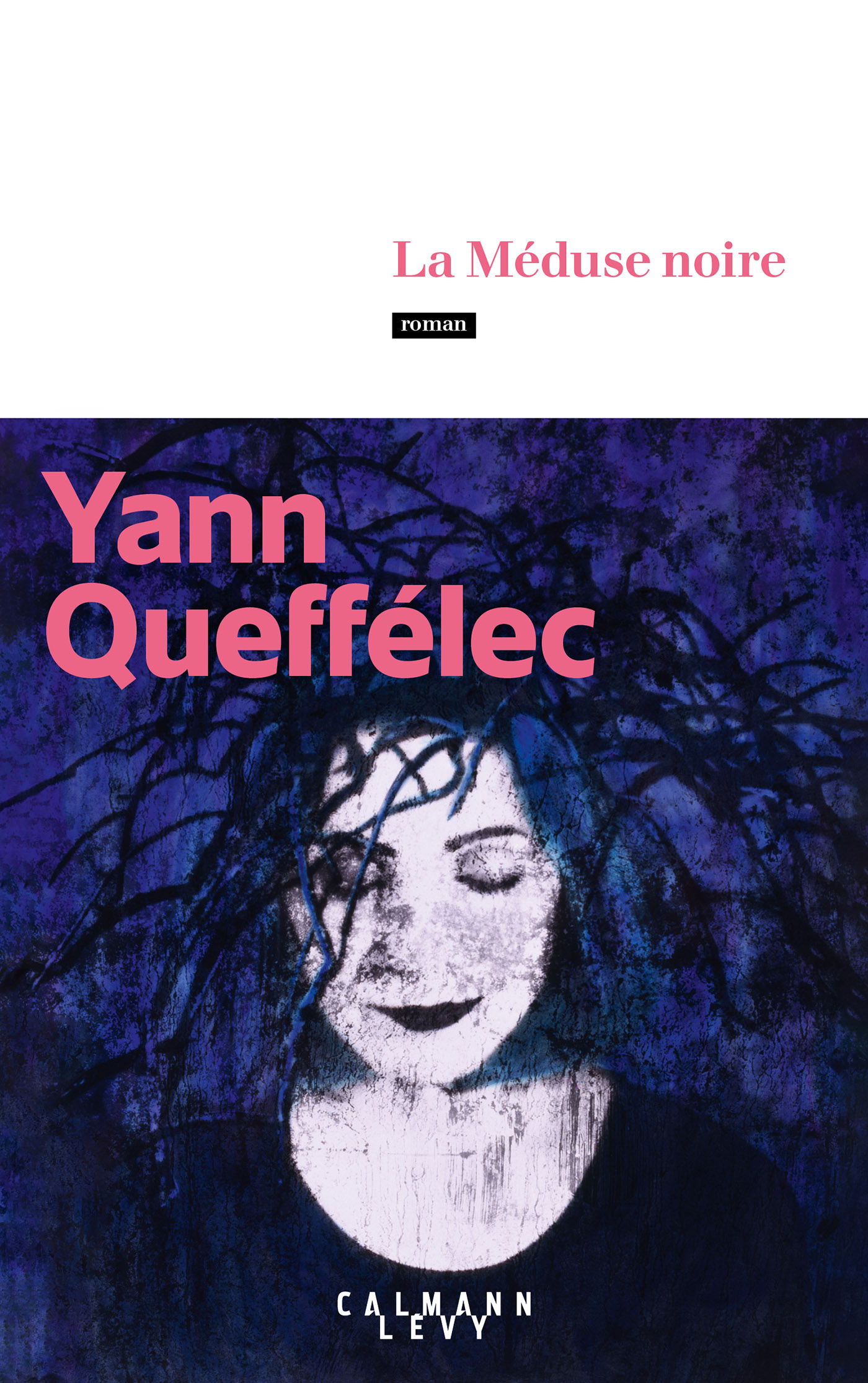
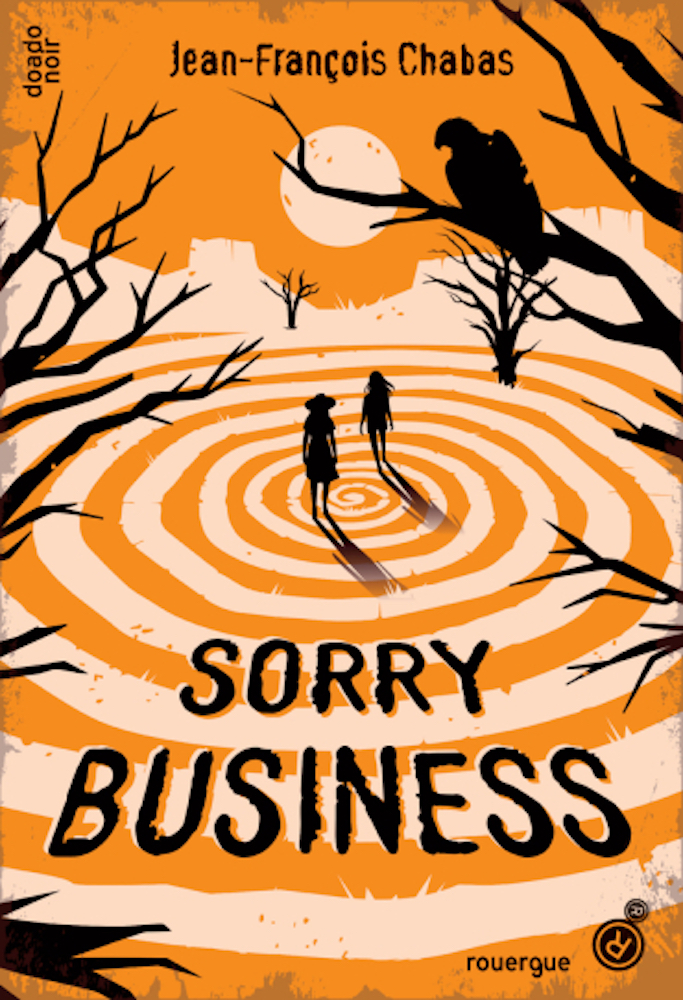
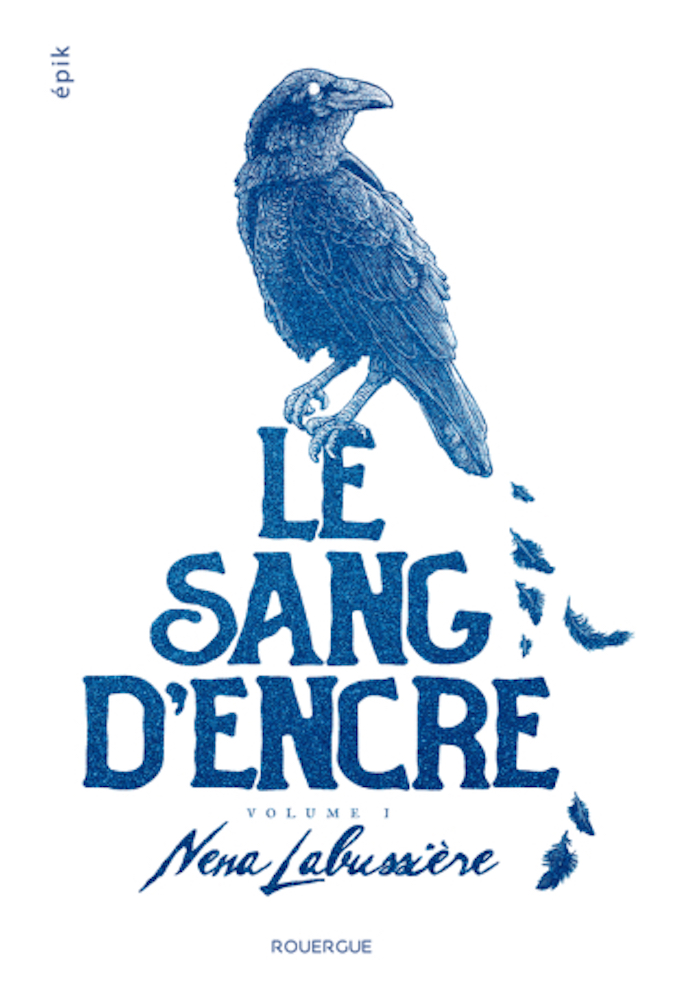
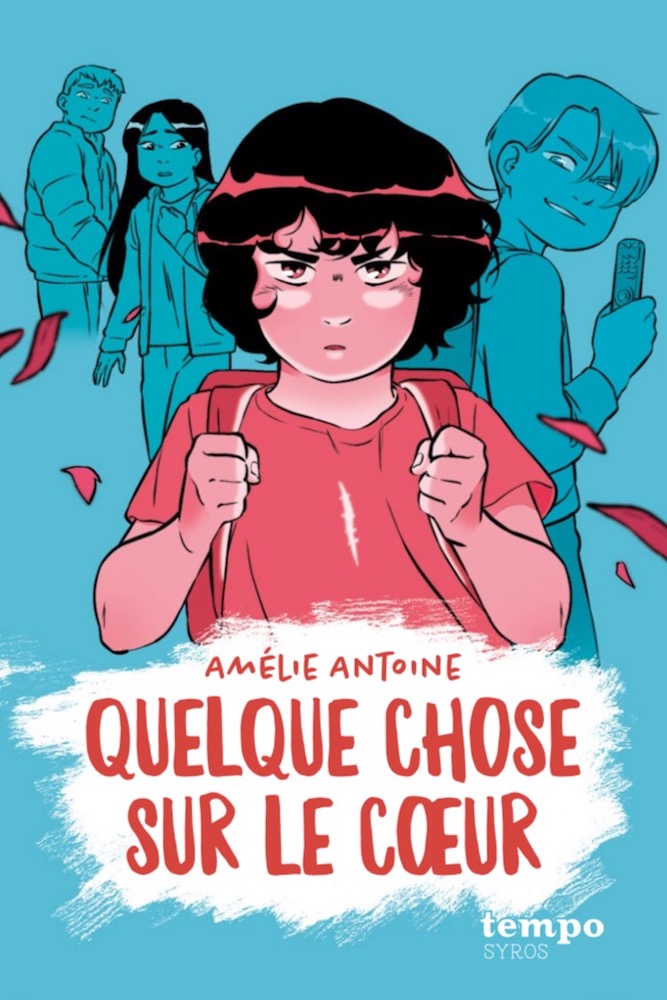

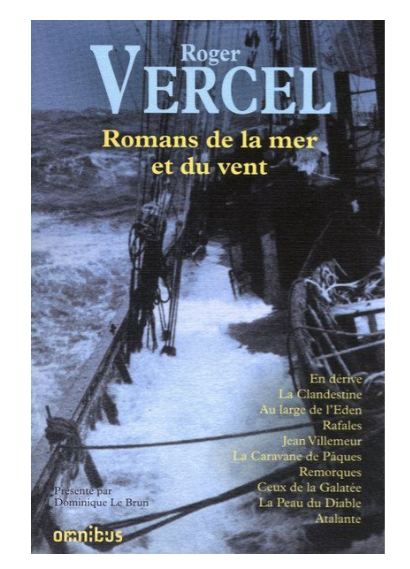
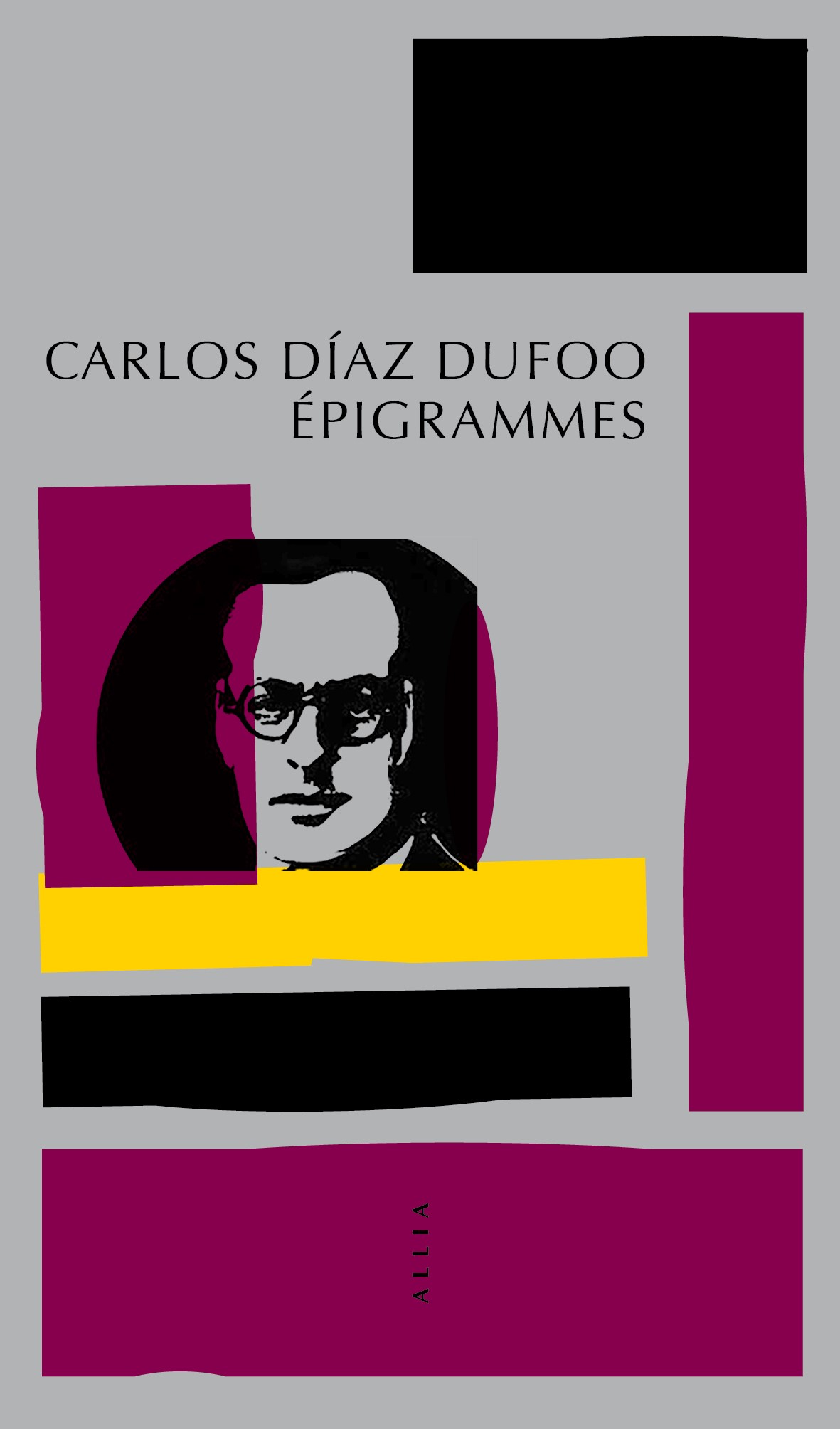
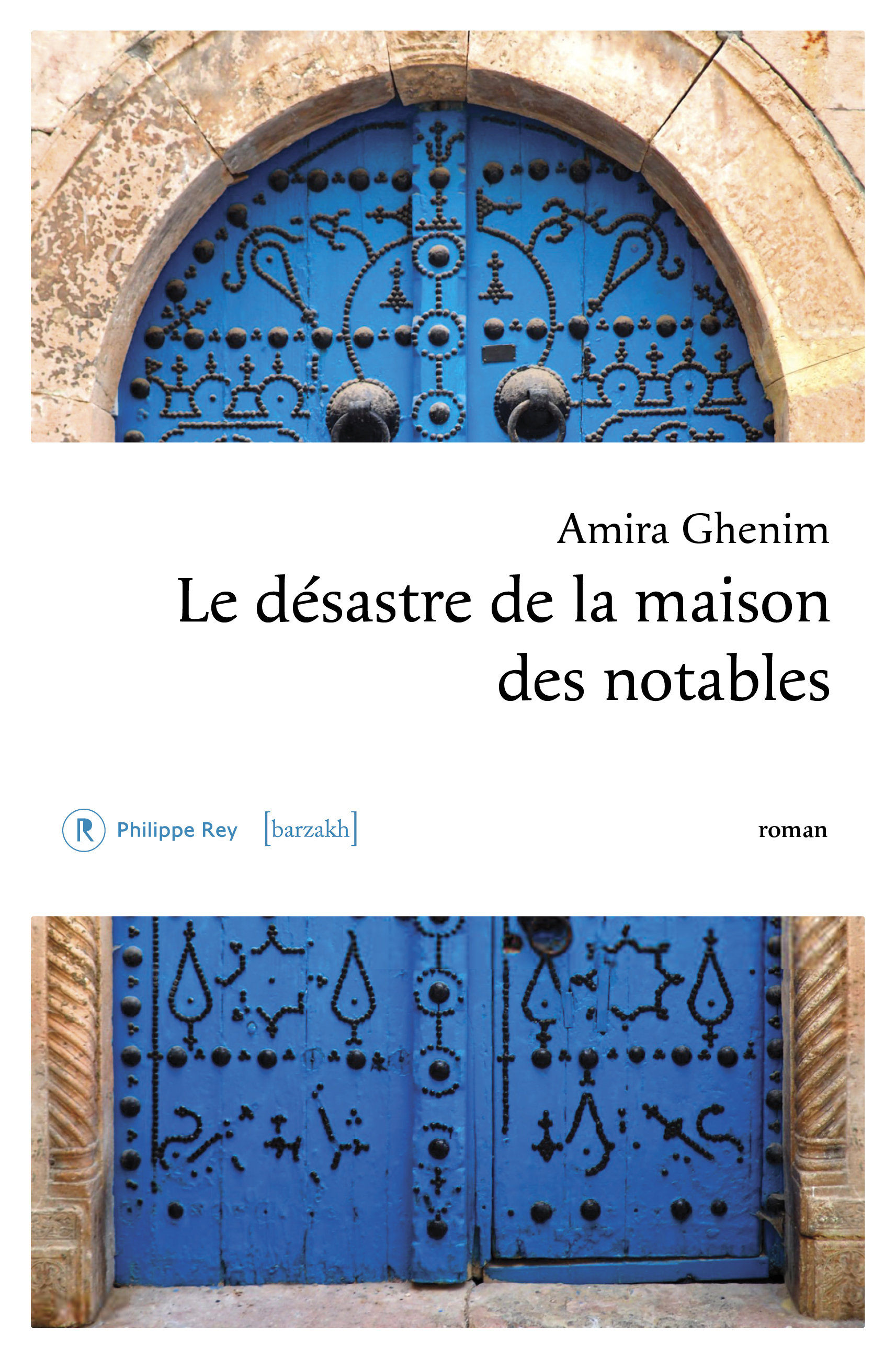
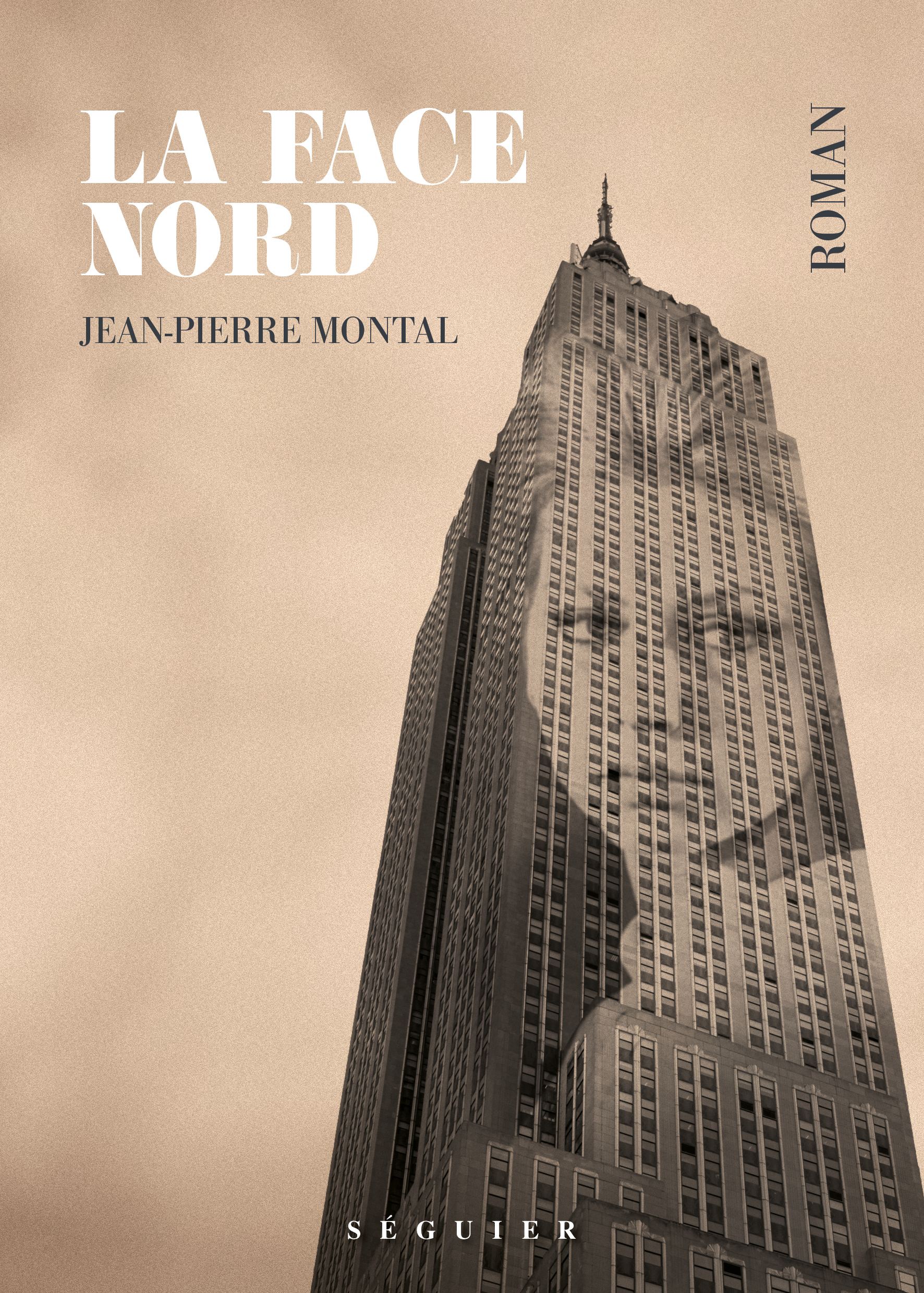
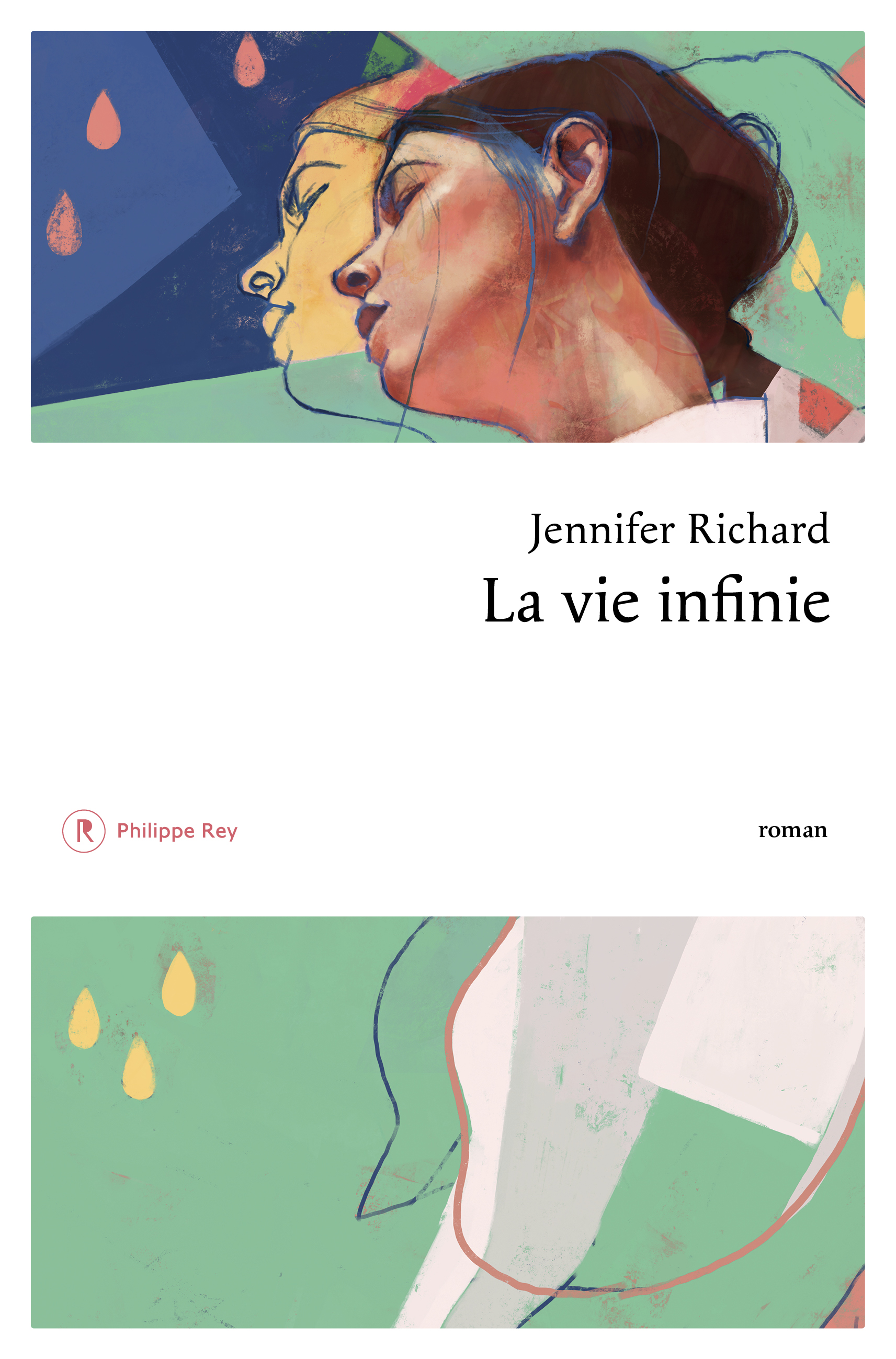
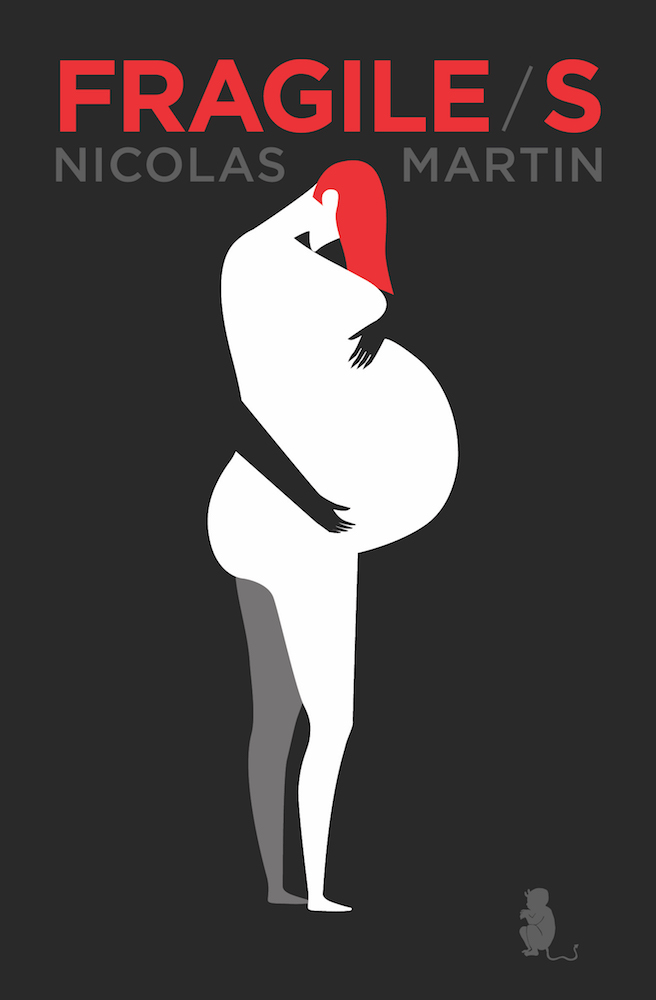

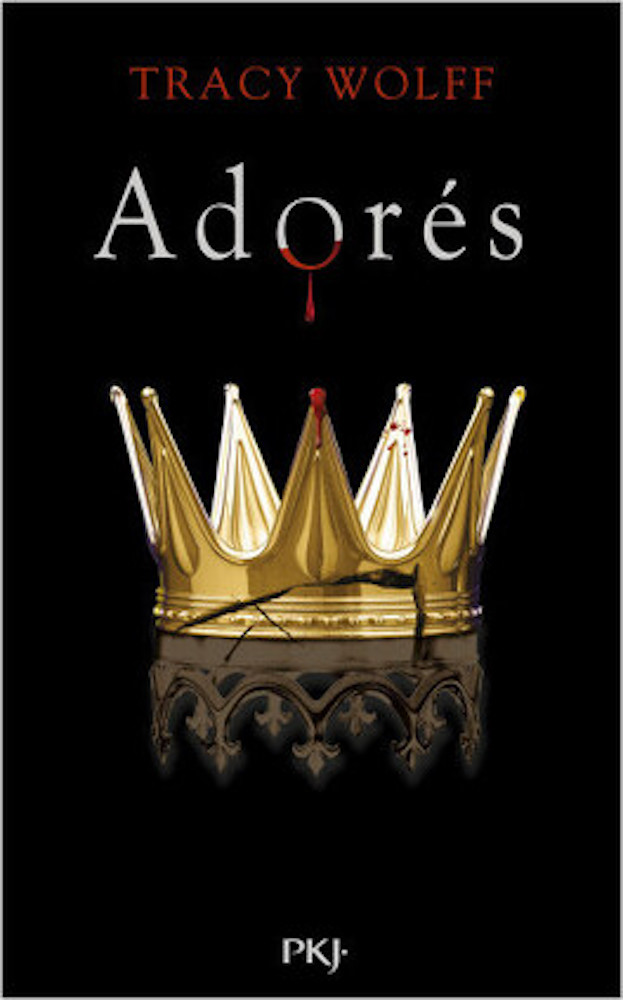
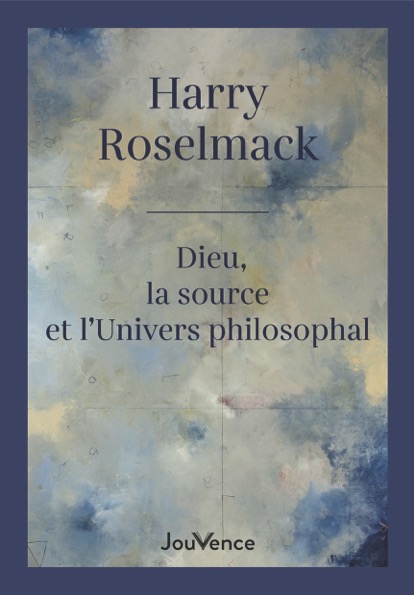
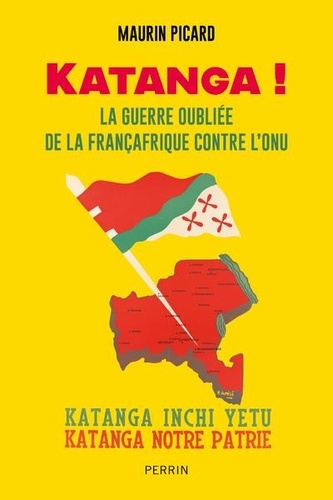
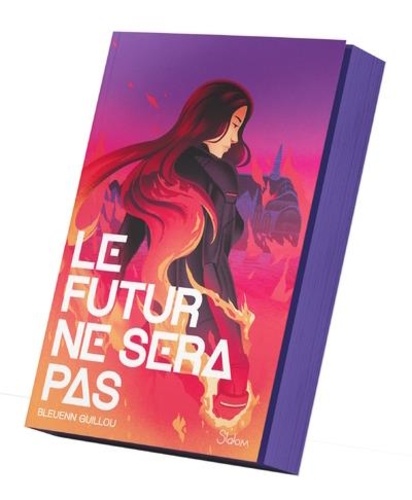
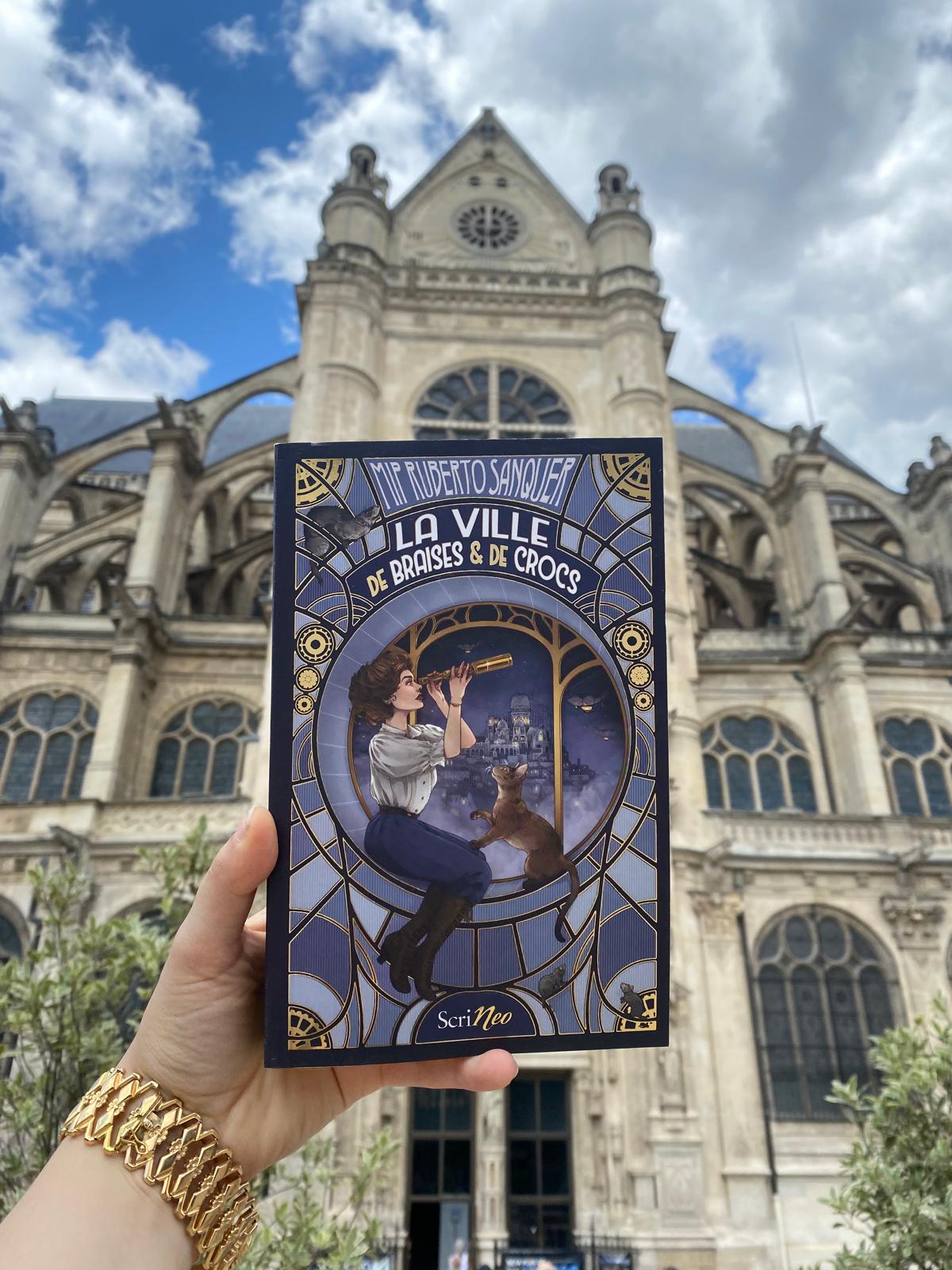


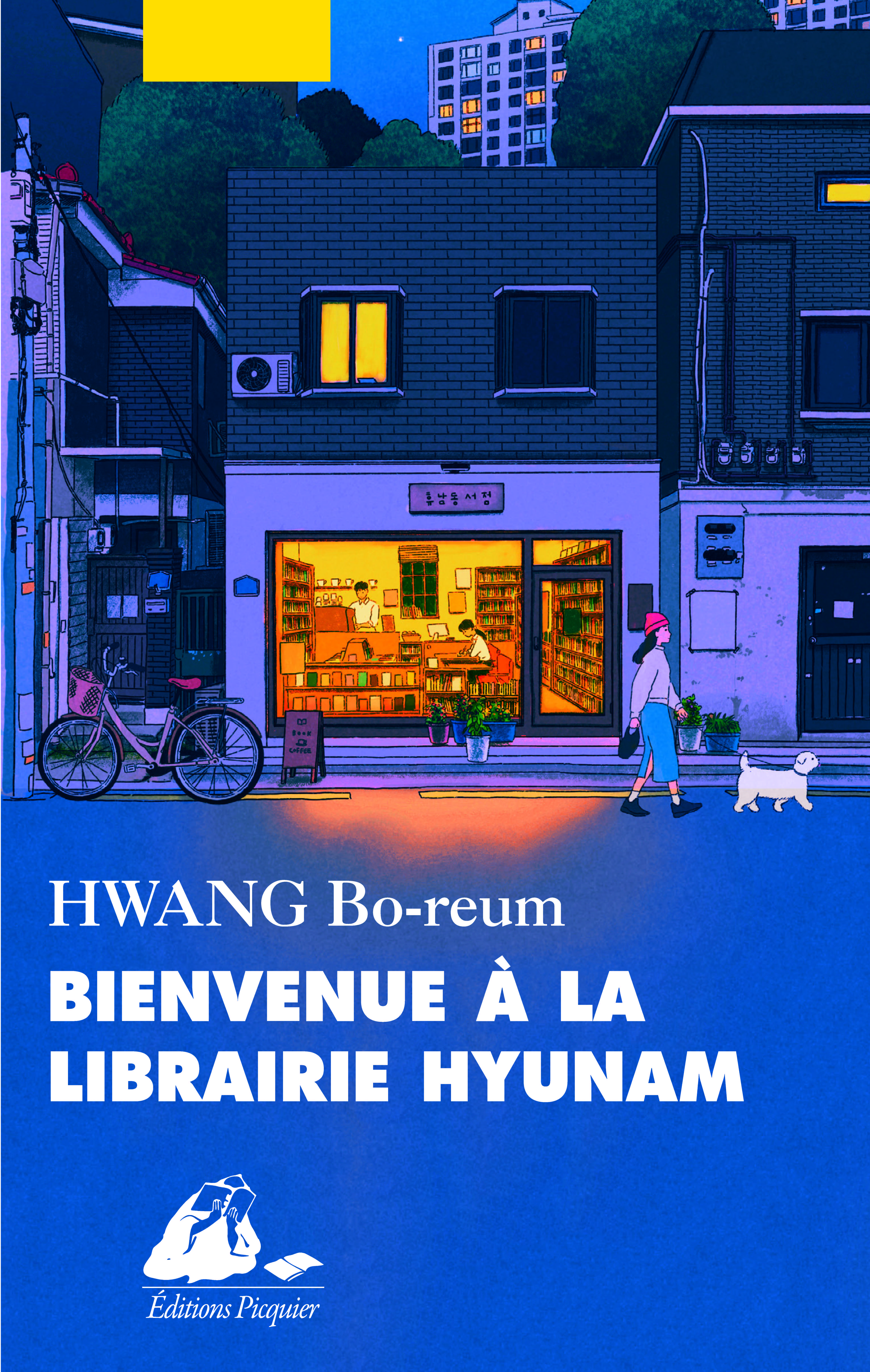
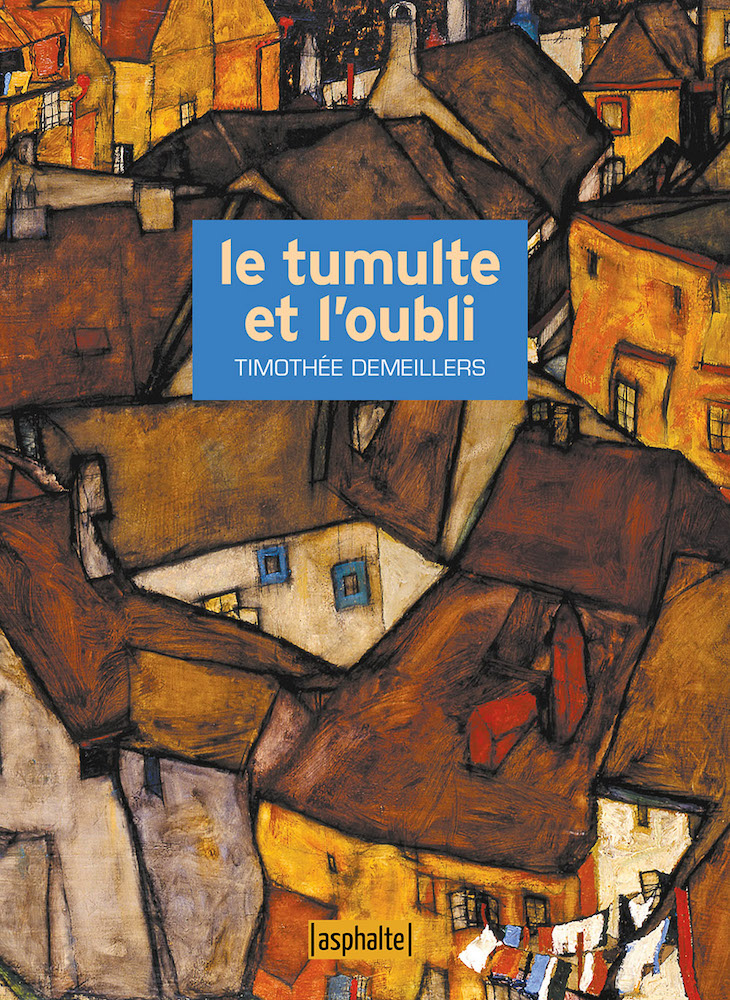
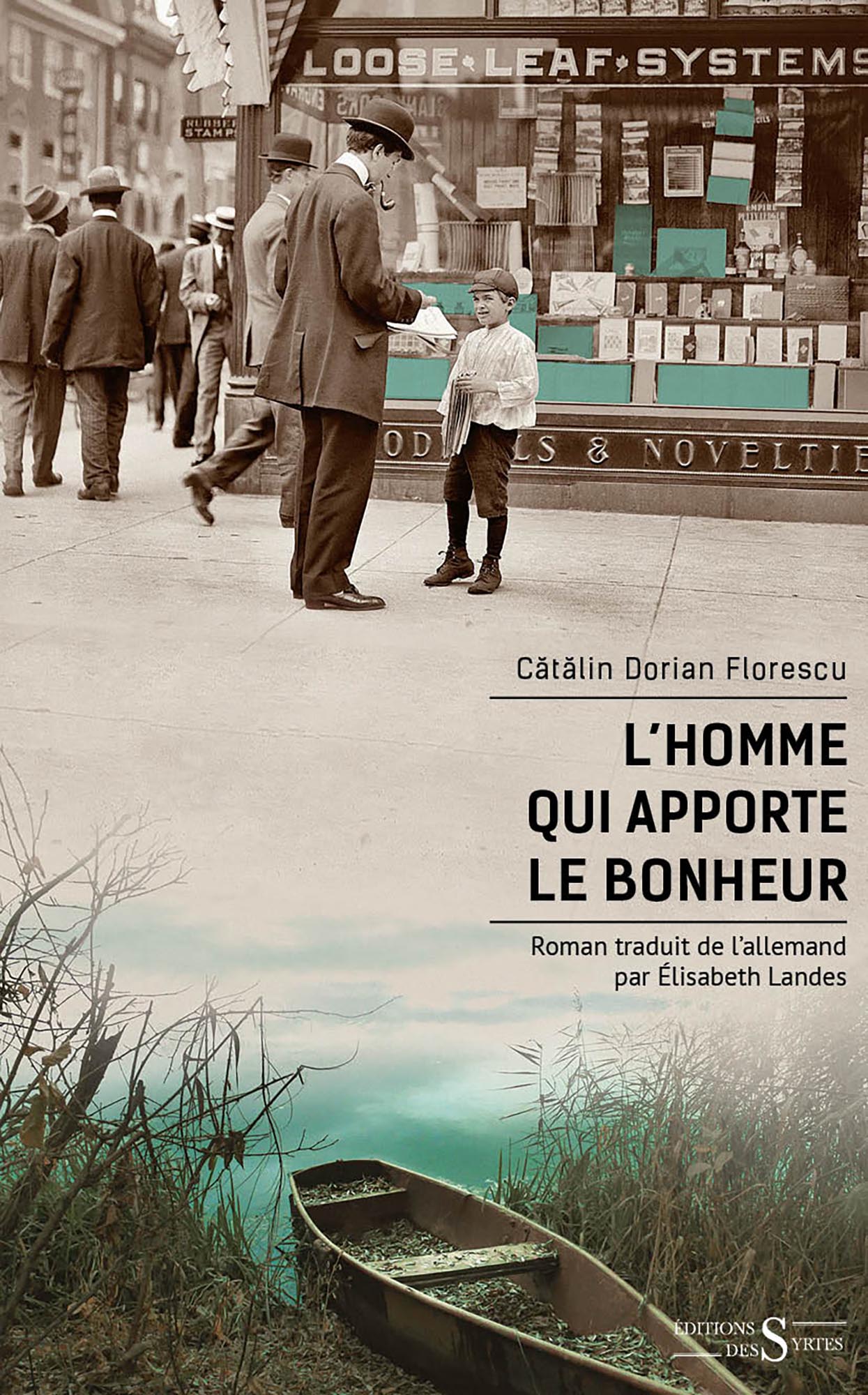
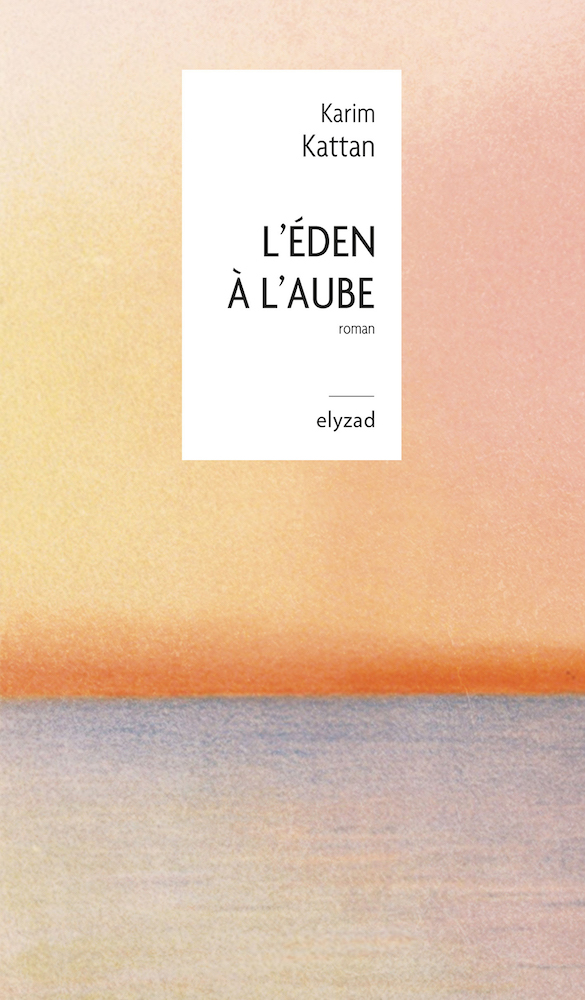
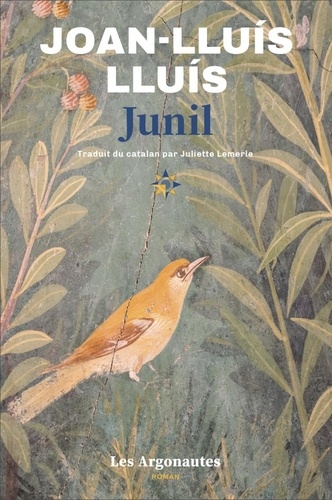
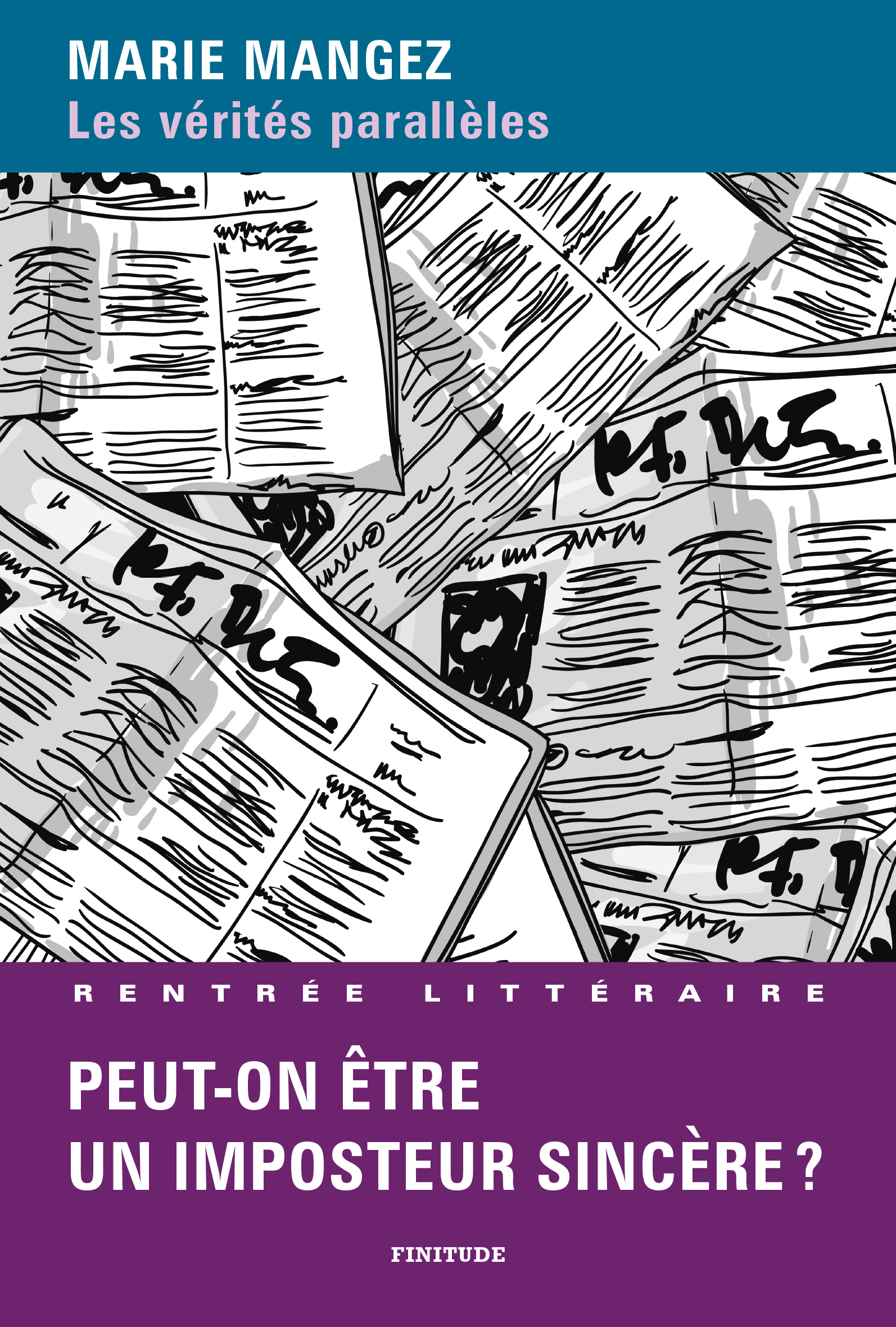

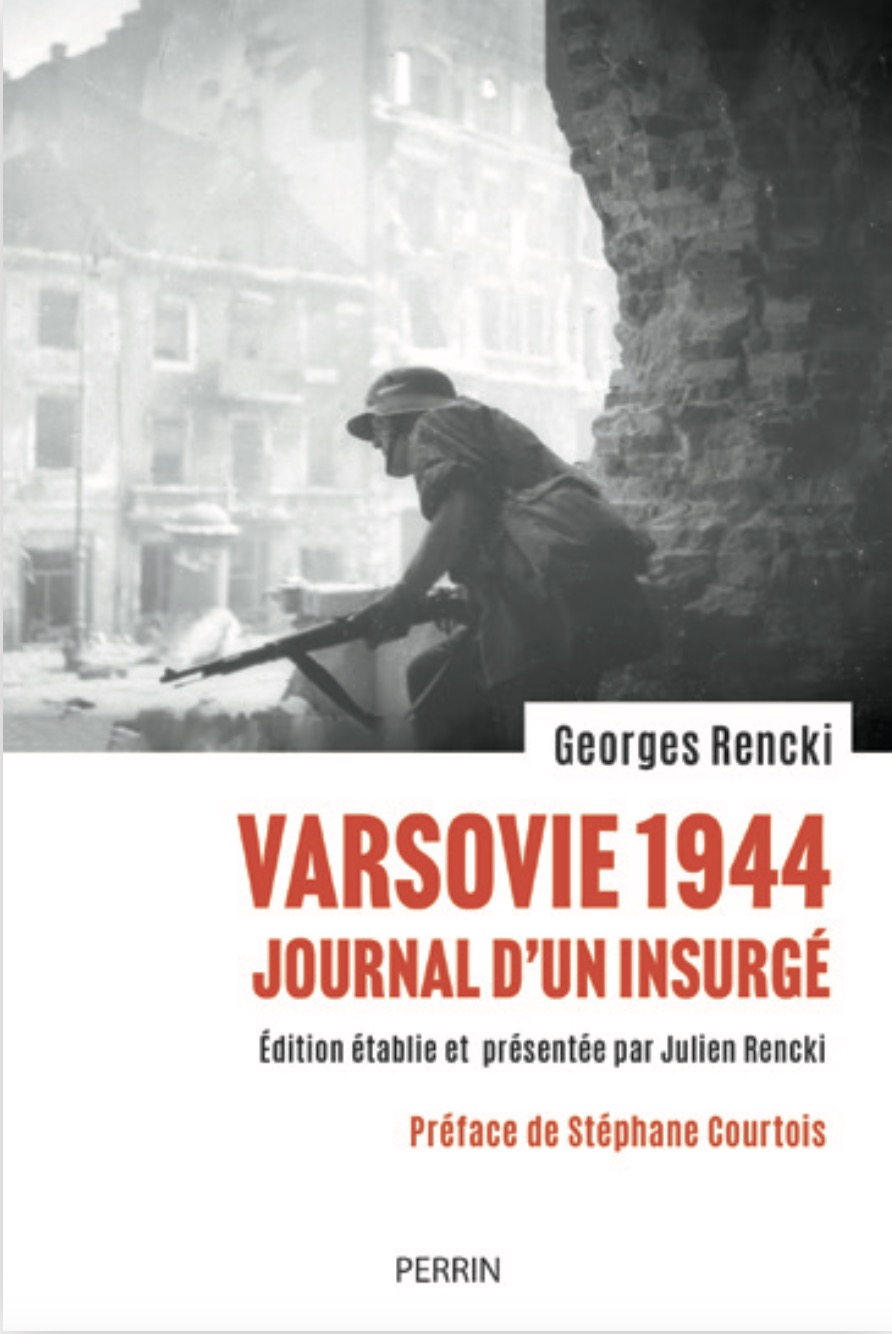
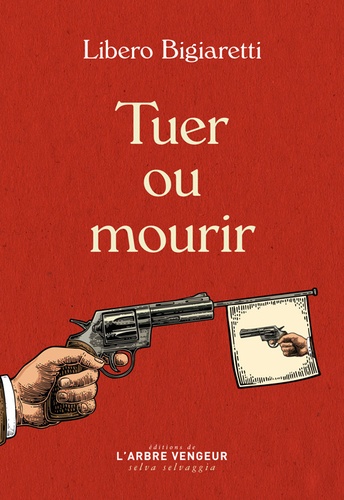
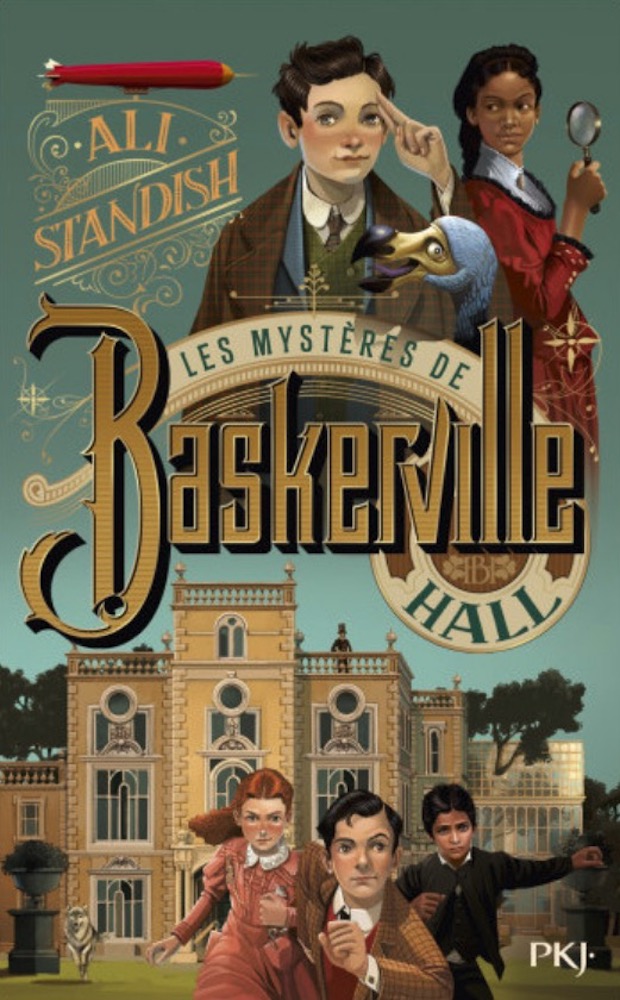
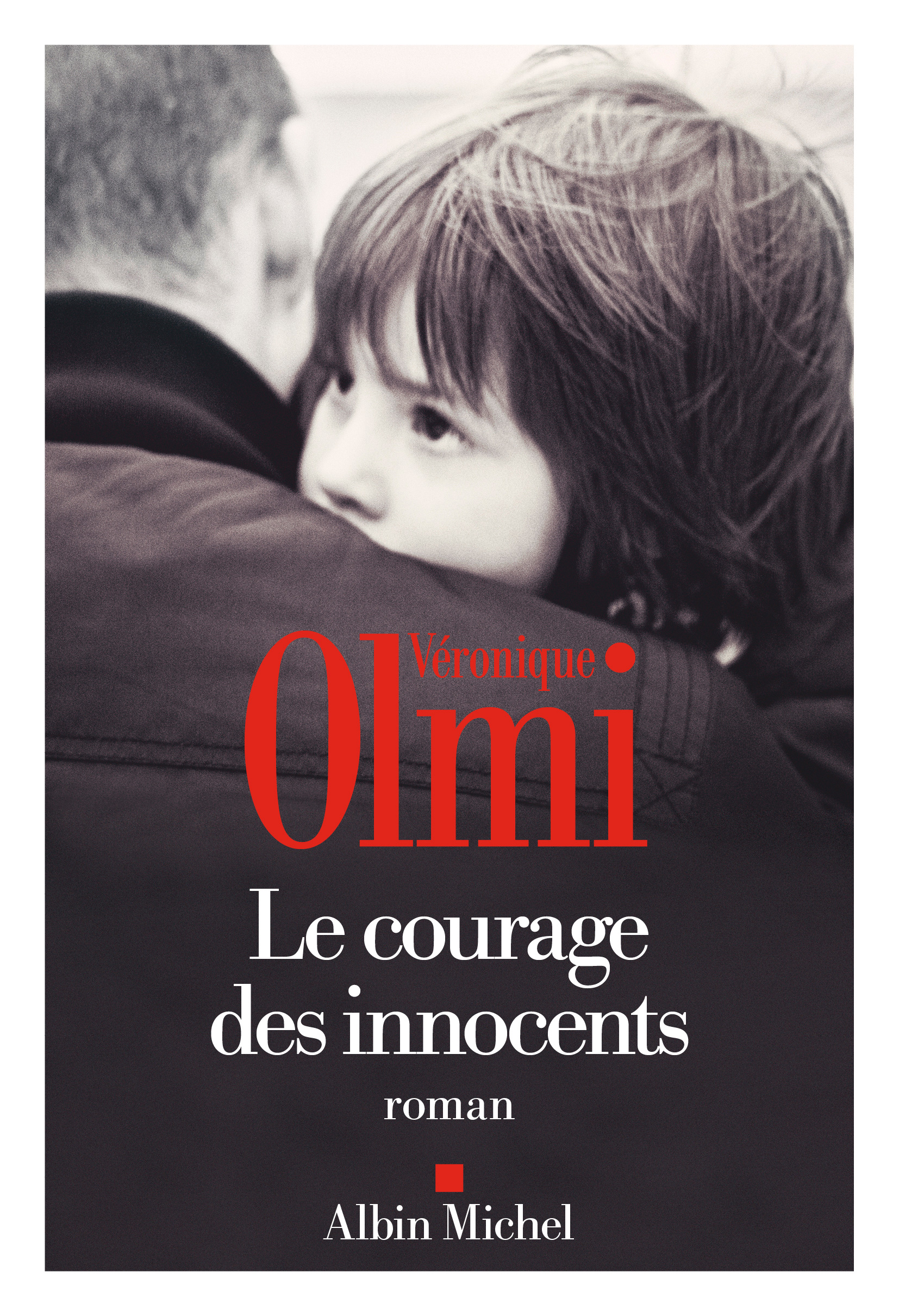
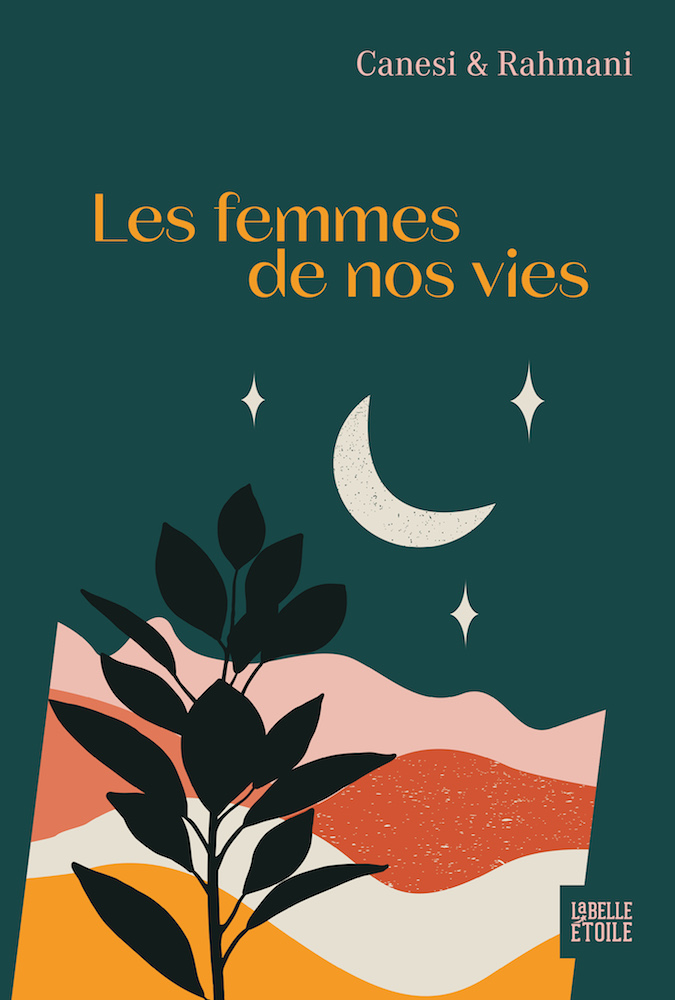
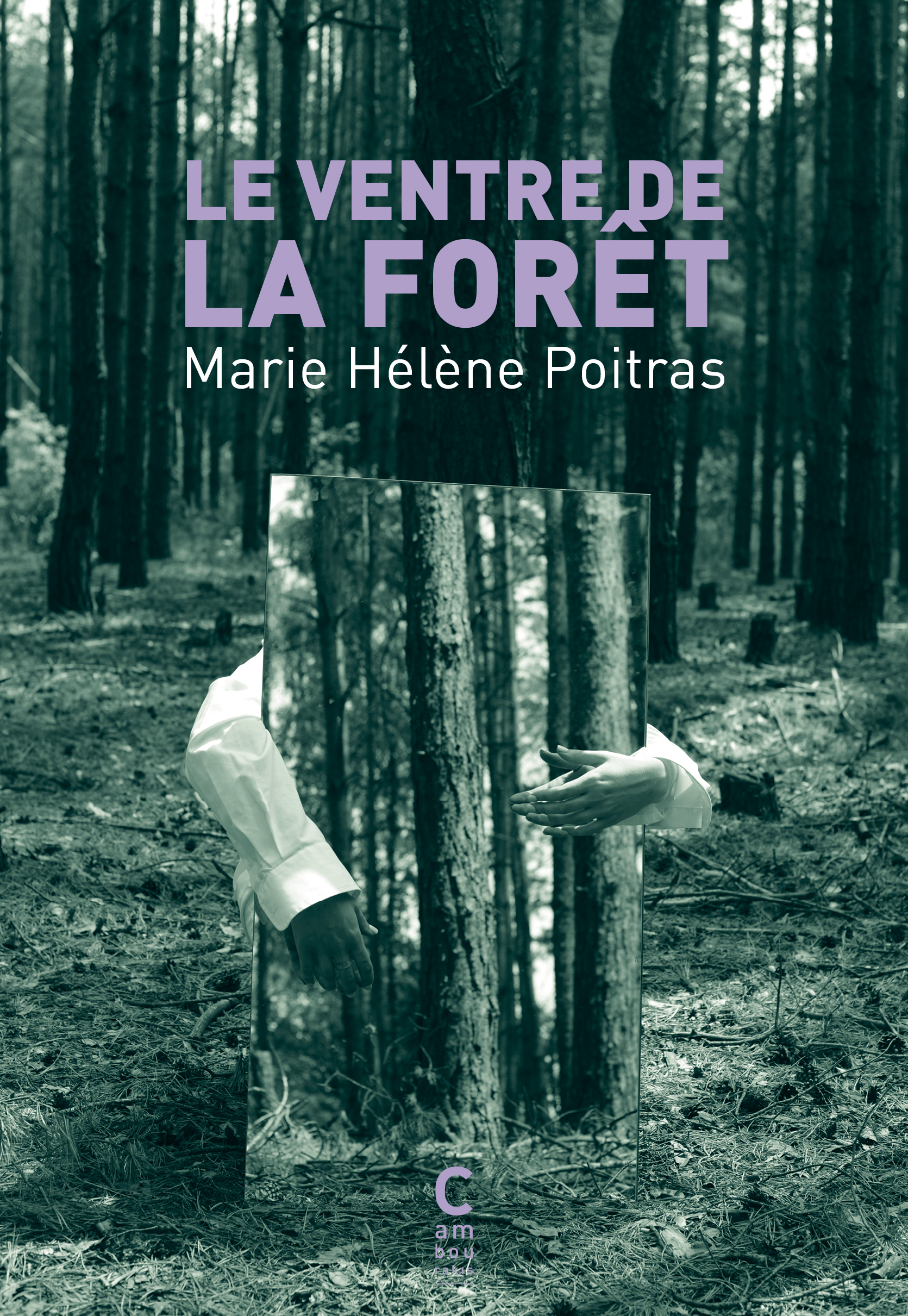
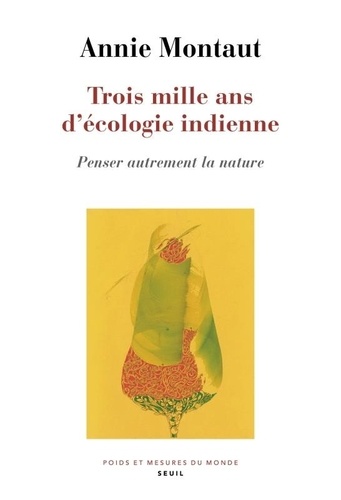
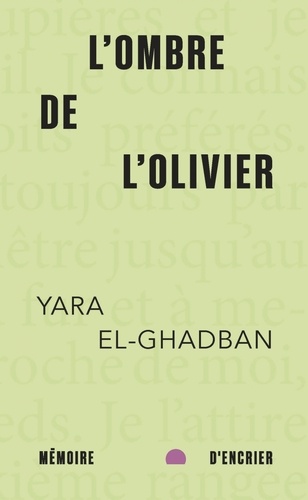
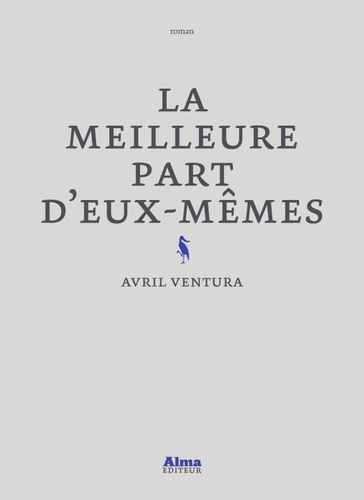
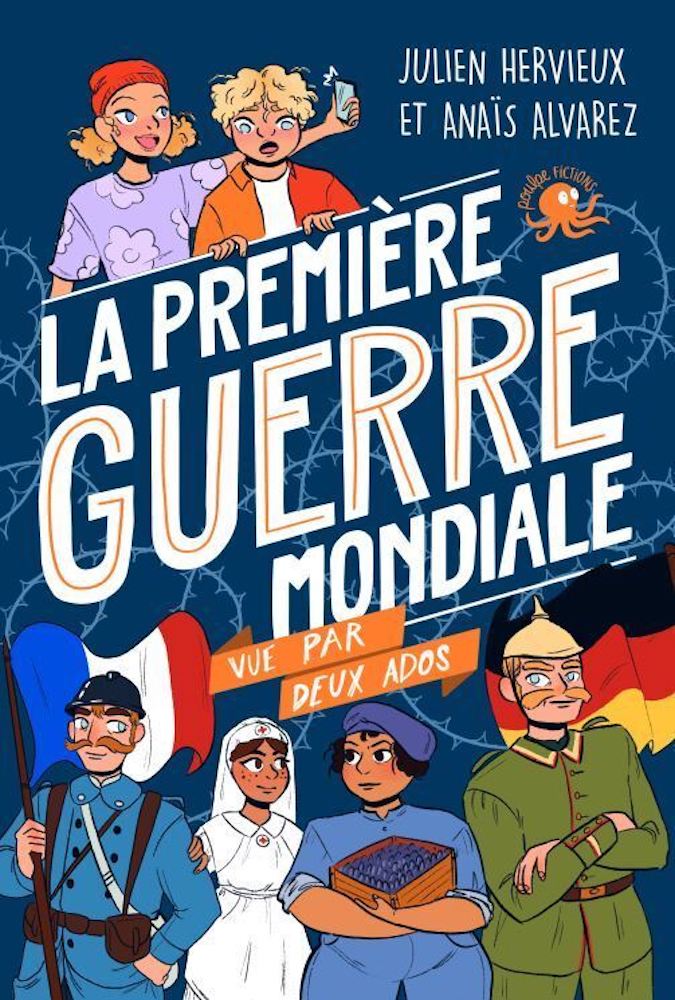
Commenter cet article