Mes fous, de Jean-Pierre Martin : en flagrant délire
ROMAN FRANCOPHONE – Depuis son autodissolution en 73, la Gauche prolétarienne, tel un Pôle Emploi révolutionnaire, a offert de belles reconversions. Il y eut Benny Levy (rabbin sartrien), Olivier Rolin (écrivain primé), André Glucksmann (père du fils), Gérard Miller (Grosse tête), Serge July (donneur d’avis), Alain Geismar (jospinien égaré) mais aussi : Jean-Pierre Martin, désormais universitaire et écrivain, qui sort un nouveau roman aux Éditions de l’Olivier (2020), intitulé Mes fous. Cours vite, camarade !
Le 27/10/2020 à 10:14 par Maxime DesGranges
1 Réactions | 1 Partages
Publié le :
27/10/2020 à 10:14
1
Commentaires
1
Partages
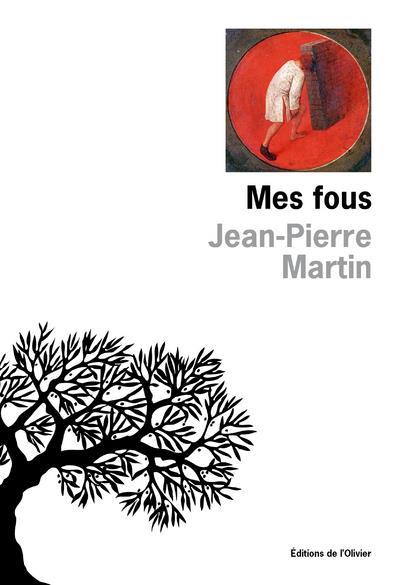
Tout compte fait, John Updike est un con. Dans ses 6 règles à suivre pour une critique constructive, la règle N°1 disait : « Essayez de comprendre ce que l’auteur a voulu faire, et ne l’accusez pas de ne pas avoir accompli ce qu’il n’a même pas voulu tenter. » Mais si, John, on peut accuser un auteur de tout un tas de choses, dont celle-ci. C’est d’ailleurs précisément la tâche que je m’apprête à exécuter sous tes yeux ébaubis, puisque je vais démontrer pourquoi, point par point, Jean-Pierre Martin (JPM) n’aurait pas dû écrire ce Mes fous-là, mais bien un tout autre Mes fous qui n’existera jamais.
Mais d’abord, la « 4 de couv’ ». Un quinquagénaire, Sandor Novick, est à la dérive : ses parents meurent après avoir sombré dans la démence, sa fille Constance est schizophrène, sa femme Ysé le quitte, ses trois fils, Adrien le geek autiste, Ambroise le militant écoradical, Alexandre le fils modèle que rien n’atteint, lui causent bien du souci. Victime de son empathie excessive et fasciné par la folie, Sandor se retrouve à côtoyer tous les fous qu’il croise dans les rues de la ville qu’il sillonne en tous sens, et en tire une galerie de portraits qu’il colle dans son « herbier psychotique ».
Un roman à l’essai
Point par point, disais-je. Pour commencer, JPM n’aurait pas dû adopter la forme romanesque mais plutôt celle de l’essai, à la manière de son remarquable Livre des hontes (2006, Seuil). C’est d’ailleurs un essai que je m’attendais à recevoir après avoir demandé Mes fous à l’auguste et vénérable rédaction d’ActuaLitté. « Quel toupet ! » penseront sans doute les lecteurs et les lectrices circonspects et circonspectes, et pourtant je parie que JPM lui-même est d’accord avec moi, au fond de son petit coeur, même s’il préfèrera probablement s’en tenir à la chronique pleine de sucre que Camille Laurens lui a consacré dans Le Monde.
Lisez-le vous-même : tout au long du roman la forme essayistique démange son auteur. Chassez le naturel universitaire il revient au galop académique. Le narrateur, Sandor, a beau travailler dans une entreprise où l’on parle de « challenge », de « soft skills », de « feed-back » et de « talent management », il profite de son récent chômage pour écumer les colloques universitaires sur la littérature (et un peu la folie, c’est vrai), et ne rêve que d’écriture (et de pouvoir jouer Schumann au piano).
En filigrane, ce sont bien les lectures de JPM qui, quand on connaît un peu le bougre, se retrouvent finalement au centre des recherches de Sandor, desquelles émergent des références de prestige : Wittgenstein, Fitzgerald, Foucault, Michaux, Ginsberg, Artaud, Burroughs, De Quincey, Althusser, Debord, Mandelstam, Cendrars, Hölderlin… Pourquoi ne pas leur avoir donné toute la place qu’ils méritaient en leur consacrant un bel essai dans le plus pur style Martinien, c’est-à-dire accessible, enlevé, érudit et pertinent, plutôt que de nous faire croire qu’un Manager de la France jusqu’à la Navarre aurait le temps et surtout la volonté de se plonger dans le Tractatus logico-philosophicus entre deux brainstormings ?
On devine notamment que l’essai le gratouille et le chatouille quand JPM, las de ses propres personnages, développe enfin l’histoire de Romain Gary et son grand amour schizophrène Ilona Gesmay, puis celle d’André Breton et sa fameuse Nadja, ou bien celle encore du trop peu connu Robert Walser qui, interné en psychiatrie, aurait prononcé cette belle phrase : « Je ne suis pas ici pour écrire, je suis ici pour être fou ». C’est ce que fait magnifiquement JPM dans son Livre des hontes et aussi, si mes souvenirs sont bons, dans son excellent Éloge de l’apostat (2010, Seuil), qui dessinent en creux le parcours tortueux de l’auteur, interrogent ses revirements (ou « l’aventure extraordinaire de se préférer autre », citant Robert Antelme), tout cela en convoquant les grands écrivains qui l’ont aidé à éclairer ses questionnements existentiels. Pourquoi n’avoir pas continué dans cette veine en nous livrant un texte passionnant sur « ses » fous littéraires, pour reprendre à sa façon le flambeau de Raymond Queneau ?
Certes, Sandor assure que « ce n’est pas sur Ilona, Hölderlin, Walser, Nadja, pas même sur les corps errants que je voudrais écrire. C’est sur Constance. Je voudrais écrire l’impossible roman de Constance. » Soit, très bien, mais dans ce cas : où est Constance ? Nulle part. Et c’est bien le problème.
Pas assez, c’est trop peu
Constance, censée être la figure centrale du roman, préoccupation principale de Sandor, n’est guère plus qu’un fantôme, son personnage est à peine esquissé, et le narrateur peut répéter autant qu’il veut que le souci de Constance le réveille la nuit, que Constance le hante, que Constance le fait pleurer chaque jour, ça ne suffit pas à rendre réel un personnage qui aurait pu être très beau, sa relation au père profonde et touchante, si précisément JPM avait été romancier, ce qu’il n’est pas, et ce n’est pas lui faire injure que de l’affirmer.
À y réfléchir, Jean-Pierre Martin est trop sain d’esprit pour écrire un roman sur la folie. De la même manière qu’aucun musicien amateur n’est jamais assez « creep » ni assez « weirdo » pour reprendre le morceau de Radiohead sans en trahir le sens. Les fous sont partout dans Mes fous, dans la rue, le métro, à la campagne et à la ville (une ville de fous que je connais bien puisque JPM et moi avons visiblement arpenté les mêmes rues des mêmes quartiers, Croix-Rousse, les Pentes, la Presqu’île, les quais) et pourtant à aucun moment la folie n’est palpable pour le lecteur sauf peut-être – c’est un comble – dans l’extrait d’un forum sur la schizophrénie recopié in extenso par le narrateur, mauvaise orthographe incluse. Mais c’est trop peu.
JPM n’a pas non plus jugé nécessaire d’explorer les possibilités narratives qui s’offraient à sa propre imagination. Au début du roman, Sandor emménage dans un appartement ayant été occupé avant lui par un psychiatre dont la plaque n’a pas été enlevée. Des patients se présentent à lui en pensant avoir affaire à un remplaçant. Intrigue potentielle prometteuse ! Elle ne sera pas exploitée.
Autre exemple, autre déception : Sandor, qui a « tendance à voir la folie partout » et qui s’inquiète lui-même de sombrer dans la folie (« Je me sens trop vulnérable. Je crains la contagion, la chute mentale imprévisible, le basculement psychique. Je dois faire partie des âmes faibles. »), nous donne l’impression, au fil des portraits de fous qui se succèdent, que le fou c’est peut-être bien lui. On s’attend alors à un basculement imminent qui nous ferait voir le monde de Sandor sous une perspective différente : qu’est-ce qu’être fou, qu’est-ce qu’être sain d’esprit ? Le fou était-il vraiment celui que l’on croyait ?
C’est ce qu’arrive à faire à la perfection Lázló Krasnahorkai dans Guerre et guerre : son fou à lui est tellement atteint, tellement convaincant, que le lecteur en vient à se demander s’il ne serait pas un prophète incompris par les idiots que nous serions. Dans Mes fous, rien de tout ça malheureusement, mais une simple galerie de portraits gentillets sans développement, sans fil conducteur, sans véritable ambition ni progression, et finalement sans profondeur.
Pas plus haut que le bord des choses
Les manquements au devoir romanesque sautent définitivement aux yeux quand on se penche sur la relation de Sandor avec sa femme Ysé, dont le départ a provoqué en partie sa détresse psychique. À un moment, oh joie, Sandor et Ysé doivent traverser le pays ensemble pour chercher Constance. Épisode expédié en quelques phrases laconiques : « Ysé m’a dit : "Il faut qu’on aille tous les deux la chercher, ça la rassurera." Mon cœur s’est soulevé de reconnaissance. Nous sommes partis en voiture la retrouver. Voyage étrangement tendre entre nous. Au retour, quand il a fallu ramener notre fille, ça a été une autre affaire. » Non seulement on ne saura rien sur la tendresse du voyage et son étrangeté, mais on n’en saura pas davantage sur l’ « autre affaire » du retour avec Constance. En fait, on ne sait jamais rien sur quoi que ce soit.
Cette impression de lire la déposition d’un rapport de police tapé à deux doigts se renouvelle dans le train du retour après une visite de Sandor et Ysé chez leur fils Alexandre : « Pendant le voyage, avec Ysé, nous avons parlé paisiblement, évoqué des souvenirs. À un moment, on s’est tenu la main. On a pleuré. » Que d’émotion ! Quelle écriture virtuose ! J’imagine, allons-y, Crime et châtiment réécrit par nos auteurs contemporains : « J’ai tué la vieille usurière et sa sœur. Puis j’ai jeté les bijoux dans la Volga. Ensuite, j’étais chez moi. À un moment, Sofia est arrivée. On a évoqué quelques sujets. J’avais de la fièvre. Puis la Sibérie. »
J’ai beau être Martinal, j’ai mal
Voilà encore un point pour lequel Jean-Pierre Martin aurait dû résister à l’appel du roman : le style. Tenez. J’ouvre au hasard le Livre des hontes que j’ai sous la main. Voilà des phrases qui, à mes yeux, ont une certaine tenue, un rythme, une consistance, une matière : « Regardez-les, ces grands dadais, ces grandes gigues, ces petits gros, ces visages rougissants, ces gamines mal dans leur peau. Ils, elles ne savent que faire de leurs bras, sont engoncés dans leurs vêtements, traînent les jambes, émettent des bredouillis. Un corps maladroit et gauche qui pousse de partout malgré soi, des seins qui surgissent, mal à l’aise d’être là, sous les regards indiscrets, l’apparition des règles qui se vit comme une souillure : c’est un âge boutonneux et mal dégrossi, bourgeonneux, turgescent et pubescent, tributaire comme jamais du langage des autres comme de leur regard, où le rougissement a gagné en gravité (l’enfant qui rougit est encore charmant, l’adolescent qui rougit commence à payer le prix de ses hontes puériles), où les mots des autres vous offensent et vous emprisonnent – la godiche, le puceau, la grande bringue, le pot, le boudin, le mal attifé, le binoclard, le gros, le racho… »
Ça ressemble à ce qu’on appelait, à une époque, un style. Or, dans Mes fous, Jean-Pierre Martin semble avoir été atteint lui aussi par la pandémie de ponctuation qui fait des ravages dans la littérature française depuis des années maintenant. Prenons quelques passages symptomatiques de la maladie : « Aujourd’hui, une carte de Rachel. Elle est au Bahamas. Avec Maginot, j’imagine. Carte très sobre, très conventionnelle. Où est sa drôlerie ? Où est son cynisme ? Elle est rentrée dans le rang. Son psychiatre l’a recadrée. » Je trouve ici que l’auteur a été trop prolixe, trop exubérant. Essayons de faire plus sobre : « Carte de Rachel. Bahamas. Avec Maginot. Sobre, conventionnelle. Drôlerie ? Cynisme ? Rentrée dans le rang. Recadrée. » Voilà qui est plus digeste pour le lecteur à l’estomac décidément trop sensible.
Le douanier de la Belle Prose que je suis peut encore laisser passer sous son radar des petites phrases de contrebande comme : « Il me l’a fait louper, putain de bordel de merde » ou bien : « Ça caillait ». Mais comment un pianiste de Jazz et lecteur averti de Céline comme JPM peut-il ne pas se rendre compte du manque d’élan, de variations, de musicalité, bref comment peut-il se satisfaire de ces phrases construites à la chaîne comme les barres d’immeubles d’une cité dortoir : « Un homme qui pleurait. C’était touchant. Il était dévasté. Il bafouillait dans ses larmes. Ses phrases étaient difficiles à comprendre. En fait, il était révulsé de colère. Une mousse sortait de sa bouche à chaque phrase. Il pleurait de rage. Je n’arrivais pas à comprendre ce qu’il disait, la raison de son gros chagrin. Je lui ai posé des questions pour élucider un peu l’énigme. J’ai fini par comprendre. Il ne pouvait plus s’adresser aux petites filles comme il le voulait, maintenant. Il aimait tant parler aux petites filles. » Littérature de marteaux-piqueurs ! « Aaaaah c’est rare un style monsieur ! », disait Céline dans une célèbre interview télévisée. Comment lui donner tort.
Inconstance de Constance
J’ai bien compris que Sandor n’était pas destiné à sombrer lui-même dans la folie et qu’il ne cherchait à côtoyer la folie des autres que pour « tenter d’approcher l’énigme Constance ». Mais plutôt que de résoudre cette énigme, plutôt que de s’y plonger complètement, JPM démissionne de son propre sujet et l’abandonne en cours de route, délaissant le lecteur du même coup. Sandor : « Moi, j’aimerais pouvoir sauver Constance. Constance et tous mes fous. » Mais qui Sandor cherche-t-il à sauver sinon lui-même ? Si le sort de Constance ne l’intéresse pas, qu’il la confie au moins au lecteur !
Car survient notre dernière déception quand JPM évacue brutalement Constance en l’échangeant contre Ambroise le fils écoradical, sans autre justification qu’un besoin de trouver une cheville narrative pour passer de la folie des villes à la folie des champs. D’un coup : « Je suis prêt à tout pour plaire à Ambroise », « Ambroise, c’est un peu moi », « Ambroise serait fier de moi. Je pense souvent à lui. Le souci d’Ambroise me fait diversion. Il a pris le pas sur celui de Constance. Il est nettement moins désespéré. Je me dis : Au fond, j’ai un ami, c’est Ambroise. » Et le lecteur qui se demande ce que devient la pauvre Constance, dans tout ça ? Qu’il se rassure, elle est sauvée : « Un nouvel antipsychotique la stabilise. » Fin. Littéralement.
Jean-Pierre Martin - Mes fous - L'Olivier - 9782823616644 - 17 €
Dossier : Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite
Mes Fous
Paru le 27/08/2020
153 pages
Editions de l'Olivier
17,00 €



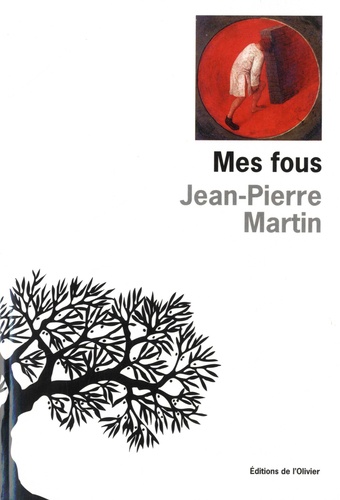
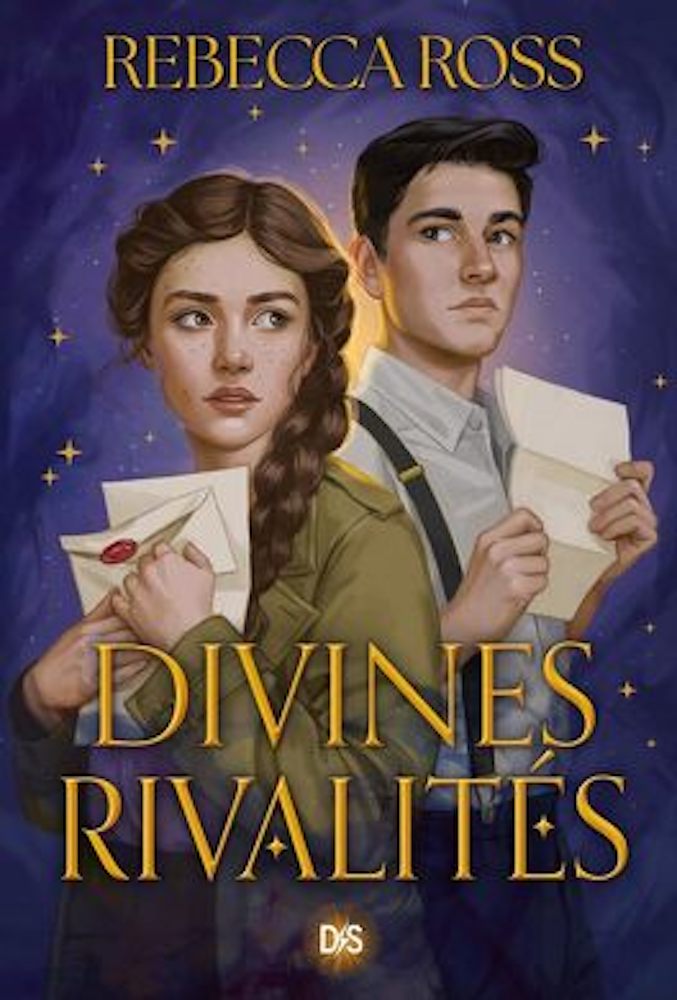
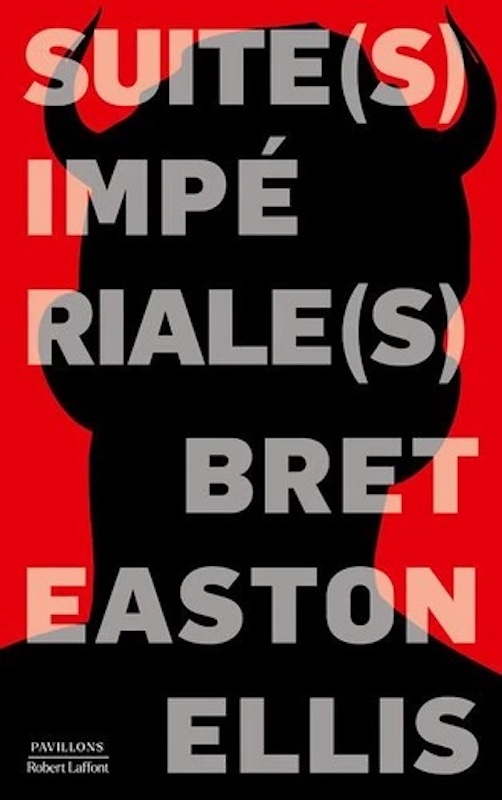
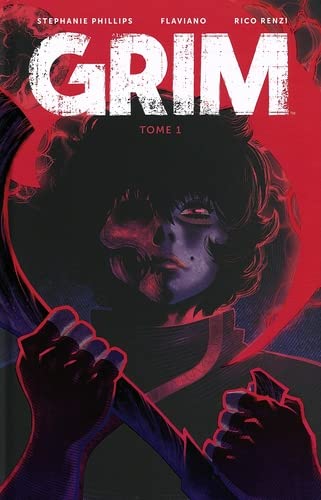
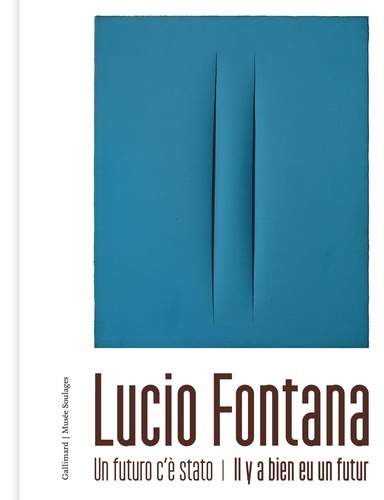
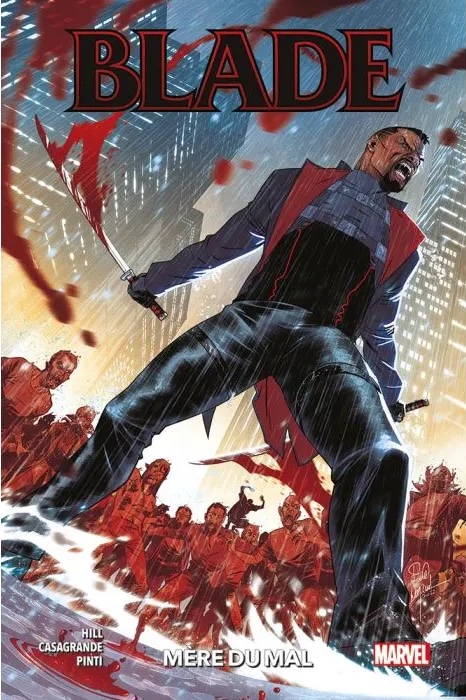
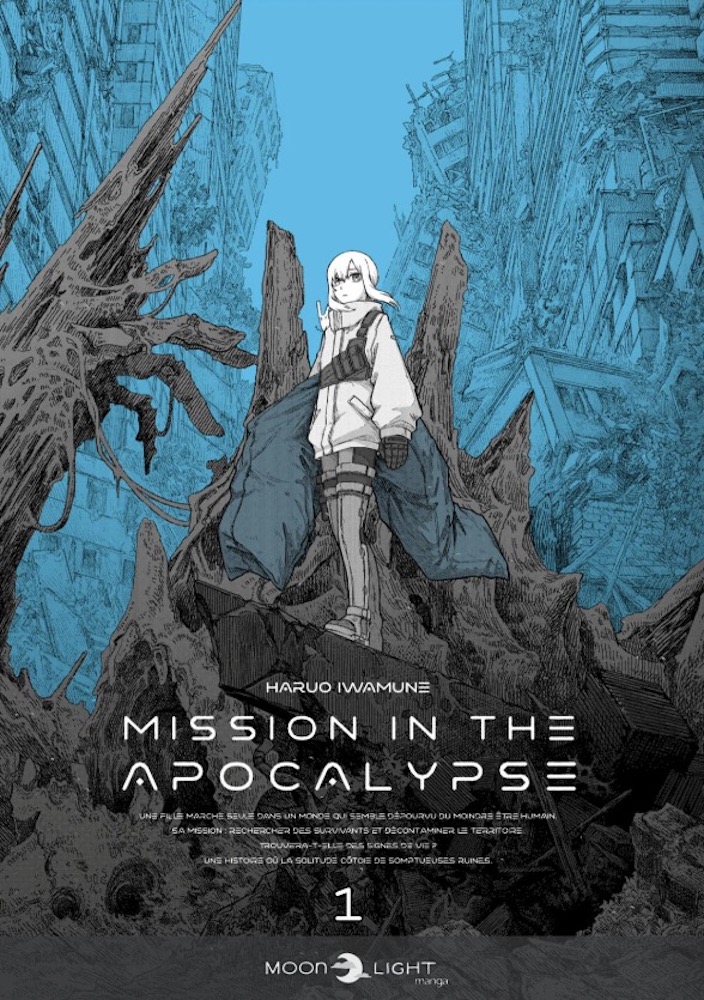
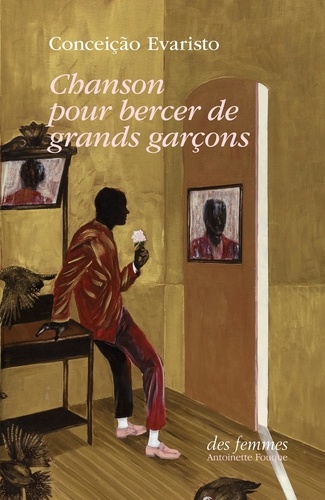
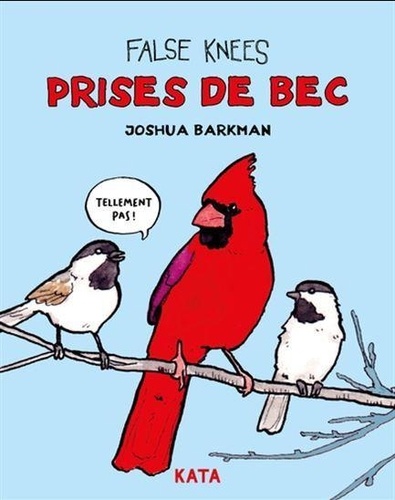
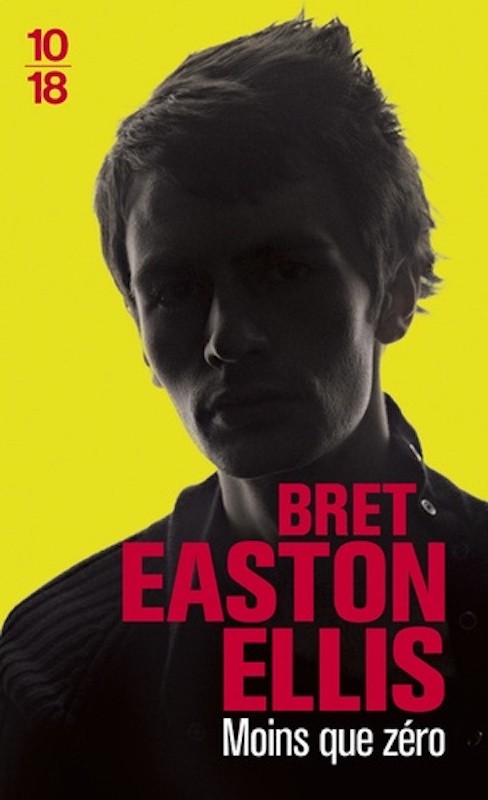
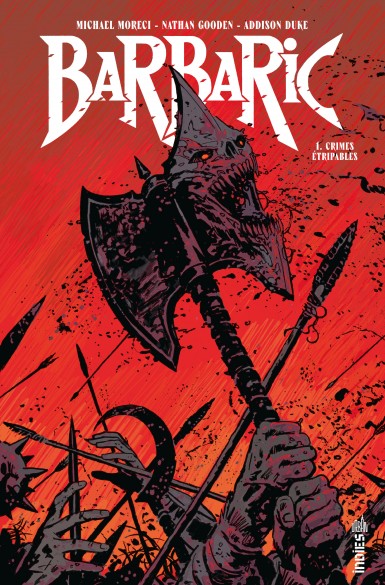
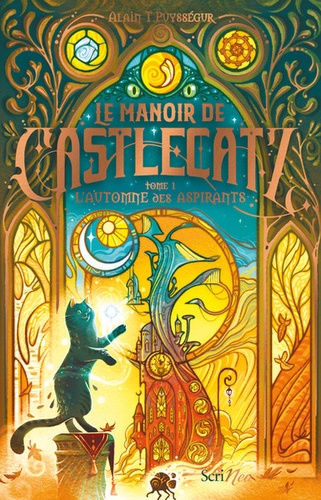
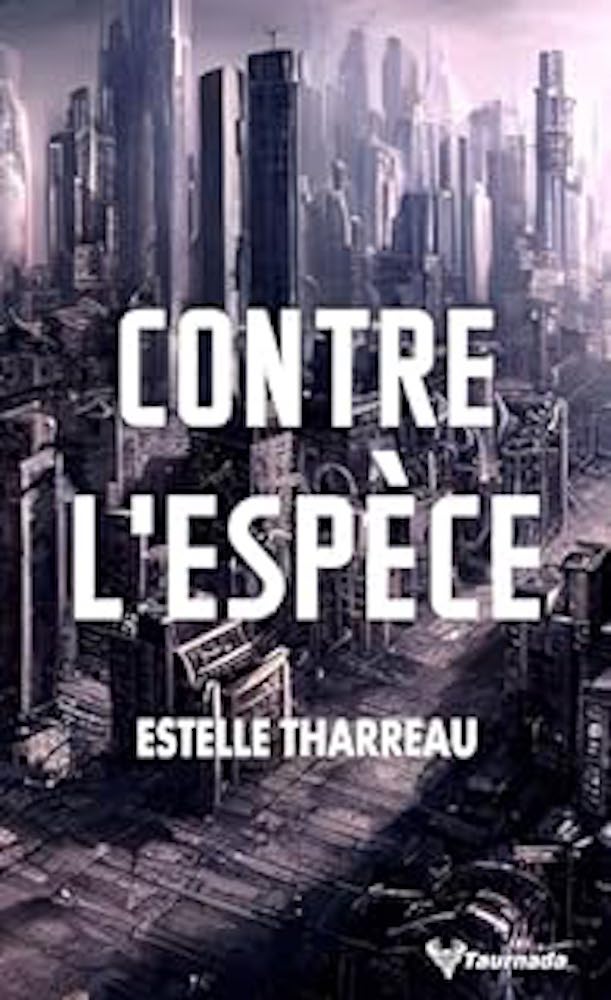
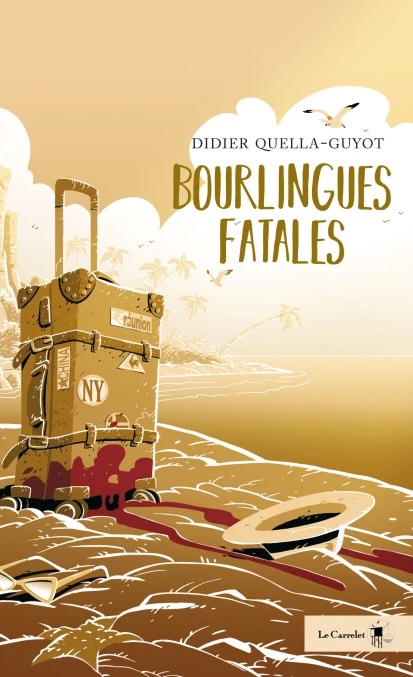
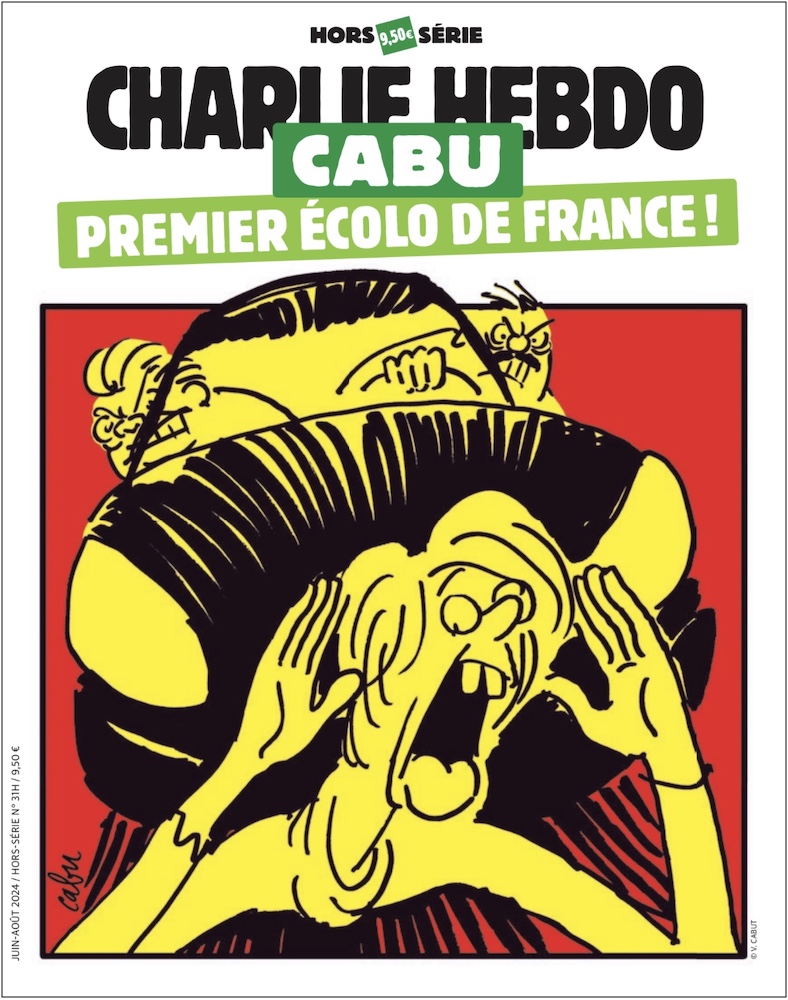
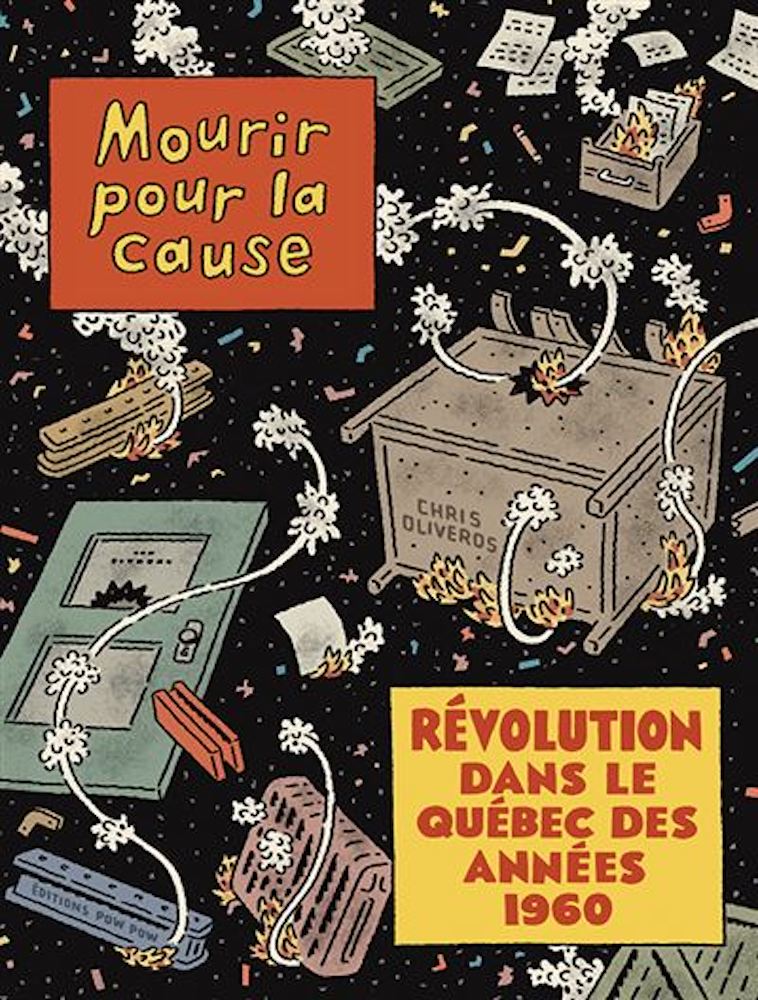
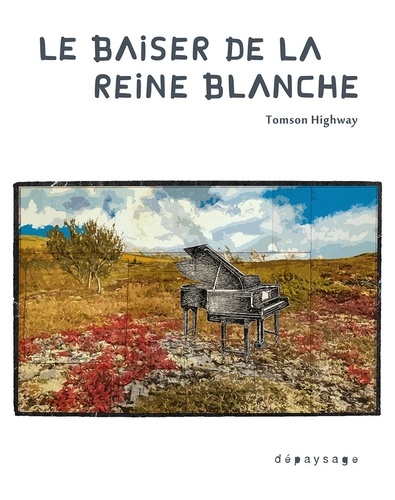
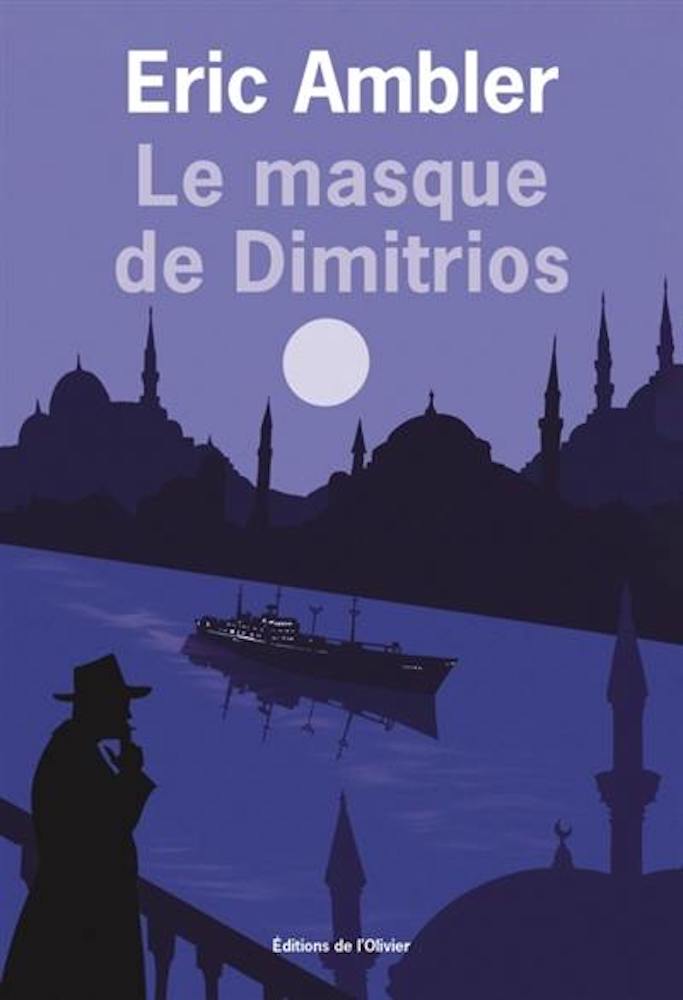
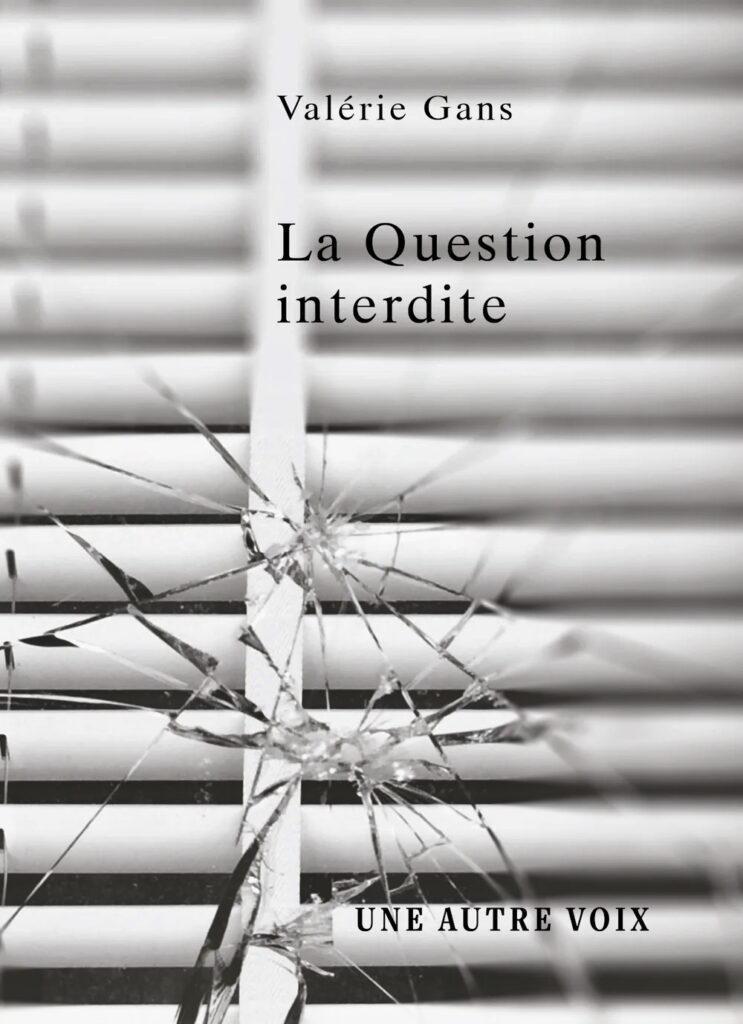
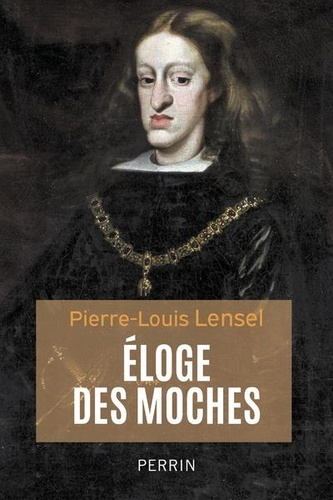
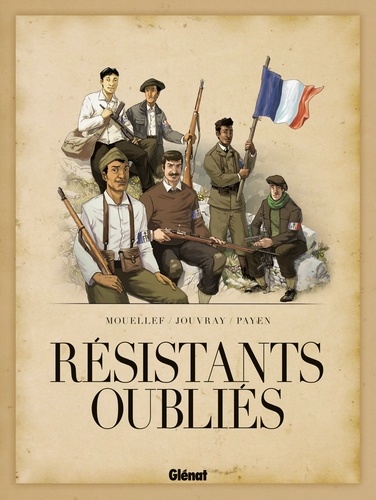
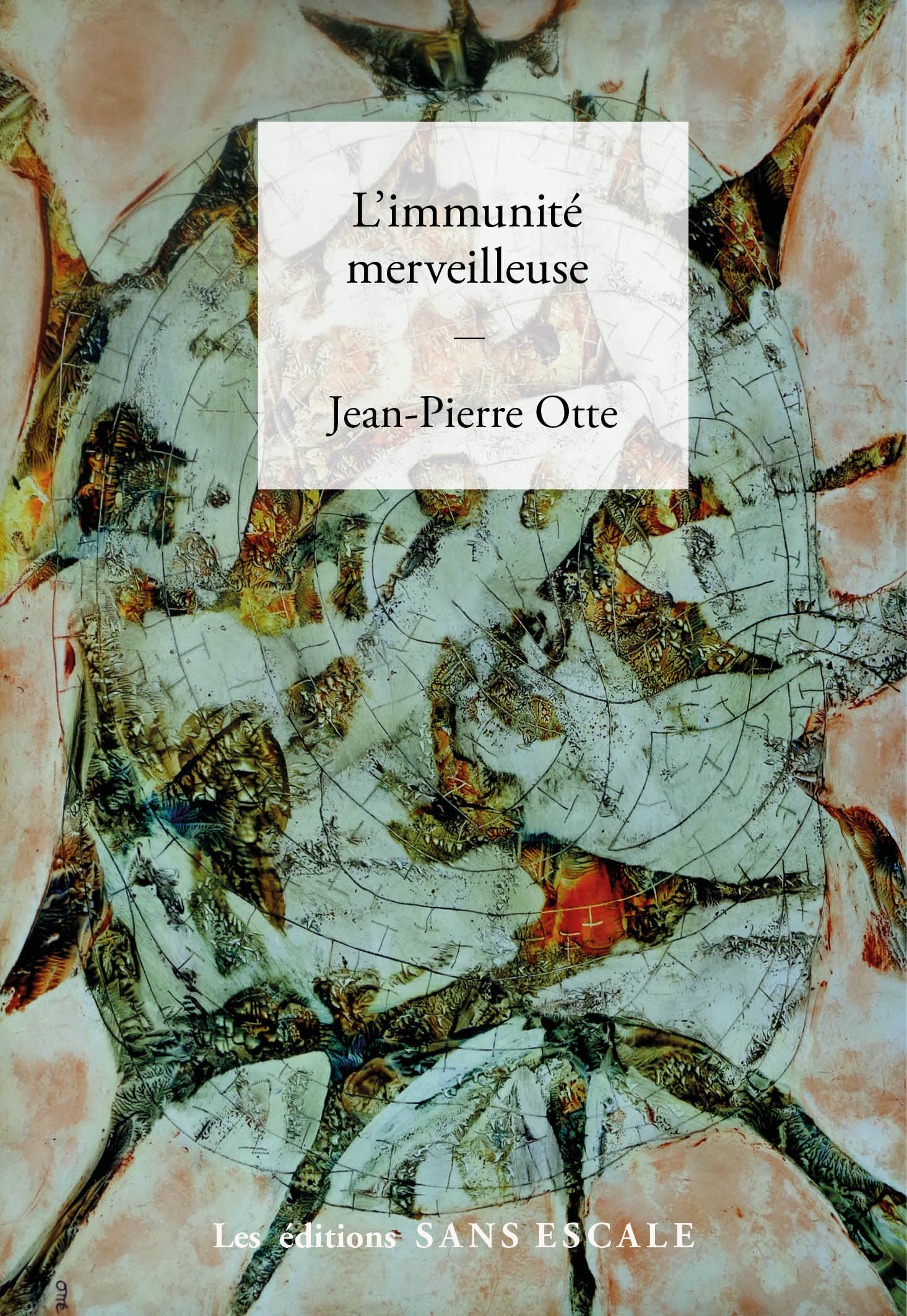
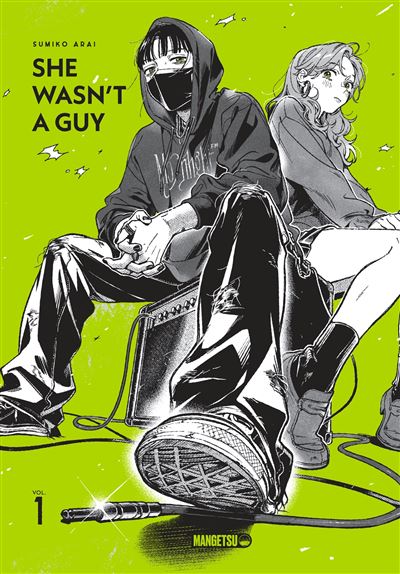
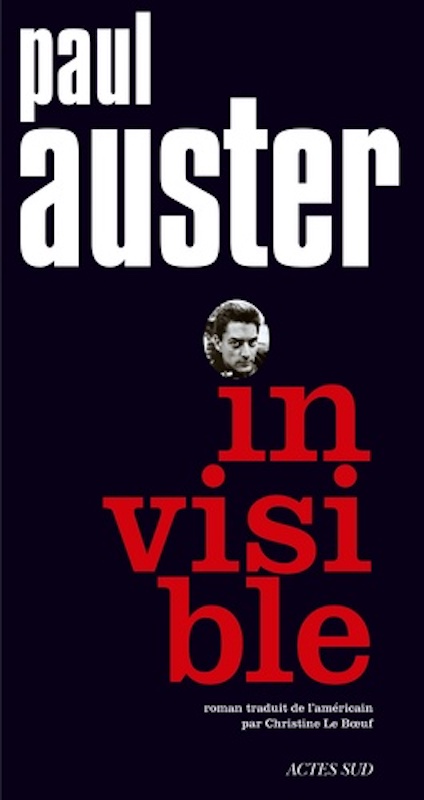
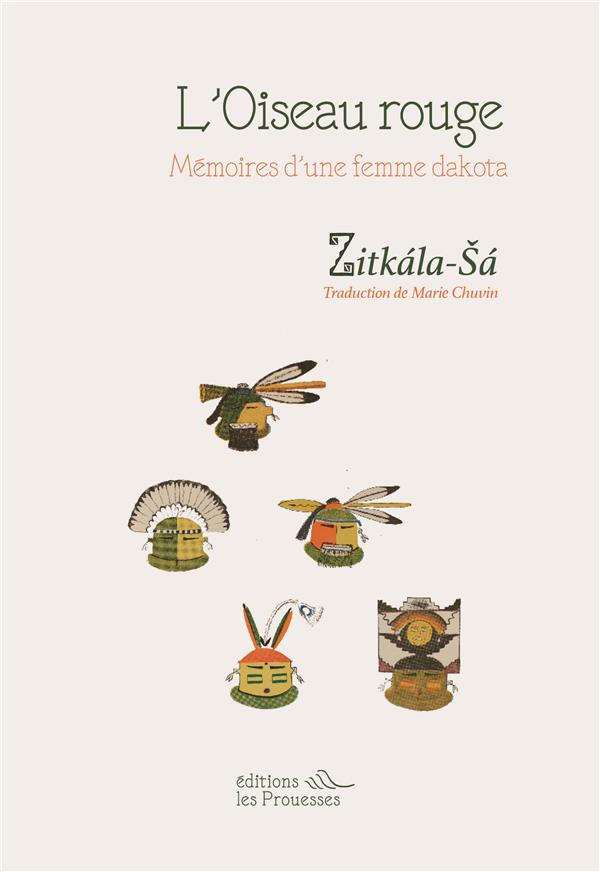
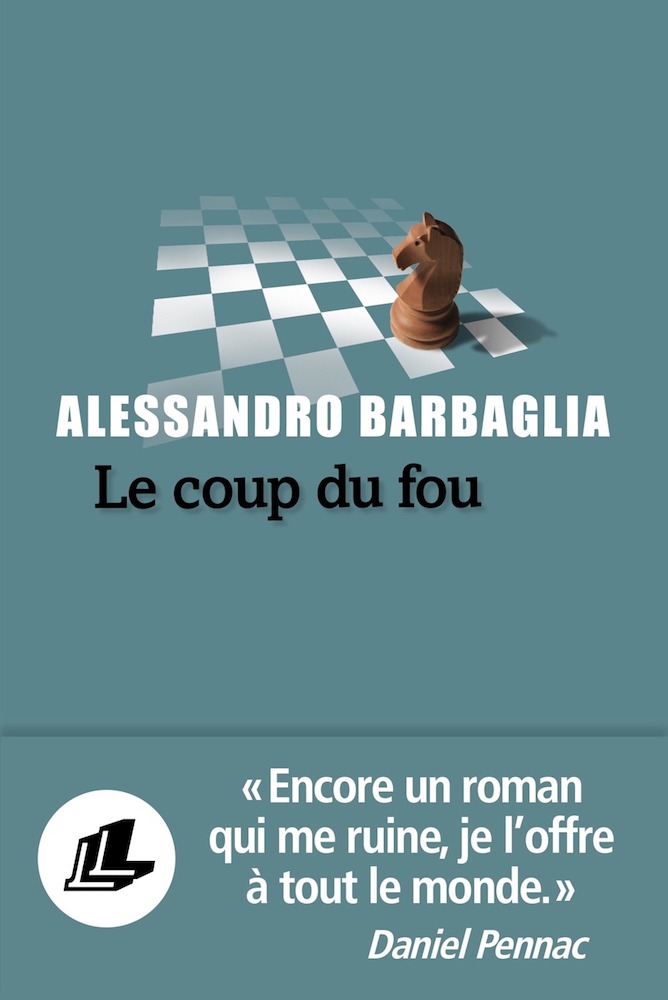
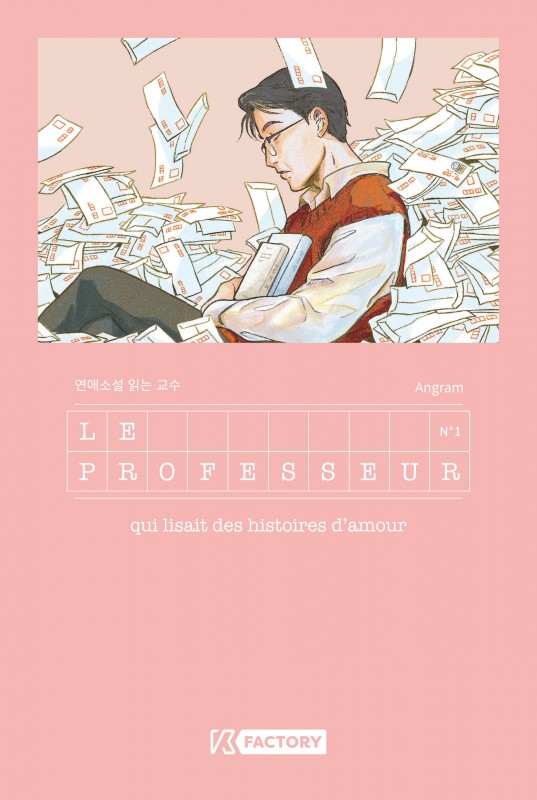
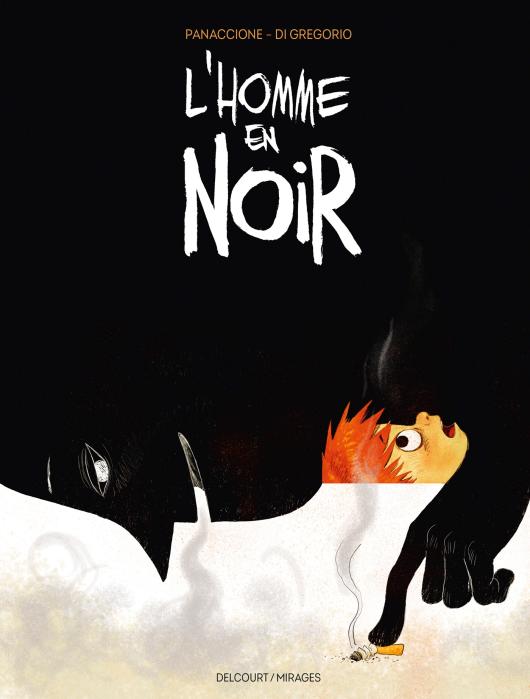
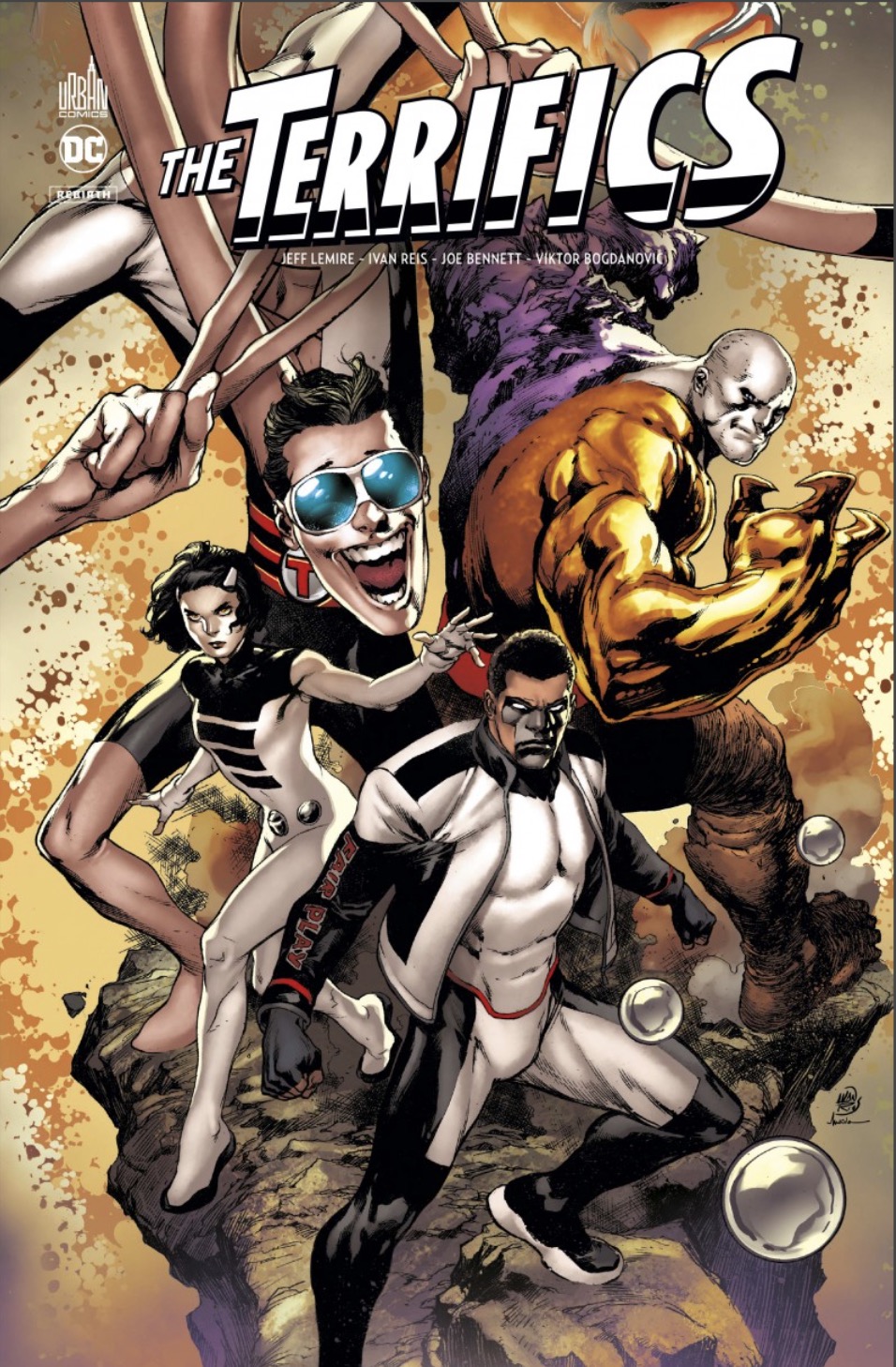
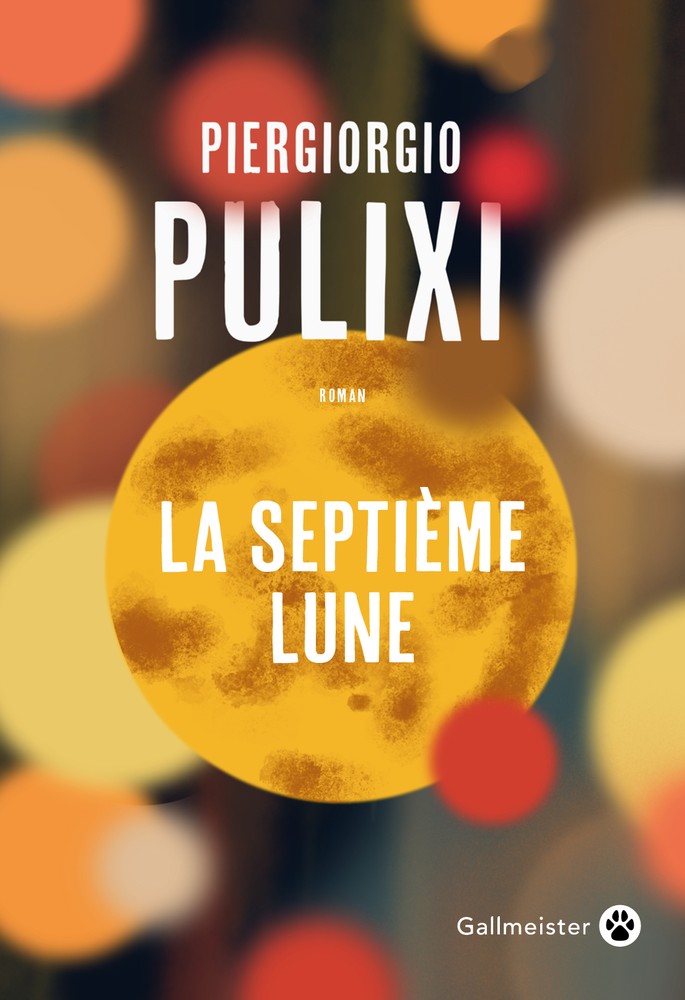
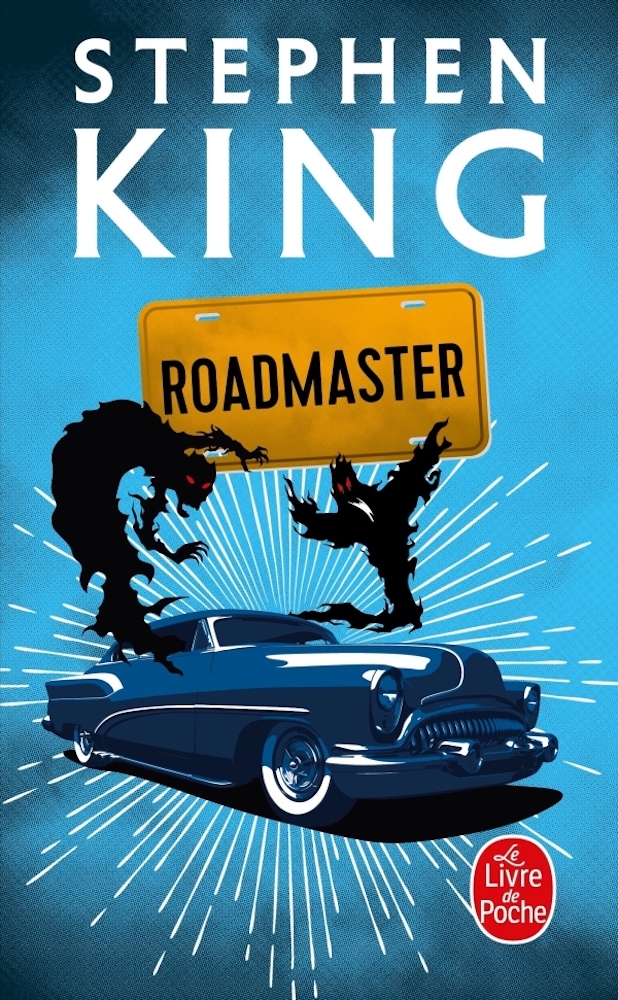
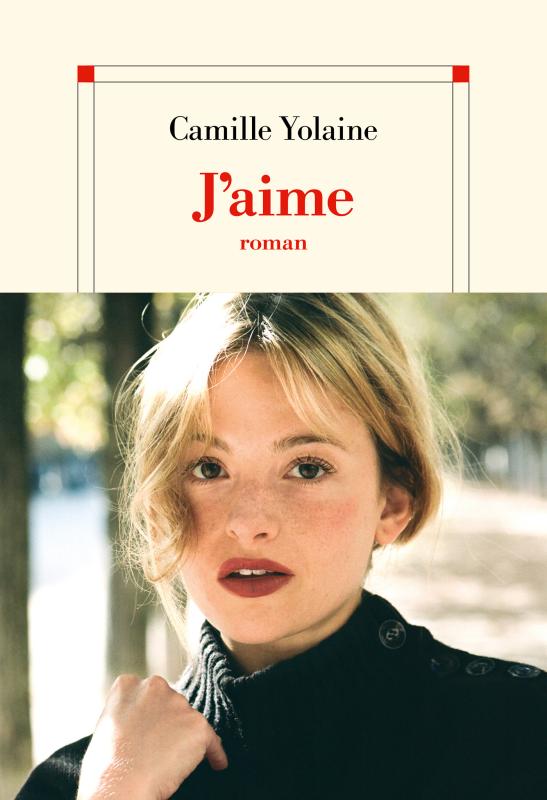
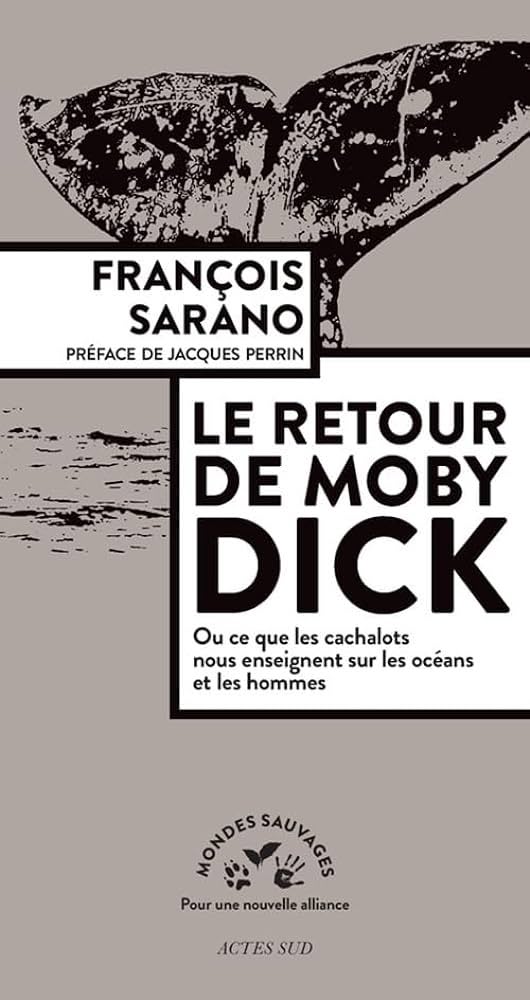
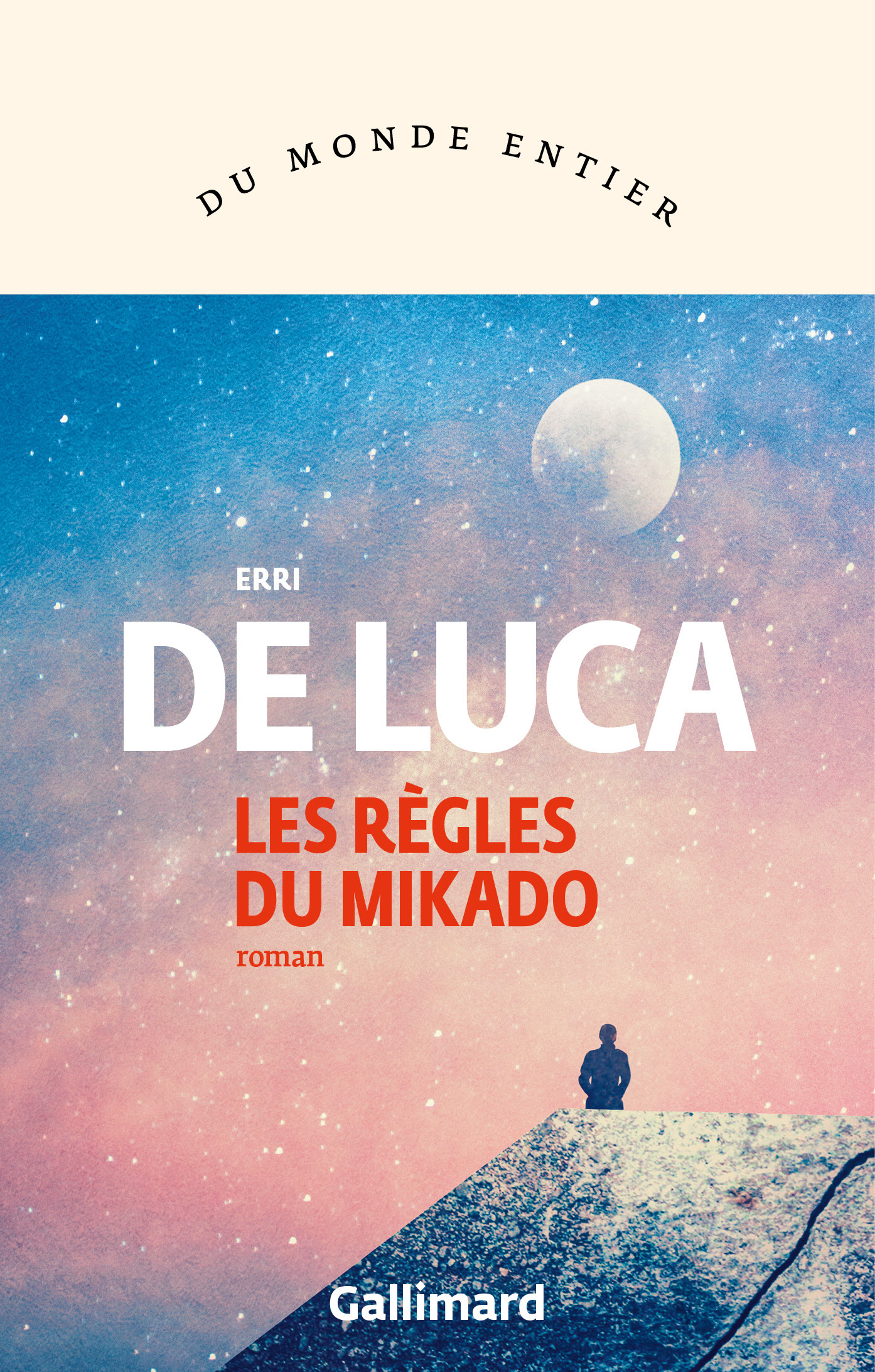
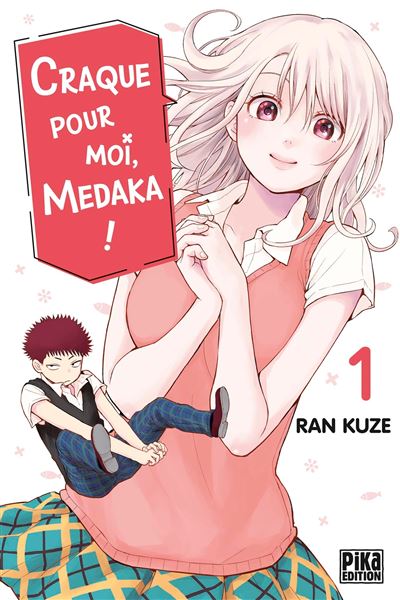

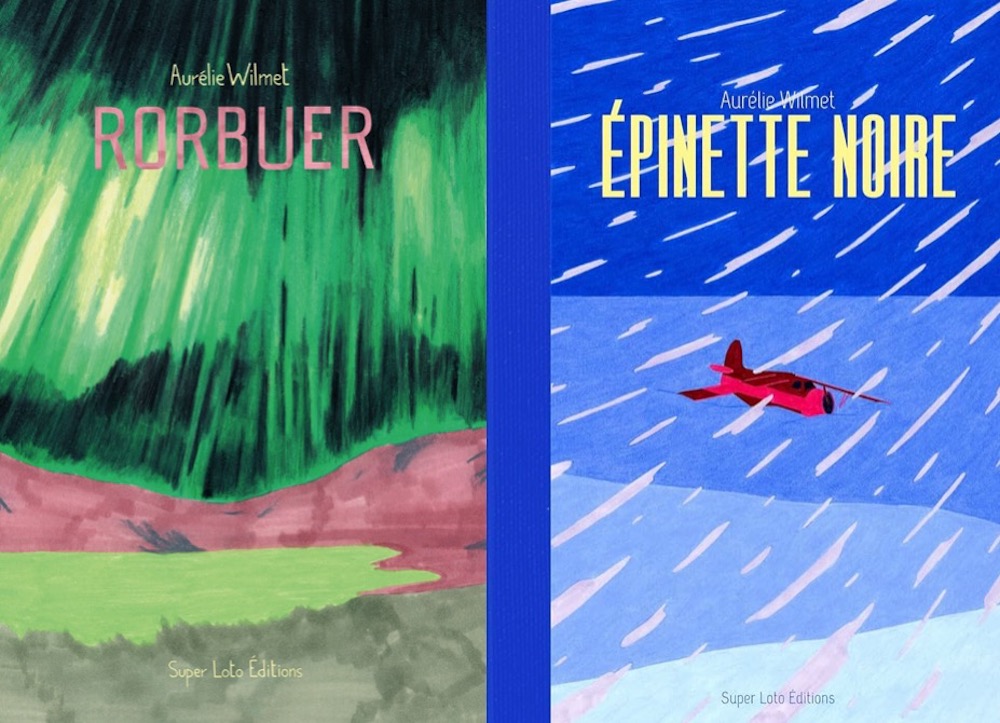
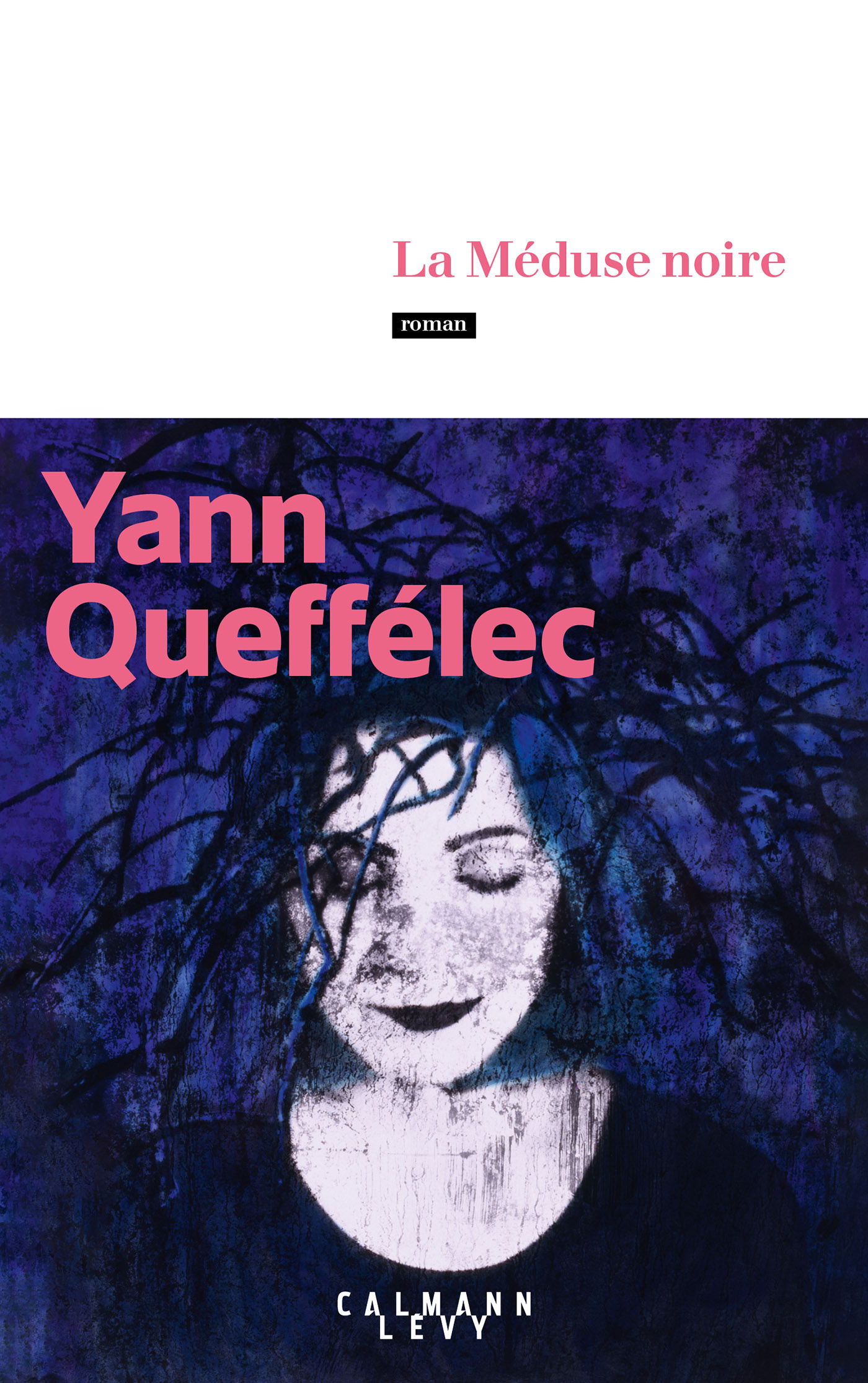
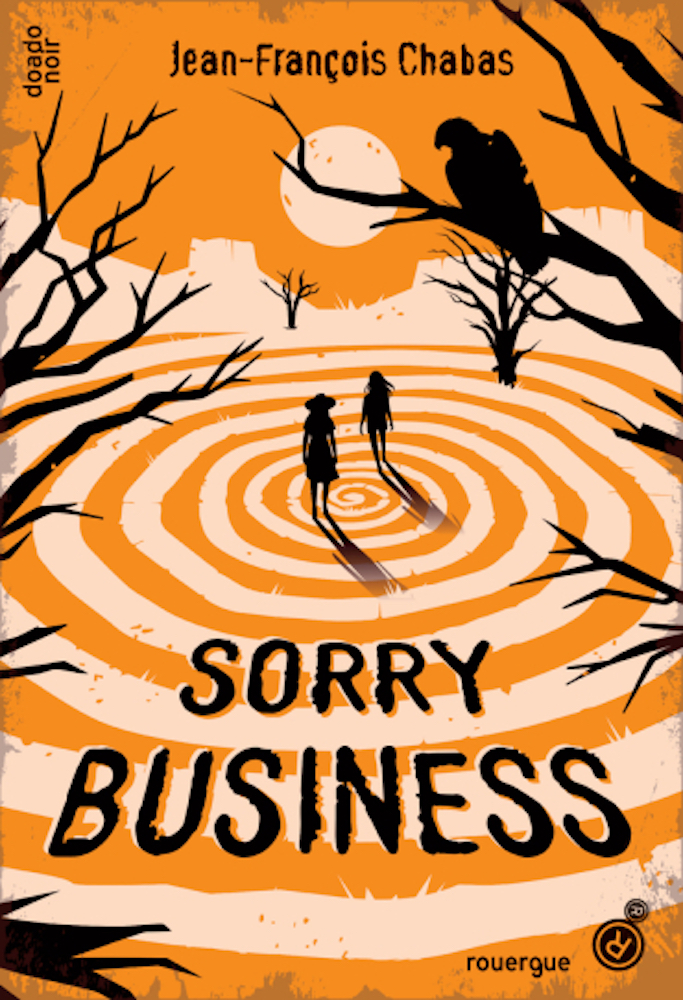
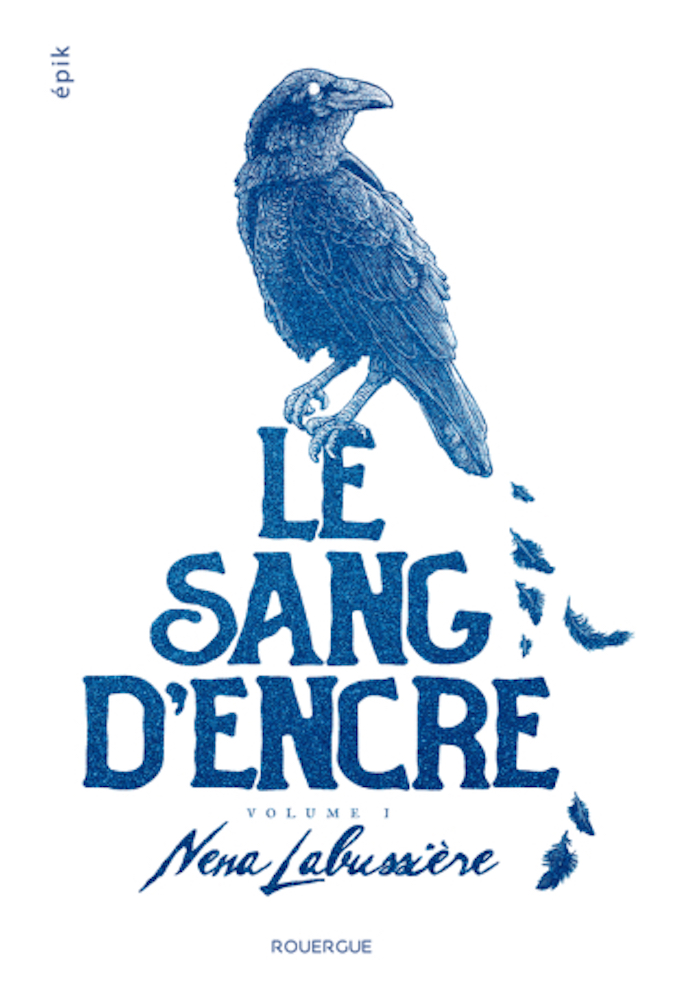
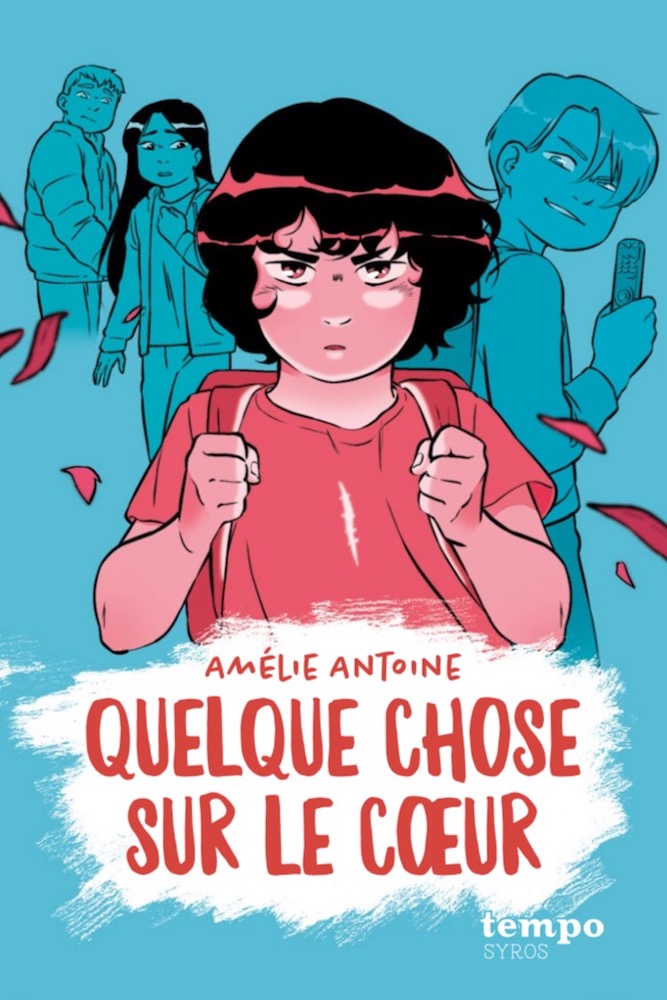

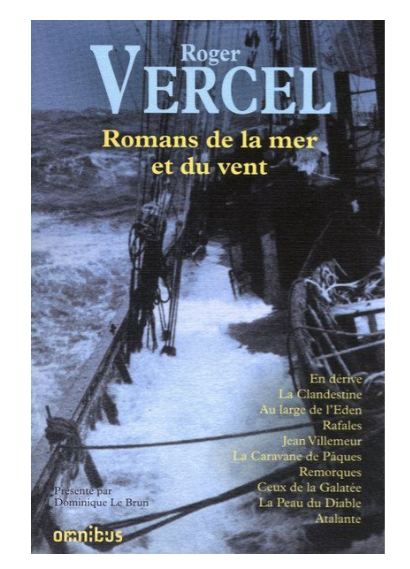
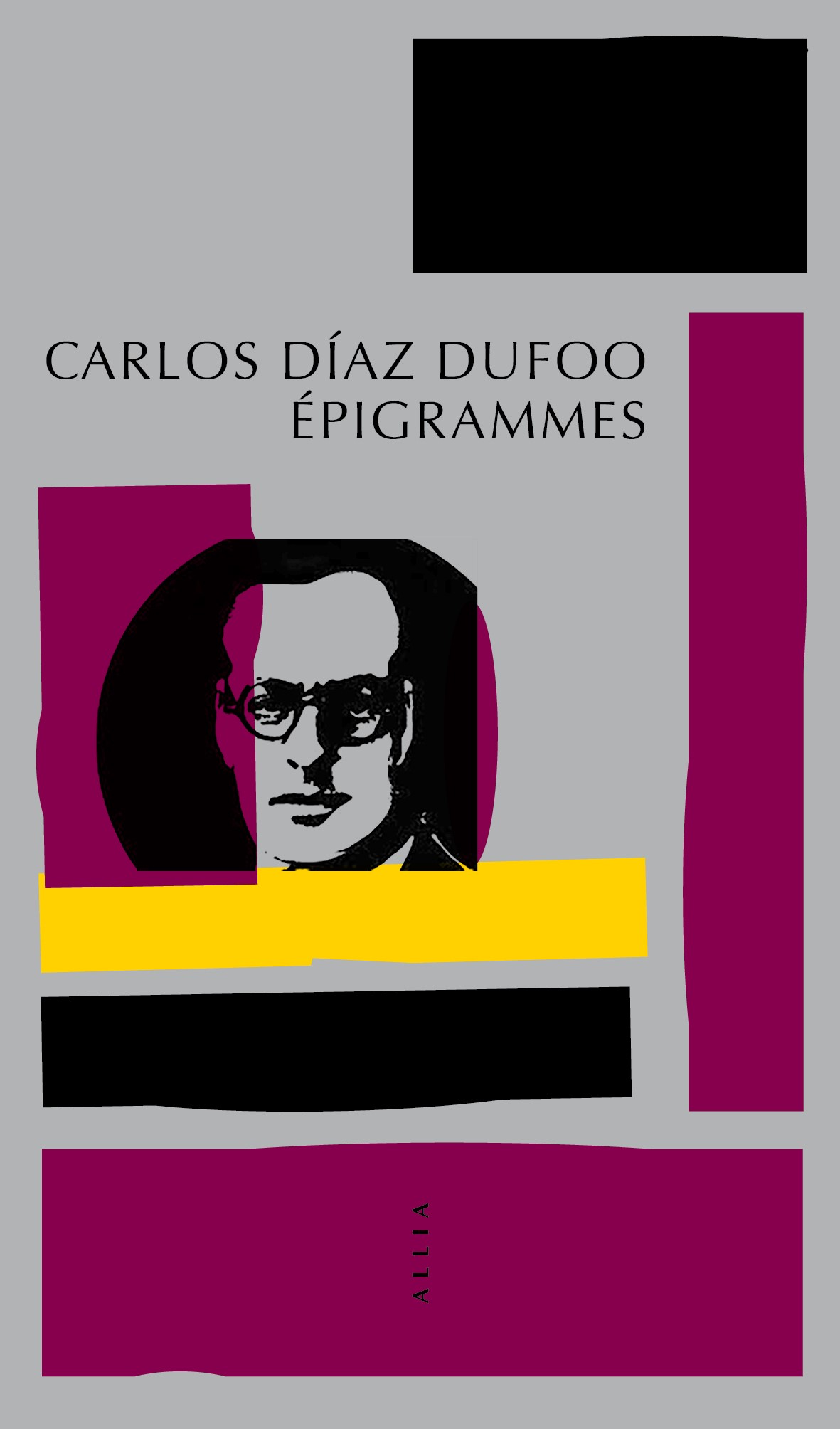
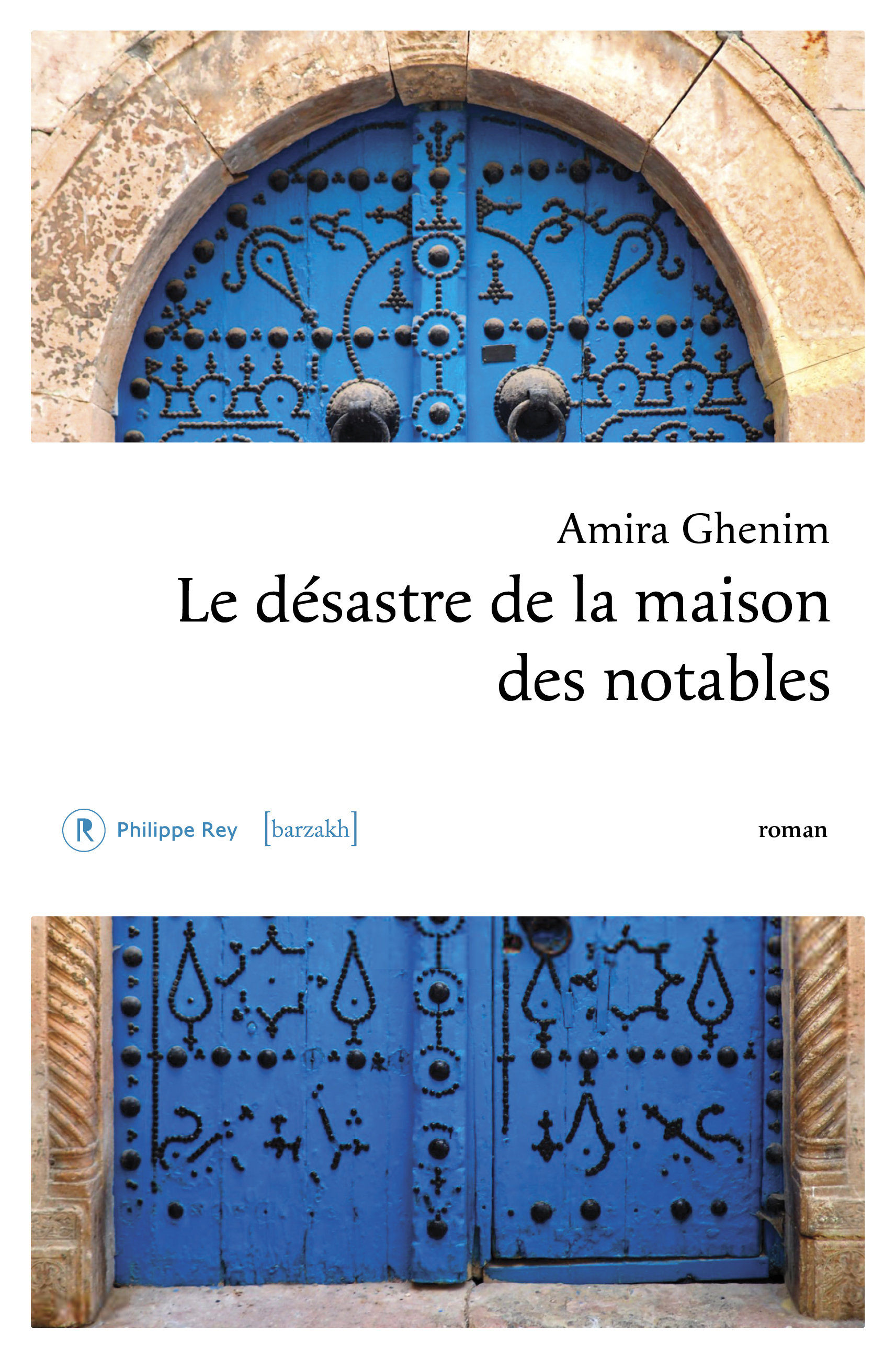
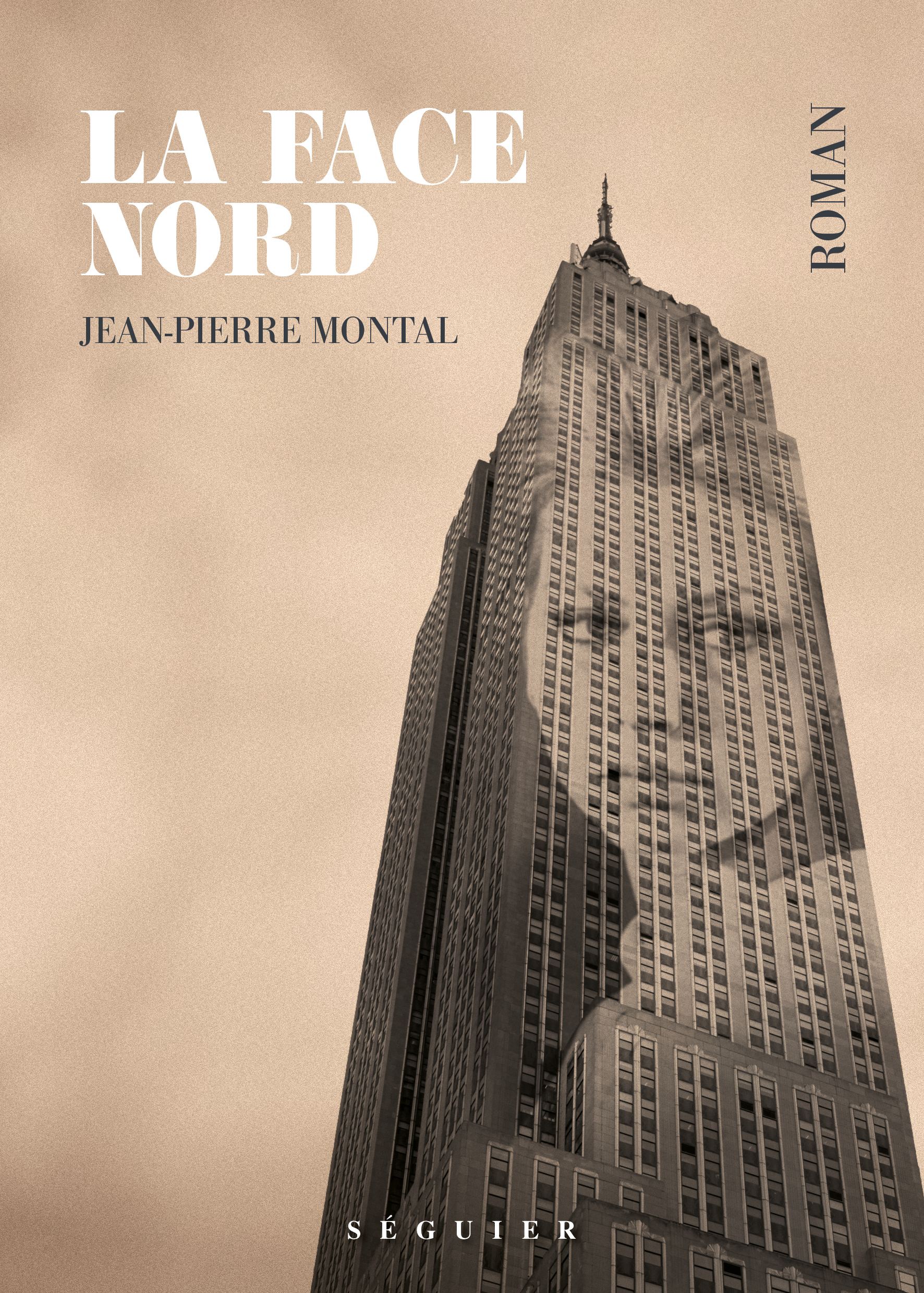
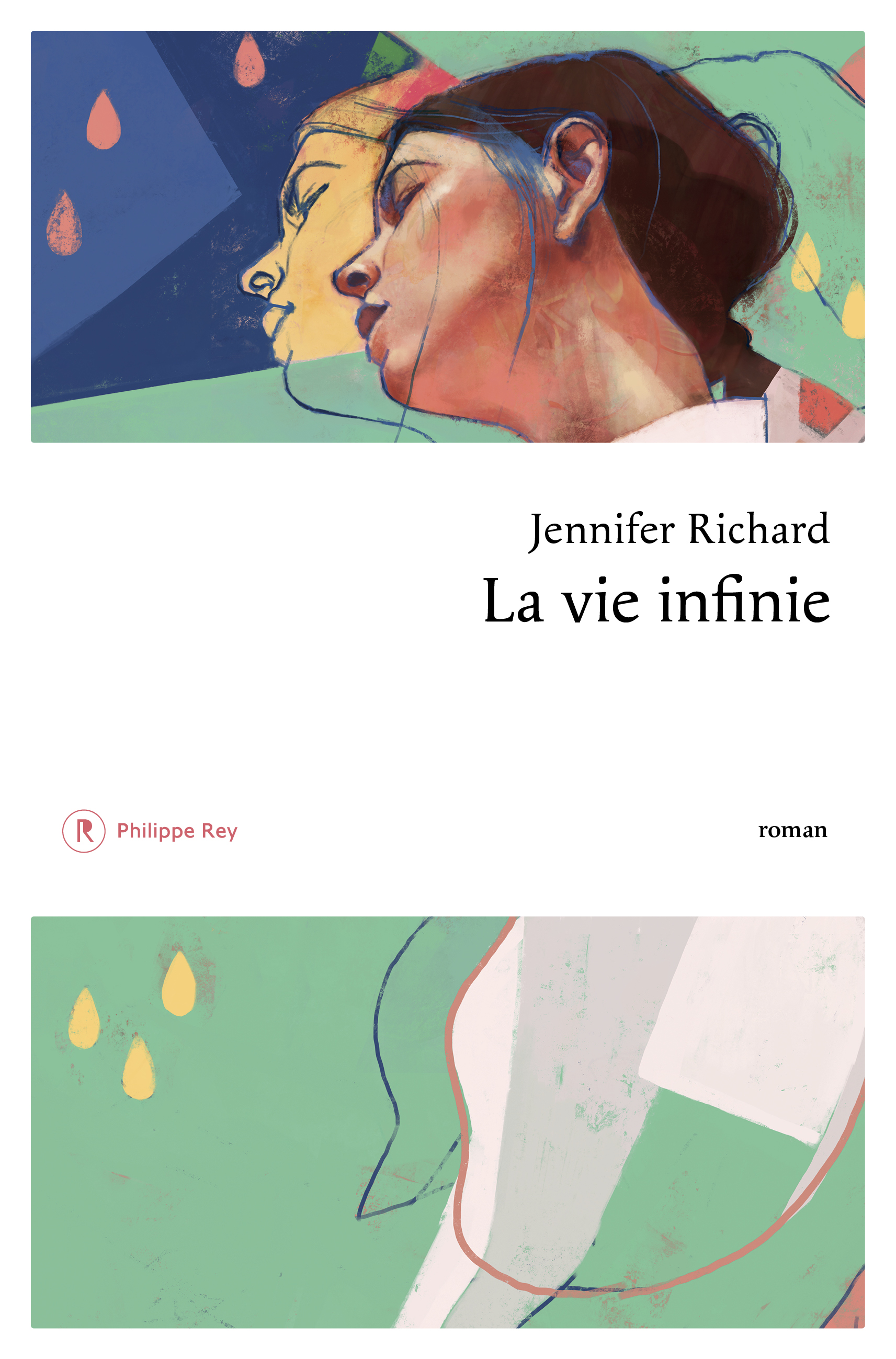
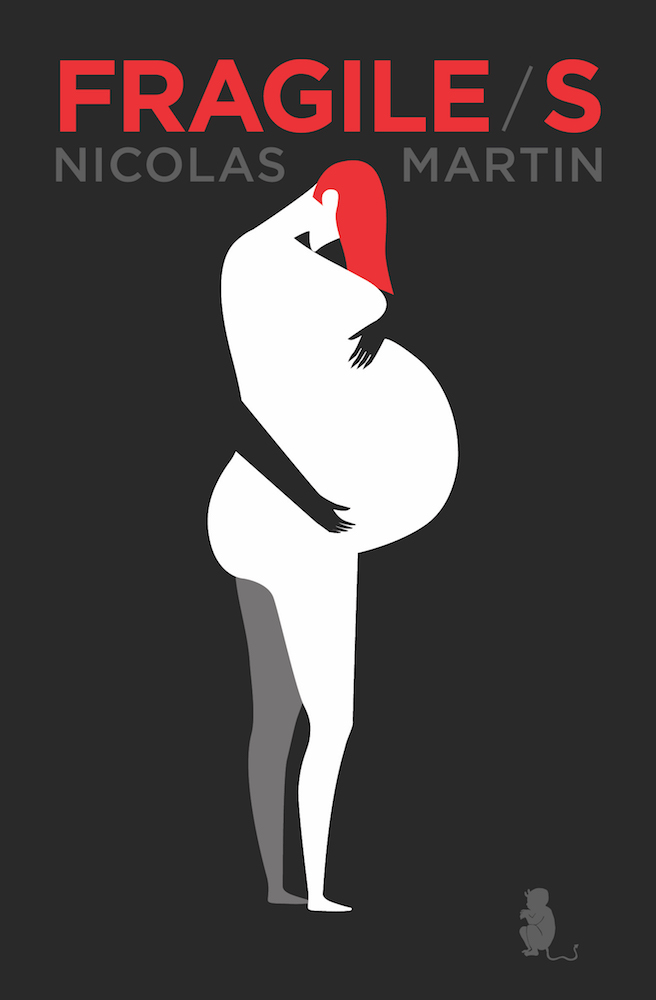

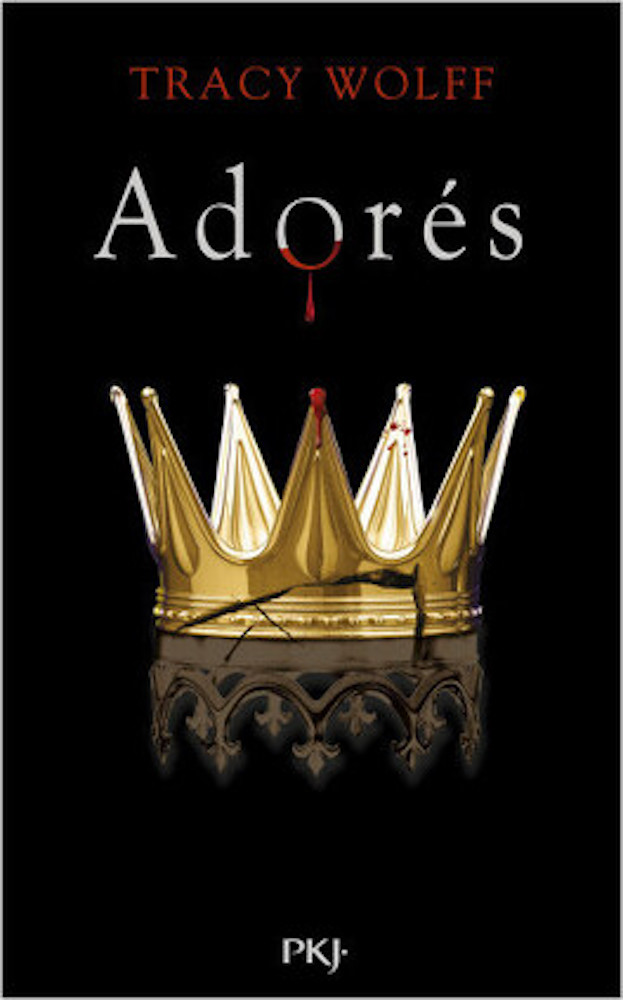
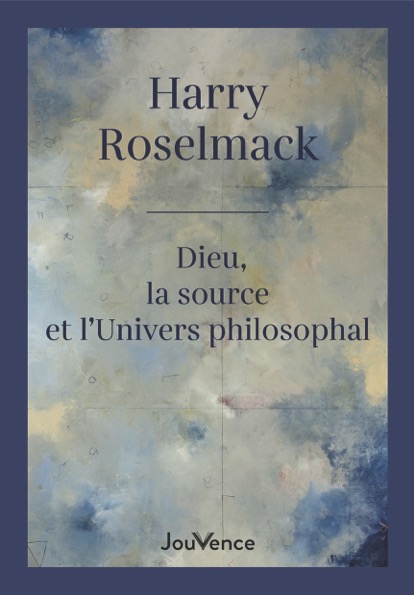
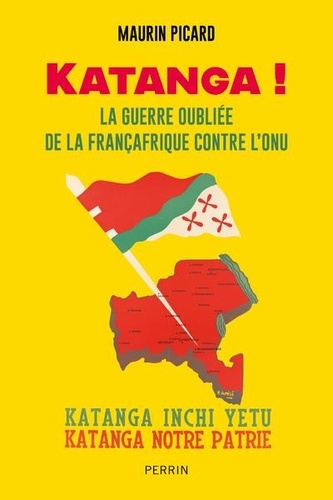
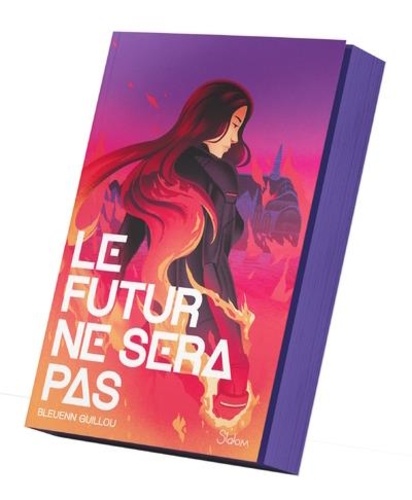
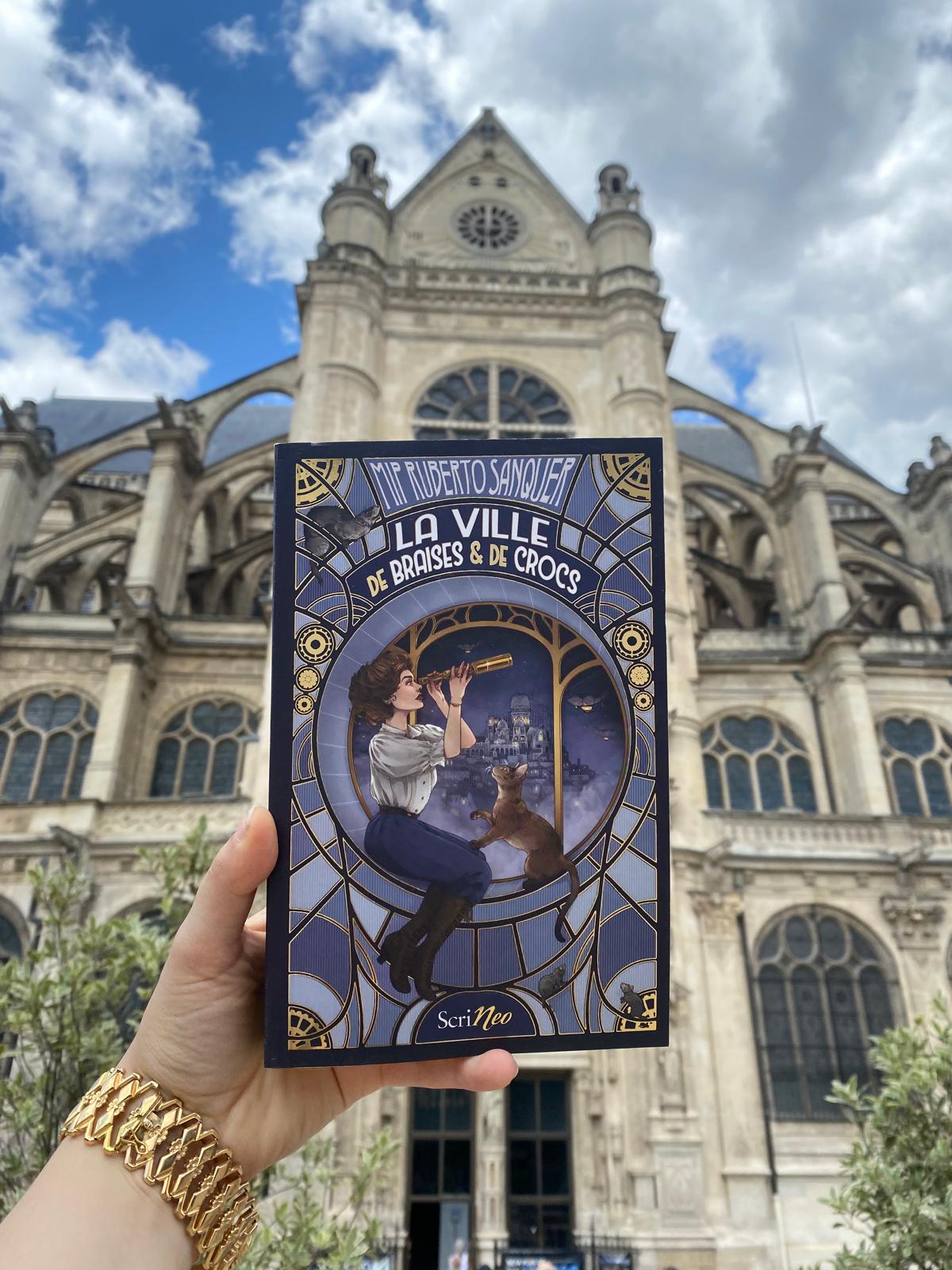


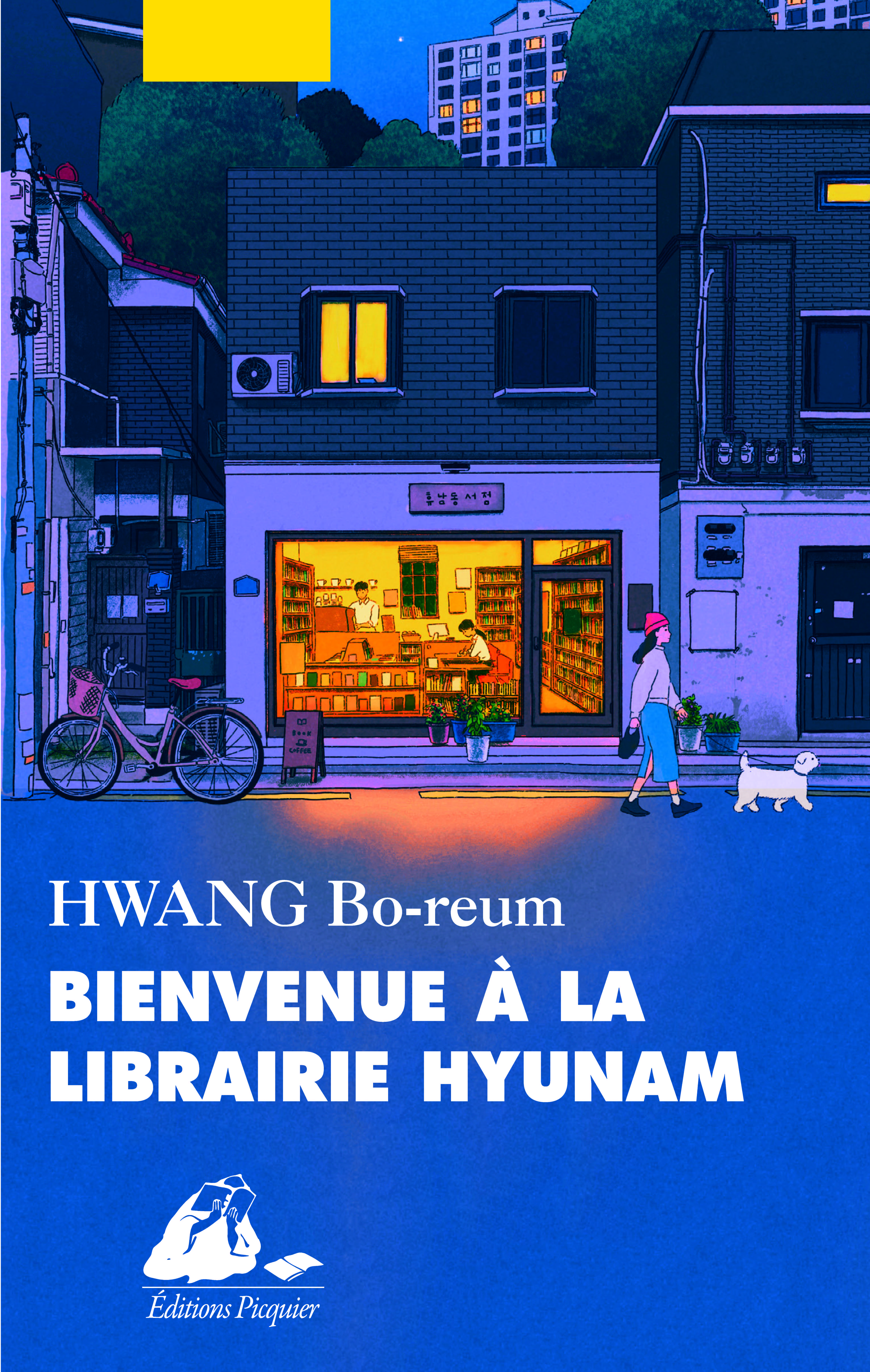
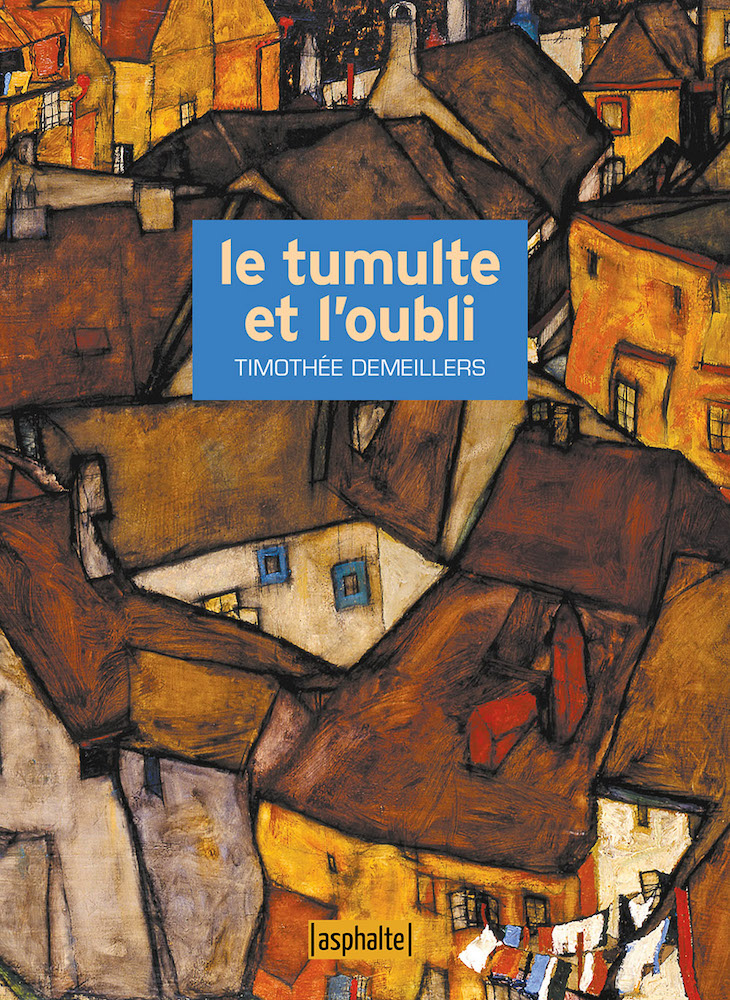
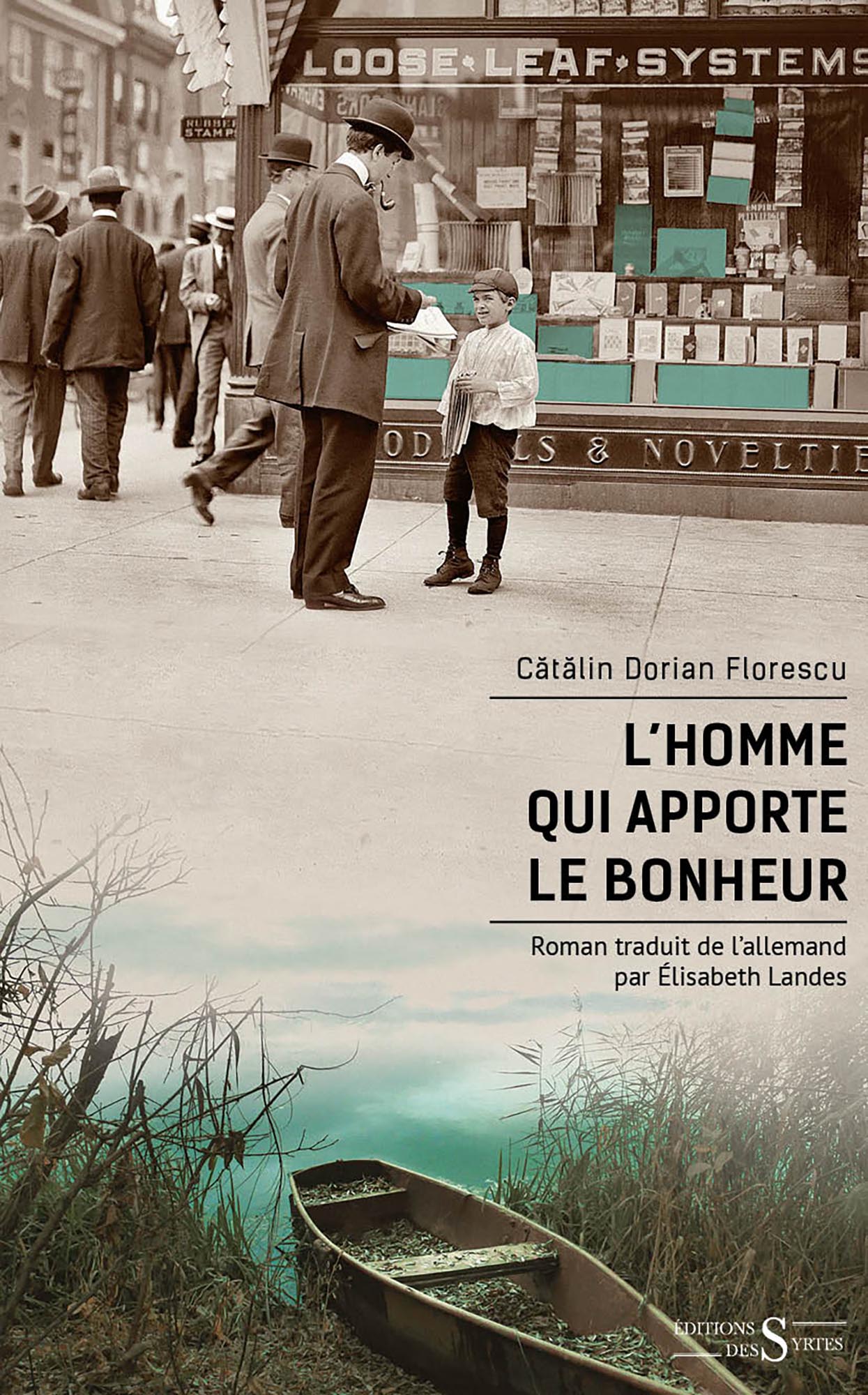
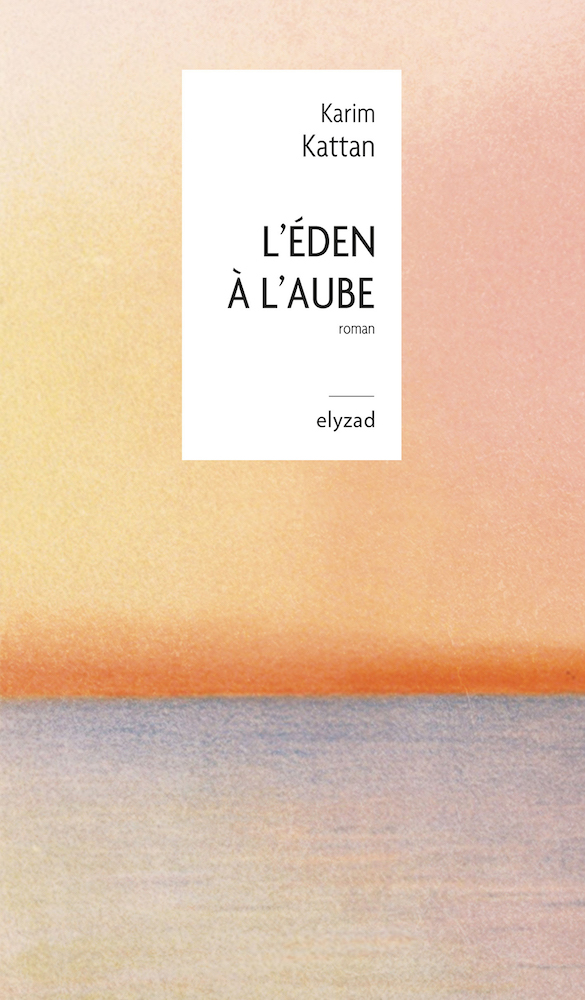
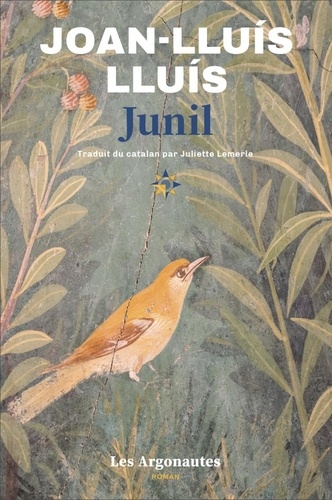
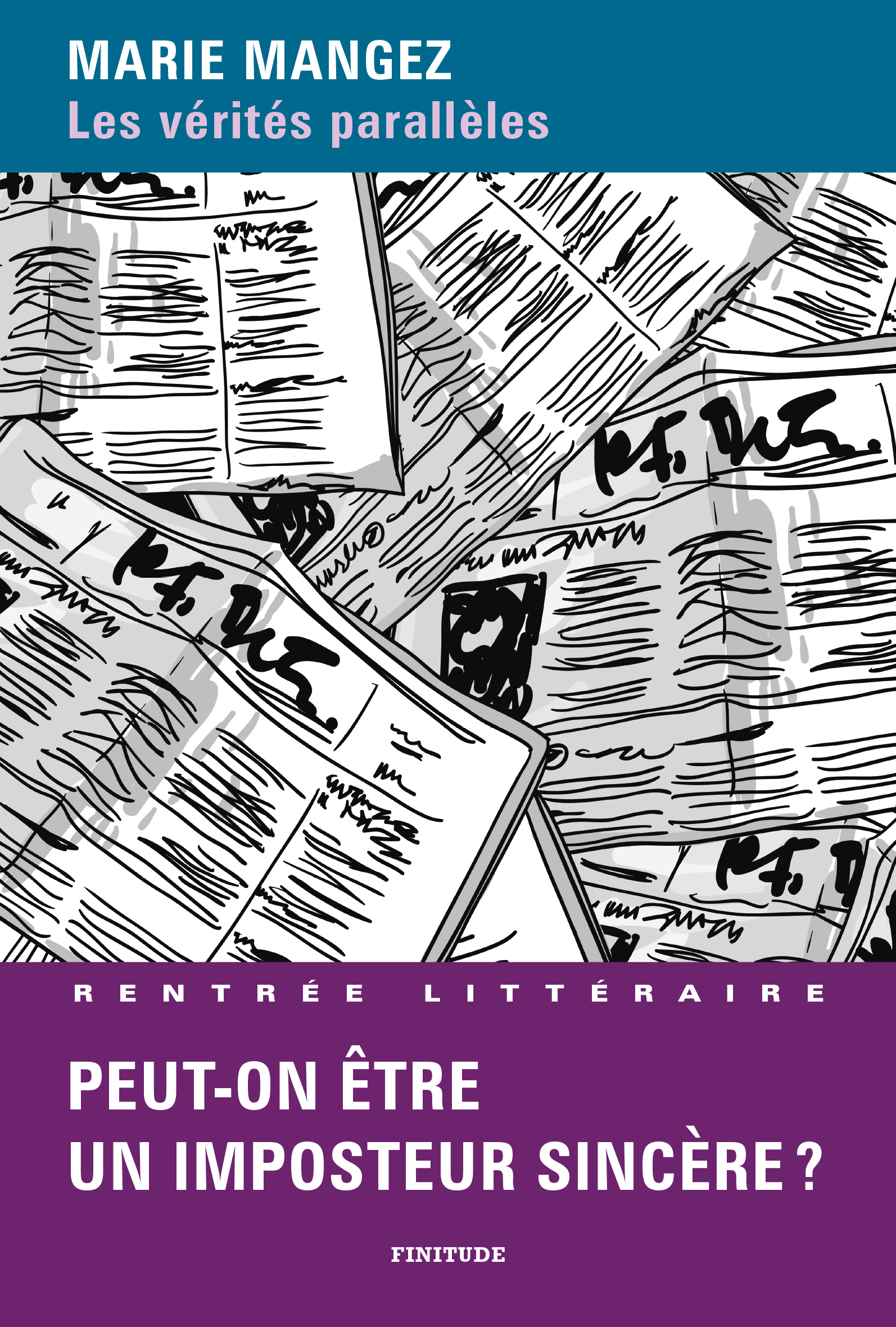

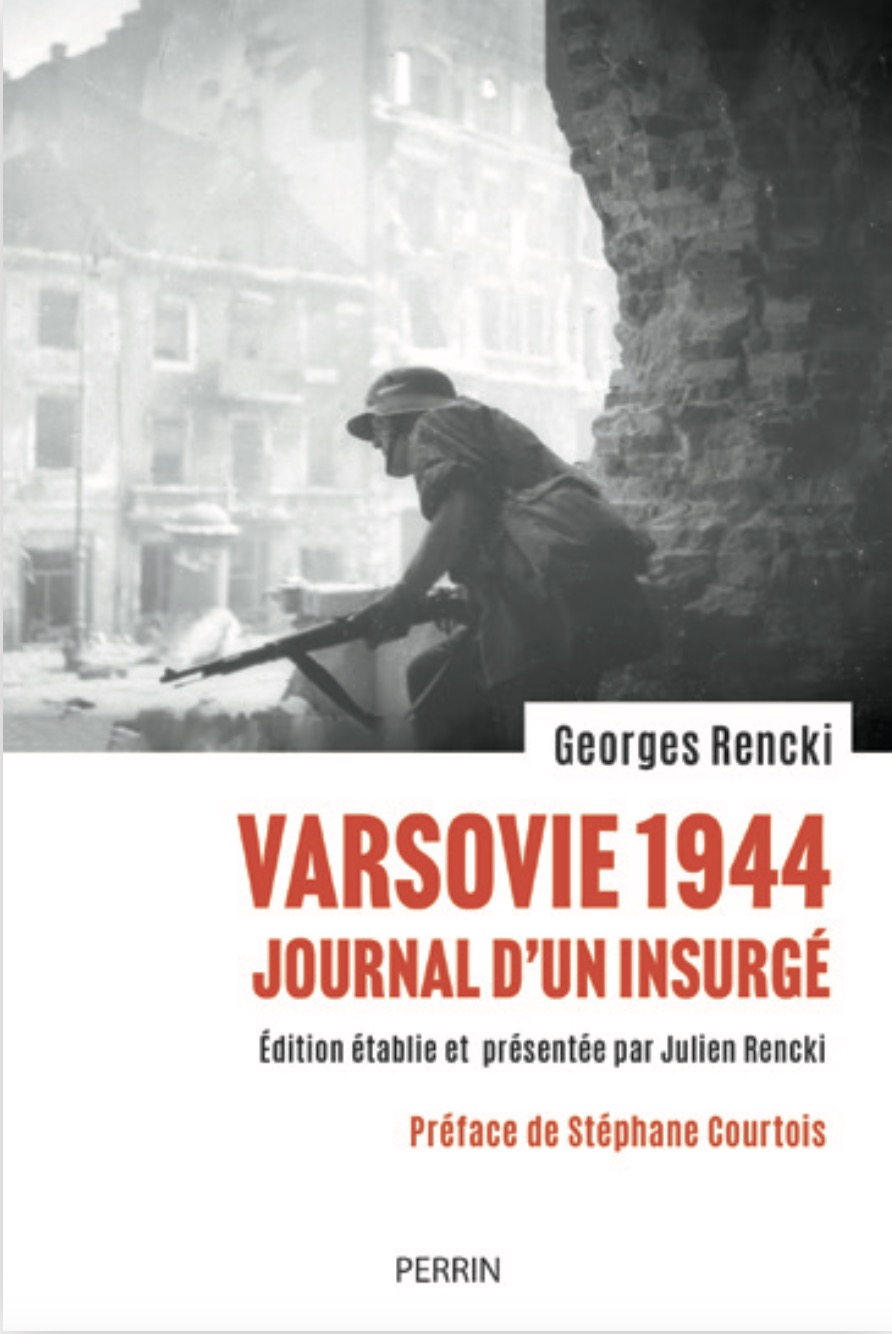
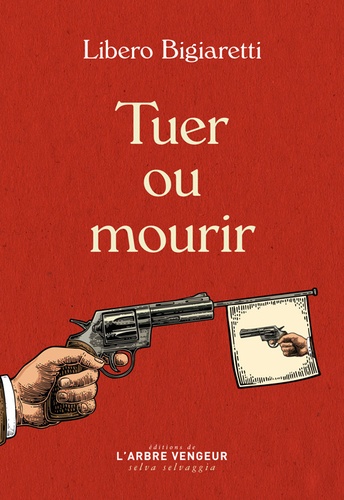
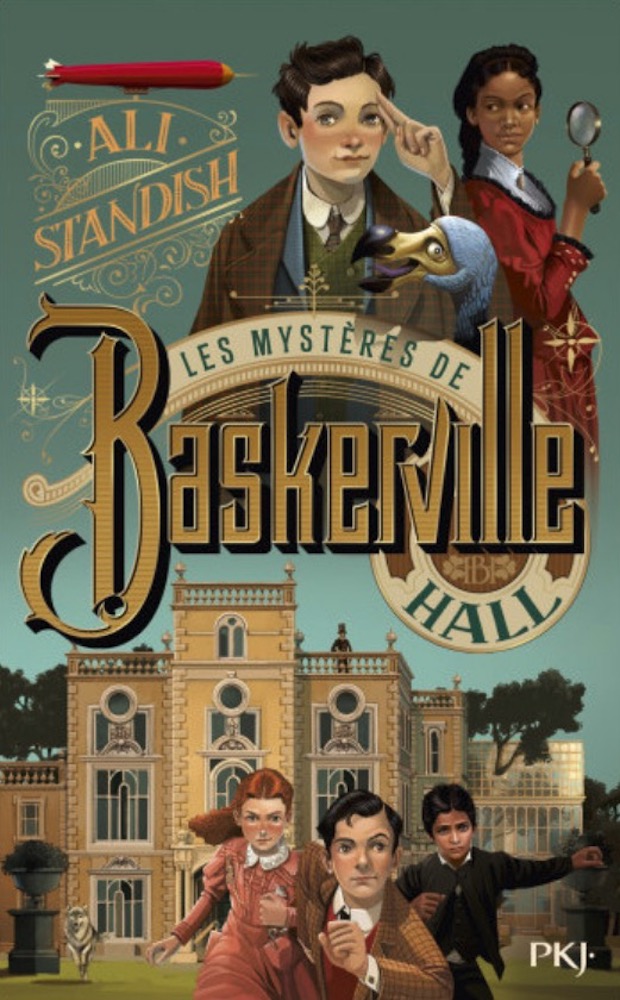
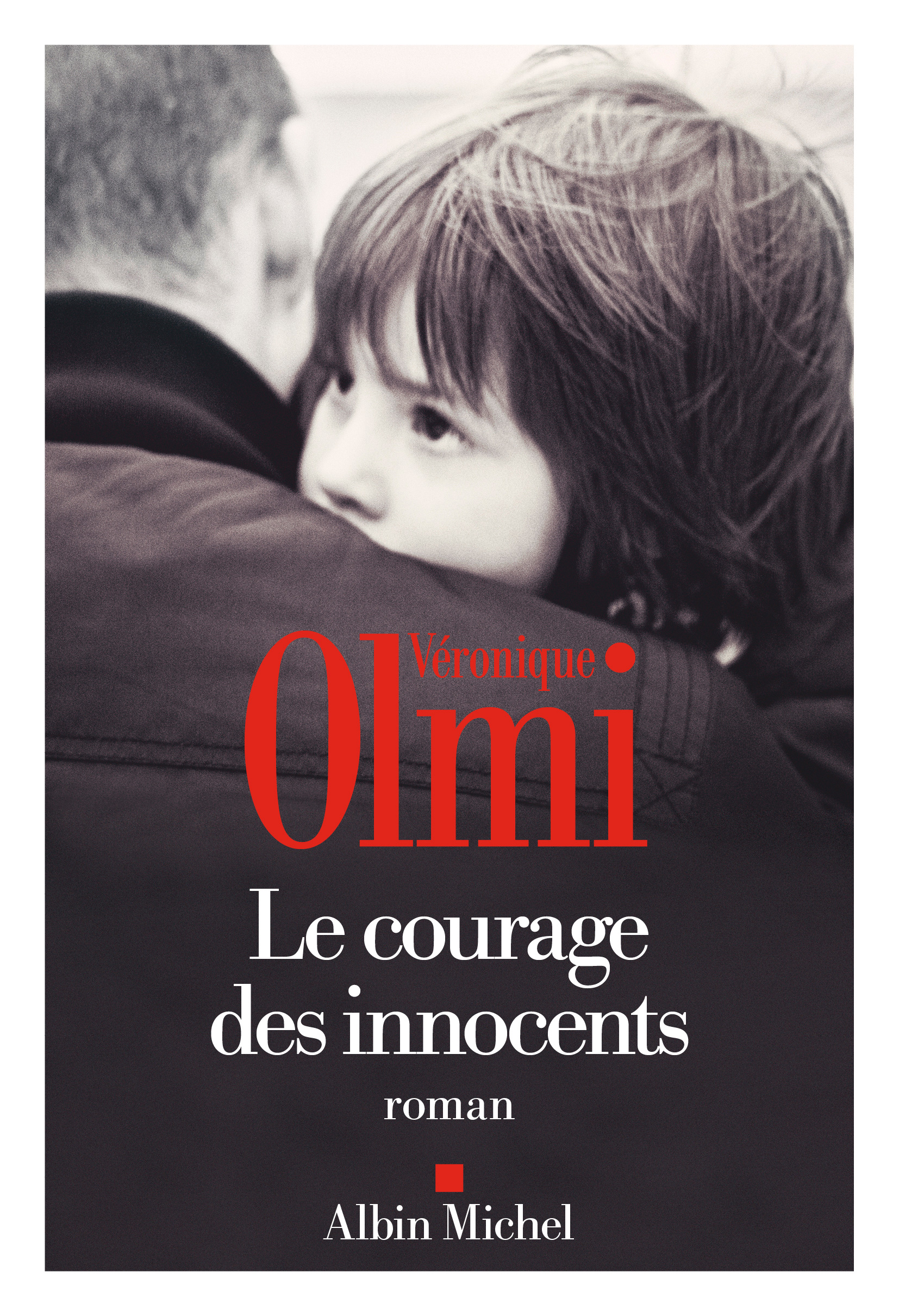
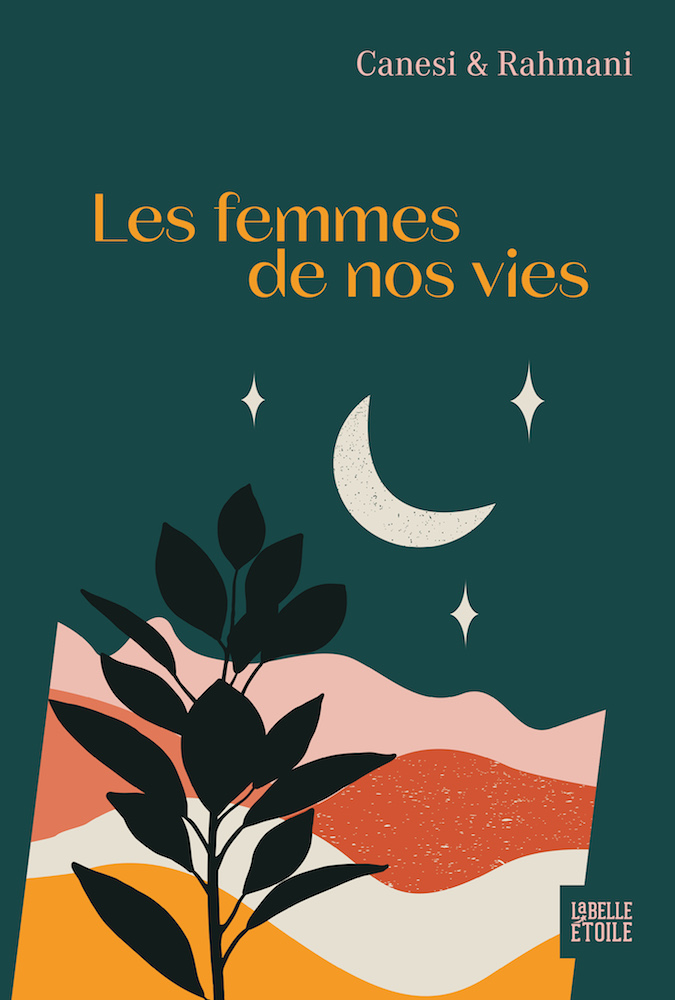
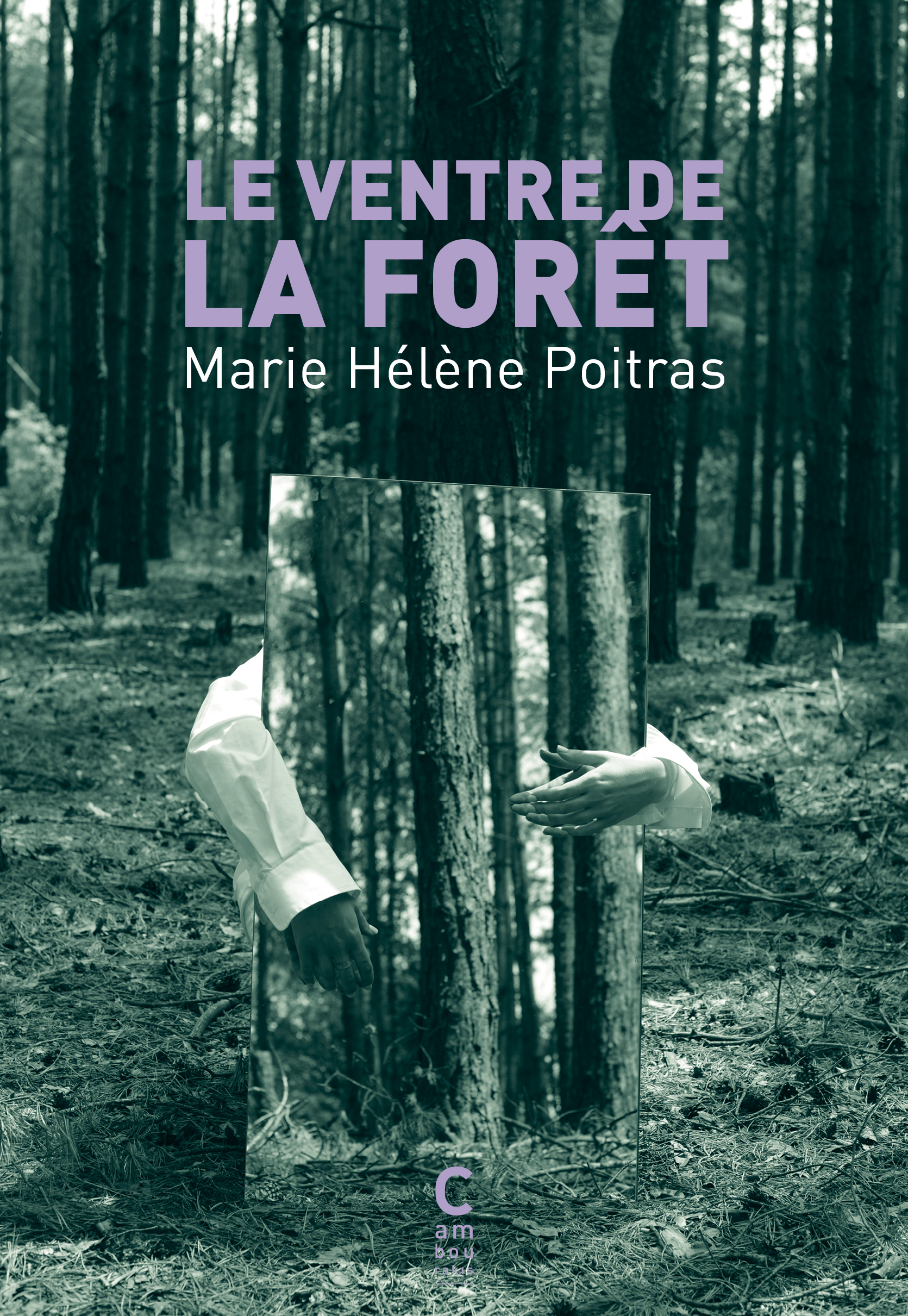
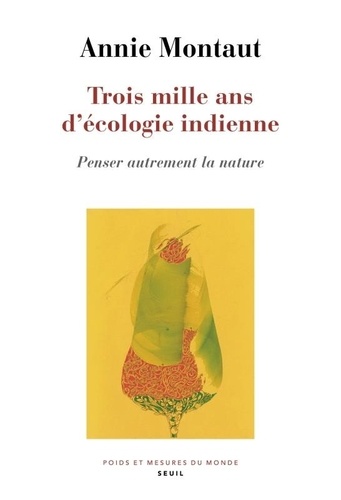
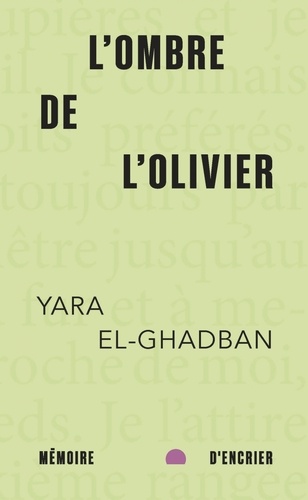
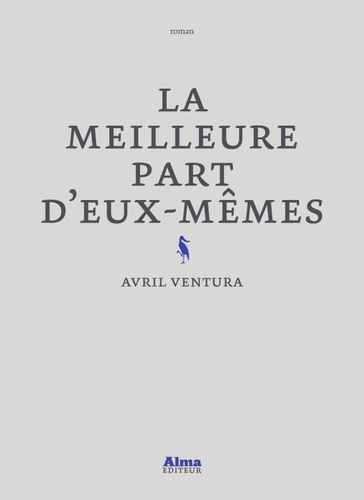
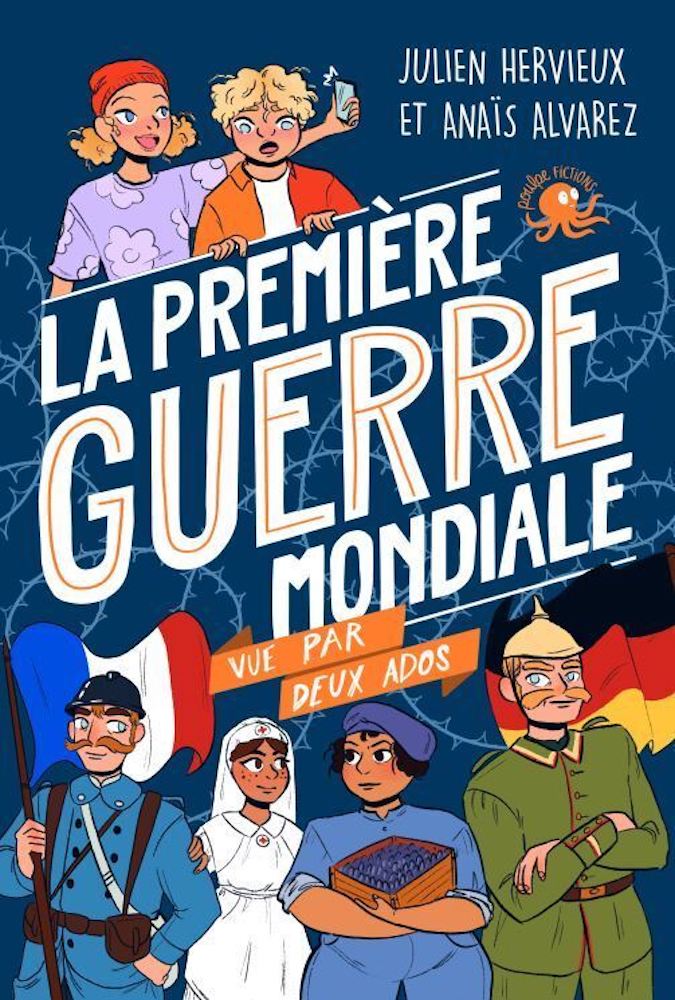
1 Commentaire
Nicole Charlier
15/02/2021 à 01:18
Je ne suis pas du tout d’accord avec votre article critique : je viens de lire Mes Fous et j’en sors totalement bouleversée !!! Un parcours sur le fil du rasoir du monde de la folie , à travers ce personnage émouvant , complexe , trop empathique envers les désaxés , les perdus de la société - oui il veut comprendre la maladie de sa fille , qui même absente est bien le centre du livre , il lui court après avec l’amour du désespoir ! Un beau texte , et qui apprend au lecteur des anecdotes , des faiblesses de nos fous célèbres , écrivains ou musiciens ! Belle écriture vraiment !!!!!