Le Démon de la théorie : La littérature est-elle une science exacte ?
Qu’est-ce que la littérature ?
Le 20/05/2019 à 09:02 par Maxime DesGranges
6 Réactions | 9 Partages
Publié le :
20/05/2019 à 09:02
6
Commentaires
9
Partages
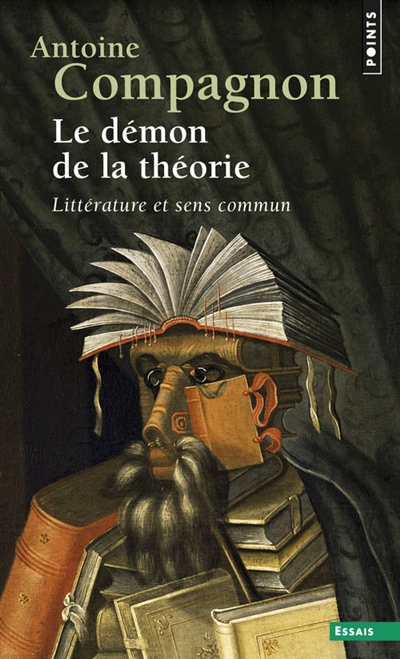
ESSAI – 1998. Pendant que vous chantiez à tue-tête « Aïe will seuvaïve » au Stade de France, que vous alliez voir couler le Titanic pour la troisième fois au ciné « juste pour accompagner une copine », que vous dansiez frénétiquement au camping sur « Asi Pata Pata » de Coumba Gawlo ou que vous réécoutiez le CD gravé du décevant « Americana » de Offspring dans votre Discman, Antoine Compagnon, lui, se replongeait dans Genette, Barthes et Greimas pour sortir un essai que pratiquement personne n’a lu. Respect.
Aujourd’hui, tous les étudiants de Lettres, même les nuls du fond de l’amphi et les dispensés d’assiduité, sont censés avoir entendu parler – hélas ou heureusement selon les goûts – de « narratologie », de « focalisation interne », d’« intradiégétique » et d’« extradiégétique », de « singulatif » et d’« itératif », et ont nécessairement entendu sonner à leurs oreilles juvéniles, entre deux pétards de mauvaise weed, les doux noms de Gérard Genette et de Roland Barthes.
Car ce vocabulaire si séduisant appartient à ce qu’on appelle la « théorie littéraire », discipline qui dans les années 60 a tâché de dégager de nouveaux horizons dans la compréhension des œuvres littéraires, puis a fini par infuser complètement dans la recherche universitaire – ayant eu pour conséquence d’écœurer des générations entières d’« apprenants » en littérature qui se sont précipités, pour le rarement meilleur et plus souvent le pire, dans des filières pleines de Pierre Bourdieu et de Judith Butler option Écriture inclusive.
Comme le succès n’arrive jamais par hasard, celui de la « théorie » était dû sans doute à ce que cette dernière venait s’opposer au « sens commun », dont la pertinence critique était largement remise en cause. Et le « sens commun », ce sont toutes ces vieilles questions habituelles que tout lecteur continue presque instinctivement de se poser sur un texte littéraire, les mêmes que celles que les professeurs de Compagnon posaient déjà à l'époque de sa scolarité : « Comment comprenez-vous ce passage ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire ? Quelles sont les beautés du vers ou de la prose ? En quoi la vision de l'écrivain est-elle originale ? Quelle leçon pouvons-nous en retenir ? », etc.
Il faut l’admettre : malgré les efforts des théoriciens, rien n’y a fait, le « sens commun » a résisté à l’assaut et ce n’est sans doute pas sans raison. Pour Compagnon, il était donc temps de faire le point sur les arguments respectifs des uns et des autres et d’en dégager les lignes de force, d’analyser les points de vue antithétiques pour en montrer les limites, en cerner les excès, et tenter de dégager une voie du milieu qui ferait revenir tout le monde à la raison, (et à la fac).
Pour commencer, Compagnon relève cinq éléments indispensables pour qu'il y ait « littérature » : un auteur, un livre, un lecteur, une langue, un référent ; avant d’en ajouter deux supplémentaires : l'histoire et la critique. Ces sept points composent la structure de l’essai : chaque chapitre sera l'occasion de confronter théorie littéraire et sens commun autour de ces éléments pour tenter de répondre à un certain nombre d’énigmes irrésolues autour de la littérature. Prenons donc ces énigmes une par une.
Éternelle question à laquelle personne n’a jamais vraiment pu répondre, malgré les tentatives aussi brillantes que nombreuses (Charles du Bos, Sartre…). Autrement dit : quels sont les marqueurs linguistiques indiquant qu'un texte est littéraire et qu'un autre ne l'est pas ? Rien n’affirme d’ailleurs que cela se joue au seul niveau linguistique. Mais dans ce cas, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de littérature, d’œuvre littéraire ? Compagnon explore le sujet en faisant parler les critiques, afin de trouver une explication – faute de réponse – à cette interrogation difficile, car : « La littérature, ou l'étude littéraire, est toujours prise en sandwich entre une approche historique au sens large (le texte comme document) et une approche linguistique (le texte comme fait de langue, la littérature comme art du langage), qui sont irréductibles. » « Historicisme » et « formalisme » : ces deux approches définissent la nature de la fracture théorique présente tout au long du livre.
Qu'est-ce que l’auteur a voulu dire ?
La place de l'intention de l’auteur constitue le chapitre le plus long du livre, tant la question de sa fonction et de son rôle a été débattue. Ici, les critiques se séparent en deux chapelles : les partisans de l'explication (cherchons à comprendre ce que l'auteur nous dit) et les partisans de l'interprétation (cherchons à comprendre ce que le texte dit, indépendamment de l'auteur).
Pour les New Critics anglo-saxons (Allen Tate, Penn Warren, Wimsatt, Beardsley…), qui ont précédé les structuralistes français dès les années 20, la question relève d'une « illusion intentionnelle » (intentional fallacy) car, comme le démontre par exemple le texte célèbre de Proust, Contre Sainte-Beuve, l’œuvre est le « produit d'un autre moi que le moi social, d'un moi profond irréductible à une intention consciente ». L’oeuvre s'affranchit de son auteur pour devenir une entité signifiante autonome. C'est tout l'objet du structuralisme littéraire (la théorie) que de chercher à le prouver.
Alors, le sens d'une œuvre se réduit-il à l'intention que l'auteur à voulu y mettre ou bien le texte s'émancipe-t-il de l'intention initiale ? Comme souvent dans les questions complexes, la réponse pour Compagnon serait du genre : un peu des deux :
L'intention d'auteur ne se réduit donc pas à un projet ni à une préméditation intégralement consciente (« l'intention claire et lucide » de Picard). L'art est une activité intentionnelle (...), mais il existe de nombreuses activités intentionnelles qui ne sont ni préméditées ni conscientes.
La littérature nous parle-t-elle de la réalité ?
En d'autres termes : la littérature traite-t-elle vraiment du monde, de la réalité qui nous entoure, et à quel degré ? Depuis la « Poétique » d'Aristote, la mimèsis (imitation, représentation) est le terme qui rend compte du rapport entre littérature et réalité. Seulement, « la mimèsis a été remise en cause par la théorie littéraire, qui a insisté sur l'autonomie de la littérature par rapport à la réalité, au référent, au monde, et soutenu la thèse du primat de la forme sur le fond, de l'expression sur le contenu, du signifiant sur le signifié, de la signification sur la représentation, ou encore de la sèmiosis sur la mimèsis. » Ainsi, la référence serait elle aussi une illusion (on parle dans ce cas d’ « illusion référentielle »).
Selon la théorie, la littérature ne nous parle pas du réel, elle ne peut pas le faire, malgré tous les apparats réalistes dont elle s'orne parfois. Une longue description dans un roman de Balzac ne nous parle pas du monde, elle ne représente rien, elle ne fait que parler de littérature, ne renvoie à rien d'autre qu'à elle-même (auto-référentialité) et à un acte de langage. Et si le texte se réfère à autre chose que lui-même, ce n'est qu'à d'autres textes (intertextualité).
La théorie s'oppose donc à la « tradition aristotélicienne, humaniste, classique, réaliste, naturaliste et même marxiste », pour qui le but de la littérature est de représenter la réalité le plus fidèlement possible, dans la mesure de ses possibilités. Cette dernière précision, « dans la mesure de ses possibilités », est importante, puisqu'elle offre à Compagnon l'angle d'attaque argumentatif qui lui permet de contester Barthes : pour ce dernier, si la littérature ne permet pas complètement de représenter la réalité, alors la référence est une illusion totale. C'est cette radicalité que Compagnon met en cause : « Le triomphe facile de la théorie littéraire sur la mimèsis dépendait d'une conception de la référence linguistique simpliste et outrée : l'hallucination ou rien. » (« l'hallucination » étant ici un terme utilisé par Barthes pour désigner la référence au réel).
Et le lecteur dans tout ça ?
Compagnon se penche sur l'approche pragmatique (effet produit) de la littérature, soit son rapport au lecteur. Deux conceptions critiques s'opposent à nouveau : la « critique scientifique » (Brunetière) puis « historique » (Lanson), polémiquait contre ce qu'elle appelait la « critique impressionniste » (qui parle de son expérience de lecture, procède par sympathie, par goût, etc.) Si l’œuvre est une « unité organique auto-suffisante », le point de vue du lecteur est inutile. Car il relève d'une nouvelle illusion, encore une, relevée par les New Critics américains : l'illusion affective (affective fallacy).
Le lecteur, trompé par la volubilité de ses affects, déforme la vérité du texte. Seule une dissection textuelle méthodique, « scientifique », permettrait d'en dégager toutes les virtualités de sens. Seulement, le lecteur résiste. Proust en tête, affirme Compagnon qui cite l'écrivain : « Ce dont nous nous souvenons, [...] ce qui nous a marqué dans nos lectures d'enfant, ce n'est pas le livre lui-même, mais le cadre dans lequel nous l'avons lu, les impressions qui ont accompagné sa lecture. La lecture est empathique, projective, identificatoire ».
Autre exemple de l’importance du lecteur dans l’élaboration de l’oeuvre : dans Manon Lescaut, l'abbé Prévost n'offre aucune description physique de son héroïne, afin que chaque lecteur puisse l'imaginer selon son propre idéal féminin (et non pas, comme le prétendait récemment quelque journaliste radio-francophonique débraillé, pour « invisibiliser » la femme). Ainsi le livre échappe toujours à l'écrivain, car le lecteur le transforme en le lisant, par le filtre de son imaginaire. Il y a toujours comme une lutte intime qui se joue autour de la lecture du livre, qui met en prise la liberté imaginative du lecteur et les contraintes imposées par le texte lui-même, qui balisent temporairement son imaginaire, avec son accord tacite.
Qu'est-ce que le style ?
Arrive la question du style. Pour la théorie littéraire, le style est, je vous le donne en mille, une nouvelle illusion. Pour le sens commun, le style est une réalité liée à chaque écrivain. Une ambiguïté se joue autour du terme en ce sens que le style est à la fois une norme et un écart par rapport à cette norme, il a un aspect à la fois collectif (quand on parle de style baroque, de style Louis XV, etc.) et un aspect individuel (singularité d'une œuvre). C'est, en fait, « au sens le plus vaste, un ensemble de traits formels repérables, et en même temps le symptôme d'une personnalité (individu, groupe, période). »
Durant les années 50, la notion de stylistique est contestée, alors que la linguistique prend de l'ampleur. Comme la notion de style se rapproche de celle d'intention d'auteur, elle est à bannir au chapitre des illusions elle aussi. Pour le linguiste Stephen Ullmann : « Il ne peut être question de style à moins que le locuteur ou l'écrivain n'ait la possibilité de choisir entre des formes d'expression distinctes. La synonymie, au sens le plus large, se trouve à la racine de tout le problème du style. » Or, pour la linguistique : dire autrement la même chose, c'est dire autre chose. La notion de synonymie (donc de style) perd aussitôt sa pertinence.
La thèse de l'unité insécable entre pensée et langage devait avoir raison des études de style, puisque le principe de synonymie était anéanti. Mais selon Compagnon, le philosophe Nelson Goodman parvient à résoudre l'aporie en affirmant que « la distinction entre le style et le contenu ne suppose pas qu'exactement la même chose puisse être dite de différentes façons. Elle suppose seulement que ce qui est dit puisse varier de façon non concomitante avec les façons de dire. »
Partant de là, Compagnon résume : « il y a des manières très diverses de dire des choses très semblables, et inversement. Plusieurs œuvres sur le même sujet – ou à peu près le même sujet – peuvent avoir des styles différents, et plusieurs œuvres sur des sujets différents peuvent avoir le même style. » Conclusion de Goodman : « Ce n'est pas parce qu'on se passe de la synonymie que style et sujet ne font plus qu'un. » Une phrase de Goodman définissant sa position médiane permet de sortir de l'impasse dans laquelle la linguistique cherchait à entraîner la question du style : « il y a des façons assez différentes de dire à peu près la même chose. » De cette façon, le style existe bel et bien.
Qu'est-ce que l'histoire littéraire ?
Autrement dit : comment la littérature s'inscrit dans sa propre histoire et quel rapport elle entretient avec l'histoire qui l'entoure. C'est la littérature en contexte et en mouvement : querelles des Anciens et des Modernes, imitation ou innovation, etc. Nouvelle illusion (eh oui, désolé) dénoncée par la théorie : « l'illusion génétique […] consiste à croire que la littérature peut, et doit, s'expliquer par des causes historiques. […] La théorie littéraire accuse l'histoire littéraire de noyer la littérature dans un processus historique qui méconnaît sa « spécificité » de littérature (le fait précisément qu'elle échappe à l'histoire). » Or un problème se pose quand on sait que : « L'hypothèse centrale de l'histoire littéraire est que l'écrivain et son œuvre doivent être compris dans leur situation historique, que la compréhension d'un texte suppose la connaissance de son contexte : "Une œuvre d'art n'a de valeur que dans son encadrement, et l'encadrement de toute œuvre, c'est son époque", écrivait Renan. »
L’historien littéraire et critique Gustave Lanson, quant à lui, affirmait qu'on faisait de l'histoire littéraire dès lors qu'on regardait le nom de l'auteur sur la couverture du livre. L'opposition des deux points de vue est d'ordre synchronique et diachronique : soit toutes les œuvres sont lues dans leur simultanéité, comme si elles étaient toutes contemporaines entre elles et de leur lecteur actuel, soit elles sont lues dans une série chronologique intégrée au processus historique. Or, rappelle Compagnon : « l’œuvre d'art est éternelle et historique. »
Par ailleurs, on ne peut tout à fait considérer les œuvres hors de l'histoire puisque la sélection de ces œuvres dans le canon est une conséquence d'un processus historique de jugement critique. En d'autres termes, ceux qui s'opposent à l'historicité de la littérature en sont les victimes, puisque les œuvres qu'ils étudient ont été sélectionnées par leur appartenance même à cette historicité. L'illusion, c'est de prétendre étudier la poésie de Baudelaire en la « déshistoricisant », alors que le fait même d'étudier cet auteur-là plutôt qu'un auteur oublié est le fruit d'une sélection historique.
Mais le problème que pose l'histoire est aussi lié à l'évolution de la discipline. Compagnon rappelle que : « L'histoire des historiens n'est plus une ni unifiée, mais se compose d'une multiplicité d'histoires partielles, de chronologies hétérogènes et de récits contradictoires. Elle n'a plus ce sens unique que les philosophies totalisantes de l'histoire lui voyaient depuis Hegel. L'histoire est une construction, un récit qui, comme tel, met en scène le présent aussi bien que le passé ; son texte fait partie de la littérature. » Conséquence singulière de cet éclatement de l'histoire : deux livres parus à la même date ne sont pas forcément contemporains, l'un peut être en retard sur son temps, l'autre en avance.
Qu'est-ce qu’un « bon livre » ?
Se pose enfin le problème de la qualité d'un texte : comment reconnaître un bon livre d'un mauvais, existe-t-il des critères objectifs de jugement ? C'est ce que la critique « scientifique » a essayé d'établir, comme elle se méfiait de la critique « impressionniste », trop souvent à côté de la plaque. Pourtant, la théorie n'échappe pas à la préférence ni à l'évaluation. Car simplement : « une théorie érige ses préférences, ou ses préjugés, en universaux ». Naturellement, on sélectionne les textes les plus susceptibles d'illustrer ce qu'on cherche à démontrer. Tout discours sur une œuvre littéraire dépend d'un jugement critique préalable sur elle, implicite ou explicite.
Définir la valeur d'une œuvre de façon objective pose de toute façon problème. Dans la Critique de la faculté de juger, Kant nous dit que : « le goût est la faculté de juger un objet ou un mode de représentation par l'intermédiaire de la satisfaction ou du déplaisir, de manière désintéressée. On appelle beau l'objet d'une telle satisfaction. » Avec Kant, le jugement esthétique se place au niveau du sujet, non de l'objet. Or, même en précisant ultérieurement la notion de désintéressement, qui permettrait d'atteindre un certain consensus du jugement esthétique, ce point de vue conduit au relativisme du Beau : est beau ce que je trouve beau, tout simplement. Chacun ses goûts. « Les goûts et les couleurs ne se discutent pas » est un lieu commun esthétique.
Dans ce cas, comment définir ce qu'est un classique ? Doit-on faire confiance au temps qui passe pour faire le tri entre mauvaise et bonne littérature comme certains le suggèrent ? (à ce sujet, lire notre chronique sur Albert Thibaudet) Compagnon résume le nouveau conflit théorique en ces termes : soit il existe un canon légitime, à la liste immuable et à l'ordre rigide, soit tout est arbitraire comme le suggèrent les théoriciens.
Une nouvelle fois, il s'agit d'adopter une position intermédiaire : il existe un canon, désigné par une pratique empirique inscrite dans l'histoire, il y a des entrées (Sade est un exemple) et des sorties, mais les changements se font en périphérie plus qu'au centre. La meilleure preuve en est que les théoriciens littéraires, sous couvert de dénoncer toutes les illusions mentionnées, n'ont fait que parler des œuvres du canon. De la même façon qu'en démontant le réalisme, ils n'ont fait que lire et parler des œuvres réalistes.
Ce long résumé n’a d’autre ambition que d’être une porte d'entrée à ce livre stimulant, qui pourra paraître compliqué à ceux qui ne sont pas habitués au style d'un universitaire, même si Antoine Compagnon est connu pour son style accessible comme il l’a prouvé avec la série Un Été avec… qui a connu un grand succès aux éditions des Equateurs. Ceci dit, Le Démon de la théorie s’adresse à un public plus restreint.
Pour finir, laissons à l’auteur le mot de la fin qui résume en une phrase tout le paradoxe de cette « aventure théorique » dont il a analysé le parcours et les limites :
Certes, l'auteur est mort, la littérature n'a rien à voir avec le monde, la synonymie n'existe pas, toutes les interprétations sont valables, le canon est illégitime, mais on continue à lire des biographies d'écrivains, on s'identifie aux héros des romans, on suit avec curiosité les traces de Raskolnikov dans les rues de Saint-Pétersbourg, on préfère Madame Bovary à Fanny, et Barthes se plongeait délicieusement dans Le Comte de Monte-Cristo avant de s'endormir.
Antoine Compagnon – Le démon de la théorie : littérature et sens commun – Points – 9782757842041 – 9.50 €
Le démon de la théorie. Littérature et sens commun
Paru le 21/08/2014
338 pages
Points
9,50 €



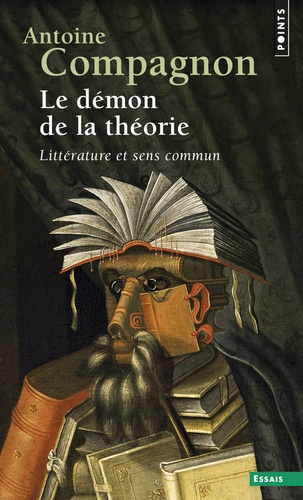
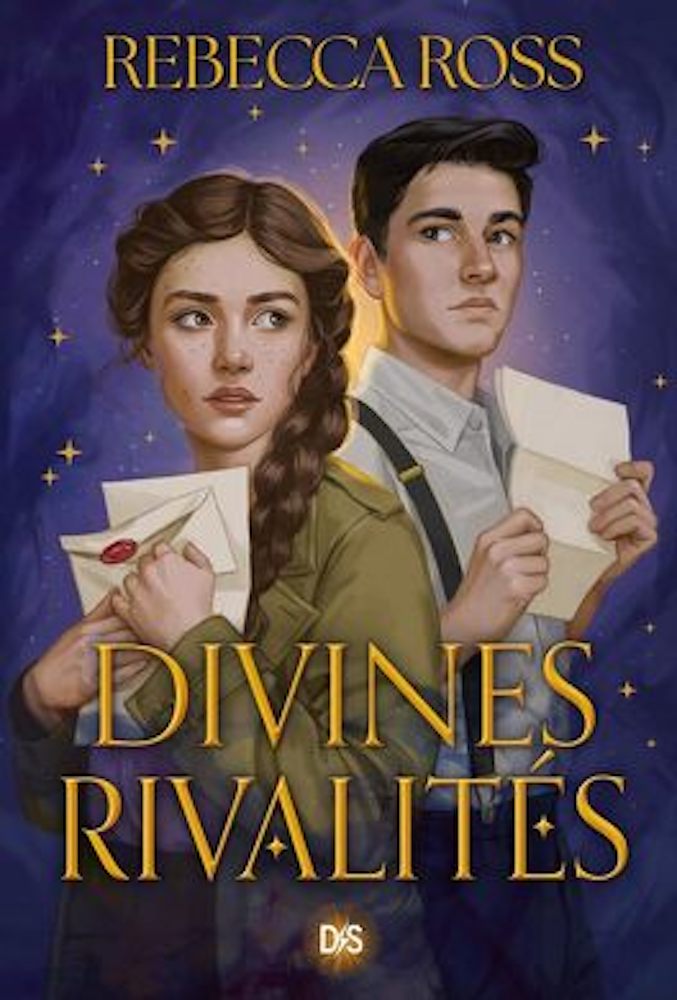
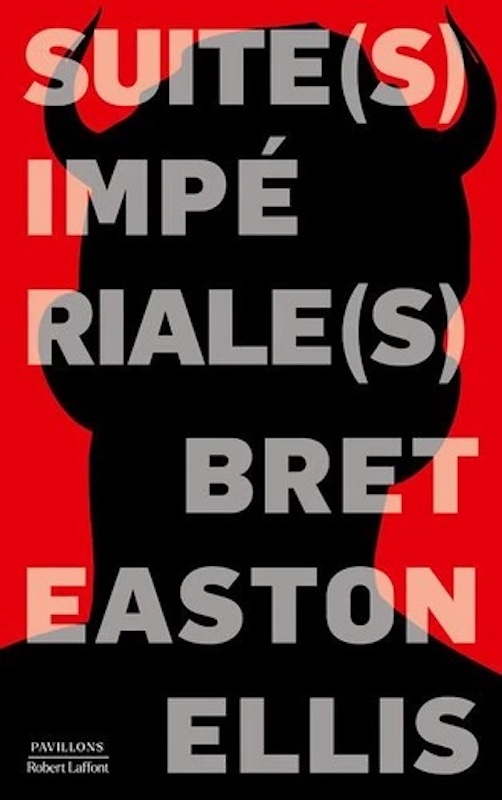

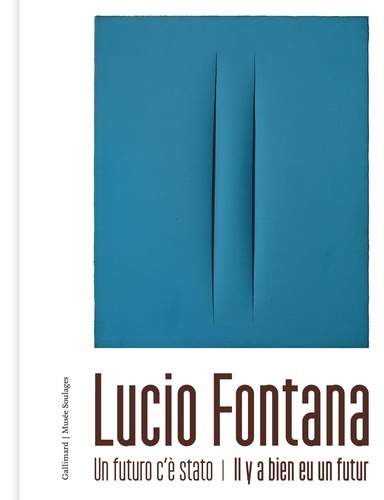

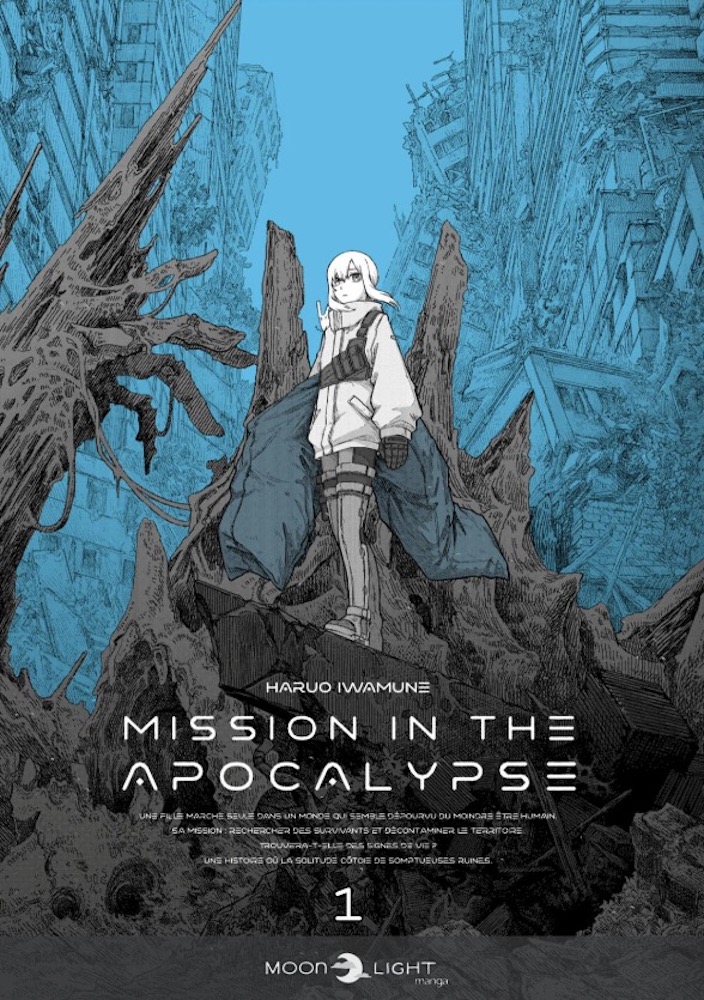
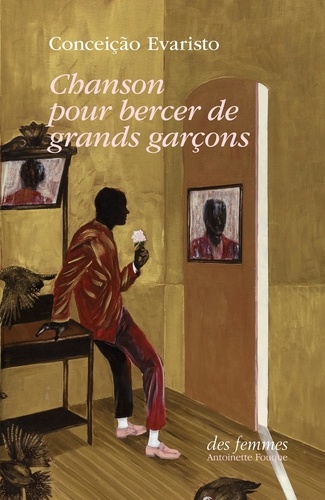
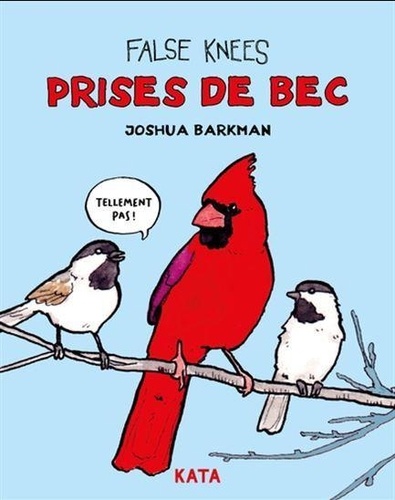
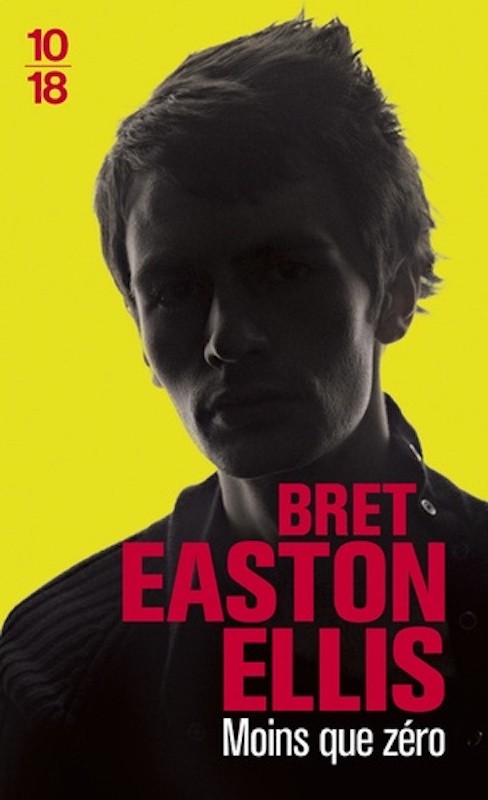

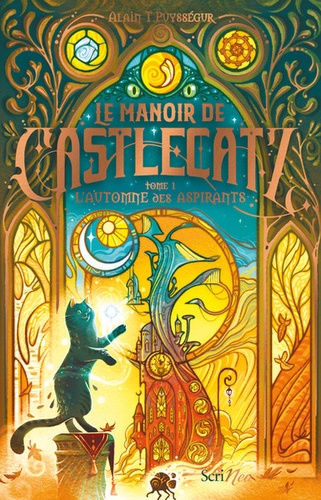

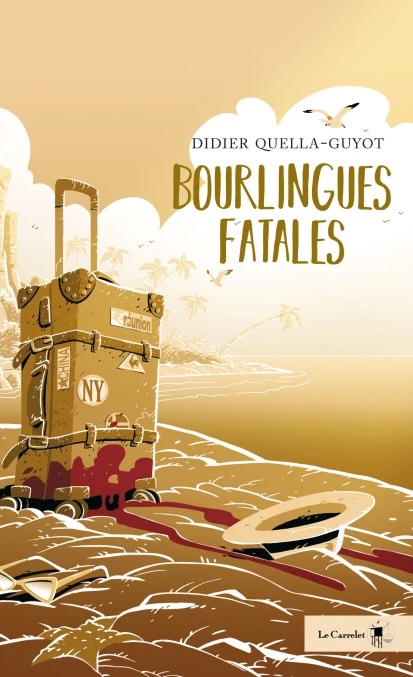

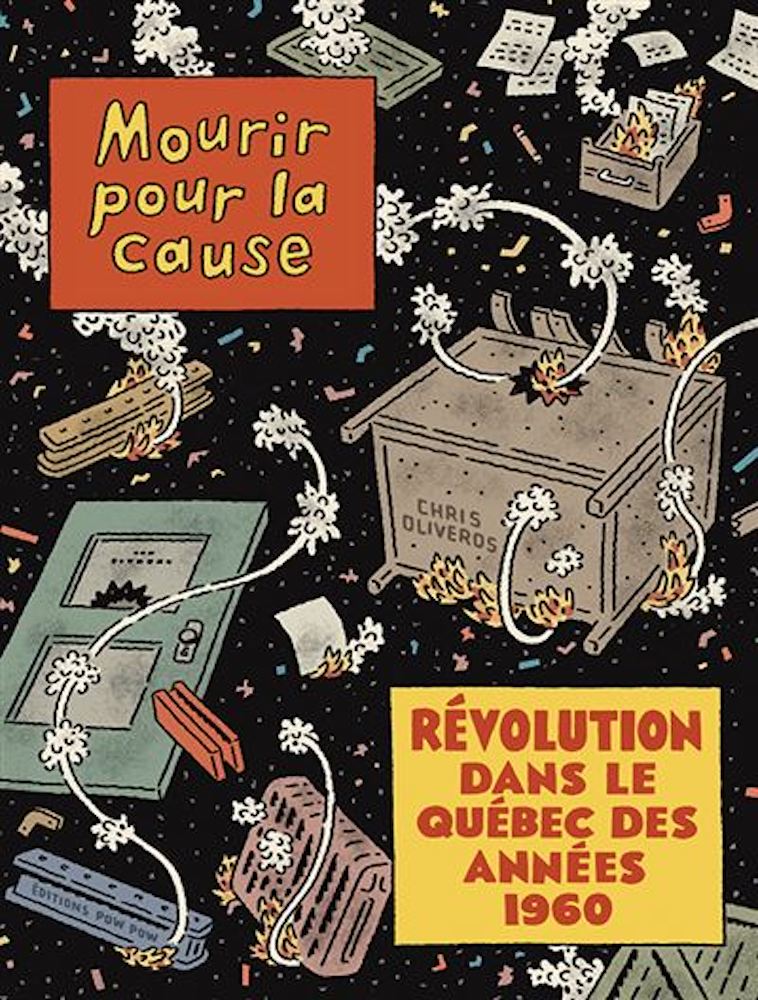
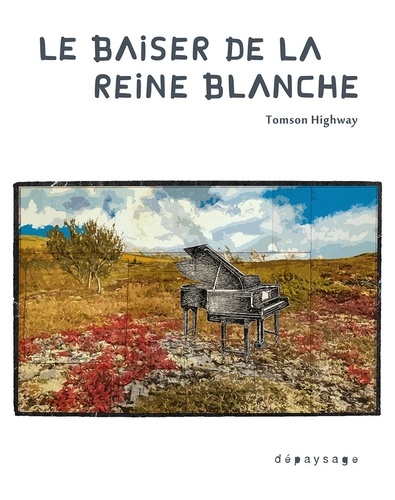
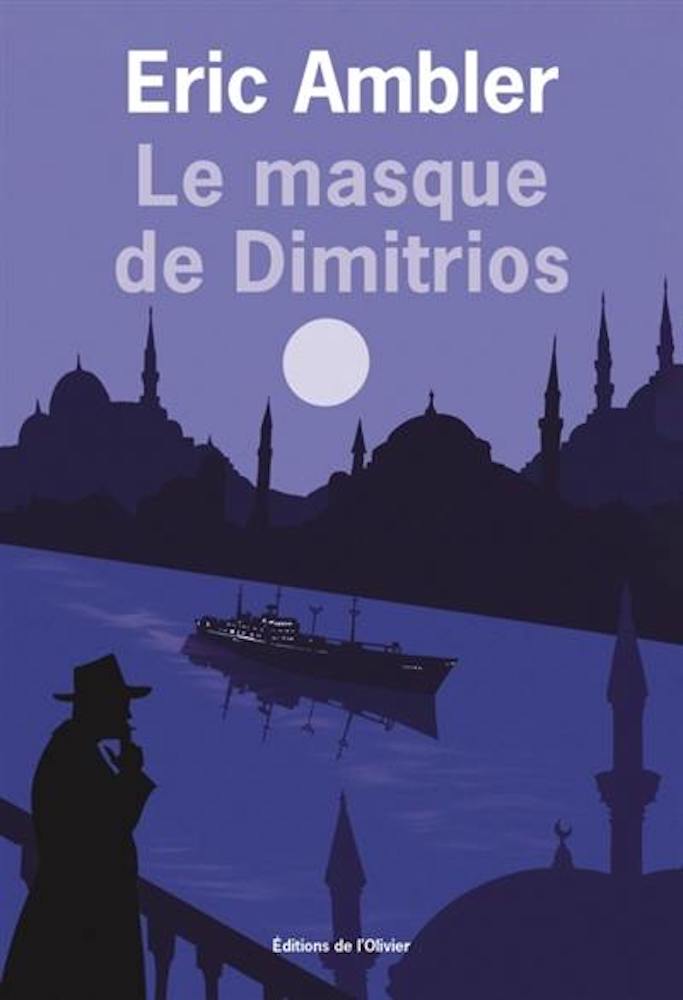
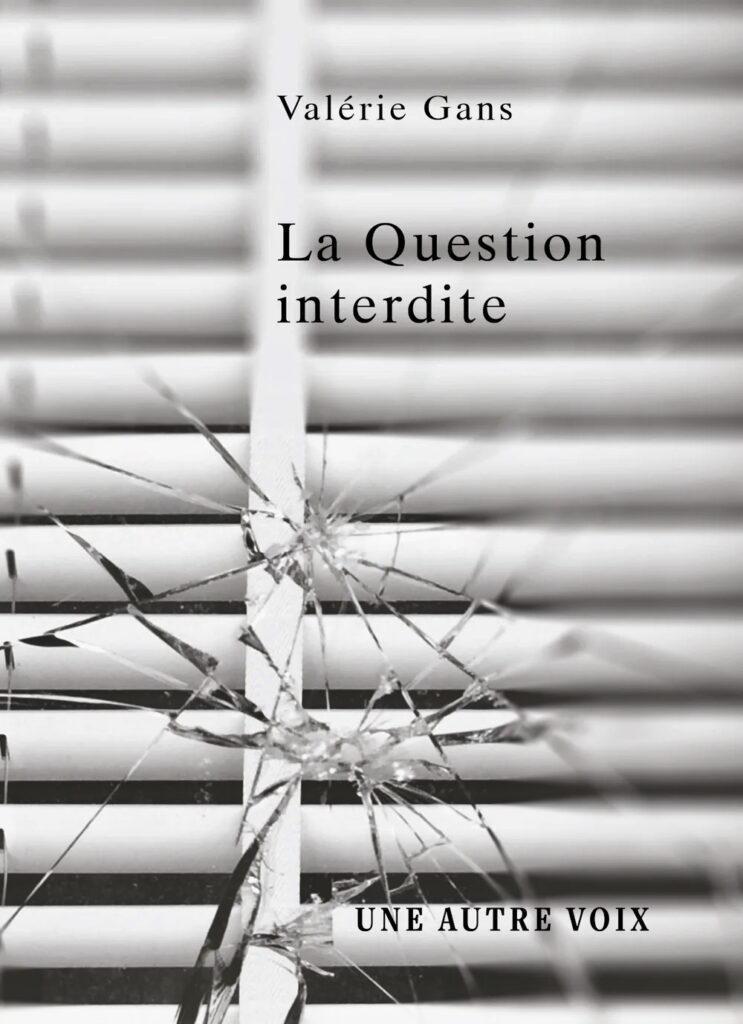
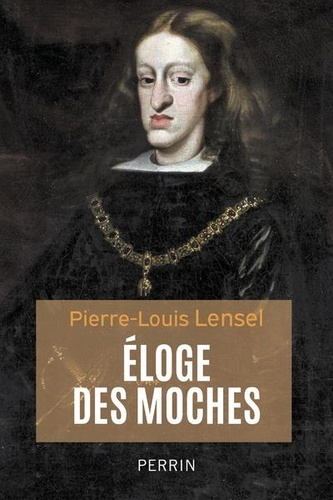
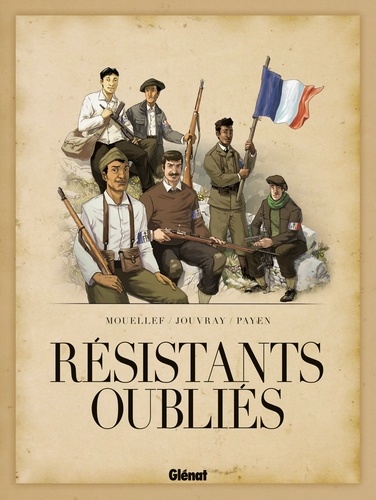

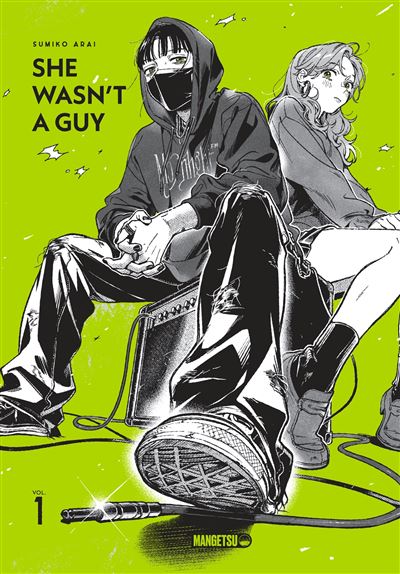
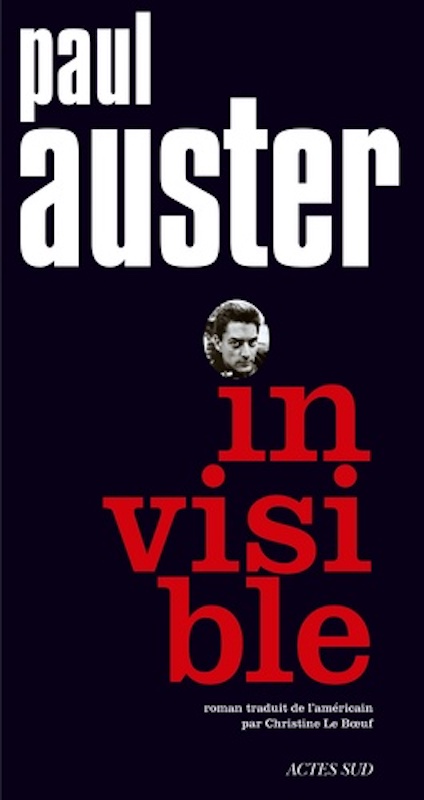
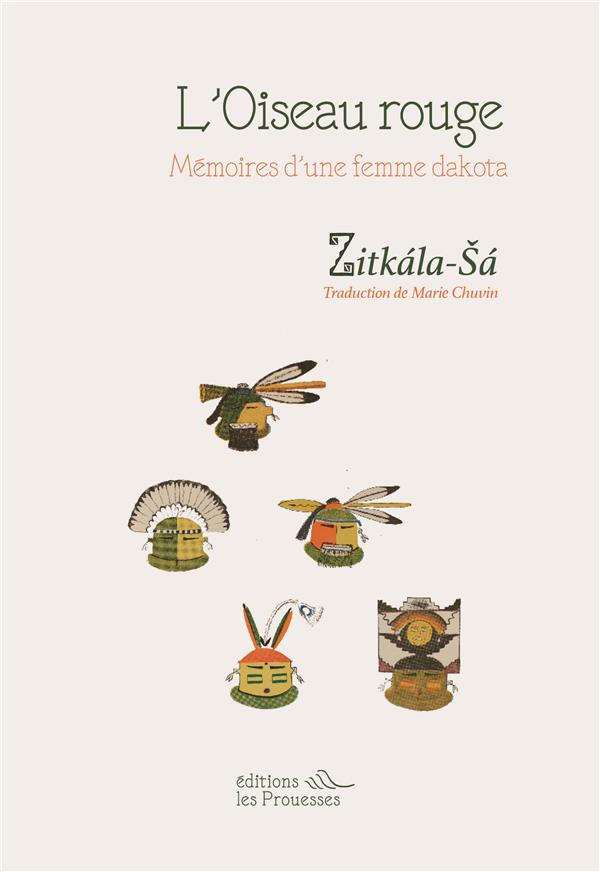


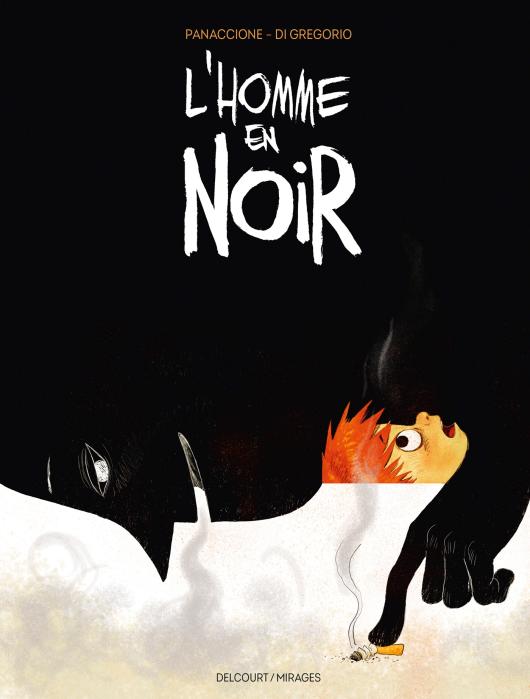



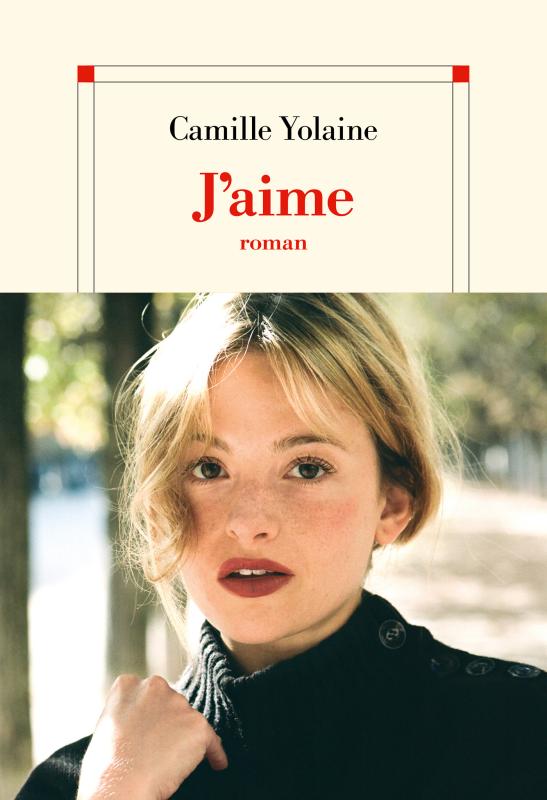
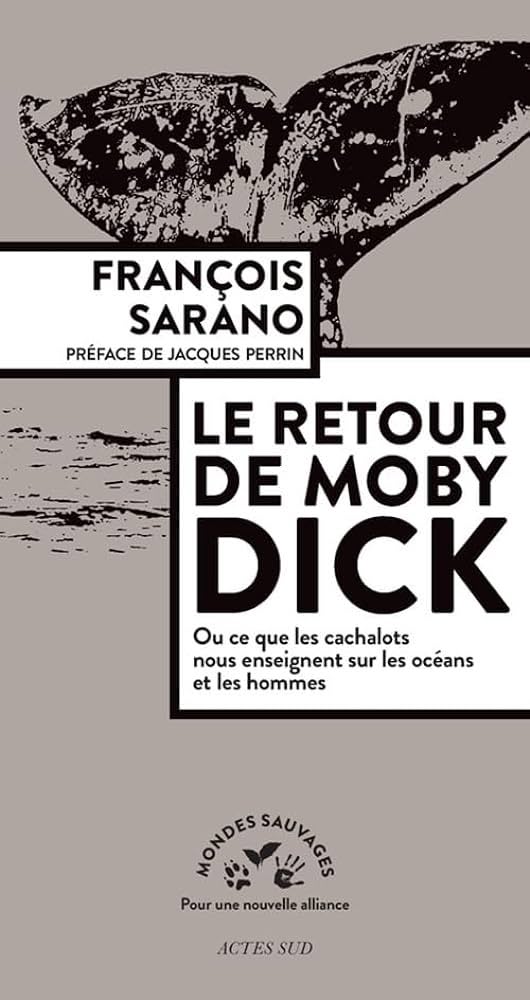




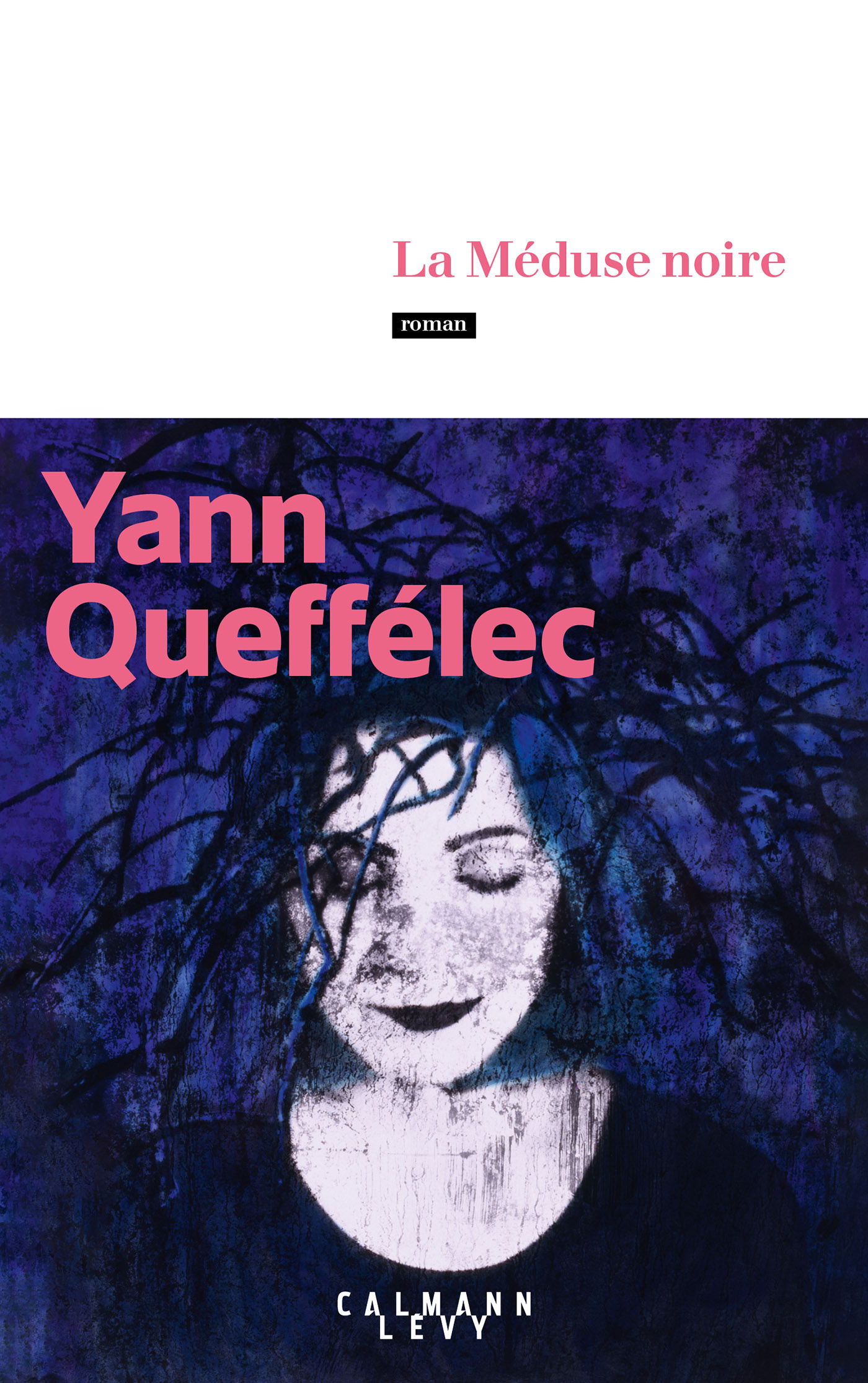




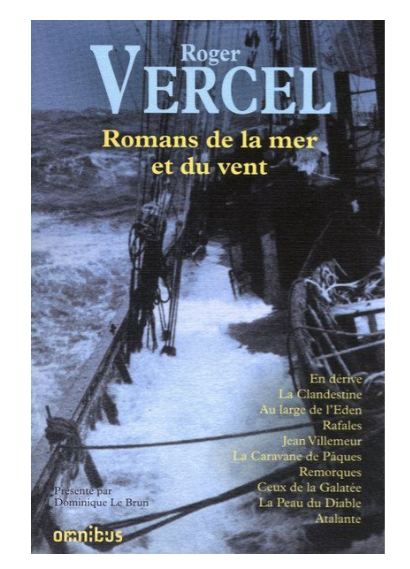

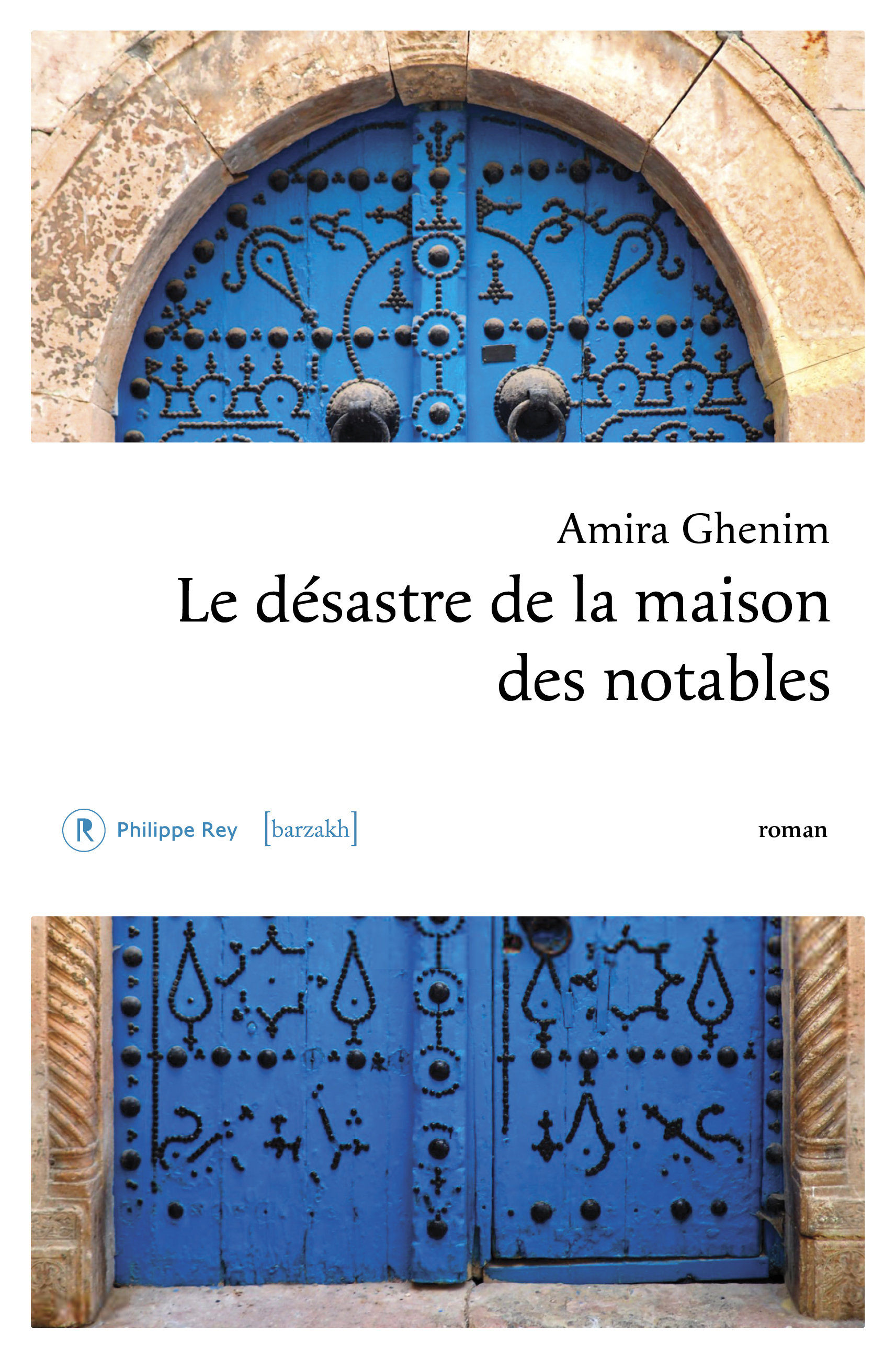
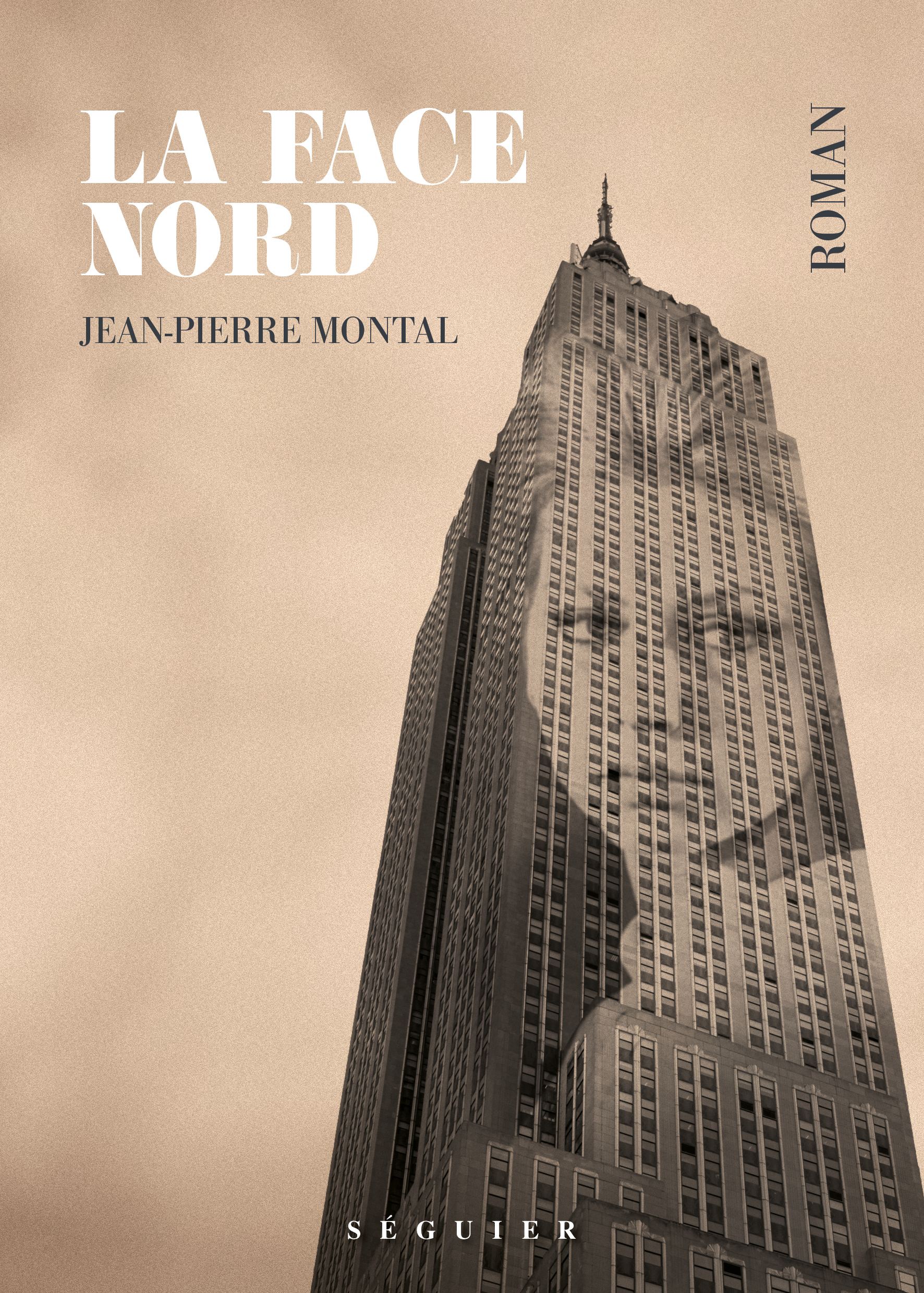



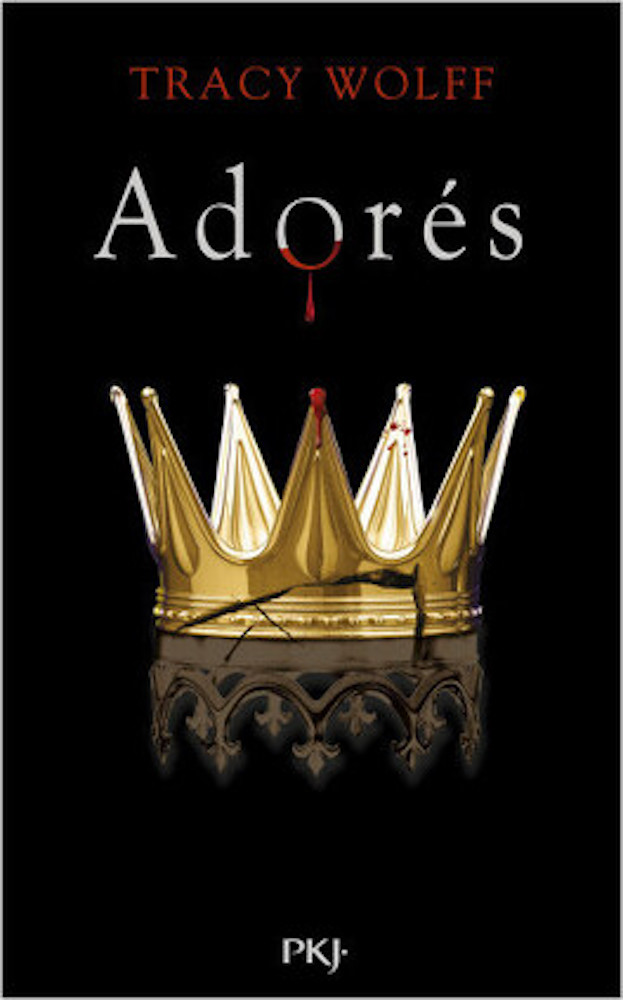
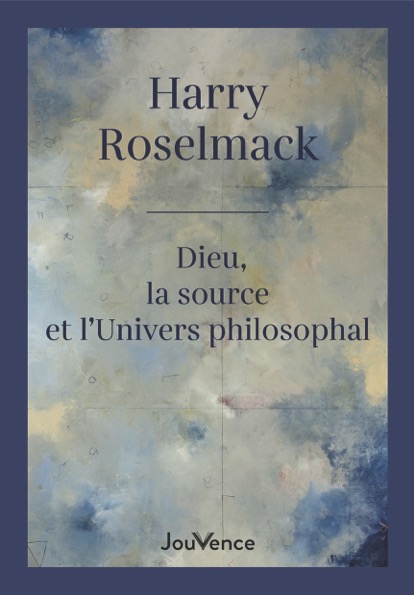
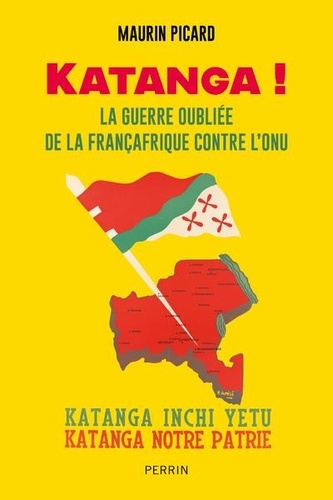

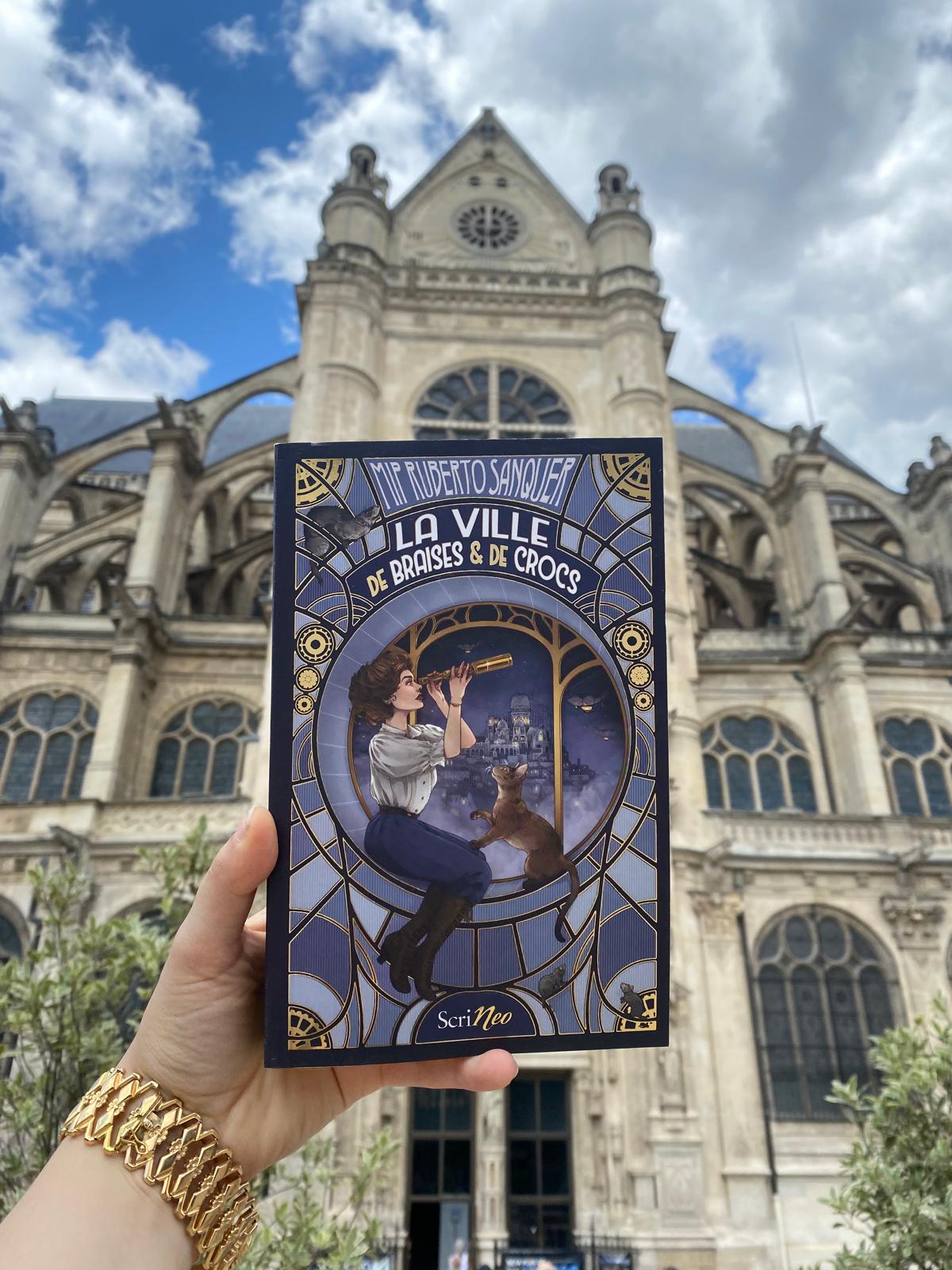



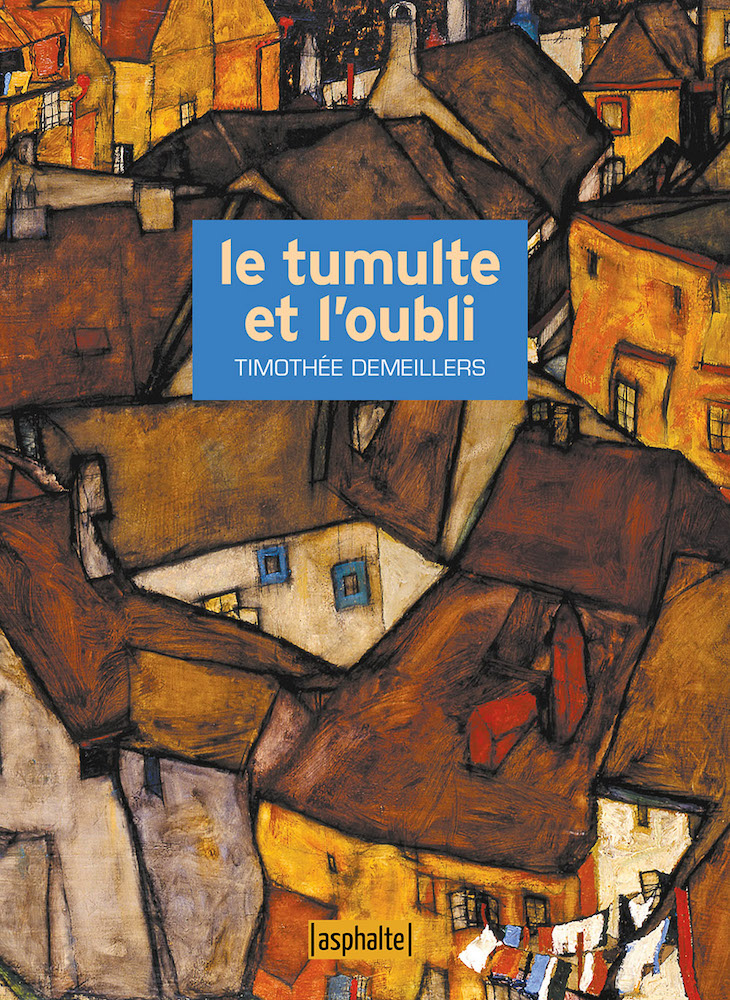


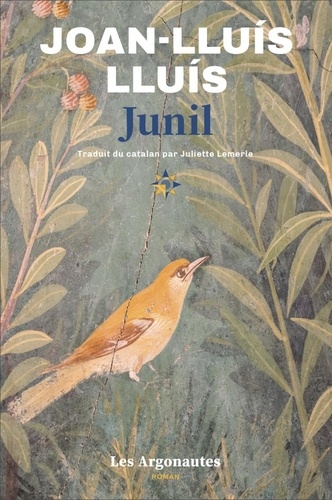


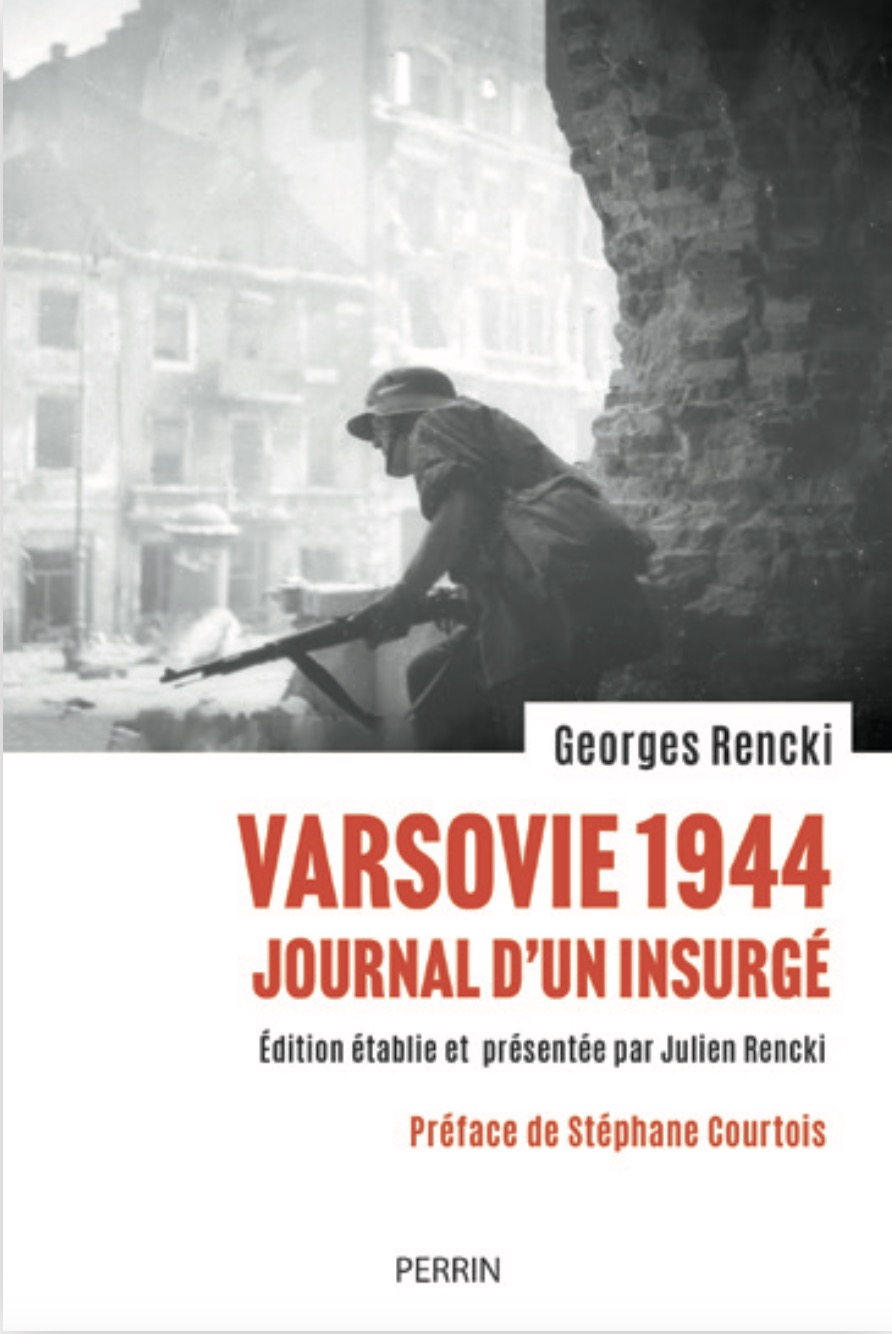
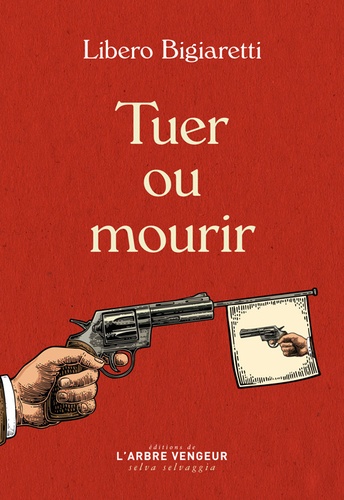




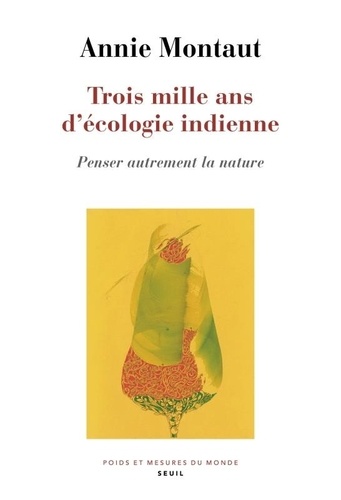
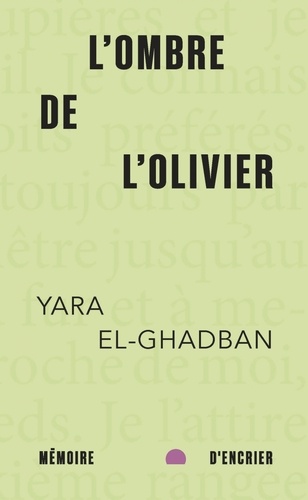
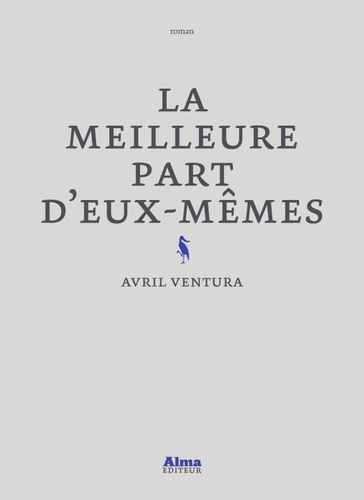

6 Commentaires
Dona
21/05/2019 à 14:29
Finalement il faut se délesté des fardeaux du snobisme et écrire pour être mal lu! J'ai aimé!
daniel
08/03/2022 à 08:47
Peut-être que Dona devrait, à tout le moins, apprendre l'orthographe !
Chris
24/05/2019 à 01:43
excellente analyse d"un bouquin libérateur
Max
27/05/2019 à 13:02
Merci pour ce retour Chris !
Baroutsaki
25/05/2019 à 15:03
impatiente de plonger dans son contenu!
Gaby
03/03/2021 à 21:39
Attention, Kant n’ouvre surtout pas la porte au relativisme ! Justement, c’est là la grande différence entre la satisfaction ( purement sensible ) et le plaisir esthétique : lorsqu’on juge que quelque chose est beau, on estime du même coup que chaque être humain devrait penser la même chose s’il se trouvait à notre place. L’agréable n’est pas le Beau ! " le Beau est ce qui plaît universellement sans concept " .