Voir Petrograd et mourir (de faim)
NOUVELLE ETRANGERE – Les Éditions Noir sur Blanc, dont la collection La bibliothèque de Dimitri est destinée à faire connaître la littérature des pays de l’Est dans le sillage de feu Vladimir Dimitrijević (fondateur des éditions suisses L’Âge d’Homme), ont exhumé L’Attrapeur de rats (1924), nouvelle sombre et énigmatique d’un auteur russe méconnu, Alexandre Grine.
Le 02/08/2019 à 10:20 par Maxime DesGranges
Publié le :
02/08/2019 à 10:20
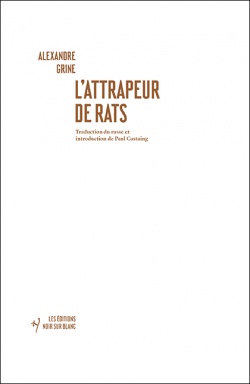
En réfléchissant à cette chronique pour vous, lecteurs et lectrices qui profitez de façon honteuse et déraisonnable de cette période d’évasion balnéaire pour vous imbiber de mauvaises lectures pendant que les matons de la critique ont le dos tourné vers une rentrée littéraire qui s’annonce aussi excitante qu’une scène de sexe d’un roman de Michel Houellebecq, j’ai pris conscience de quelque chose de tout bête, mais de frappant à la fois.
Dans une chronique récente, souvenez-vous, j’évoquais quelques traits saillants de l’année 1998 : Zizou, le tube de l’été, Titanic, le discman, etc. Et tout à coup j’ai réalisé, en coupant mes carottes bio dans ma cuisine pourrie, ou mes carottes pourries dans ma cuisine bio, je ne sais plus, que seulement 74 ans, c’est-à-dire, à l’échelle de l’Histoire, rien du tout, à peine la durée d’une vie à peu près épargnée par les cancers, les AVC et les romans de Paulo Coelho, seulement 74 ans, donc, séparaient 1998 de l’année de parution de L’Attrapeur de rats : 1924.
Et pour que vous preniez toute la mesure du gouffre civilisationnel qui sépare ces deux antipodes du même siècle, voici grosso modo ce qui se passait en 1924 dans la Russie d’Alexandre Grine : la guerre civile entre Armées rouge et blanche laissait un pays exsangue, Lénine mourait, Trotski était écarté du Parti par Staline qui prenait du même coup le contrôle du Comité central. Comme on dit : deux salles, deux ambiances.
Une certaine idée de la misère
À propos d’ambiance des années 20, Albert Londres disait justement de Saint-Pétersbourg, bientôt rebaptisée Leningrad, qu’elle était une « ville assassinée depuis deux ans et laissée là sans sépulture, et qui maintenant se décompose. » Et la (première !) psychiatre française Madeleine Pelletier, pourtant pleine d’enthousiasme révolutionnaire et d’espérance socialiste, écrivait lors de sa venue à Moscou : « Le quartier que nous traversons présente l’aspect de la désolation la plus lamentable. Les gens sont vêtus de guenilles et chaussés de chiffons retenus par des ficelles ; des femmes portent des robes en toile de sac. Beaucoup de ces gens ont sous le bras un énorme pain noir. » C’est donc dans ce genre de décor funeste que se déroule L’Attrapeur de rats.
Du pain noir, le narrateur de notre histoire n’en a pas un quignon. Tiraillé par la faim, affaibli par le typhus, accablé par l’insomnie, il est contraint de vendre de vieux livres pour trois fois rien sur un marché en ruines en plein hiver (printemps, en fait, mais un mois de mars russe vaut bien un hiver français, et de toute façon, comme tout récit russe digne de ce nom : la neige tombe encore et « l’épuisement et les morsures du froid irradiaient chaque visage ». Bref, c’est l’hiver même au printemps).
Intrusions de l’auteur et « rêve fictionnel »
Avant même de présenter son héros, Grine propose par ailleurs une entrée en matière assez curieuse : « Au printemps 1920, précisément en mars, précisément le 22 du mois (sacrifions à l’exactitude pour payer notre droit d’admission dans le sanctuaire des documentalistes patentés, faute de quoi le lecteur, si tatillon de nos jours, ira sûrement enquêter dans les salles de rédaction), je me rendis au marché. Je me rendis au marché le 22 mars, et, je le répète, de l’année 1920. » Cette pointe de sarcasme semble indiquer que les temps ne sont plus aux romans d’aventure que Grine a l’habitude d’écrire, et que le réel est devenu si pesant, si imposant, qu’un écrivain ne peut plus se permettre la fantaisie de le contourner (en tout cas sans utiliser de subterfuges), de se réfugier dans l’imaginaire.
Signes de cette contrainte nouvelle de réalisme : des descriptions percutantes et efficaces amorcent rapidement le récit : « À ma droite se tenait une vieille femme en burnous, coiffée d’un antique chapeau noir orné de perles de verroterie. Branlant du chef d’un mouvement mécanique, elle tendait aux passants de ses doigts noueux une paire de bonnets d’enfant, des rubans et un petit paquet de cols jaunis. À ma gauche, une jeune fille, de sa main restée libre, serrait sous son menton un douillet fichu gris ».
D’un coup, nous voilà transportés au cœur de ce marché en ruines ; on commence à ressentir le froid, à apercevoir les personnages, la foule miséreuse au-dessus de laquelle tournoie la neige fondue ; quand soudain Grine nous sort une de ces phrases lourdes et disgracieuses qui ponctuent malheureusement le texte à différents endroits : « Nous portons de l’intérêt à ceux qui répondent à notre conception de l’homme dans une circonstance donnée ; c’est pourquoi je demandai à la jeune fille comment marchait son petit commerce. »
Plusieurs fois, et c’est à mon sens l’un des défauts les plus flagrants du livre, celui qu’on estime être Grine lui-même fait irruption dans le texte pour délivrer des remarques complètement hors de propos qui brisent la continuité du récit, et interrompent le fameux « rêve fictionnel » dont parlait John Gardner que nous avons évoqué dans une précédente chronique.
Un exemple évident se trouve dans le passage qui suit, où Grine / narrateur (on ne sait plus bien les distinguer, dans ces moments-là) donne l’impression de régler ses comptes encore une fois avec le réalisme, assez maladroitement d’ailleurs : « La table nue, le chalet dégarni, un tabouret, une tasse sans soucoupe, une poêle à frire et une bouilloire dans laquelle je faisais cuire mes pommes de terre. Mais assez de ces évocations. Le génie du terre-à-terre se détourne souvent du miroir que lui présentent avec application des gens irréprochablement instruits et qui étalent leurs grossières élucubrations dans la nouvelle orthographe avec autant de succès que naguère dans l’ancienne ».
Un dernier exemple : Grine nous décrit de manière très juste et émouvante un monde de misère où prévaut « l’instinct de conservation qui lutte si vaillamment pour la chaleur, la survie des proches et la nourriture. Je vis comment on garnit un poêle avec le buffet, comment on fait bouillir l’eau sur la lampe, comment on grille un morceau de cheval à l’aide d’huile de coco et comment on maraude des poutres de bois dans les ruines. » Et voilà qu’il ajoute son habituelle remarque superflue : « Mais toutes ces choses et beaucoup d’autres, et bien plus nombreuses encore, ont déjà été décrites par des plumes qui déchiquettent les sujets nouveaux en mille lambeaux. Nous ne toucherons pas à ce morceau disputé. »
Un héros sur la brèche dans une ville en lambeaux
Mais passons sur ce petit défaut de style. Pour l’instant nous sommes au marché et la jeune fille à côté de lui, qui vend des livres elle aussi, aide notre pitoyable héros à refermer le col de son manteau avec une épingle, puis inscrit son numéro de téléphone sur un livre que le narrateur finit par vendre. Il perd donc le numéro de celle qui devient « la jeune fille à l’épingle de sûreté ».
Peu de temps après, le narrateur perd connaissance à cause de la maladie (le typhus est d’ailleurs porté notamment par les rats), et on le transfère à l’hôpital où il reste trois mois. Est-ce là le déclenchement d’un délire, d’un long cauchemar, d’un fantasme dans lesquels se déploie le reste du récit, inquiétant et angoissé, au cours duquel « la jeune fille à l’épingle », comme un guide vers le salut, ne cesse de réapparaître (y compris au téléphone, alors qu’il avait précisément égaré son numéro) ? On passe en tout cas le plus clair de notre temps de lecture à se poser la question, sans jamais vraiment pouvoir y répondre.
Le cœur de la nouvelle arrive assez vite. À sa sortie de l’hôpital, le héros cherche une place où dormir et se réchauffer. Un intermédiaire lui donne alors accès aux gigantesques locaux abandonnés de la Banque centrale. C’est à partir de là que la nouvelle prend véritablement son ampleur.
« Do not go gentle into that good night » (Dylan Thomas)
Le héros pénètre en effet dans un espace labyrinthique et mystérieux, compartimenté par une infinité de murs et de portes :
À peine avais-je franchi une porte que devant moi et sur les côtés j’en apercevais d’autres qui s’ouvraient vers la lumière blafarde de lointaines perspectives percées d’ouvertures encore plus sombres. Les planchers marquetés étaient encombrés de papier comme de neige souillée les chemins au printemps. L’abondance de ce papier rappelait le spectacle d’une rue qu’on nettoie de ses congères. Dans certaines salles, dès le seuil, on enfonçait jusqu’aux genoux dans cette paperasse chancelante. Un mélange omniprésent de papiers de toutes formes, de toutes destinations, de toutes couleurs déferlait en un véritable déluge. Le papier s’élevant à l’assaut des murs s’écroulait en avalanches, envahissait l’embrasure des fenêtres. L’inondation blanchâtre progressait de parquet en parquet, alimentée par les cascades des armoires béantes ; elle emplissait les recoins. Par endroits, c’était comme des talus ou des champs défoncés. Les blocs-notes, les formulaires, les livres de comptes, les étiquettes, les colonnes de chiffres, les textes imprimés ou manuscrits, tout le contenu de mille armoires éventrées s’étalait au regard et les yeux papillotaient, offensés par l’intensité de la sensation.
De là, on ne peut évidemment s’empêcher de voir une allégorie de ce que deviendra la bureaucratie tentaculaire, chaotique et oppressante de l’URSS. Sans doute Grine ne l’a-t-il pas sciemment imaginé en écrivant sa nouvelle (comme Noir Désir n’avait pas prévu non plus de sortir « Le Grand incendie » le 11 septembre 2001, mais c’est autre chose). Mais le symbole que représente cette immense Banque centrale laissée en ruines, étouffant de paperasse au point de former de « blêmes horizons de papier », est trop puissant pour s’interdire d’attribuer à l’auteur, à son corps défendant peut-être, une vision quasi prophétique du destin du pays, et c’est aussi ce qui rend ces passages fascinants.
D’ailleurs, en avançant dans la « substance médullaire de la banque, foulant aux pieds la noire semence des chiffres », le narrateur est saisi de la sensation d’errer « dans les siècles passés travestis par un sortilège », le sortilège, nous apparaît-il de façon assez transparente, de la Révolution ayant mis à bas cet « ennemi qui n’a pas de nom, pas de visage, mon ennemi, c’est le monde de la finance » (selon la célèbre diatribe d’un guérillero révolutionnaire français).
La paperasse et le vide comme seuls horizons
Interprétation capillotractée par un chroniqueur paresseux, me direz-vous. Peut-être, mais les allusions sont tout de même trop nombreuses pour être fortuites. Le narrateur lui-même vient au secours de notre hypothèse avec des images fortes qui apparaissent comme des fulgurances : « L’exaltation que procure la vue d’un énorme incendie me fut à nouveau compréhensible. La tentation de la destruction montait en moi comme une inspiration poétique : j’avais sous les yeux un paysage original, une contrée, tout un pays même. »
Ou encore cette intuition étrange : « Ces impressions provoquaient une sorte de démangeaison cérébrale qui rendait fascinante l’idée d’une catastrophe, un peu comme ce magnétisme intérieur qui vous pousse à regarder dans le vide. Il semblait qu’en ces lieux une pensée unique répétée en écho enveloppât toute forme ».
Et pour progresser dans cet espace infini gagné par les ténèbres : « il me fallut faire l’ascension d’une montagne glissante de dossiers cartonnés dans lesquels je m’enlisais », « On s’embourbait dans les duplicatas, plus haut que la poitrine. » « Partout la même uniformité : des monceaux de paperasse, le vide souligné par des fenêtres ou une porte, et partout l’attente d’une multitude de portes semblables, ouvertes sur la solitude. »
Les noces funèbres
Peu à peu – et à partir du moment où le héros tombe sur une armoire débordante de nourriture (et de rats), on bascule vers un registre plus surnaturel (en gardant à l’esprit qu’il puisse s’agir d’un délire fiévreux, même si le narrateur nous assure qu’« il ne s’agissait pas d’une illusion des sens ») : le bâtiment devient un lieu hanté où se succèdent les pièges et les jeux d’illusions dangereuses voire mortelles, et où le héros, pourtant motivé plus tôt par un « souci de réalisme », doit faire face à « un enchaînement de retentissantes invraisemblances. »
D’ailleurs, depuis une cachette où il s’est réfugié, il entend qu’a lieu un grand rassemblement dans l’immense hall de la banque : les « rats » font la noce, acclament celui qu’ils appellent « l’Affranchisseur », veulent la peau de celui qu’ils appellent « l’Attrapeur de rats » pendant qu’un « orateur épanchait son discours monotone ». Cette « absurdité » relève-t-elle d’une « hallucination auditive », le héros est-il « la proie de visions troubles » ou de « visions de l’esprit » comme il commence à le penser ? L’ambiguïté est permanente et c’est elle qui nous fait poursuivre la lecture.
Une nouvelle à couloirs multiples
Sur l’intrigue, je n’en dirai pas davantage et laisse au lecteur curieux le soin de la découvrir. Quoi qu’il en soit, c’est un récit mystérieux et intrigant que cet Attrapeur de rats, développé dans une ambiance sombre et oppressante, et livré par un auteur singulier à la vie rocambolesque (copiste, mendiant, matelot, révolutionnaire, chercheur d’or, écrivain… : la brève chronologie placée à la fin du livre me rend en tout cas cet homme-là immédiatement sympathique).
Même si la nouvelle n’est pas exempte de défauts comme je l’ai évoqué brièvement (intrusions intempestives de l’auteur mais aussi quelques clichés d’histoires d’épouvante notamment, et des mystères qui mériteraient d’être éclaircis autrement que par la simple explication possible de la maladie), l’histoire et ses zones d’ombres peuvent être interprétées de différentes manières et c’est cette richesse de sens qui le rend intéressant.
Mais comme le dit le personnage qui ouvre la porte de la Banque centrale au narrateur : « La clé existe, me précisa-t-il, mais ce n’est pas moi qui l’ai – celui qui connaît le secret peut entrer très facilement. »
Alexandre Grine, trad. Paul Castaing - L’attrapeur de rats - Éditions Noir sur Blanc, coll. La bibliothèque de Dimitri - 9782882505750 - 11 €
L'attrapeur de rats
Paru le 23/05/2019
88 pages
Les Editions Noir Sur Blanc
11,00 €



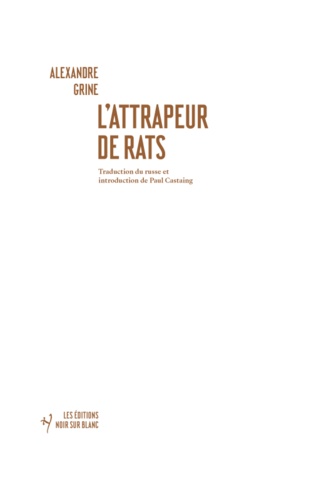
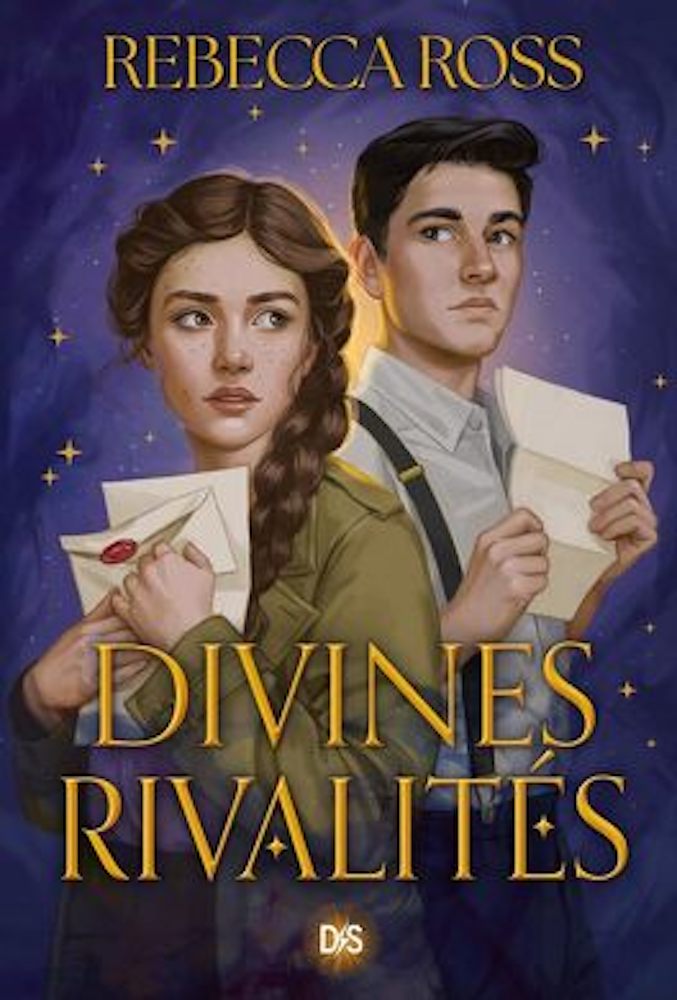
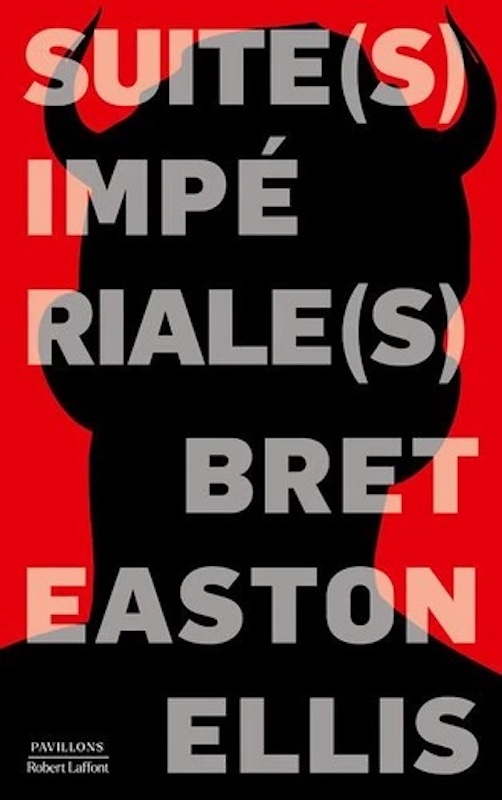

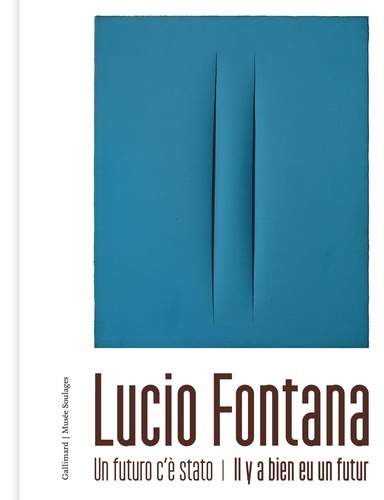

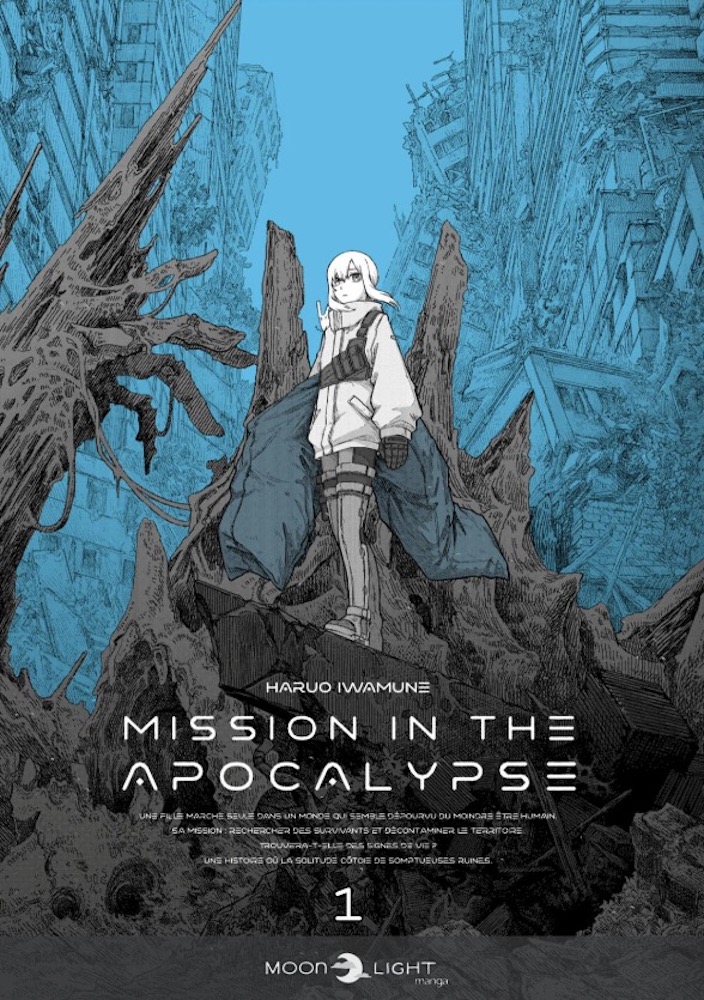
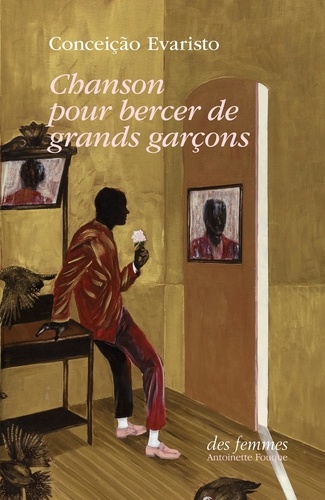
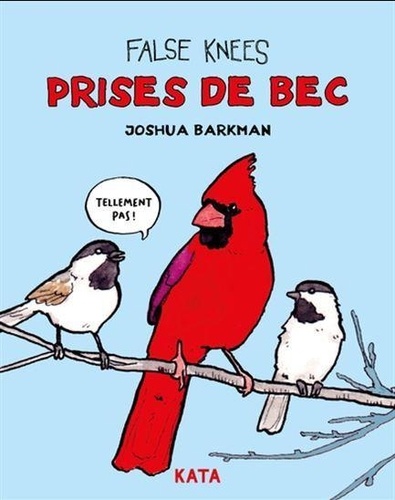
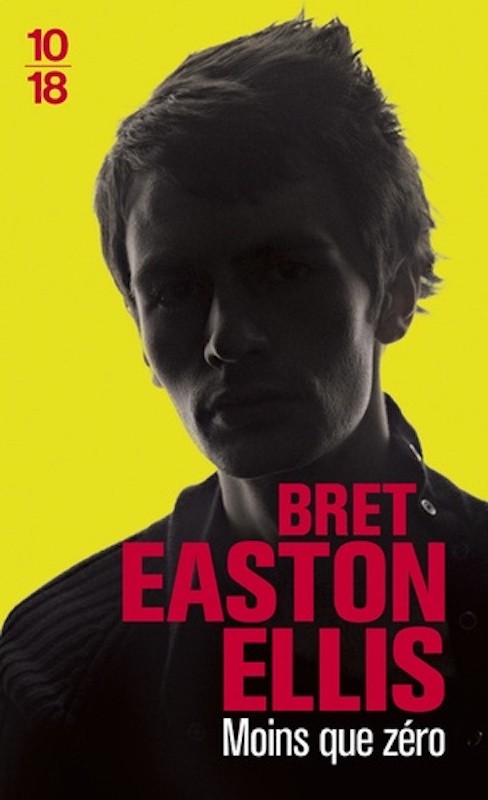

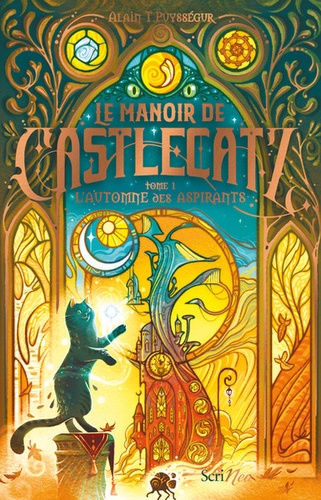

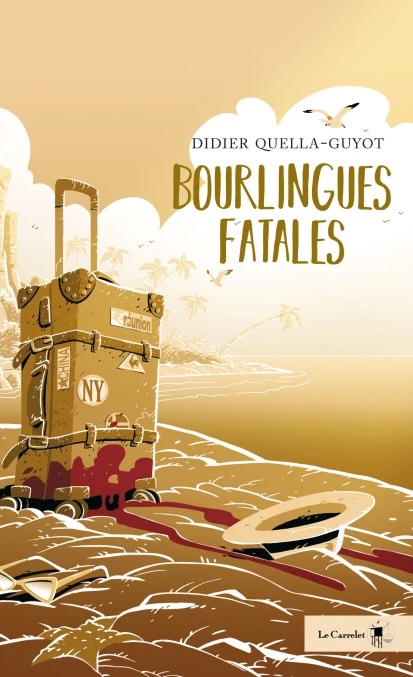

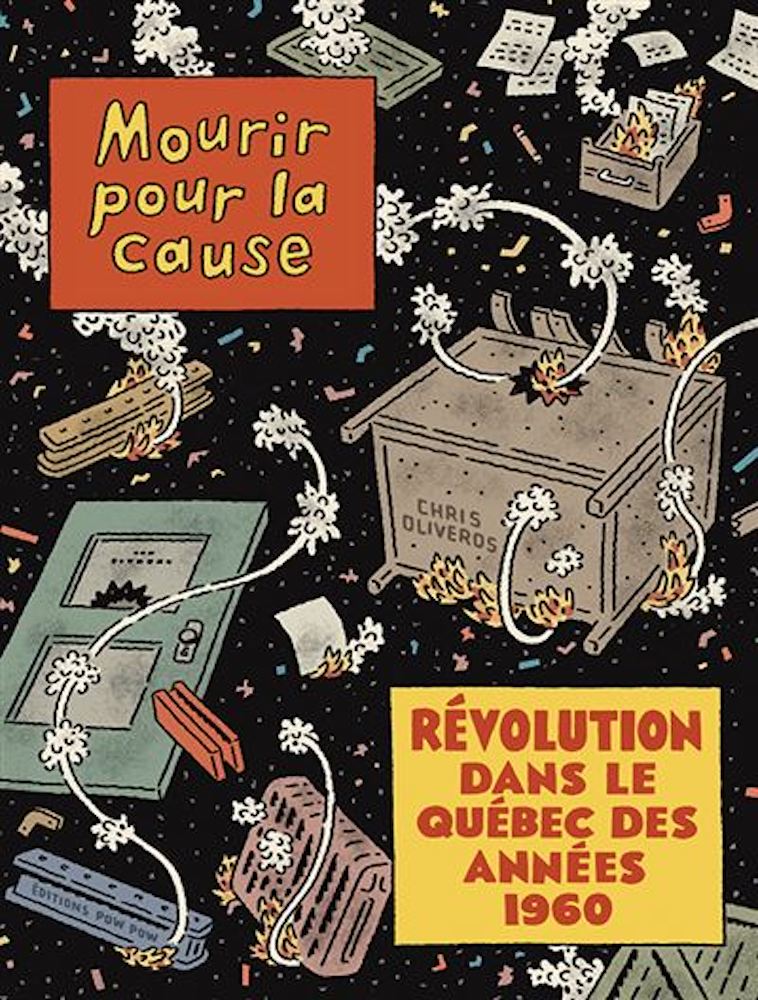
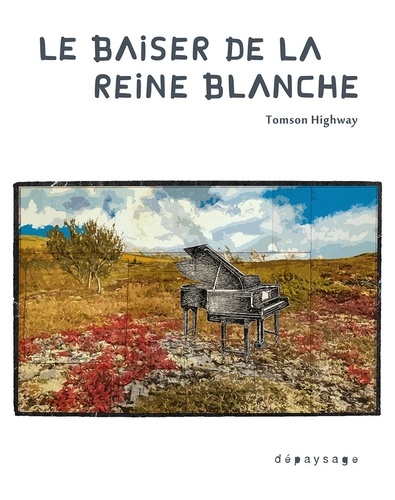
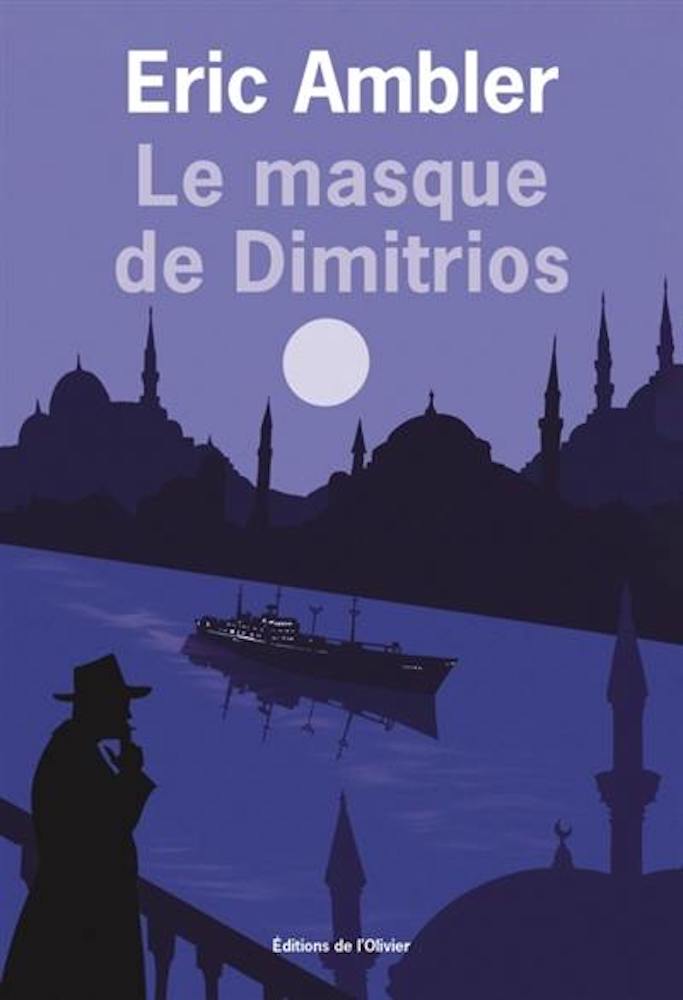
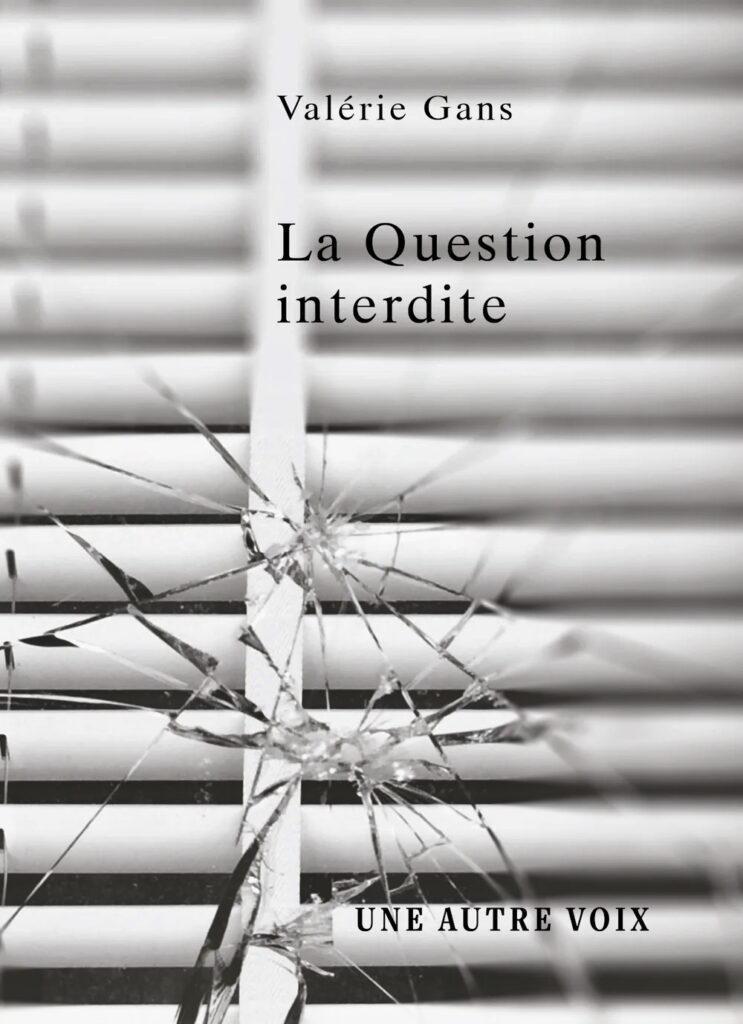
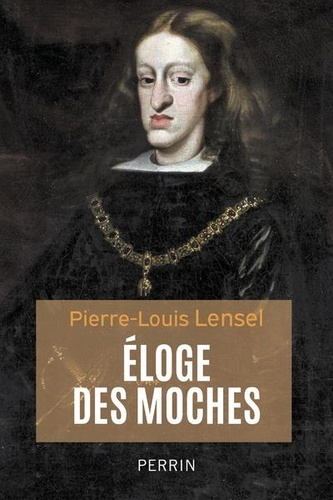
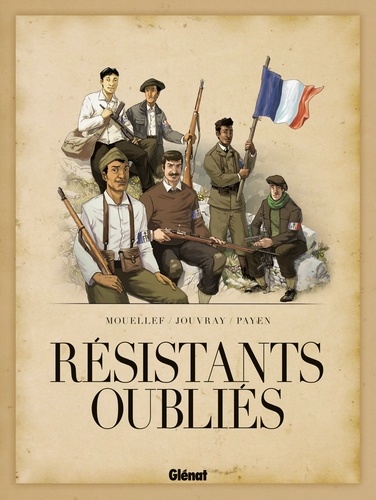

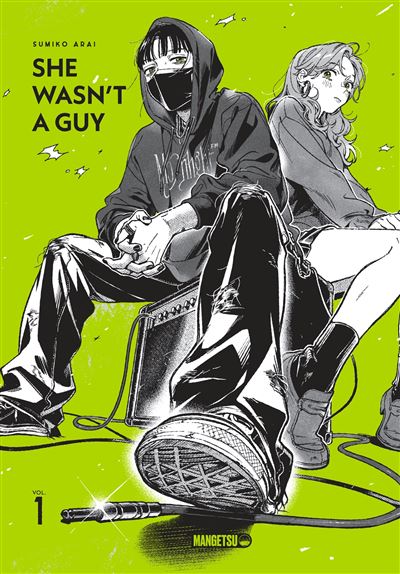
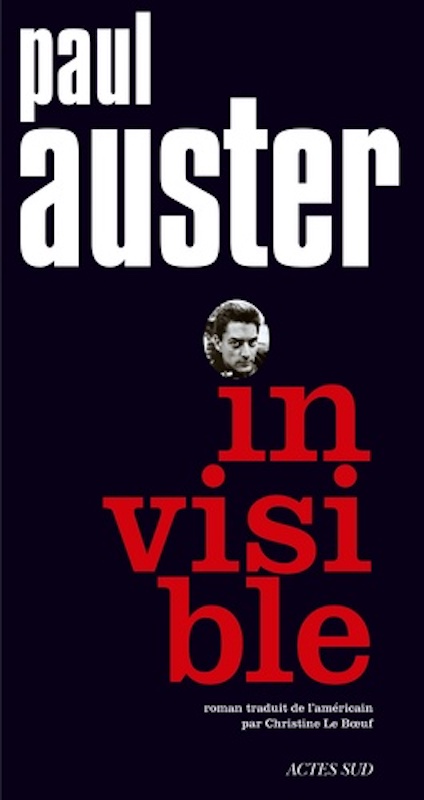
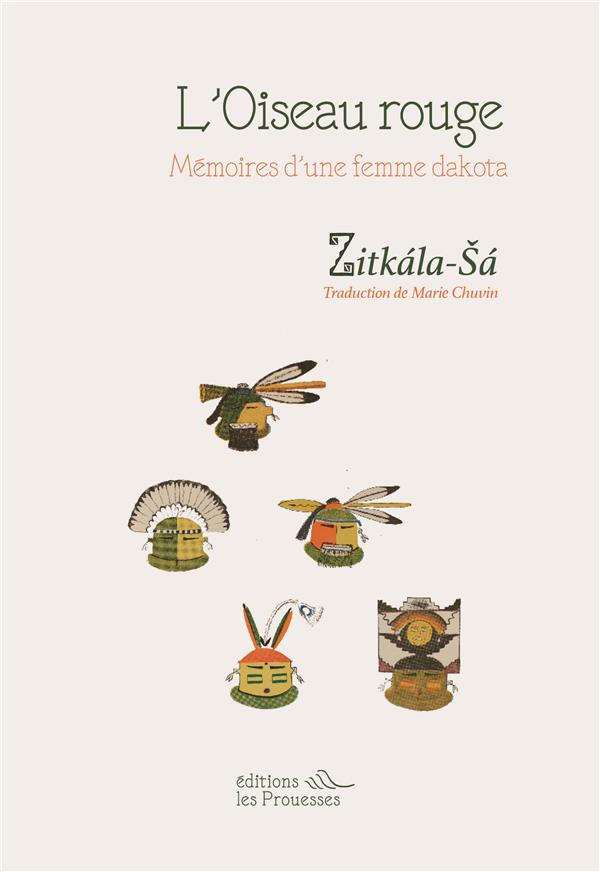


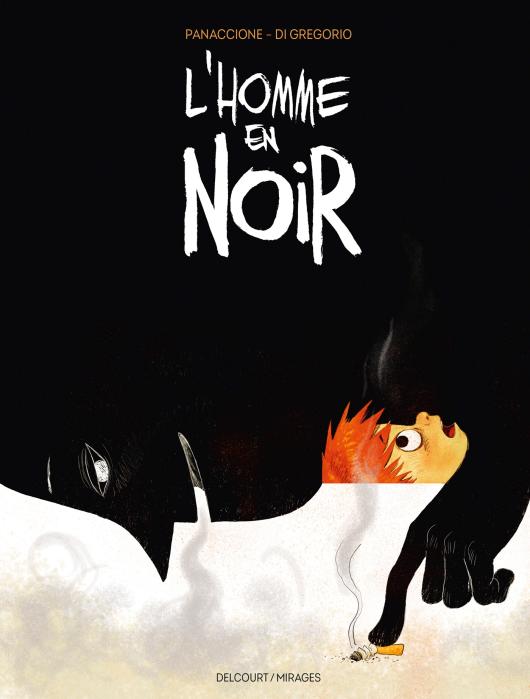



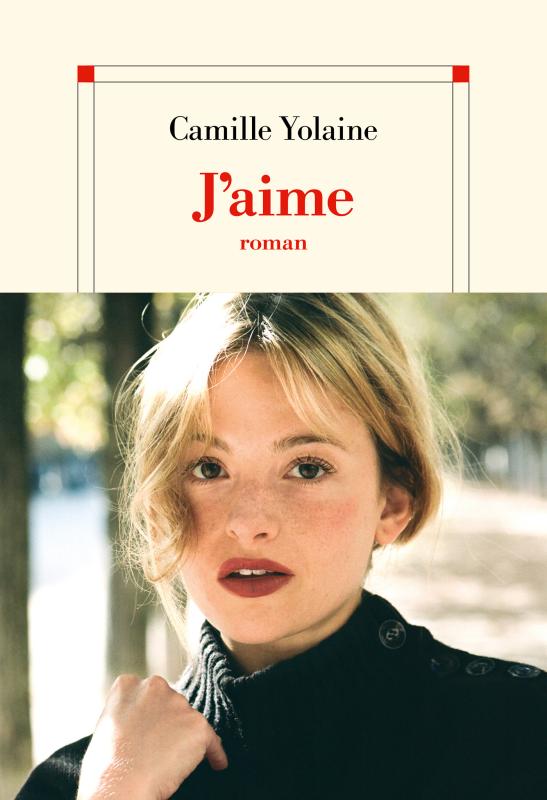
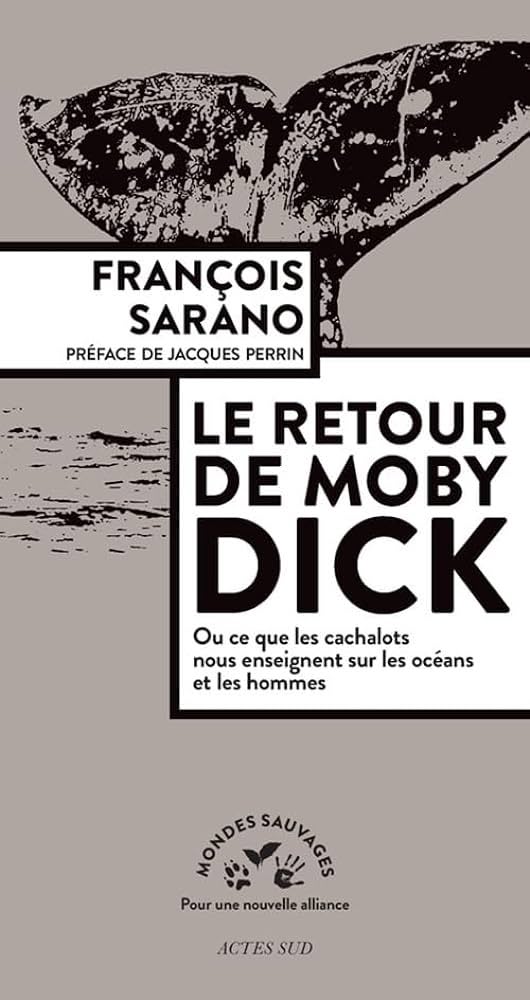




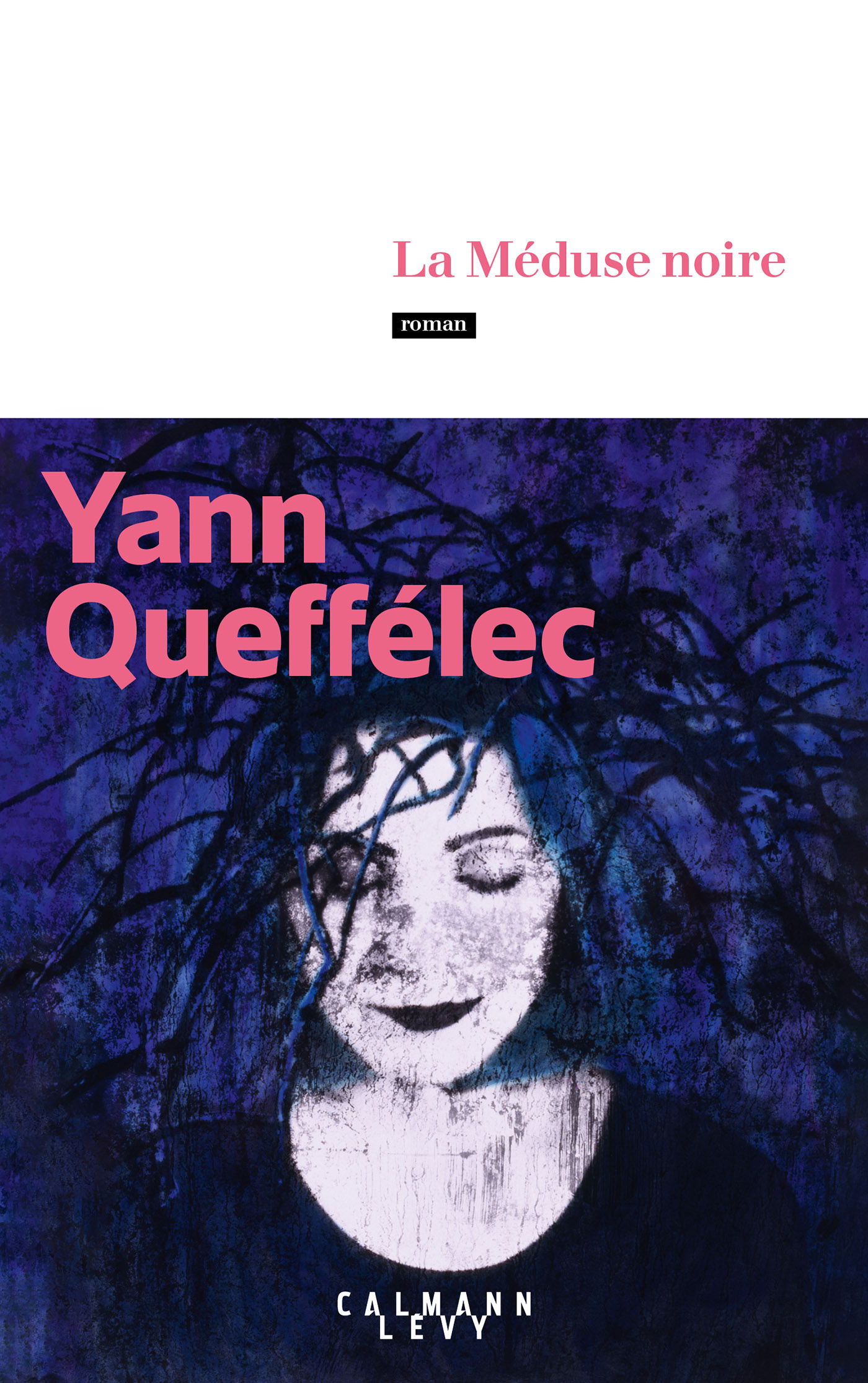




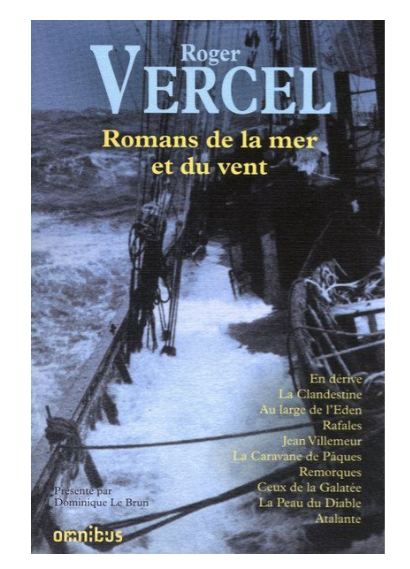

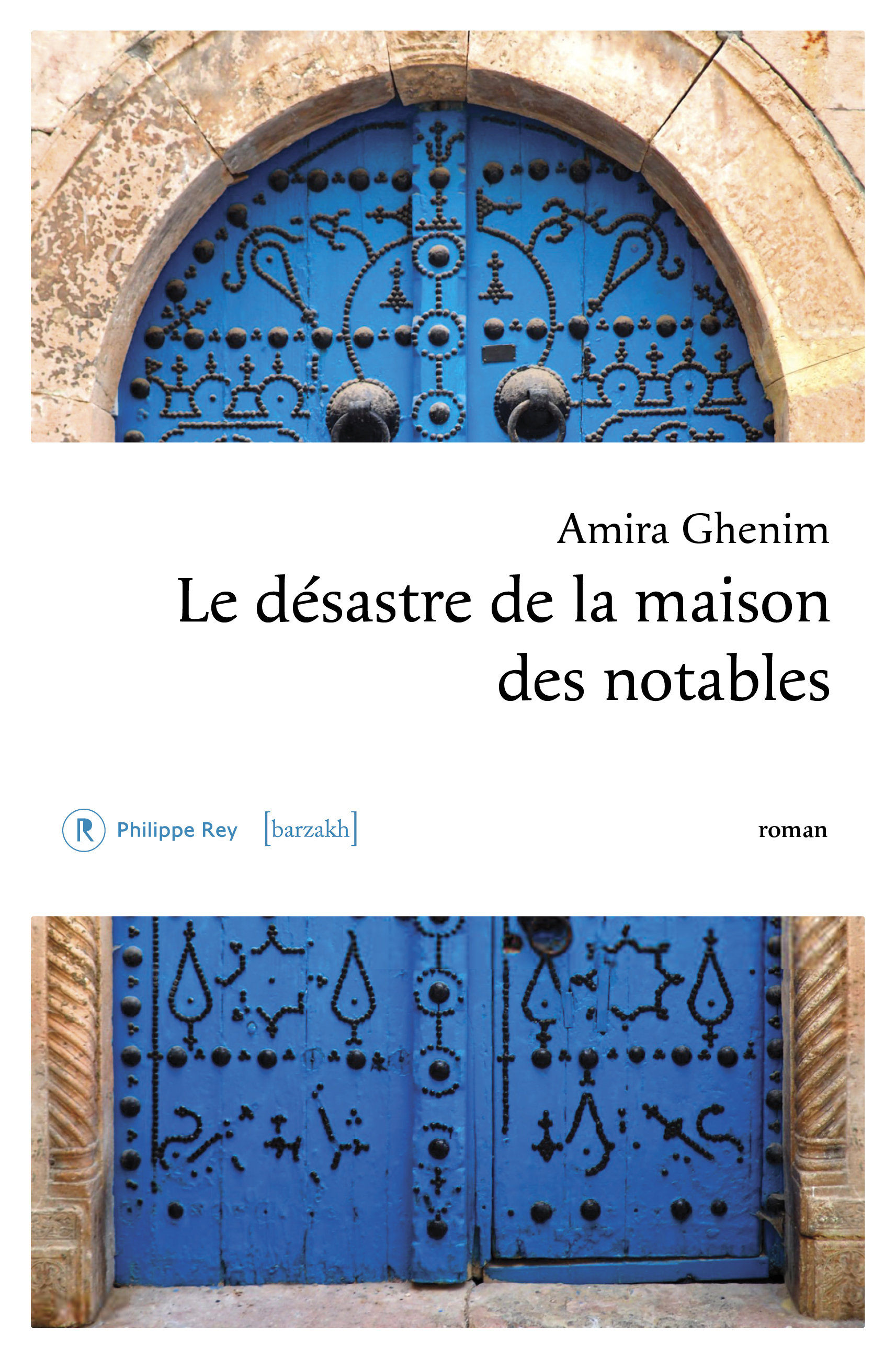
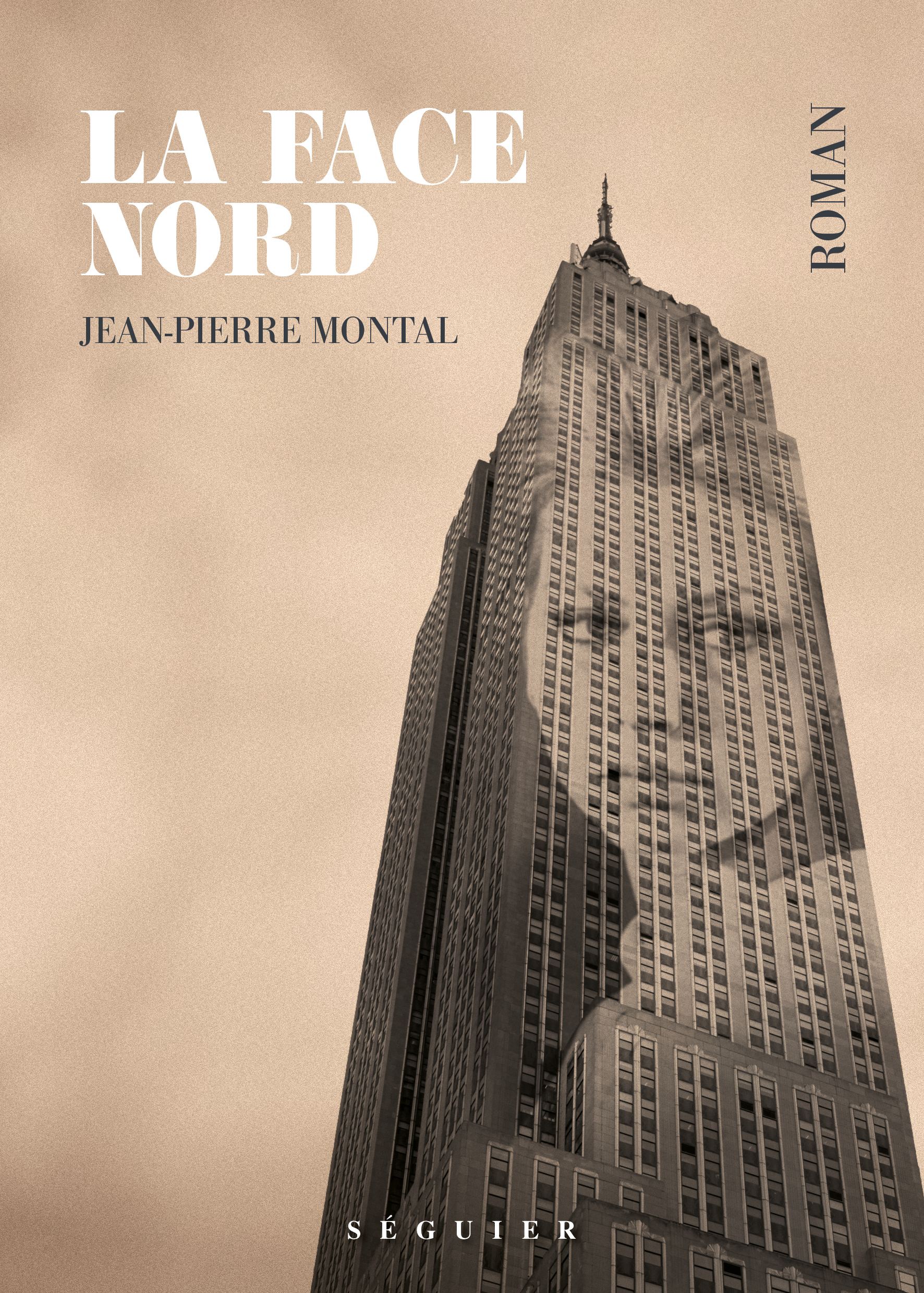



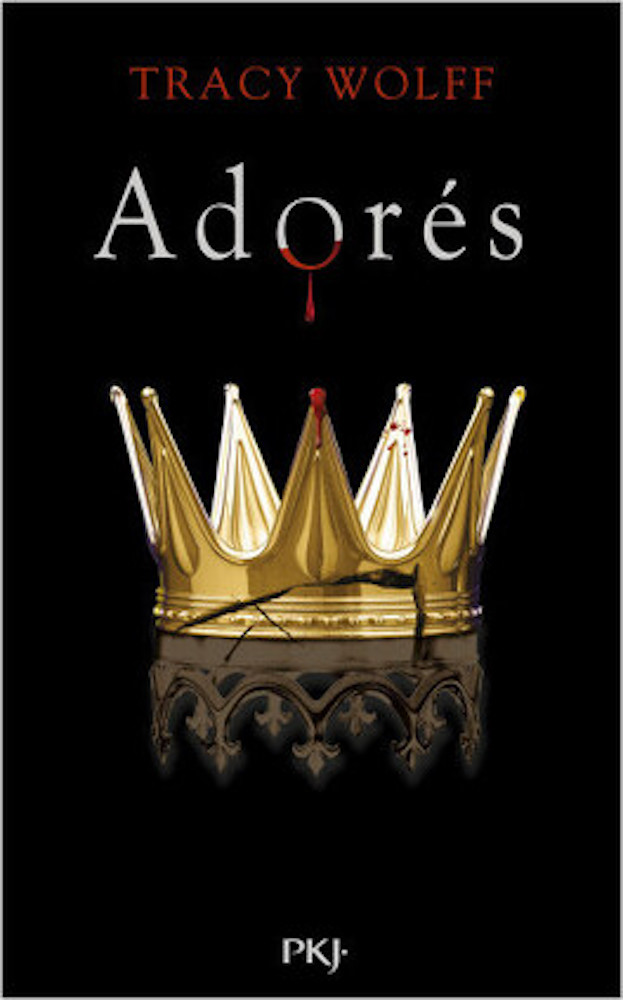
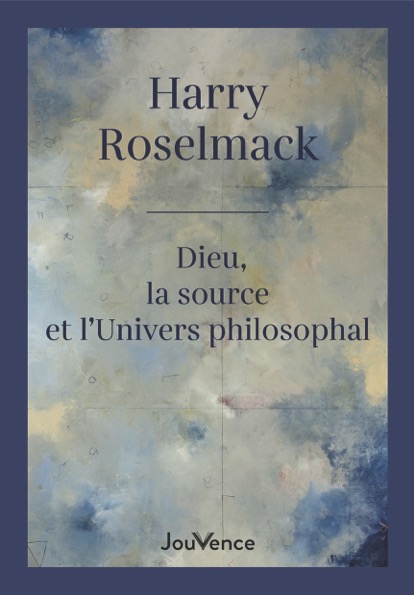
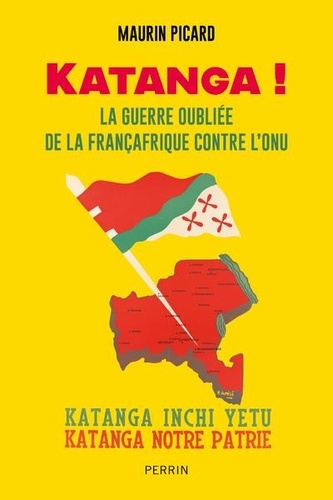

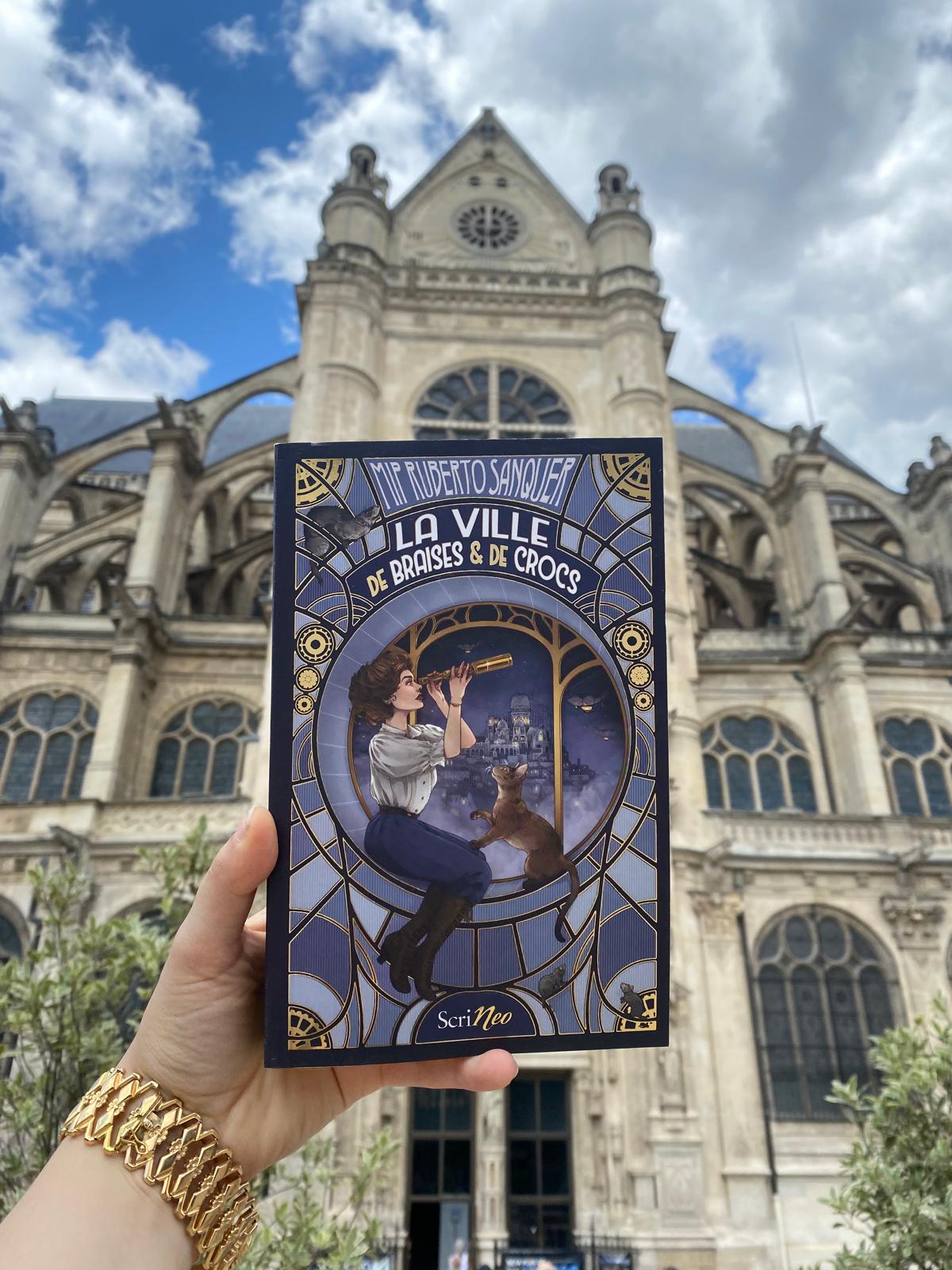



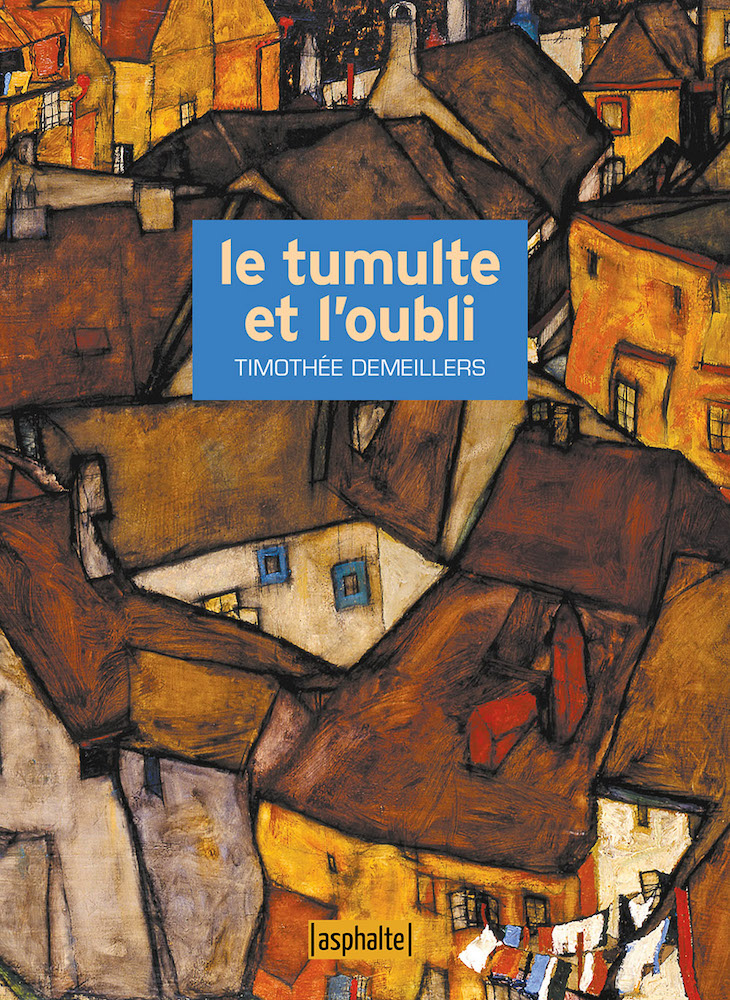


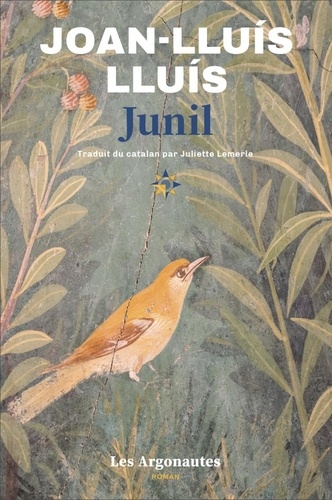


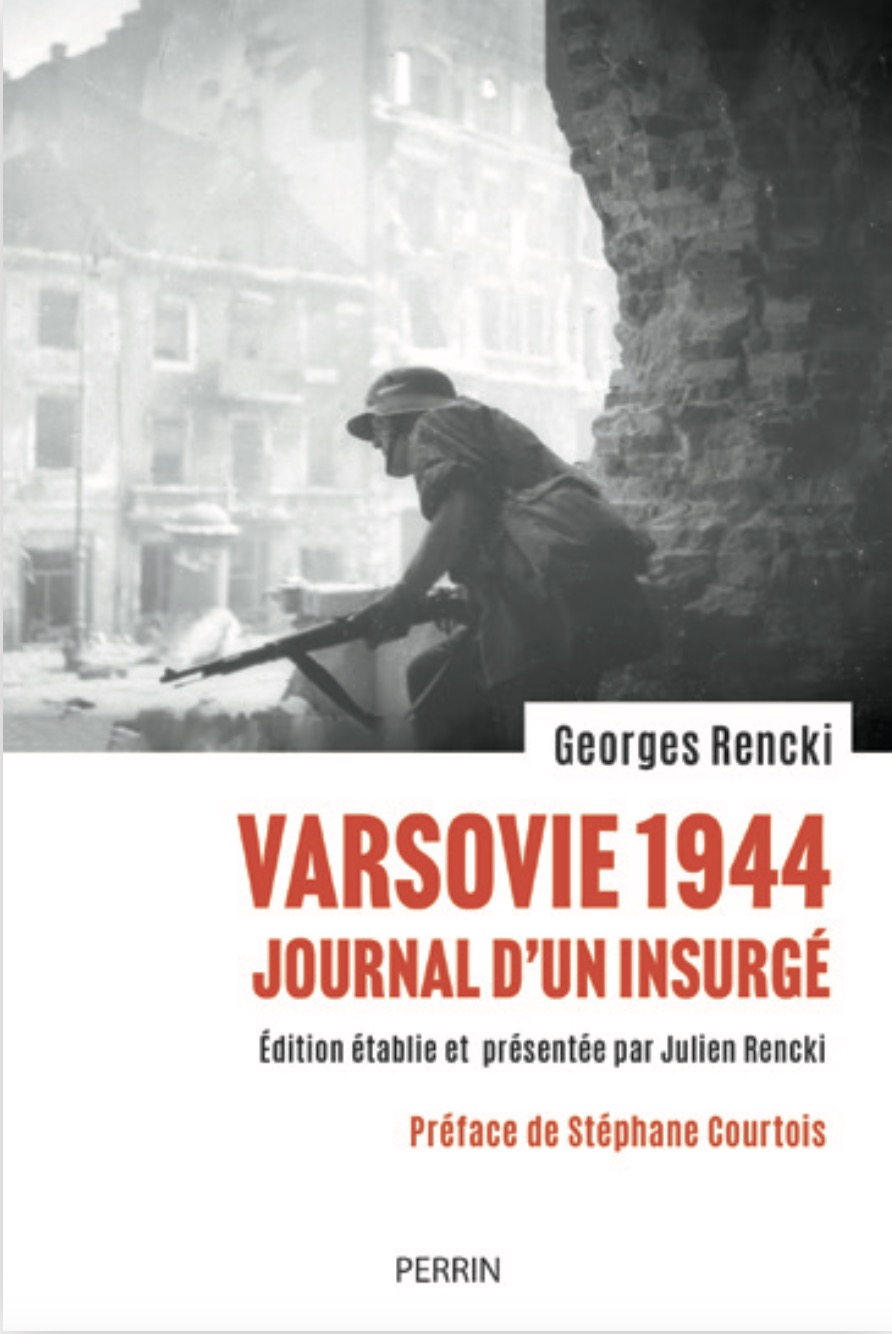
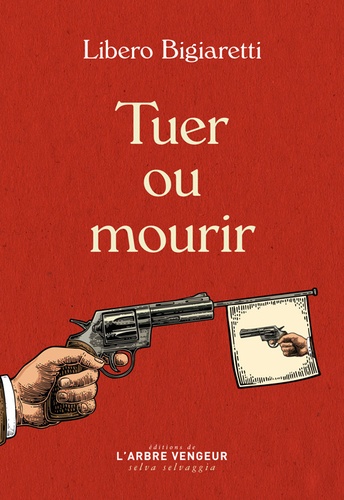




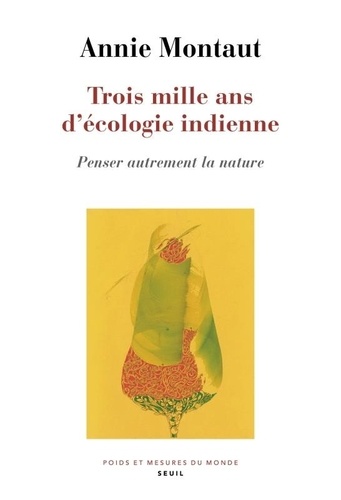
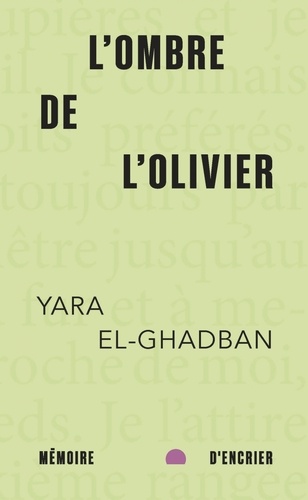
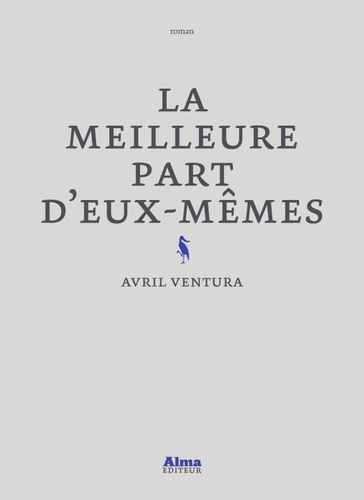

Commenter cet article