Un jour : récit d'une vie inscrite dans son temps
C’est l’histoire d’une rencontre !
Au tout début des années 40, « après l’effondrement » (!) mais « la date importe peu. C’était hier, c’est aujourd’hui et c’est demain, hors de nos calendriers ». C’est l’automne, seule certitude : le « soir commençait à monter ».
Le 18/05/2022 à 11:54 par Mimiche
1 Réactions | 299 Partages
Publié le :
18/05/2022 à 11:54
1
Commentaires
299
Partages
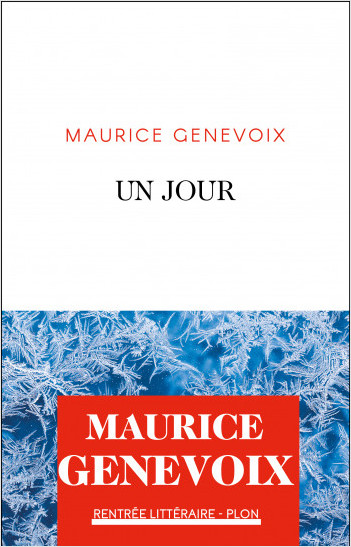
Le narrateur a quitté sa maison de Vernelles proche des bords de Loire pour une promenade au gré des sentiers plus ou moins marqués. Plus préoccupé par tout ce qui l’entoure que par la destination vers laquelle l’entraînent ses pas, émerveillé par les couleurs, le silence, la mousse, les pins sylvestres ou « le déboulé d’un garenne hors d’un roncier ».
Un plaisir solitaire mais immense d’avancer vers l’inconnu sur le sable des chemins, sur la mousse des sous-bois jusqu’au bord d’un étang perdu au milieu de rien, au milieu d’une friche, au-delà du bois, bientôt seulement éclairé par une grosse lune ronde qui, dans cette fin de journée, accompagne la lente disparition du soleil.
Et bien que proche de son domicile de villégiature, loin de la ville, peut être à quelques kilomètres seulement de la tiède chaleur où l’attend sa vieille servante, un peu perdu à l’issue de ce cheminement erratique, cet étang le surprend, lui qui pensait connaître tous les recoins des boisements et des plans d’eau autour de chez lui.
Alors qu’il tentait de se soustraire à cette douce torpeur dans laquelle l’avait plongé la vue de cet étang que les cris des vanneaux avaient désormais déserté, ce sont les aboiements d’un chien qui viennent trouer le silence immédiatement suivis des échanges entre deux voix toutes proches.
Quelques instants plus tard, deux hommes le rejoignent : un garde-champêtre répondant au nom de Hubert et tenant le chien en laisse et un homme à la « moustache rousse mêlée de poils blancs » auxquels le narrateur se présente en serrant les mains tendues. Fernand d’Aubel, le moustachu, s’amuse de cette intrusion sur ses terres mais l’invite derechef chez lui, « aux Vieux Gués », lui proposant d’y prendre quelque repos avant de le remettre « sur la route » et pousse l’hospitalité jusqu’à partager avec lui son repas en tête-à-tête : Hubert étant retourné dans ses foyers auprès de son épouse et la fille d’Aubel aussi furtivement apparue que discrètement disparue.
Au bout d’une aimable et courtoise conversation pleine de gaîté et de naturel, d’« une spontanéité sans faille qui […] gardait [les propos d’Aubel] de l’insignifiance, de la vulgaire banalité », ce dernier raccompagne tranquillement le narrateur jusqu’à un chemin où celui-ci ne manque pas de retrouver, malgré la seule clarté de la lune, la direction qui le ramènera chez lui. D’Aubel, avant de saluer son visiteur et de prendre congé pour rejoindre son logis, ne manque pas de l’assurer qu’il sera toujours le bienvenu aux « Vieux Gués ».
Ce n’est que des années plus tard, la guerre finie et un retour aux Vernelles enfin possible, que l’auteur reprend le chemin des bois où, sans coup férir, il retrouve d’Aubel, toujours en forme malgré ses quatre-vingt-huit ans, lequel, après des retrouvailles qui effacent les années écoulées, semble reprendre la conversation là où elle s’était arrêtée avant qu’ils ne se quittent et lui demande de lui « donner un jour, un des [ses] jours et le confondre avec l’un des [siens] ? » lui promettant « qu’il ne se passera rien, que ce sera un jour ordinaire […] Je vivrais, vous étant là […] comme hier et demain ? Et puis […] vous partirez, nous nous quitterons, nous ne nous reverrons peut-être plus […]. Mais je pourrais dire que quelqu’un sait ».
Dix jours plus tard, le narrateur se rend aux « Vieux Gués ».
Un jour est paru initialement en 1976 alors que Maurice Genevoix avait délaissé ses fonctions à l’Académie Française pour consacrer le temps qu’il lui restait à l’écriture.
Ré-édité aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’appréhension que je me suis plongé dans ce livre, trop plein du souvenir magnifique de Raboliot pour ne pas craindre une déception.
Quelle prétention qu’oser imaginer que cela puisse être !
Dès la première page, j’ai été à nouveau embarqué par la limpidité des phrases, ces mots simples et savoureux, ces imparfaits du subjonctif (ah, les imparfaits du subjonctif!!!), ces situations décrites en quelques mots choisis sobrement mais qui ne nécessitent pas plus, ces personnages d’un autre âge aux gros souliers bien ajustés, aux attitudes tranquilles, ces êtres qui prennent leur temps lequel semble glisser sur eux comme s’il était tellement habitué à eux qu’il ne pouvait pas se passer d’eux, ces atmosphères surannées dans des logis qu’on n’imagine plus, ces paysages immobiles qui, eux aussi, prennent le temps de regarder pousser les arbres et les fleurs, chanter les oiseaux, monter la lune dans l’horizon du soir, souffler le vent qui ride doucement la surface des étangs.
Ah cette douceur, cette communion avec les arbres, les herbes, les garennes, les grands cervidés, comme avec le chien qui, par tous les temps, suit, précède, flaire, guette, attend avec cette infinie connivence qui ressemble à de l’amitié.
Maurice Genevoix en appelle à Thoreau, à Emerson, pour ces errances au beau milieu de la nature, « ces vieux sonneurs d’alerte, ils nous ont devancés sur les voies d’une prise de conscience, d’un retour vers une sagesse à visage d’homme ».
Cet homme, ce d’Aubel, c’est Thoreau à Concord ! Comme lui, il a « trouvé son méridien : bonne façon d’embrasser l’univers, de rejoindre l’enfance et de garder ainsi […] le contact avec le monde vrai ». Il vit pour et avec le peuple du vivant, végétal ou animal, qui déploie autour de lui toute son ingéniosité à vivre, à s’adapter : « en avril, dans les taillis, l’herbe qui pointe à travers les feuilles mortes est plus verte que le vert même » ! Il admire, avoue son amour des « beaux tapis d’Orient ». Et pourtant reconnaît que « cette beauté […] la nature fera toujours mieux ».
Alors, certes, cette sorte de cécité qui évacue « les bagnoles » peut paraître totalement déconnectée de notre monde (complètement connecté justement) mais elle ressemble à la sagesse des premiers hommes, et des animaux qui étaient leurs alter ego et ne chassaient que pour se nourrir, ne cueillaient que ce qui leur était nécessaire et ne se laissaient pas embobiner par les « toujours plus » de notre civilisation gargantuesque, boulimique, qui, dans cette frénésie totale, s’oublie avec délectation dans la vitesse et la consommation de masse.
Alors, laissez-vous emporter par cette histoire sans aucune réticence : c’est beau, c’est tellement agréable, tellement rafraîchissant. On en ressort rasséréné, plein de calme et de douce quiétude.
Un jour
Paru le 16/09/2021
208 pages
Plon
19,00 €
Raboliot. 1 CD audio MP3
Paru le 01/12/1989
285 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €



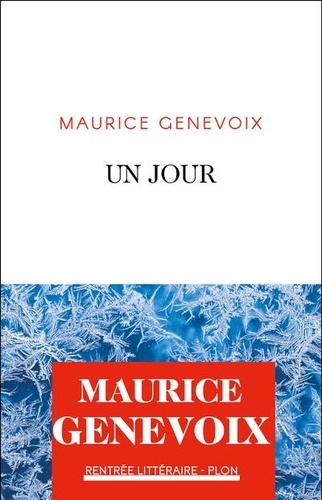
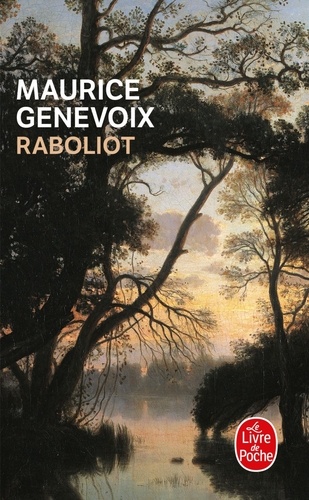
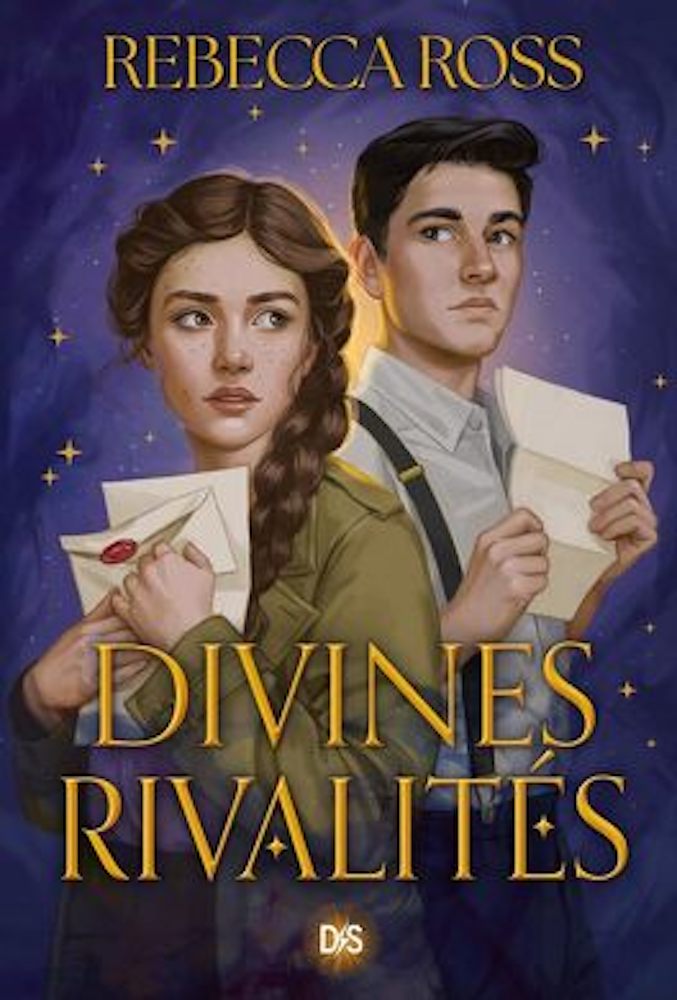
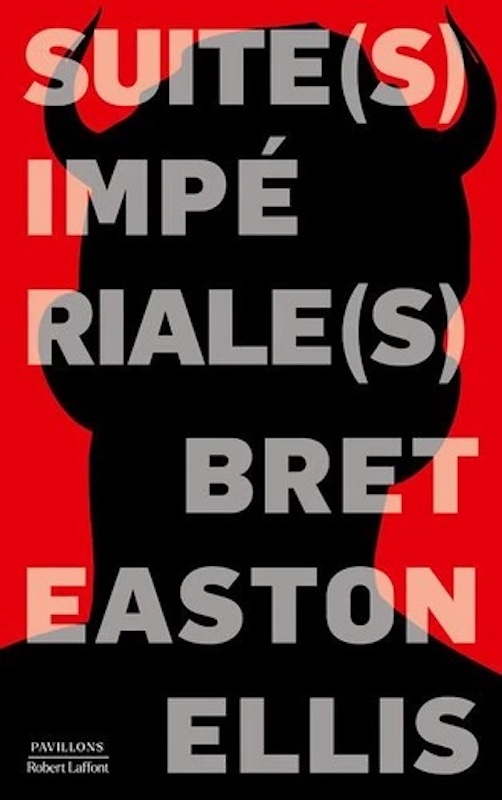

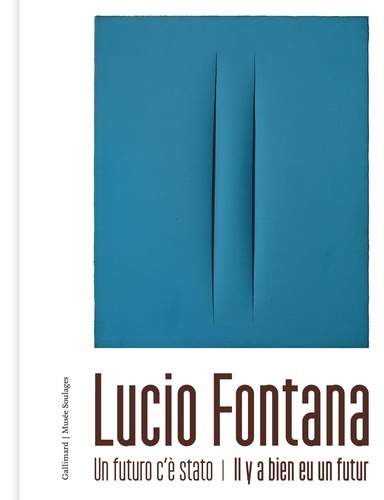

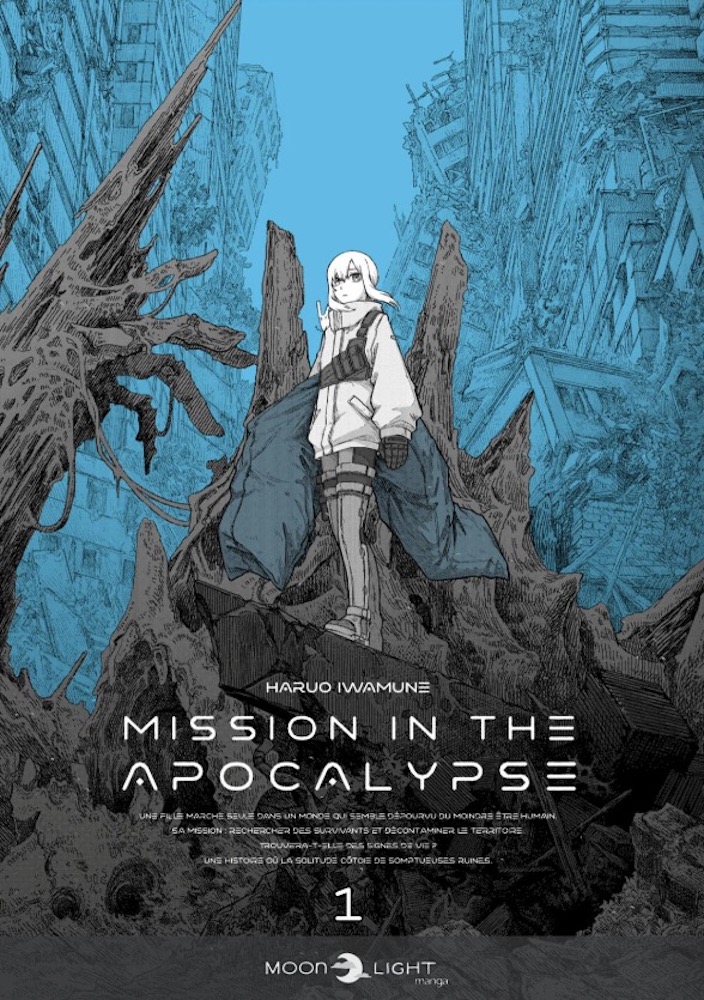
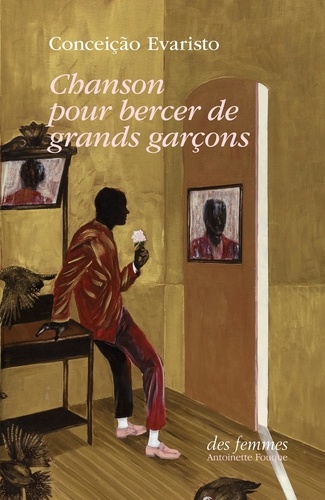
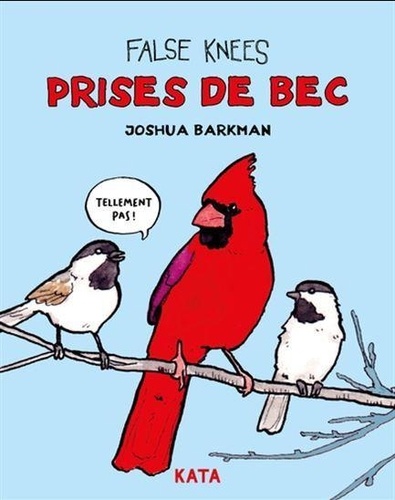
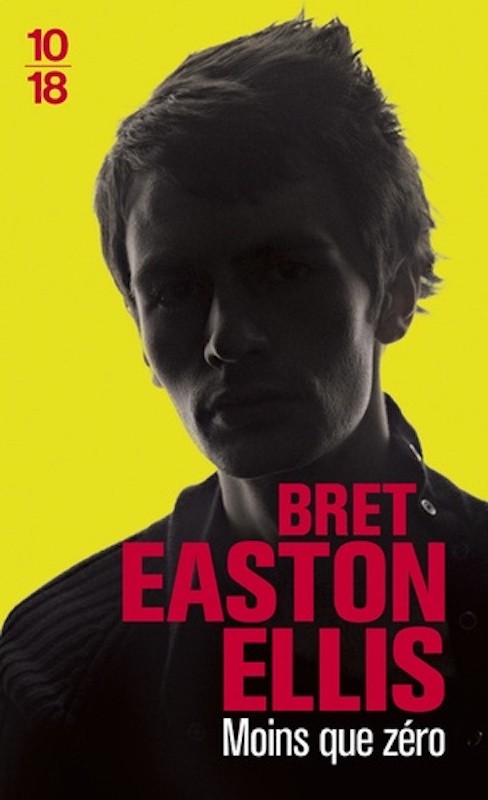

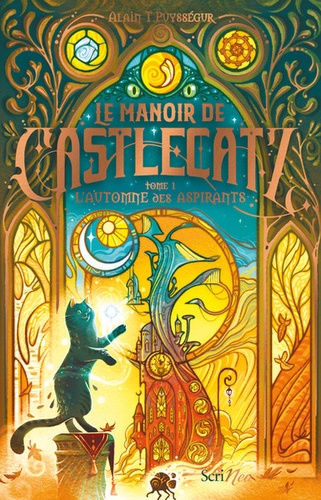

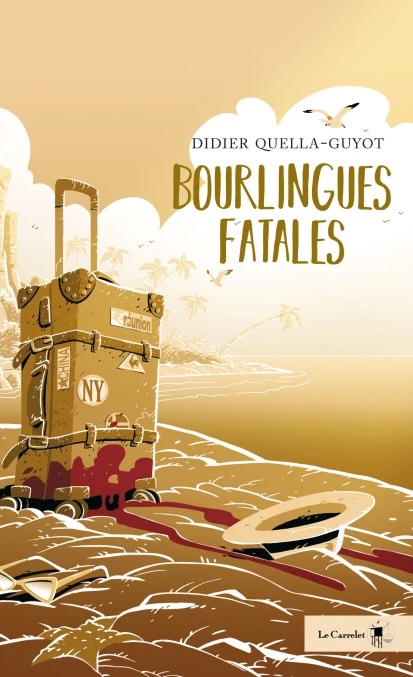

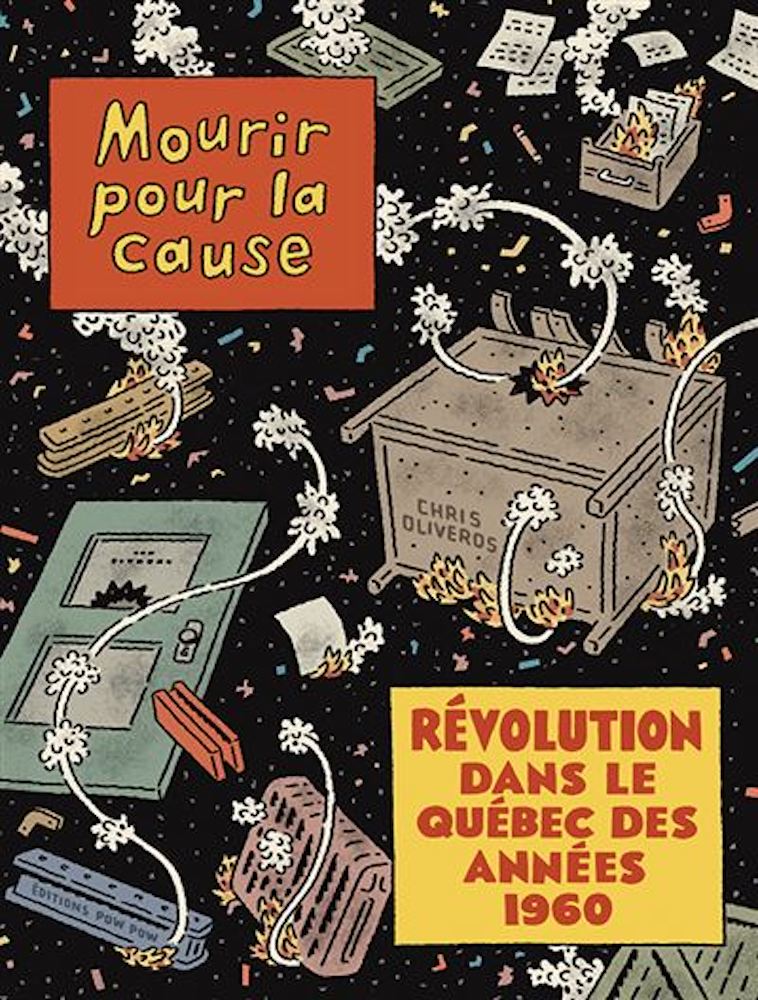
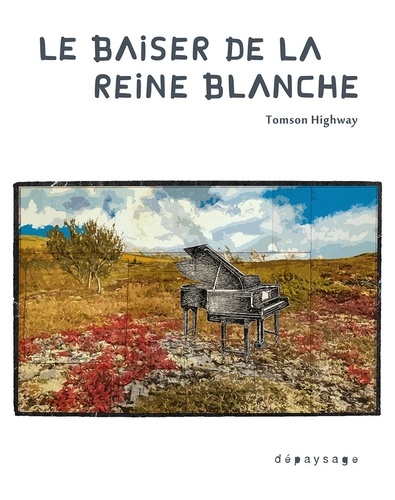
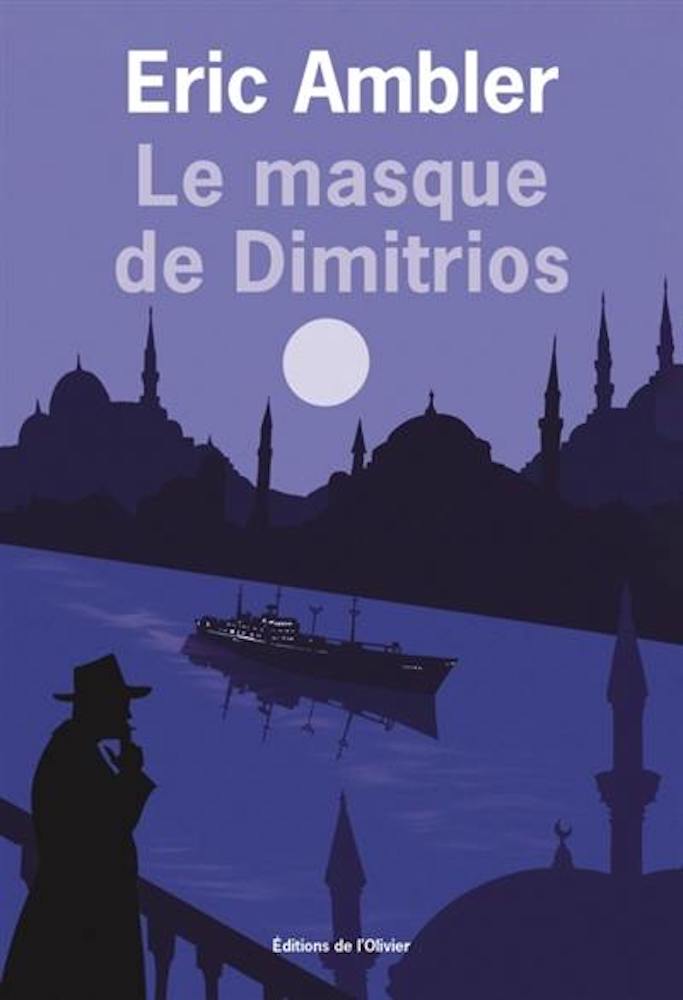
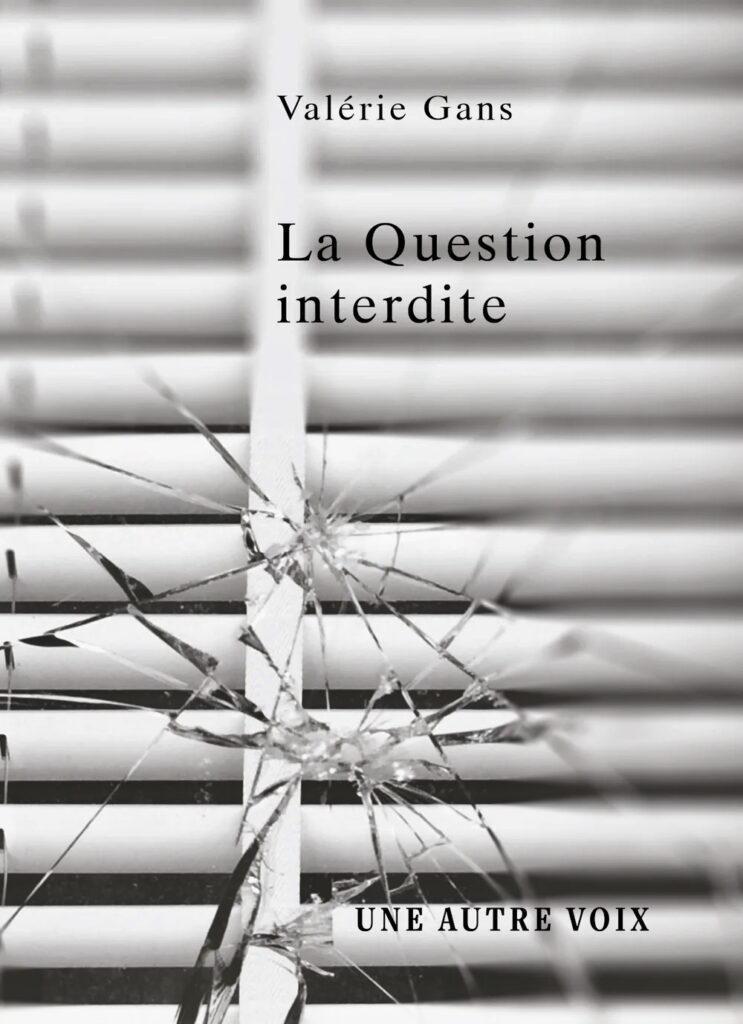
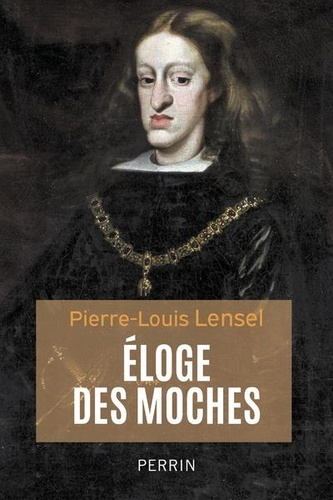
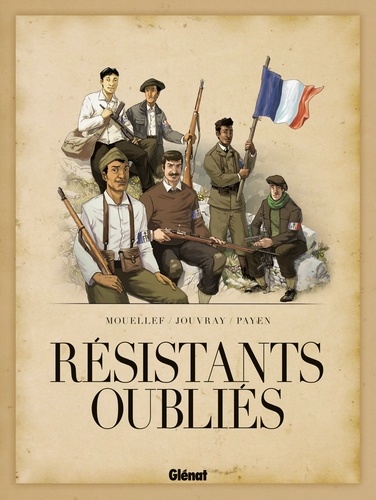

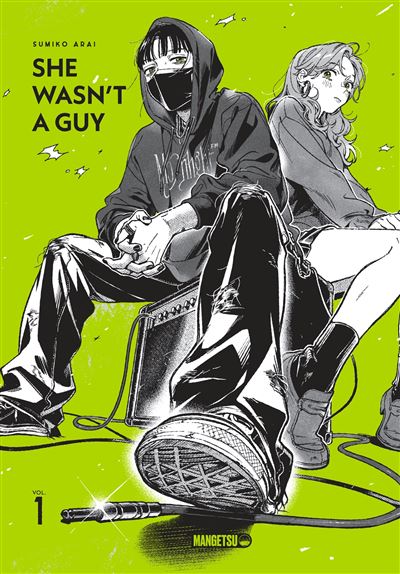
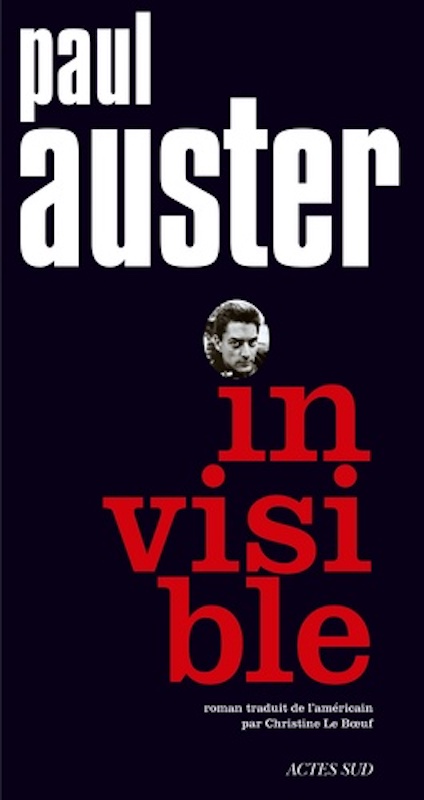
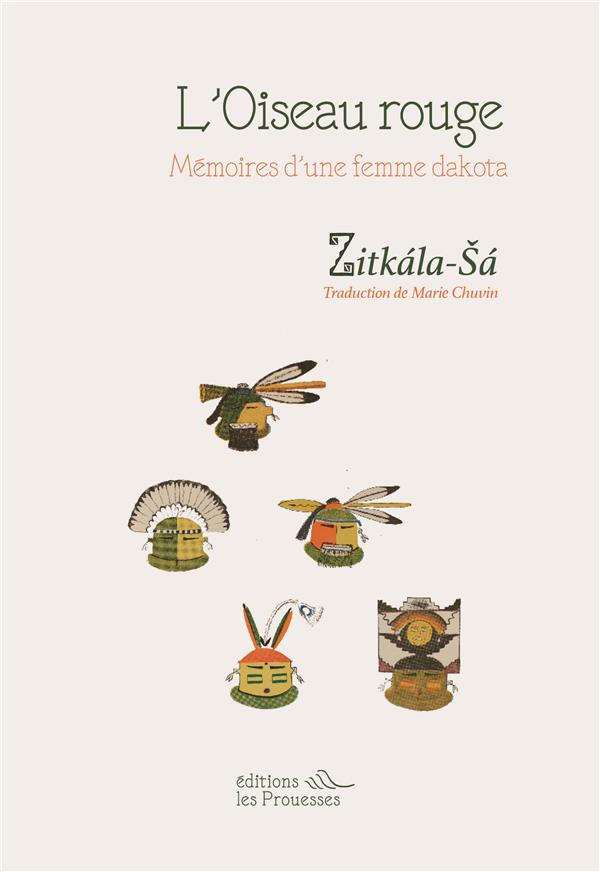


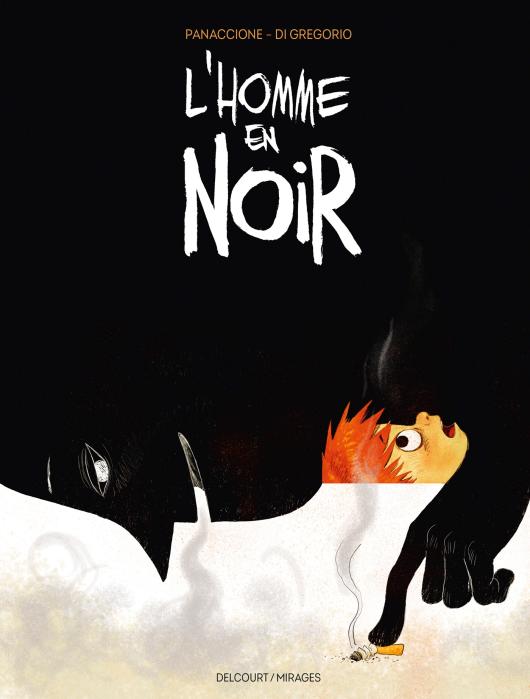



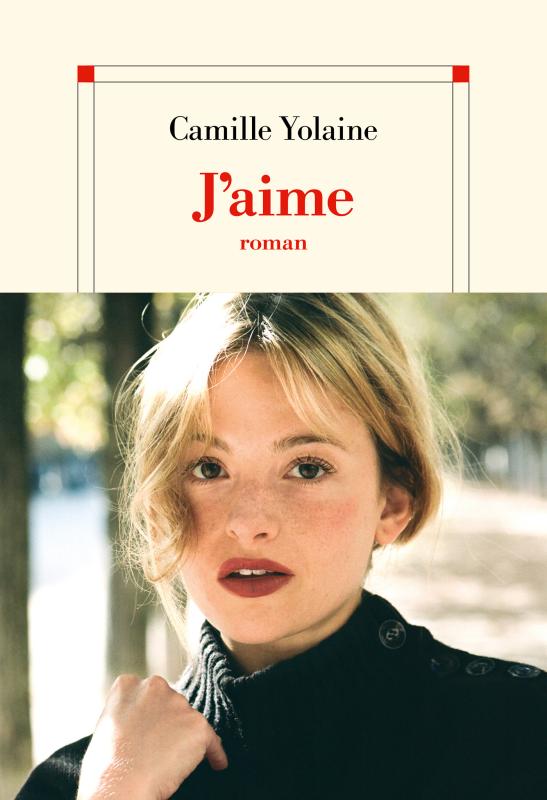
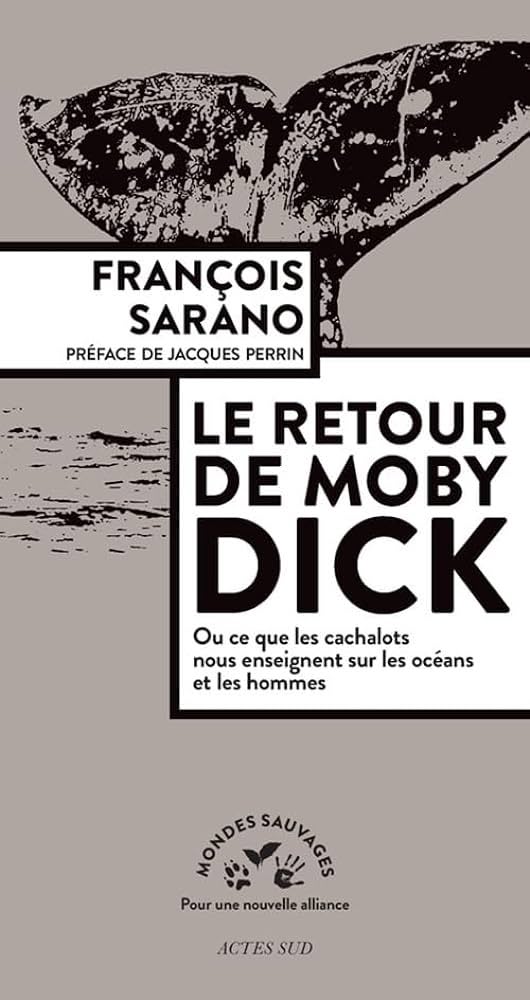




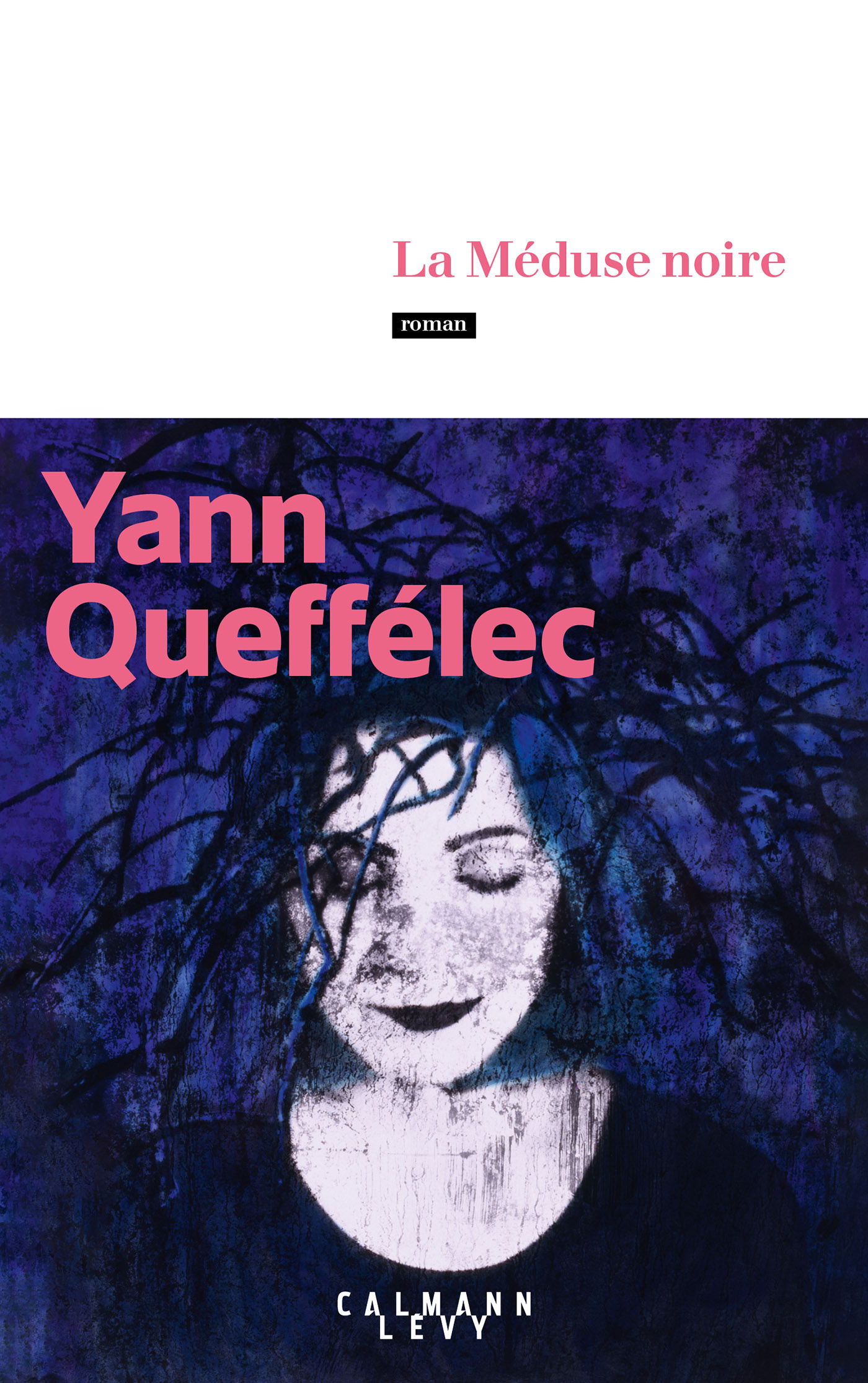




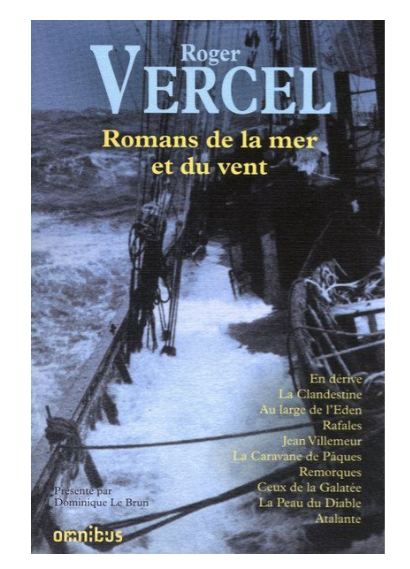

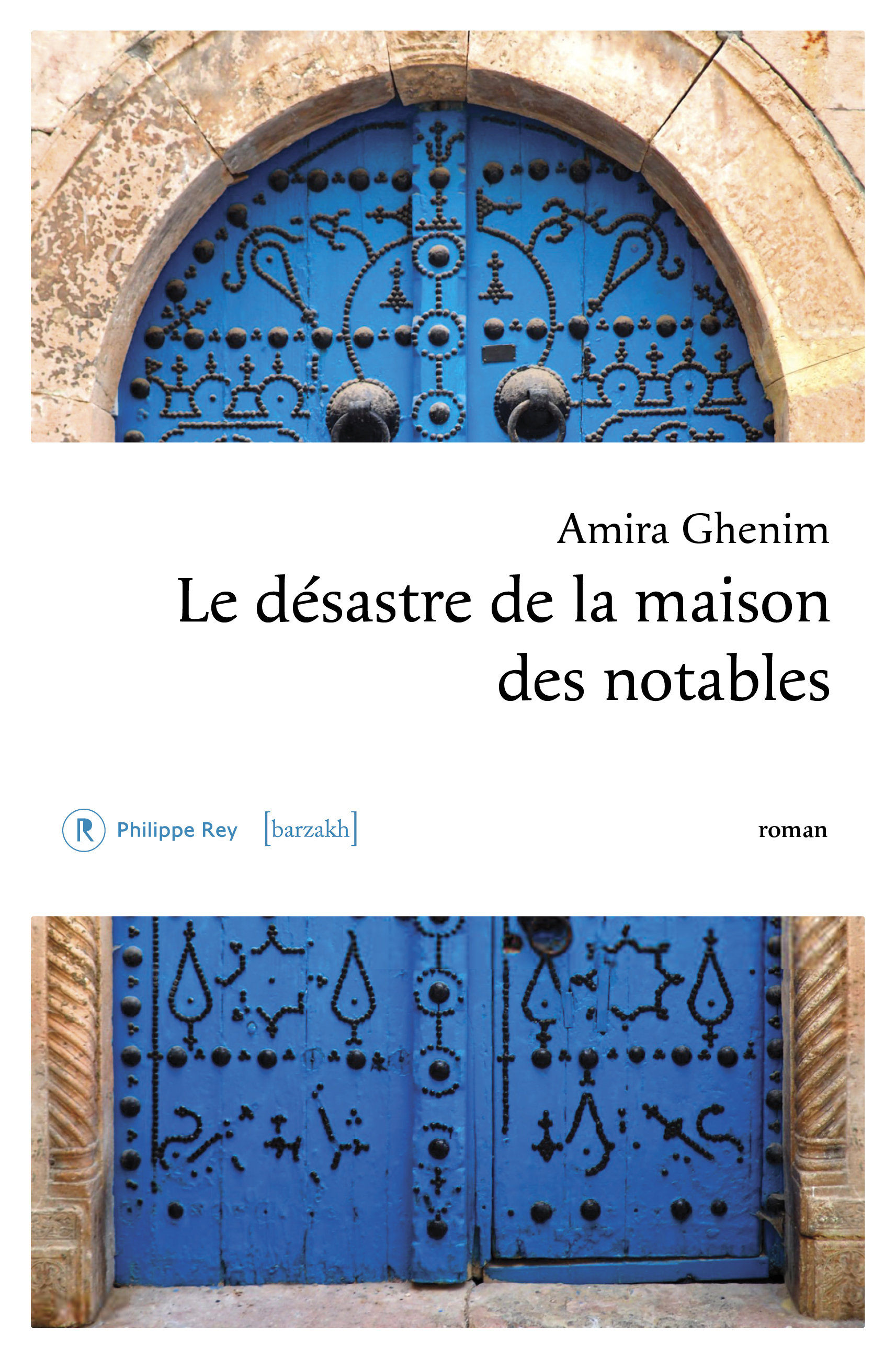
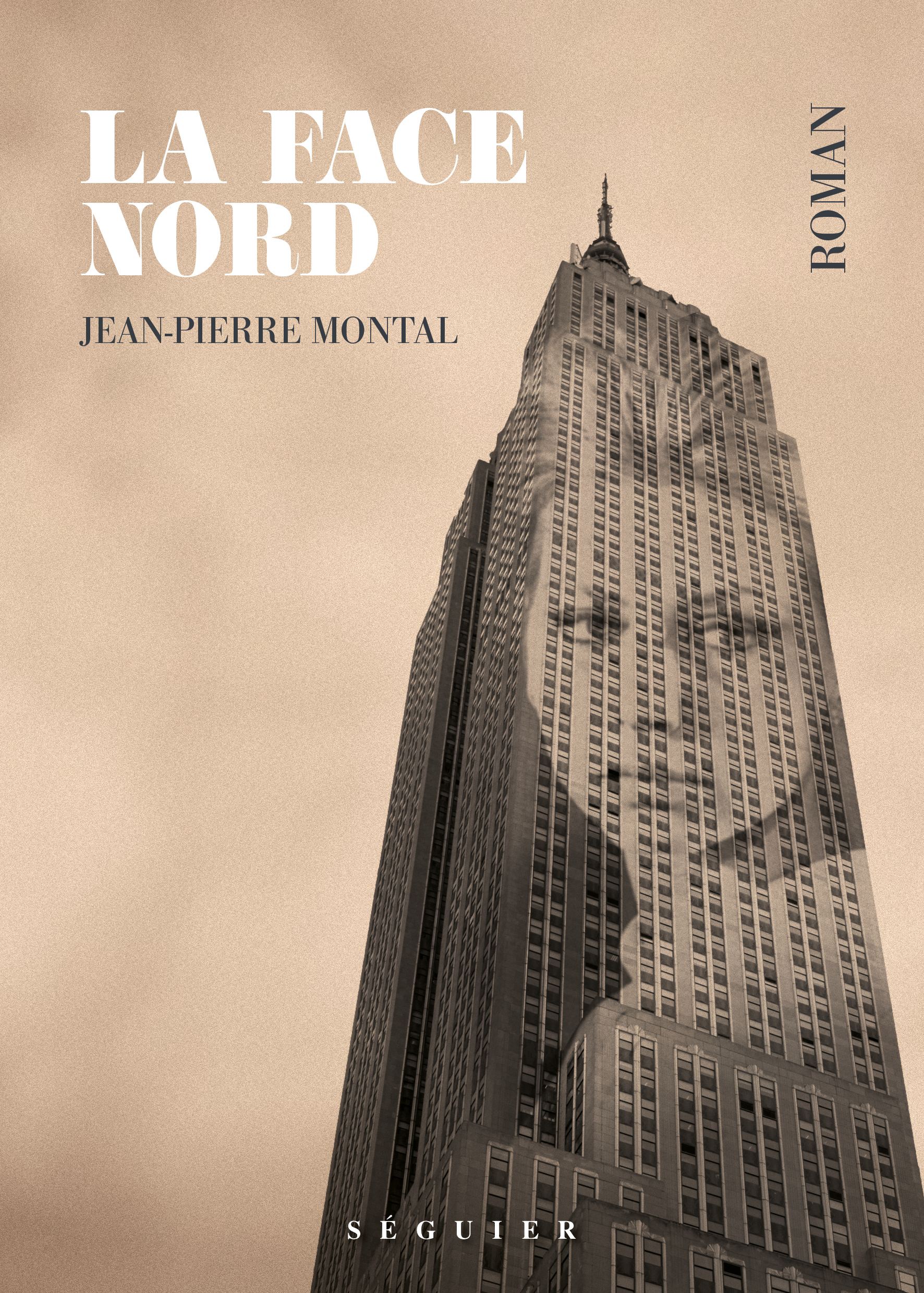



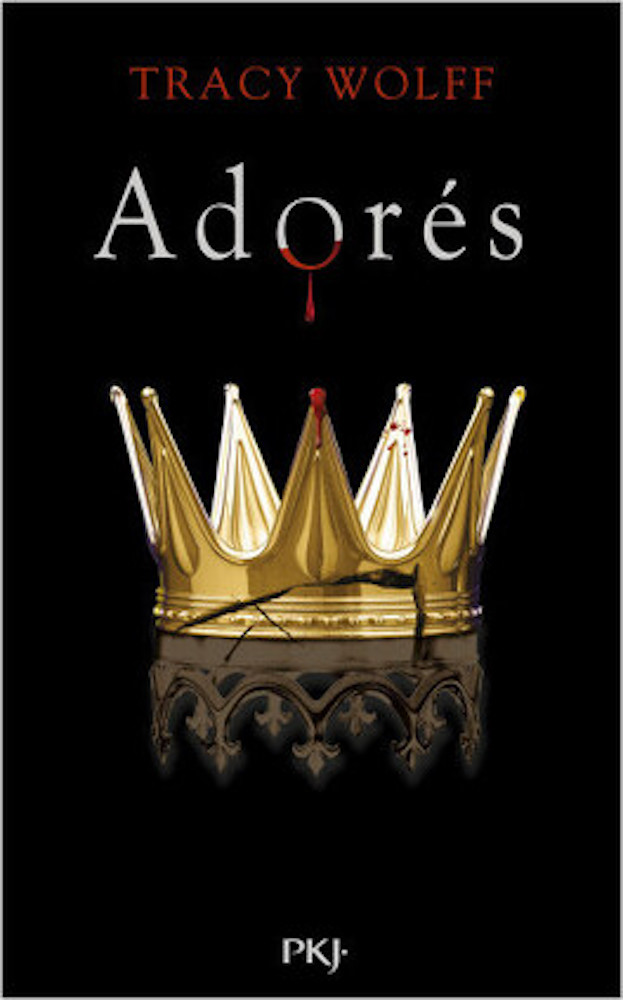
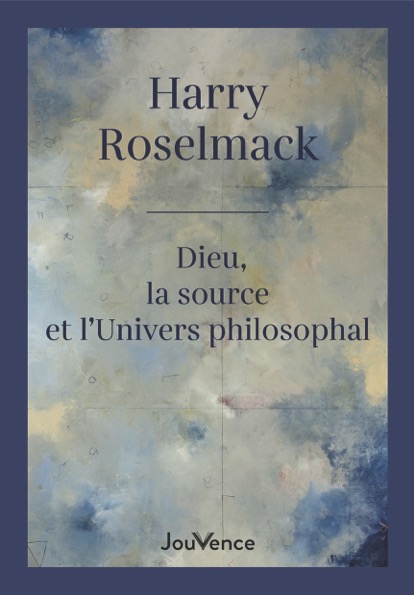
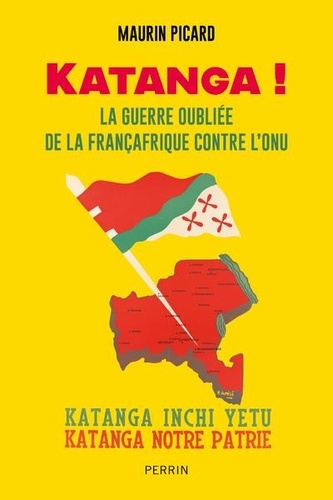

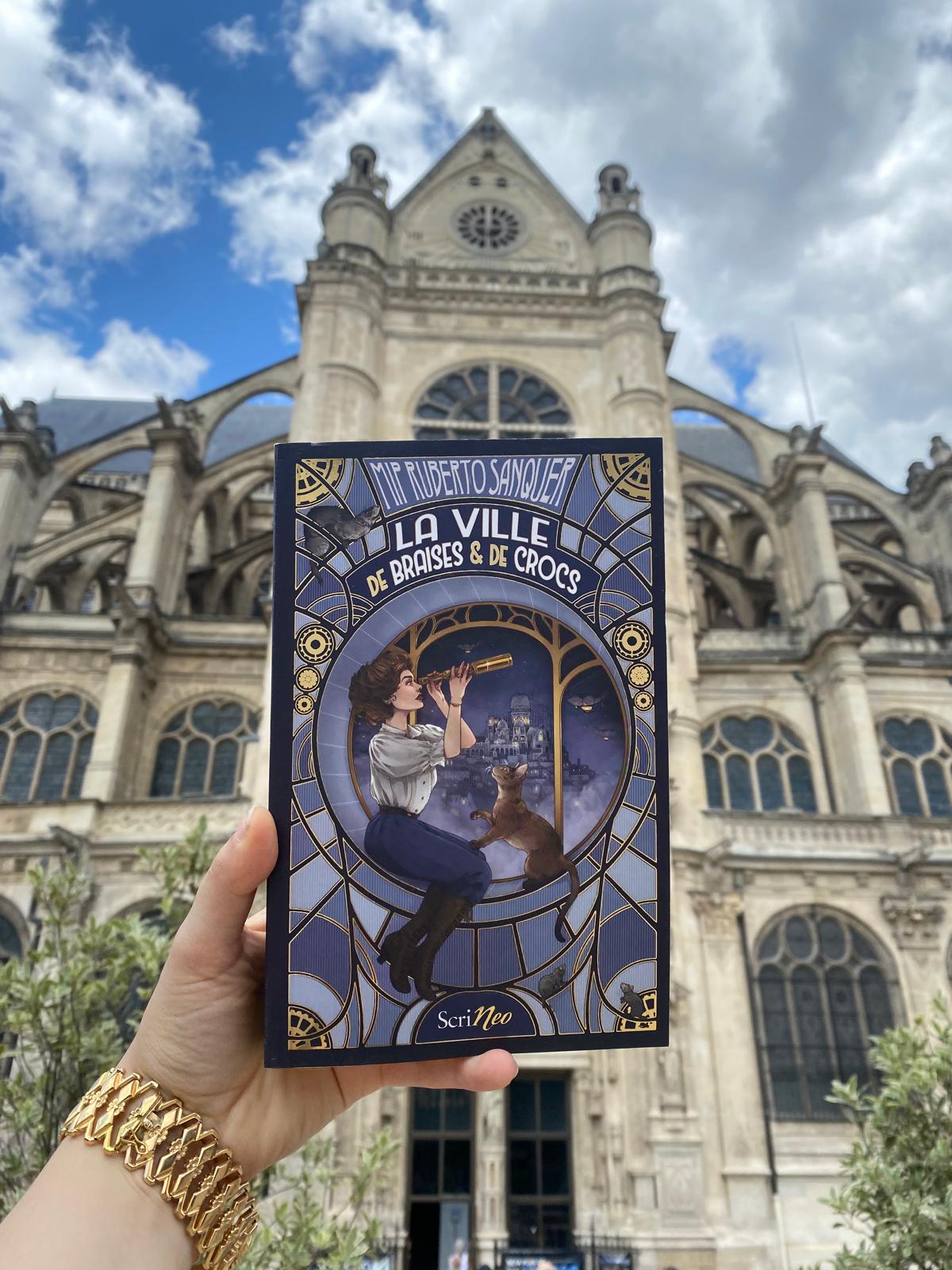



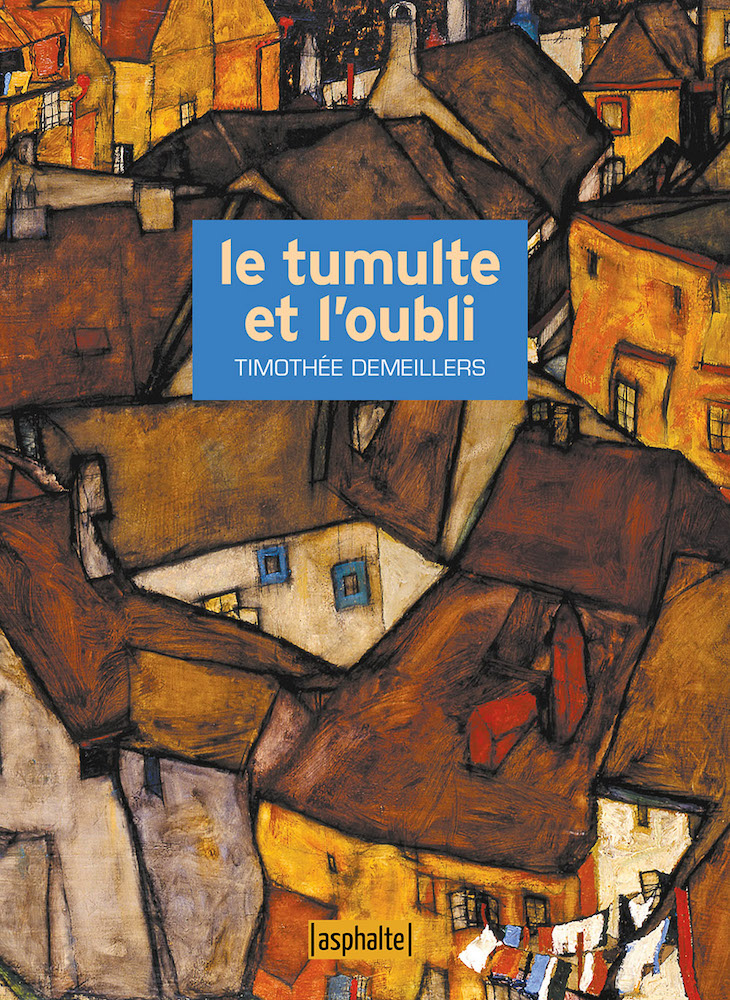


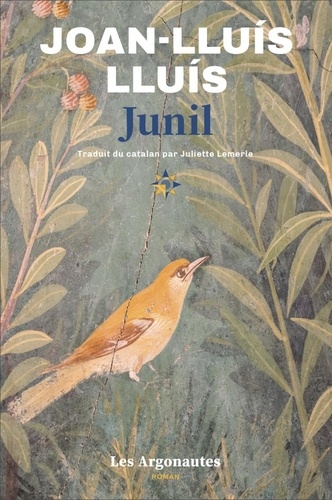


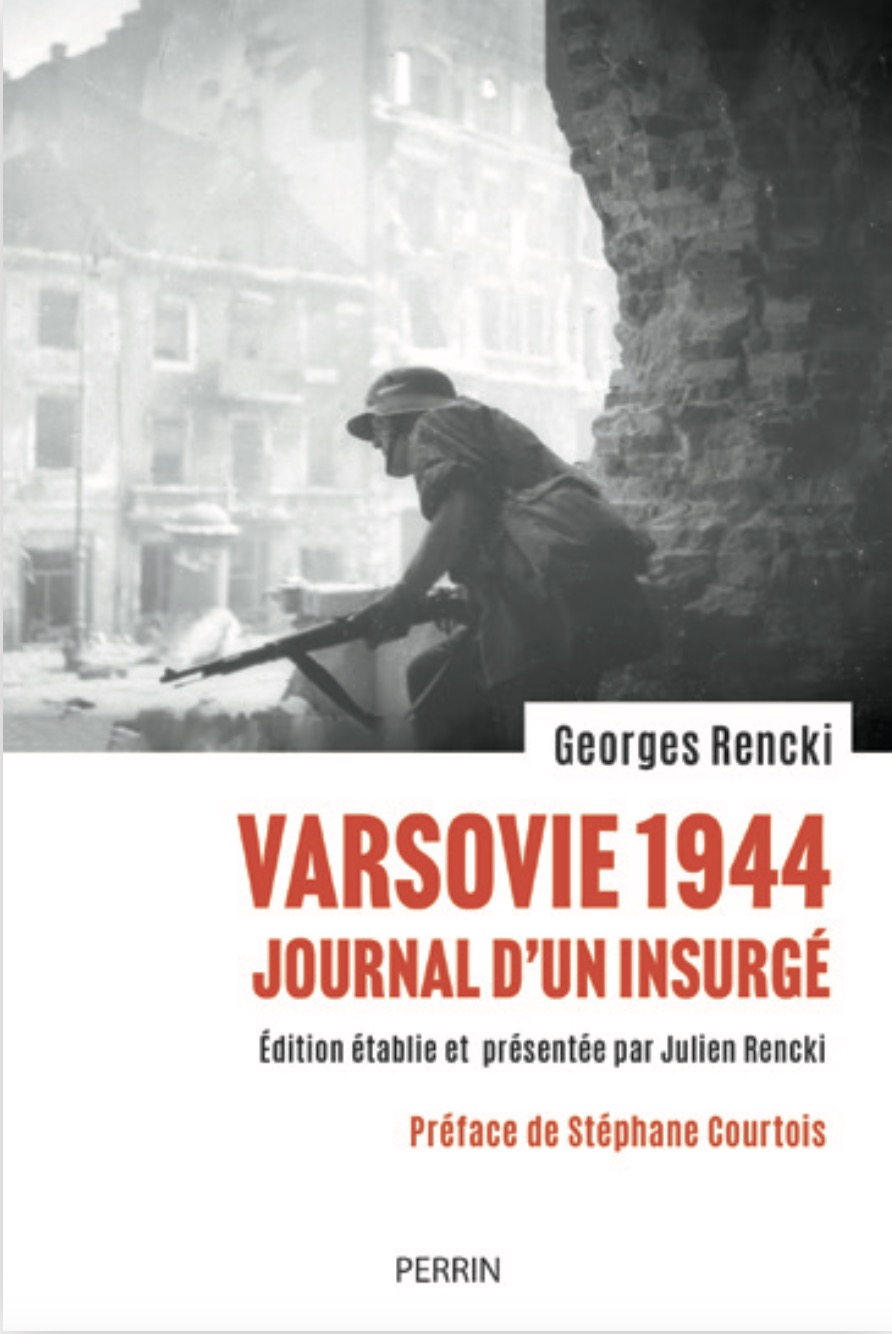
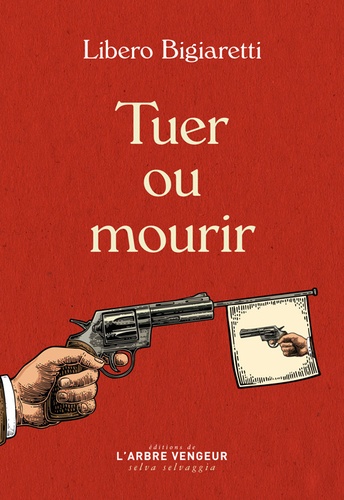




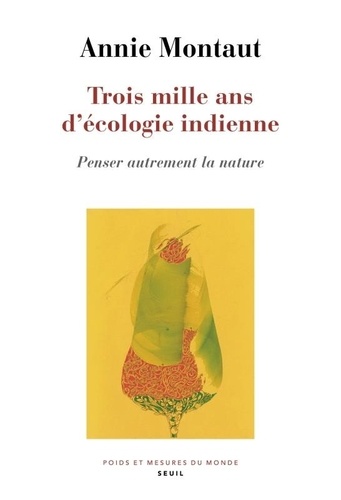
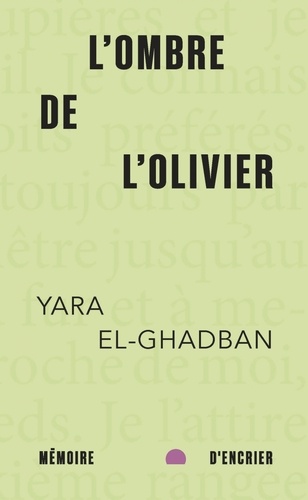
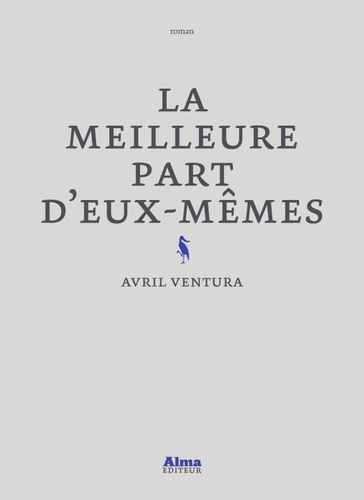

1 Commentaire
Ribiata
19/05/2022 à 10:37
bonjour,
pourquoi ai-je lu cet article ? Je n'en sais trop rien, peut-être justement parce qu'une réédition de Genevoix est à mille lieues de mes intérêts... Le rousseauisme de Mimiche, qui ne l'empêche pas de maltraiter la syntaxe et le lexique, m'a un peu agacé. Que faire d'une telle assertion "...la sagesse des premiers hommes, et des animaux qui étaient leurs alter ego..." ? En 2022, l'on sait maintenant que l'homme modifiait son environnement dès la plus haute préhistoire et était à l'origine de la disparition d'espèces par son activité de prédation : soit, pour les proies, parce qu'il les chassait avec excès ; soit, pour les prédateurs, parce qu'il les surpassait. Lisez ou écoutez (France Culture) qq'un comme J-J Hublin, par exemple, vous resterez écologiste et humaniste... mais un peu plus conscient de notre réalité !