Un barrage contre l’Atlantique , de Frédéric Beigbeder : Crépuscule île
« Mais j'aimais le goût des larmes retenues, de celles qui semblent tomber des yeux dans le coeur, derrière le masque du visage. » Valéry Larbaud. Quel beau livre, encore une fois. Comment imaginer un seul instant que l’œuvre de Beigbeder puisse un jour sombrer dans l’oubli, que ses livres ne soient plus lus ? (une phrase écrite quelque part dans le roman pleine d’humour ou d’auto-dérision).

Coup de foudre pour le petit dernier : sombre, touffu, tendre, mélancolique, poétique, dépouillé. Politique aussi. Beigbeder n’est jamais aussi bon que quand il révèle sa part d’ombre, son intimité, son âme, délaissant « les scories » de la fiction. Ici, dans ce récit très incarné et fitzgeraldien, il se dévoile totalement, tombe le masque, baisse la garde, fend l’armure. Et dresse le portrait émouvant de Benoît Bartherotte, ce « Sysiphe gascon ».
Ce personnage fort en gueule est aussi une force de la nature se dressant tel Ulysse contre les flots atlantiques à la Pointe Lège-Cap Ferret pour préserver sa Digue mise à mal par l’érosion maritime. L’hommage que l’auteur lui rend en s’attachant à souligner le combat de préservation de ce territoire au cœur du bassin d’Arcachon est intéressant et noble en ce qu’il interroge notre condition humaine et notre relation avec la nature. Le titre en guise de clin d’œil à Duras s’imposait. La façon qu’a l’auteur de déplacer ce tableau du peintre basque Thierry de Gorsotarzu acheté à Saint-Jean-de-Luz à la cabane de Bartherotte pour conduire son récit est subtile et d’un raffinement suprême.
Calfeutré dans son chalet, Beigbeder remonte le fil du temps à partir de deux éléments spatio-temporels significatifs : une rencontre en ce lieu il y a 20 ans, et une perception organique (sentiment de déjà — vu, déjà vécu). « Seul le passé peut nous sauver de cette pandémie. » Animé de ce besoin de retrouver le nid de l’enfance — seul moyen d’échapper au confinement — il rentre dans sa coquille. Narrant des souvenirs très « la vie selon Claude Sautet » avec celles et ceux qui comptent pour lui, il compose ponctuellement et à l’arrache des bribes pleines de reliefs, tirées de flashs.
Les premières parties ont des airs de recueil où sont racontées les scènes d’enfant et d’adolescent vécues à Guéthary et Verbier, les deux lieux d’ancrage principaux. Nostalgique de quelques minutes de 1985, toujours figé dans son « immobilité » dans ces endroits inamovibles, réactivant — donc — des souvenirs épiques ou douloureux, l’auteur se surpasse en toute fin dans un texte enfin resserré où se mêlent des descriptions inouïes, suffocantes de beauté. Là encore, la magie de l’écriture et de la maîtrise littéraire opère.
Difficile de ne pas partager le constat intuitif sur l’évolution délétère de la société mondialisée faussement libertaire. Le roman traduit bien les changements de ce monde dystopique et persécuteur, de l’ambiante hystérie actuelle. Le préambule de « Bibliothèque de survie » dénonçait approximativement déjà cela. Difficile également de ne pas partager les réflexions sur le sentiment de rupture d’avec le monde d’avant, sentiment à peu près commun à tous — « L’insouciance est une guerre » — et sur le cloaque complet apparu au tout début de la crise sanitaire — « Inconséquence totale du monde d’avant qui portait le mot pompeux de liberté ».
Il est à noter qu’Un barrage contre l’Atlantique est également un livre sadien qui parle beaucoup de corps et de transgression : et pas seulement quand il aborde l’attente amoureuse, la révolution sexuelle et mai 68. Clairement, Beigbeder n’y va pas par quatre chemins. Il nomme les châtiments corporels, décrit la jouissance, — « Rien ne peut rivaliser avec l’orgasme » — dit le désir, l’interdit, les premiers corps à corps, le sado-masochisme, les premières caresses, et les tabous...
J’ai beaucoup aimé les passages piquants qui mentionnent Histoire d’O et Cendrillon. J’ai plus de réserve sur la manière d’envisager et de percevoir les échanges sexuels entre jeunes adolescents et adultes au temps des années 70/80. Non, je ne suis pas une mère la Morale, 50 ans de naturisme entre Montalivet et le Cap-Ferret — que je connais comme ma poche ! –, ayant contribué durablement à mon éducation sexuelle, ont eu raison de moi ! Simplement, n’est-ce pas maladroit pour justifier l’injustifiable de perpétuellement se retrancher derrière un changement de mœurs inversé ? Un changement d’époque ?
Quant aux slows d’antan, ils ne pouvaient être des viols puisque la dynamique de l’intention supposait que chacun reste libre de ses choix (le garçon invitait, la fille refusait). En d’autres termes, pour appuyer la thèse qu’il défend, Beigbeder choisit un mauvais exemple. Enfin, c’est bien parce que « la séduction repose, en effet, sur un énorme malentendu » qu’il devient globalement plus difficile de donner blanc-seing aux hommes plus qu’aux femmes.
Quelques exercices d’admiration s’intercalent dans le récit. Celui qui est réservé au père absent qui n’a jamais lu les livres de ce bon fils/bon frère/bon père — c’est manifeste — est particulièrement touchant. Les mentions adressées à toutes les femmes aimées, quelles qu’elles soient, font monter les larmes aux yeux. Parfois, le livre prend un tour cathartique, résilient. Avec ce bilan, l’auteur nostalgique conjure sa tristesse ou sa fatigue en se clamant heureux, quand d’autres fois, on le sent vaciller, recherchant la compassion, le pardon, la paix. Voilà toute l’ambivalence du personnage.
Ma seule critique au fond concerne le style littéraire des 100 premières pages, même si je devine la démarche innovante, même si j’en loue le bien-fondé. Ces phrases aérées, espacées les unes des autres ont gêné ma lecture. J’ai d’abord pensé à une liste de notes — je sais que Beigbeder aime les listes —, ou bien à une tentative oulipienne, ou bien à une fantaisie originale qui visaient à scander, ou bien à un hommage rendu à la mer — vu le contexte, l’idée aurait été d’imaginer des vaguelettes, avec le blanc séparateur pour écume —, ou bien à un hommage rendu à Perec ou à Apollinaire, via « ces papillons épinglés vivants par un maniaque ».
J’ai bien compris que l’auteur cherche constamment à se renouveler, « à épouser des formes neuves, des inventions renversantes, des chamboulements syntaxiques… comme en 1921 » comme il l’écrit dans Bibliothèque de survie, mais la lectrice que je suis a souffert de ce texte en manque d’unité. Heureusement, les phrases s’agrippent et se resserrent à partir des trois quarts et la qualité littéraire indéniable du roman fait presque oublier la structure précédente.
J’ai adoré la grâce contenue dans ce livre, et son côté rétroviseur, faisant l’éloge de l’amour, mêlant multiples déclarations d’amour explicites ou feintes. J’ai aimé ce crépuscule sur cette île qu’est l’enfance, ce paradis « perdu ». En lisant, je croyais parfois entendre Lilicub, Daft Punk, et Souchon. J’ai adoré revoir le nom de Lolita Pille. Je n’ai pas offert Baudelaire à Beigbeder, mais Mauriac à l’Auberge de Venise.
À propos des 40 ans, je me souviens également de cette fête gigantesque donnée au Théâtre du Rond-Point, où il se produisit pour la première fois seul sur scène (le DJ Set du 23 septembre dernier était une forme de resucée). J’avais défié tous les potes admirateurs de l’auteur présents sur Myspace en relevant un pari assez fou. Aller jeter 40 roses rouges sur scène et un livre célèbre de Paul-Jean Toulet au son des chants basques que nous entendions. J’avais revêtu le costume local et les espadrilles adéquates. Je n’oublierai jamais le regard éberlué de Beigbeder en me voyant. Ces moments uniques resteront gravés.
C’était 2005 ! Année culte ! Merci d’exister Freddy de Guéthary et be care.
Un barrage contre l'Atlantique
Paru le 05/01/2022
272 pages
Grasset & Fasquelle
20,00 €




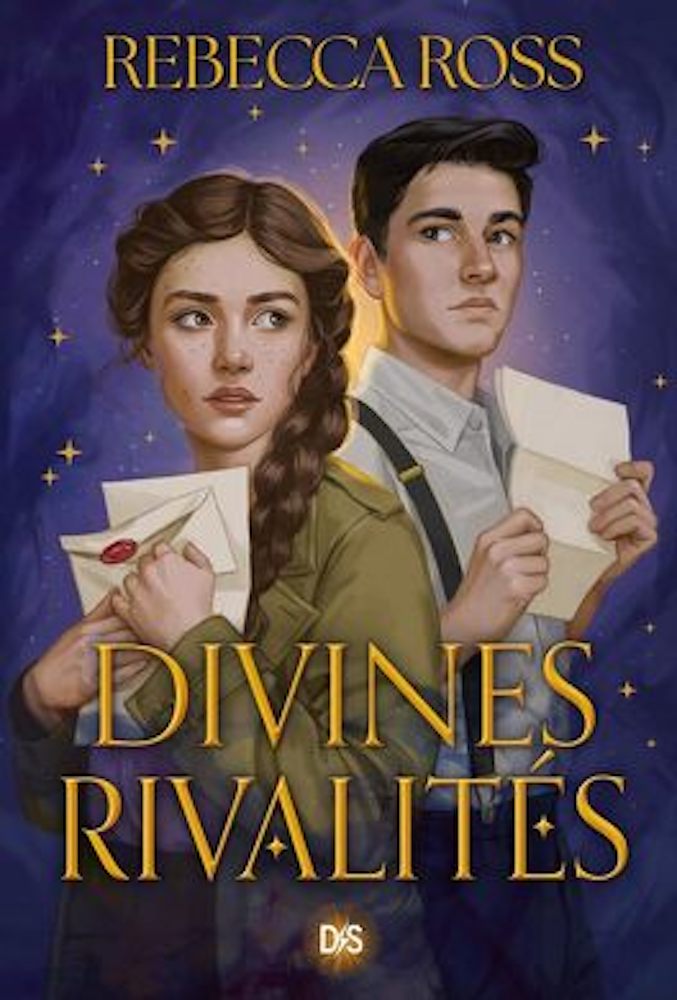
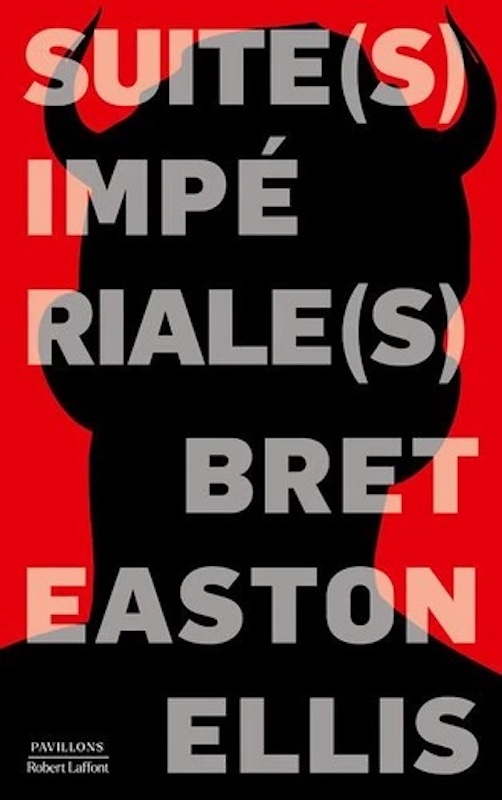

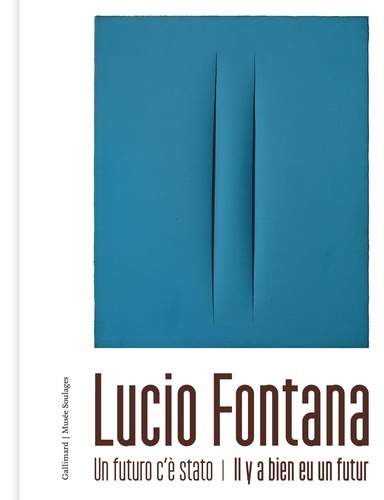

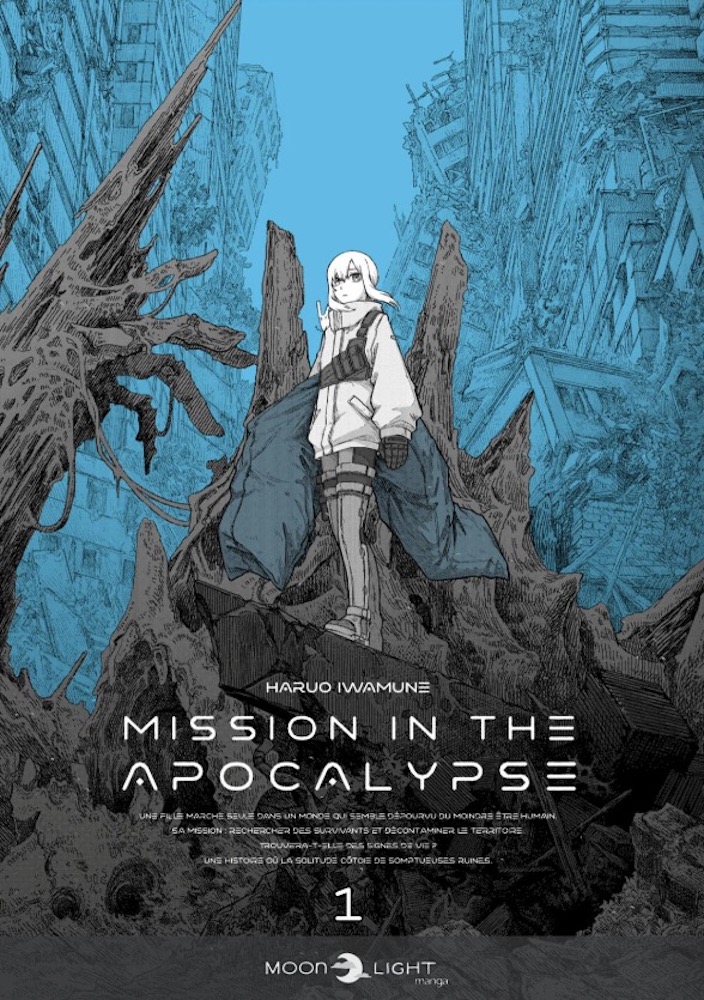
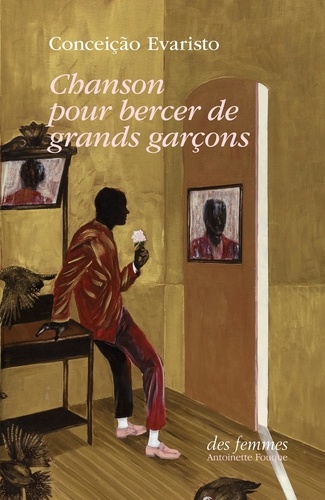
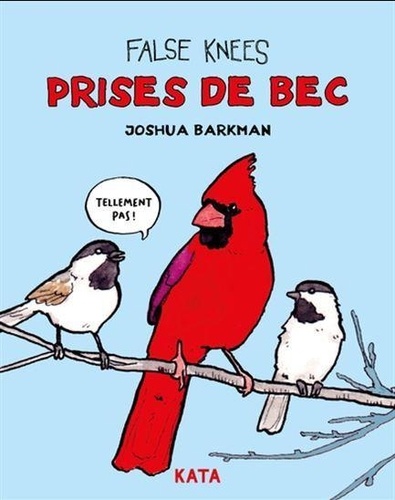
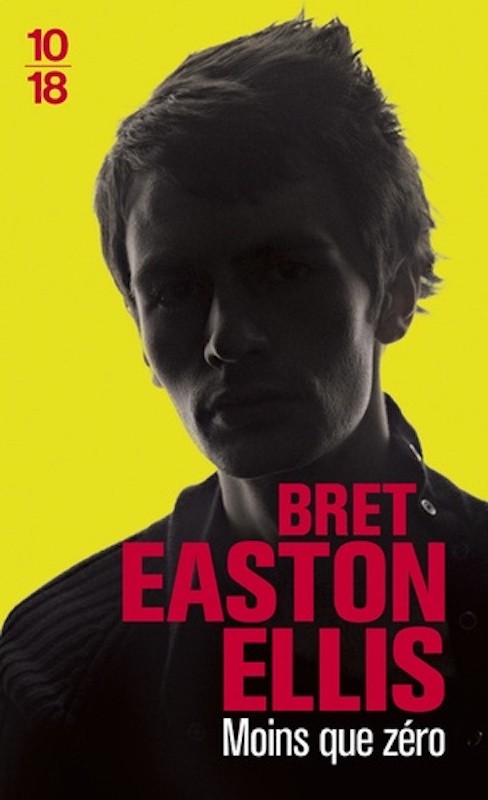

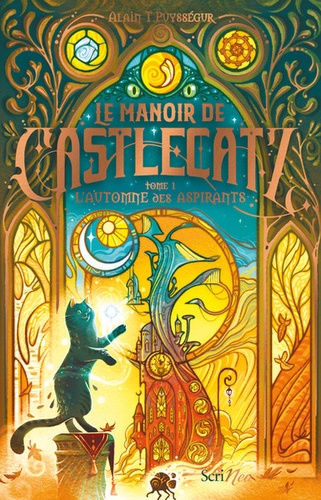

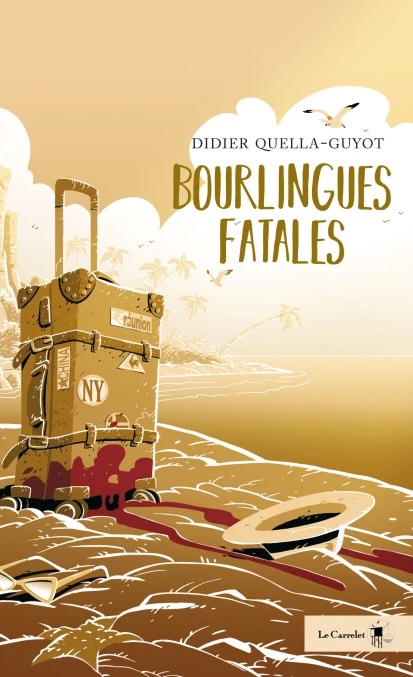

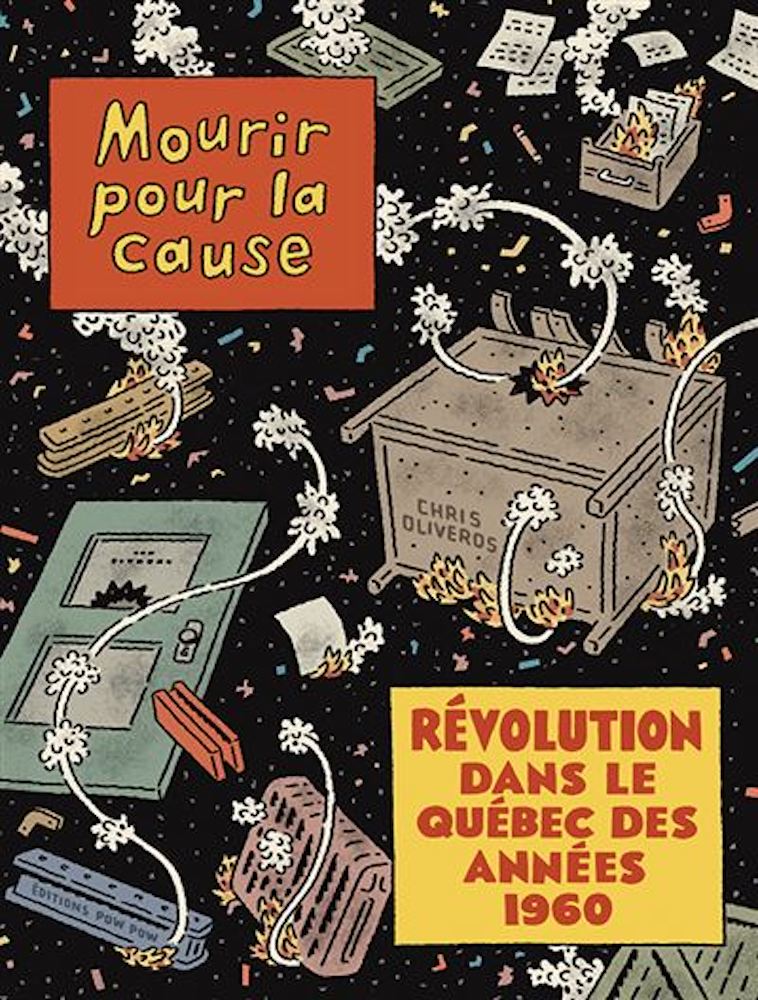
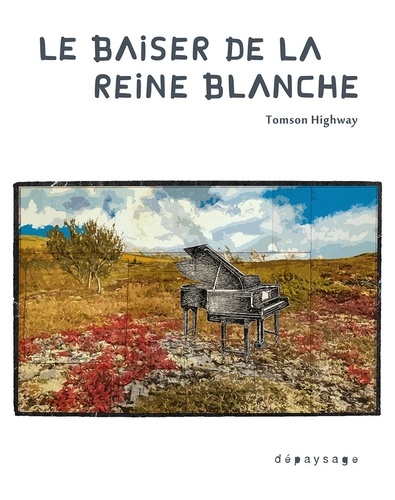
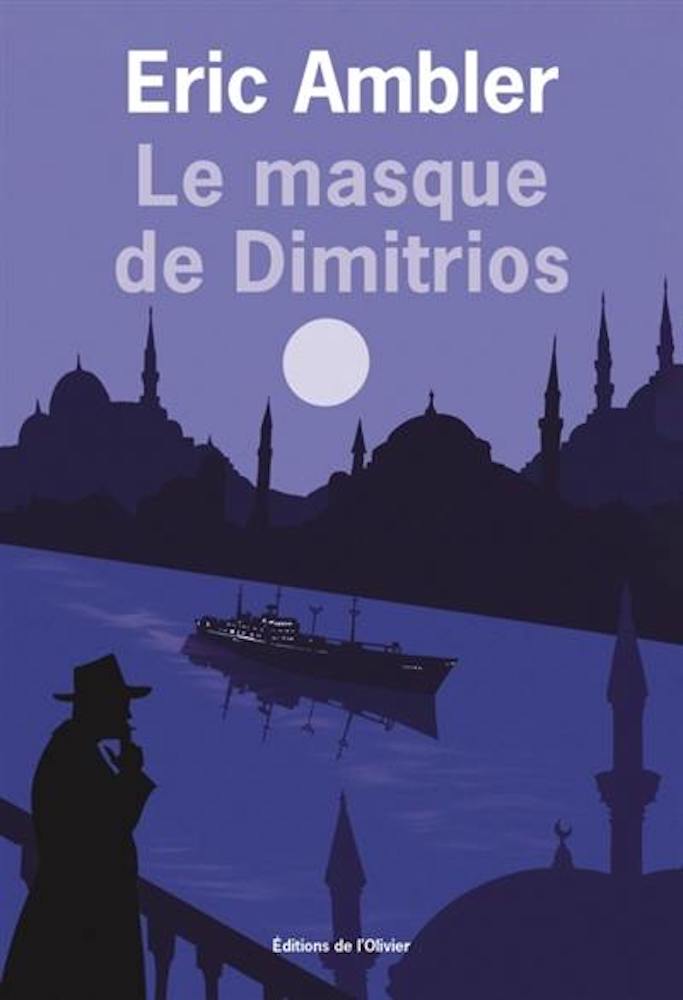
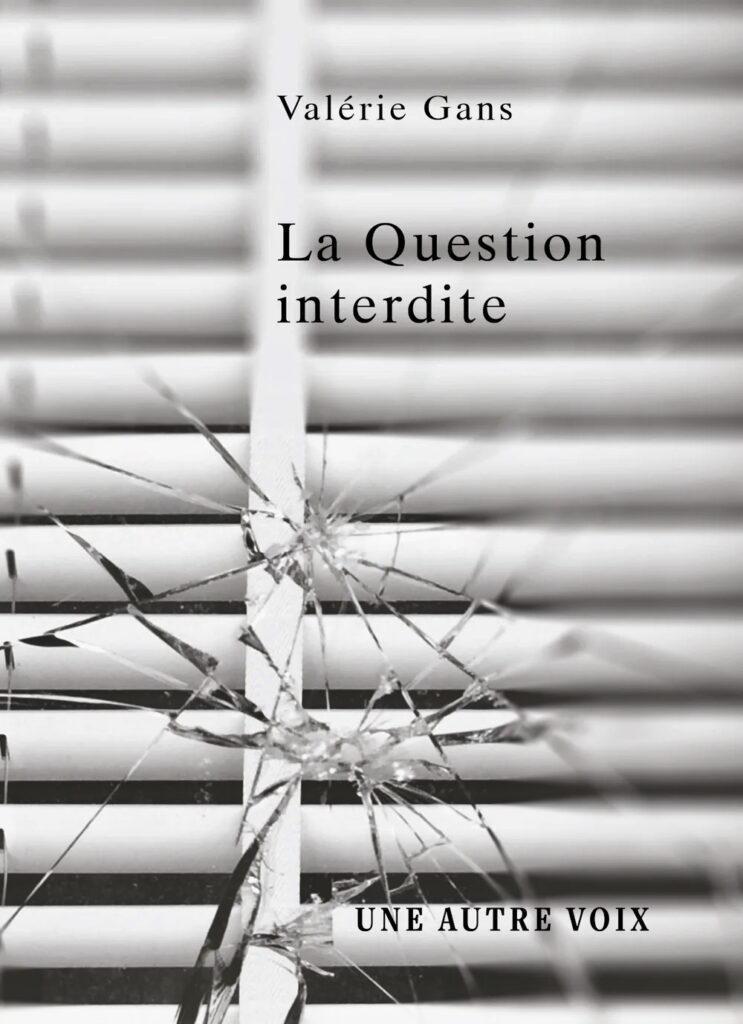
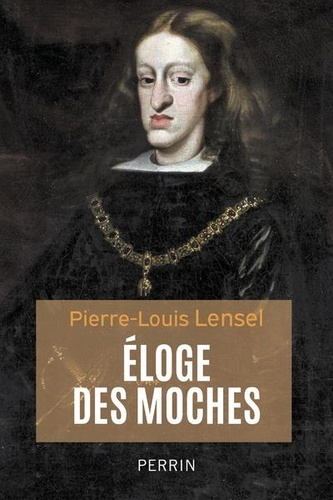
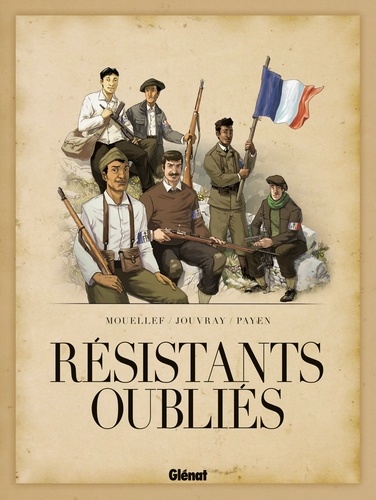

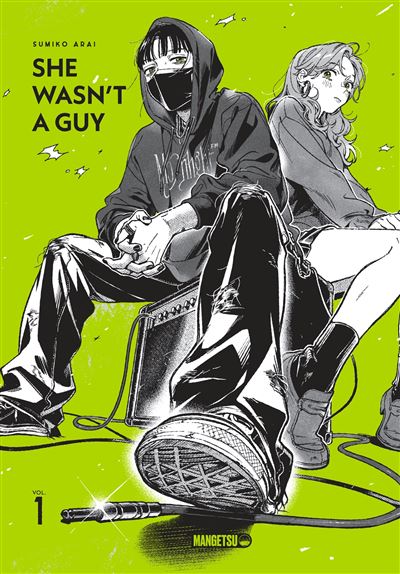
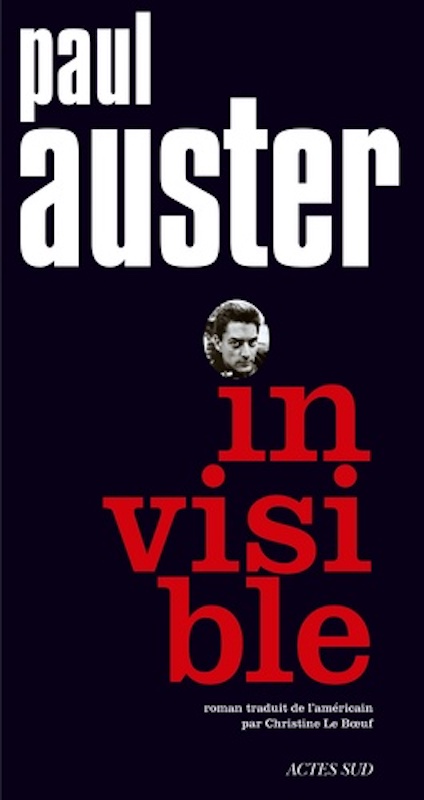
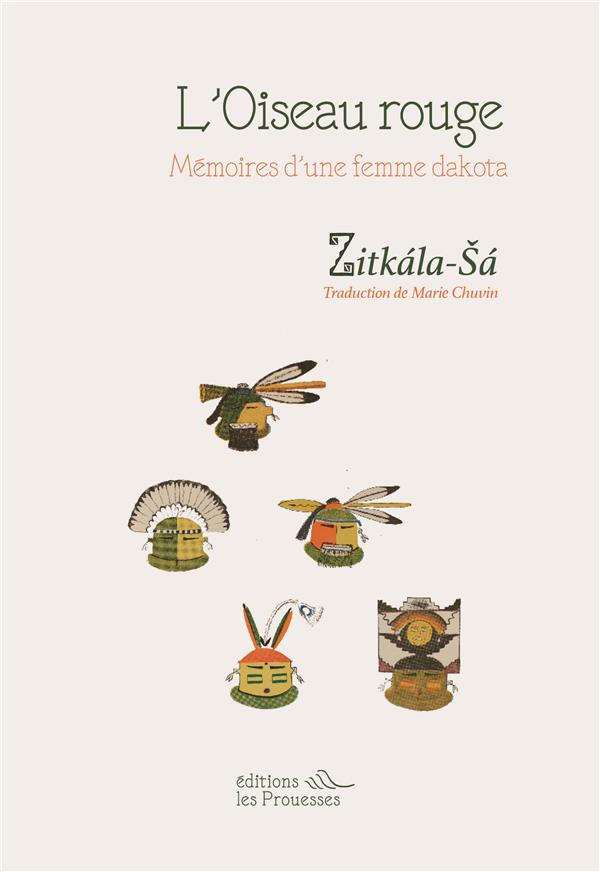


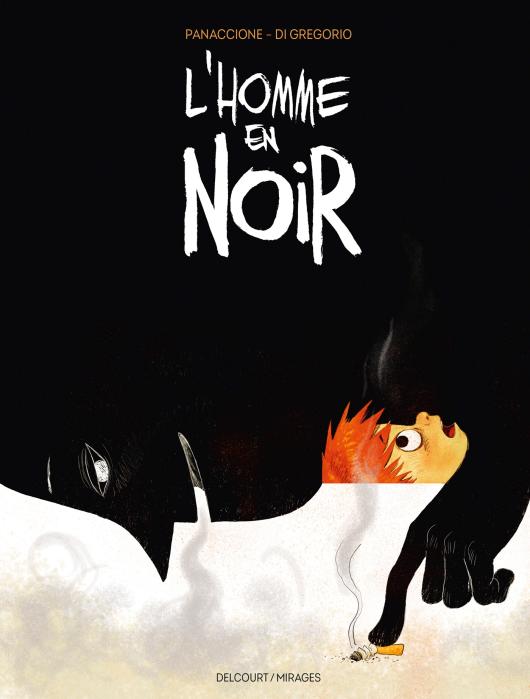



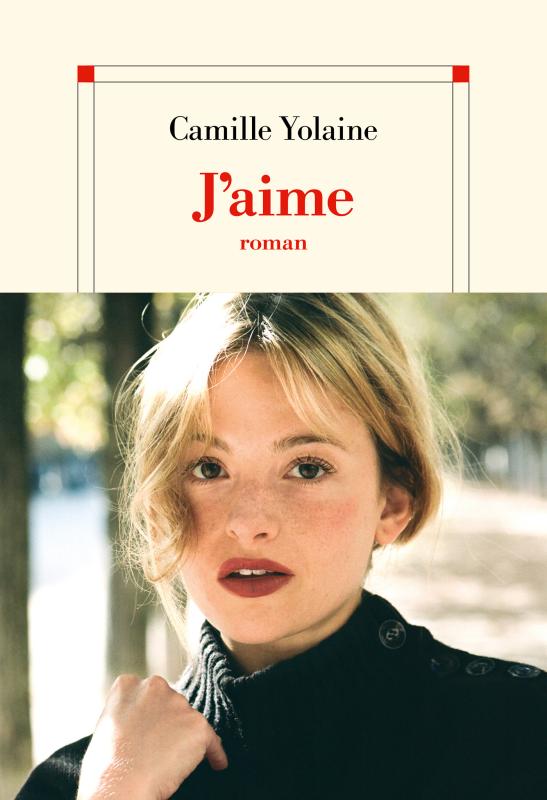
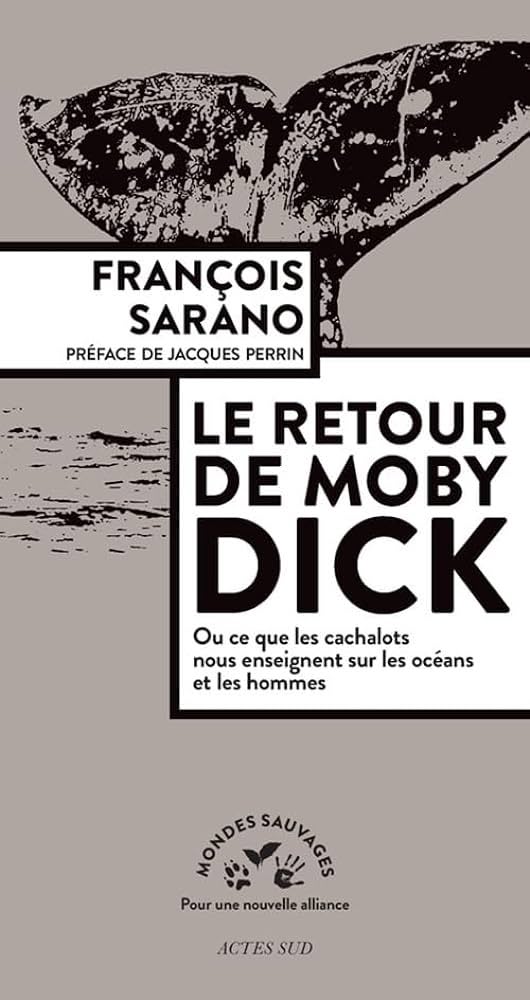




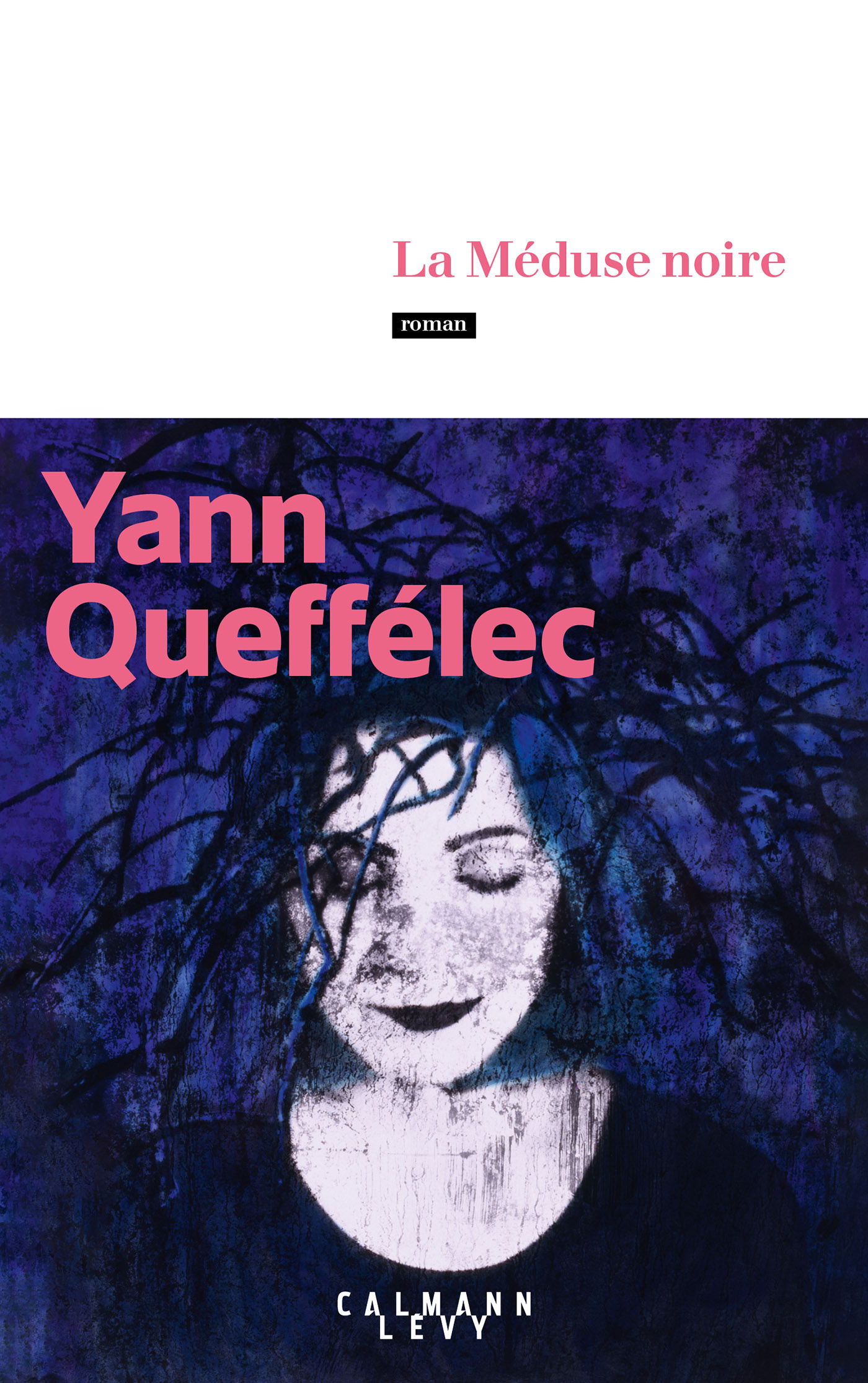




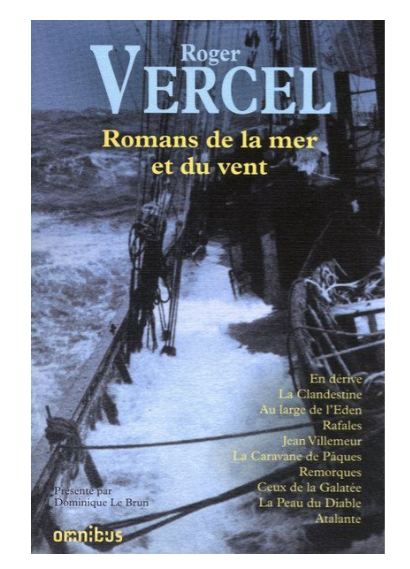

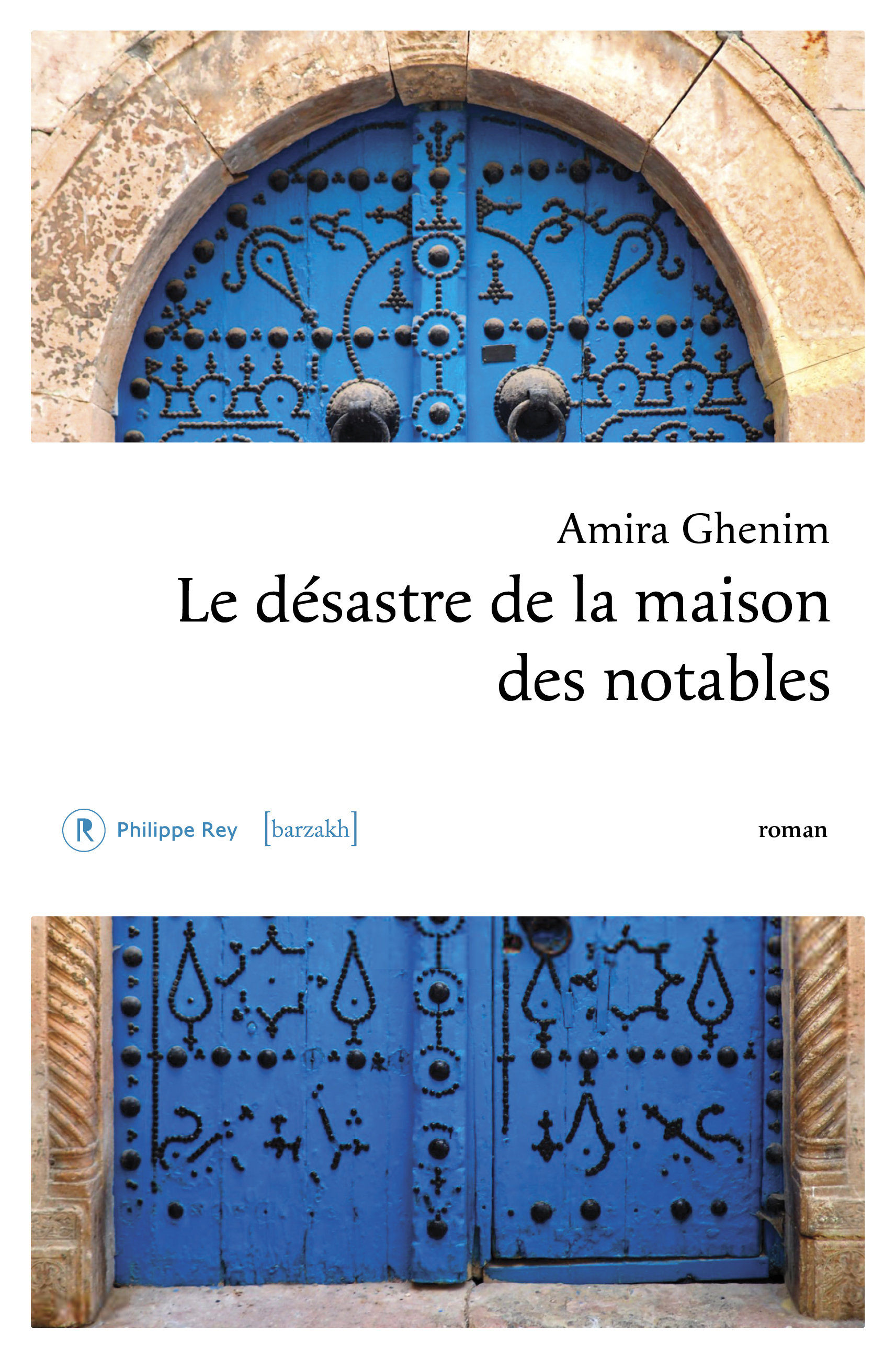
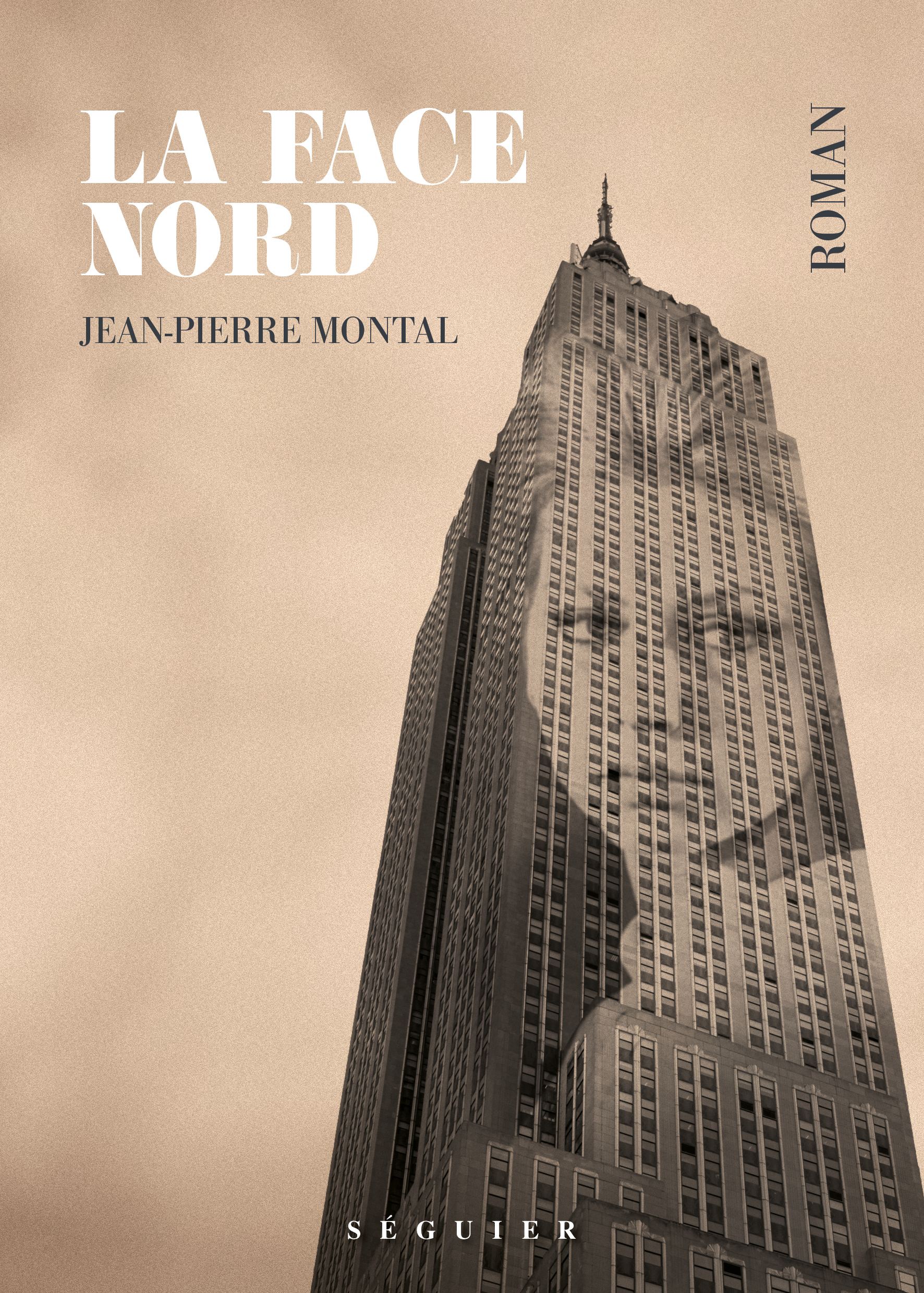



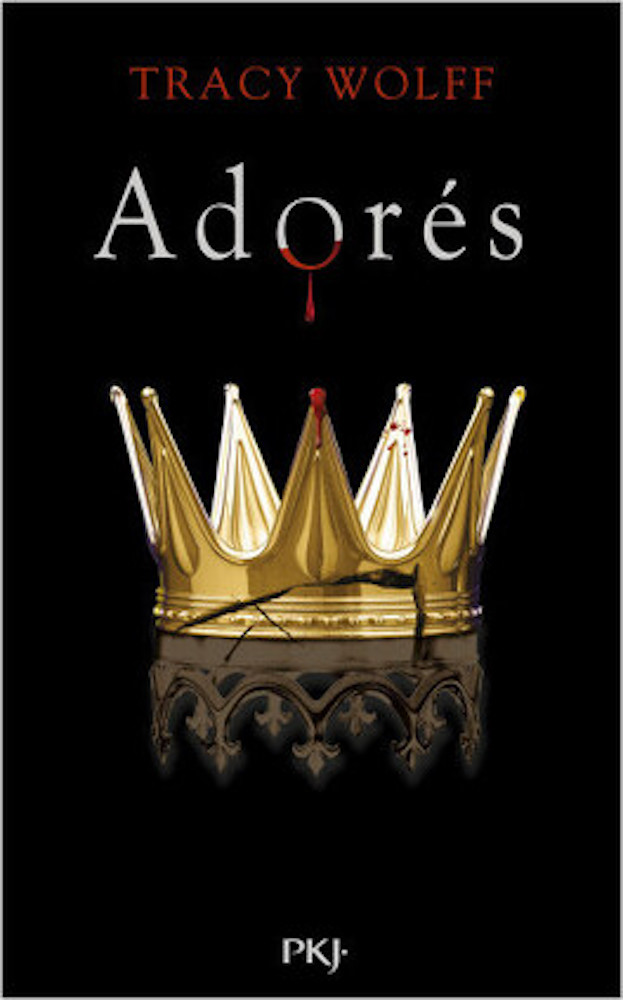
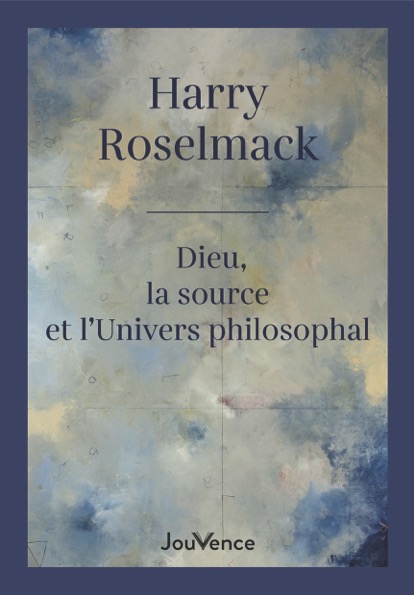
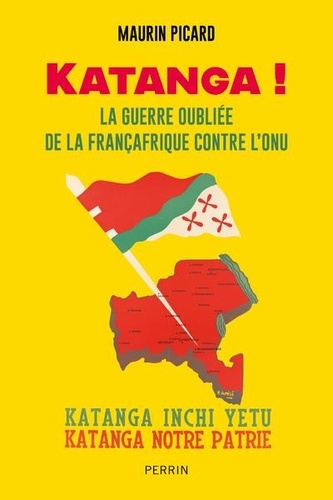

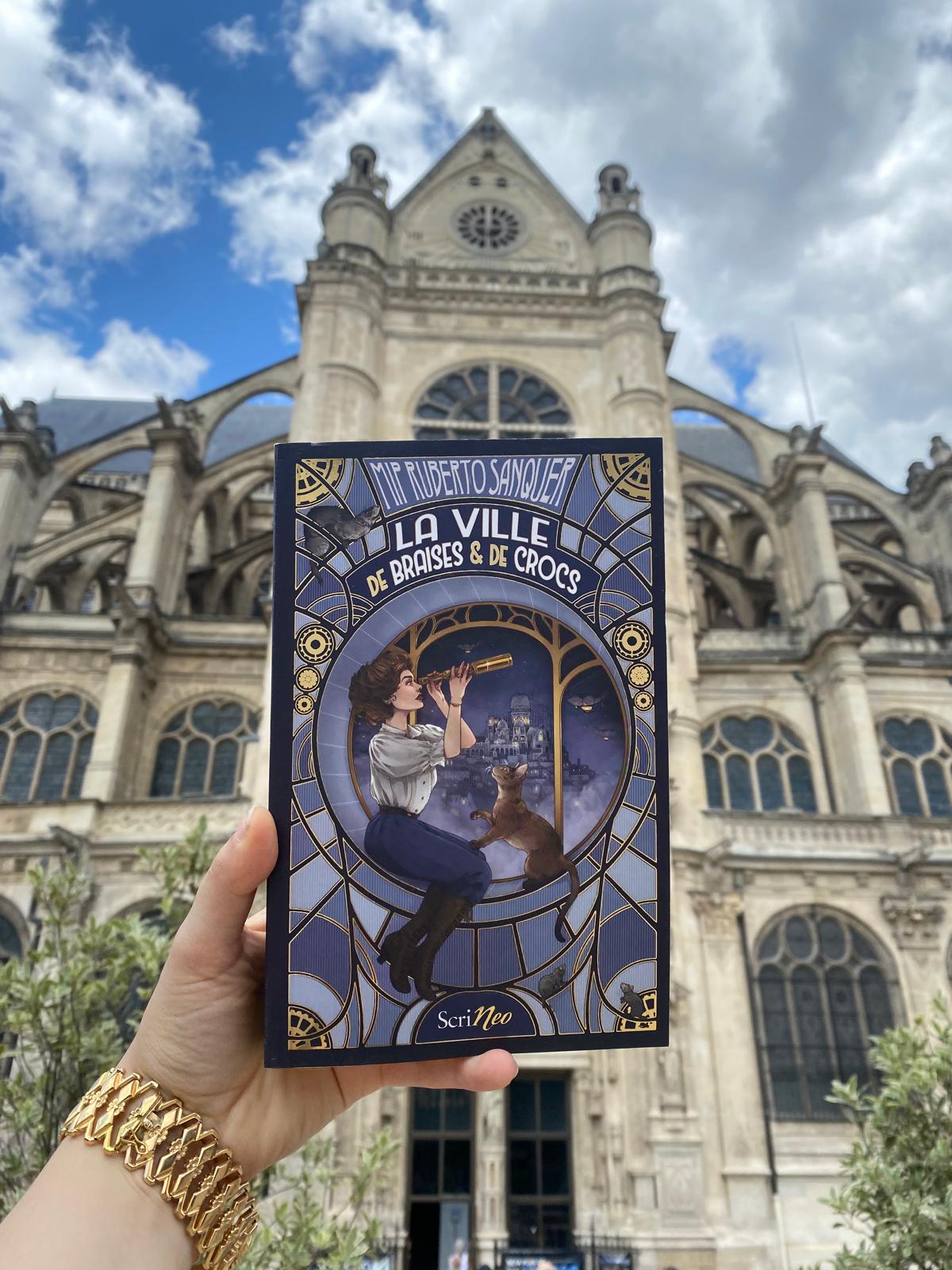



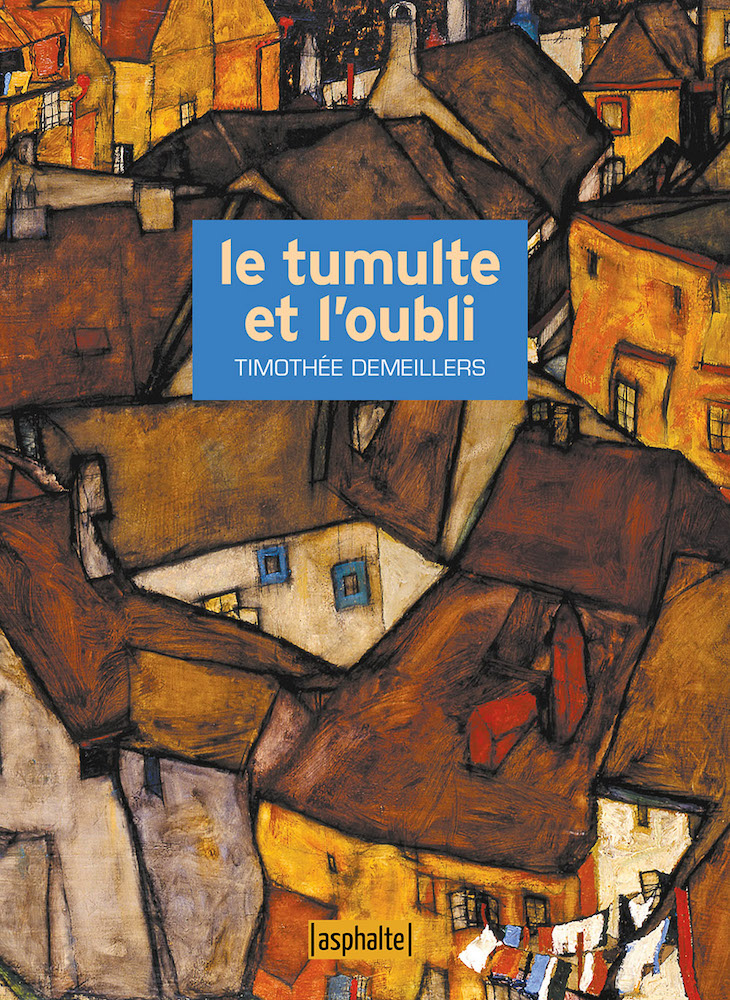


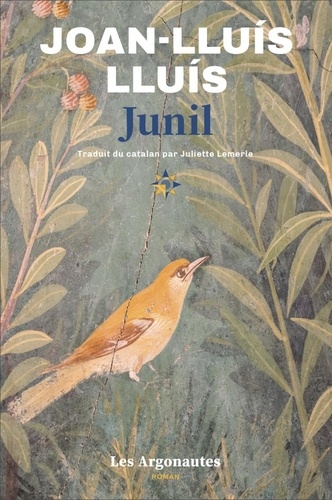


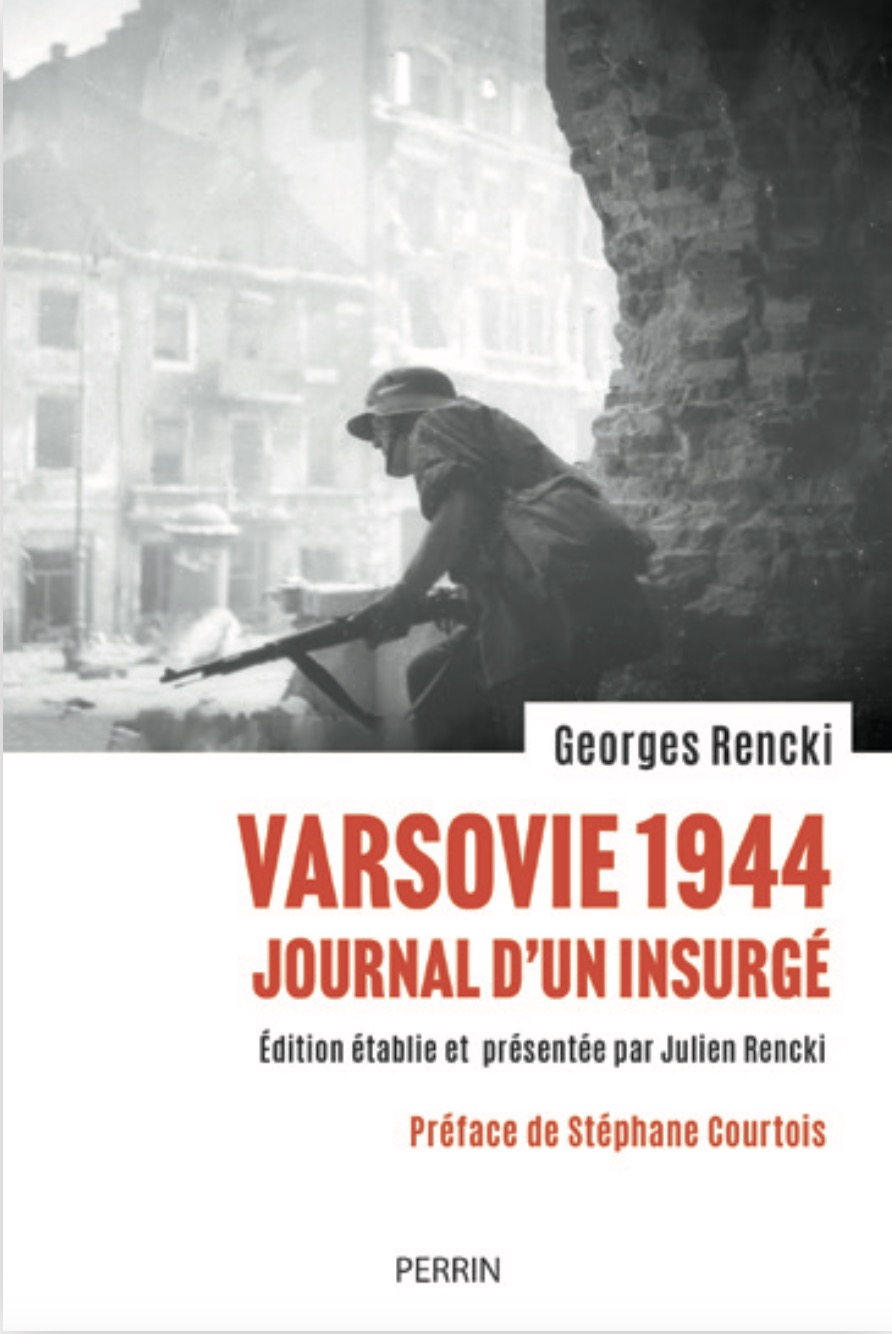
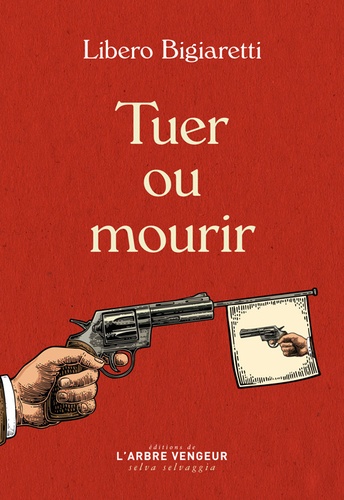




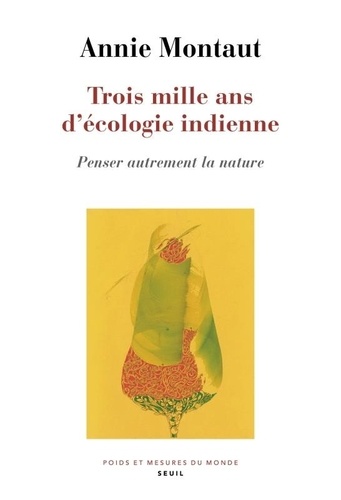
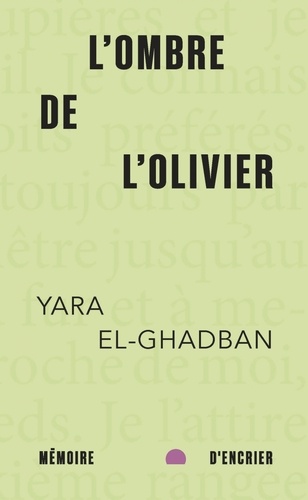
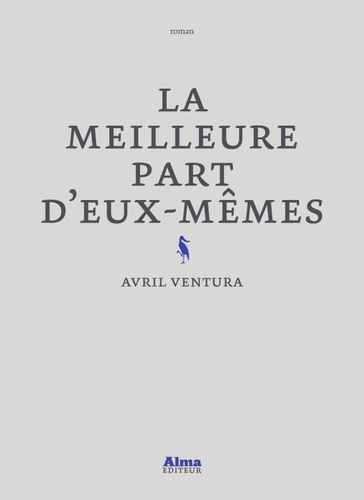

Commenter cet article