Uchronie biographique : Diderot à l'écran
Avec l’aide de chercheurs spécialistes, ActuaLitté vous propose d’explorer ce que seraient devenues certaines grandes figures littéraires françaises si elles avaient vécu en ce début de XXIe siècle. Qu’aurait fait Voltaire avec un smartphone dans la poche ? Qu'aurait imaginé Zola devant les lignes de train automatiques ? Quels vers aurait écrit Rimbaud sur Tinder ?
Le 11/09/2020 à 16:10 par Auteur invité
2 Réactions | 1 Partages
Publié le :
11/09/2020 à 16:10
2
Commentaires
1
Partages

Pour cette seconde uchronie biographique, l'on vous présente un Diderot, cinéaste, critique d’art contemporain et instigateur de Wikipédia. Par Nathalie Kremer, Maître de conférences et enseignante à l'Université Sorbonne Nouvelle, auteure de Diderot devant Kandinsky : Pour une lecture anachronique de la critique d’art et de Traverser la peinture : Diderot - Baudelaire.
« J’avais en une journée cent physionomies diverses, selon la chose dont j’étais affecté. J’étais serein, triste, rêveur, tendre, violent, passionné, enthousiaste. Mais je ne fus jamais tel que vous me voyez là. » (Salon de 1767)
Le tempérament pétillant de celui que Voltaire appela le pantophile, - « l’ami de toutes choses » - aurait pu être né en ce début de XXIe siècle comme dans l’Antiquité : il aurait été le même grand homme qu’au XVIIIe siècle. Car Diderot n’est pas tant l’homme de son temps que l’homme de tous les temps : son esprit curieux, ouvert, agile, optimiste, ne recule devant aucun travail ni devant aucun problème à résoudre.
En ce sens, les développements technologiques et numériques modernes ainsi que leurs conséquences l’auraient passionné. Internaute avant l’heure, le philosophe utilisait son esprit comme aujourd’hui nous utilisons le web : « J'ai prisl’habitude d’arranger mes figures dans ma tête, comme si elles étaient sur la toile […] je les y transporte, et que c’est sur un grand mur que je regarde quand j’écris… » (Salon de 1765).
Sur la grande toile de l’esprit de Diderot, isolons trois preuves parmi d’autres de son incomparable actualité, qui font de lui un génie de l’écran : le philosophe inventa au milieu du XVIIIe siècle à la fois Wikipedia, le cinéma, et l’art moderne.
L’Encyclopédie, ou le Wikipedia des Lumières
Diderot consacra près d’un tiers de sa vie à la direction et à la rédaction de l’Encyclopédie. Le projet fut entamé avec d’Alembert, mais ce dernier ne conduira pas jusqu’au bout une entreprise dont les difficultés deviendront bien vite quasi insurmontables Ce projet complètement fou, à l’ambition démesurée avait dans son ADN ce qui a fait le succès de Wikipedia.
Il suffit pour cela de relire le titre complet de l’Encyclopédie :Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Par une société de gens de lettres. Ce titre montre que le projet encyclopédique a pour but de compiler non seulement tout le savoir sur les sciences et les arts, mais sur les métiers aussi : donc de reconnaître l’importance du savoir pratique et théorique, et cela dans tous les domaines, y compris techniques. Les onze volumes d’illustrations ou « Planches » sont à ce sujet révélateurs : ce sont des gravures permettant aux utilisateurs de l’Encyclopédie de voir le fonctionnement de quantité d’outils, de produits, de techniques.
Les sous titre « Par une société de gens de lettres »indique que Diderot et d’Alembert n’avaient pas la prétention de nous donner par leurs propres forces un état des lieux exhaustif des connaissances de leur époque, mais qu’ils ont su constituer un réseau de collaborateurs (près de deux cents) en fonction de leurs spécialisations respectives. L’Encyclopédie est résolument un ouvrage collectif ou « participatif ».
Enfin, pour remédier à cette organisation aléatoire qu'est l’alphabet (où se suivent évidemment de façon tout à fait illogique, par exemple, les termes « abdication », « abdomen », « abducteur »), les encyclopédistes introduisirent au sein de chaque article une série de termes logiquement corrélés au propos développé, vers lesquels le lecteur est renvoyé. Ces termes ne sont certes pas « cliquables » comme aujourd’hui sur le web, mais ils ont la même fonction qu'ont aujourd'hui les « hyperliens ».
On permet donc au lecteur de l’Encyclopédie de « surfer » au travers des pages en toute liberté, et donc en désordre, tout en lui proposant un « ordre » de pensée qu’il est libre ou non de choisir de suivre.
Le théâtre comme cinéma
Un autre exemple pour montrer que Diderot est un esprit moderne est son rapport au cinéma. Si le cinématographe a été inventé à la toute fin du XIXe siècle, Eisenstein montra néanmoins dans un essai daté de 1943 que « Diderot a parlé de cinéma ». Diderot ne pouvait certes pas connaître un art qui n’existait pas encore, mais tous ses écrits sur le théâtre ainsi que ses expériences dramatiques (à travers les deux pièces du genre du « drame bourgeois », dont il est l’inventeur : Le Fils naturel en 1757 et Le Père de famille en 1758) sont conçus de telle façon que, sans en avoir les moyens techniques, il invente le 7eme art.
« Imaginez-vous avoir devant vous un haut mur vous séparant du spectateur, et comportez-vous comme si jamais le rideau ne se levait », recommande le philosophe aux acteurs, en inventant ainsi ce qu’on appelle « le quatrième mur » au théâtre. Il invite en même temps ses comédiens à jouer comme si on pouvait les voir de tous les côtés, comme pourra seule le montrer plus tard une caméra : « si un ouvrage dramatique était bien fait et bien présenté, la scène offrirait au spectateur autant de tableaux réels qu’il y aurait dans l’action de moments favorables au peintre ».
C’est bien sûr son engouement pour la peinture, pour les « tableaux » que la vie et la scène doivent pouvoir montrer successivement en explorant toutes les facettes d’un geste, d’une pose, d’un mot, qui permettent à Diderot de rêver d’un théâtre où les personnages seraient vus de tous les plans différents. Diderot rêve par ailleurs d’un théâtre « où la décoration changeât toutes les fois que le lieu de la scène doit changer ». C’est, comme le soulignait Eisenstein, la vision d’un « spectacle qui suive pas à pas de manière invisible les péripéties du dialogue, c’est-à-dire faire ce qu’accomplit sans peine le ciné-panorama glissant sur les rails », afin qu’à chaque instant, à chaque mouvement des acteurs, un déplacement spatial puisse y correspondre.
Diderot devant Kandinsky
Cette passion du philosophe pour la peinture, on l'oublie trop souvent. Entre 1759 et 1781, Diderot écrira des milliers de pages de descriptions de tableaux exposés aux Salons du Louvre, à l’attention des illustres lecteurs de la revue manuscrite La Correspondance littéraire, dirigée et diffusée en quelques exemplaires en Europe par son ami Grimm. ll s’agit de décrire, et si possible, de vendre aux Princes et hauts dignitaires étrangers des tableaux des grands peintres de France qu’ils n’ont pas vus, faute d’avoir pu faire le déplacement jusqu’à Paris durant la période du Salon. Ce faisant, Diderot invente la critique d’art.
Mais on ne saurait réduire les pages de Diderot à un catalogue décrivant des tableaux et les jugeant sur base du grand principe classique de l’imitation. Le philosophe apprécie bien sûr les tableaux où le pinceau du peintre a su rivaliser avec la nature, où les dentelles semblent vraies, où l’eau pourrait se boire, où les jeunes filles invitent à être enlacées. « Il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger ; cette bigarade, l’ouvrir et la presser ; ce verre de vin, et le boire ; ces fruits, et les peler ; ce pâté, et y mettre le couteau », écrit Diderot à propos des natures mortes de Chardin, dont il ne se lasse pas. Mais au-delà de l’imitation parfaite, son œil apprécie la parfaite imitation : ces traces, invisibles ou non, de la main de l’artiste, qui révèlent que l’impression de « vrai » n’est néanmoins qu’un génial artifice du peintre.
Et, entrant plus loin dans les Salons, il apprécie dans et sous les « couches épaisses de couleur » la touche délicate et « floconneuse » de tel peintre, les lignes brisées des figures et des monuments chez tel autre, ou encore l’inachevé, le tableau imparfait, la rature qui opère la merveille, comme lorsque Chardin « se contente d’esquisser sa pensée en quatre coups de pinceau », et sans même prendre « la peine de faire des pieds et des mains », laissant ses toiles inachevées, alors qu’elles sont pourtant les plus mimétiques.
Comme si le philosophe étudiait la Composition VIII de Kandinsky, en résumant l’essence même de l’art moderne, il écrit à propos de Hubert Robert :
« Quatre lignes perpendiculaires, et voilà quatre belles colonnes, […] un triangle joignant le sommet de ces colonnes, et voilà un beau fronton, […] l’imagination fait le reste. Deux traits informes élancés en avant, et voilà deux bras ; deux autres traits informes, et voilà deux jambes ; deux endroits pochés au-dedans d’un ovale, et voilà deux yeux ; une ovale mal terminée, et voilà une tête, et voilà une figure qui s’agite, qui court, qui regarde, qui crie. » (Salon de 1767)
Avec l’imagination qui « fait le reste », On voit dans cette masse de lignes et de couleurs des figures, des monuments, un monde entier. Diderot est déjà au XVIIIe siècle un spectateur de l'art moderne.
L’ordinateur et l’homme
Finissons par une idée importante de Diderot et d’Alembert qu’on trouve dans leur « Discours préliminaire » à l’Encyclopédie. En essayant de trouver une façon d’organiser logiquement « la chaîne du savoir », c’est-à-dire la façon dont se tiennent logiquement (raisonnablement) ensemble les connaissances compilées dans l’Encyclopédie, les philosophes reconnaissent que leur logique de classement n’en est qu’une parmi d’autres, car plusieurs façons de classer, de réfléchir, d’aborder les choses sont possibles, écrivent-ils : « Peut-être que demain deux et deux feront cinq, et qu’un triangle aura quatre angles : par-là toutes les sciences perdraient leur unique et inébranlable fondement », lit-on à l’article « Vérité métaphysique ».
Le savoir est en constante évolution : rien n’est permanent, selon la conviction intime et optimiste de Diderot qui écrit dans Le Rêve de d’Alembert : « tout change, tout passe, il n’y a que le tout qui reste ». Mais une chose est sûre, souligne le « Discours préliminaire » :
« C’est la présence de l’homme qui rend l’existence des êtres intéressante […]. Qu’on suive telle autre voie qu’on aimera mieux, pourvu qu’on ne substitue pas à l’homme un être muet, insensible et froid. L’homme est le terme unique, d’où il faut partir, et auquel il faut tout ramener, si l’on veut plaire, intéresser, toucher, jusque dans les considérations les plus arides et les détails les plus secs. Abstraction faite de mon existence et du bonheur de mes semblables, que m’importe le reste de la nature ? »
L’homme, avec sa sensibilité, son expérience, son savoir, est la seule source du bonheur : ne substituons donc jamais un ordinateur, cet « être muet, insensible et froid » à l’homme sensible et vivant dont Diderot incarne l’un des plus grands exemples.
Dossier - Uchronie biographique : les figures littéraires du passé plongées dans un monde moderne




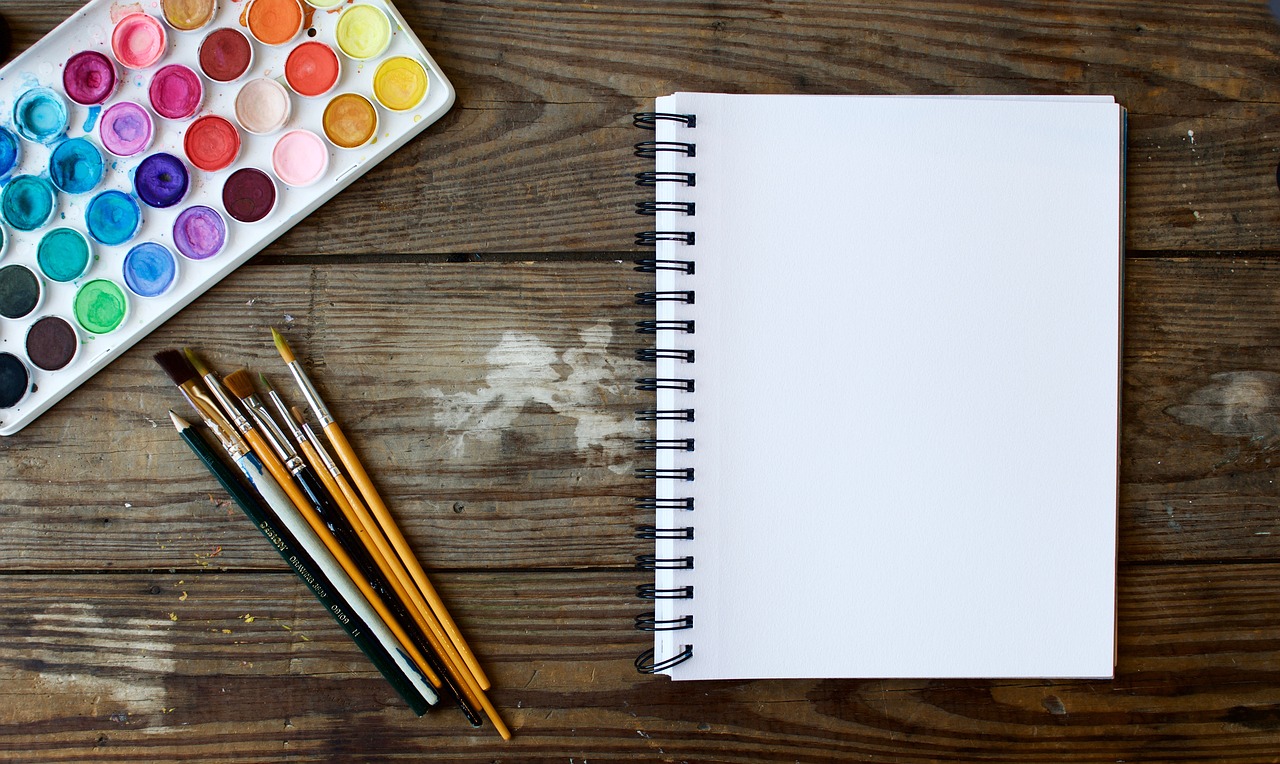





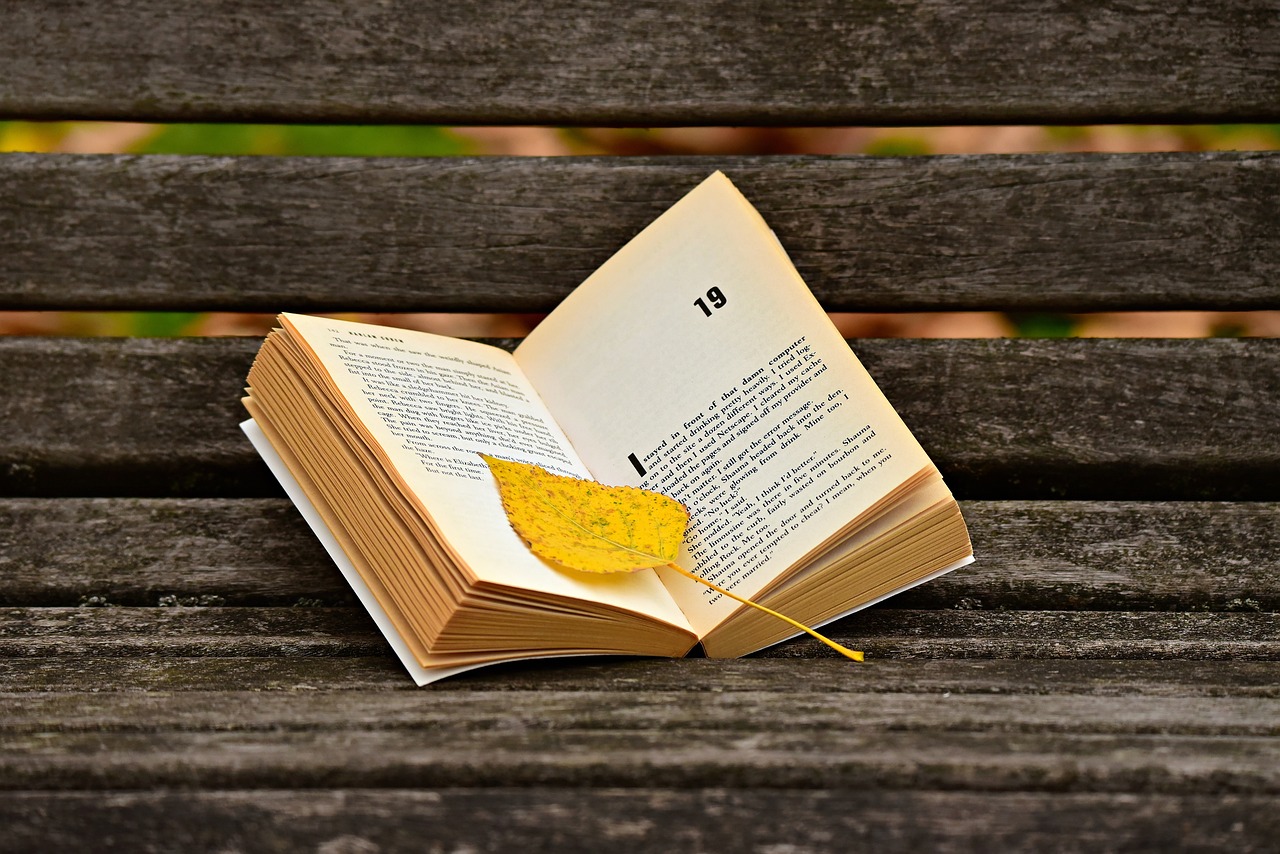
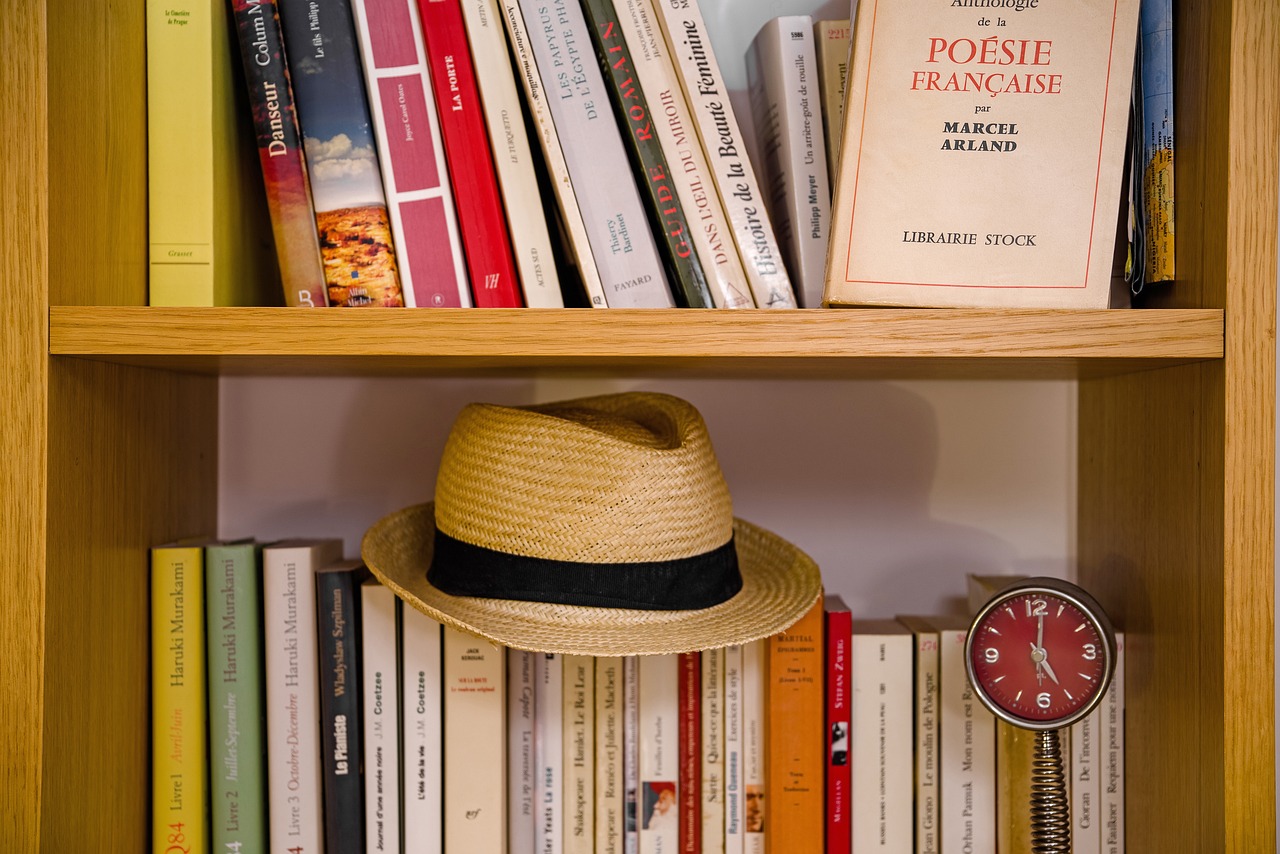















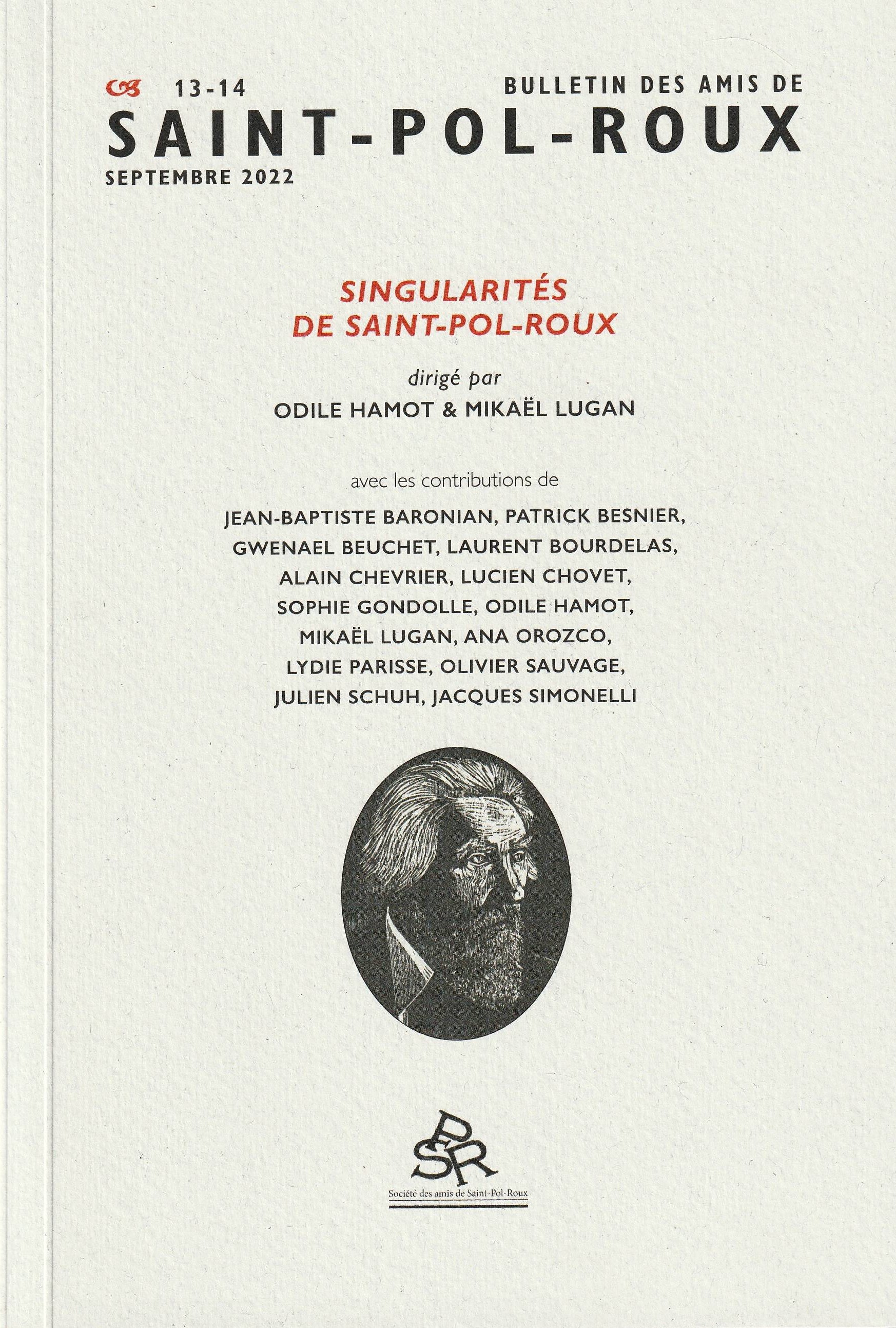



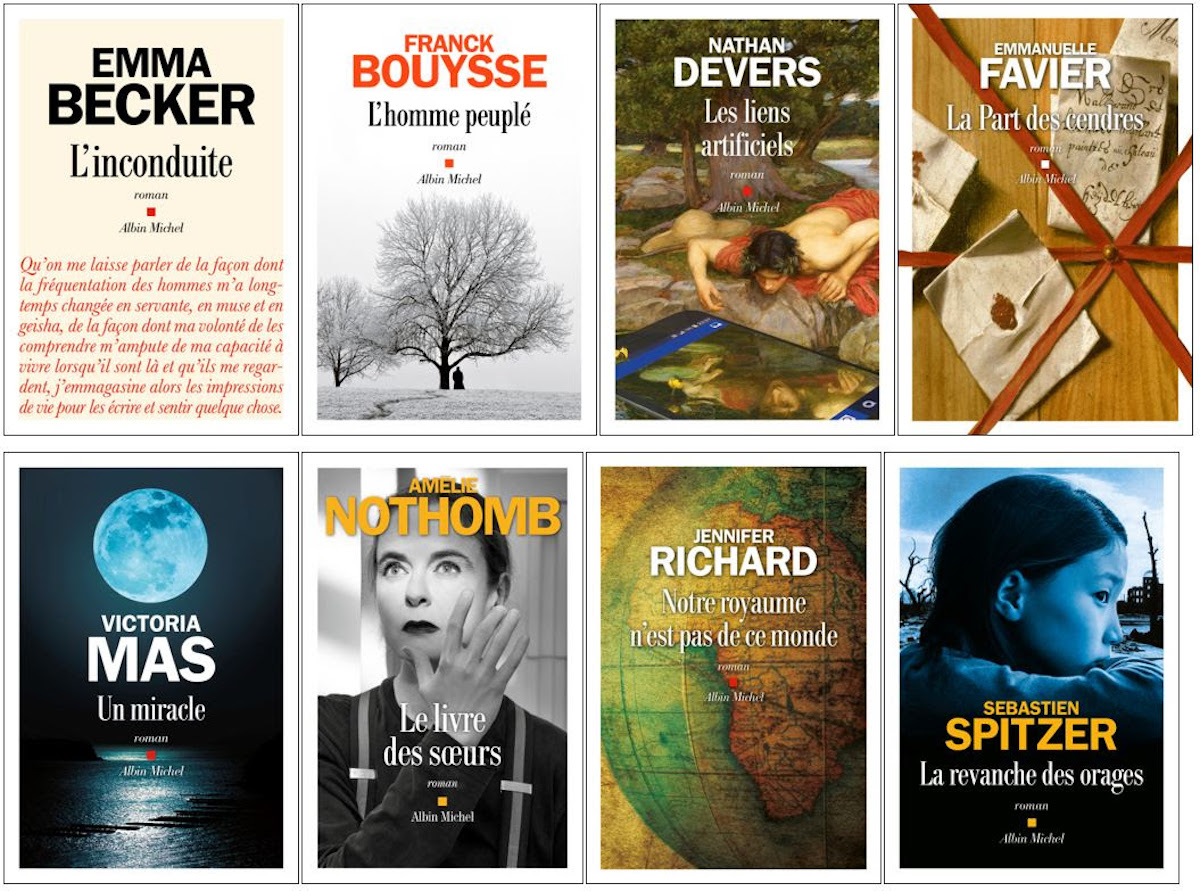
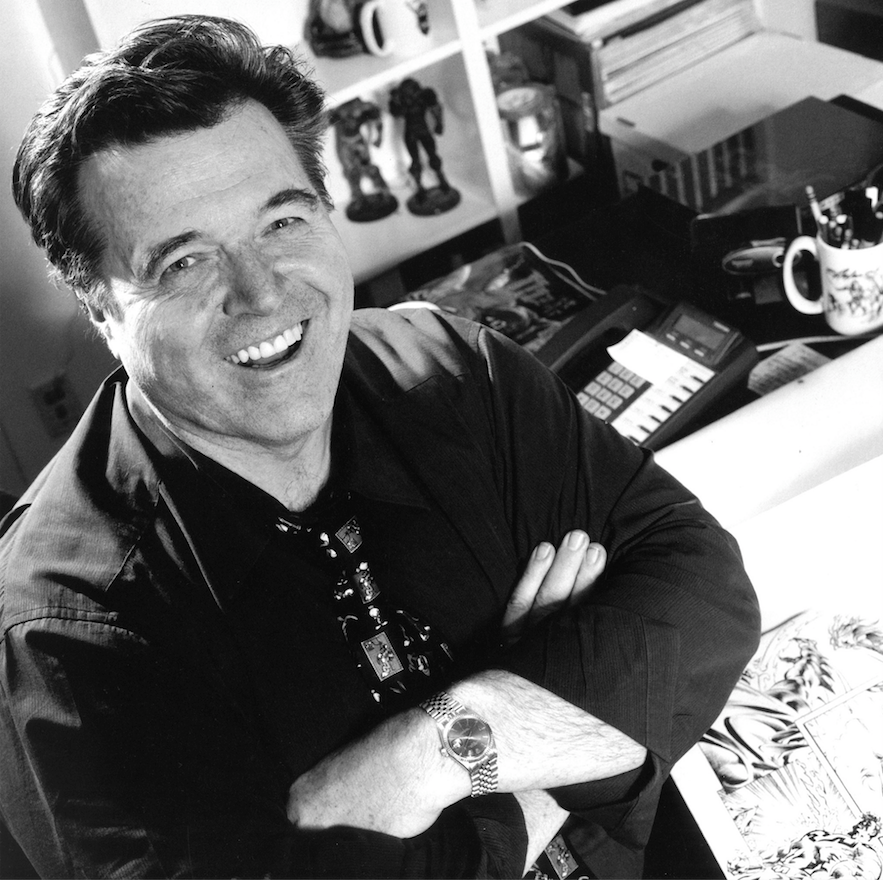

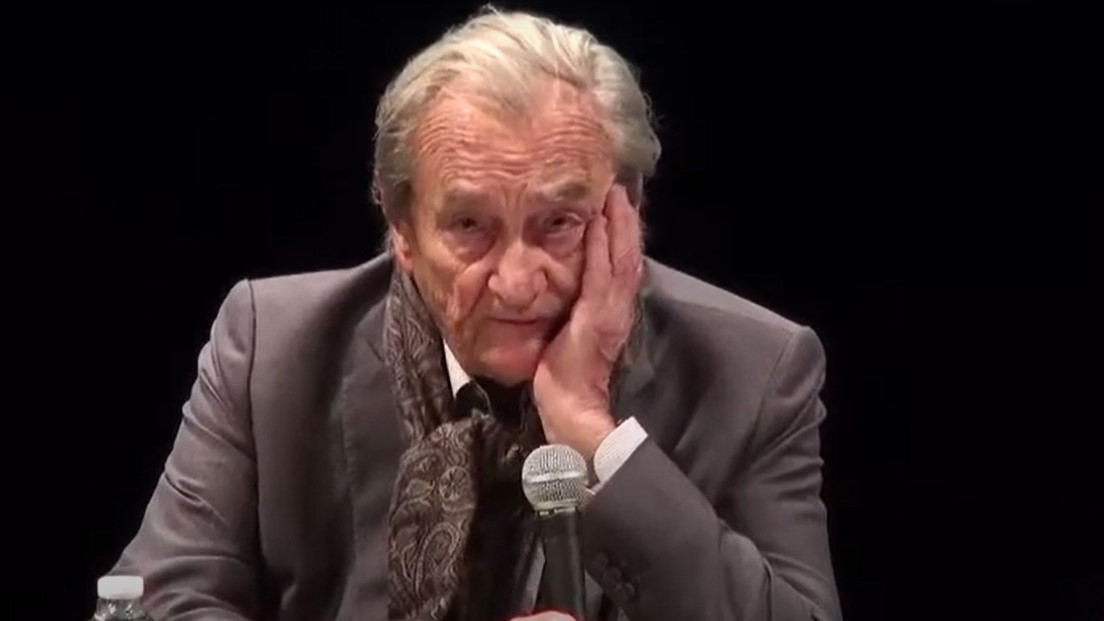


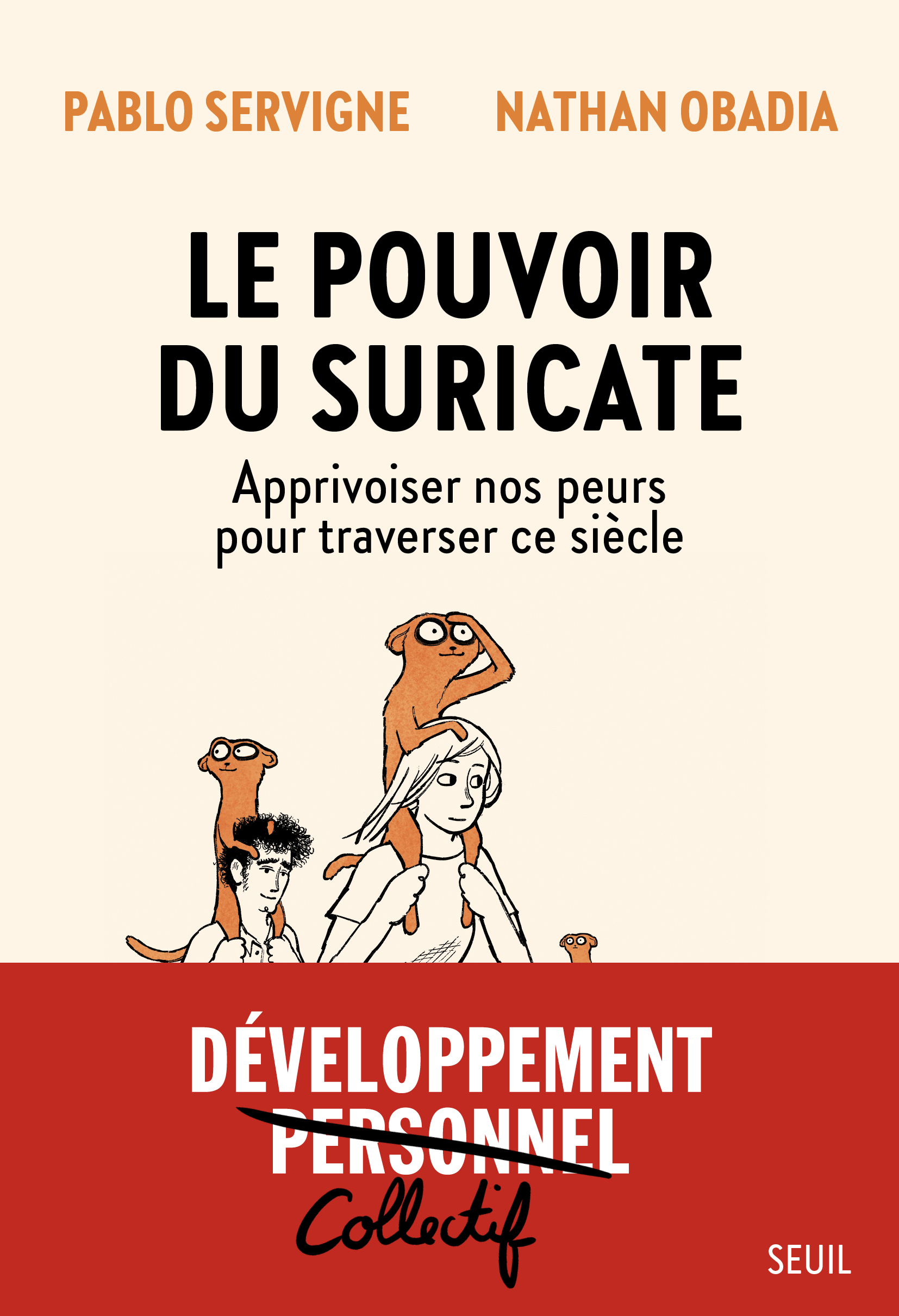
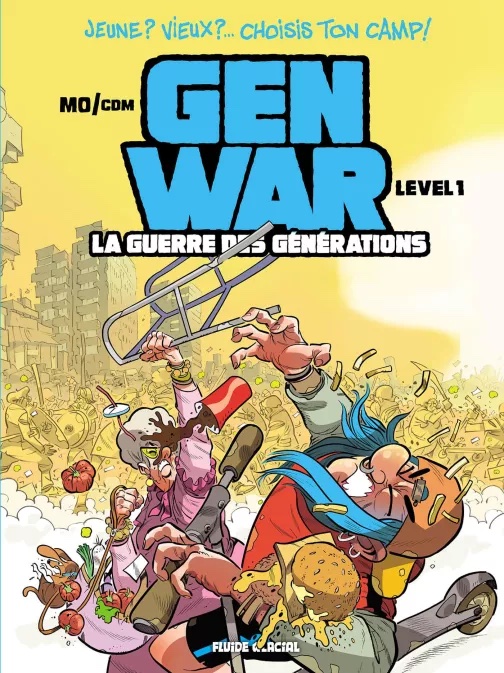
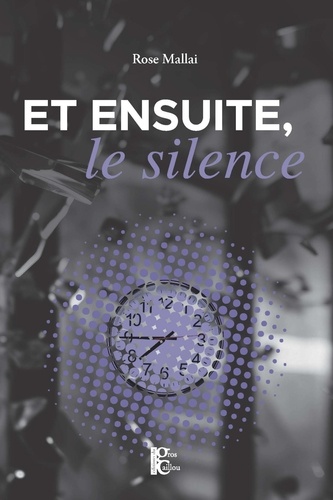
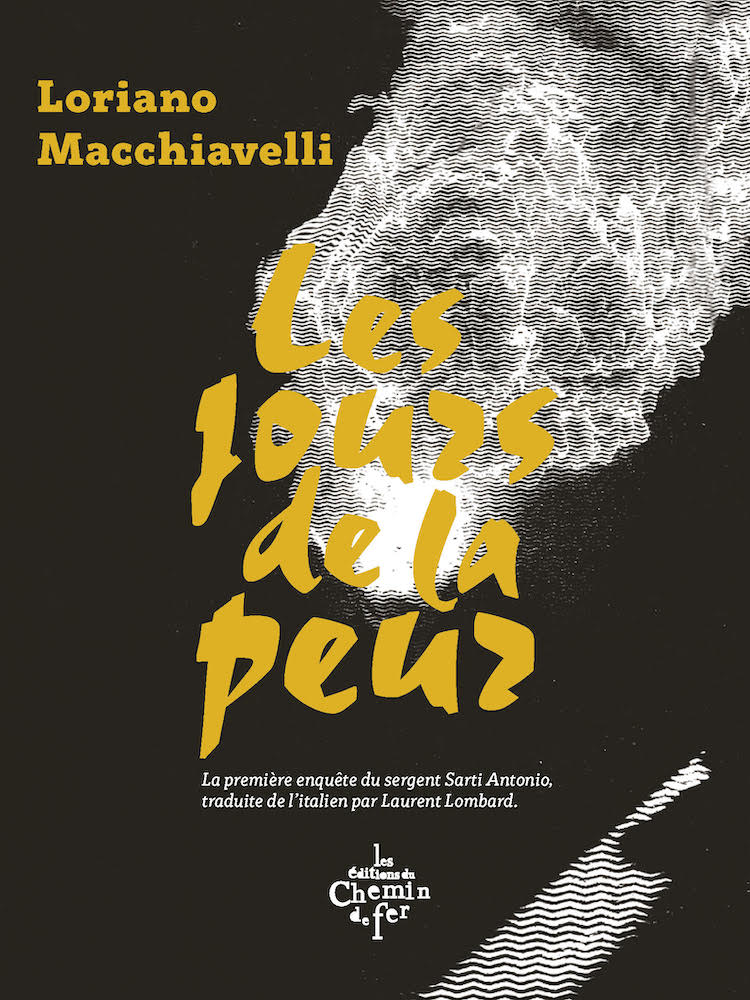

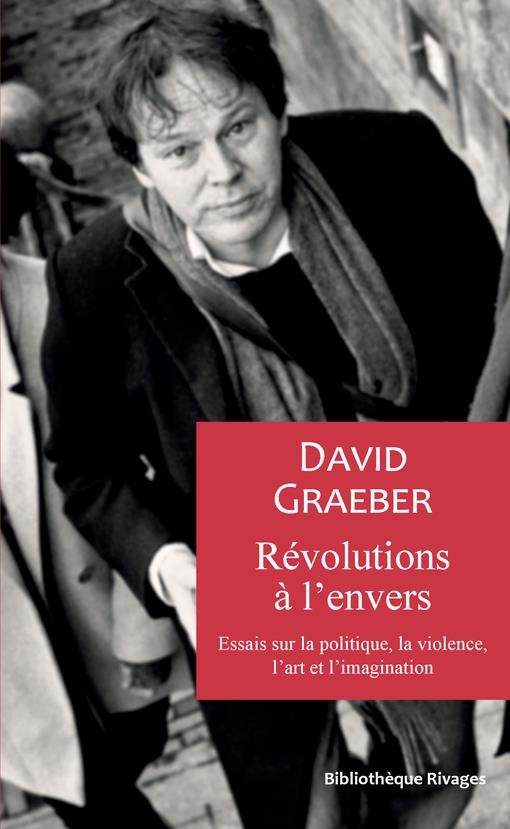
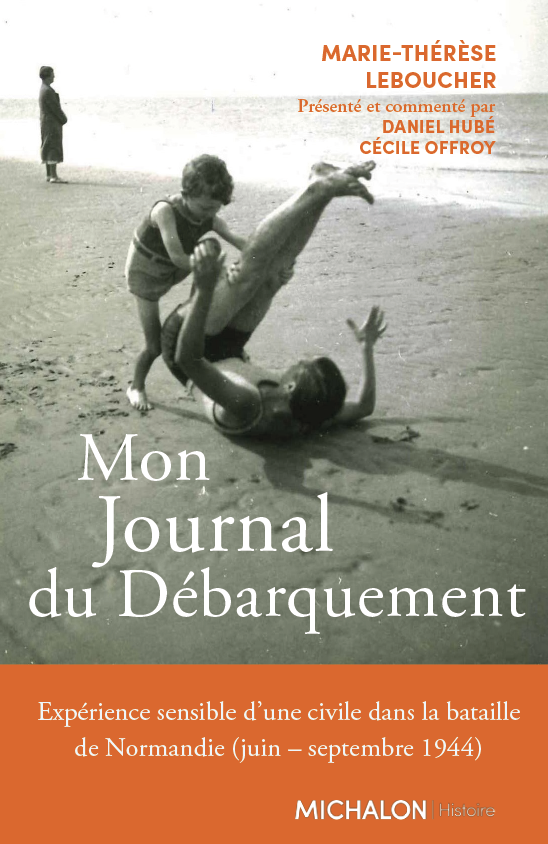
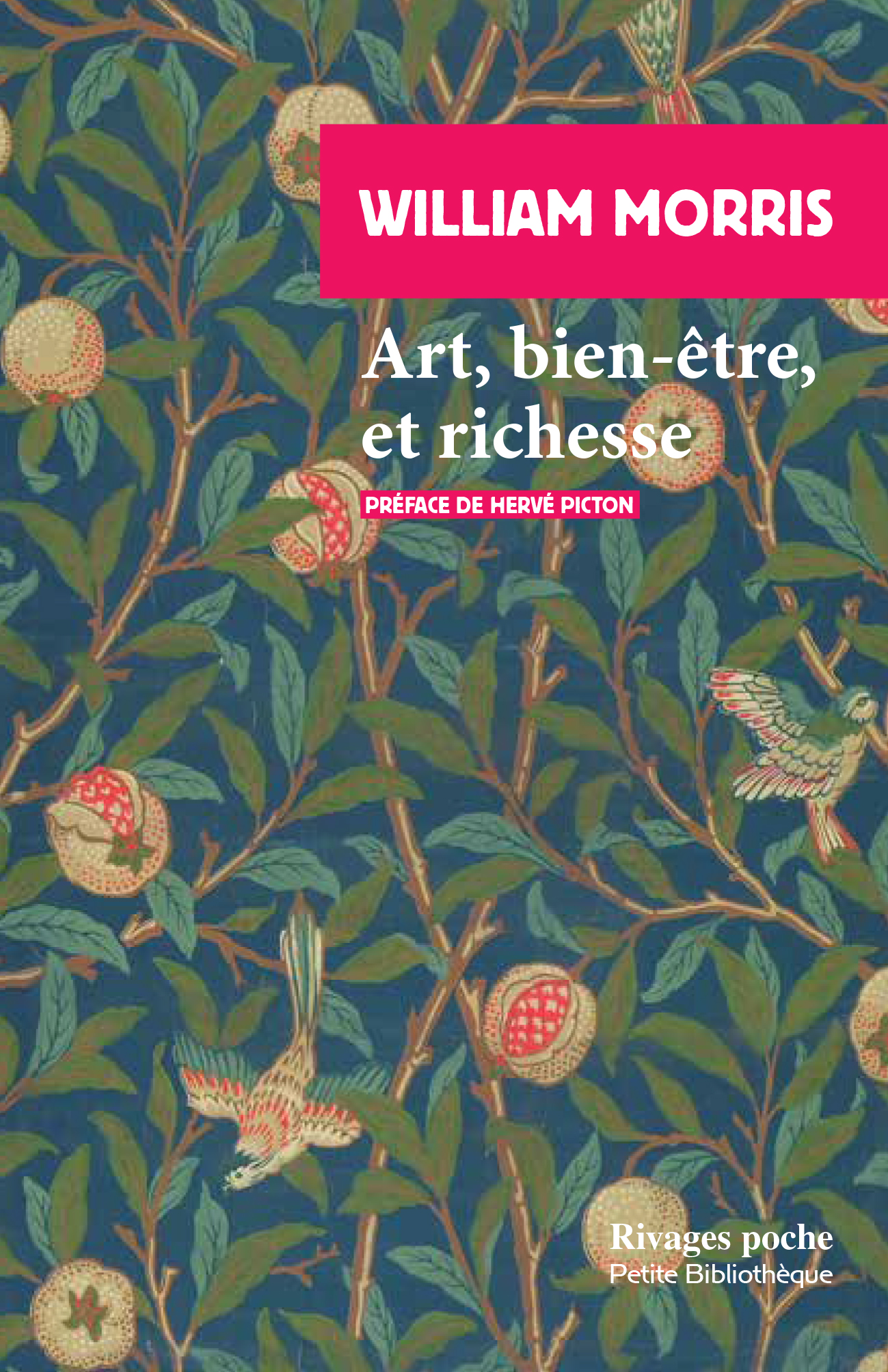

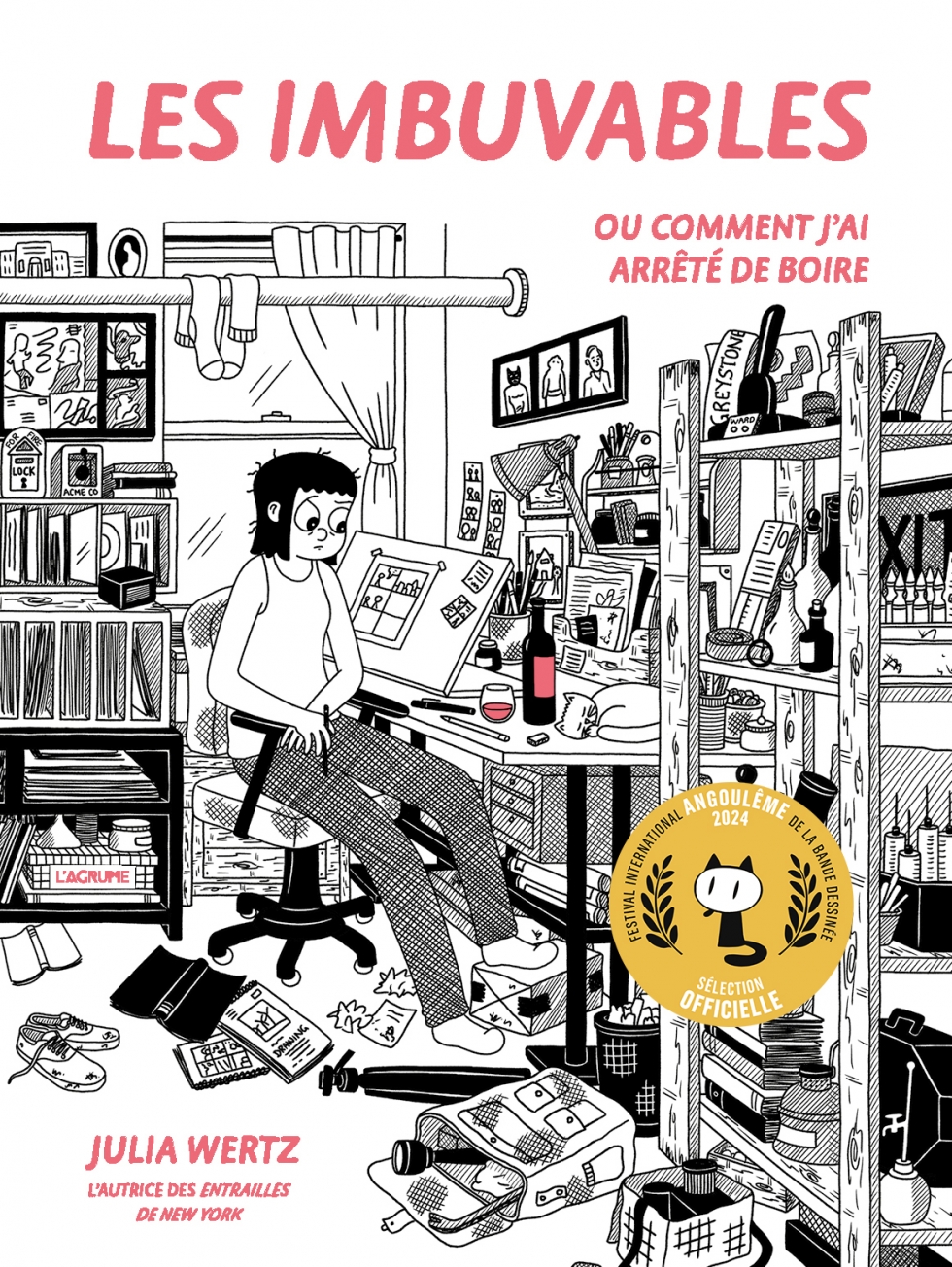
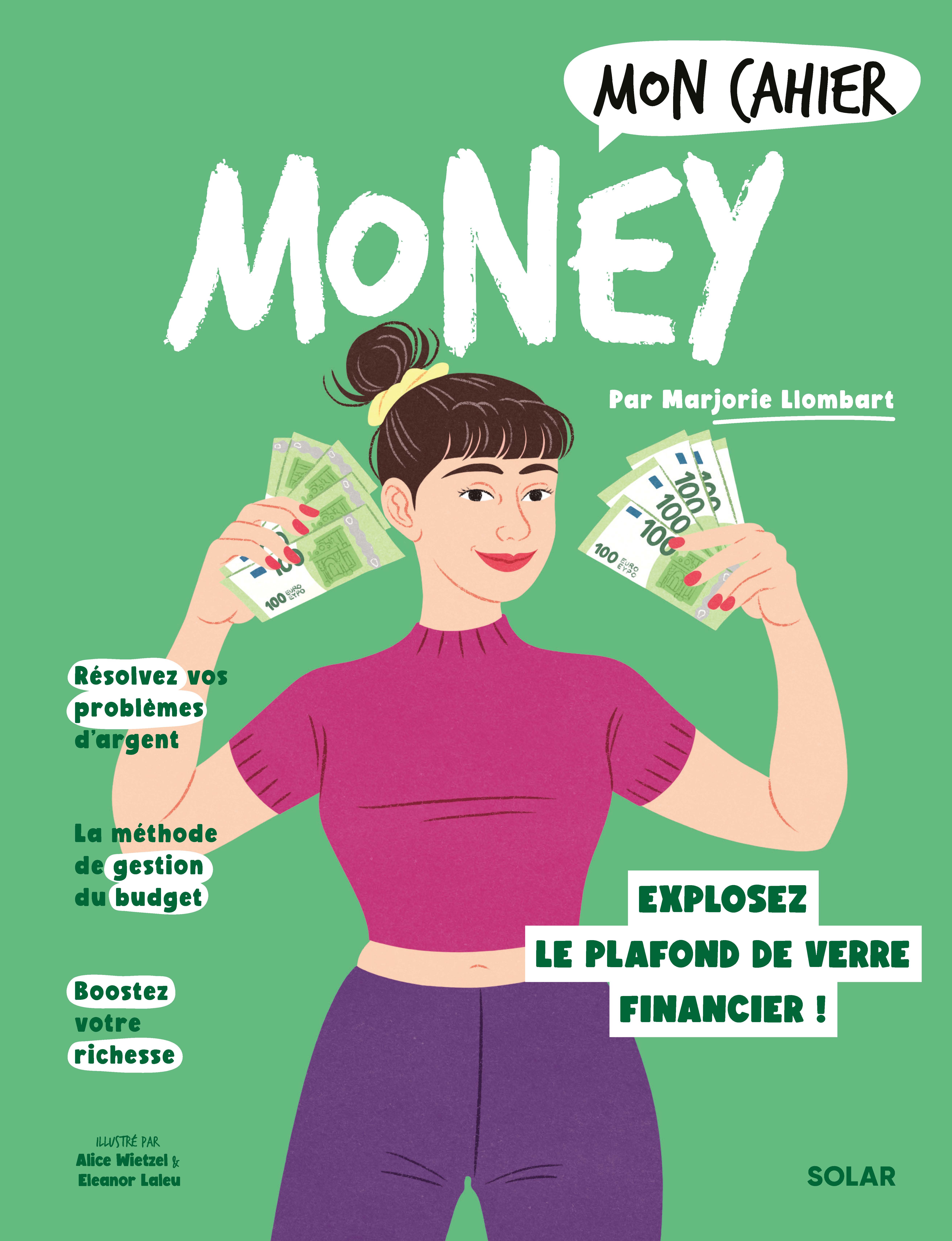
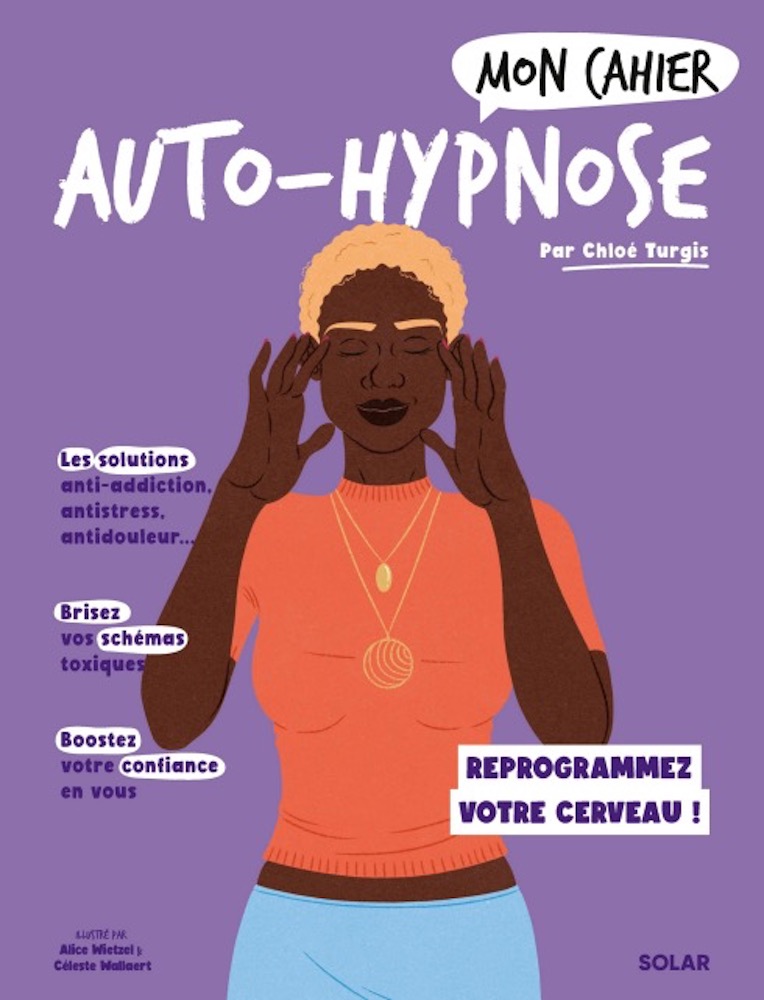
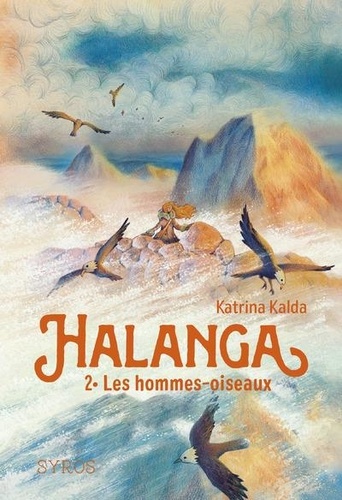
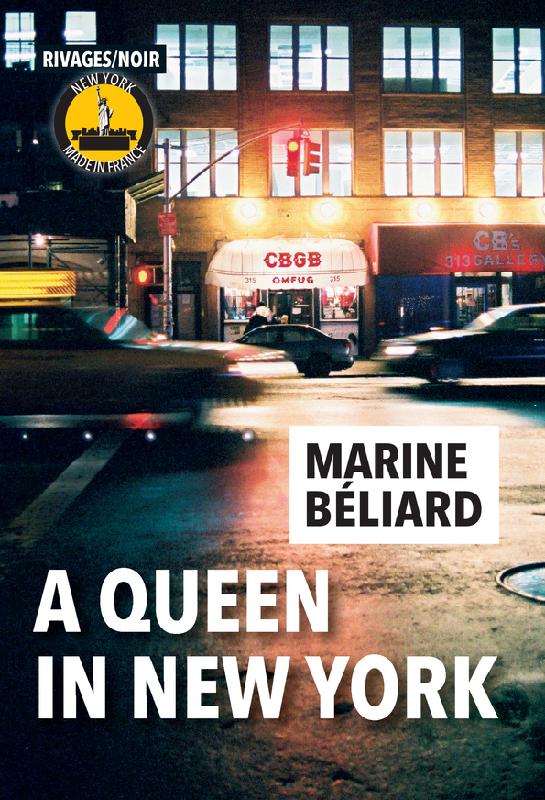
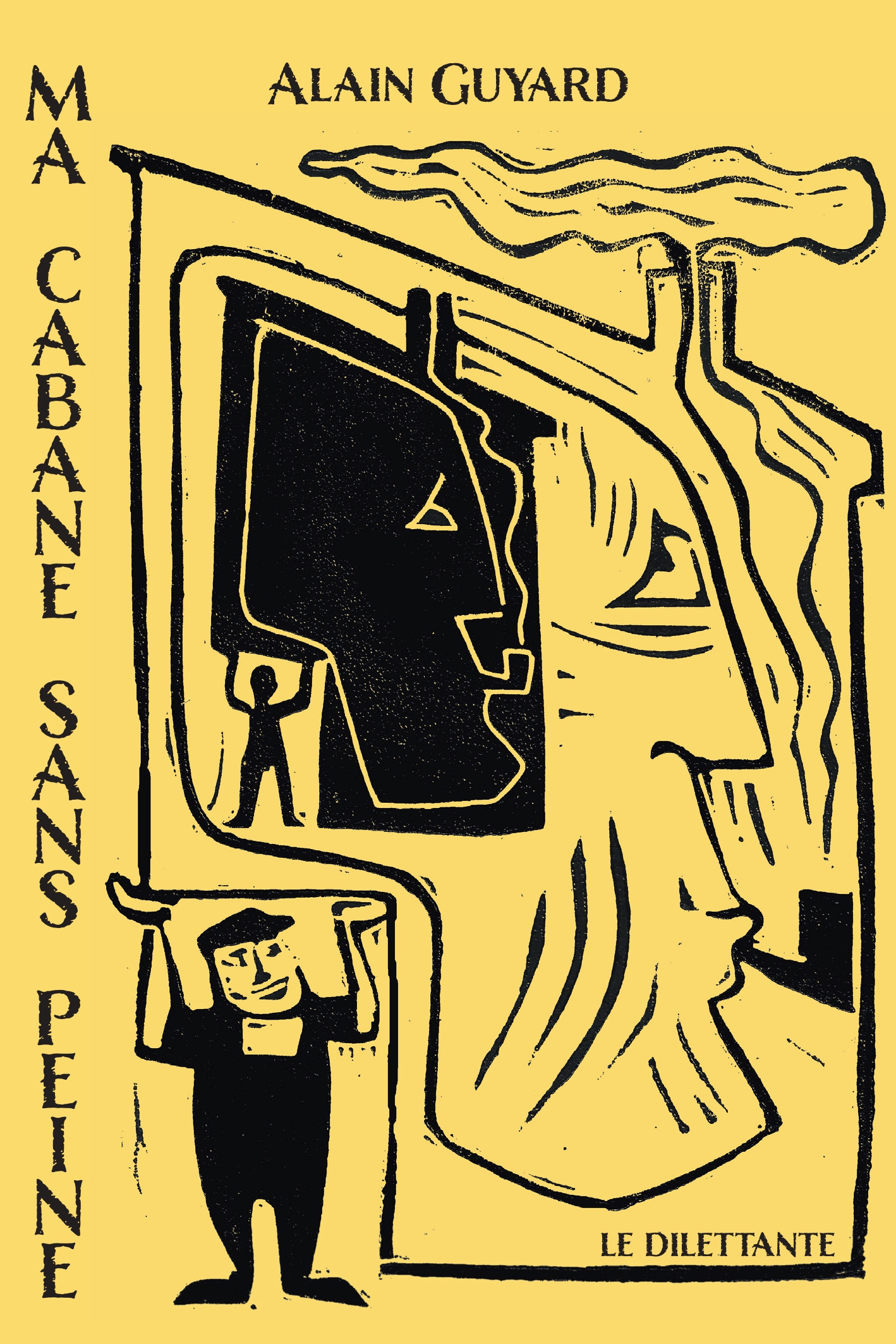
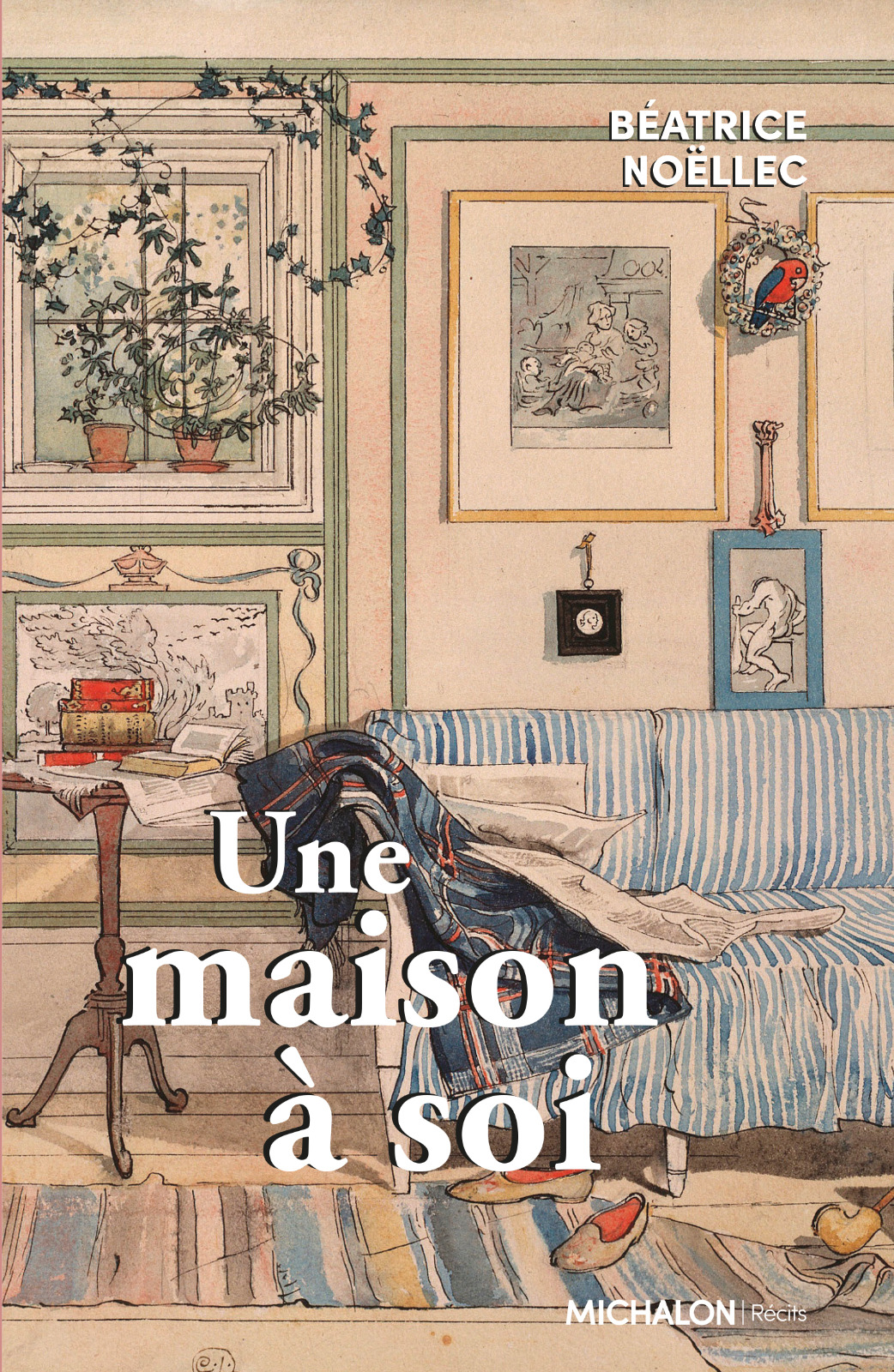
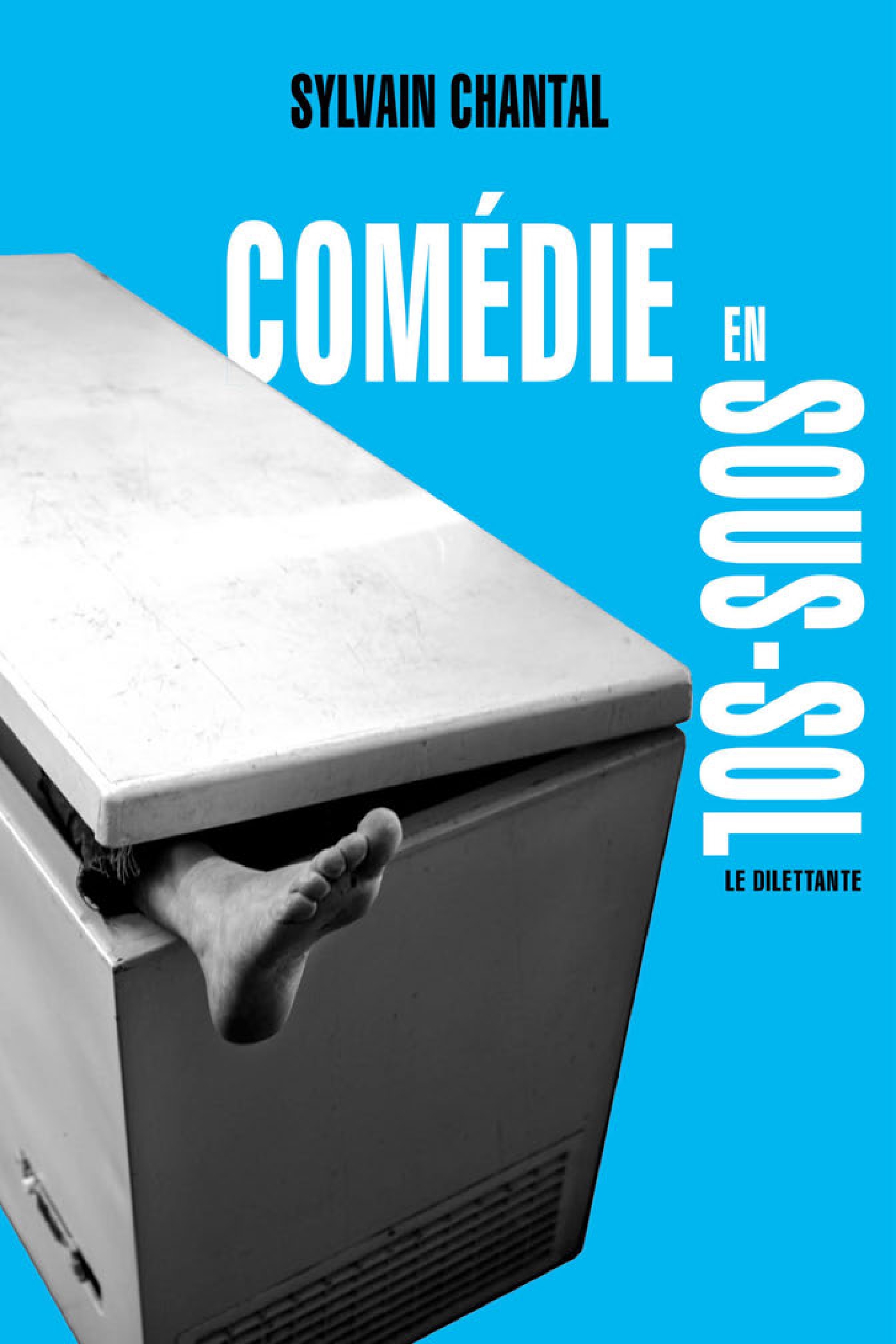
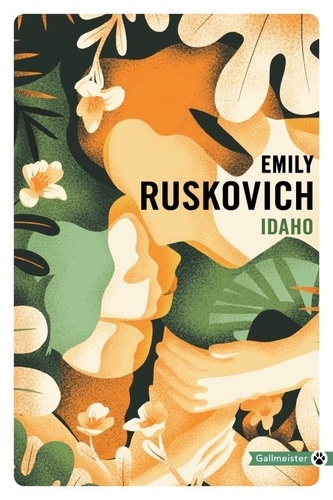
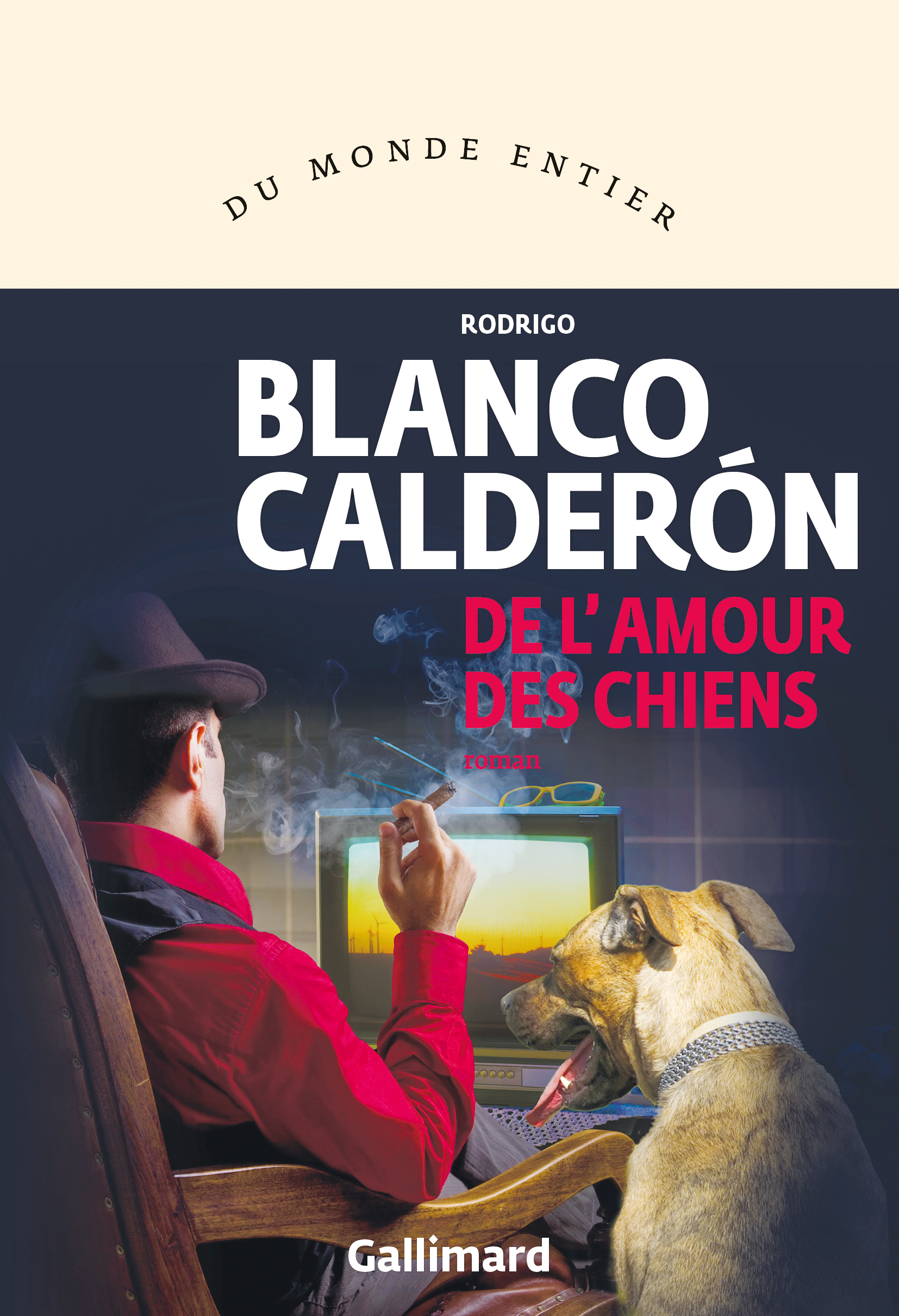
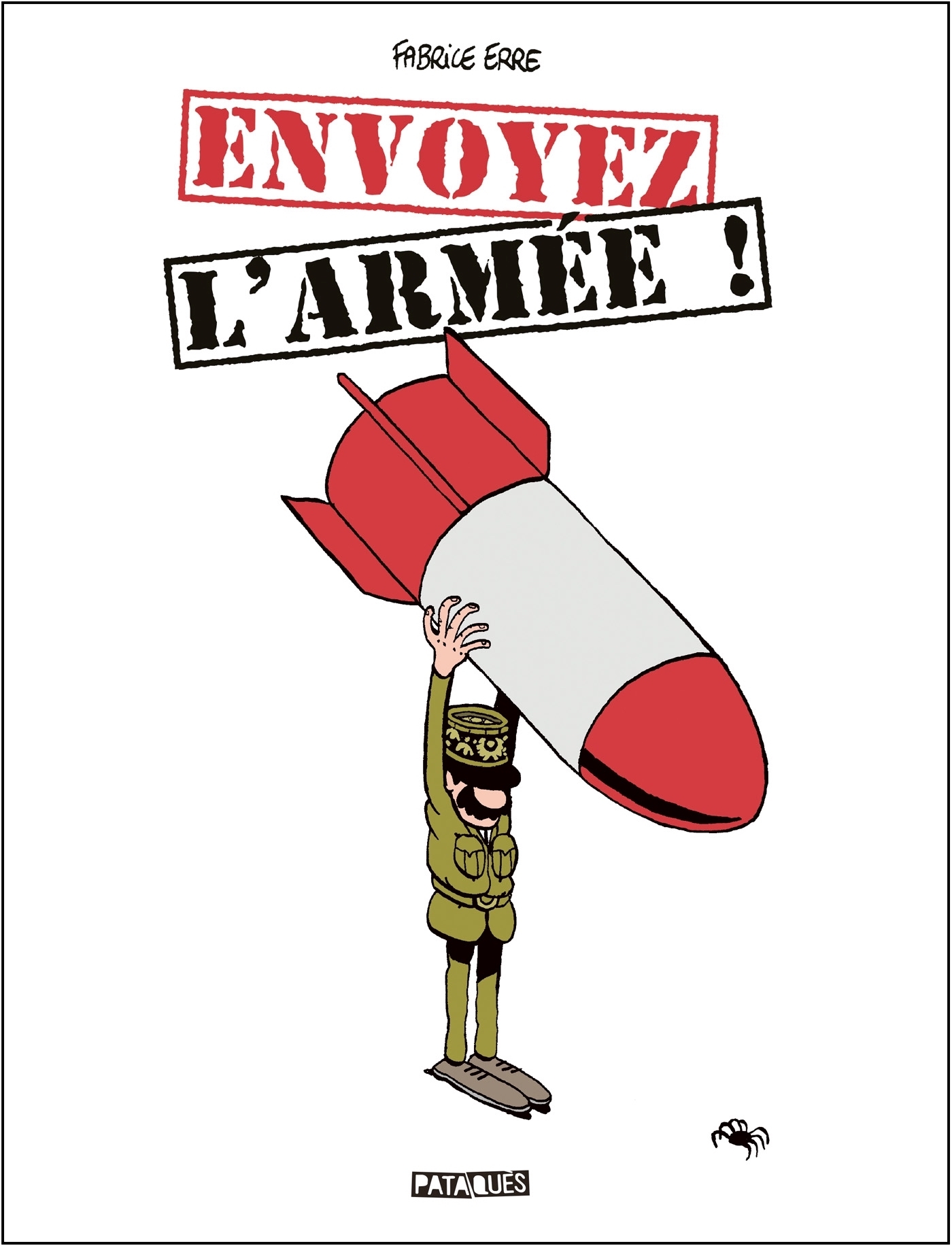
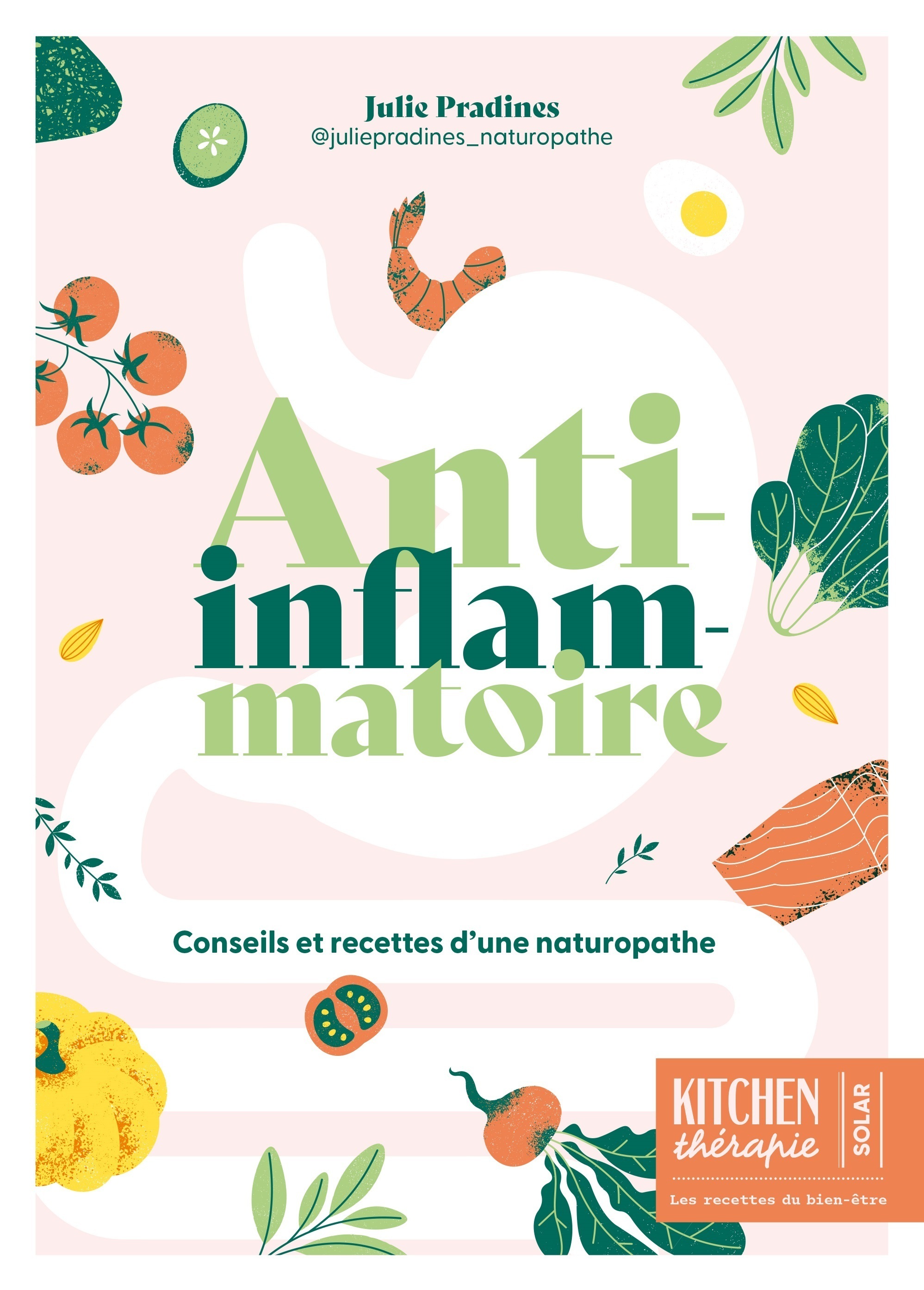
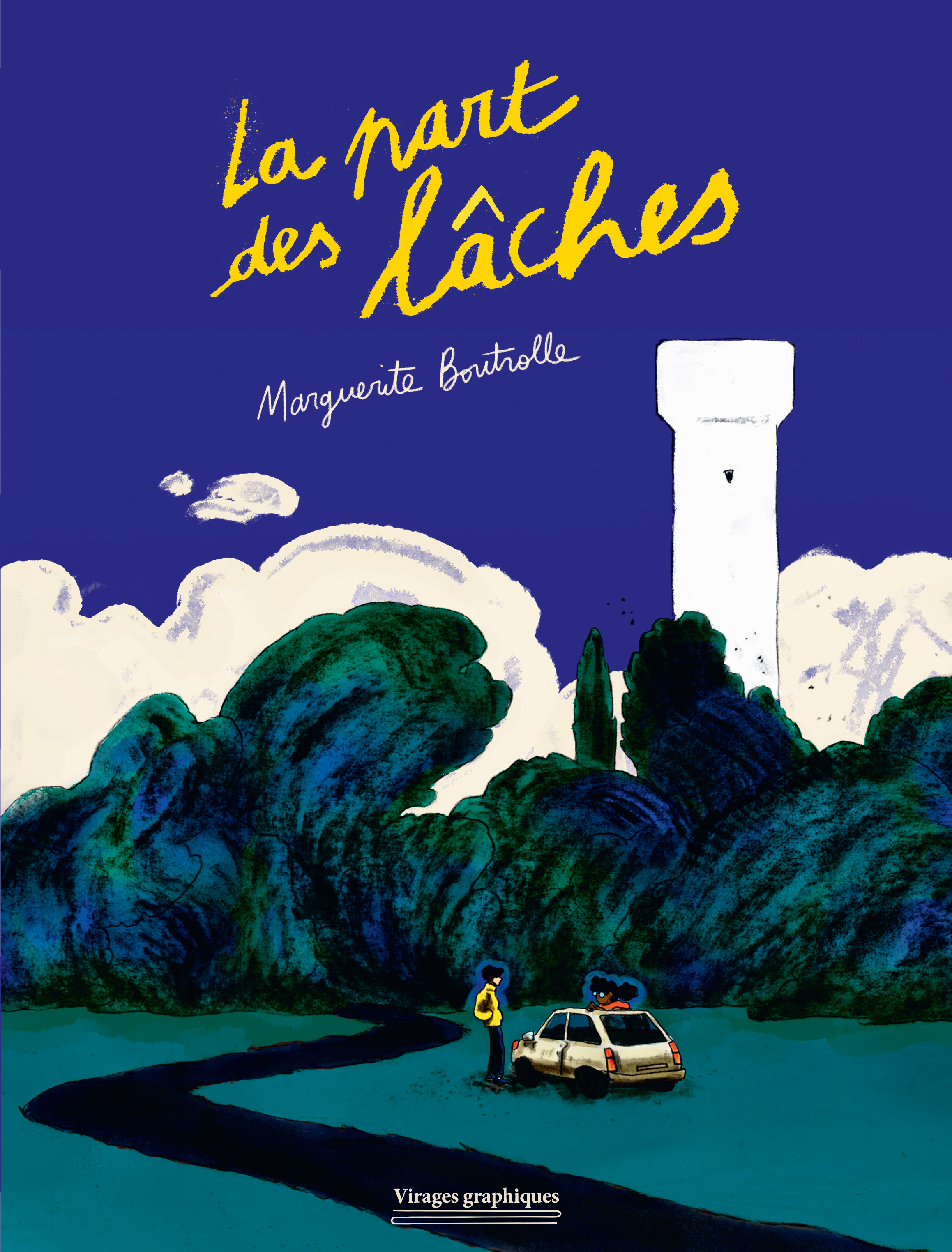

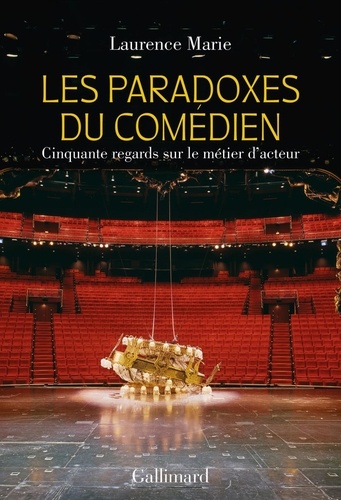
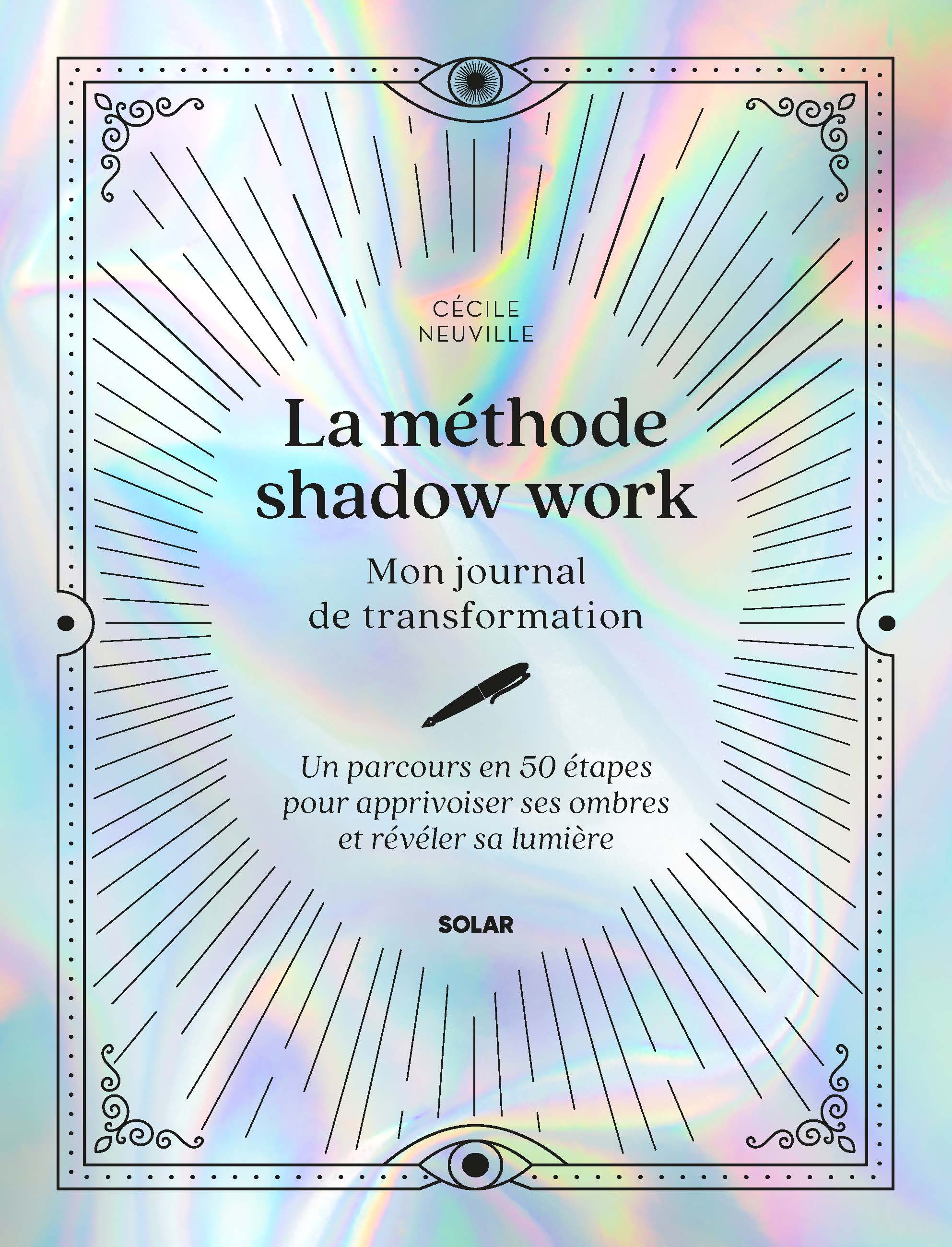
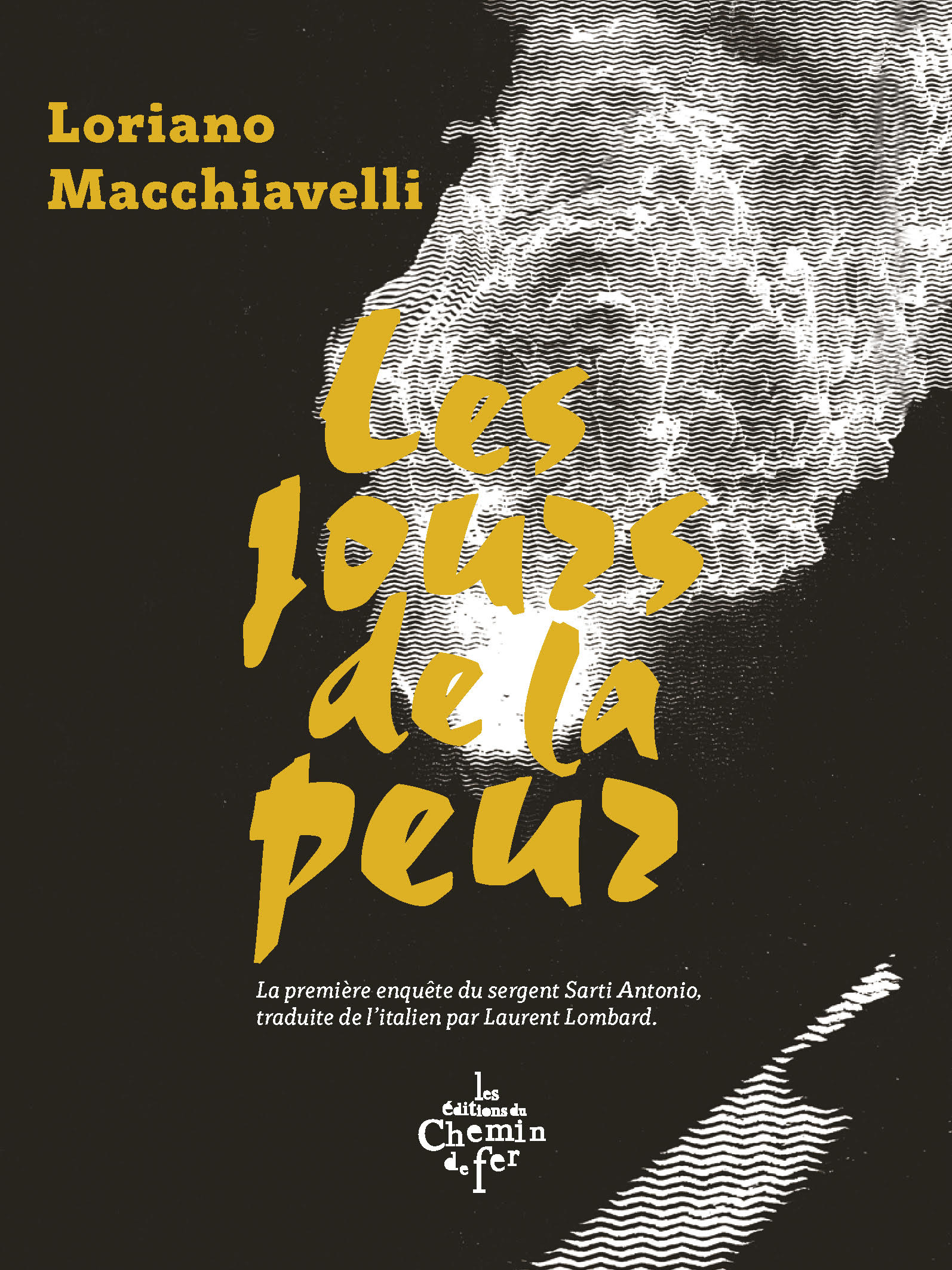
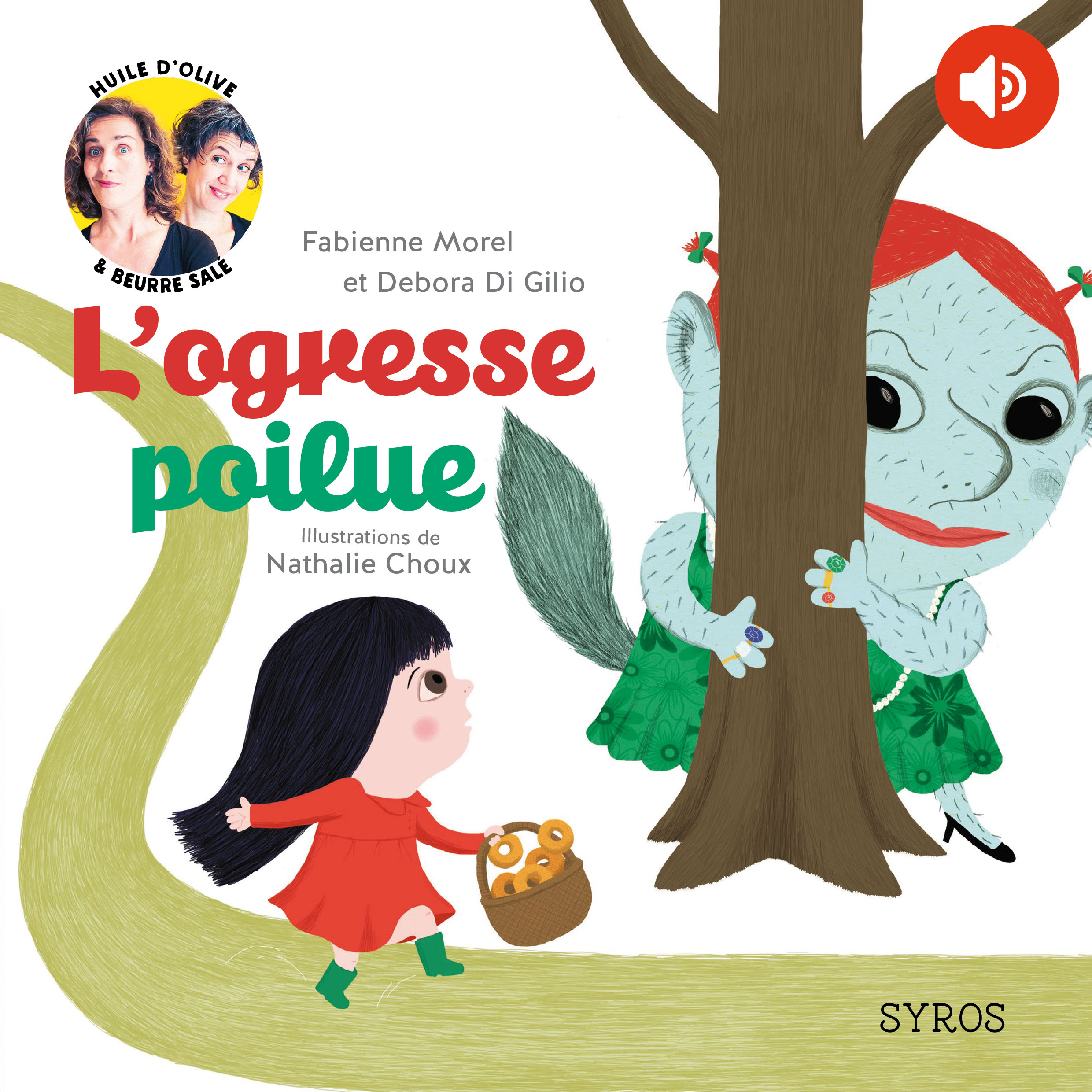
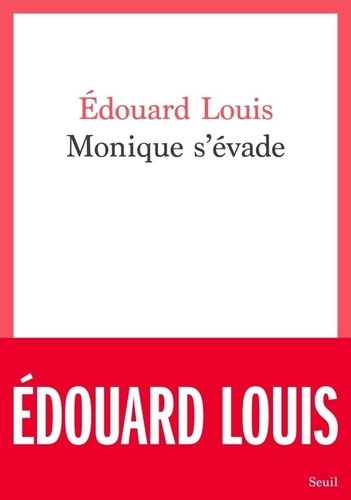
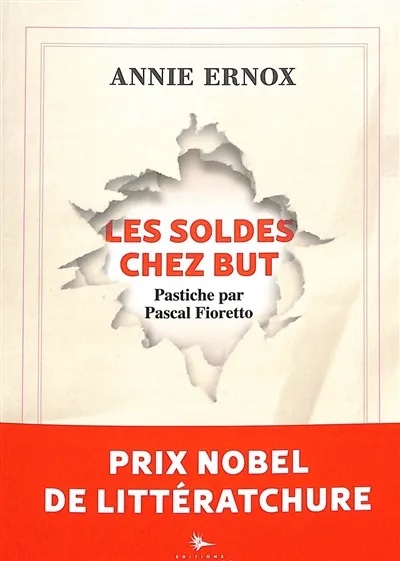
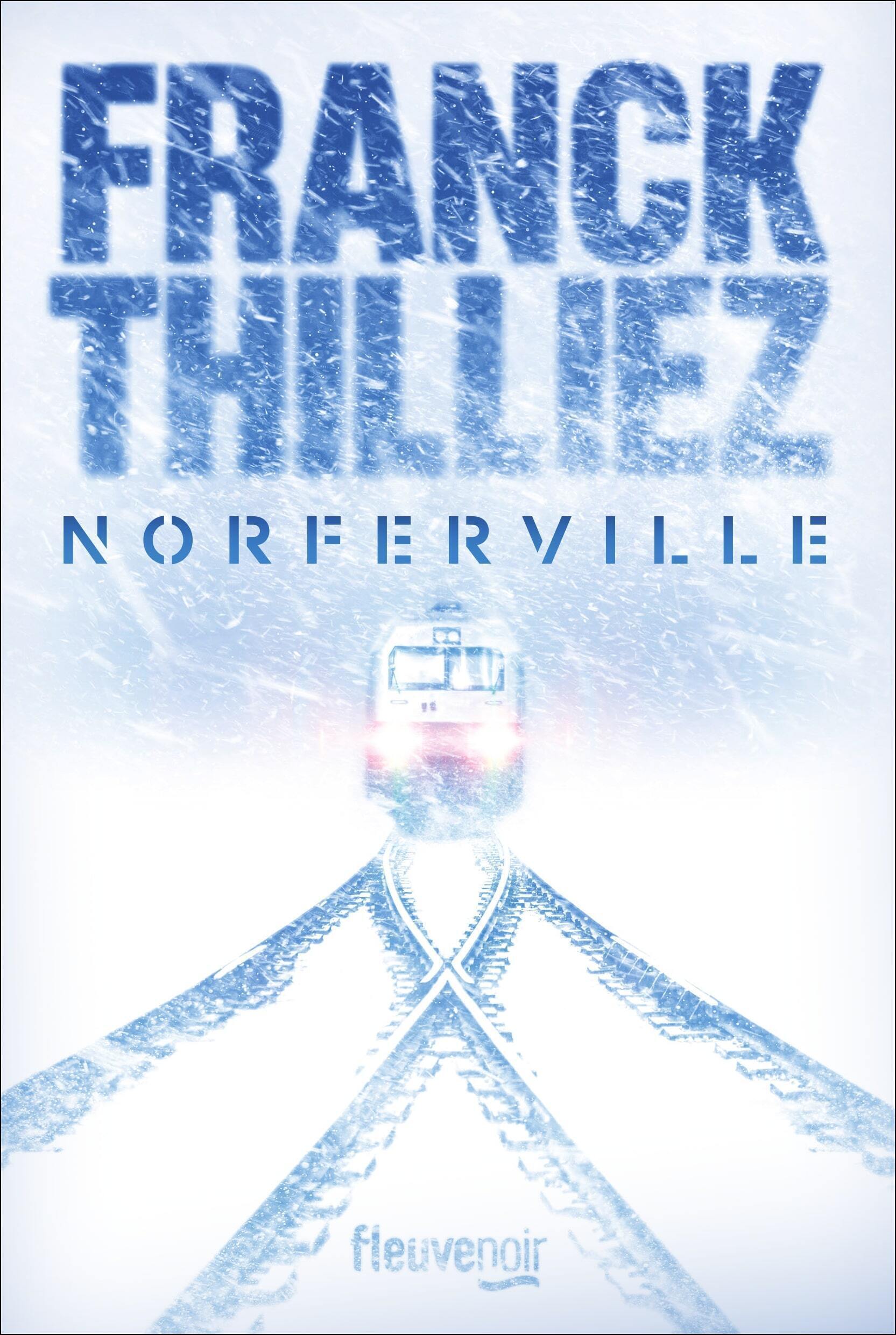
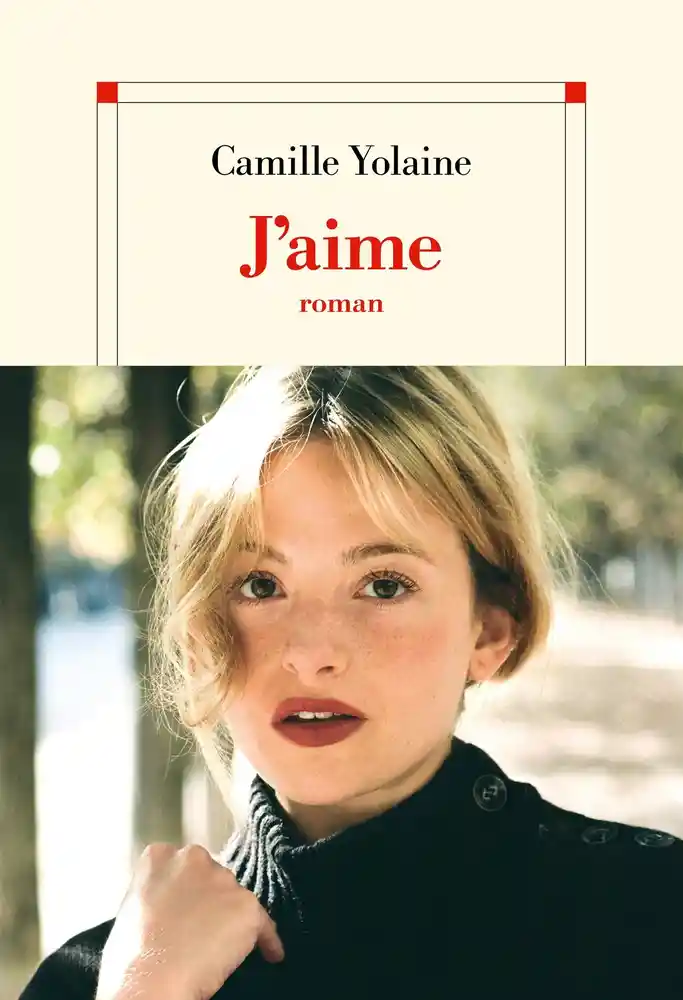
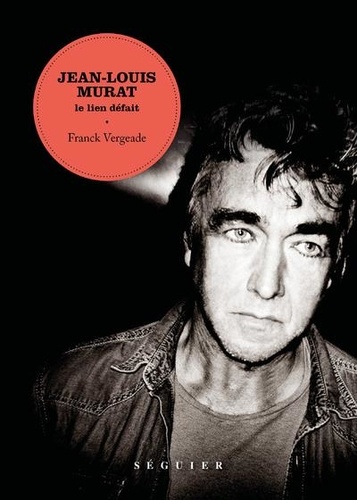
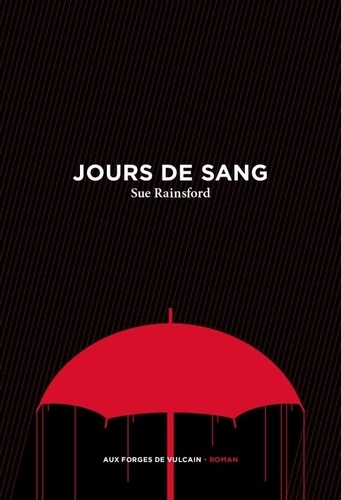
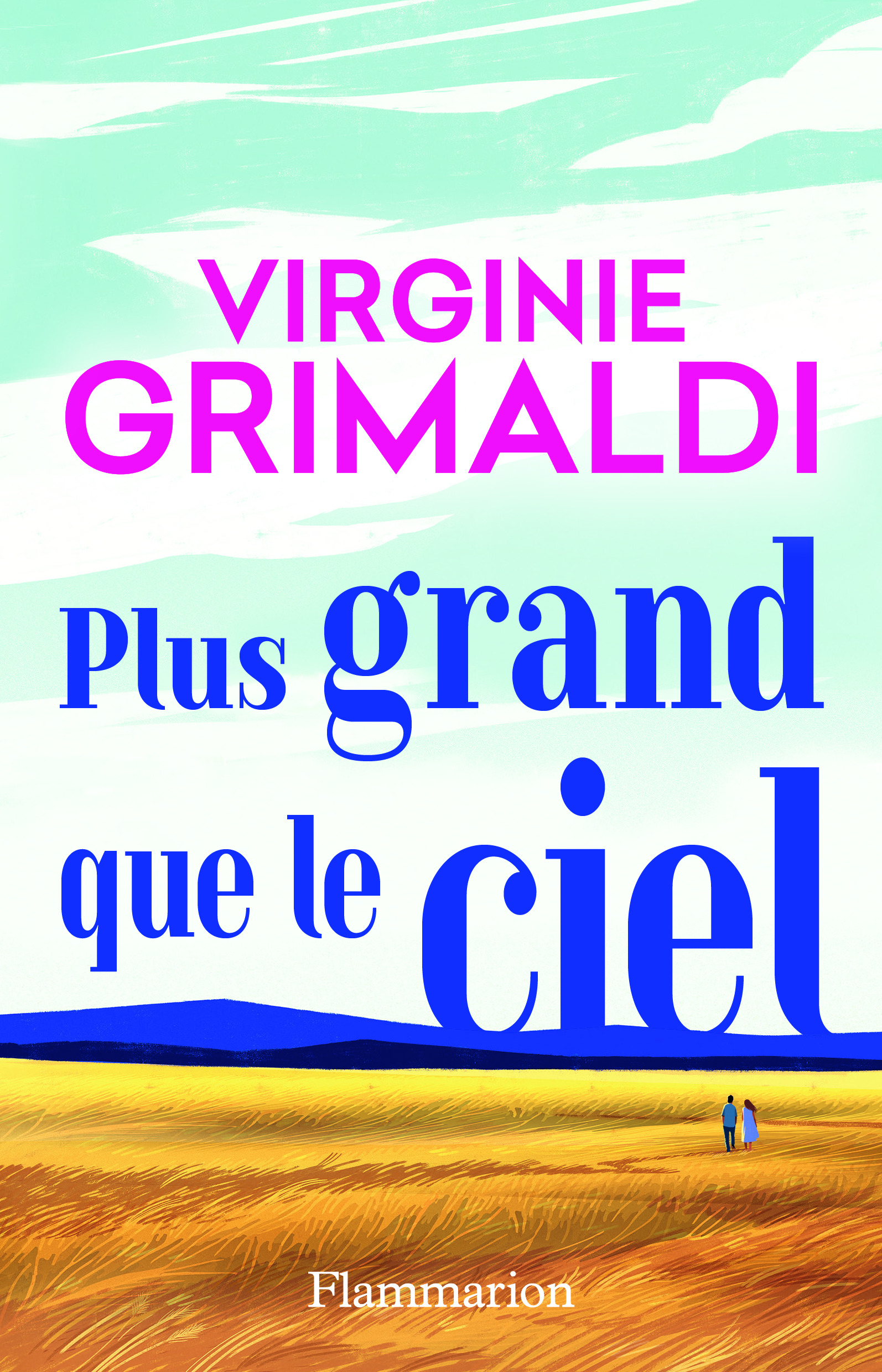
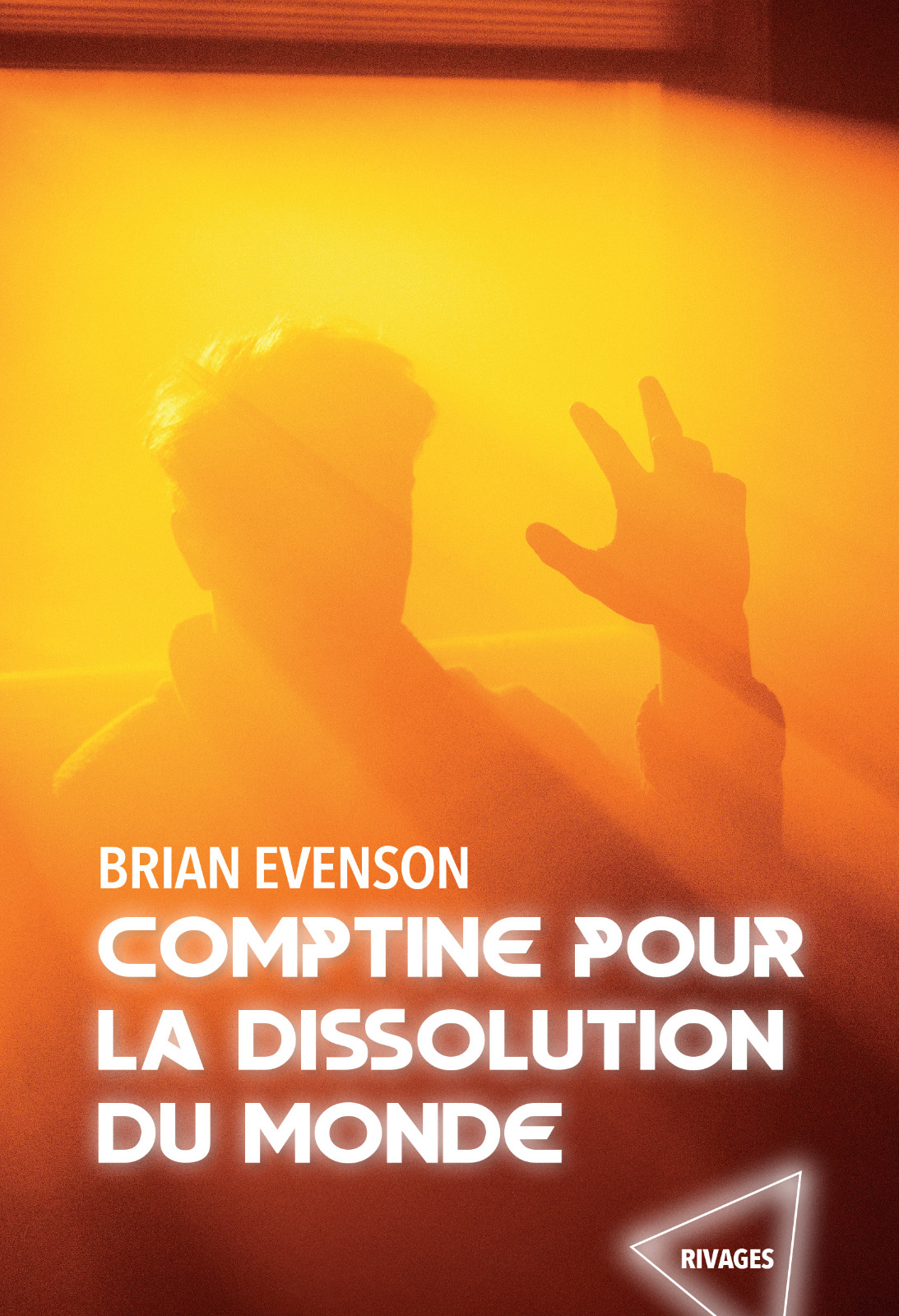
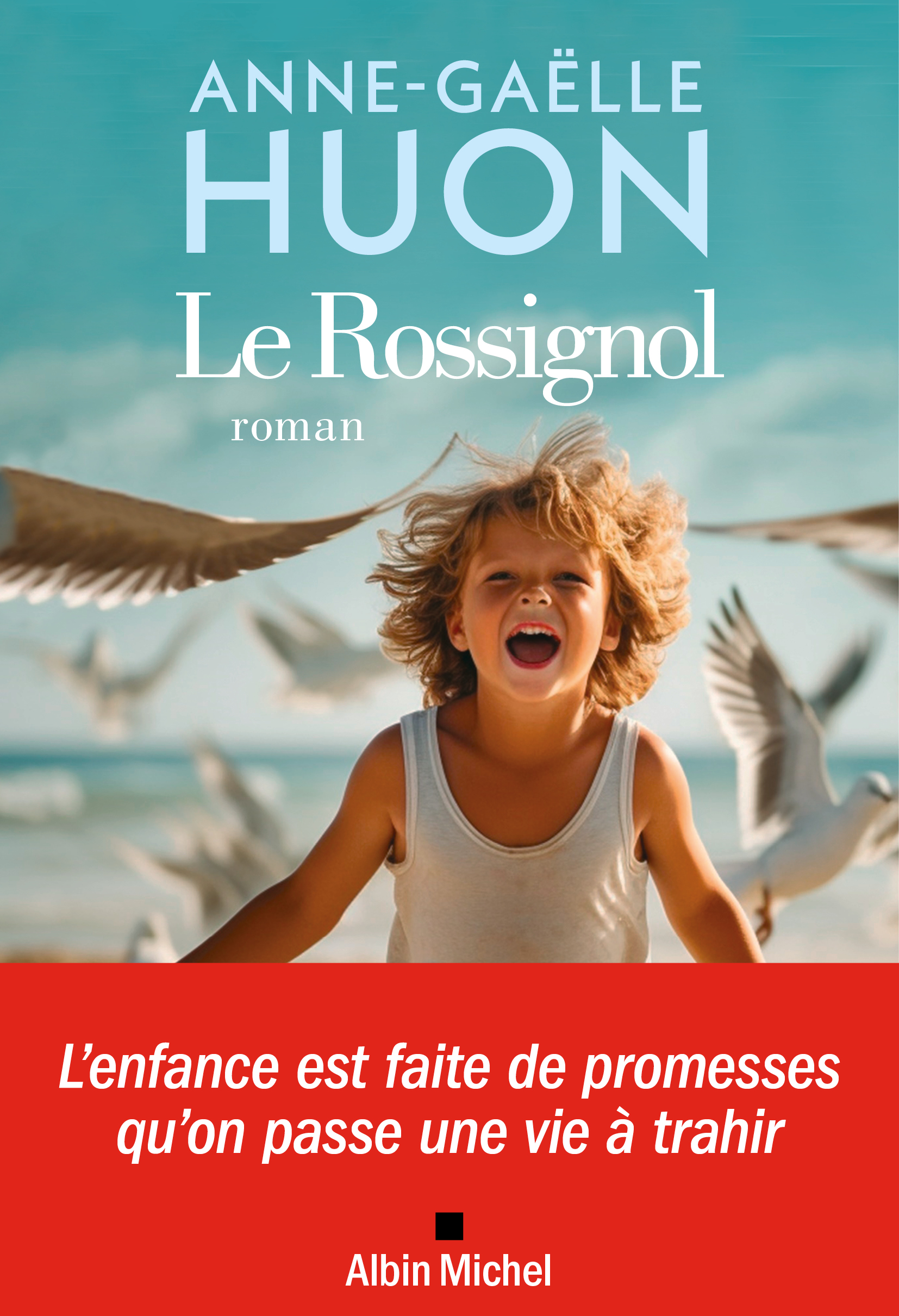

2 Commentaires
MDR
12/09/2020 à 06:57
« Car Diderot n’est pas tant l’homme de son temps que l’homme de tous les temps : son esprit curieux, ouvert, agile, optimiste, »
C'est amusant de constater que le temps lisse bien des aspérités. L'esprit curieux et optimiste cachait bien des relents, comme celui de Voltaire, vil et bien raciste. En parlant de Voltaire, quand ce dernier trépassa, il voulut recevoir les derniers sacrements (il faut bien avouer, contre tout attente, étant donné sa vie à vouloir détruire « l'Infâme » (pour ceux qui ne le connaisse pas, il désignait ainsi le Christ). Son grand ami Diderot interdit au curé appelé de franchir la porte de son domicile.
Sans doute par curiosité et optimisme...
Ryoro
30/09/2020 à 15:32
Merci pour cette prise de conscience.
Je m'en vais unfollow de suite le compte twitter de Diderot