Donald Trump, le sexe et moi
RÉCIT ÉTRANGER – Maintenant que j’ai attiré votre attention aussi grossièrement qu’une publicité Aubade sur une façade d’immeuble avec ce titre éhontément racoleur, nous allons pouvoir parler un peu de White, dernier livre de l’auteur culte (c’est comme ça qu’on dit quand il s’agit, en fait, de n’importe quel Américain) Bret Easton Ellis, traduit (nous y reviendrons) chez Robert Laffont.
Le 09/08/2019 à 11:30 par Maxime DesGranges
1 Réactions
Publié le :
09/08/2019 à 11:30
1
Commentaires

Oscar Wilde disait : tout un tas de choses en fait, un peu comme Churchill, à croire que ces deux-là ne parlaient qu’en aphorismes en permanence, ce qui, tout compte fait, devait être d’un ennui mortel à la longue. Bref, entre autres choses, Wilde affirmait que le critique parle moins de livres que de lui-même, et que pour un critique, le livre était secondaire voire complètement superflu.
C’est vrai en un sens, et cette chronique, si elle évoquera (un peu) Donald Trump et pas du tout le sexe, à moins que vous ayez l’esprit vraiment tordu et là je vous conseille de consulter un psychiatre d’urgence, sera tout de même – rassurez-vous – le prétexte à une nouvelle confession de ma part, encore plus scandaleuse et suicidaire que celle de ma chronique sur Pierre Bayard où je dressais piteusement la liste de mes non-lectures.
“Justice has been done” (Obama à la mort de Ben Laden)
En effet, depuis un matin de novembre 2016 où j’ai ouvert les yeux sur un beau soleil orangé, avant de comprendre, une fois mes yeux dessillés, qu’il s’agissait en fait de la tronche surmaquillée du nouveau président américain passant sur BFM accompagnée du bandeau « Trump élu président », j’essaie de comprendre, en toute sincérité, les raisons pour lesquelles j’ai laissé échapper à ce moment-là un grand éclat de rire. Oui, vous avez bien entendu, bande d’impitoyables aiguiseurs de fourches caudines, j’ai ri à gorge déployée devant cette espèce de farce guignolesque tout en me répétant cette phrase : « Bien fait pour eux ».
« Bien fait », je ne savais pas trop pour quoi, et « eux », je ne savais pas trop qui c’était. Une simple pulsion nihiliste qui éclatait, comme souvent, dans l’intimité de ma vie solitaire ? Mon inaltérable côté punk qui adressait un gros doigt d’honneur à la face de « l’Empire du Bien », comme l’appelait Philippe Muray ? Je ne sais pas. Mais c’était quelque chose qui allait bien au-delà du seul plaisir tout à fait sain, normal et légitime de voir la tête du neurasthénique arrogant Yann Barthès se décomposer aussi rapidement que mes épluchures de fruits et légumes au fond de mon bac de compost.
C’est donc avec l’espoir de résoudre le mystère encore non éclairci de cet éclat de rire venu des profondeurs de mon être diabolique que j’ai entamé la lecture de White, première incursion de « BEE », comme l’appellent les petits snobs dans mon genre, dans les contrées de la non-fiction, dix ans après son dernier roman.
Histoire de la bromance (presque Édouard Louis)
Ça commençait plutôt bien, je dois dire, car Ellis et moi partageons quelques traits communs : comme moi, il est attentif à la politique sans être politisé ; comme moi, il place l’esthétique au-dessus de l’idéologie ou de la morale (ou pour être plus précis : il ne fait pas de l’idéologie ou de la morale le critère premier pour apprécier une œuvre), et comme moi, il accepte une chose très simple, désagréable peut-être mais qu’il faut accepter une fois pour toutes : oui, le monde de l’art accueille sur ses terres hideuses tout un tas de névrosés, psychotiques, suicidaires, misanthropes, tyranniques, racistes, antisémites, misogynes et toutes les tares intolérables que porte en son sein notre humanité corrompue. Et ni lui, ni moi (ni personne, au fond) ne rêvons d’un art raisonnable, inoffensif, acceptable, bref, ennuyeux.
Je partage aussi avec Ellis, et peut-être avec vous depuis que vous avez commencé la lecture de cette chronique, une « irritation vague, mais presque insurmontable, irrationnelle » qui me prend lorsque je passe un peu trop de temps sur le Web 2.0, celui où tout le monde s’autorise à donner son avis, même idiot, sur toute chose, même sérieuse. Et je m’inquiète comme lui de cette « certitude inébranlable d’avoir raison » qui envahit les réseaux sociaux et qui, lorsqu’elle est partagée par une meute, se transforme en arme de coercition massive. Autrement dit, Bret et moi, nous étions faits pour nous entendre.
Seulement, je ne suis pas là pour imaginer ma bromance potentielle avec Bret, mais pour juger un livre, donc un style, une structure, une pensée, une vision, en suivant notre principe commun : se préoccuper moins d’idéologie que d’esthétique. Et c’est là que les choses commencent à se corser quelque peu.
Génération X contre Millennials (titre d’un futur blockbuster)
Ellis ne s’en cache pas : son livre est une sorte de « mishmash » (dieu que j’adore ce mot) de textes divers : mémoires, réflexions tirées de ses podcasts, anecdotes sur le microcosme hollywoodien… Conséquence : ce livre hybride donne parfois l’impression d’un vaste fouillis, parfois intéressant (genèses de ses romans, analyses de films), parfois tout à fait dérisoire (polémiques sur Twitter, déboires de people dont personne n’a entendu parler) mais qui dans tous les cas le rend franchement inégal.
Dans la première partie (sur huit), Ellis commence plutôt bien en nous parlant de son enfance et de la façon dont le cinéma, notamment d’horreur, a façonné son rapport au monde et comment les jeunes de la « Génération X » (la sienne, née dans les années 60-80, à l’apogée de « l’Empire ») devaient à l’époque se construire dans une relative autonomie, contrairement à la nouvelle « Génération dégonflée » (comprendre : les millennials, soit les jeunes du « post-Empire » nés dans les années 80-90 ; notions contestables en soi, la différence générationnelle fondamentale se faisant simplement, selon moi, entre ceux qui ont connu un monde sans internet et les autres), génération angoissée, infantile et colérique couvée par des « parents hélicoptères » prêts à secourir leurs bambins en toutes circonstances à la moindre contrariété (c’est-à-dire tout le temps).
Si l’on met de côté ses considérations c’était-mieux-avantistes assez peu convaincantes, cette première partie est intéressante dans la mesure où BEE sait partager son expertise esthétique et sa passion du cinéma et des acteurs. Il élabore par ailleurs un long développement sur les raisons pour lesquelles le film à Oscars Moonlight serait typique, à ses yeux, de la victimisation ambiante (sexuelle, raciale, sociale) qui aurait cours aux USA. Ces pages sur le cinéma puis sur les acteurs, loin d’être décoratives, nous conduisent en fait à une conclusion : nous serions entrés dans une ère où tout le monde jouerait un rôle, celui de l’individu impeccable, irréprochable et moralement supérieur dans le but d’augmenter sa « likabilité », ce qui nous aurait conduits tout droit dans une « une phase culturelle autoritaire », ou autrement dit : « une sorte de totalitarisme qui exècre la liberté de parole et punit les gens s’ils révèlent leurs véritables personnalités. »
Guerre civile de basse intensité
Le point névralgique du livre est là. Contrairement à ce qu’ont pu faire entendre certains journalistes imbéciles, et nous ne citerons aucun nom car Isaac Chotiner du New Yorker pourrait mal le prendre s’il nous lisait, ce qui n’arrivera jamais et rend d’autant plus lâche, donc savoureuse, ma petite charge contre lui, la question n’est pas de savoir si BEE prend la défense de Trump ou non. La thèse d’Ellis est pourtant suffisamment provocatrice pour que nous n’ayons pas besoin d’en détourner le sens : selon lui, une « nouvelle forme de fascisme » (le terme revient à de nombreuses reprises) serait en train de se répandre aux États-Unis, et ce serait une frange radicale des Liberals, des Democrats, bref, de la gauche qui en serait la principale propagatrice.
Affirmation qui pourra étonner certains, mais pas vraiment ceux qui s’intéressent de près au contexte culturel américain des années post-crise économique et au clivage qui sépare deux Amériques désormais irréconciliables. Dommage qu'Ellis ait senti le besoin d’enrober cette déclaration clinquante de tout un tas de fioritures, comme pour mieux faire passer la pilule. À mon sens, Ellis n’a même pas été assez loin dans la provocation, ou pour le dire autrement : il n’a pas suffisamment serré son sujet de près, ne lui a pas donné toute sa puissance du fait précisément que son livre est hybride : si Ellis n’est pas essayiste, et ce n’est pas un défaut, la fiction aurait sans doute augmenté à mon sens la capacité déflagratrice du propos.
Liberté sous caution
Partant de l’idée que Trump ne serait pas la cause du climat délétère actuel mais bien sa conséquence, comme un symptôme de la maladie des identity politics devenues désormais le seul horizon politique et social d’une gauche « régressive et sinistre », Ellis s’attache à décrire les effets de cette maladie identitaire et victimaire sur la liberté d’expression, le rapport aux artistes, la manière de vivre ensemble et, comme disait Ernest Renan, le désir commun de former une nation.
L’un de ces effets serait notamment la création informelle et décentralisée d’une police de l’expression publique qui régirait désormais les rapports sociaux, représentant « une forme infantile de fascisme » sévissant principalement dans les médias, sur les réseaux sociaux et les campus universitaires, police qui aurait un seul objectif : contraindre au silence toute personne proférant des propos s’écartant de la « ligne du parti » progressiste, dans un nouveau monde orwellien où un sentiment serait devenu un fait et une opinion un crime, et dans lequel nous passerions notre temps à nous évaluer les uns les autres, tous engagés dans une vaste opération d’éradication de toute déviance idéologique, sans plus se soucier de la dimension « contradictoire et chaotique » qui caractérise l’esprit humain.
Or Ellis, qui, contrairement aux apparences, parle en artiste plus qu’en politologue, n’aspire au fond qu’à une chose : « Me retrouver dans la peau de quelqu’un d’autre et voir comment il voyait le monde – particulièrement s’il s’agissait d’un outsider, d’un monstre, d’une bête curieuse, qui m’emmènerait aussi loin que possible de ce qui était censé être ma zone de confort – parce que je sentais que j’étais cet outsider, ce monstre, cette bête curieuse. J’avais terriblement envie d’être secoué. J’aimais l’ambiguïté. Je voulais changer d’idée à propos de telle ou telle chose, à propos de tout, pratiquement. Je voulais être dérangé et même endommagé par l’art », ceci dans le but de développer son sens de l’empathie, de l’éloigner du narcissisme de l’enfance et de devenir adulte.
Oui mais voilà, la tendance actuelle des gens à ne plus vouloir s’intéresser qu’aux choses auxquelles ils peuvent « s’identifier », suivant la logique de la politique identitaire, est dramatique dans le sens où : « Ne pas être capable ou ne pas vouloir se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre – afin de voir le monde d’une façon complètement différente de la vôtre – est le premier pas en direction de l’absence d’empathie, et c’est la raison pour laquelle tant de mouvements progressistes deviennent aussi rigides et autoritaires que les institutions qu’ils combattent. »
On pourrait facilement opposer à Ellis le fait que cette tendance à ne s’intéresser qu’à ce qui nous ressemble n’est pas spécifique à la gauche et qu’on peut parier que bien peu de chrétiens évangéliques conservateurs soient allés voir Moonlight au cinéma pour se mettre dans la peau de l’autre et développer leur empathie, mais soit.
D’ailleurs, en parlant de ça, il faut quand même préciser une chose. Bret Easton Ellis a beau se convaincre qu’il ne vit pas « dans une bulle » sous prétexte que la moitié de ses amis ont voté Clinton quand l’autre a voté Trump (alors que lui ne vote pas), on peut supposer, et ce n’est pas un reproche, qu’il soit plus du genre à aller parler du cinéma de Godard avec Tarantino au bord d’une piscine de Hollywood Hills, que d’aller mitrailler des canettes de Bud au AK-47 avec des rednecks du Kentucky.
Et c’est peut-être ça aussi qui manque à ce livre : Ellis, qui nous assomme de pop culture (autant le dire tout de suite : si vous n’êtes pas familier un minimum avec ça, ce livre n’est pas pour vous) comme si ce seul prisme était suffisant pour saisir l’âme d’un pays, ne parvient pas tout à fait à restituer l’atmosphère réelle des États-unis d’aujourd’hui, et ne répond pas en profondeur à la question qu’on se pose tous plus ou moins en ce moment : « What da fuck is goin’ on over there ? », question d’autant plus légitime que dans nos contrées franchouillardes il se trouve toujours quelques hurluberlus outrageusement américanophiles spécialisés dans l’importation des pires idioties, du moment qu’elles sont estampillées du drapeau à étoiles.
Traduire, c’est trahir
Avant de conclure, quand même un mot sur la traduction de Pierre Guglielmina, pourtant expérimenté (Kerouac, Hemingway, Fitzgerald, etc.). Dieu sait que je ne suis pas un grand défenseur des anglicismes qui contaminent notre pauvre langue sans défense, mais certains choix de traduction paraissent, dans le contexte dont parle Ellis, assez saugrenus. En effet, je ne suis pas certain qu’il faille traduire « Social Justice Warriors » par « guerrières (sic) de la justice sociale », « millennials » par « milléniaux » ou pire « millénial », « vertue signaling » par « signalement de vertus », « snowflake » par « flocon de neige », etc.
Car quand on est un minimum familier avec la sous-culture internet, et nous pouvons supposer qu’une large partie des lecteurs de Bret Easton Ellis le sont, les expressions en question ont plus de sens en anglais qu’en français, qu’on le veuille ou non, et leur traduction fait ici l’effet de ces titres de films américains que nos amis québecois traduisent mot pour mot, comme ils l’ont fait par exemple pour No country for old men devenu de façon tristement comique : « Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme ». Mais c’est une question qui se discute et, si je la relève, c’est parce que ces choix m’ont frappé à la lecture.
Grosse polémique pour petit rien
Sans surprise, le livre de Bret Easton Ellis a déclenché une polémique à sa sortie en avril dernier, et voilà désormais son auteur catalogué en défenseur de l’Amérique conservatrice et réactionnaire pro-Trump. Or il n’y a pas non plus de quoi se lacérer le visage dans son safe space non-mixte pour si peu. Car quand on y regarde de près et qu’on procède à un élagage sérieux de toutes les branches encombrantes du livre, le tronc qu’on découvre n’est pas bien épais : on n’en apprend pas davantage sur la question de la néo-censure que ce qu’on trouverait dans n’importe quel article du Figaro ou de Marianne aujourd’hui.
On peut quand même reconnaître à Ellis le mérite de parler d’un sujet qui risque de nous occuper encore un moment. Car il semblerait qu’il faille se résoudre à cette nouvelle donne : quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise et quoi qu’on écrive désormais, il y en aura toujours un ou deux petits twittos ou journalistes désoeuvrés qui trouveront matière à s’offusquer. Ainsi va le monde et ce n’est peut-être pas nouveau. Comme l’avait déjà compris James Joyce : « J’en suis venu à la conclusion que je ne peux pas écrire sans offenser des gens. »
Bret Easton Ellis, trad. anglais (US) Pierre Guglielmina - White - Seuil - 9782221241172 - 21.50 €
White
Paru le 02/05/2019
314 pages
Robert Laffont
22,00 €






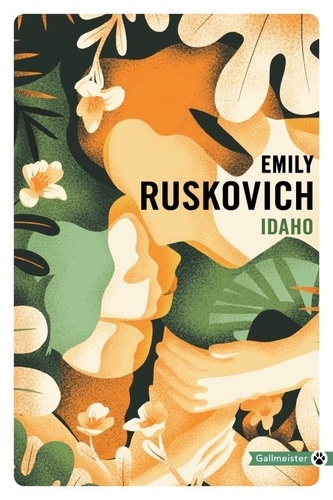
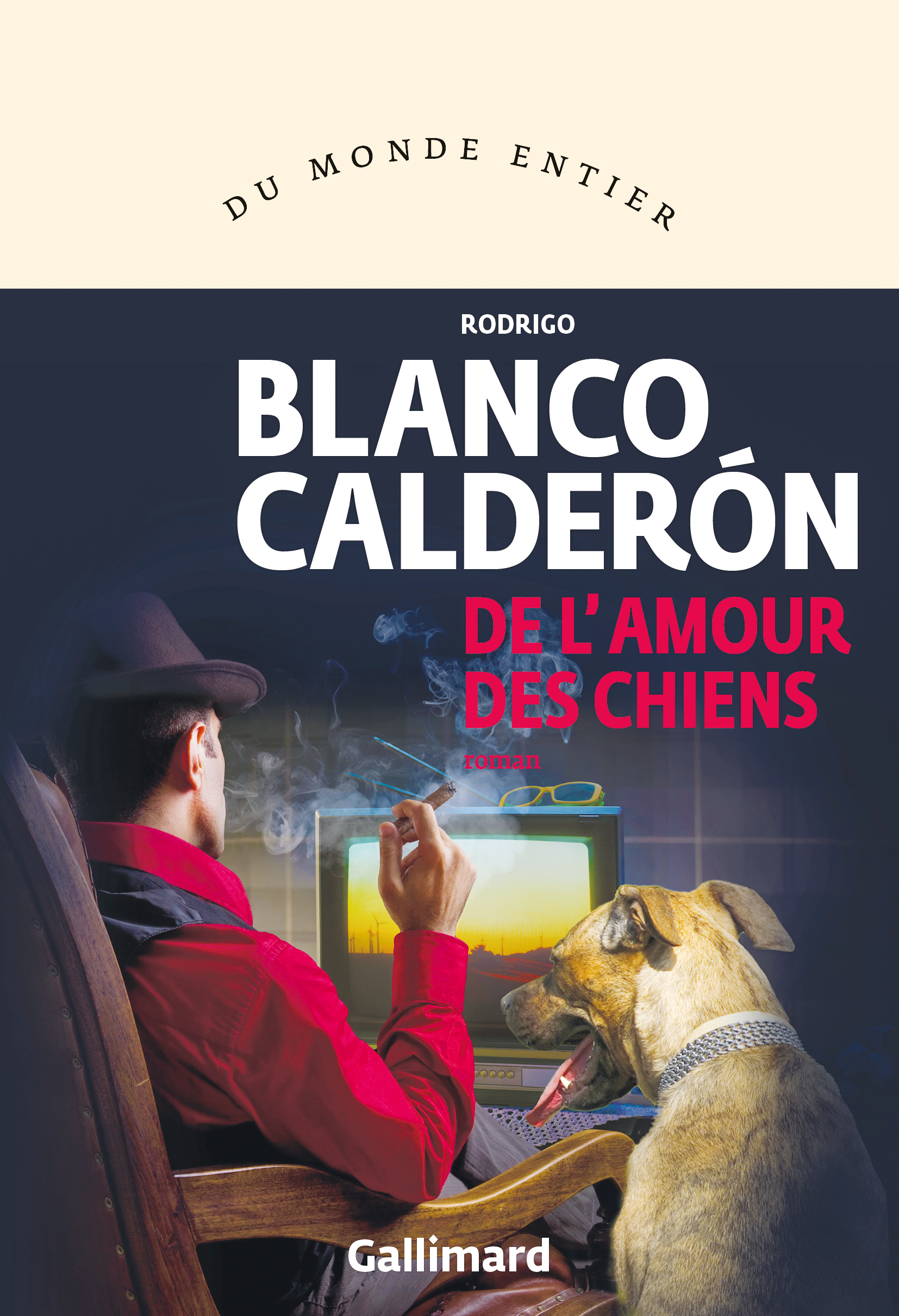
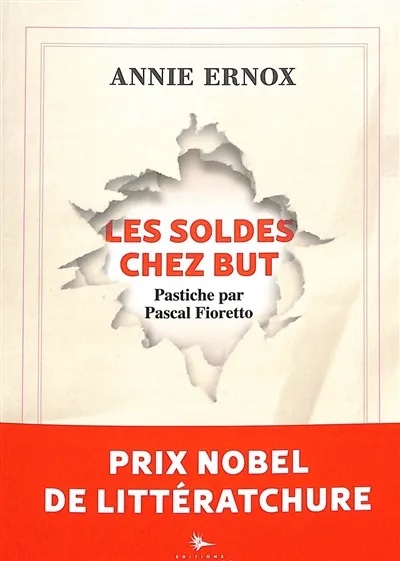



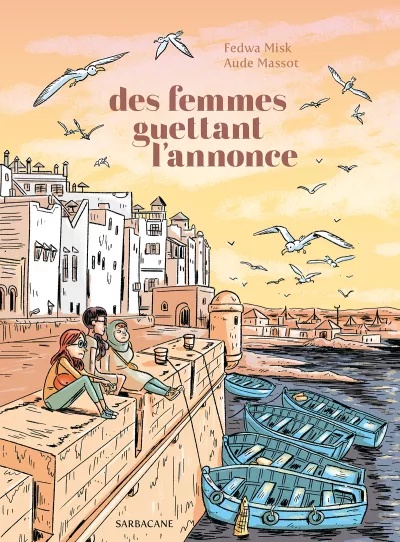
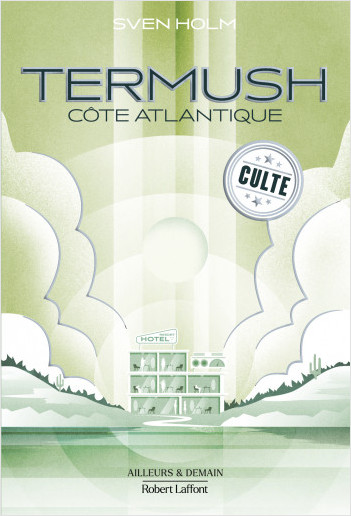
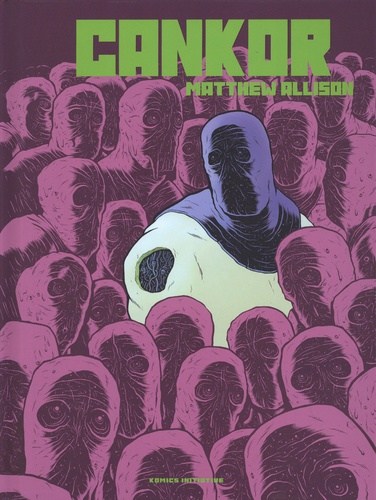
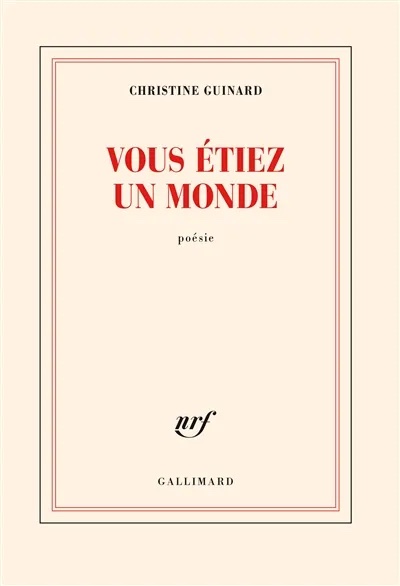

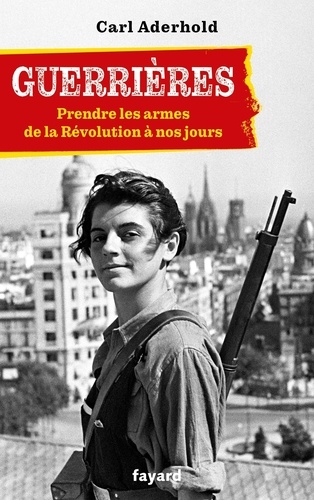
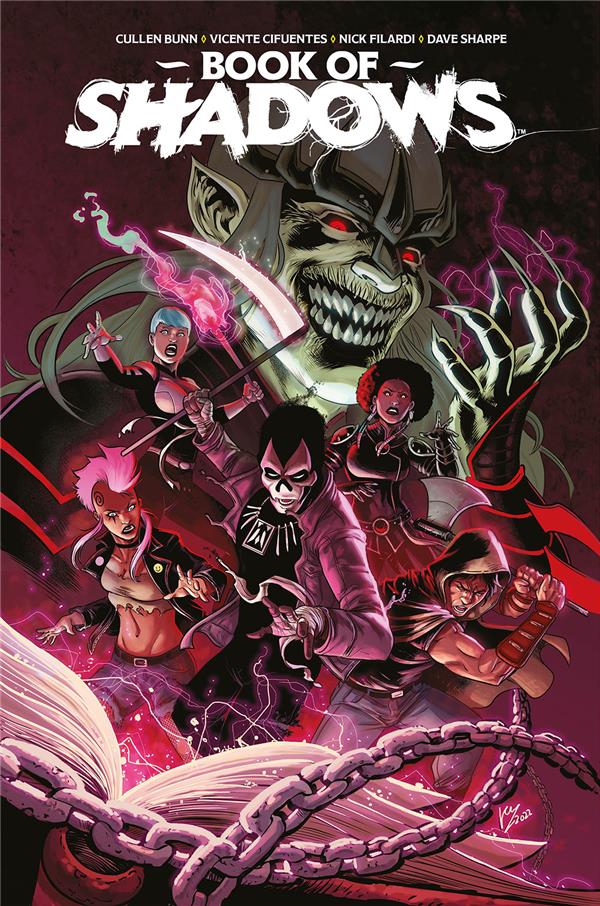

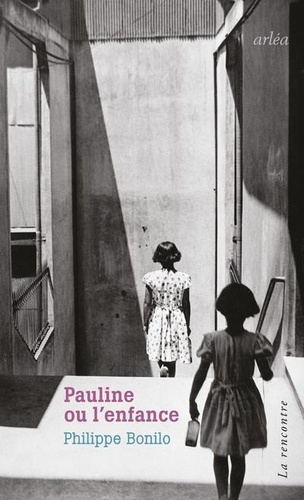
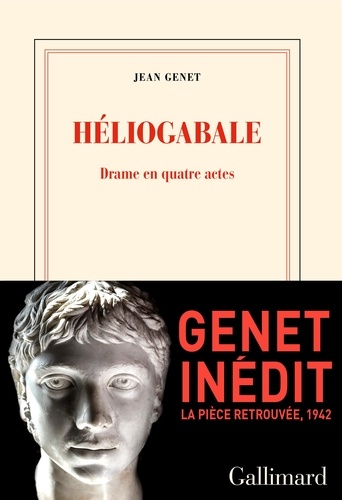



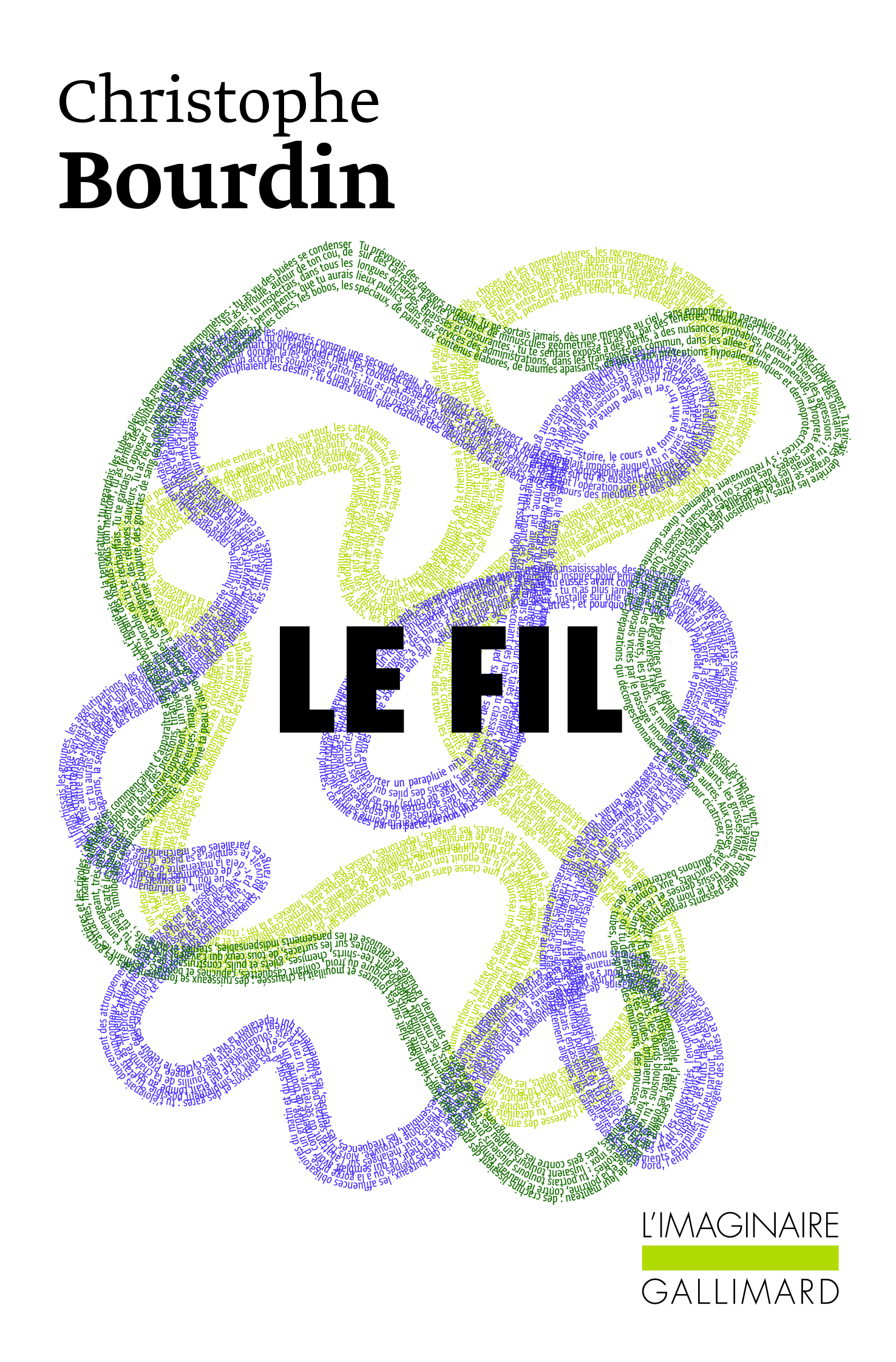

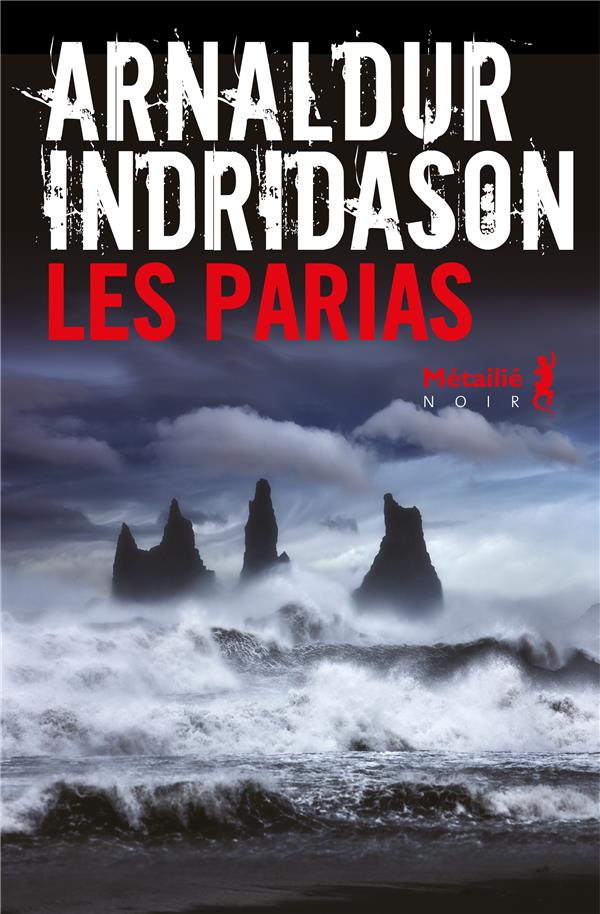


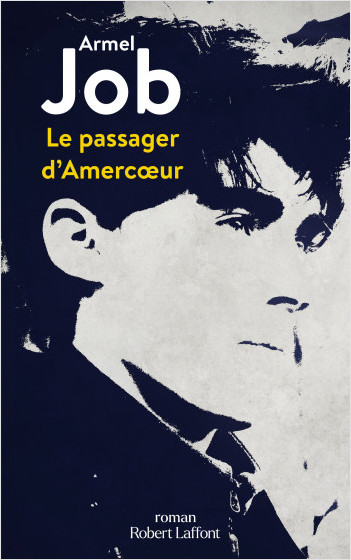

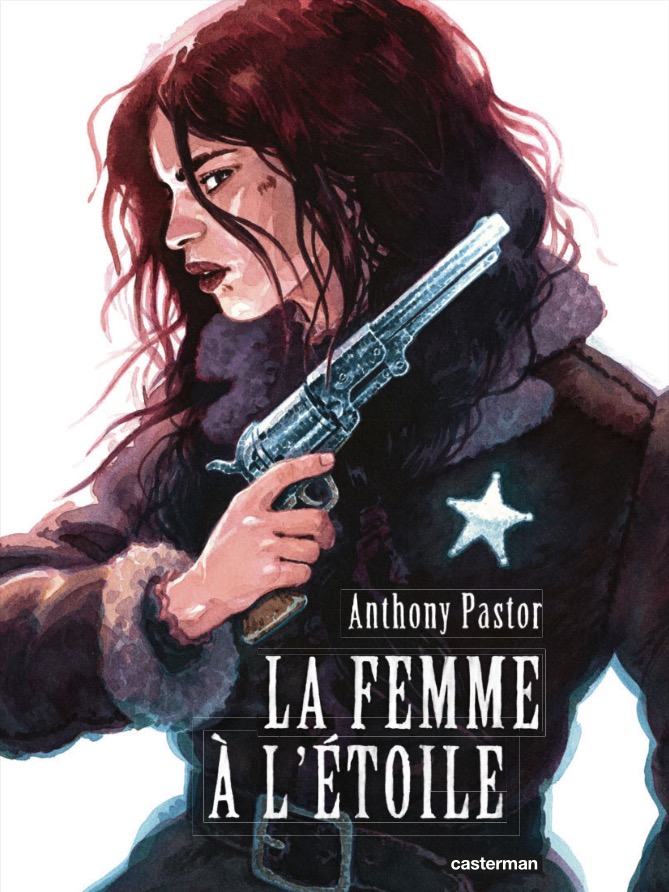
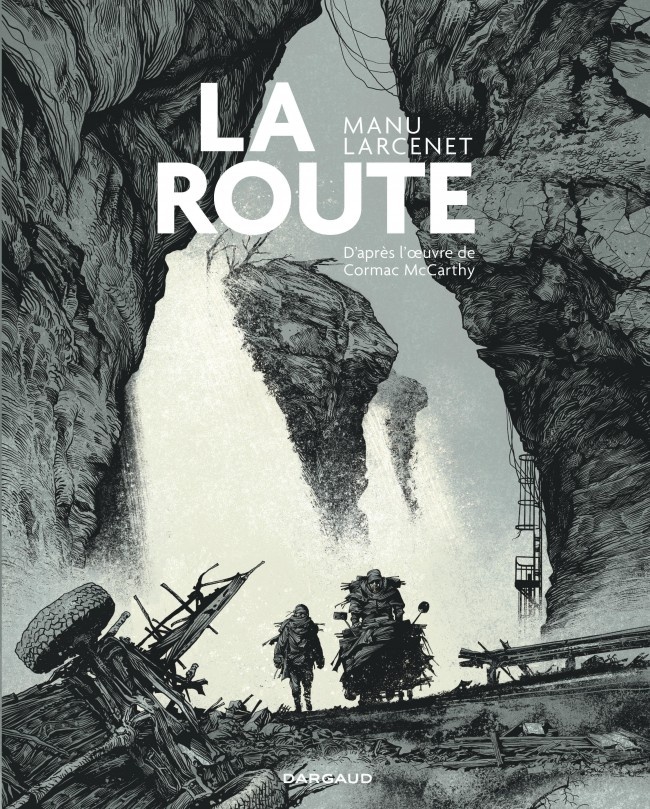

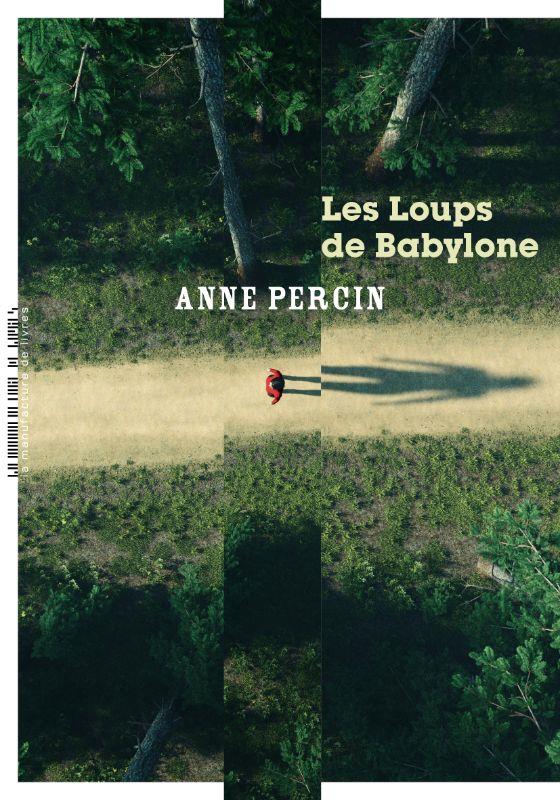




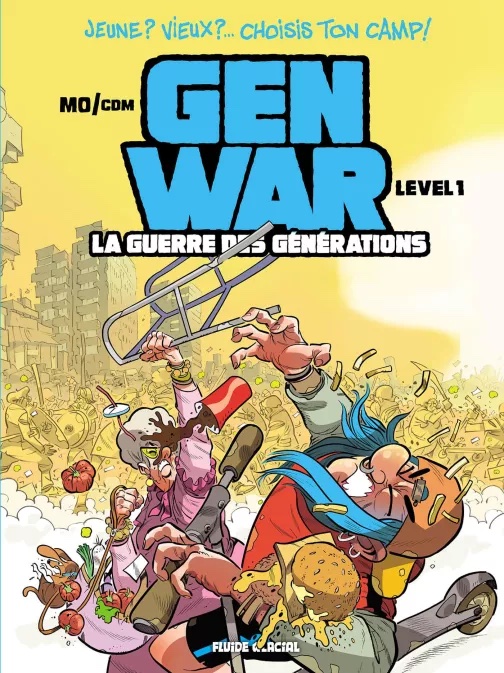



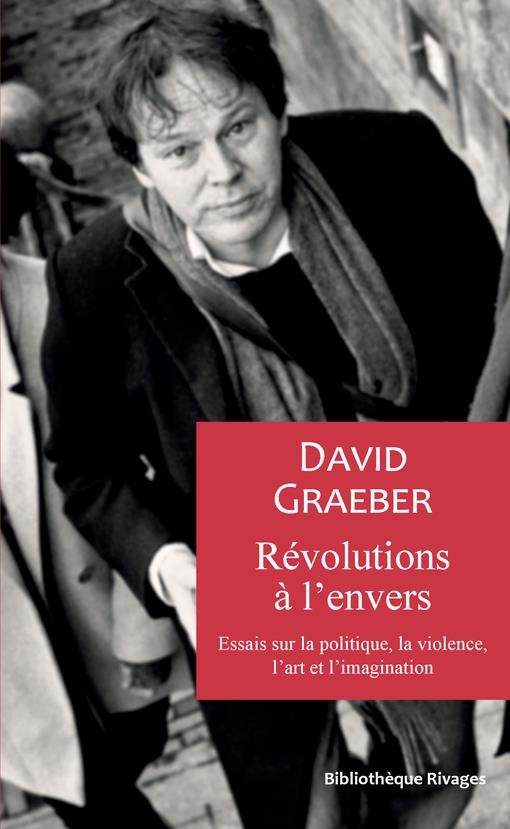
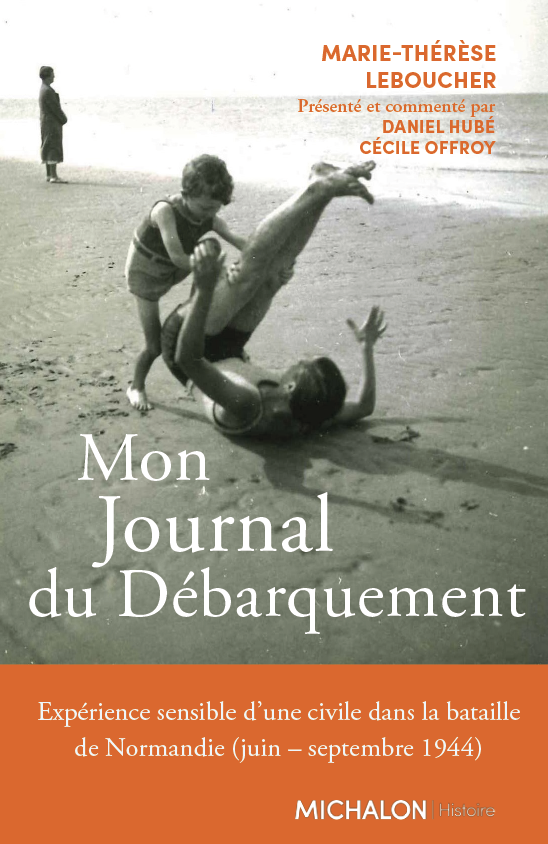


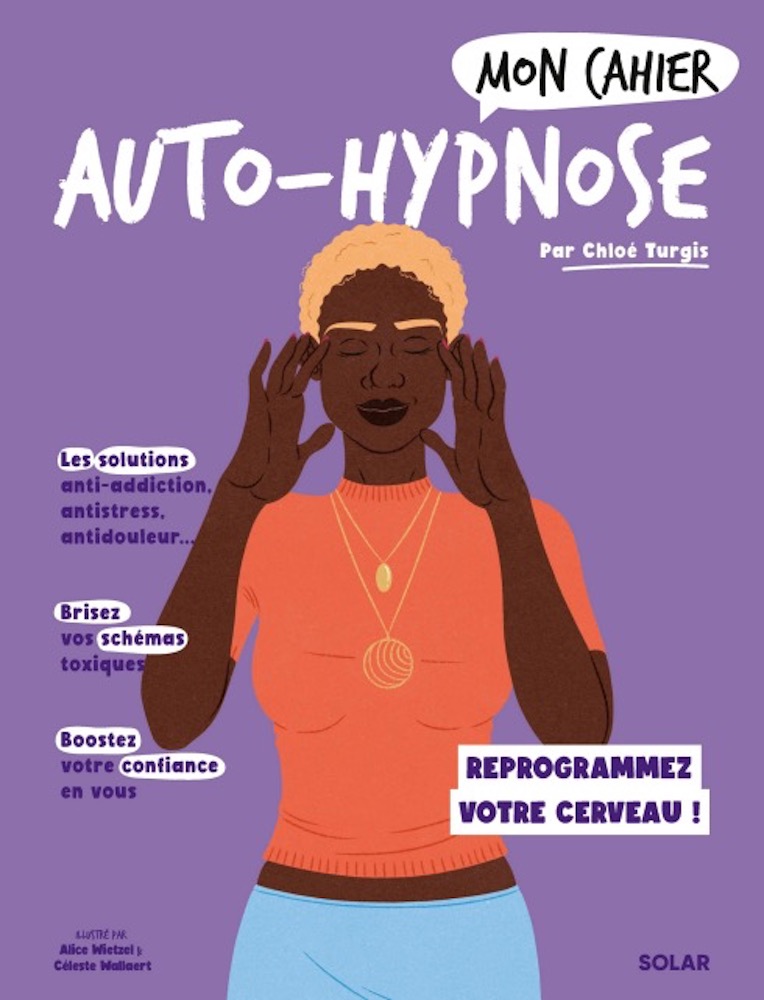
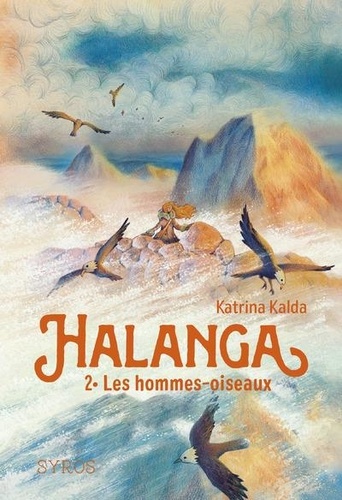
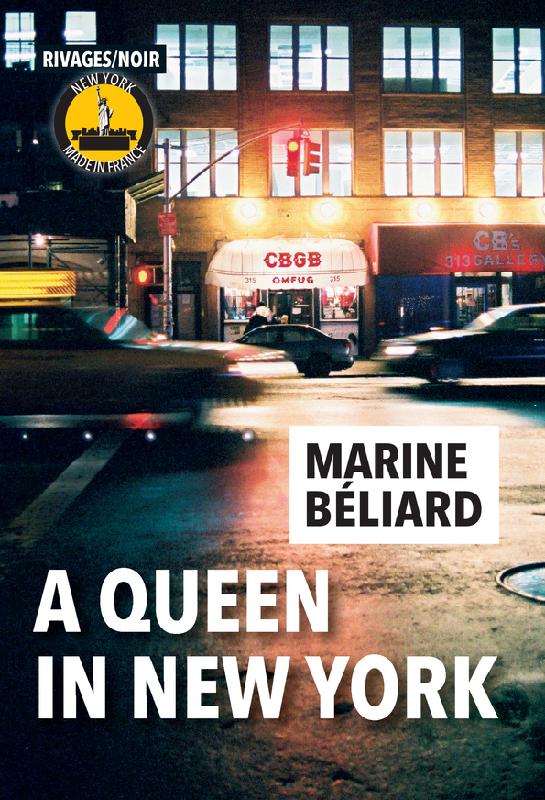








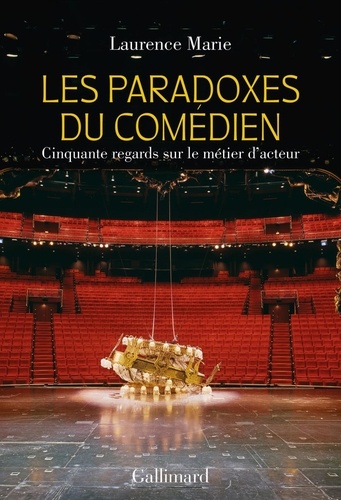
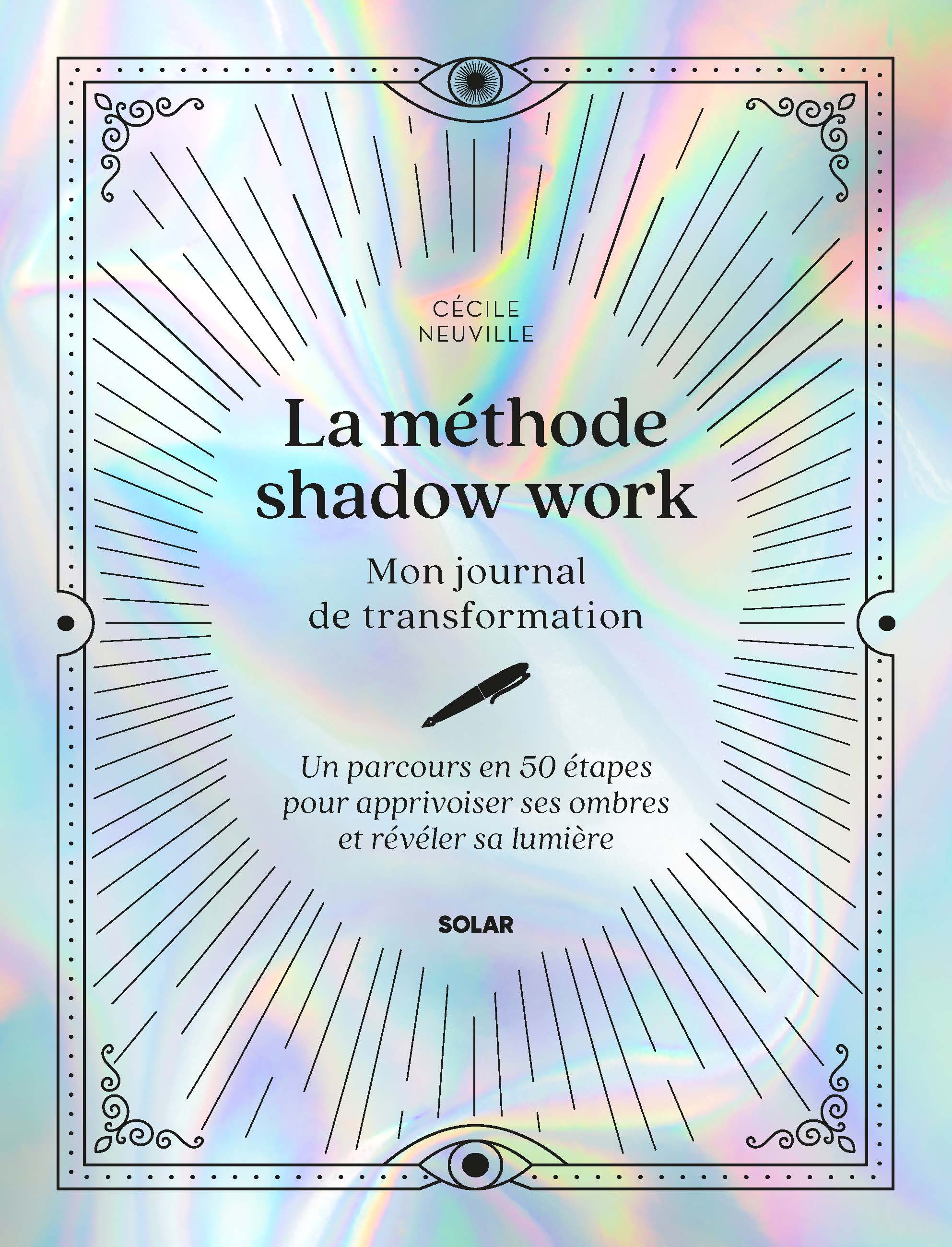


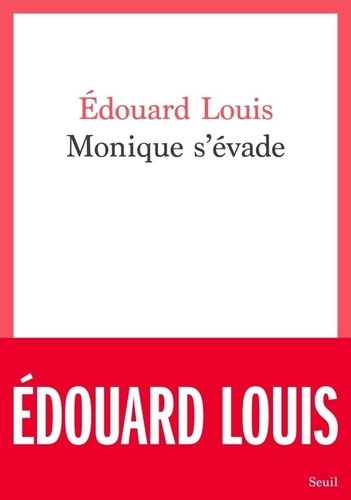
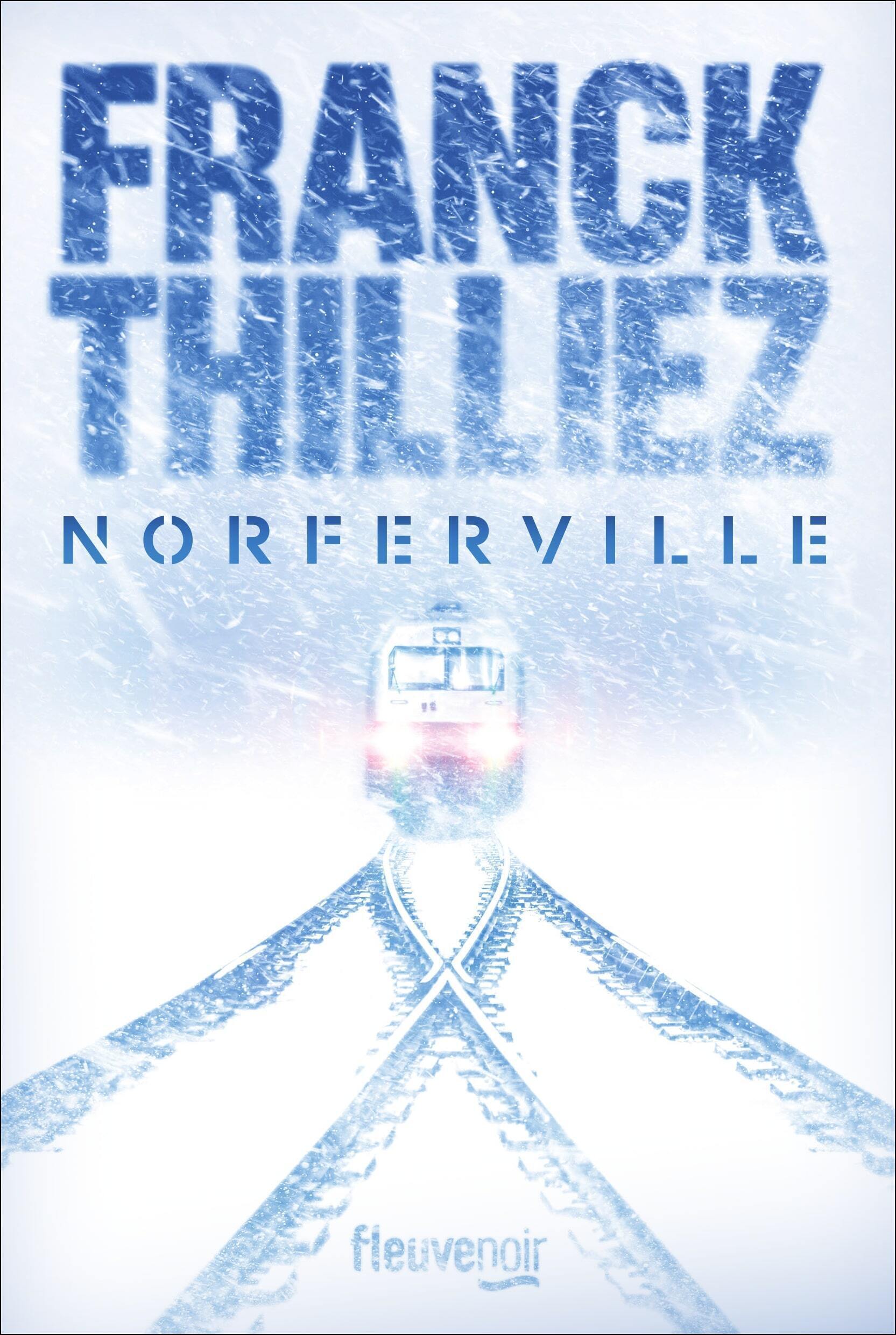
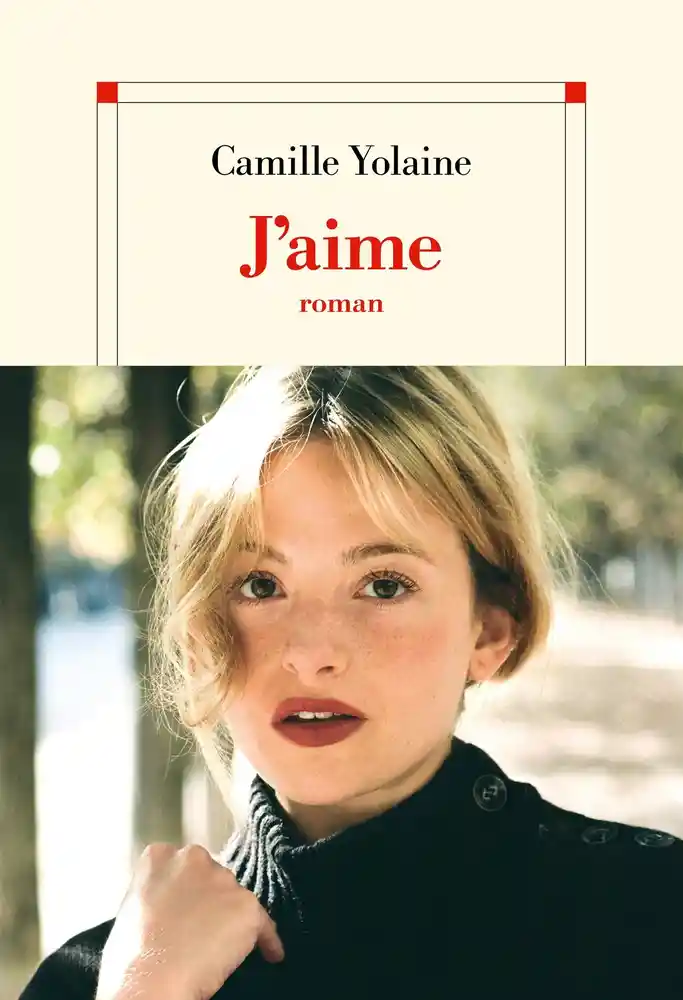
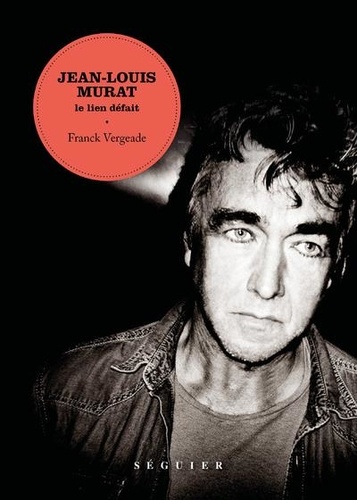
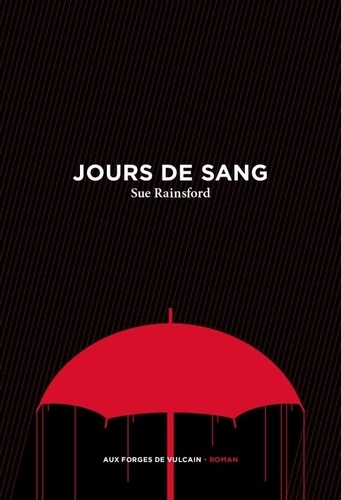







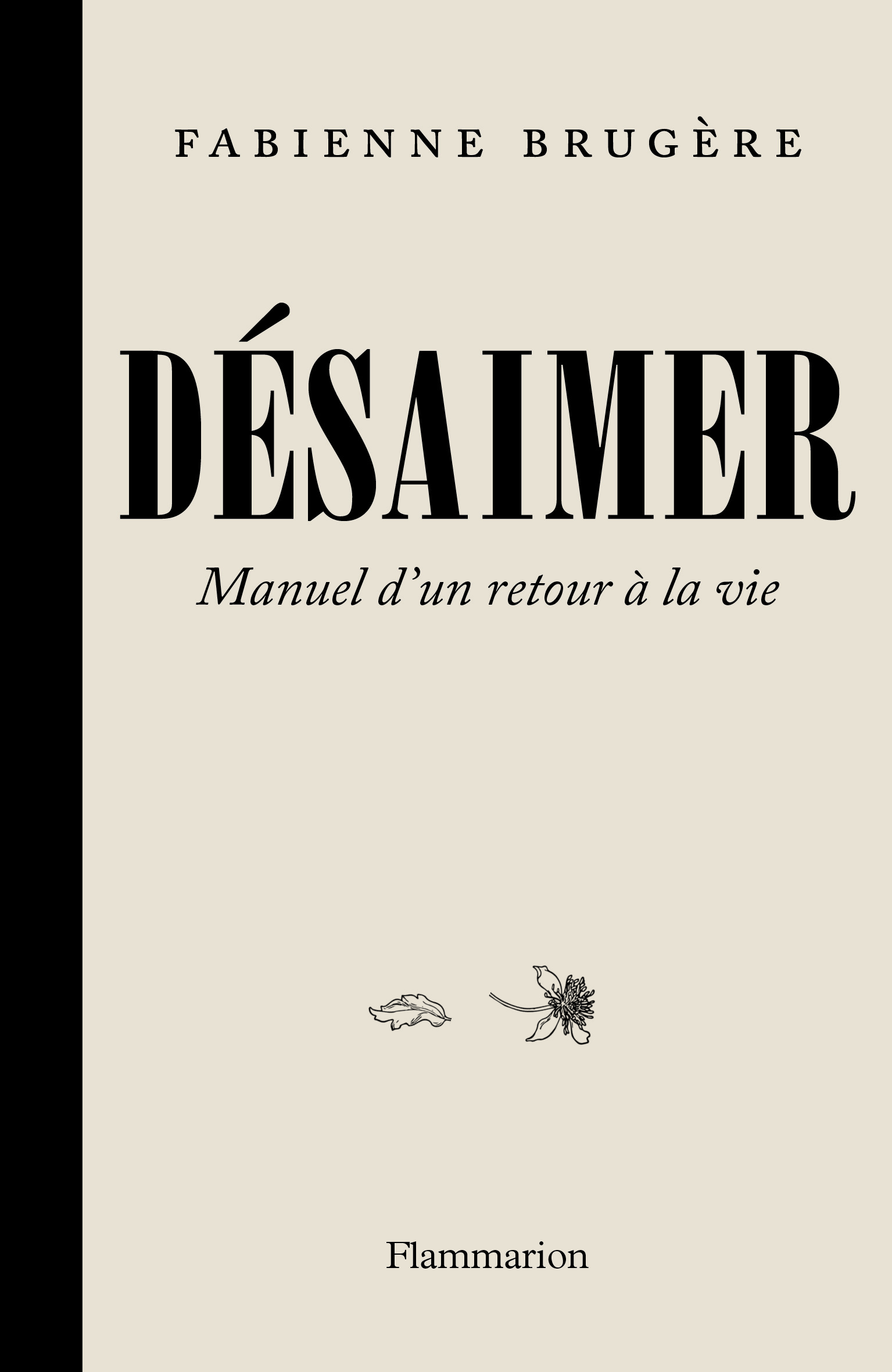

1 Commentaire
Camille
02/09/2019 à 09:10
Désolée, mais j'ai adoré la lecture de ce livre. Cela change des médias gauchistes qui nous disent quoi penser et quoi dire. C'est bien pour ça que BEE a plus de succès en France que chez lui, on a besoin de respirer et de retrouver la liberté d'expression.