Auteurs professionnels : crise de fake news à la SGDL
Rapport Racine. On s'en souviendra longtemps. Le rapport qui aura permis de mieux comprendre qui défend quoi. La première tribune de Mathieu Simonet, président de la SGDL, n'avait pas fait l'unanimité des auteurs dans l'Obs. Sa dernière déclaration a créé une levée de boucliers comme on en a rarement vu.
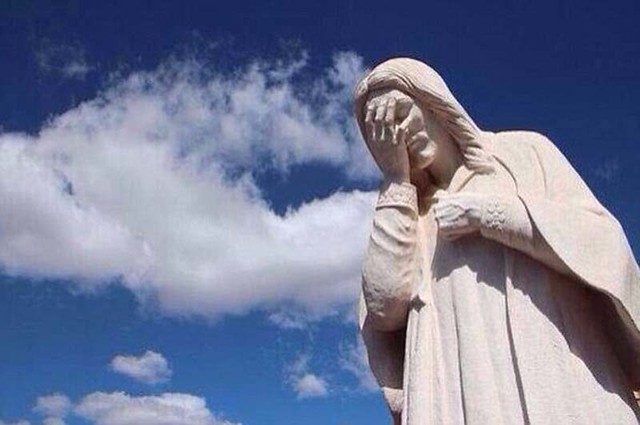
Dans un texte, Mathieu Simonet s'attaque à l'idée "d'auteur professionnel", accuse le rapport Racine de créer une hiérarchie entre auteurs et s'en prend à la toute jeune Ligue des auteurs professionnels. Trop jeune ? C’est en tout cas ce qui ressortait lors des auditions préalables au rapport, de plusieurs associations d’auteurs et d’organismes de gestion collective, qui reprochait à la Ligue de n’être pas séculaire. Or, difficilement contrôlable et bien renseignée, elle exaspère autant qu’elle inquiète.
Le problème de cette tribune alors ? Les arguments utilisés sont inexacts et traduisent une incompréhension du rapport. Procès d'intention ? Réel manque de compréhension des enjeux ? Les auteurs s'interrogent.
Mais... cette tribune n’a aucun sens (le parallèle avec la ligue du Lol ), en plus d’être mensongère : la ligue défend tous les auteurs et autrices et le rapport Racine fait un état des lieux puissants de leurs situations. La SGDL cautionne-t-elle les propos de son président ?
— Florence Hinckel (@florencehinckel) February 27, 2020
Tout commence par une anecdote personnelle du président de la Société des Gens de Lettres : « Lors de mon arrivée à Marseille, une femme m’a posé cette étrange question : “Es-tu légitime à être président de la Société des Gens de Lettres alors que tes revenus ne proviennent pas majoritairement de la vente de tes livres ?” »
Pros et anti
Le président de la SGDL s'interroge sur sa propre légitimité. Une question qui aurait une origine : la Ligue des auteurs professionnels. Par sa création, l'organisation aurait répandu cette idée dérangeante d'auteurs “professionnels”. Le concept n'a pourtant rien de nouveau. L'IRCEC, la retraite complémentaire des auteurs défendue en ce moment par la SGDL, définit l'auteur professionnel. Le critère actuel est celui du seuil d'accès aux prestations sociales.

La participation à la retraite complémentaire de la Sofia n'est réservée qu'à certains auteurs selon des critères stricts.

« Cette Ligue a trois spécificités : un talent pour la communication, des idées intéressantes et une volonté de défendre les “auteurs professionnels” », affirme Mathieu Simonet. « Or, selon la Ligue, il conviendrait de réserver le mot “professionnel” à une “élite économique”, c’est-à-dire à 10 % environ des auteurs les plus riches ; tous les autres ne seraient que des “amateurs”. »
Cherche et tu trouveras
Une affirmation qui a sidéré de nombreux auteurs, dont des membres de la SGDL. Contrairement à la SGDL, la Ligue des auteurs professionnels a ouvert l’adhésion à tous les auteurs, y compris aux auteurs autopubliés. Une rupture avec le schéma traditionnel classique — la SGDL y réfléchissait cependant depuis des années sans jamais avoir franchi le pas.

et ça ne m'empêche pas d'appartenir à la Ligue et de m'y sentir parfaitement représentée. Cela ne m'empêche pas non plus de m'associer à la demande d'une meilleure protection sociale pour ceux qui, contrairement à moi, n'en disposent pas de par leur deuxième métier.
— Camille Brissot (@CamilleBrissot) February 27, 2020
Ce qui ressort de cet article, c’est surtout que "L’écrivain Mathieu Simonet" s’échine à justifier sa légitimité. Pour la Ligue, il ne s’agit pas d’ego, mais de la survie d’une profession qui ne dispose pas d’un statut par ailleurs.
— Gabriel Katz (@Gabrikatz) February 27, 2020
Dans les documents remis à la mission Bruno Racine, le statut professionnel proposé par la Ligue est l’inverse de ce qui est ici décrit dans la tribune de l’Obs. Extrait :
« Qu’est qu’un professionnel ? Fiscalement, la jurisprudence administrative a défini deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant, et elle doit l’être dans un but lucratif. C’est évidemment le cas de beaucoup de créateurs et créatrices, et on ne peut à la fois les traiter comme tels fiscalement et ne pas leur reconnaître socialement un véritable statut professionnel et les droits particuliers qui vont avec. »
La Ligue des auteurs professionnels signale aussi le manque de protection des auteurs n’ayant pas d’autre métier :
« Pourtant, aujourd’hui, avec la disparition de la notion d’assujetti/affilié, c’est toute possibilité d’offrir un accompagnement particulier aux artistes-auteurs qui n’ont que leurs activités créatives pour vivre qui a disparu, ce qui est extrêmement problématique. L’entrée dans le régime au 1er euro a anéanti toute identité professionnelle du régime. Ce principe de recouvrement généralisé des cotisations rend très floues aujourd’hui les démarches à accomplir pour entrer dans le régime artistes-auteurs, accentuant encore davantage la confusion. Dans les faits, le principe “d’affiliation” existe toujours, mais de façon voilée, puisque les seuils de revenus demeurent pour l’accès aux prestations sociales autres que les soins. »
Même Stéphanie Le Cam, membre du collège d’experts qui a entouré Bruno Racine et maître de conférences, Directrice de l’ISSTO, Université Rennes 2 et JUSPI, déplore ce qui ressemble fort à une fake news. « Je suis inquiète ce soir : le président de la SGDL n’a pas bien lu notre travail. Il dit que “le récent rapport Racine préconise que seule une minorité d’auteurs (ceux percevant les plus hauts revenus) puisse bénéficier du droit de vote en 2020 pour élire des représentants”. Délirant... »
Si j'ai bien compris, c'est l'inverse: l'idée est de donner aux plus vulnérables qui consacrent leur vie à la création une protection sociale qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, seuls ceux qui dépassent un seuil financier ont cette protection.
— Olivier GAY (@0liviergay) February 27, 2020
L’accès aux prestations sociales pour les auteurs demande d’atteindre un seuil de droits d’auteur élevé : plus de 9000 € de droits d’auteur par an en 2020. « Il y a, aussi, en parallèle, une urgence à ce que le régime social des artistes-auteurs soit adapté à la grande précarité de leurs métiers, qu’il leur permette de s’y maintenir les années difficiles » développe la Ligue dans le document.
La proposition soutenue par l’organisation est d’ouvrir les critères stricts actuels pour déclencher les prestations sociales :
Le revenu d’artiste-auteur, s’il reste suffisant pour prouver qu’on est professionnel, ne peut pas rester la seule manière de le démontrer. Le droit d’auteur étant une rémunération dissociée d’un revenu immédiat et n’étant pas proportionnel au temps de travail, cela nécessite de trouver d’autres critères en phase avec cette rémunération particulière. Poser des critères multiples, souples, évolutifs et en phase avec la réalité des métiers, c’est également pouvoir enfin donner une définition de l’auteur professionnel. Un tel mécanisme a l’atout d’être évolutif et de pouvoir s’adapter aux changements rapides des métiers créatifs. Cette une grande amélioration qui est proposée : cela ne change rien pour les artistes-auteurs qui ont déjà accès au régime, mais cela permet à ceux qui, aujourd’hui, ne rentrent pas dans les cases alors qu’ils dédient pourtant leur vie à la création d’avoir enfin accès à la protection sociale.
La SGDL s’oppose-t-elle à ce que ceux qui ne vivent que de leurs droits d’auteur ne puissent pas avoir plus accès à des prestations vitales ? Entre les lignes, la crainte serait la mise en place des élections professionnelles. Le Rapport Racine souligne le problème de la représentativité et la nécessité de clarifier le paysage. Cet aspect semble rejeté au profit du fameux Conseil Permanent des Ecrivains, pourtant désavoué aujourd’hui par une partie des organisations d’auteurs :
Il est indispensable que les auteurs soient mieux protégés dans leurs contrats d’édition : nos partenaires et amis éditeurs doivent aujourd’hui faire un pas vers nous, de manière plus rapide et plus importante qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. De même, nous devons échanger avec eux, par écrit et par oral, selon un calendrier raisonnable, sur d’autres sujets, par exemple sur la récupération des droits qu’ils n’exploitent pas. Ces négociations doivent être portées de manière collective, c’est-à-dire au sein du Conseil permanent des écrivains qui regroupe plus d’une quinzaine d’organisations d’auteurs.
Plus que jamais, la question de qui représente les auteurs semble au centre des enjeux.

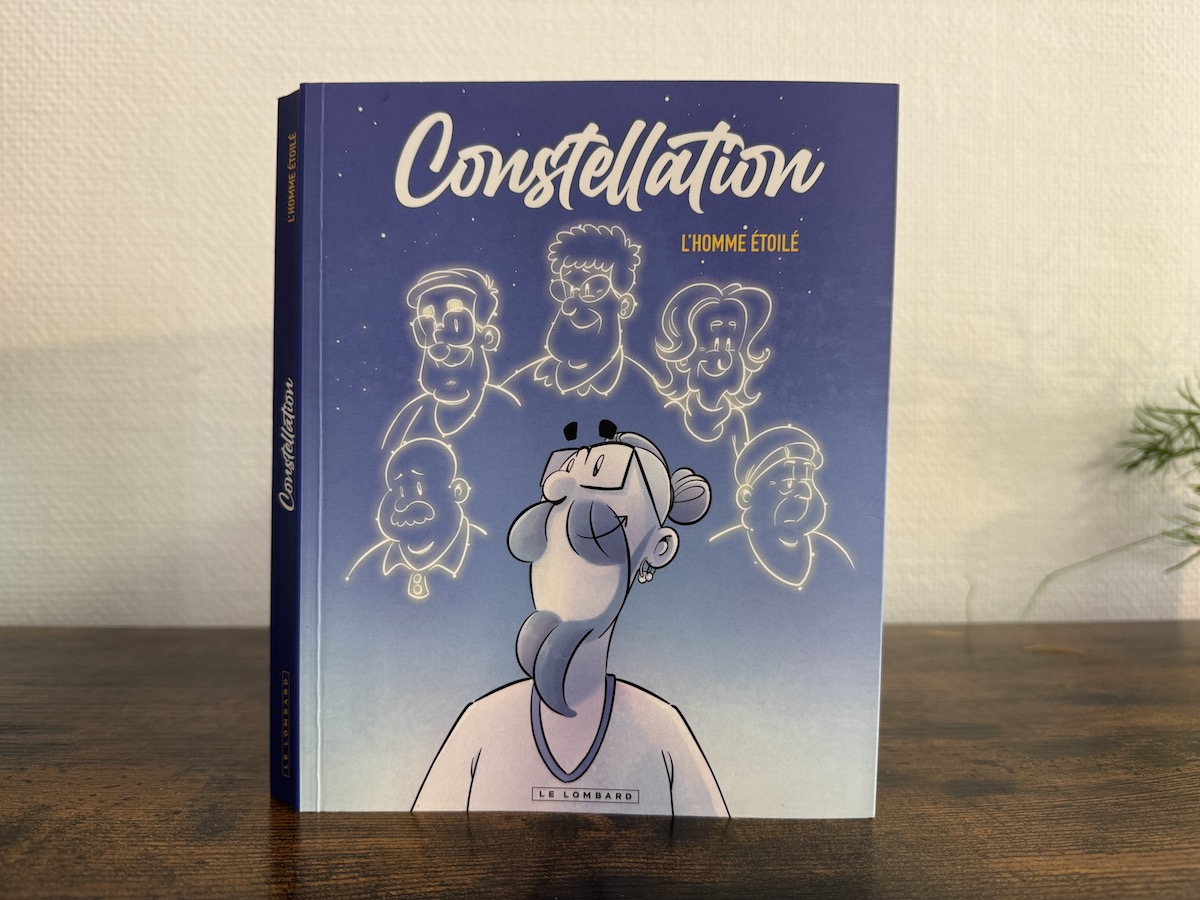
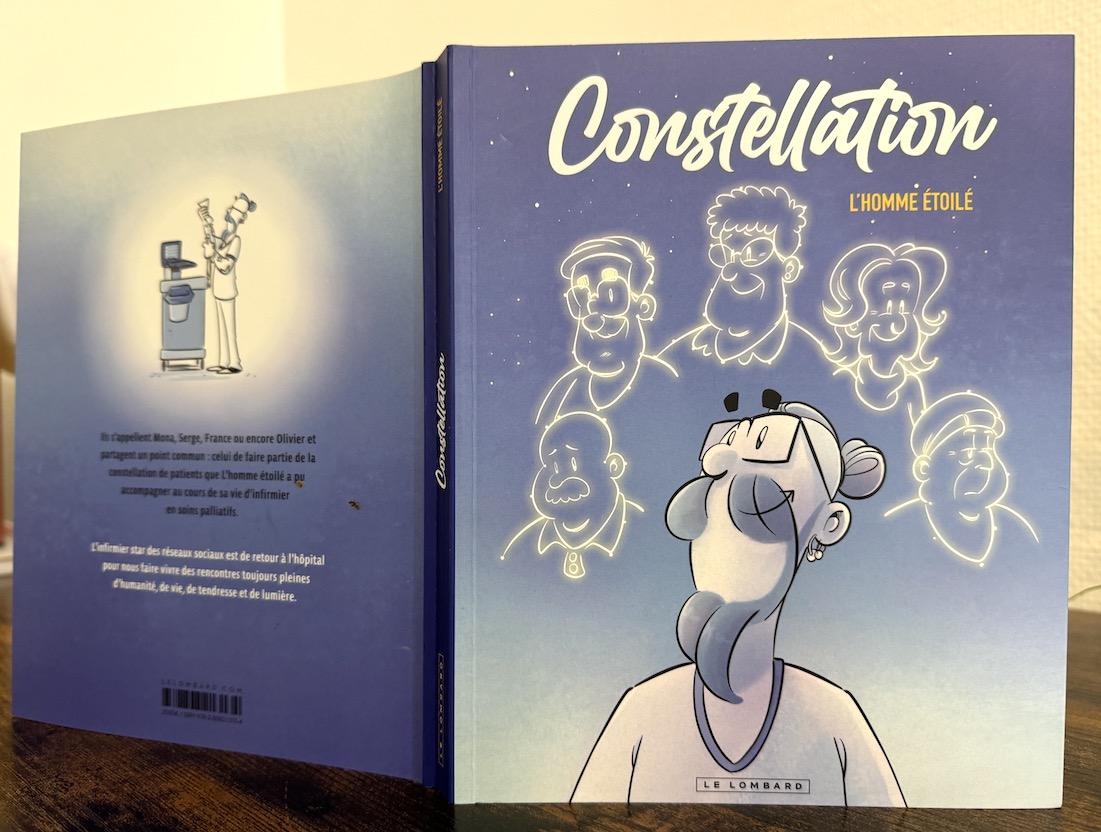

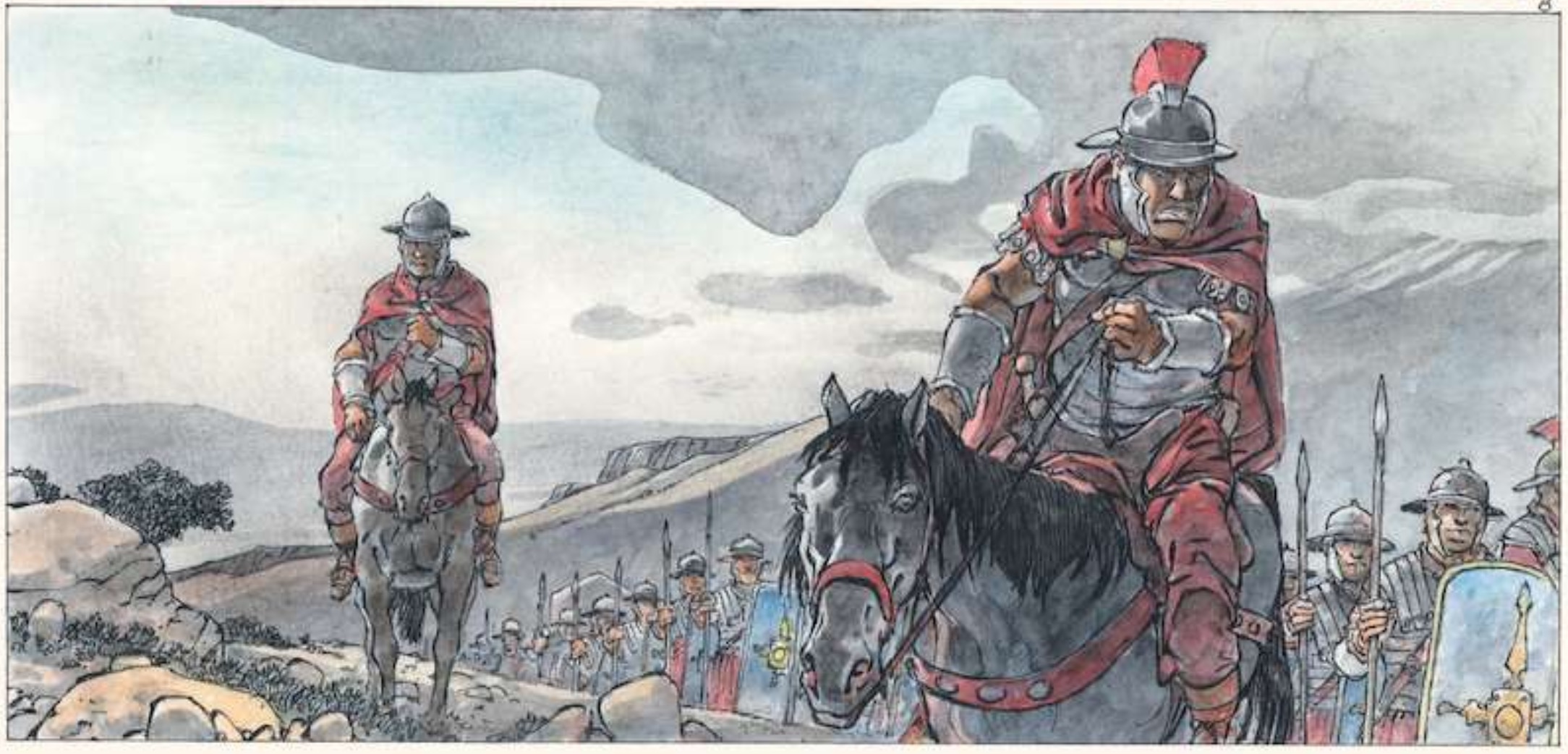

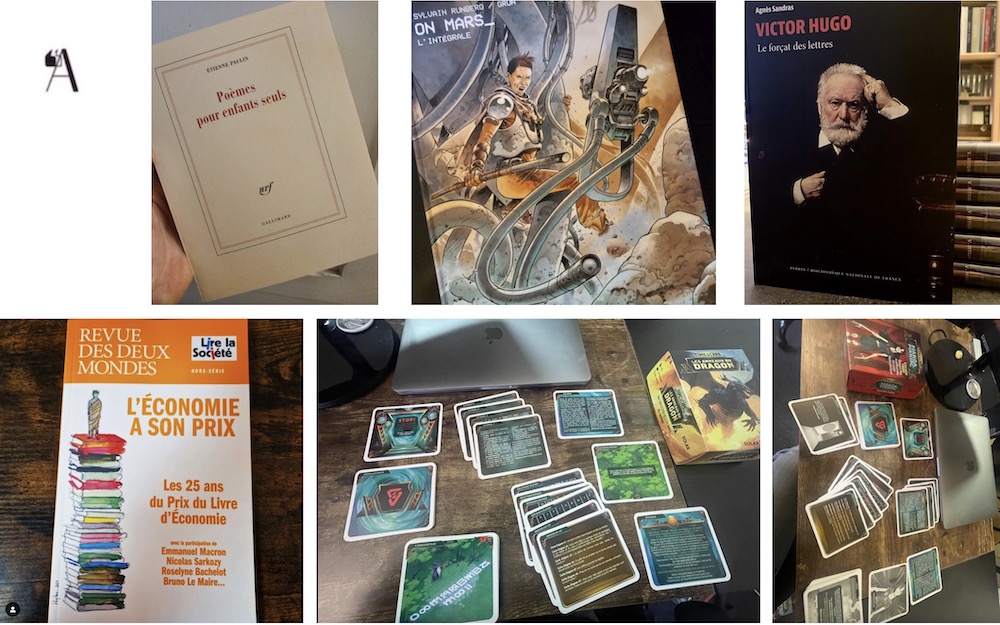

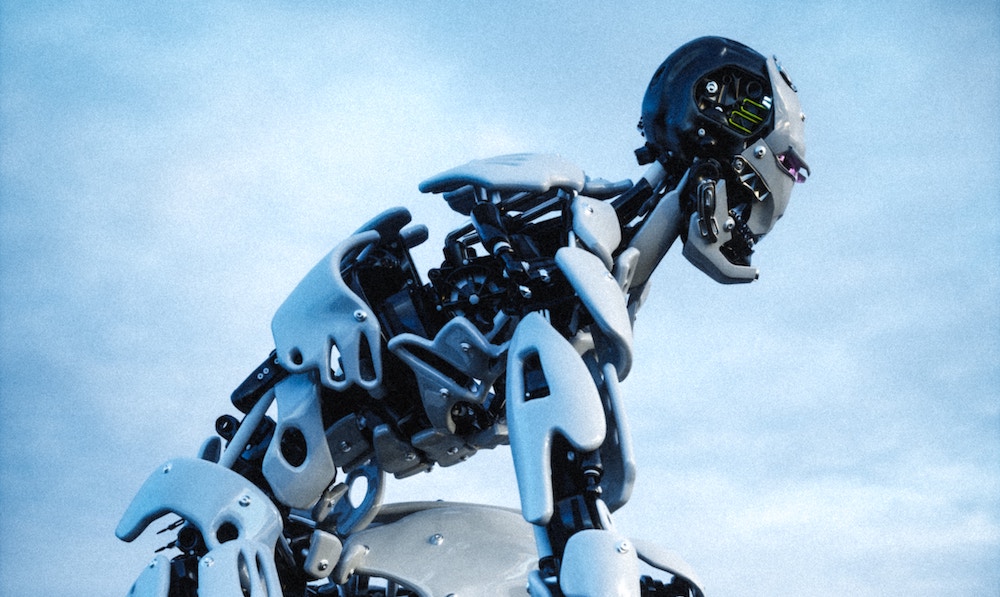
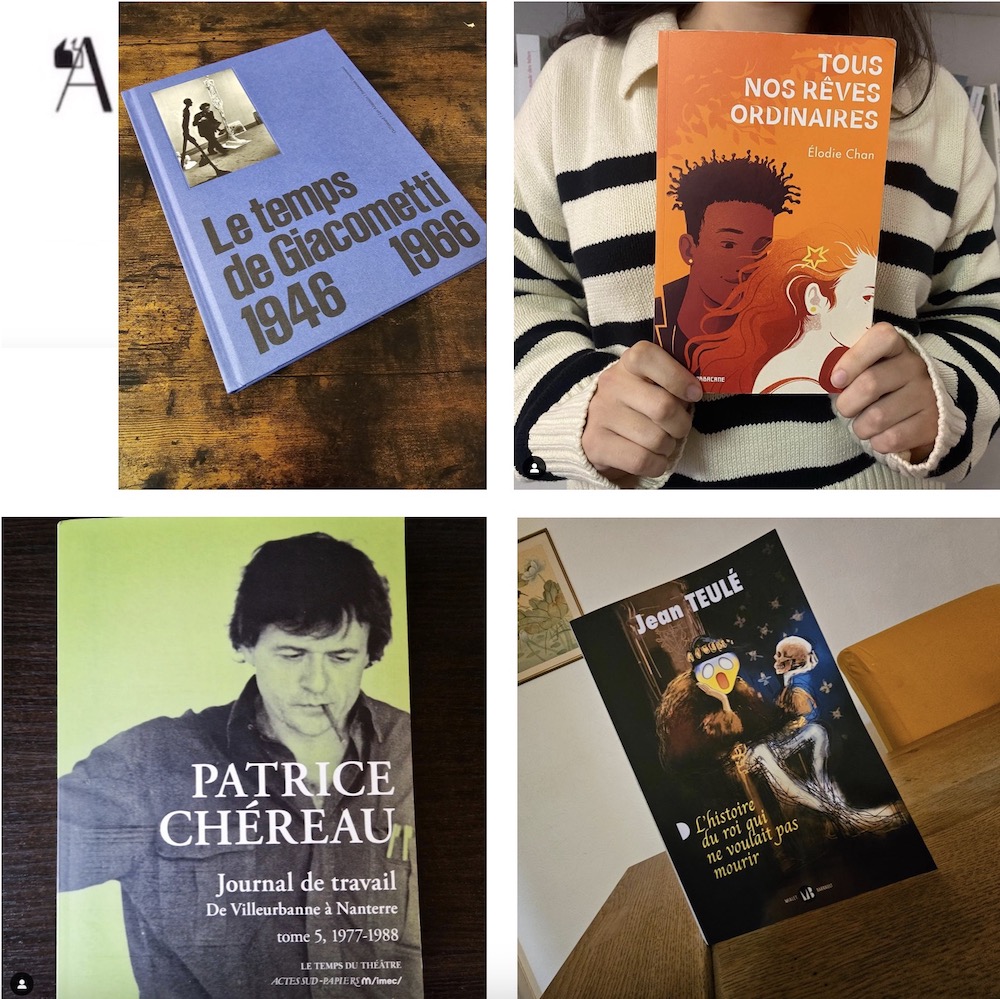


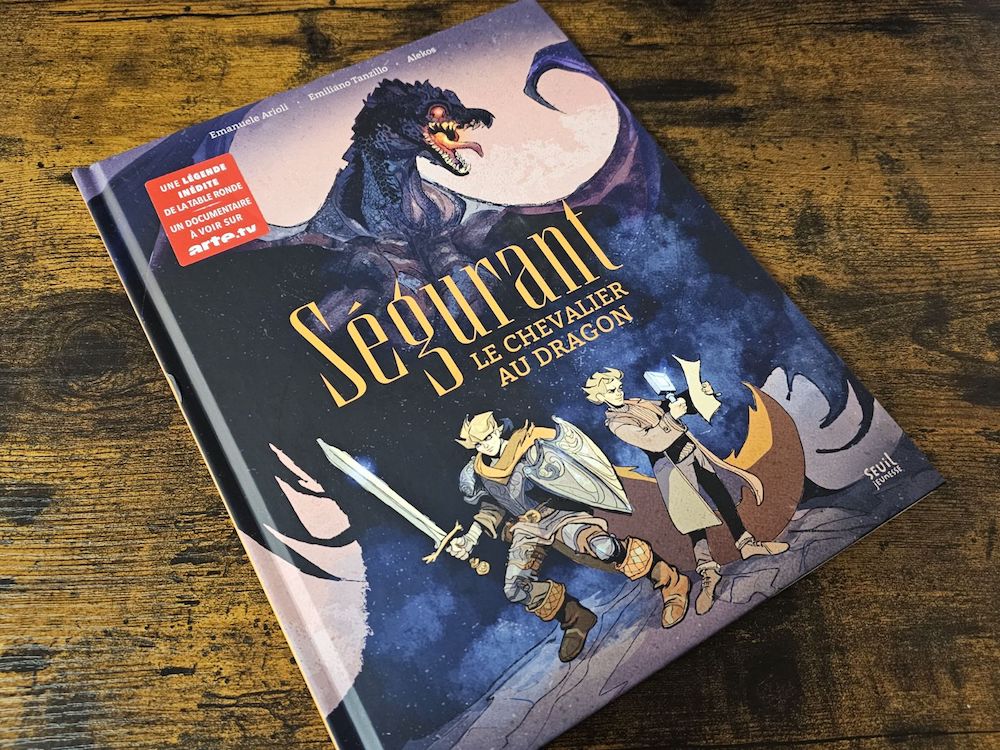
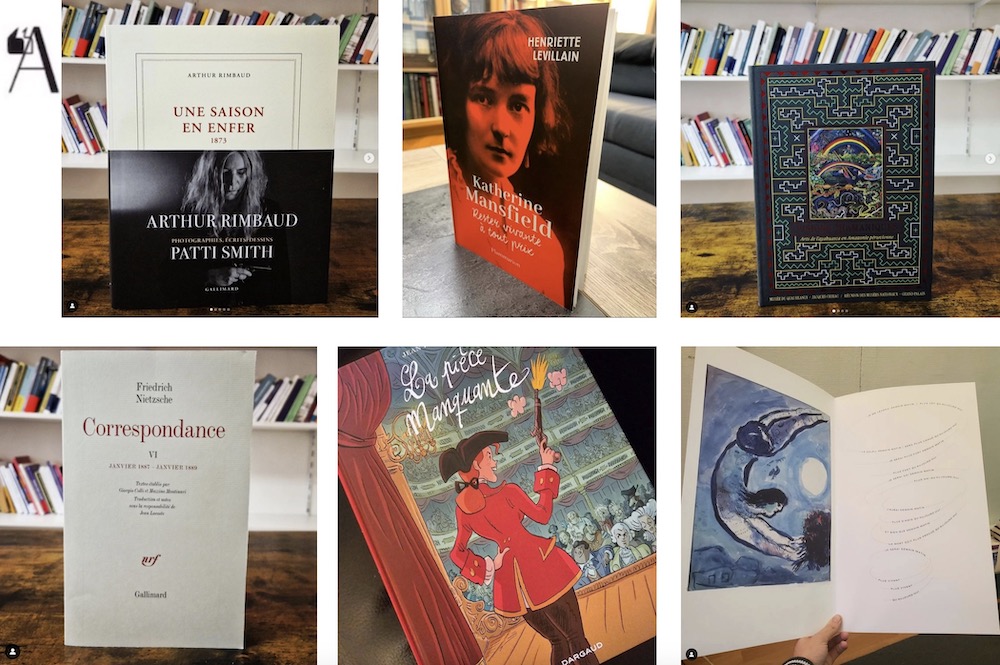
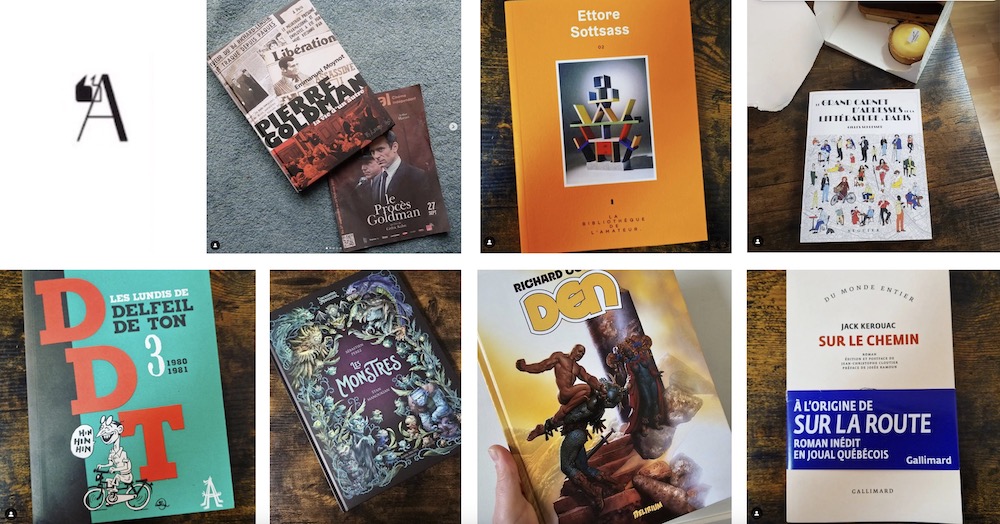
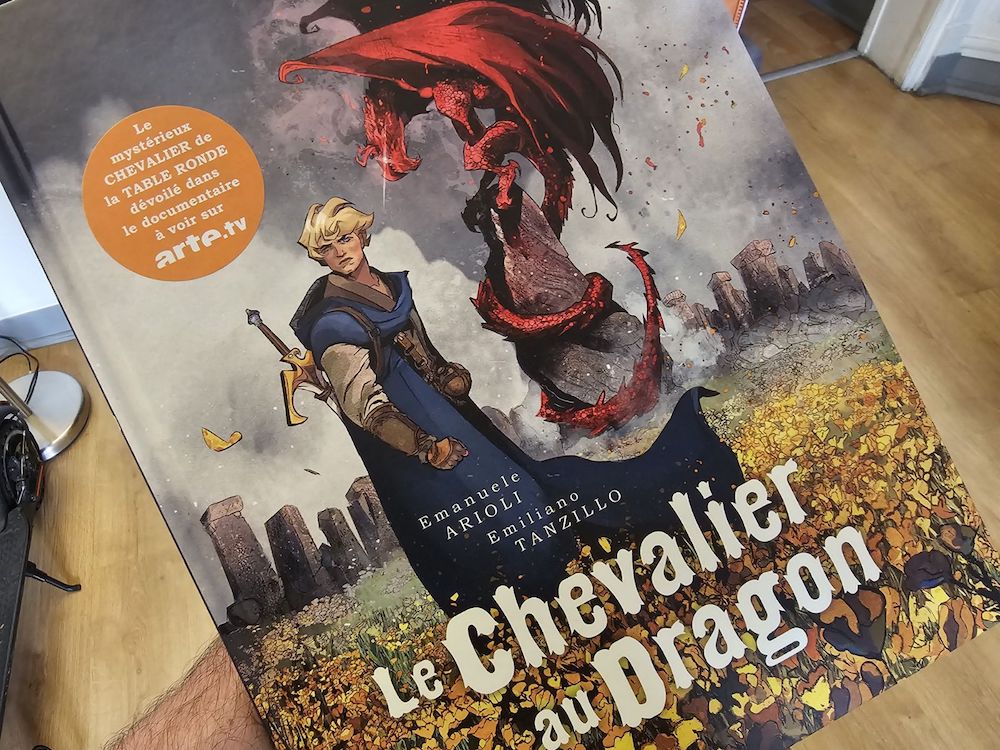
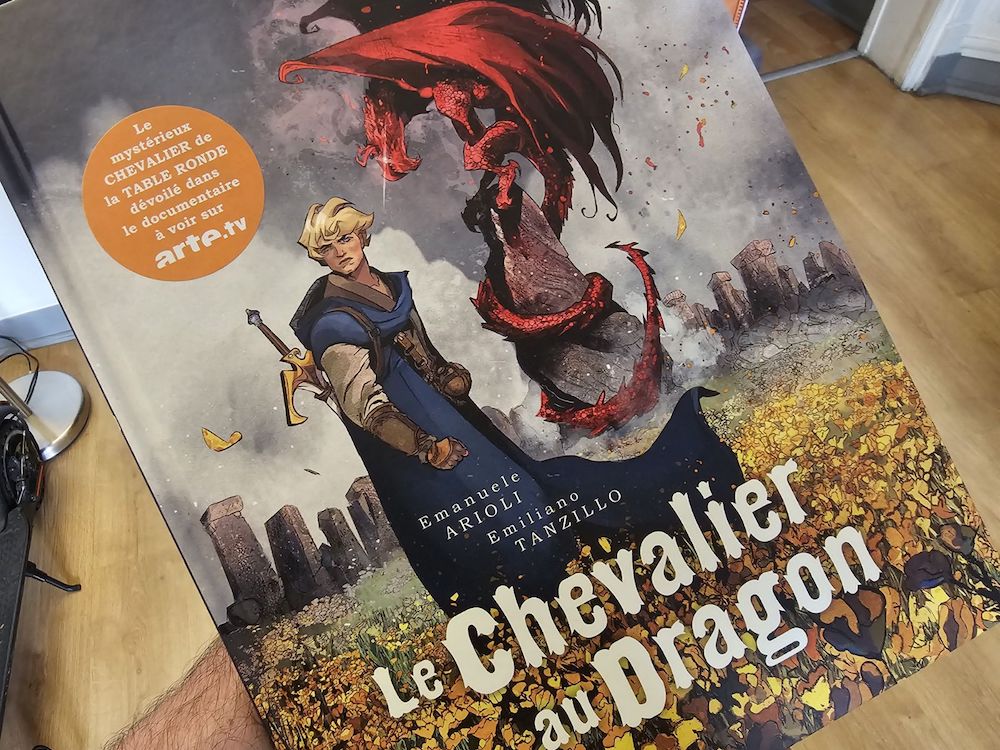
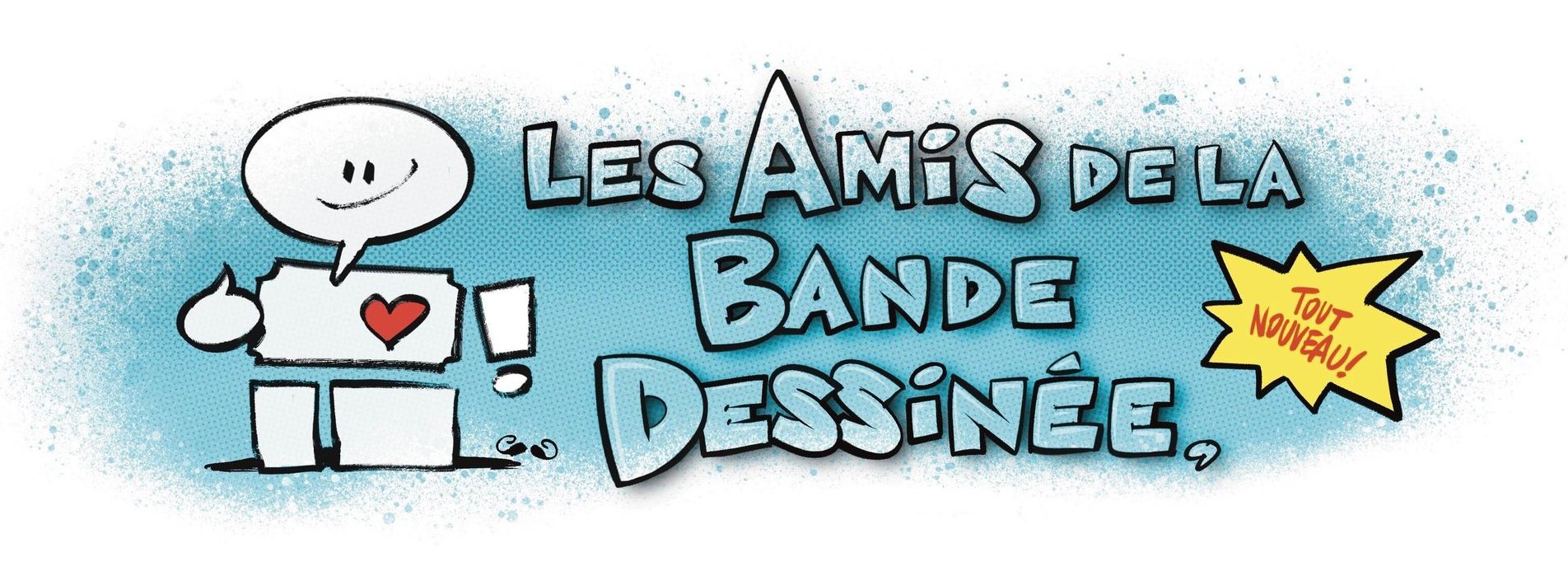
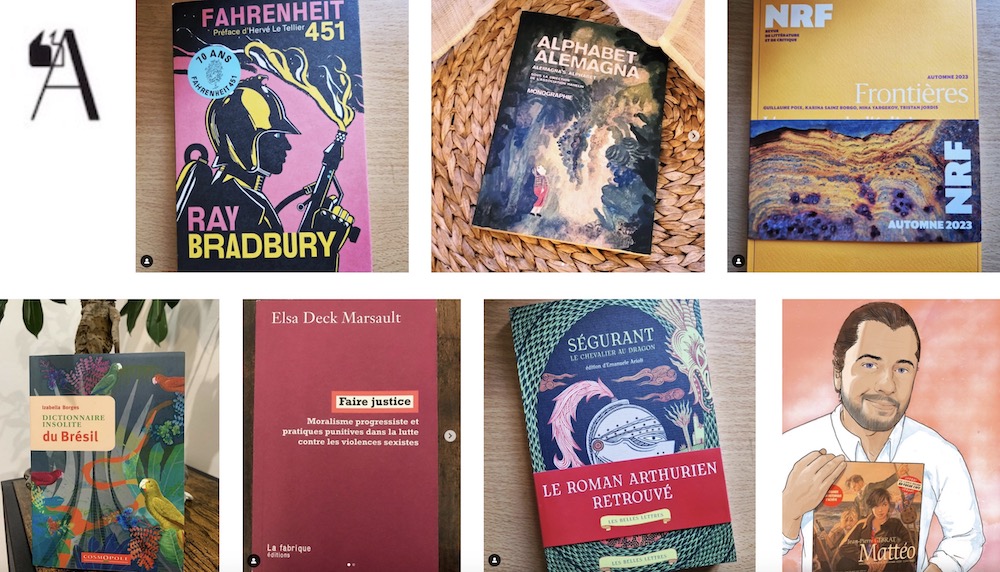
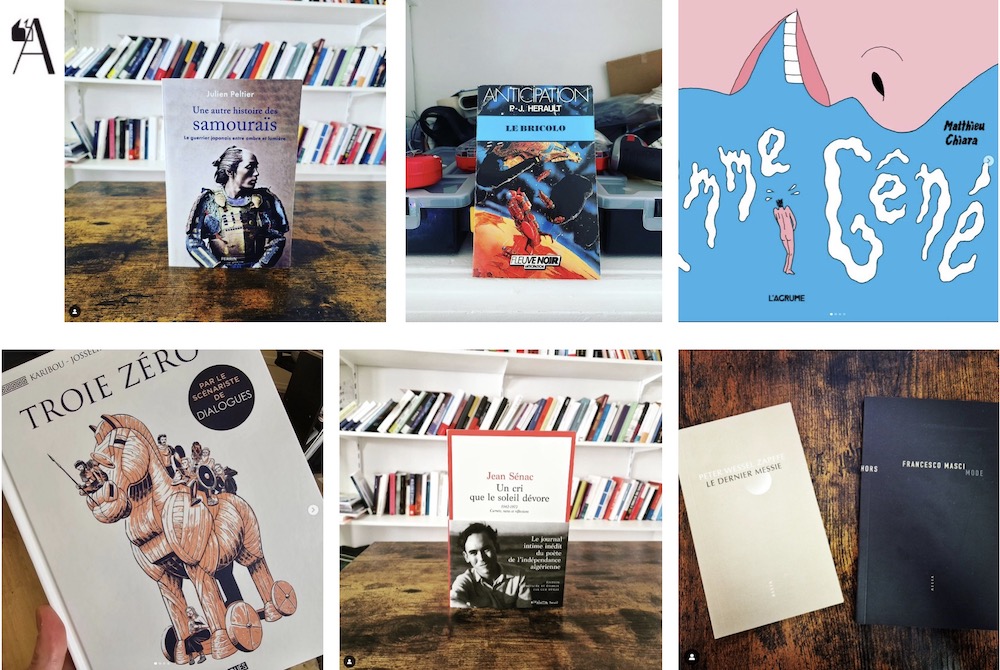
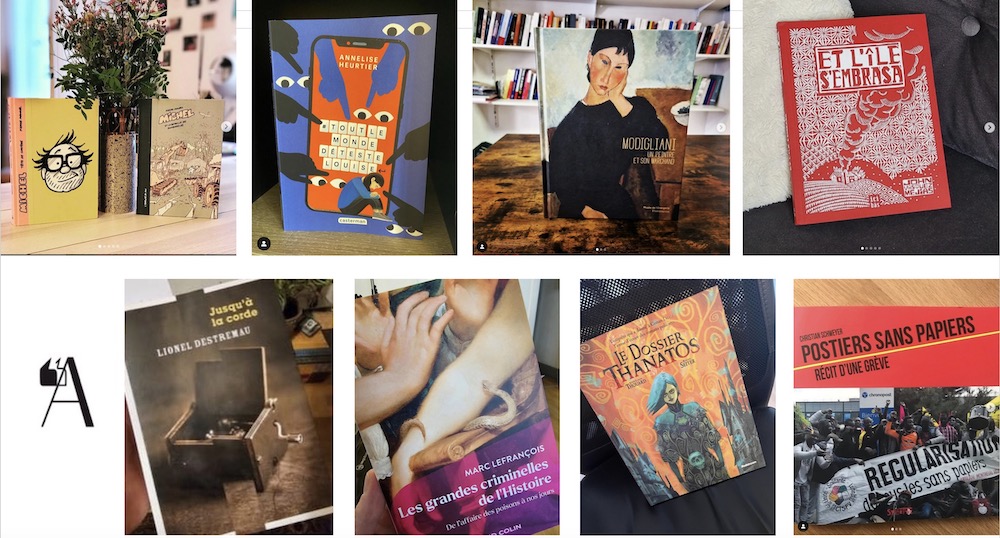
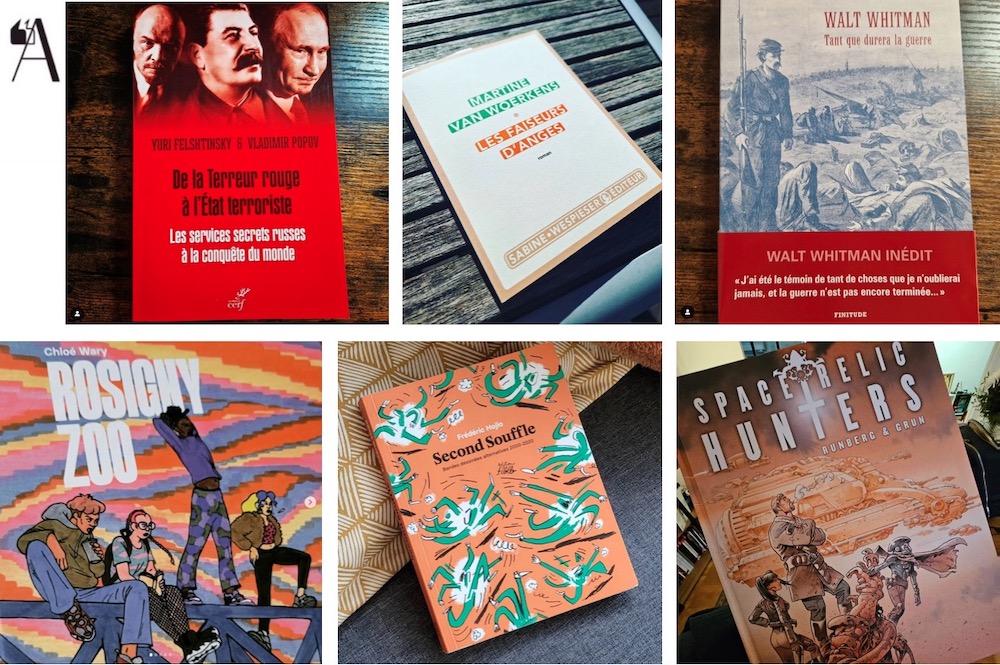
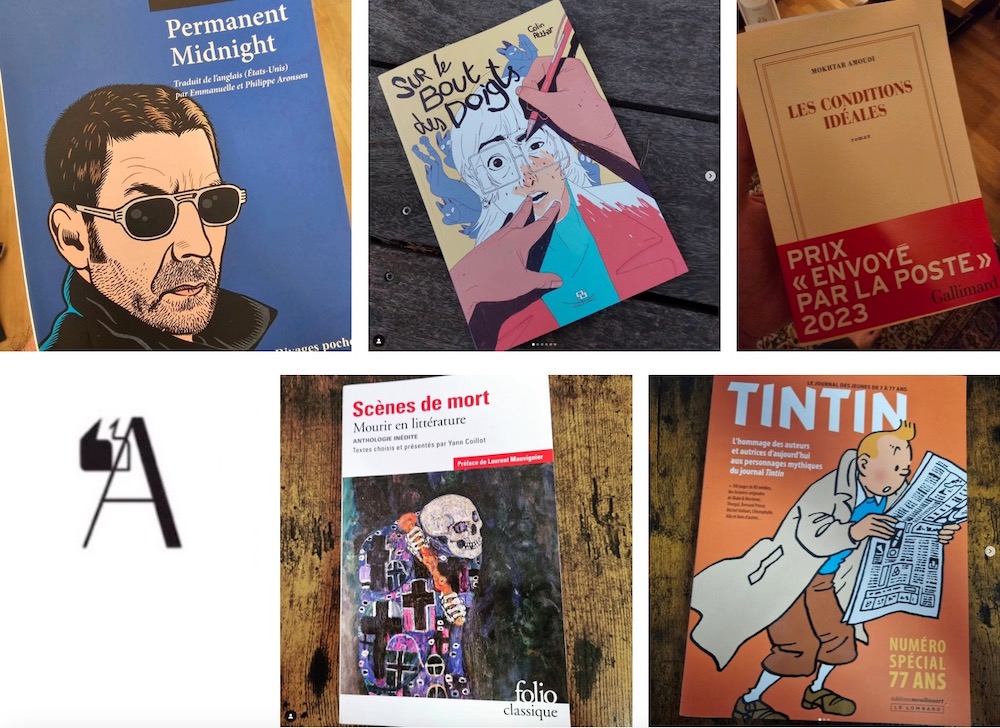
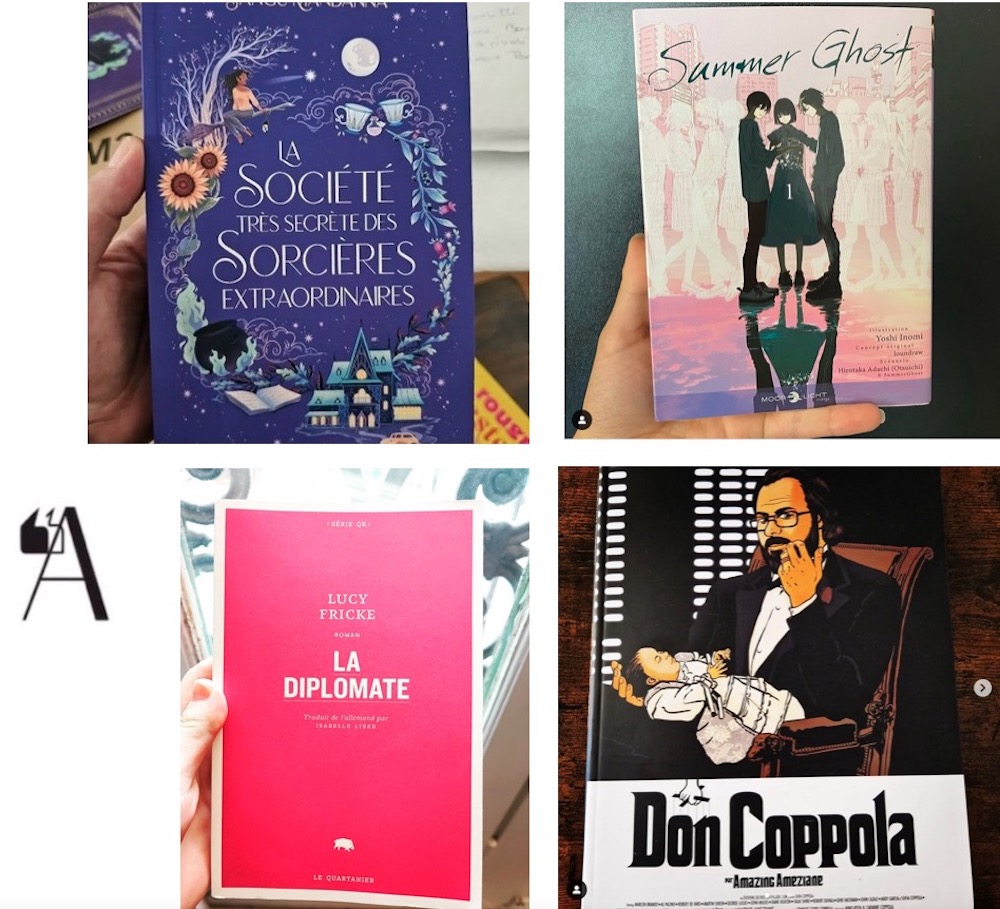
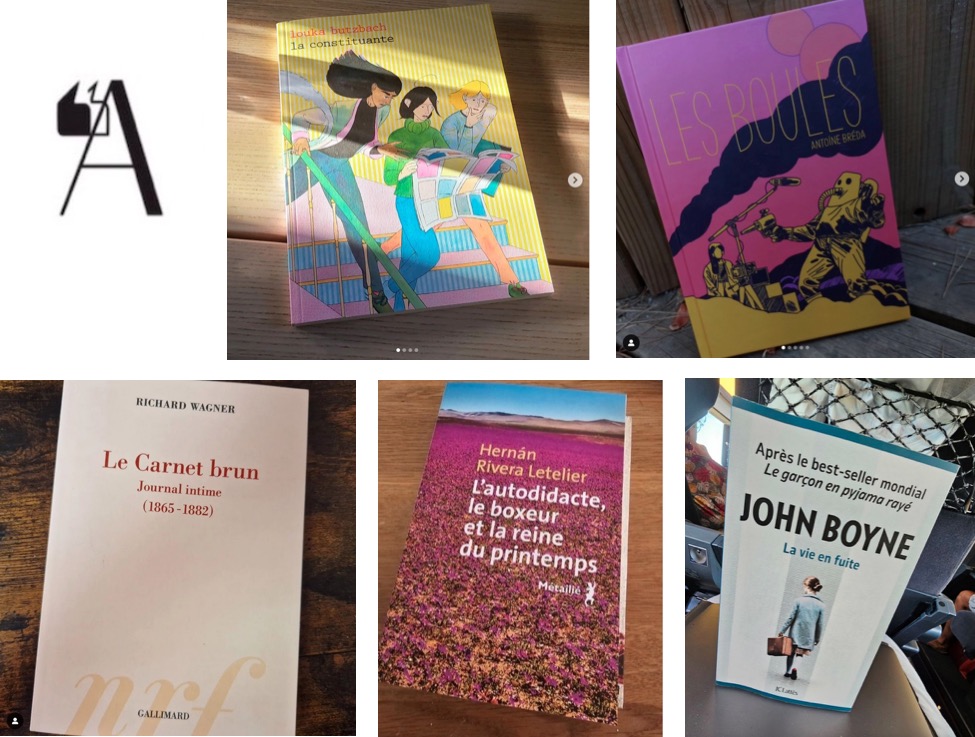
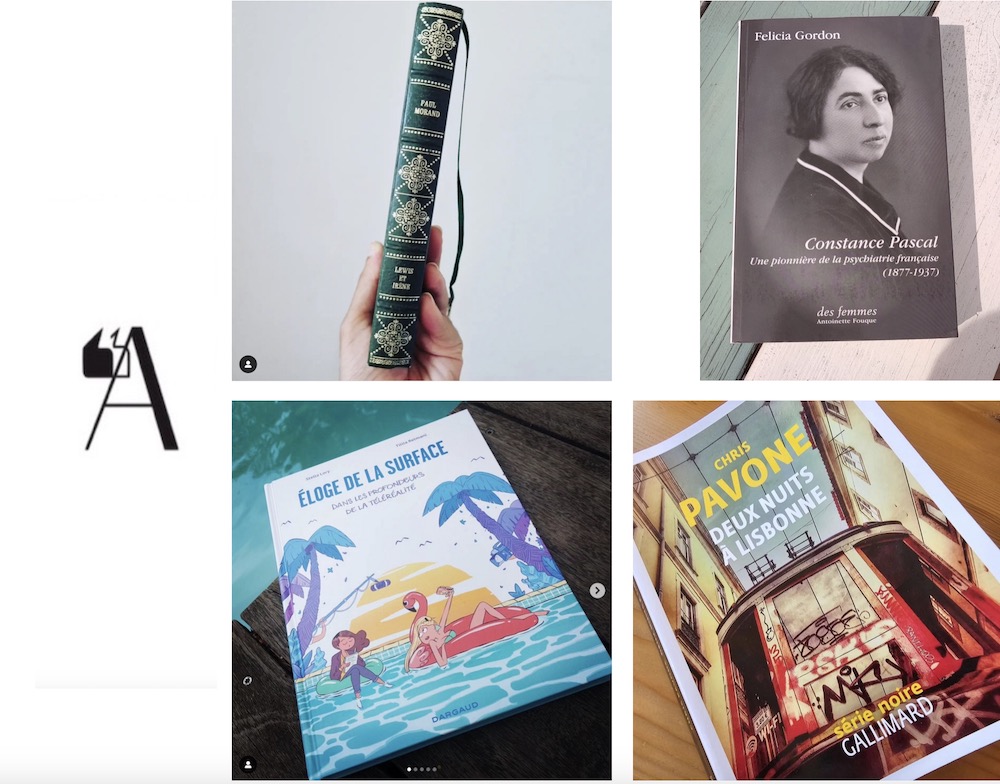
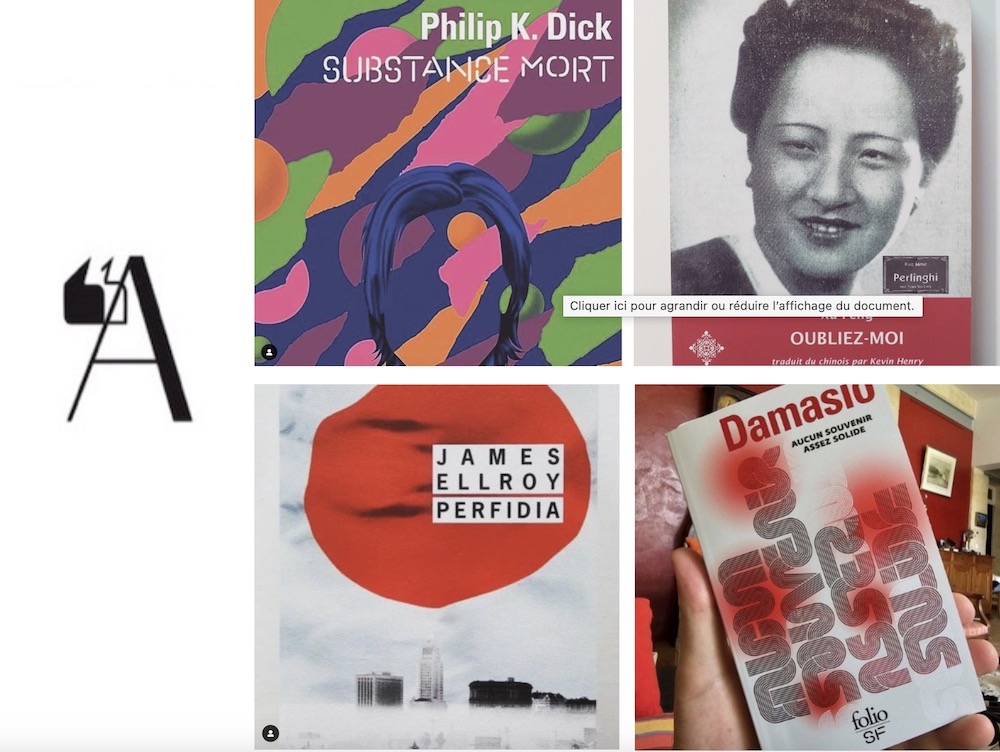

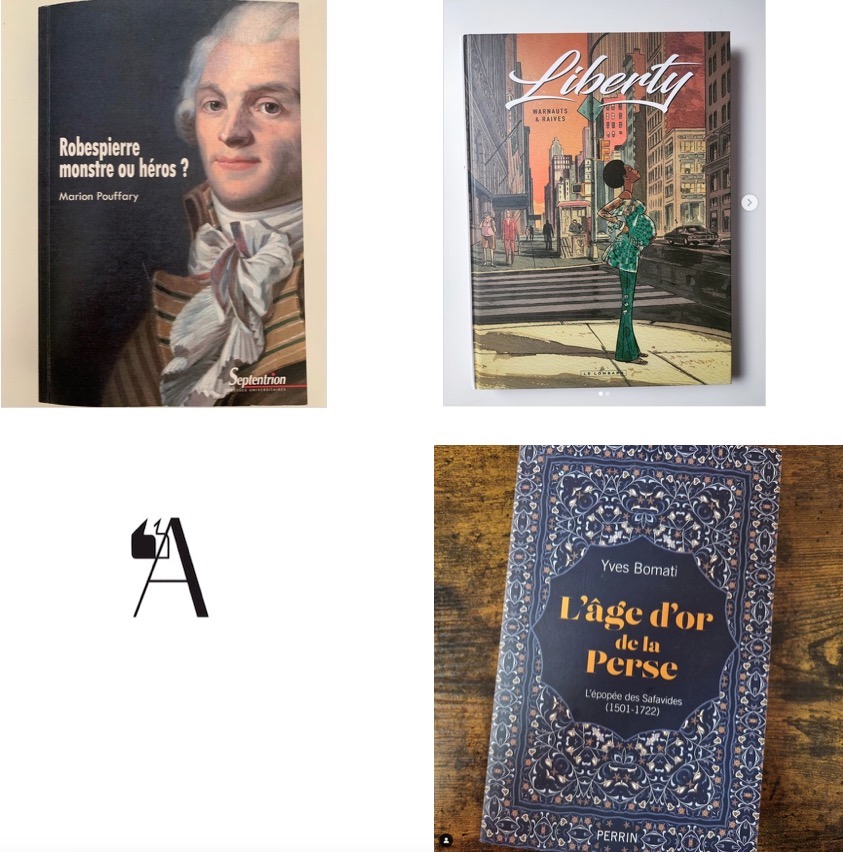
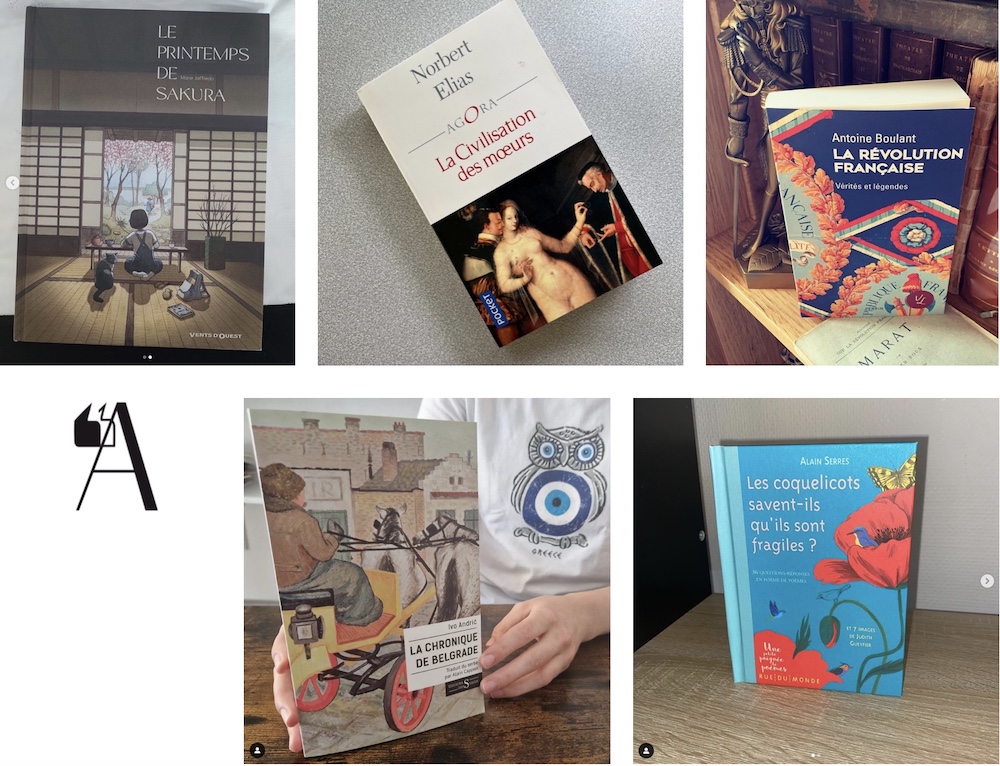
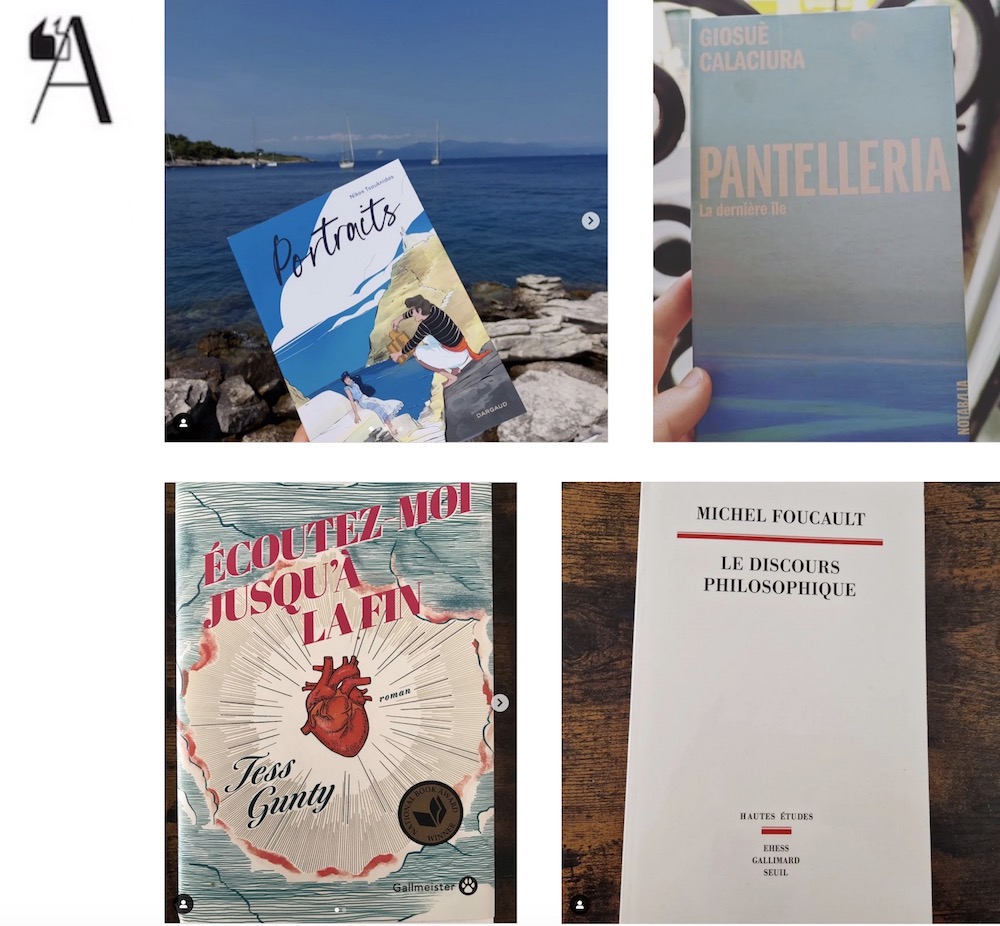




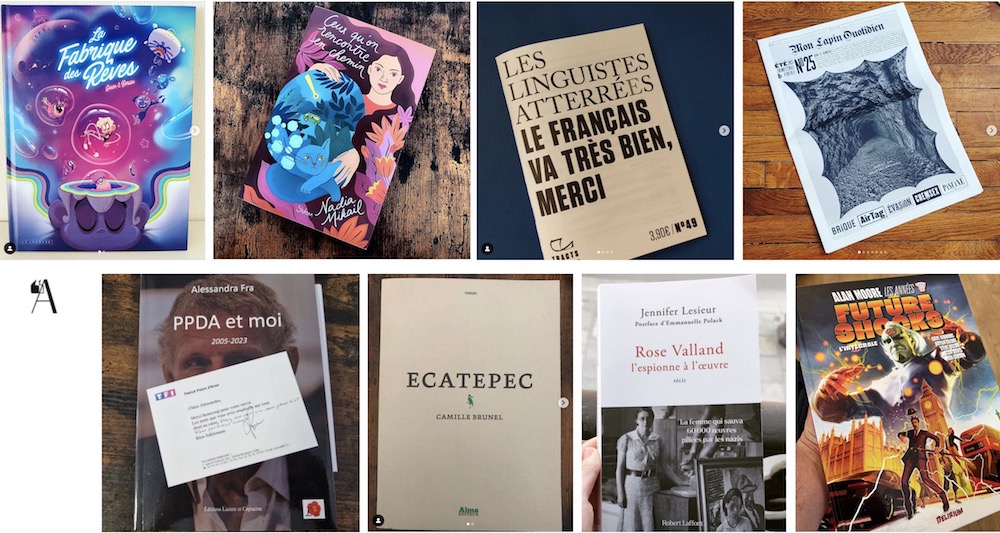

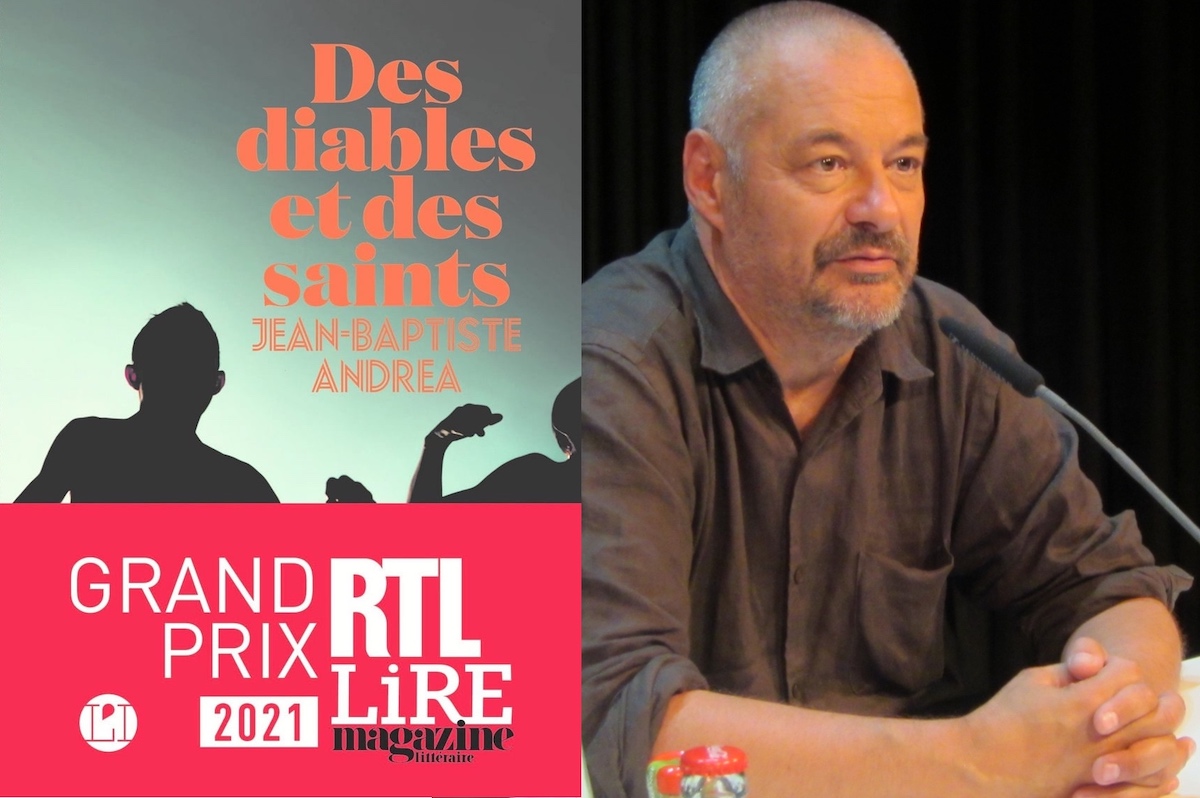


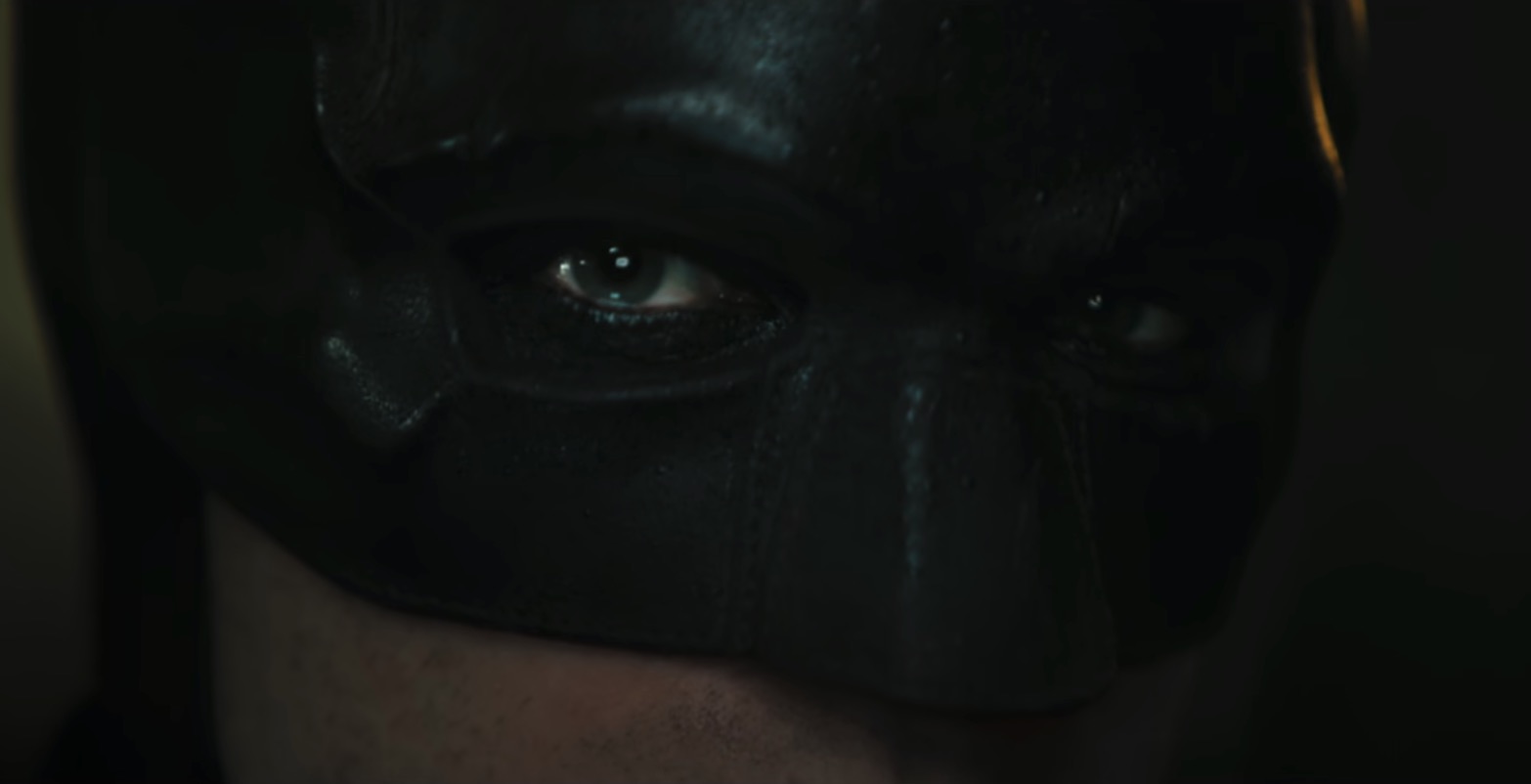

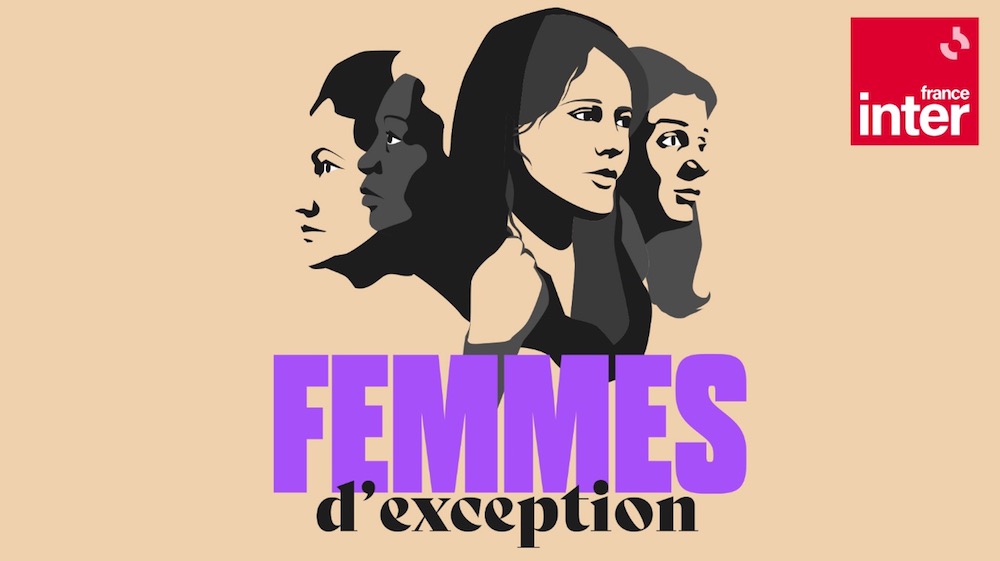



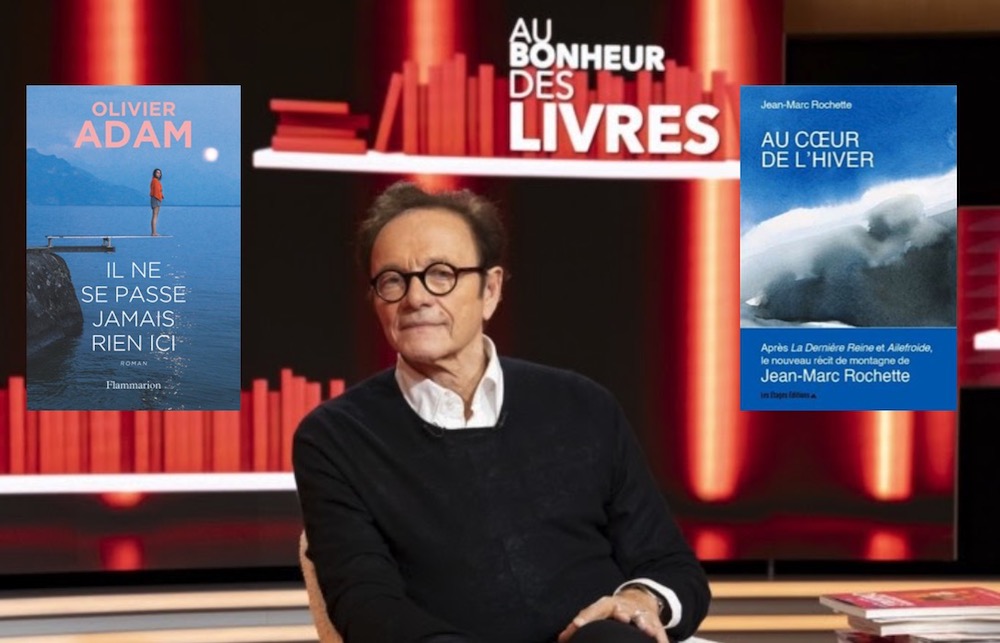
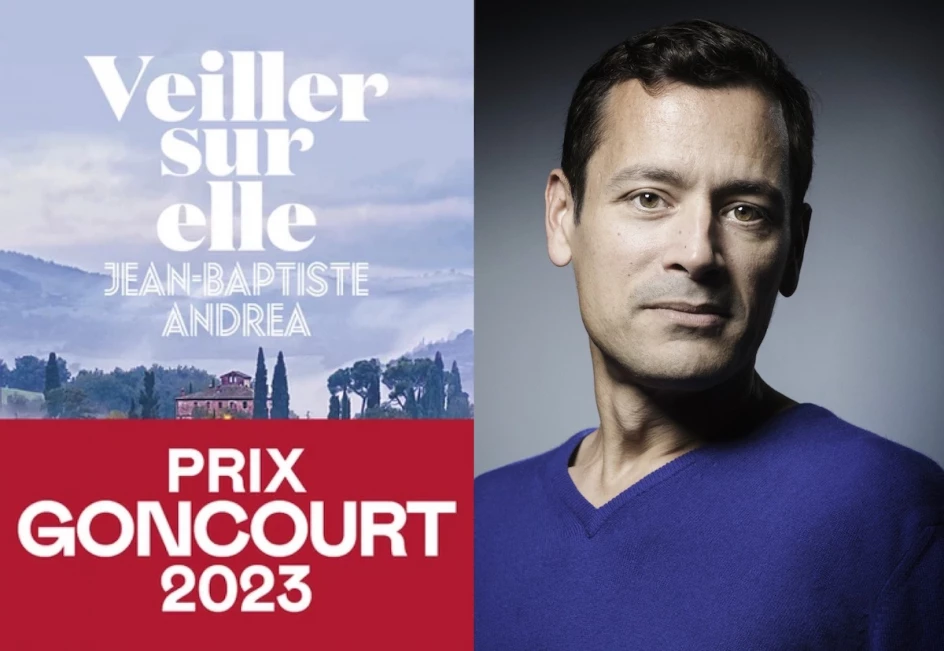
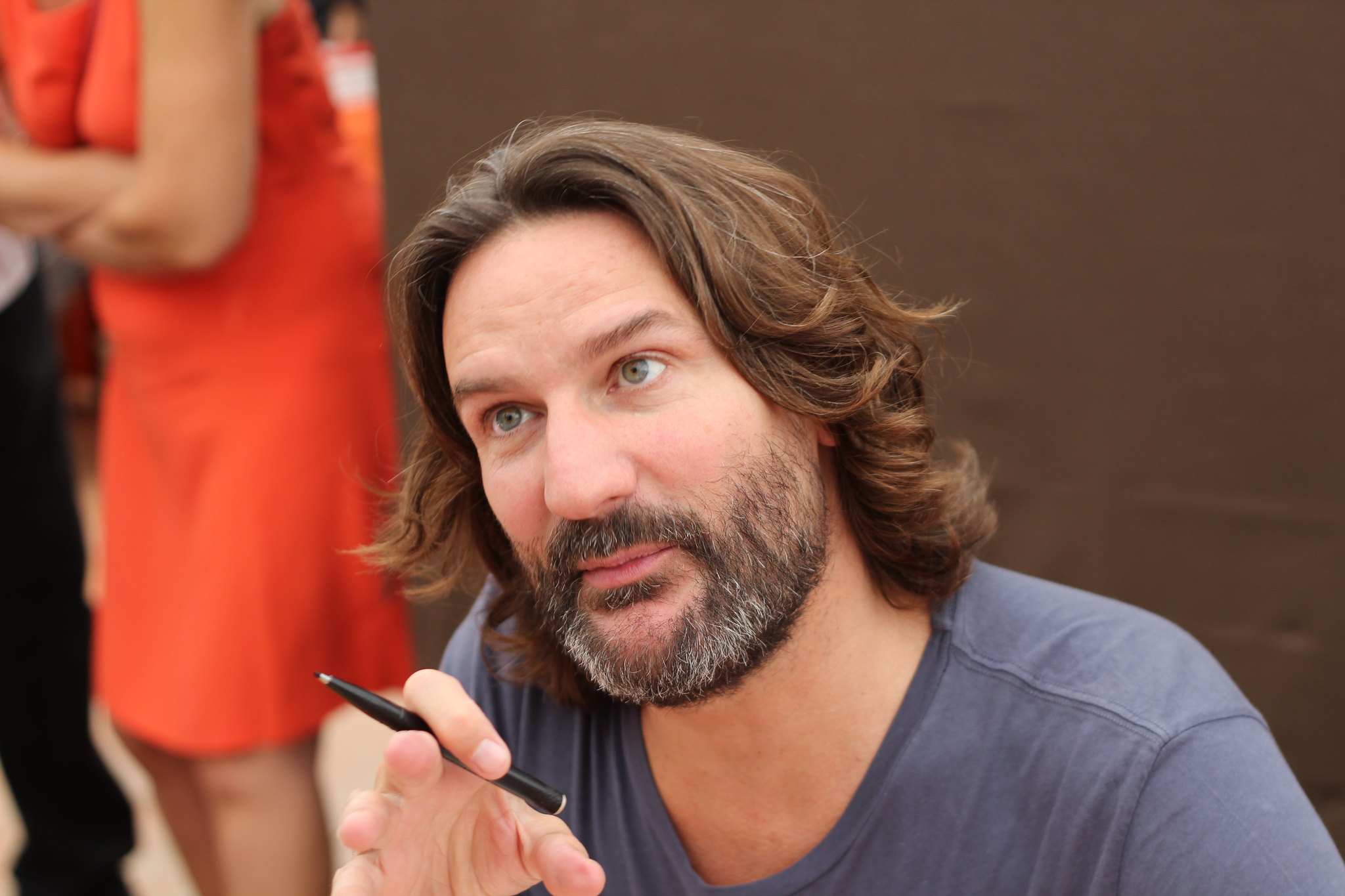



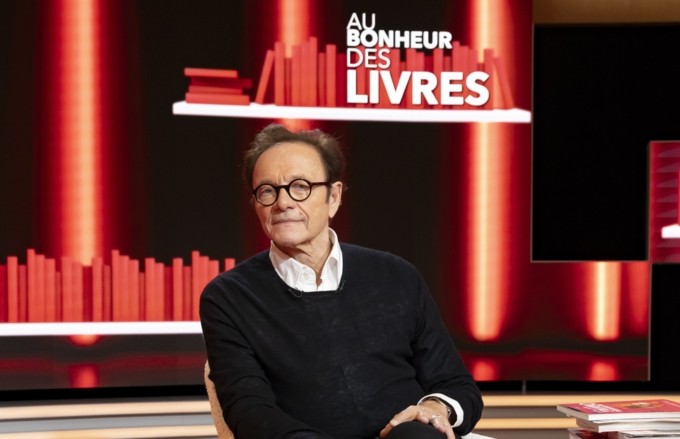
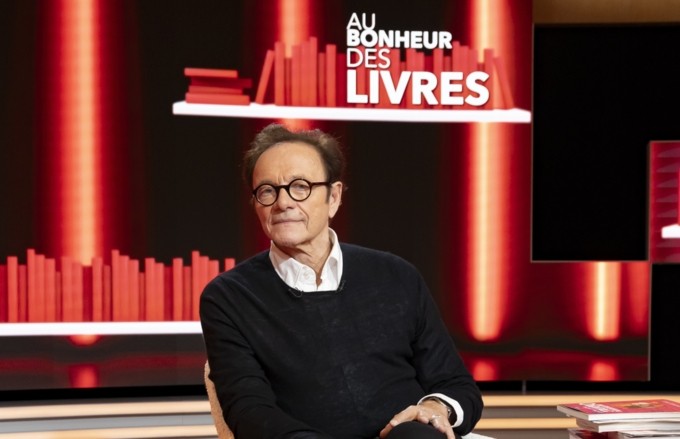



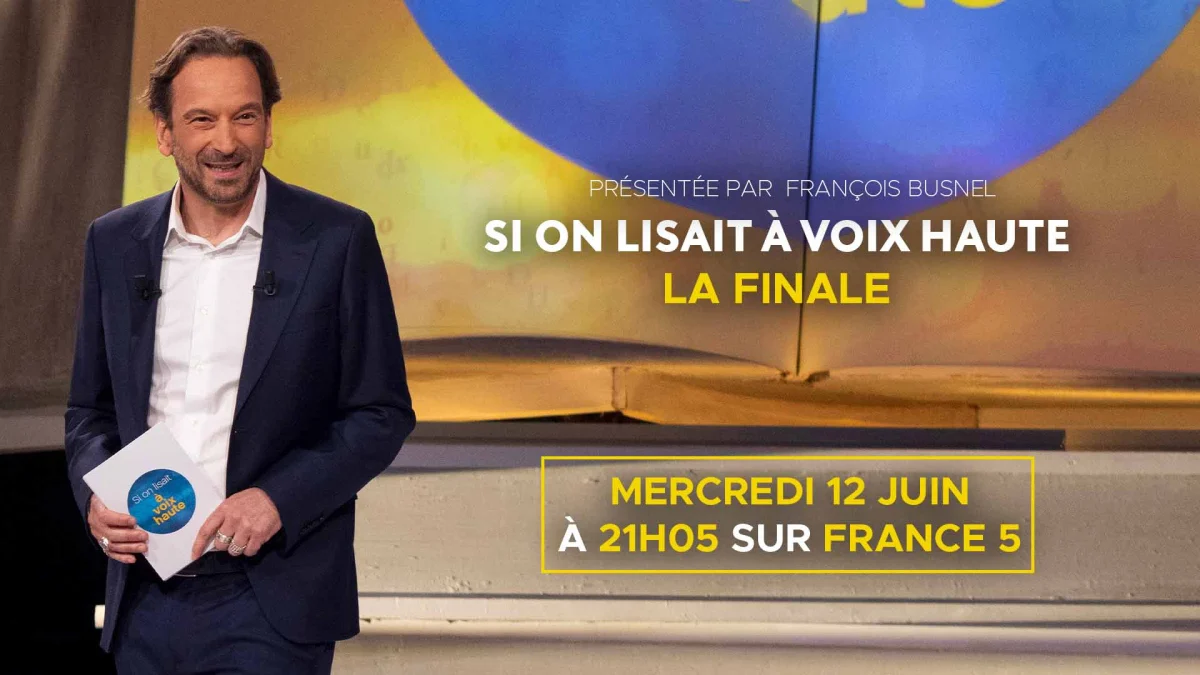


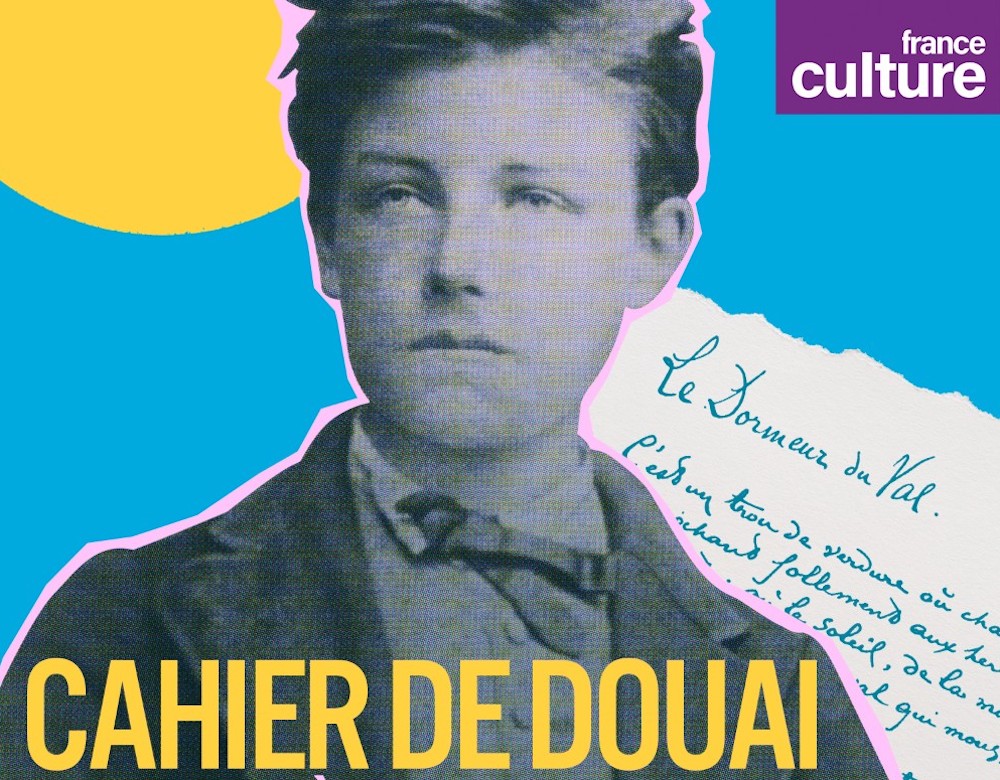



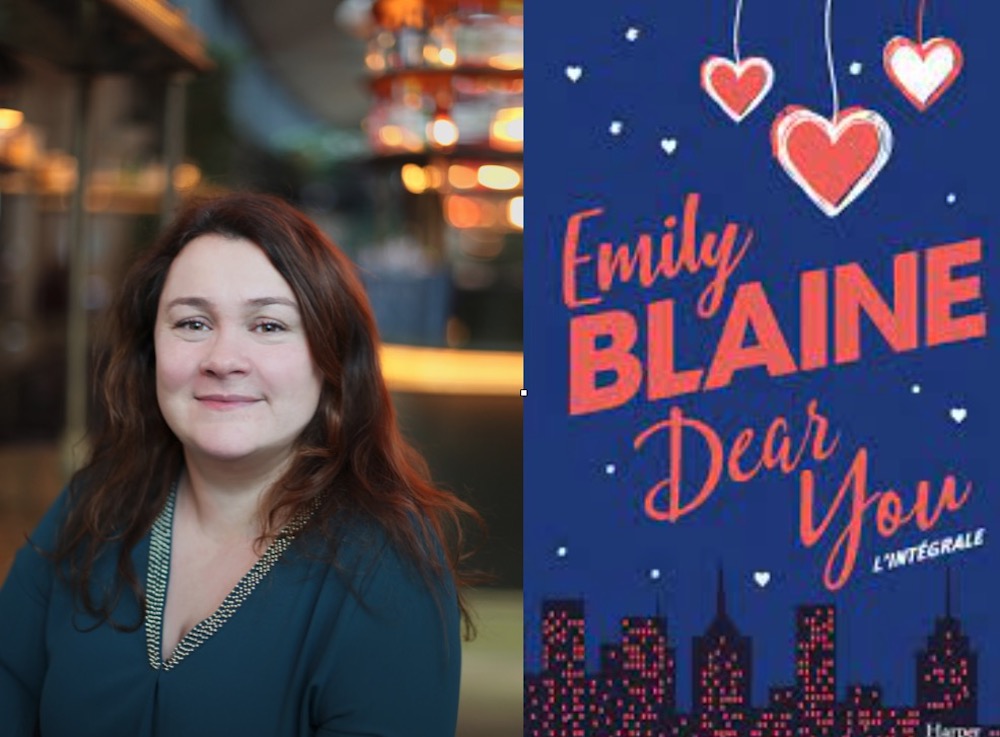








1 Commentaire
Urlène Sapin
28/02/2020 à 15:04
Étant auteur professionnel (je ne vis que de mon clavier), j'ai adhéré il y a quelques années à la SGDL, comme j'adhère à d'autres organisations professionnelles. C'était juste avant la mise en place du dispositif ReLire (https://fr.wikipedia.org/wiki/ReLIRE), auquel la SGDL s'est déclarée favorable alors qu'il s'agissait d'une spoliation des auteurs qu'elle est censée défendre.
Je n'ai rien dit, je n'ai pas rendu ma carte, mais je n'ai pas renouvelé mon adhésion l'année suivante. Ni jamais depuis.
Le temps passe, je me dis que peut-être la SGDL a changé, qu'il faudrait éventuellement envisager d'y réadhérer...
Une chose est sûre, ce ne sera pas tant que M. Simonet en sera président. Sa précédente tribune (voir le lien "L’avenir de l’auteur : animateur socio-culturel ?" fourni dans l'article) était déjà assez agaçante, il n'a apparemment absolument rien appris de ses erreurs en un mois, mais là, c'est le pompon, il s'agit même de malhonnêteté intellectuelle. Ou de stupidité...