Oeuvres indisponibles : le consentement implicite de l'auteur est envisageable
Deux réponses de la Cour dans l’affaire ReLIRE n’ont pas manqué d’attirer l’attention. D’abord, parce qu’elles étaient glissés presque en toute discrétion par la Cour de Justice dans son arrêt. Ensuite, parce qu’elles déroulent le tapis rouge à un programme de numérisation patrimonial, tel que l’envisage la Commission européenne dans sa réforme du droit d'auteur...
Le 16/11/2016 à 18:16 par Nicolas Gary
Publié le :
16/11/2016 à 18:16
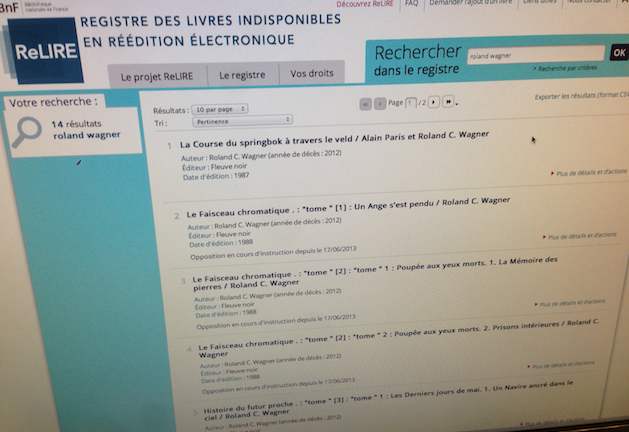
C’était bien tout le fond de l’inquiétude formulée par le Syndicat national de l’édition, début octobre : la réforme du droit d’auteur prévue par la Commission européenne « ne permet pas de légitimer le système français ». Dans les faits, le système de gestion collective est applicable, selon le projet de réforme – aussi la Sofia conserverait sa place. En revanche, seules les bibliothèques sont éligibles pour demander les licences d’exploitations. La société privée FeniXX qui en France gère la numérisation des œuvres indisponibles serait donc exclue, ipso facto. La société commerciale BnF Partenariat pourrait toutefois être dans les clous, sur le principe.
Autrement dit, avant même que la CJUE ne rende son arrêt, le SNE avait conscience que ReLIRE, le modèle de numérisation des œuvres indisponibles, ne passerait pas.
C’est d'ailleurs bien une très probable porte ouverte à la Commission que l’on retrouve dans la réponse 35 de la Cour :
Cela étant, l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l’exprimer de manière implicite.
Et un peu plus développé dans le suivant :
Ainsi, dans une affaire où elle était interrogée au sujet de la notion de « public nouveau », la Cour a estimé que, dans une situation où un auteur avait autorisé, de façon préalable, explicite et dépourvue de réserves, la publication de ses articles sur le site Internet d’un éditeur de presse, sans recourir par ailleurs à des mesures techniques limitant l’accès à ces œuvres à partir d’autres sites Internet, cet auteur pouvait être regardé, en substance, comme ayant autorisé la communication desdites œuvres à l’ensemble des internautes (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Svensson e.a., C‑466/12, EU:C:2014:76, points 25 à 28 et 31).
Préserver le patrimoine avec une exception européenne
Rappelons en effet que, dans le projet de réforme présenté le 14 septembre dernier, la Commission européenne ouvrait grande la porte à une numérisation patrimoniale. Elle évoquait en effet « une nouvelle exception européenne obligatoire afin de permettre aux institutions de gestion du patrimoine culturel de conserver des œuvres sous forme numérique, ce qui est essentiel pour assurer la survie du patrimoine culturel et permettre aux Européens d’en profiter durablement ».
Il s’agirait alors d’une solution juridique permettant de simplifier les accords de licence – chose qui avait provoqué une levée de boucliers de la part d’Henrique Mota, président de la Fédération des éditeurs européens. Simplement, parce que le modèle d’opt-out était pleinement validé. Et si l’on poursuit la réflexion, en se référant à la réponse 37, la boucle est bouclée :
Toutefois, l’objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la directive 2001/29 implique que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur.
Cet adverbe, "strictement" ne laisse par ailleurs planer aucun doute sur la démarche à adopter pour obtenir cet accord implicite. D’ailleurs, l’administration française a adopté en novembre 2014 un principe similaire par le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014. Dans les textes de loi, il est expliqué que pour toute demande faite, « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ».
@ActuaLitte Le "strictement" veut dire : à condition que l'auteur ait reçu une information individualisée. Donc c'est bien admis par la Cour
— S.I.Lex (@Calimaq) 16 novembre 2016
Ce qui manquait à ReLIRE, l’information correcte des auteurs, parce qu’« à défaut de garanties assurant l’information effective des auteurs quant à l’utilisation envisagée de leurs œuvres et aux moyens mis à leur disposition en vue de l’interdire, il leur est de facto impossible d’adopter une prise de position quelconque quant à une telle utilisation ».
François Gèze, membre du comité scientifique de ReLIRE, l’avait d’ailleurs clairement souligné : cette information personnalisée n’est pas envisageable. « C’est un problème politique. Techniquement, il n’est pas possible de disposer d’un nombre significatif d’ayants droit pour procéder à la numérisation patrimoniale, si l’on passe par un versement volontaire des œuvres. Il faudrait des centaines d’années pour renégocier tous les contrats, un par un, du corpus du projet français des indisponibles. Autant dire que tout projet de numérisation de masse serait condamné. »
Quand l'Europe pousse le bouchon si loin que...
@LaurentSoual@ActuaLitte En fait, la décision CJUE est bien plus ouverte que la décision US sur le règlement Google Books. Dingue...
— S.I.Lex (@Calimaq) 16 novembre 2016
En effet, si l’on revient dans le temps, à l’époque où les éditeurs et Google Books tentaient de trouver un accord, la proposition des deux parties avait été rejetée par le juge Denny Chin en mars 2011. Ce dernier avait estimé que, dans le cadre de la commercialisation de fichiers, il n’était pas possible d’invoquer le Fair Use pour renverser le principe de consentement préalable des auteurs.
Or, la CJUE dit bien que le consentement implicite est possible, à la condition expresse que l’information ait été portée individuellement et de façon personnalisée à l’auteur. Cela introduirait une modification profonde dans le principe de ReLIRE puisque ce dernier ne prend pas le temps d’alerter les auteurs ou ayants droit de façon directe, considérant le principe de l’opt-out.
La Commission européenne ouvertement contre ReLIRE
Bien évidemment, une pareille démarche implique d’avoir les moyens, mais cette histoire de consentement implicite, en pratique, bouleverse le modèle admis. Ainsi que le principe même du droit d’auteur. ReLIRE serait alors contraint de revenir à un modèle de petite échelle, contraire même à son ADN...
Notons, à toutes fins utiles, que dans le cas de l’affaire portée devant la CJUE, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne, en tant qu’États membres, avaient tenu à soumettre des observations écrites. La Commission européenne était également intervenue, pour marquer son opposition à la réglementation française du 1er mars 2012.
Selon elle, les dispositions des articles 2 et 5 de la directive 2001/29/CE s’opposent à ce que l’on « confie à des sociétés de perception et répartition des droits agrées l’exercice d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de "livres indisponibles", tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livrs de s’opposer ou de mettre fin à cet exercice », dans les conditions définies par la législation française et son décret d’application.
Pour revenir au cas français, il reviendra désormais au Conseil d’État, qui avait saisi la CJUE de prendre sa décision, en vertu de l’arrêt rendu. En cas d’interprétation contraire, « le Conseil d’État et donc la France, s’exposent à un rappel à l’ordre de la Commission européenne, garante de la bonne application des arrêts », précisait une source proche de la CJUE à ActuaLitté.
S’il n’est jamais arrivé par le passé qu’une juridiction nationale rende un avis contraire à l’arrêt de la Cour, cette dernière laisse, traditionnellement, une marge d’interprétation, « considérant qu’elle n’a pas une vision globale des juridictions nationales ». Or, reconnaît-on, dans le cas de ReLIRE, « la réglementation française est clairement contraire aux objectifs et aux principes de la directive ». Comprendre : aucune marge d’interprétation n’existe pour le Conseil d’État, même s’il a tout lieu d’apprécier l’arrêt de la Cour.

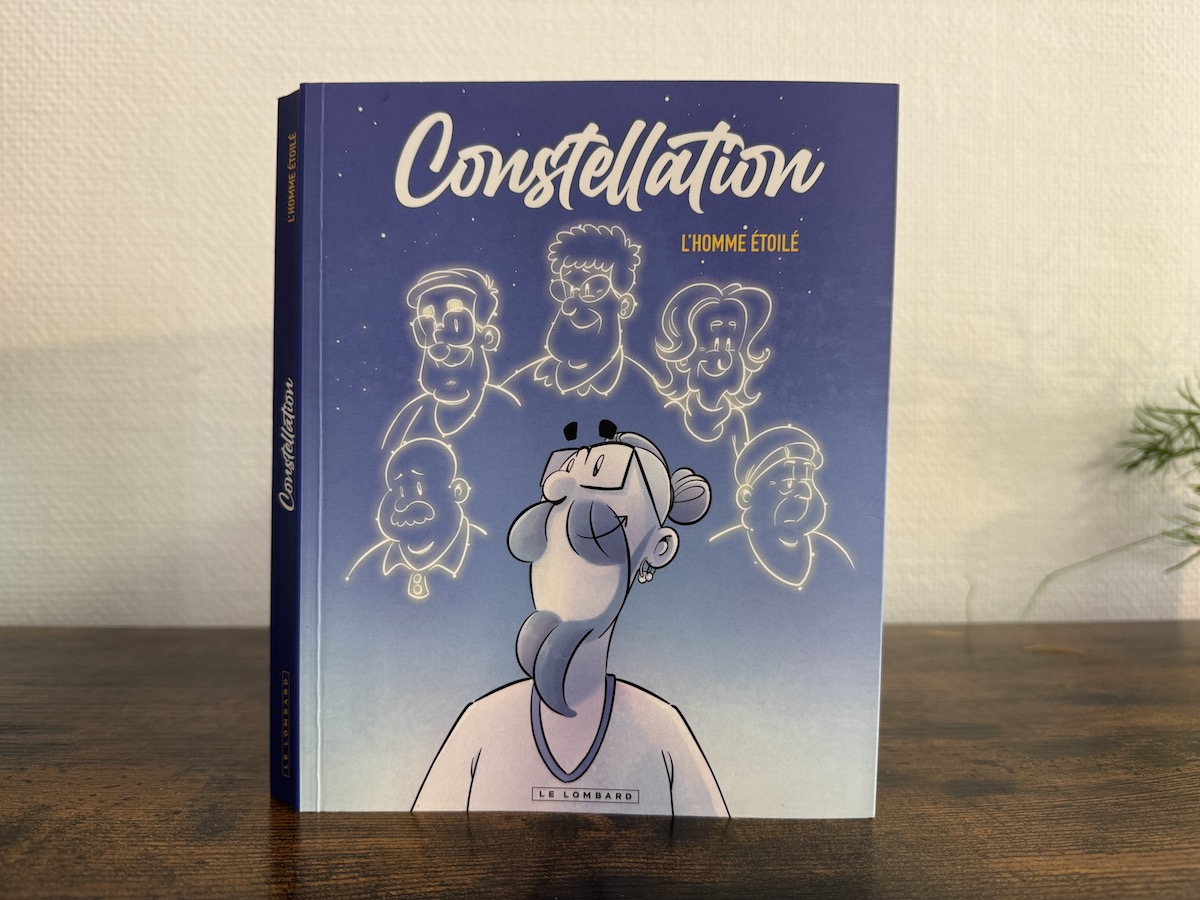
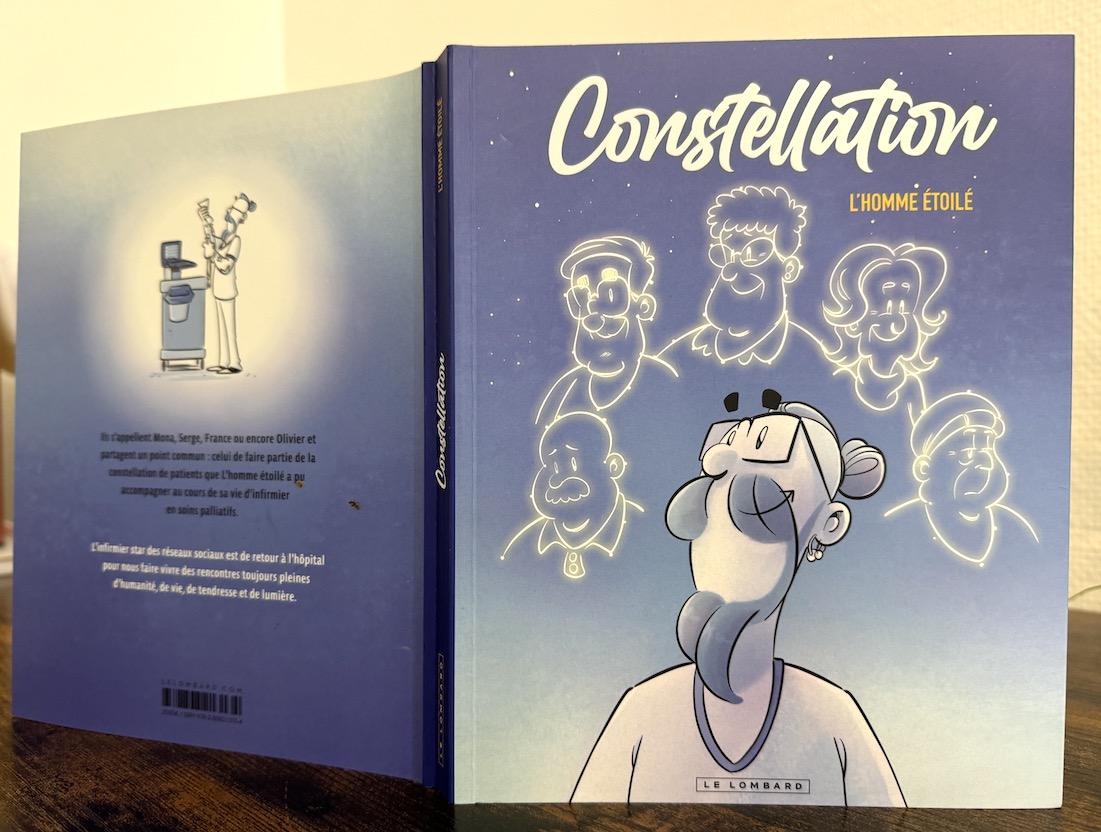

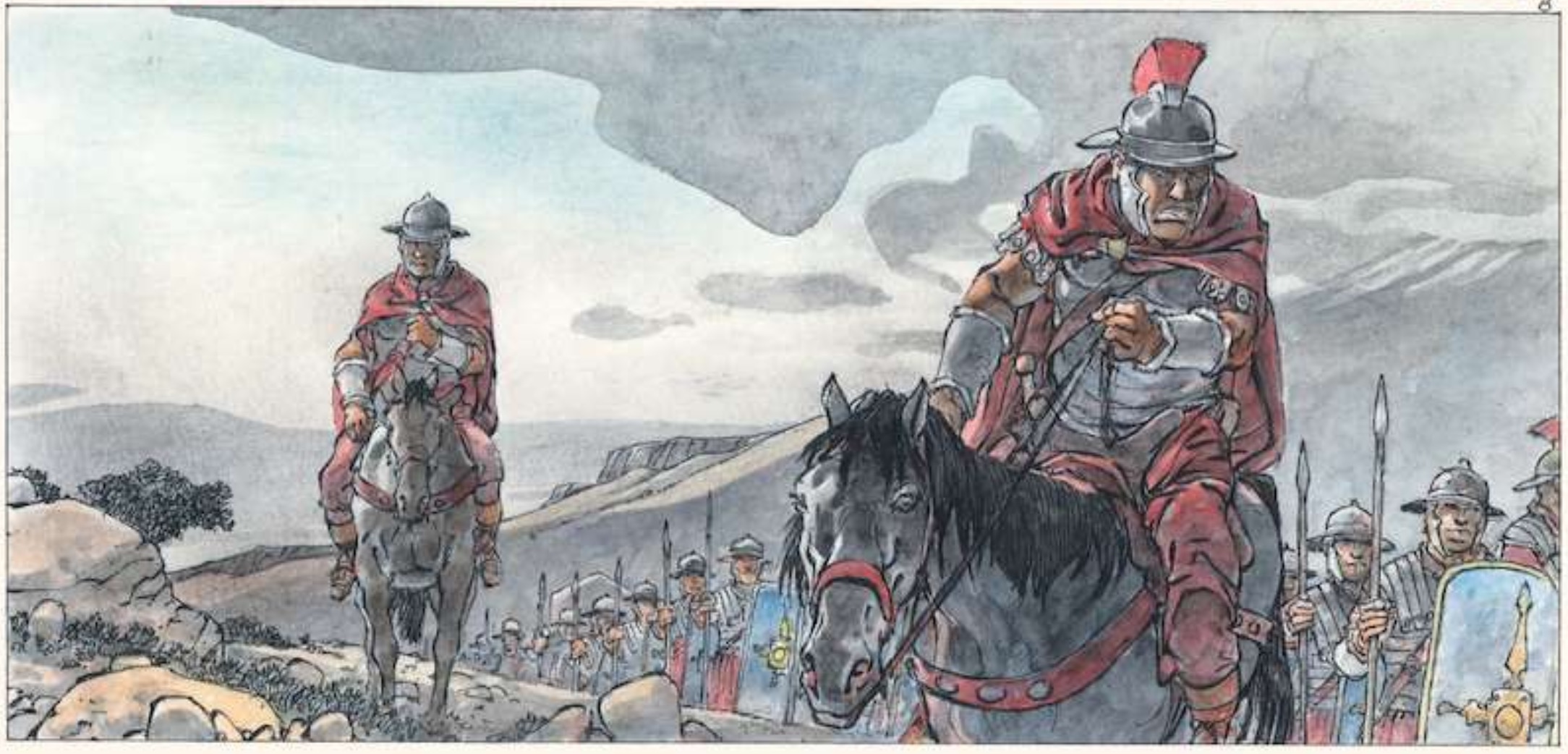

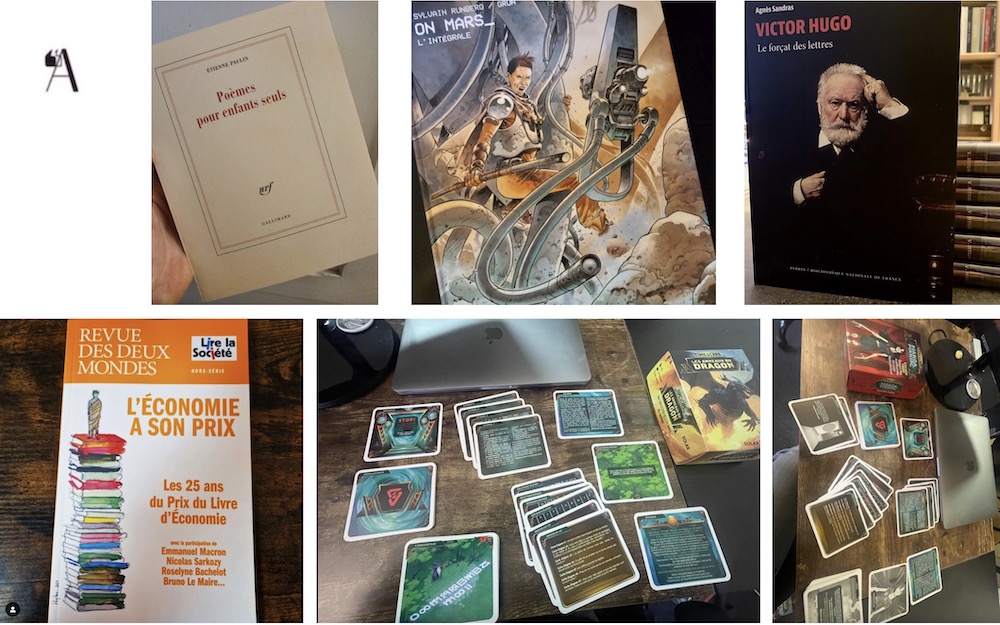

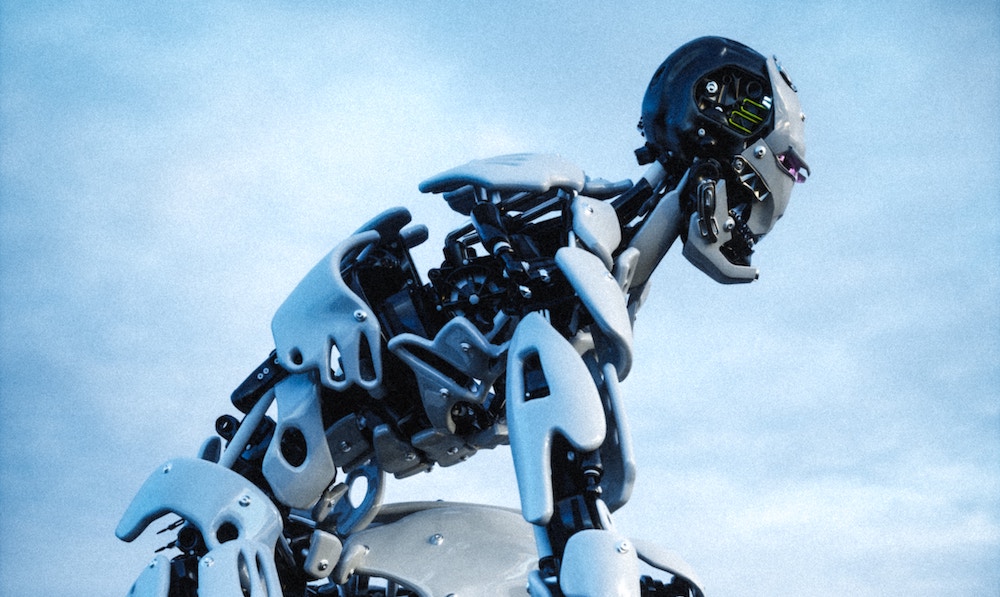
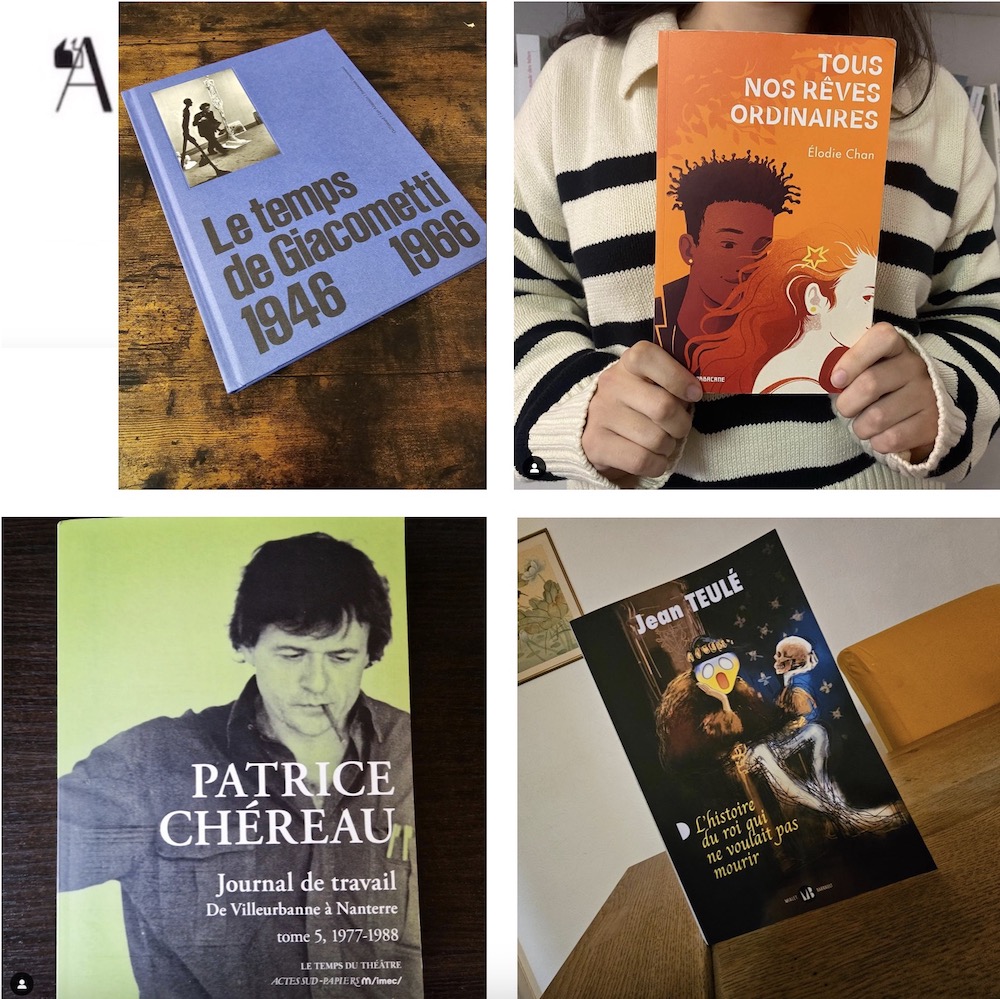


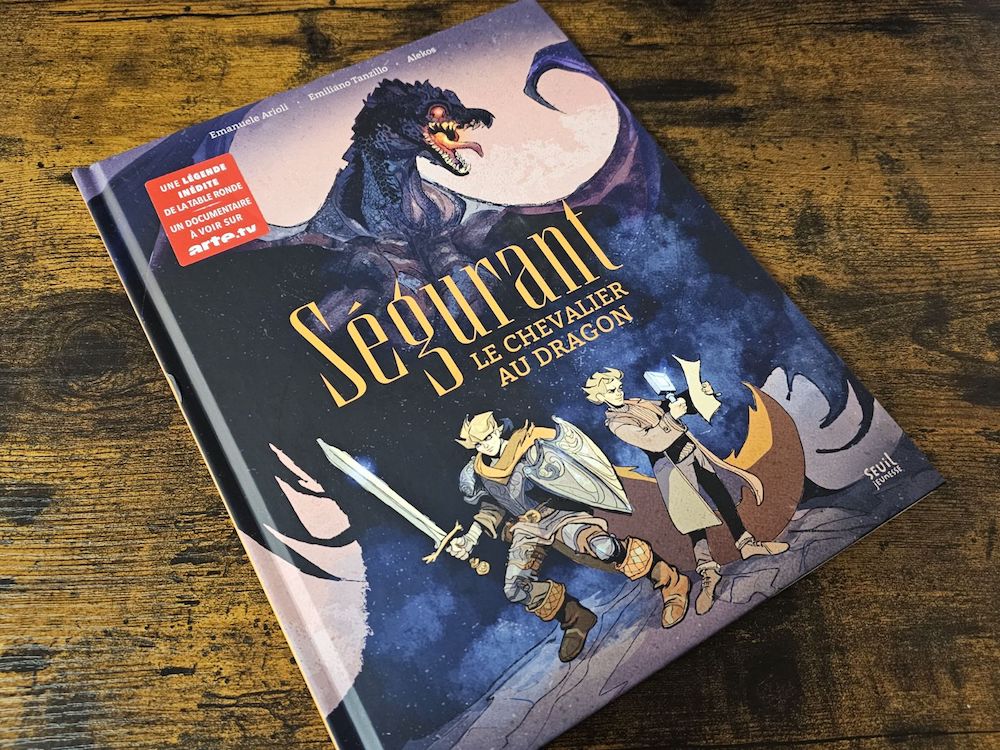
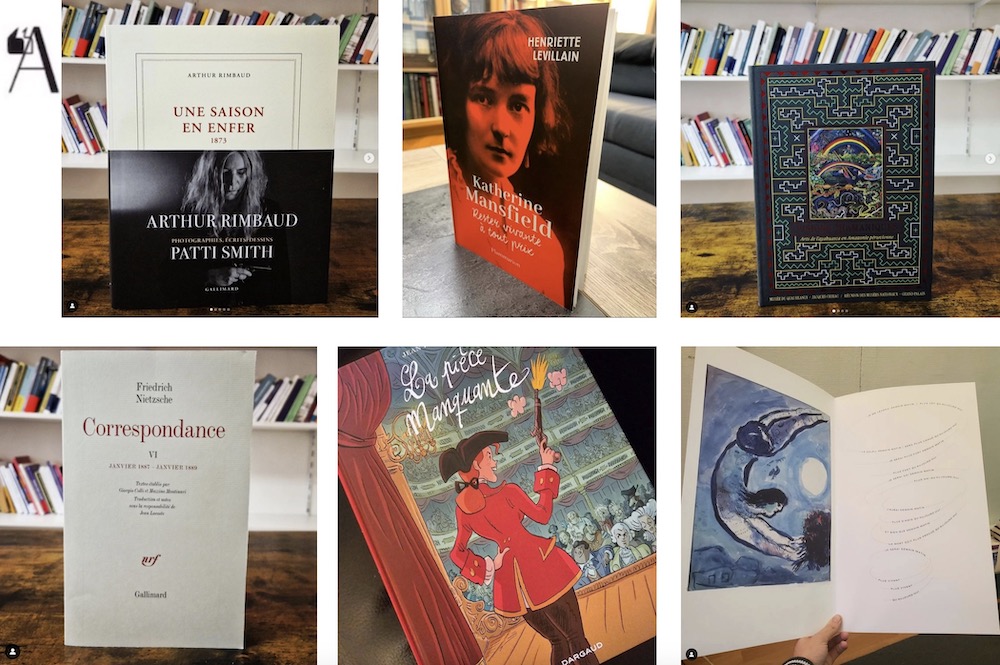
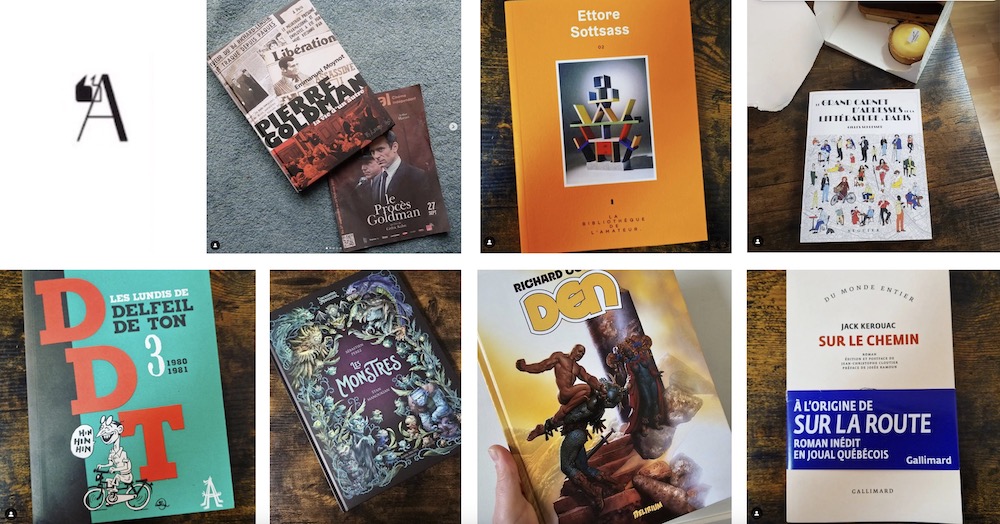
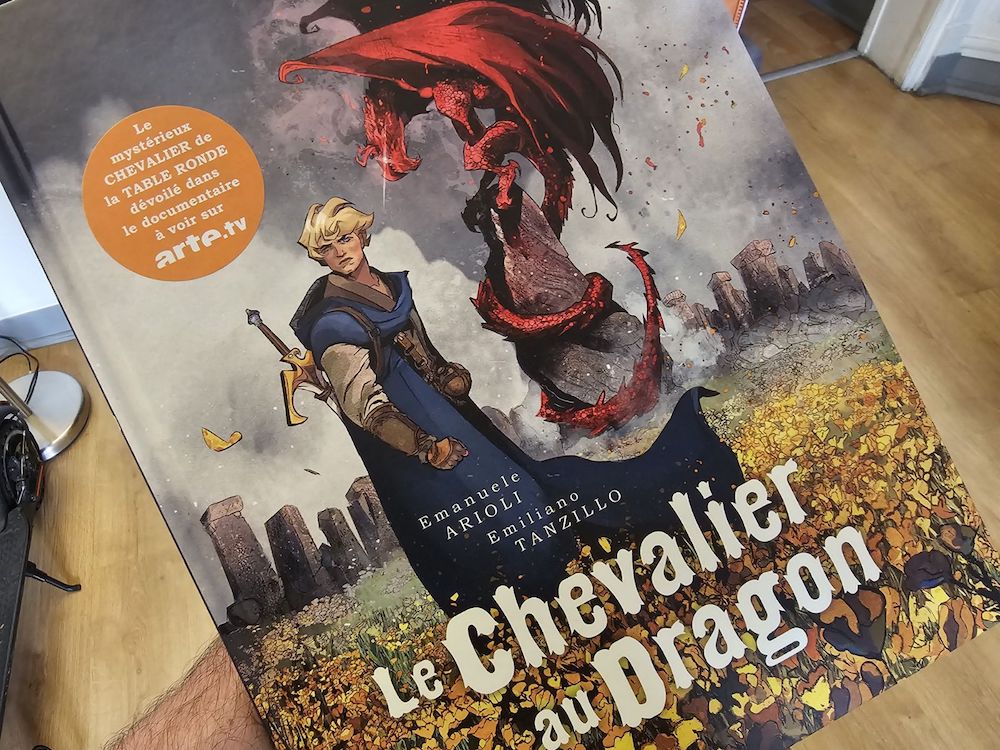
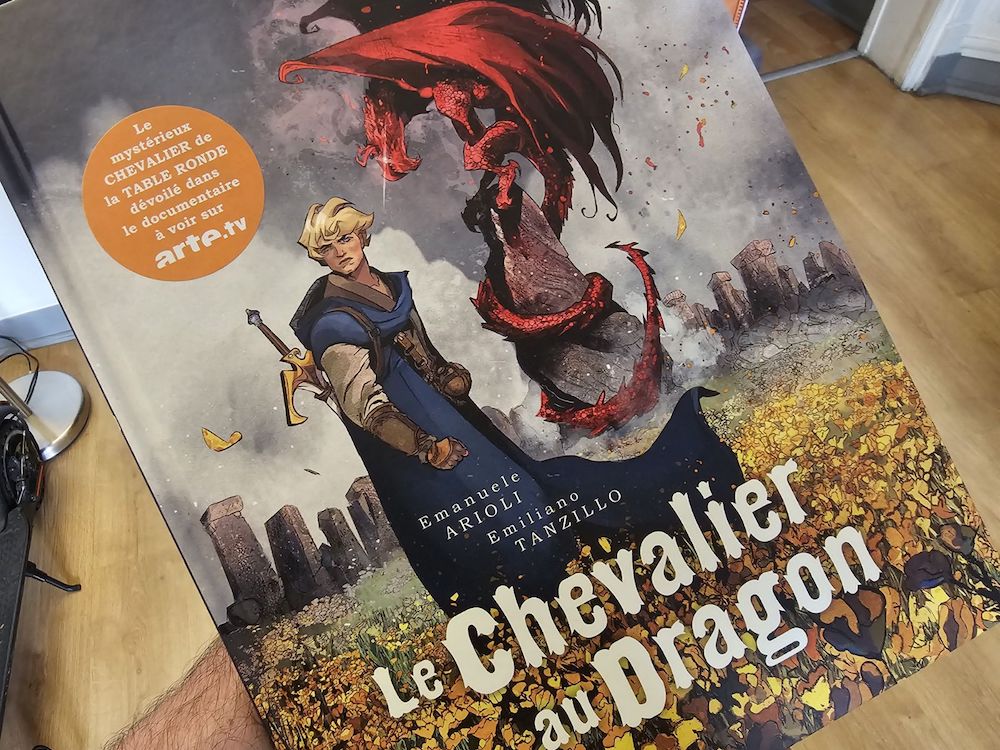
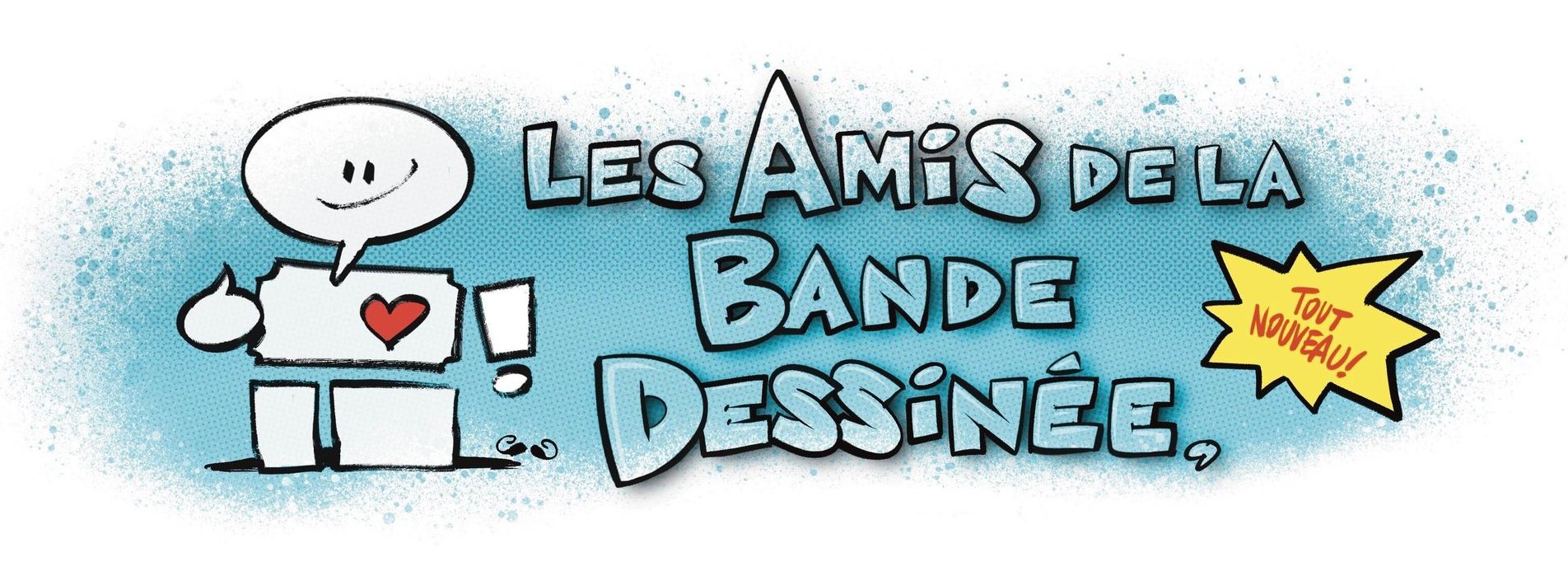
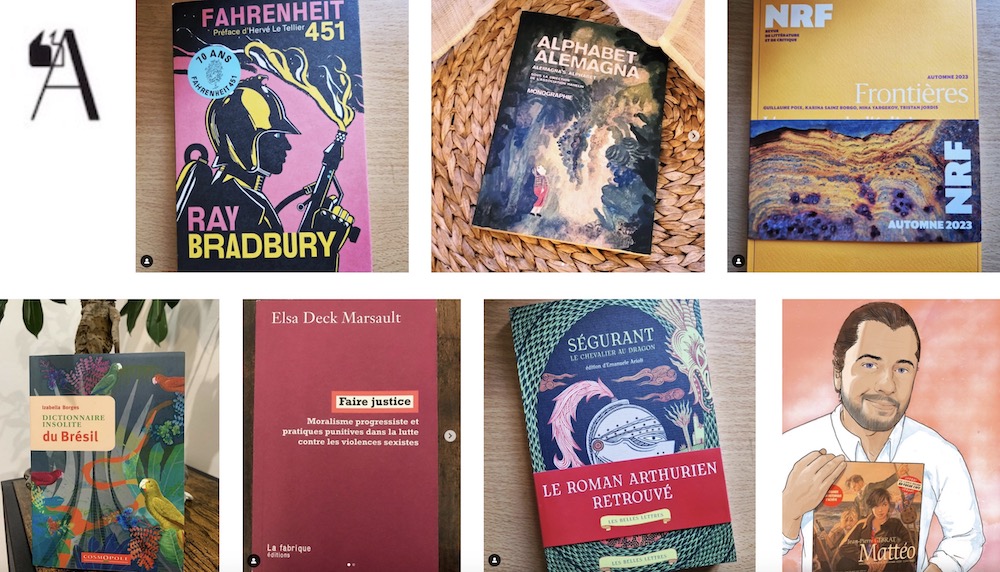
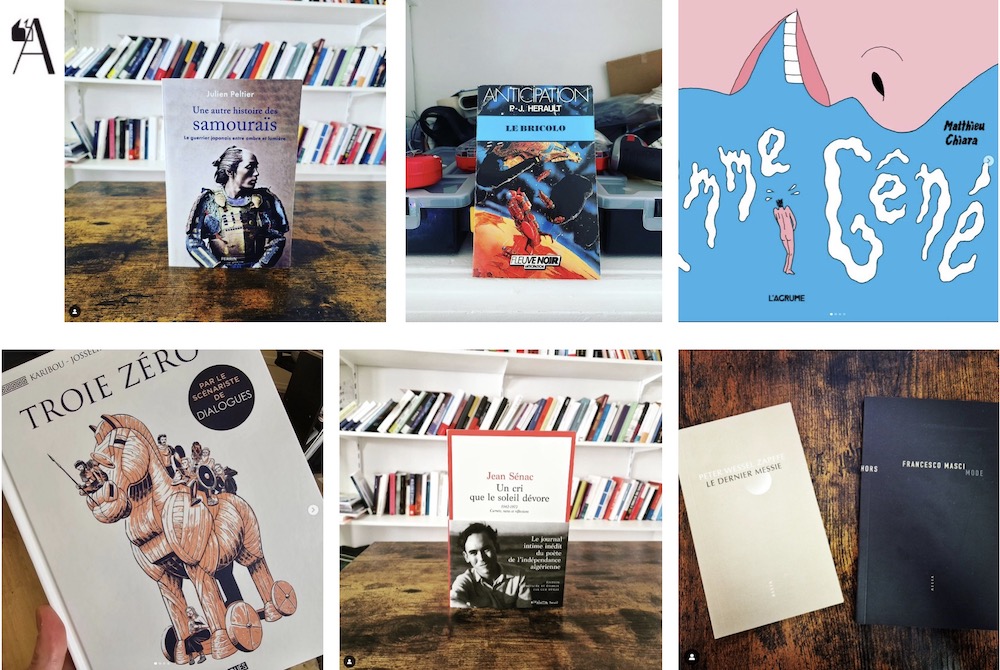
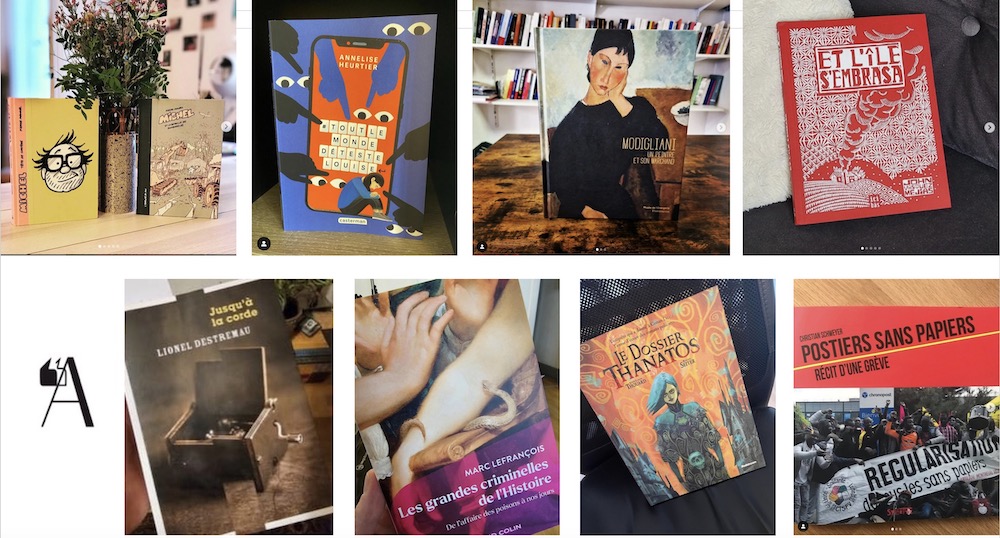
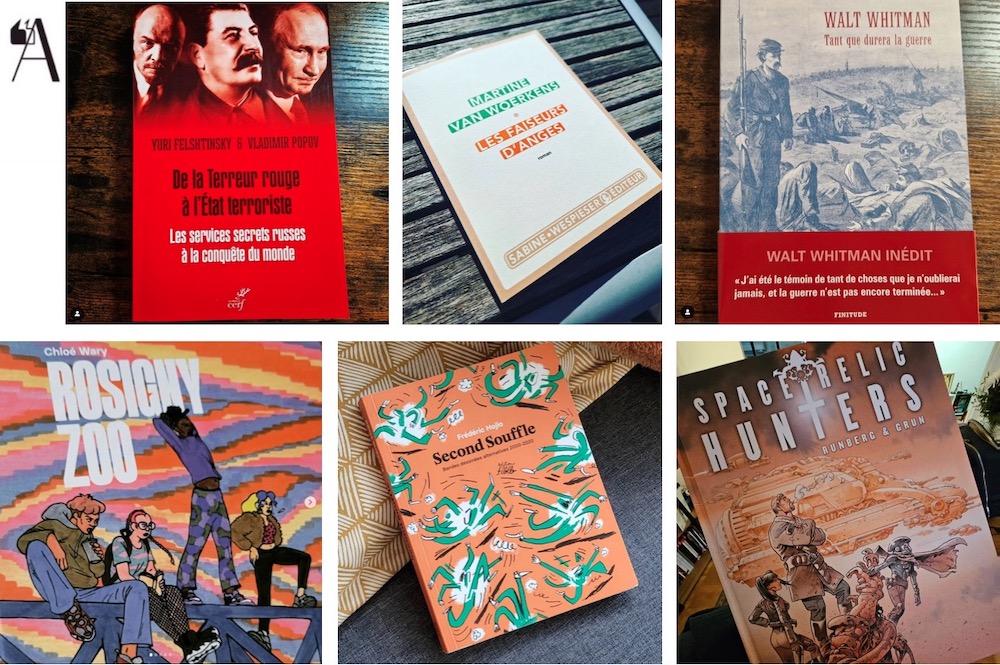
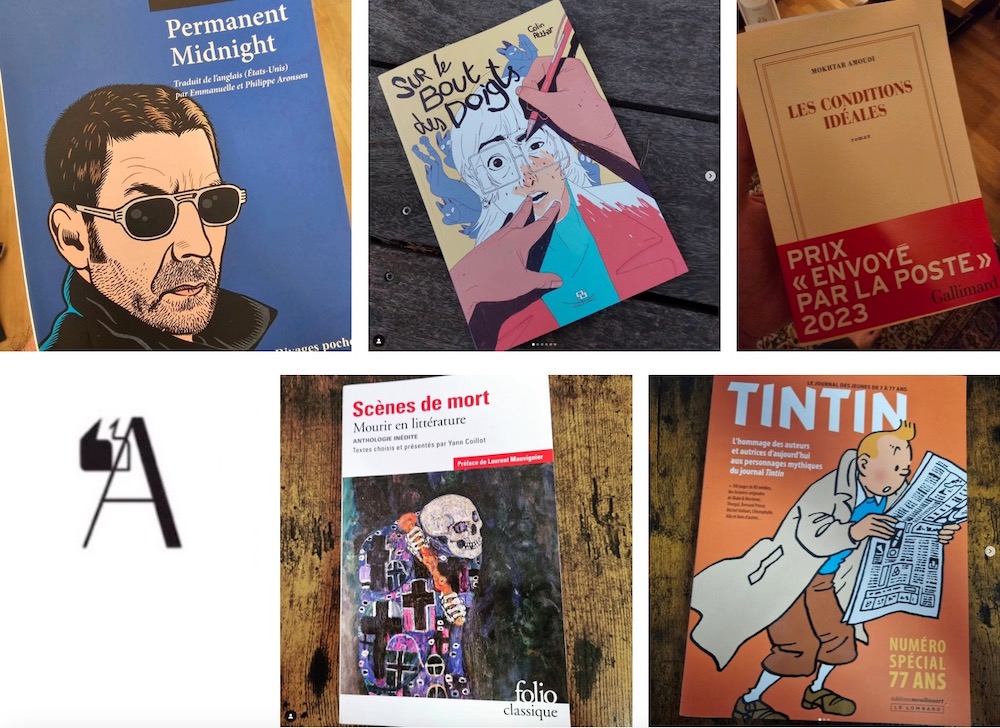
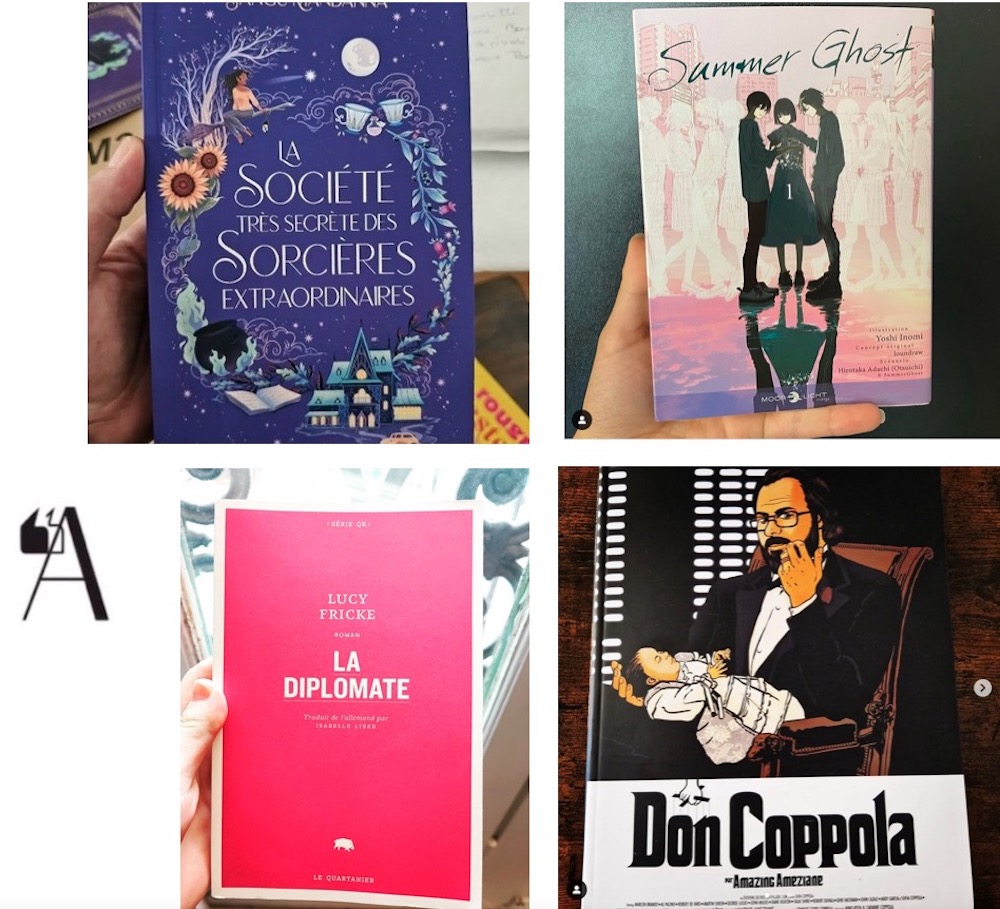
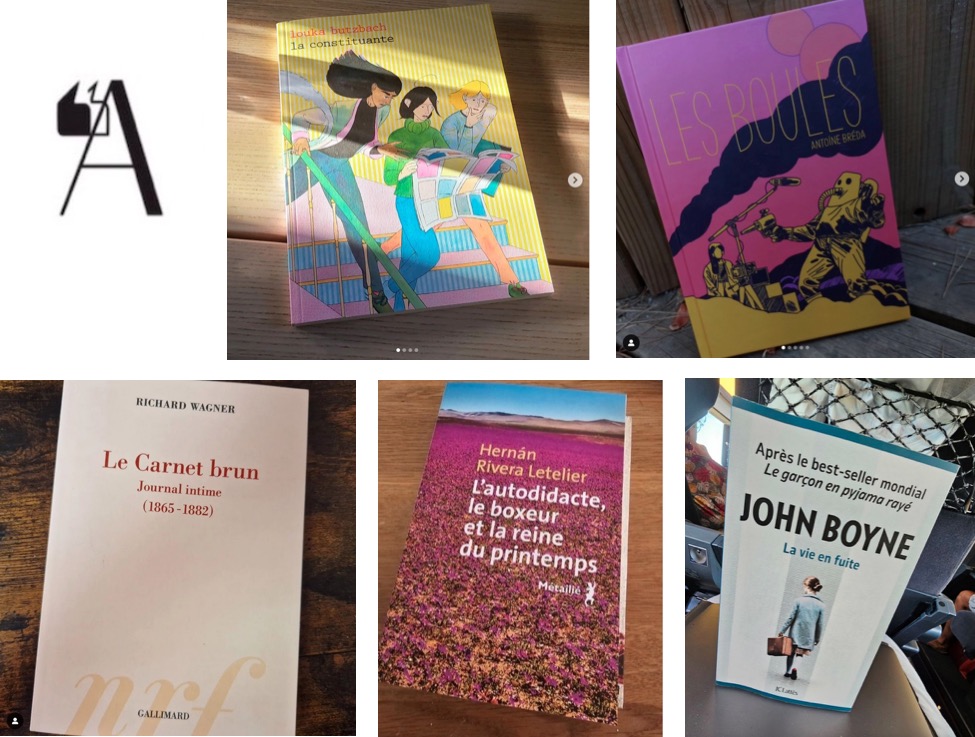
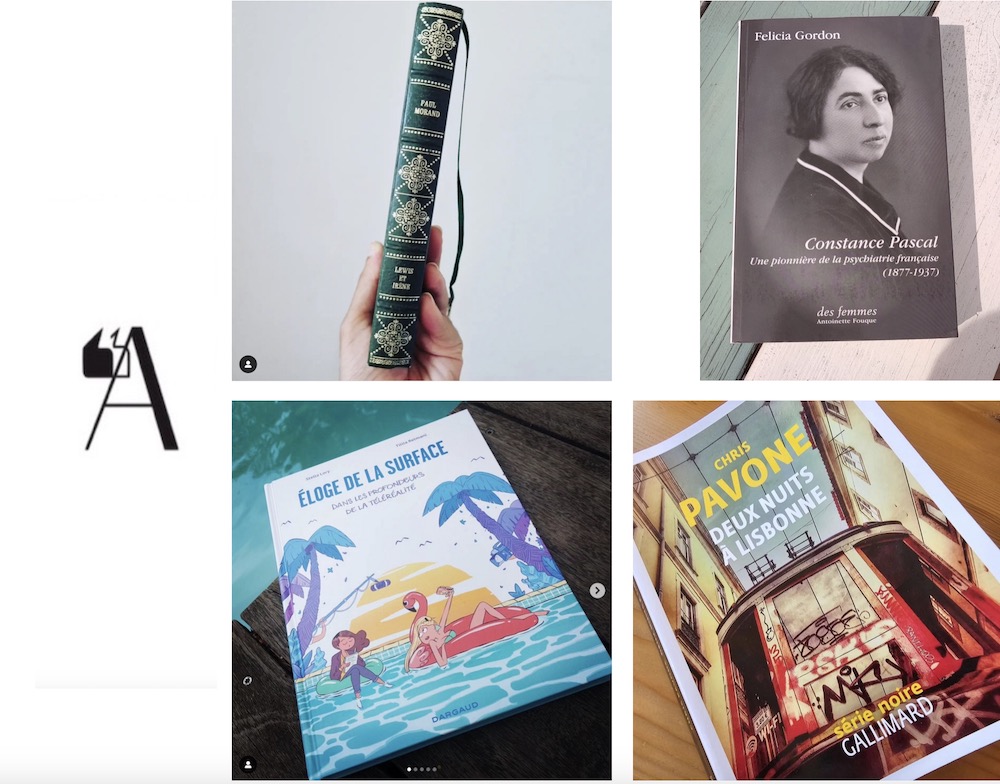
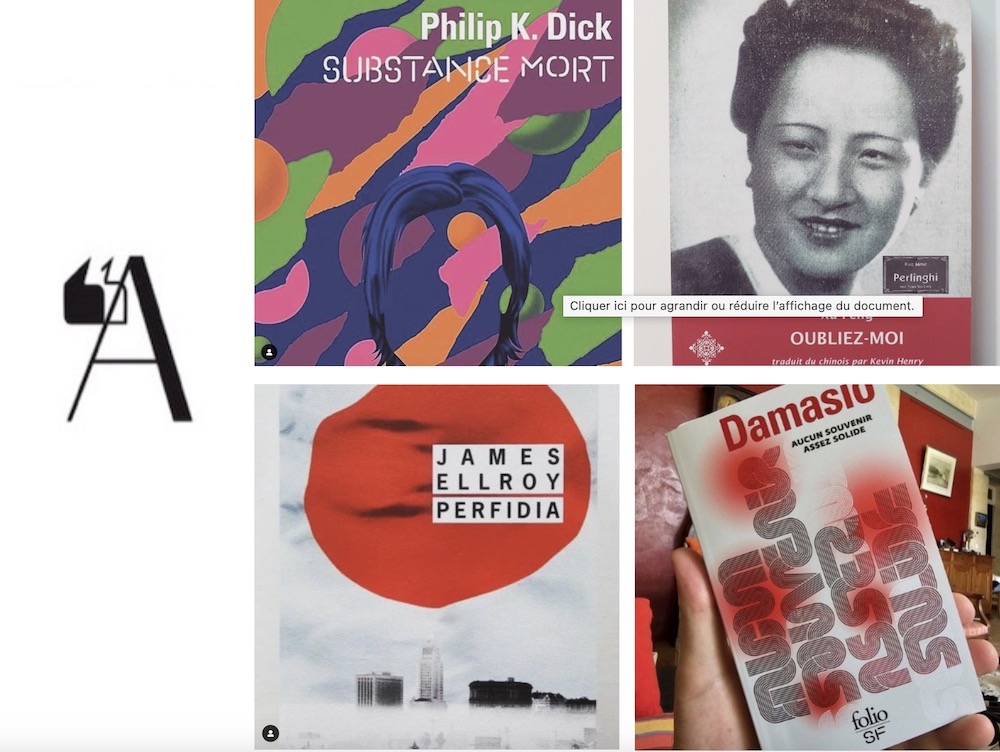

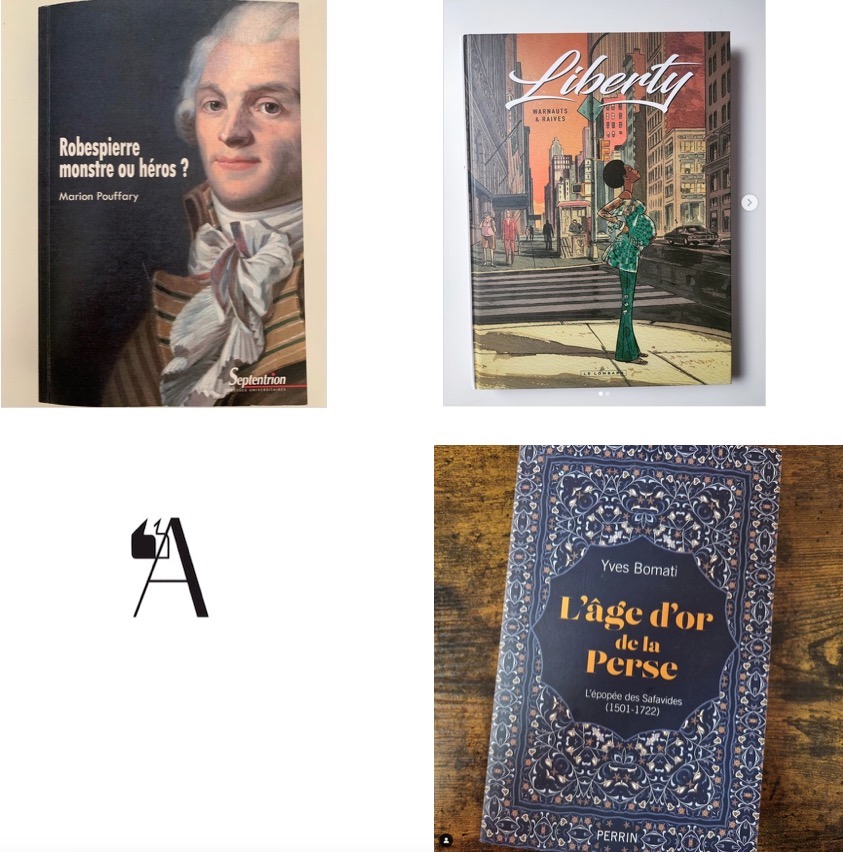
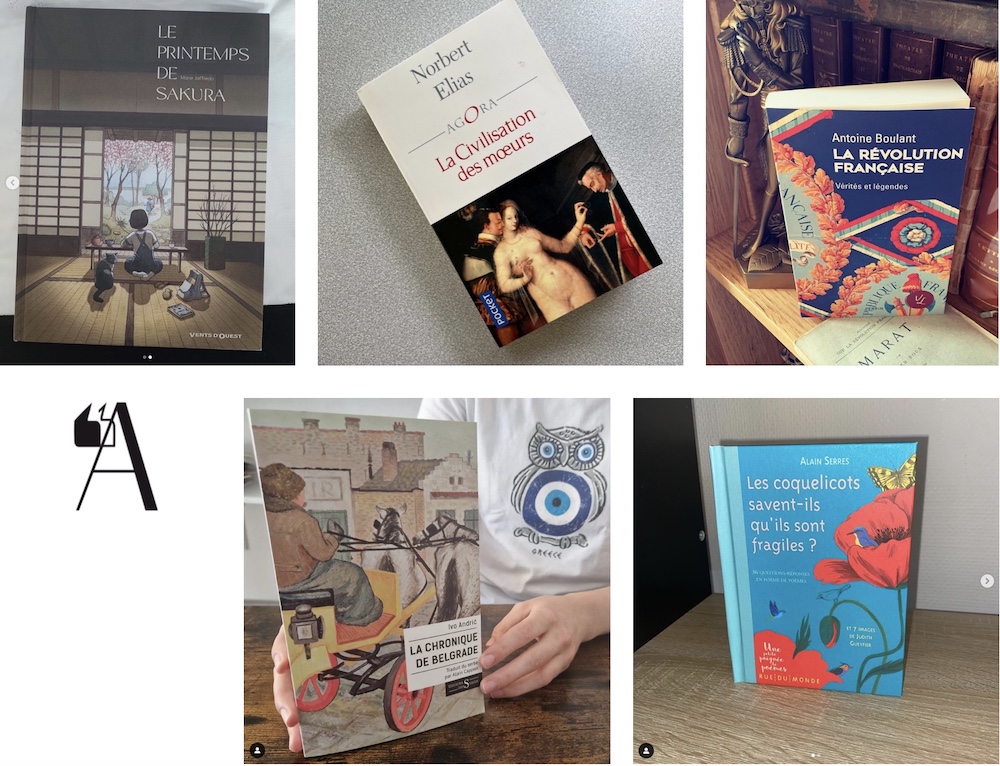
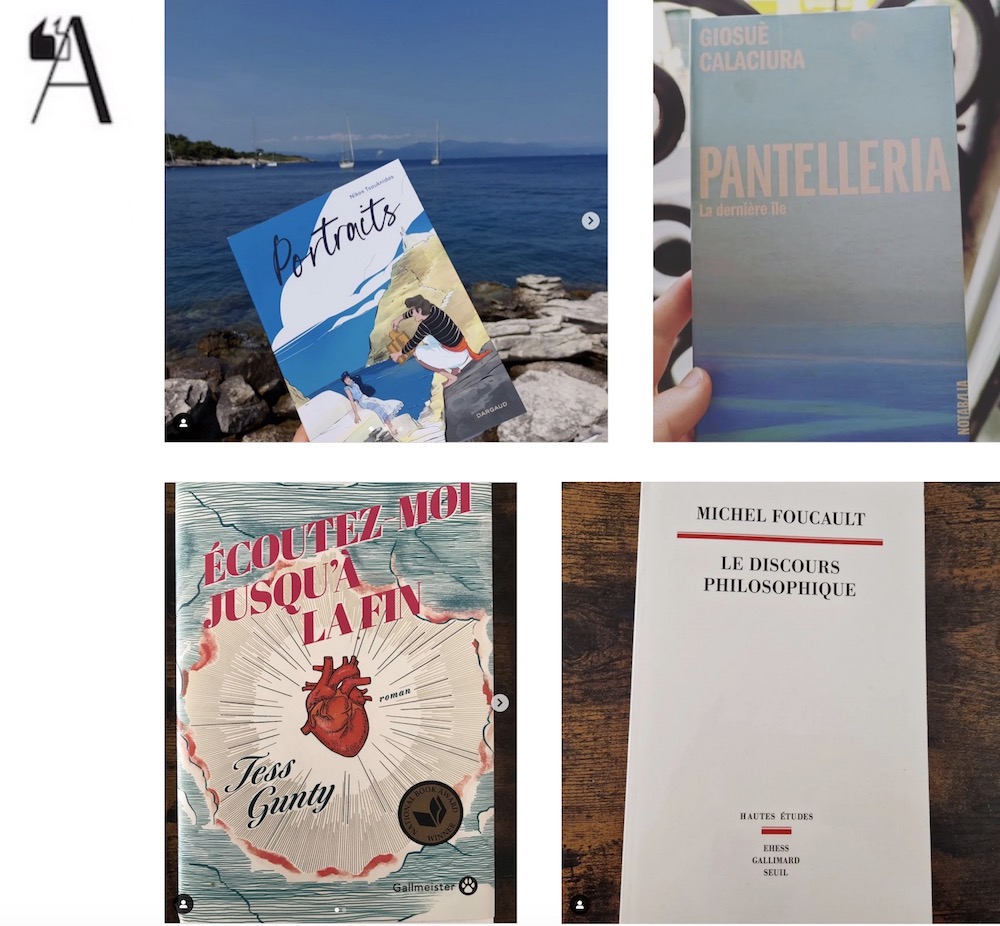




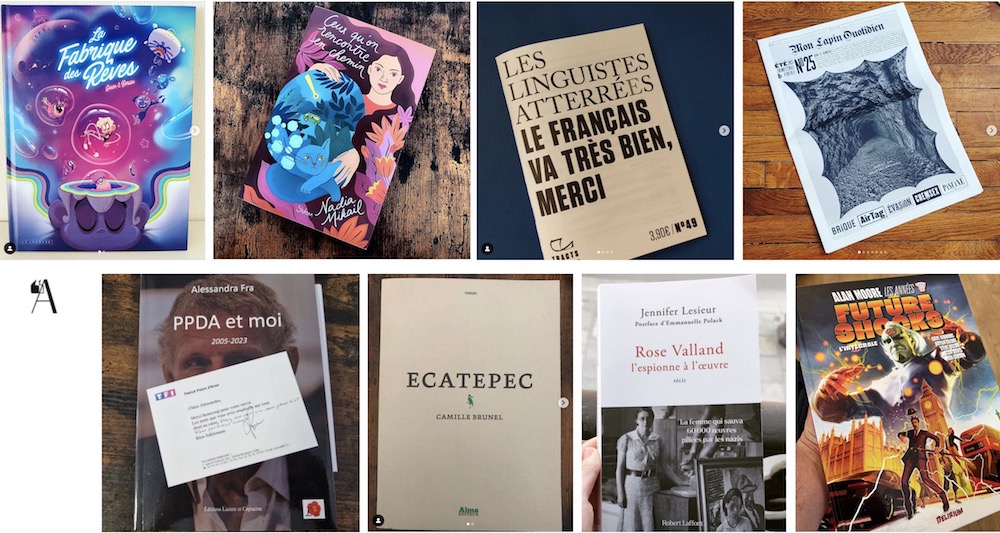

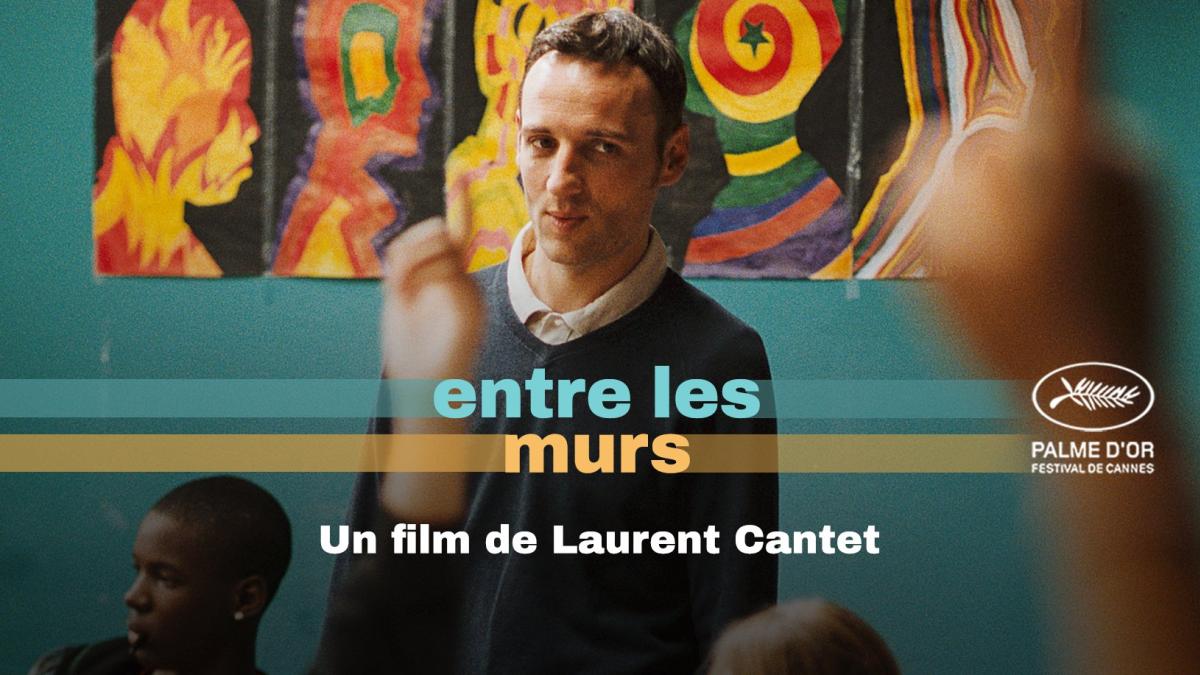

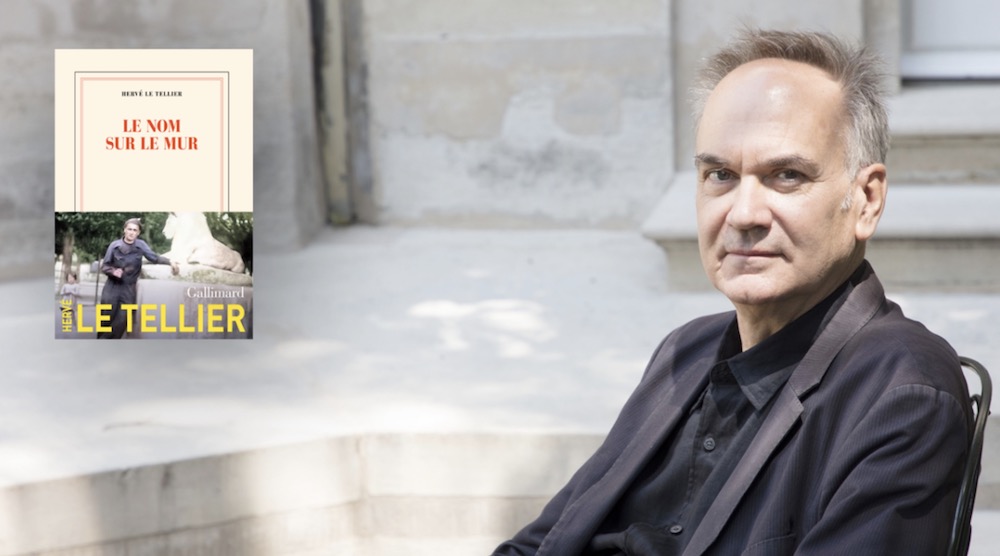





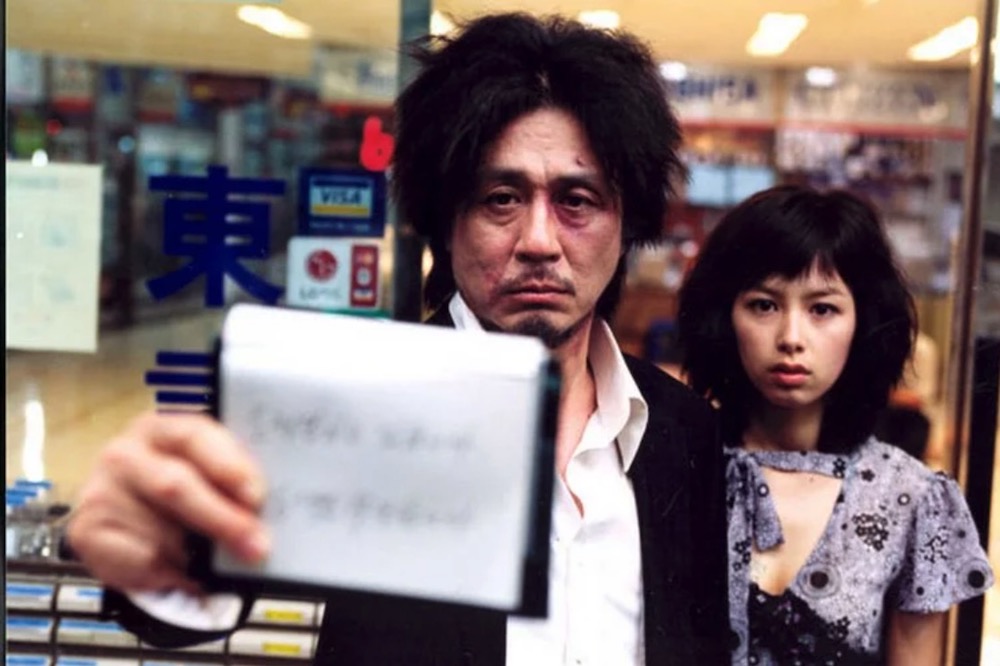

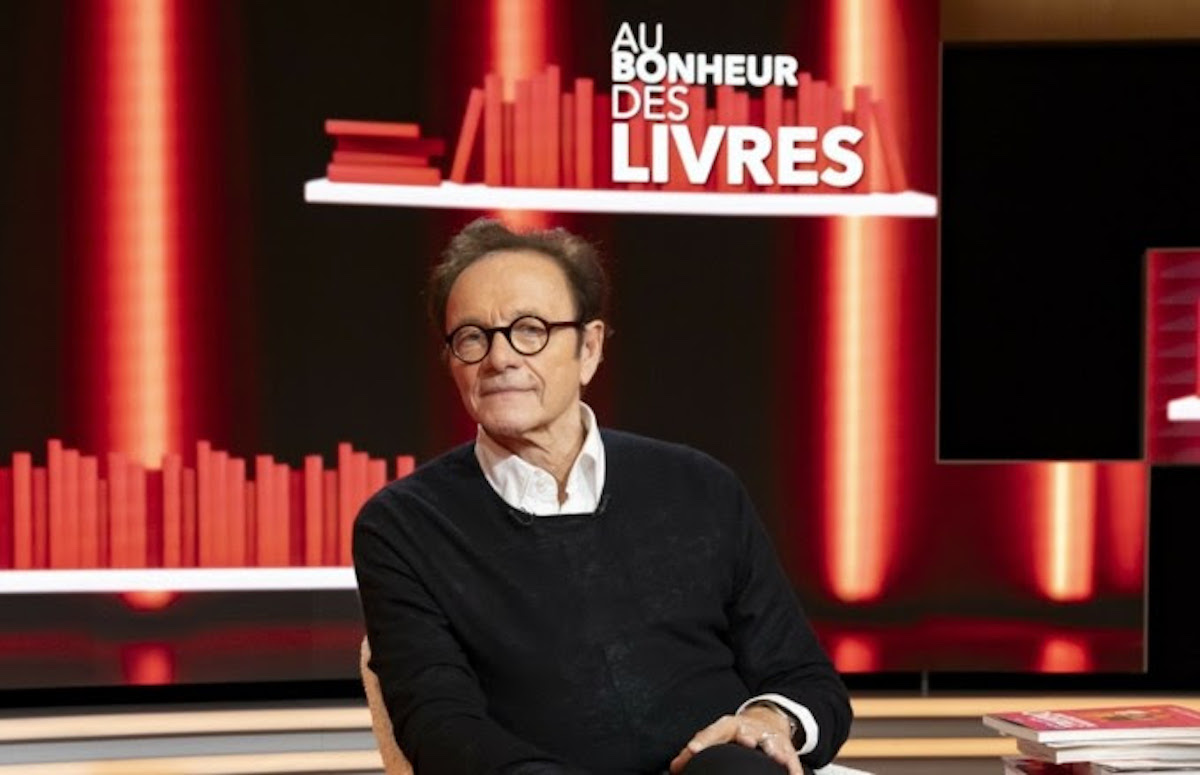





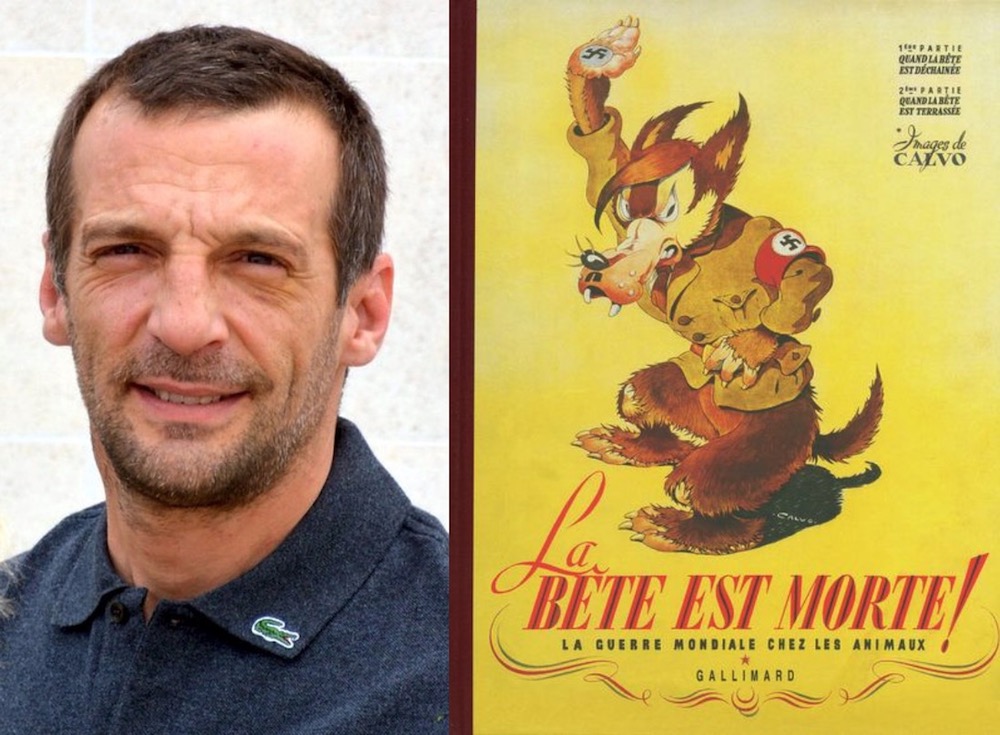




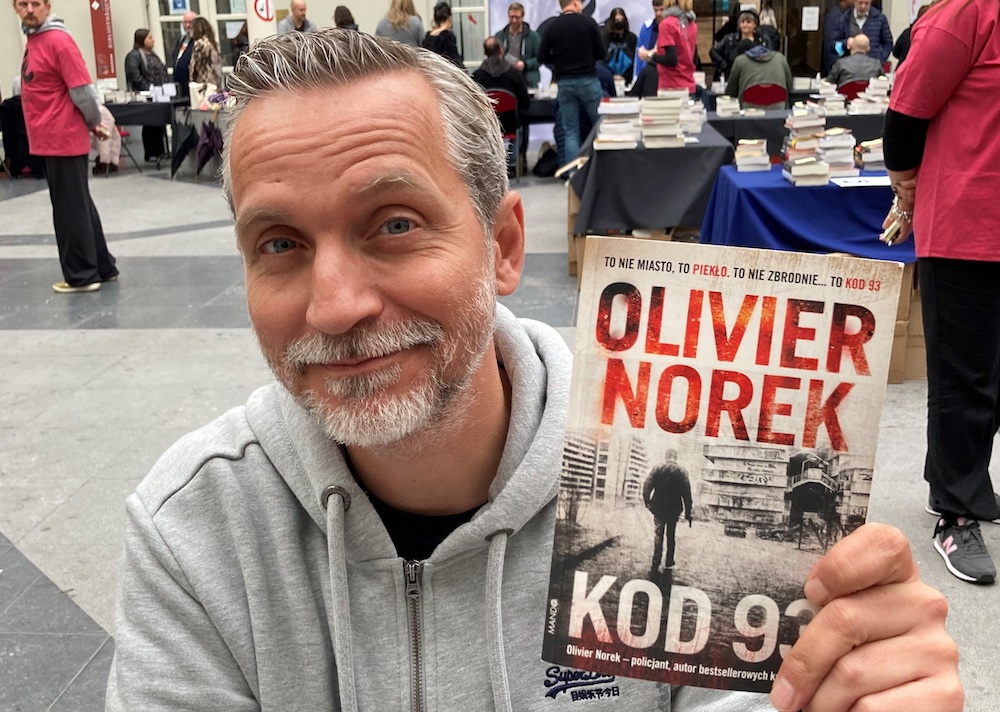
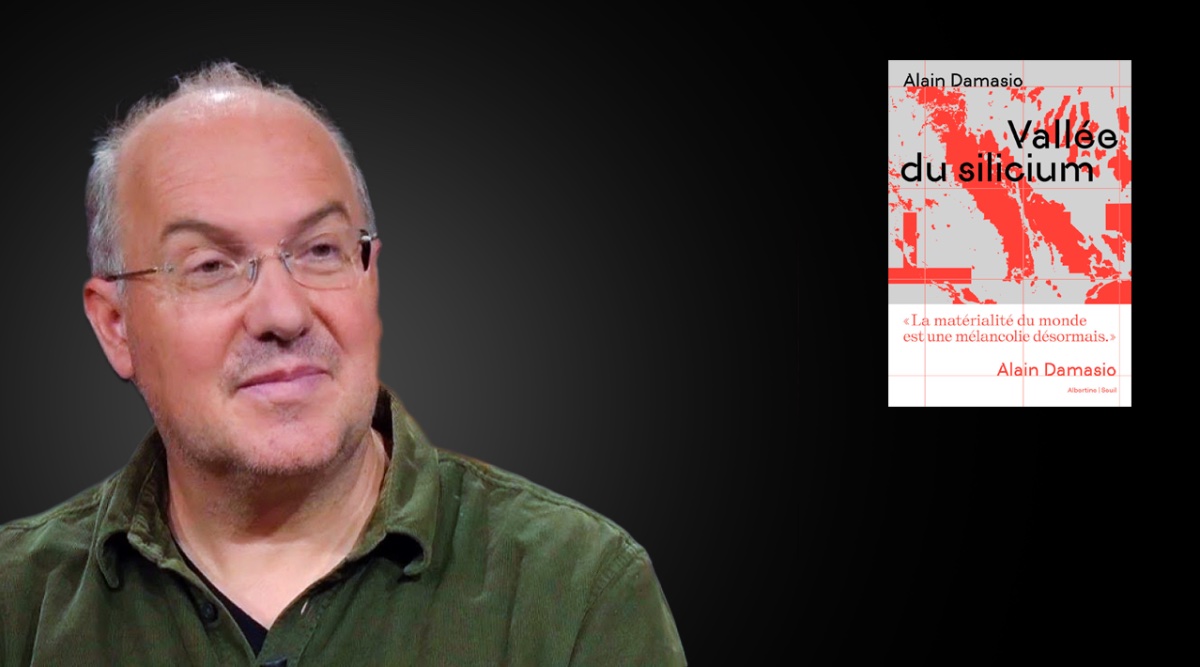

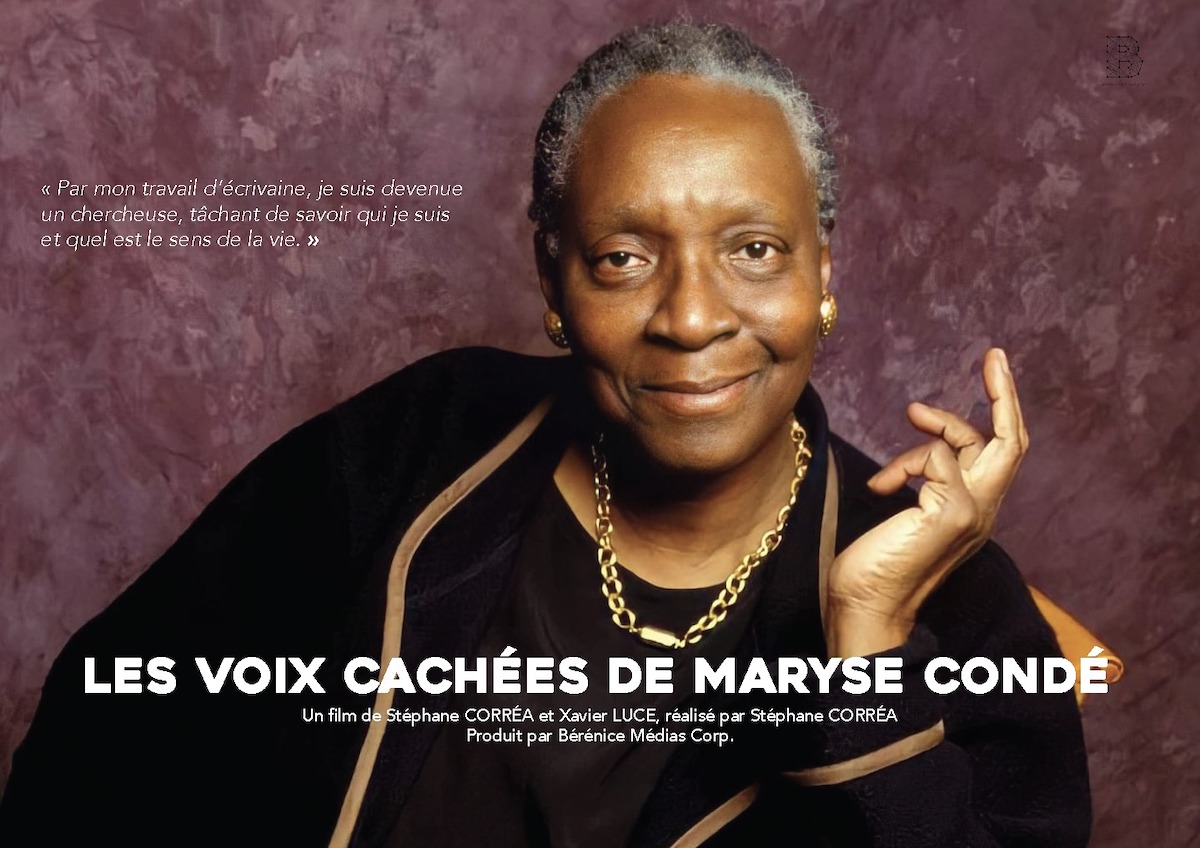

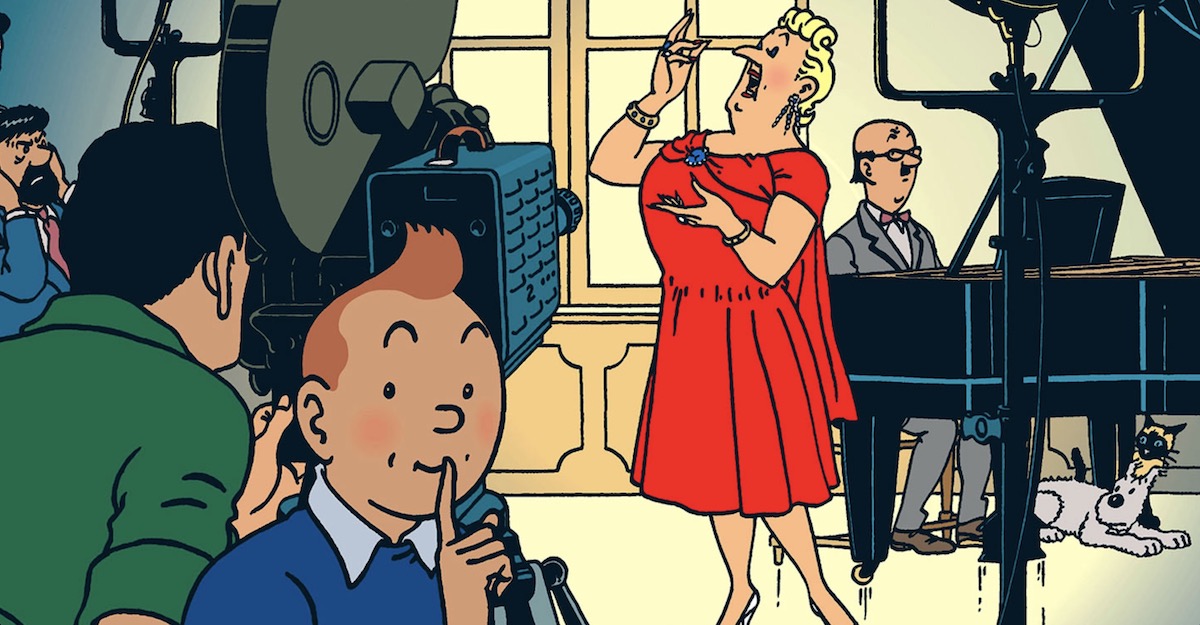

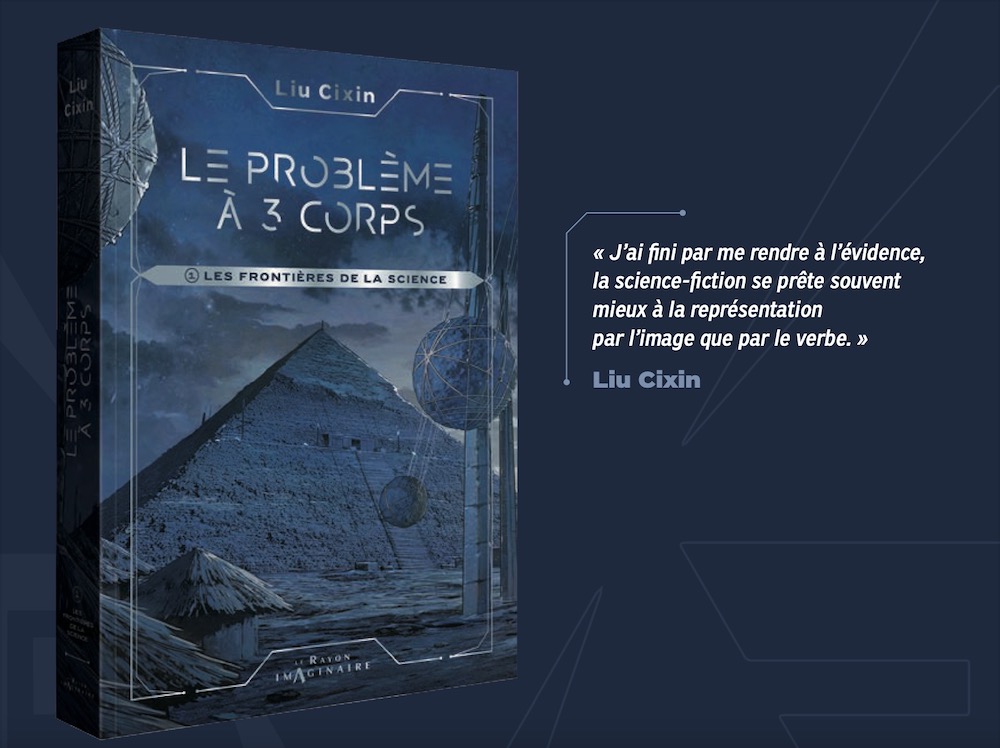

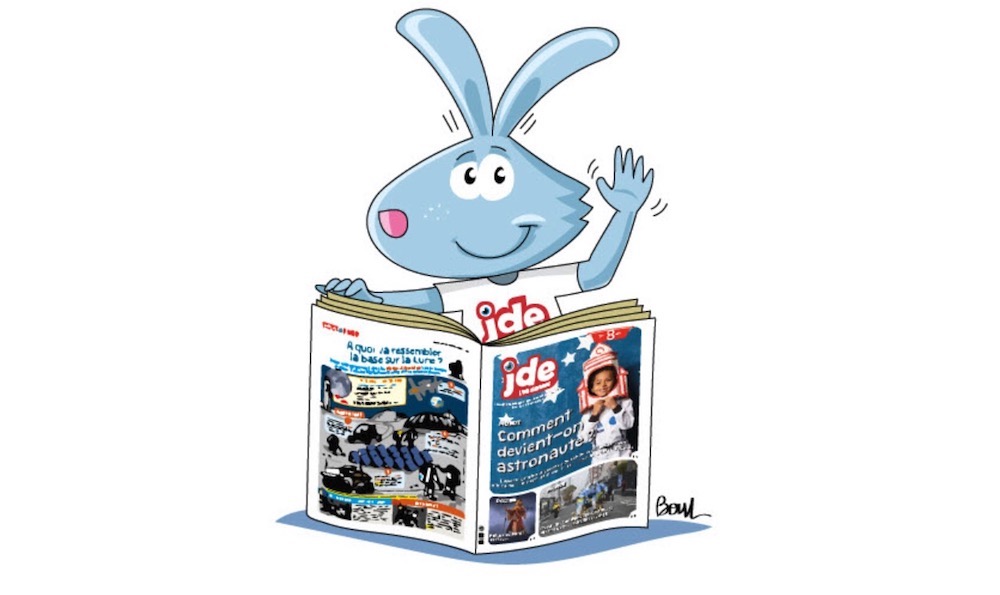


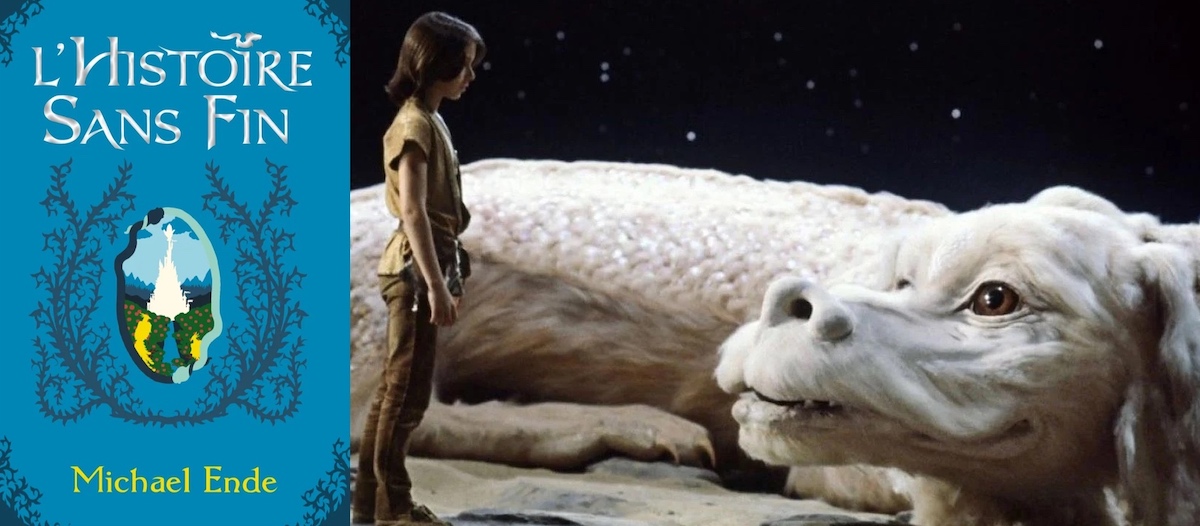
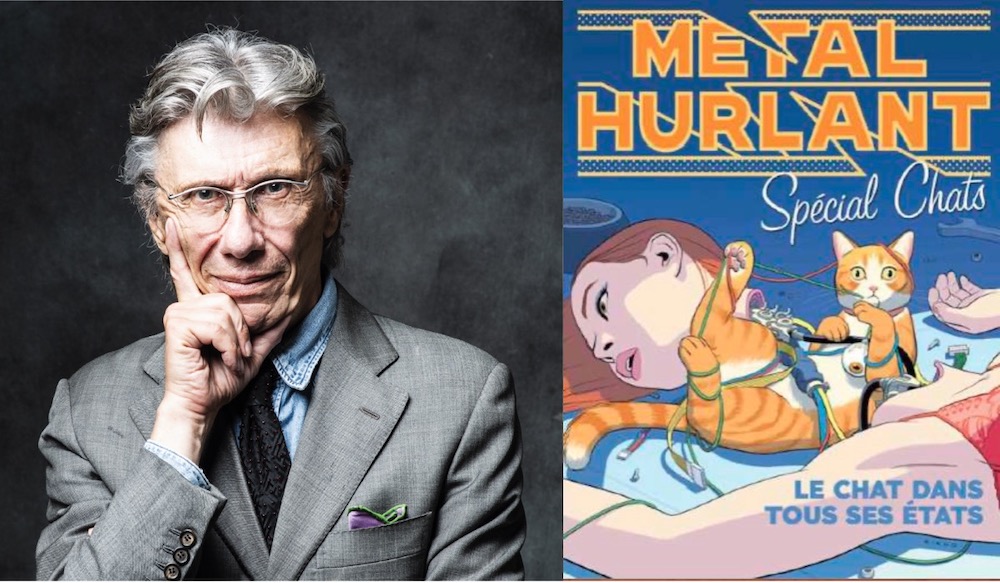


Commenter cet article