De l'ombre à la lumière : dans les mystères de l'écriture
Dans son ouvrage Les paradoxes de la postérité, Benjamin Hoffmann décide de se pencher sur le bien-fondé de la postérité. Par une succession d’angles divers, ce professeur de littérature française nous livre une analyse brillante par laquelle il parvient à la conclusion que pour tout individu, qu’il soit artiste ou non, « chercher l’immortalité » ne sert à rien.
Le 08/04/2019 à 08:42 par Auteur invité
Publié le :
08/04/2019 à 08:42
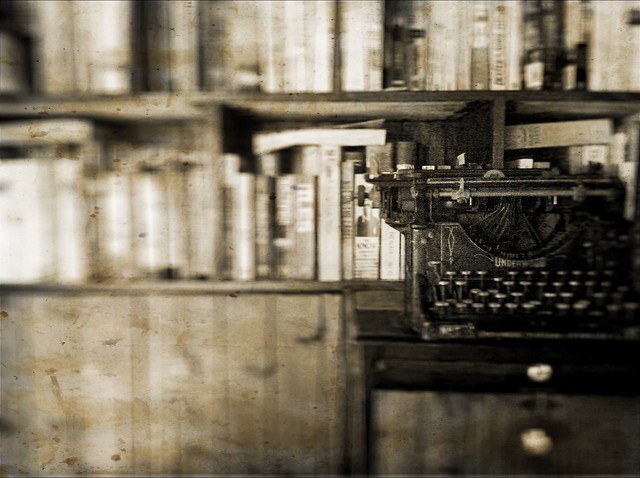
Fort de ce constat, le Docteur Hoffmann pose une question simple, mais pourtant fondamentale pour nous autres auteurs : « Pourquoi écrit-on ? »
À cela, on pourrait répondre qu’il existe probablement autant de réponses que d’écrivains, mais c’est néanmoins l’interrogation à laquelle je vais tenter de répondre avec cet article.
Personnellement, je dirais que mes motivations d’auteur sont diverses et dépendent fortement de mes états d’âme. Ainsi, les raisons qui me poussent à prendre la plume ne sont pas les mêmes le mercredi soir que celles d’un dimanche après-midi pluvieux. Pour être plus précis, j’ajouterais que mes envies et mes ambitions littéraires varient au gré des circonstances.
En revanche, ce qui est certain, c’est que c’est un fait et une réalité dont je ne saurai plus me passer, du moins pour le moment, puisque peut-être un jour viendra où l’urgence s’en ira, comme elle s’est immiscée dans ma vie en pleine trentaine.
Dans un éditorial du magazine « Lire », Frédéric Beigbeder avait expliqué que pour lui, écrire était l’occasion de « faire l’intéressant », pour reprendre ses termes. Mais plus loin dans le même éditorial, il donnait une autre explication qui n’était pas la sienne (et dont le nom de l’auteur m’échappe) et qui disait avec poésie ceci : « Écrire, c’est lire en soi, pour écrire en l’autre ».
De ce point de vue, on ne se trouve plus du côté du poète maudit qui souffre de la non-reconnaissance, mais davantage dans l’axe d’une citation qui fait mouche et qui équivaut à un échange bénéfique et louable entre l’auteur et le lecteur. Car de cette manière, ce dernier a le sentiment d’être l’élu de quelque chose d’intime, voire de secret de la part de l’écrivain. Ainsi, ce n’est plus un libelle, mais une confidence qui lui est faite.
Selon Blaise Hoffman, quel que soit le degré de vertu d’un individu, il nous démontre par A plus B, qu’il n’y a aucun intérêt à courir après la postérité, puisque par définition, la postérité surgit après notre disparition, soit après la conclusion de notre existence.
“Une récréation de l'âme”
Conséquemment, cet homme de lettres s’évertue à nous faire comprendre que même les morts dont nous parlons encore aujourd’hui ne sont plus présents pour en jouir et qu’il découle de cela que toute entreprise d’immortalité demeure vaine, puisque non vécue. Pour appuyer son argument, il cite en exemple Molière, qui est resté à travers les époques l’homme qui s’est approprié une langue, puisque l’on utilise encore de nos jours l’expression « dans la langue de Molière » pour parler du français.
Cependant l’auteur de cet essai philosophique, attire notre attention sur le fait que même l’appropriation d’une langue dont il est toujours le représentant ne lui a été d’aucune utilité outre-tombe.
Et puis, Blaise Hoffman conclut son analyse avec réalisme, en se demandant si tout bonnement, la quête de postérité n’est pas une question de chance, comme on joue à la loterie, puisqu’à l’évidence, tous les écrivains ne sont pas appelés à être honorés d’une grandeur posthume. Aussi bien, lorsque je m’interroge sur cette question, « pourquoi écrit-on ? », je pense pouvoir affirmer que c’est à mes yeux un bonheur vivace et une récréation de l’âme dont je ne voudrais plus me priver.
Alors pour conclure, je vous laisserai avec les mots de Patti Smith — dont j’aurais aimé être l’auteur d’ailleurs — et qui disent ceci :
« Pourquoi écrire ? Parce que vivre ne suffit pas ».
Mes respects Madame !
Texte de Jérôme Plattner, publié dans le cadre du partenariat entre la Fondation pour l'Ecrit et ActuaLitté. Cette dernière propose un programme, De l’écriture à la promotion, offrant à 10 jeunes auteurs de découvrir l’industrie du livre. À travers ActuaLitté, leur est proposé un espace d’expression spécifique, où il leur était proposé de publier un texte en lien avec l’histoire littéraire.




















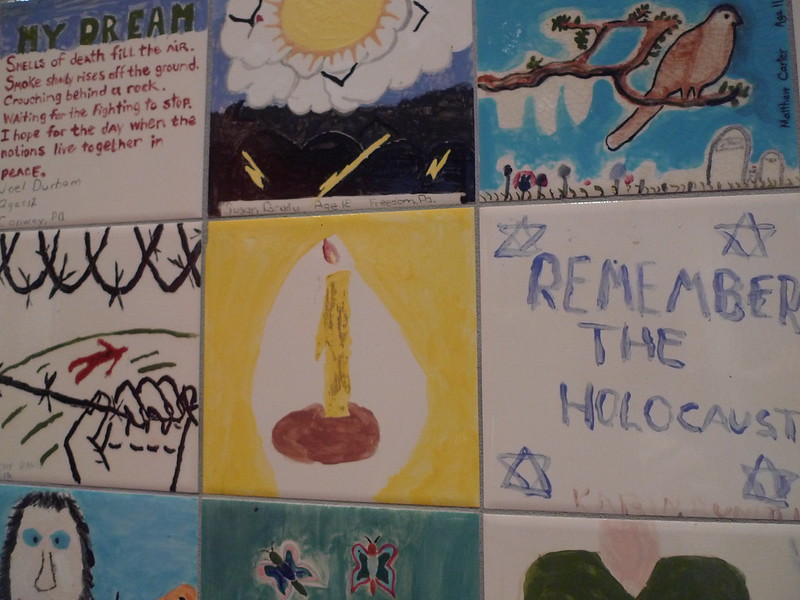


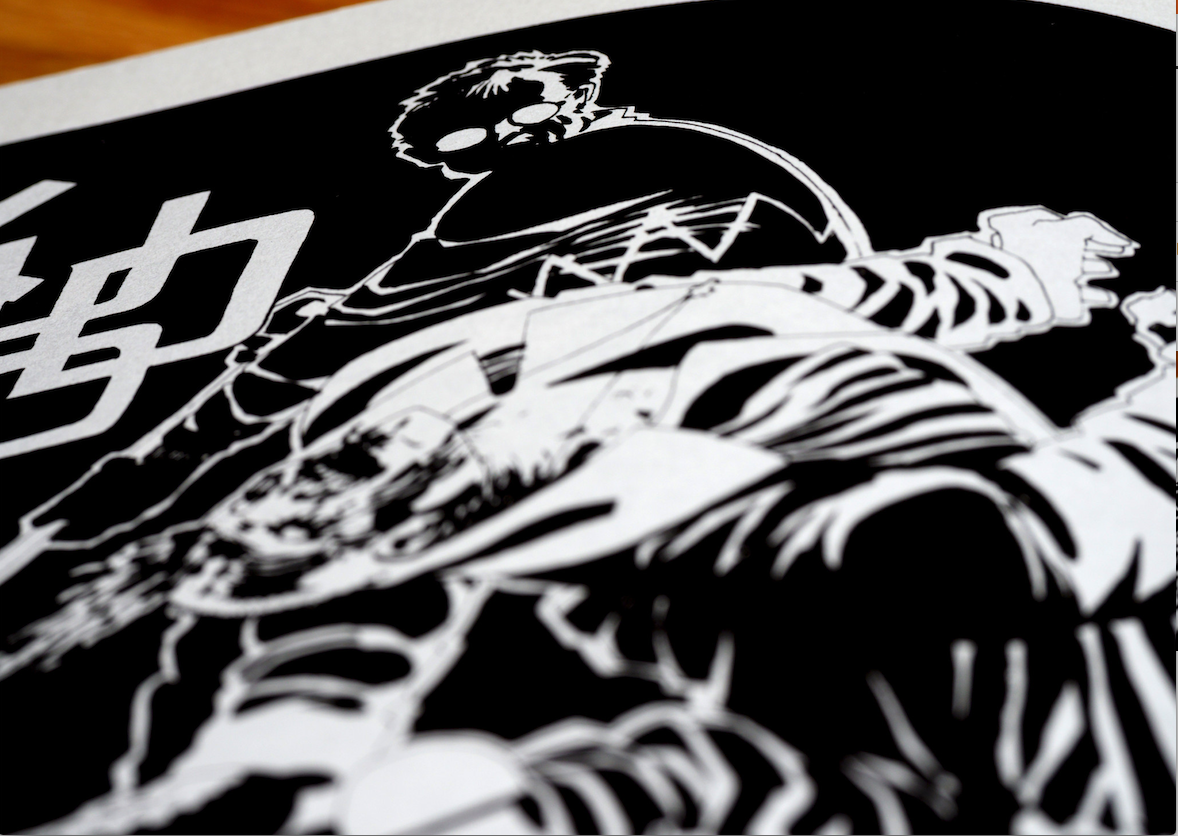

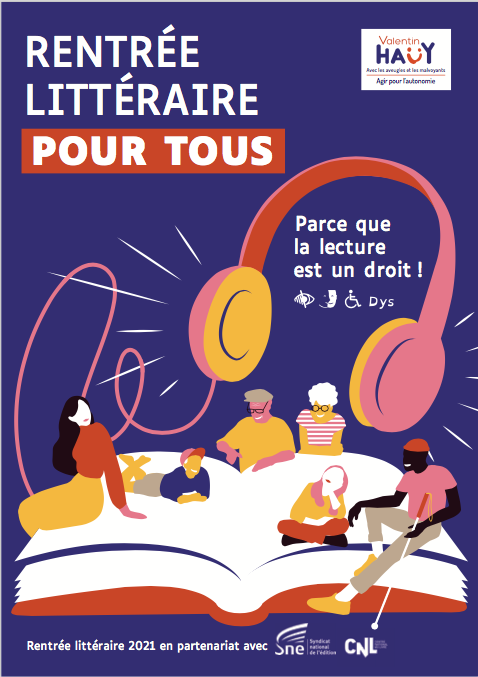

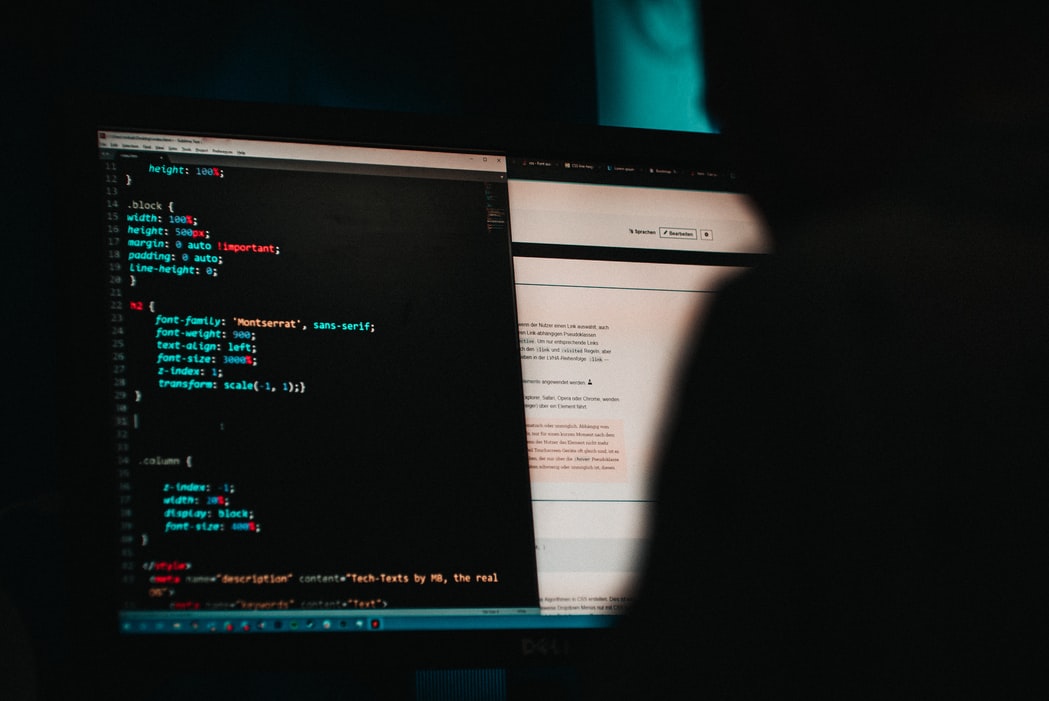
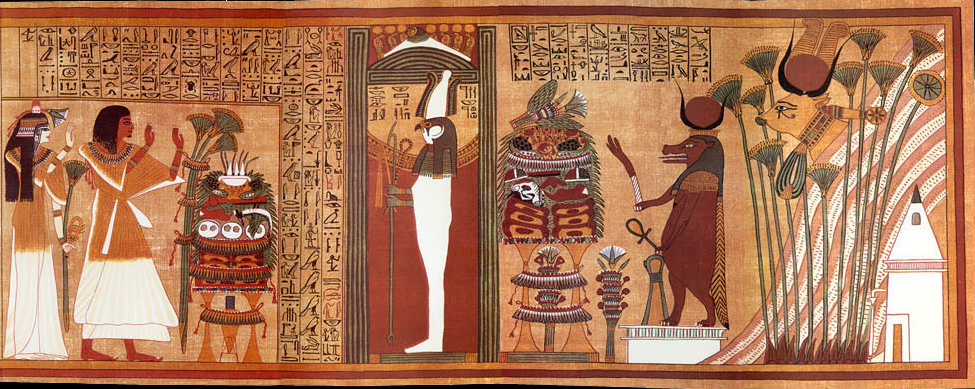
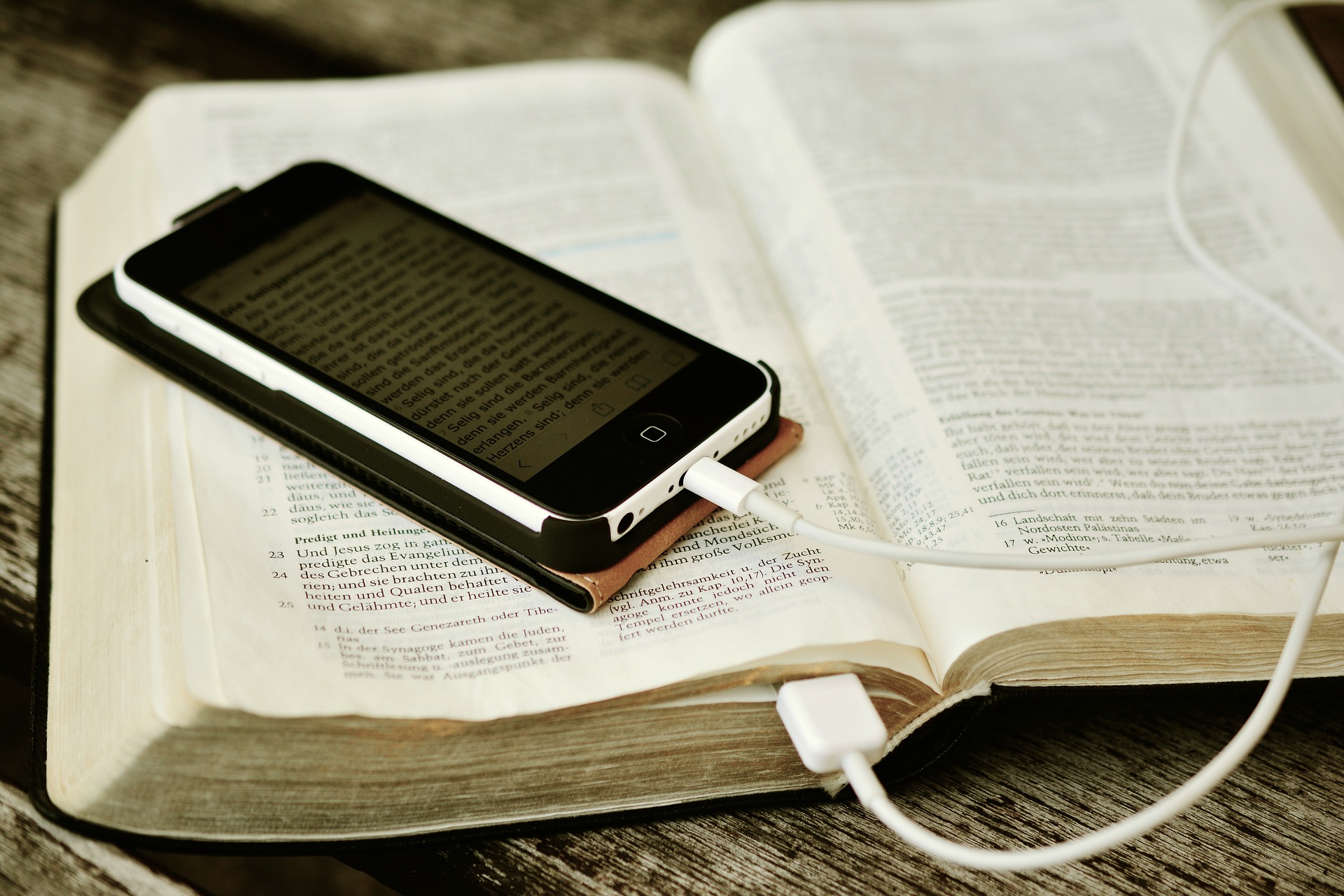

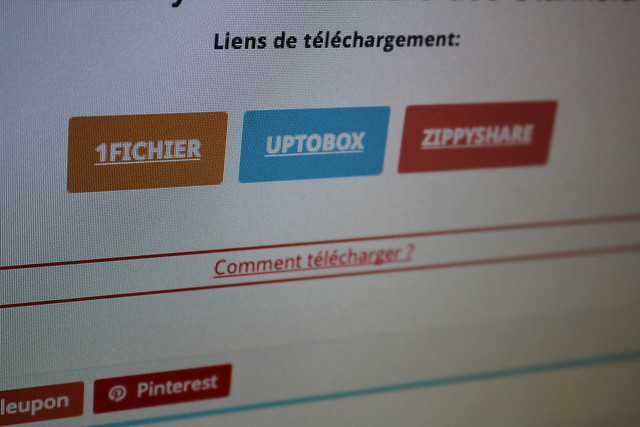



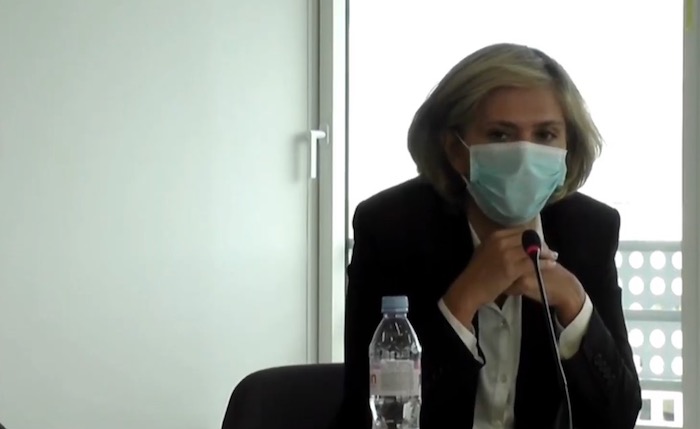
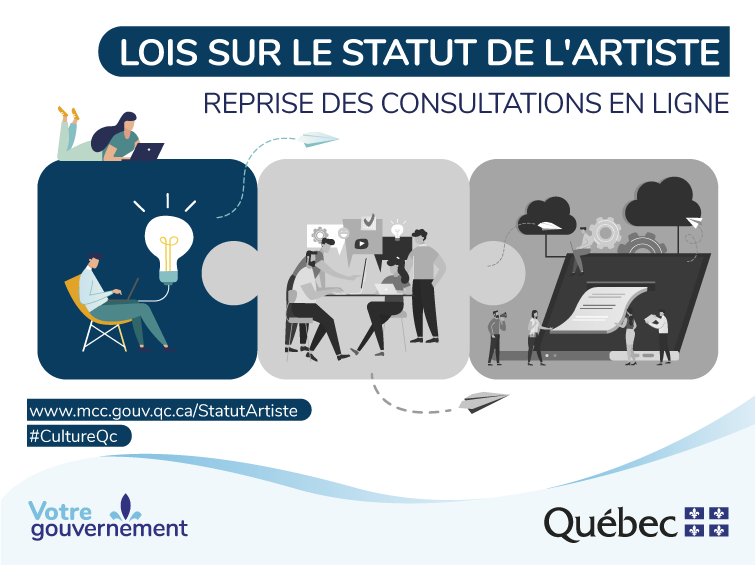
Commenter cet article