Métiers au féminin : quelles sont les règles à suivre ?
L'Académie française s'est donc finalement exprimée, par l'intermédiaire d'un rapport, sur la féminisation des titres et fonctions. Le document, rédigé par une commission spécialement créée pour l'occasion et réunissant 4 membres de l'Académie, fait passer l'usage avant toute chose et assure que celui-ci prévaut, tant que les règles de la langue sont respectées. Le rapport fut aussi l'occasion de rappeler ces règles.
Le 01/03/2019 à 11:34 par Antoine Oury
1 Réactions | 11 Partages
Publié le :
01/03/2019 à 11:34
1
Commentaires
11
Partages

Le rapport de l'Académie française le rappelle à de nombreuses reprises : le rôle de l'institution n'est pas d'édicter des règles, mais de vérifier la conformité de l'usage avec les règles, morphologiques cette fois, de la langue française. « Ces contraintes sont objectives, et il convient de rappeler que les formes féminines auxquelles on peut légitimement recourir doivent être conformes aux modes ordinaires d’expression et de formation propres au français, dans la mesure où ces règles fondamentales ordonnent et guident toutes ses évolutions. »
« Il n’est pas loisible de s’en affranchir, au risque de bouleverser le système de la langue », indique l'Académie française, qui propose ensuite un relevé des principales difficultés rencontrées au moment de féminiser les métiers.
Différentes formes de féminisation sont possibles :
C'est la plus simple, qui consiste à marquer le féminin par l’article, éventuellement l’adjectif ou le verbe tout en gardant la même forme au masculin comme au féminin.
Exemples : « architecte », « artiste », « juge », « secrétaire », « comptable » ou encore « garde ». Il existe des formes plus marquées, comme « mairesse » ou « poétesse », mais certains tombent en désuétude.
La féminisation en « — er/ — ère », « — ier/ — ière », « — ien/ — ienne »...
Dans le cas où le nom masculin est terminé par une consonne, l’adjonction d’un « e » final est aujourd’hui usuelle, sauf dans quelques cas (« une mannequin », « une médecin »...)
La féminisation des noms de métiers en « — eur »
Deux cas de figures se présentent : la forme en « — euse », plus ancienne et dont l’usage reste attesté dans un grand nombre de cas, et la forme en « — eure », qui est devenue très courante aujourd’hui.
La règle est simple : la déclinaison en « — euse » s’opère lorsqu’un verbe correspond au nom (on a ainsi « une carreleuse », « une contrôleuse », « une entraîneuse », tirés des verbes « carreler », « contrôler », « entraîner ») ; dans le cas contraire, l’usage s’en tenait jusqu’à une date récente à la forme masculine (« une docteur » ou « une femme docteur », « une proviseur »). Dans ces derniers cas, une forme en « — eure » peut être utilisée, à condition toutefois que le « e » muet final ne soit pas prononcé. À l'inverse, les formes féminines en « — esse » « correspondent à un mode ancien de féminisation, très marqué et regardé de ce fait aujourd’hui comme porteur d’une discrimination », et devront donc être évitée, de préférence.
La féminisation en « — teuse » ou « — trice »
Si le nom se termine en « — teur », le féminin est ordinairement marqué par la forme « — teuse » quand il existe un verbe correspondant (« une acheteuse », « une rapporteuse », « une toiletteuse ») ou par la forme « — trice » en l’absence de verbe ou quand le verbe ne comporte pas de « t » dans sa terminaison (on aura ainsi « une apparitrice », « une rédactrice »).
Les cas de « chef » et « agent »
Ces deux cas sont plus problématiques, souligne l'Académie : « La langue française a tendance à féminiser faiblement ou pas les noms des métiers placés au sommet de l’échelle sociale. »
La forme « cheffe » semble avoir aujourd’hui, dans une certaine mesure, la faveur de l’usage. Pour la féminisation de l'« agent », la forme « agente » commence à s’implanter dans l’usage, mais son emploi rencontre parfois une résistance de la part des femmes auxquelles il pourrait s’appliquer.
Accord des adjectifs et participes avec le substantif
Conformément aux règles syntaxiques, on accordera systématiquement les adjectifs et participes avec le substantif.
Exemples : « une conseillère principale », « une contrôleuse adjointe », « une directrice générale »...
Le rapport complet de l'Académie est disponible ci-dessous.
Rapport sur la féminisation... by on Scribd




















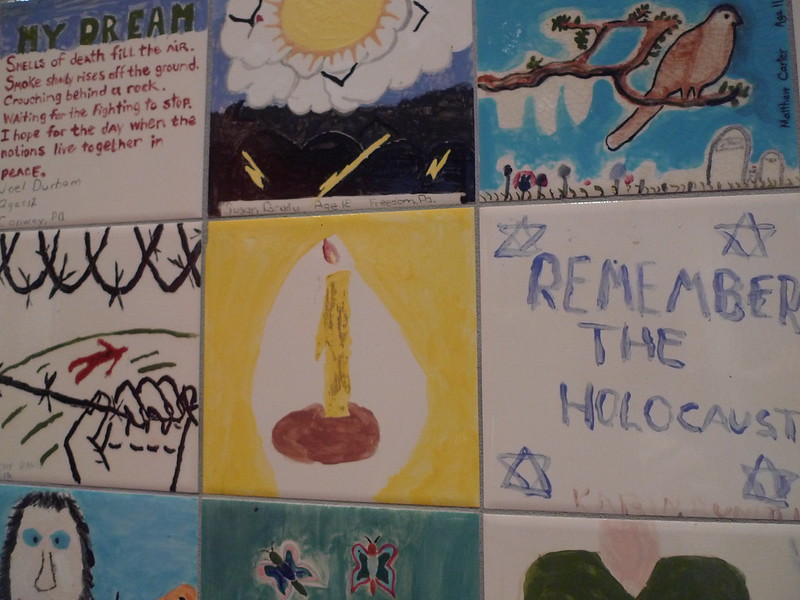


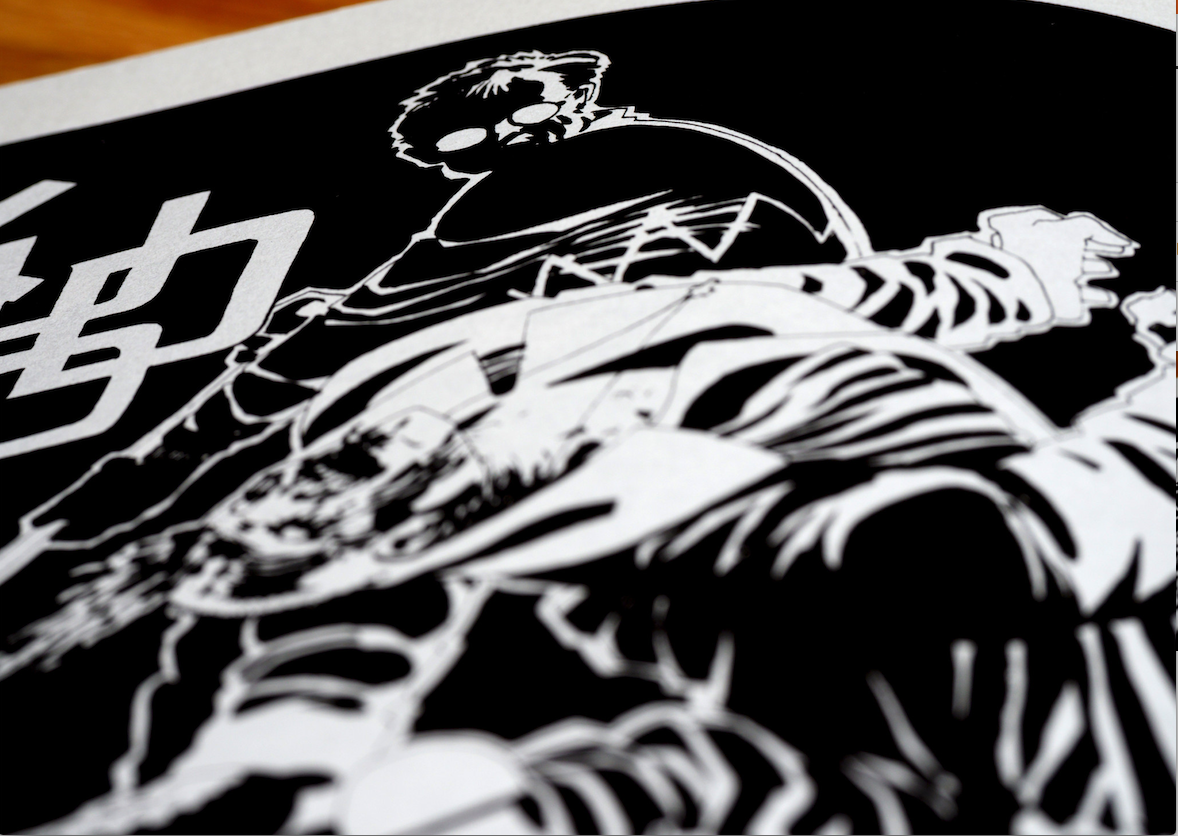

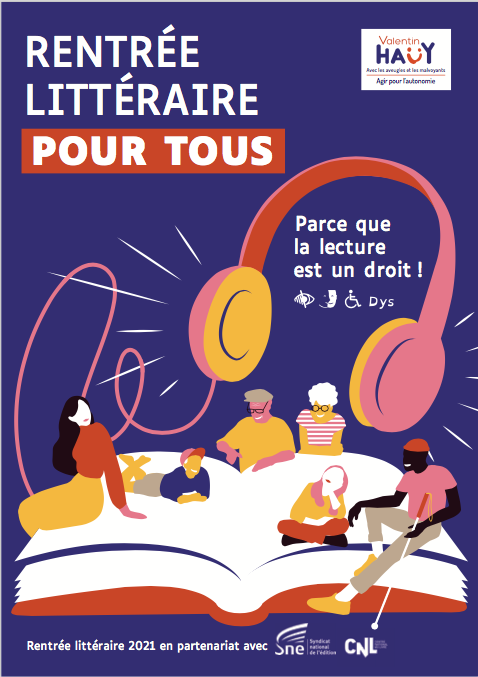

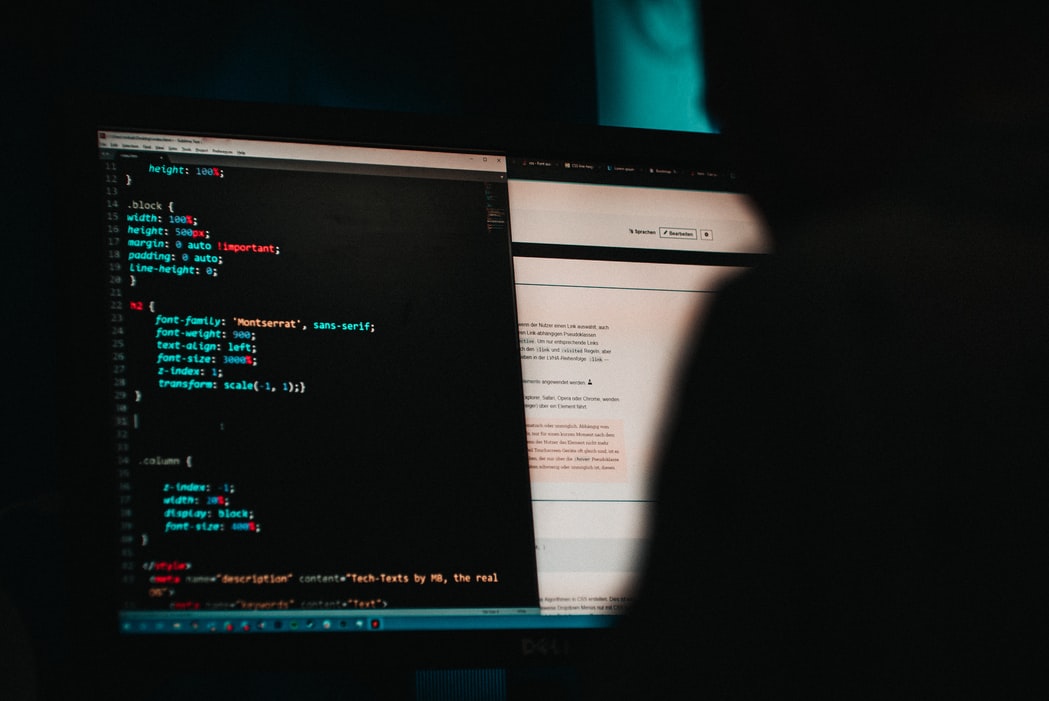
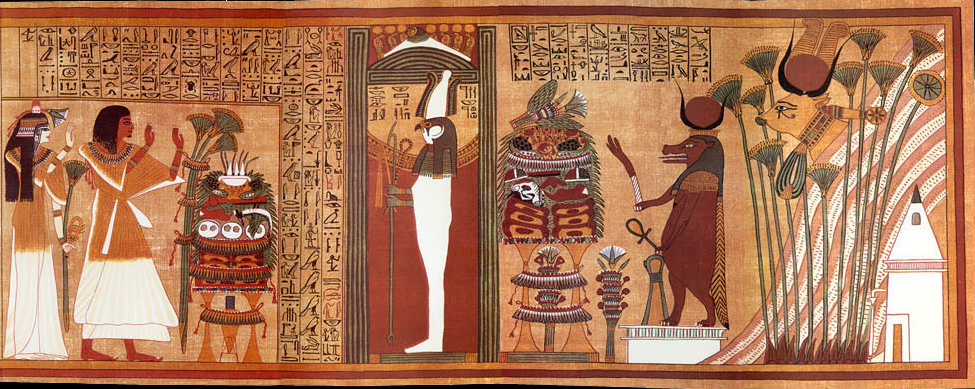
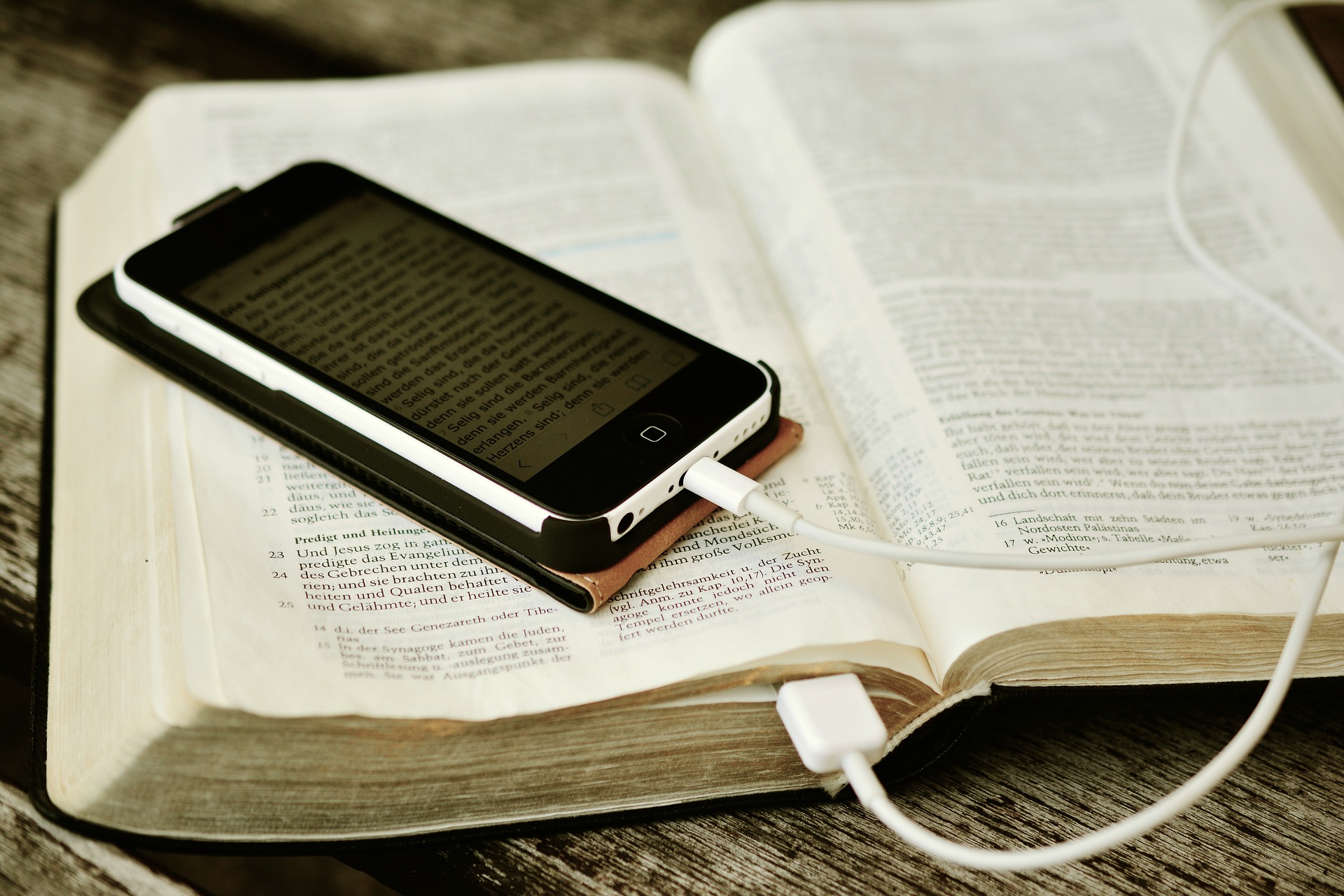

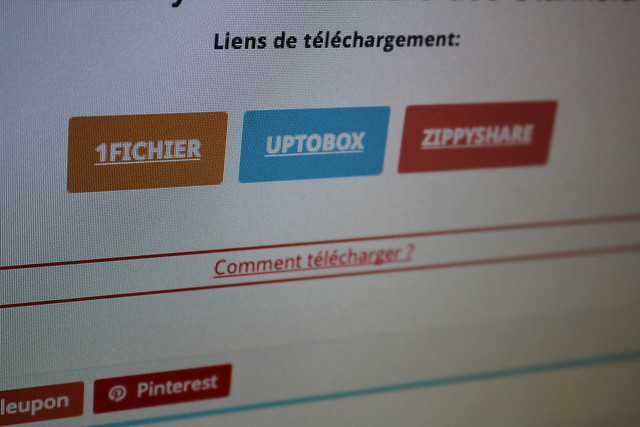



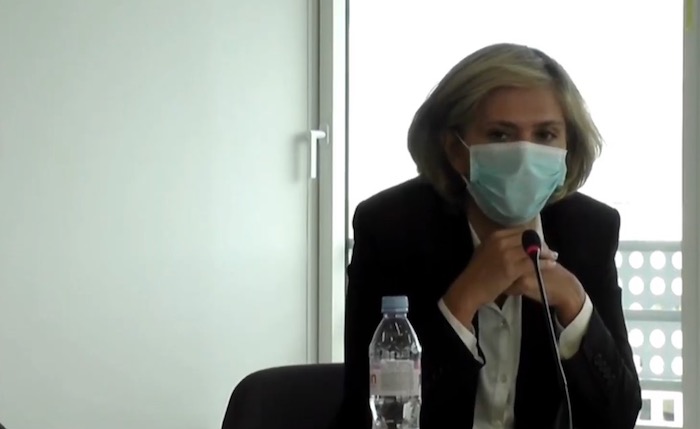
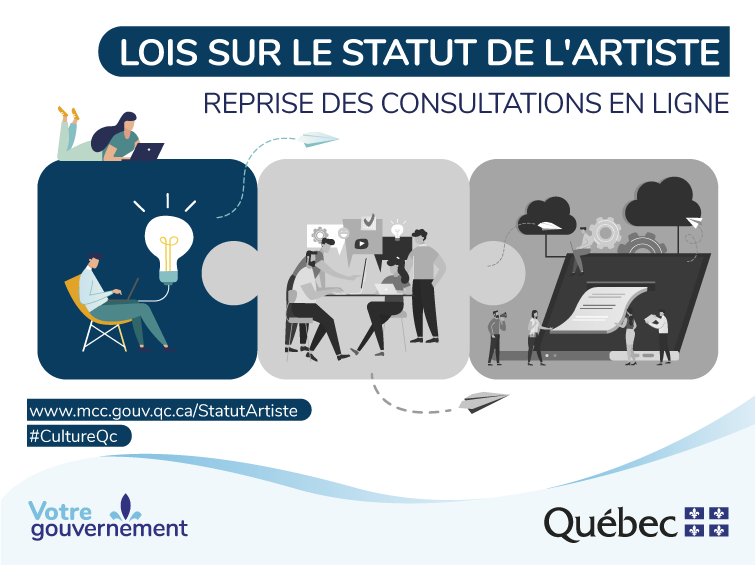
1 Commentaire
NAUWELAERS
01/03/2019 à 19:47
Bravo à l'Académie française !
Un féminin atypique et oublié, que j'ai connu naguère: celui de «chef» qui était «cheftaine» usité en Belgique.
Pour désigner une responsable de scouts ou louveteaux !
C'est loin tout ça...!
CHRISTIAN NAUWELAERS