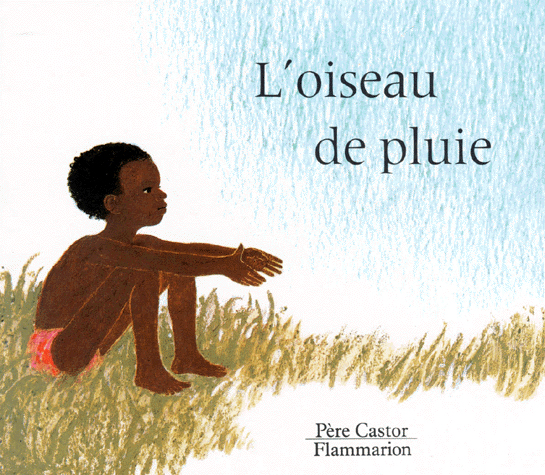Monique Etienne
Dossiers

Fête du Livre 2023 : le rendez-vous littéraire de Saint-Étienne
La 37e édition de la Fête du Livre de Saint-Étienne est en marche ! Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, la ville s'anime autour de la littérature, offrant aux passionnés et aux curieux une pléiade d'événements.

Objectif cadeaux de Nöel en cinq ouvrages
Noël approche doucement, il est donc temps de s’arrêter aux futurs présents que l’on offrira à ses proches. Si cette activité doit rester dans le plaisir de donner, on ne va pas se le cacher, il peut également être facteur d’un stress plus ou moins grand. Est-ce le bon cadeau ? Va-t-il plaire à la personne ciblée ? Pas d’inquiétude, les éditions de la Martinière ont sélectionné cinq ouvrages, pour tous les goûts. De quoi rendre heureux ce que vous aimez.

“Offrir aux femmes une terre d’accueil pour exister en tant que femmes”
En cinquante années de publications, les éditions Des femmes - Antoinette Fouque ont cherché à rendre les femmes plus visibles. A l'occasion de leur anniversaire, ce dossier propose de retrouver les oeuvres majeures de leur catalogue.

Le prix des Deux Magots : 90 années à “défricher le talent”
Le prix des Deux Magots est une récompense littéraire française prestigieuse. Il est décerné chaque année depuis 1933 au Café des Deux Magots, situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ce prix a été créé dans le but de reconnaître et de célébrer le travail des auteurs contemporains.

Prix du livre de la Ville de Lausanne 2024 : 10 ans déjà
Depuis son inauguration en 2014 par le Service des bibliothèques & archives de Lausanne, responsable de la stratégie littéraire, le Prix du livre de la Ville de Lausanne s'est consacré pendant une décennie à soutenir les auteurs de Suisse romande et leurs fidèles lecteurs. Une odyssée littéraire qui promet de perdurer !

En route pour l'aventure : des livres pour voyager et s'évader
Sur terre et sur les mers, à la découverte d’horizons inconnus, voici une liste de livres qui vous embarquent vers des destinations folles. Ce sont des récits de voyage, des essais, des textes empreints de poésie, ou des biographies d’aventuriers, comme autant de panoramas de la splendeur de notre planète.
Extraits
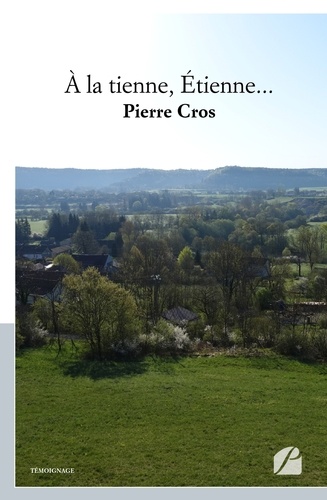
Littérature française
A la tienne, Etienne...
10/2018

BD tout public
GladyS & Monique
12/2010
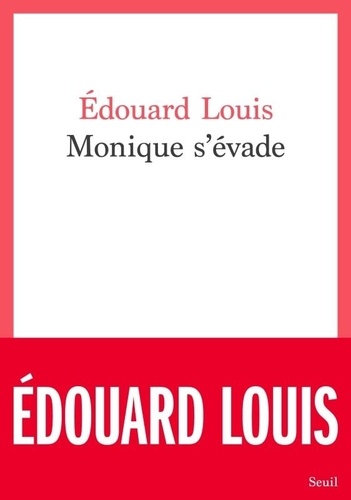
Littérature française
Monique s'évade
Une nuit, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle me disait au téléphone que l'homme avec qui elle vivait était ivre et qu'il l'insultait. Cela faisait plusieurs années que la même scène se reproduisait : cet homme buvait et une fois sous l'influence de l'alcool il l'attaquait avec des mots d'une violence extrême. Elle, qui avait quitté mon père quelques années plus tôt pour échapper à l'enfermement domestique, se retrouvait à nouveau piégée.
Elle me l'avait caché pour ne pas "m'inquiéter" mais cette nuit-là était celle de trop. Je lui ai conseillé de partir, sans attendre. Mais comment vivre, et où, sans argent, sans diplômes, sans permis de conduire, parce qu'on a passé sa vie à élever des enfants et à subir la brutalité masculine ? Ce livre est le récit d'une renaissance. E. L.
Edouard Louis est l'auteur de plusieurs ouvrages autobiographiques, traduits dans une trentaine de langues.
04/2024
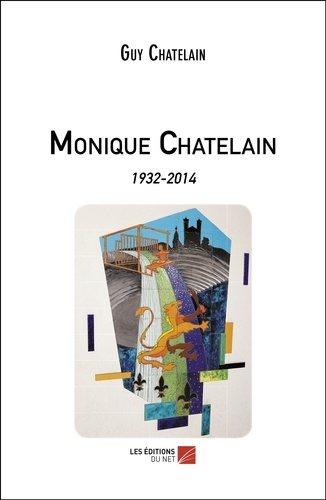
Régionalisme
Monique Chatelain - 1932-2014
01/2019
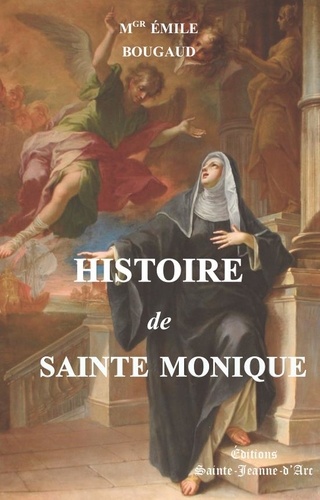
Mystique
Histoire de sainte Monique
11/2023

Non classé
Pendule Cônique
09/1999

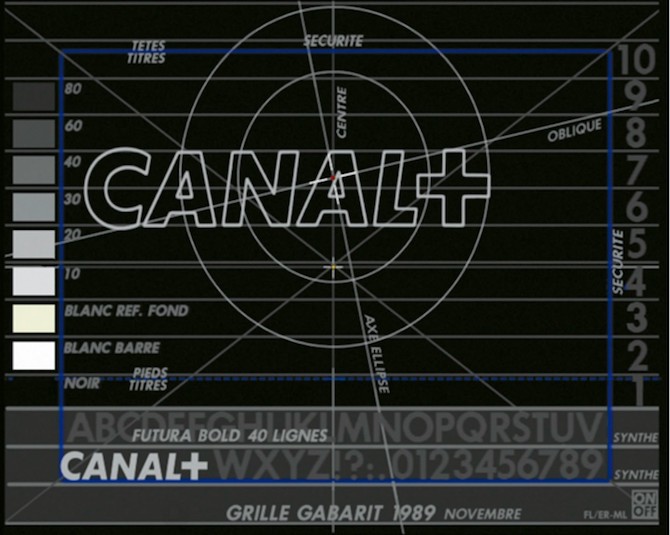


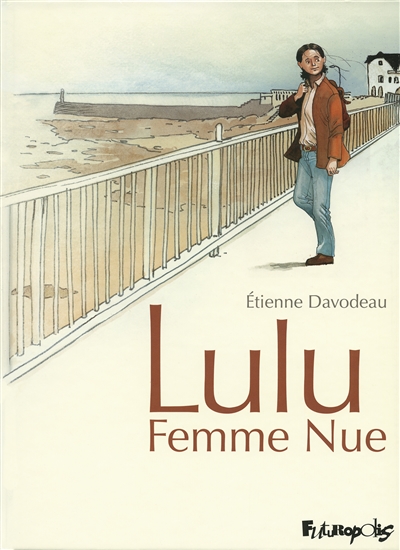
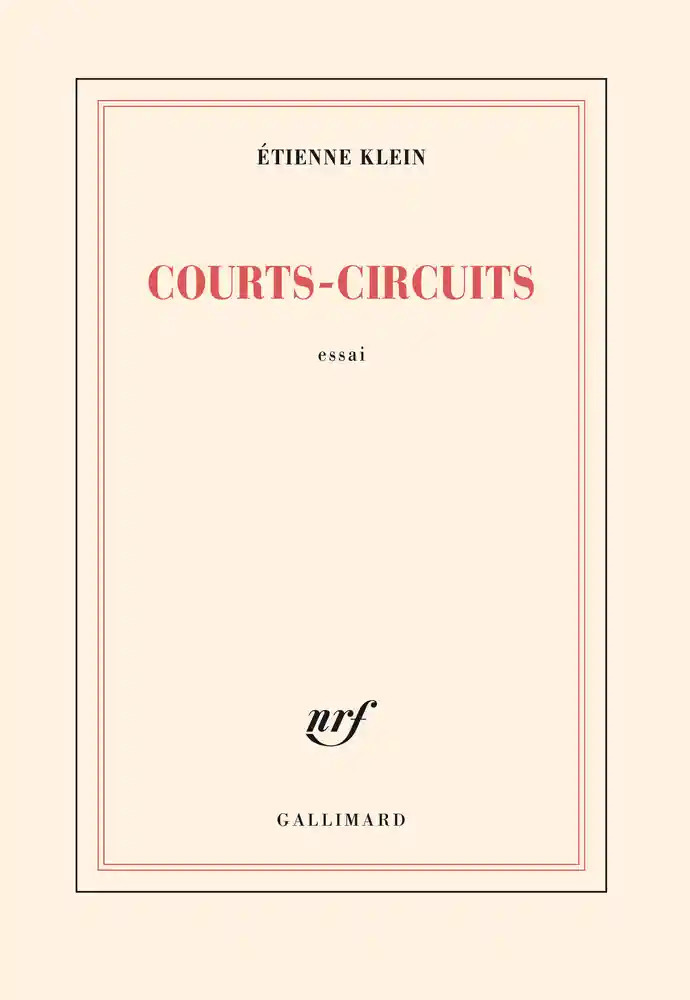

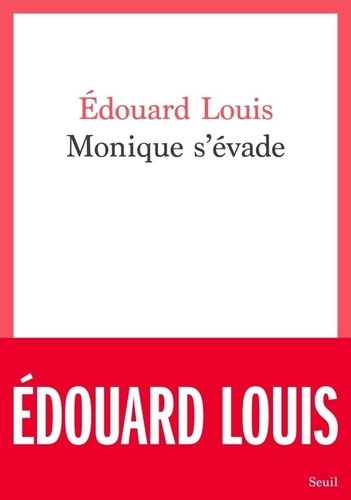

_20002-0a3c38b7-17eb-42a8-9439-db0c07acc482.JPG)