Un missionnaire botaniste martyr au Tibet. Jean-André Soulié (1858-1905)
Extraits
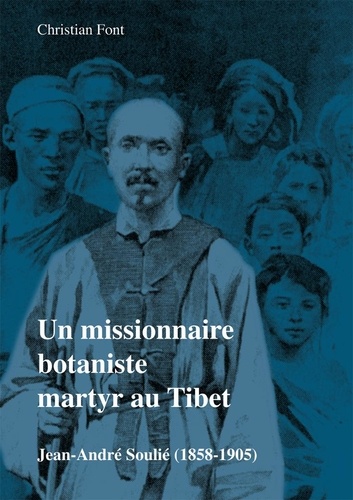
Religion
Un missionnaire botaniste martyr au Tibet. Jean-André Soulié (1858-1905)
08/2020
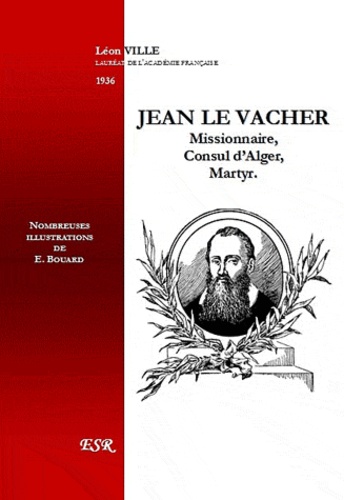
Religion
Jean le Vacher. Missionnaire, consul d'Alger, martyr
11/2011
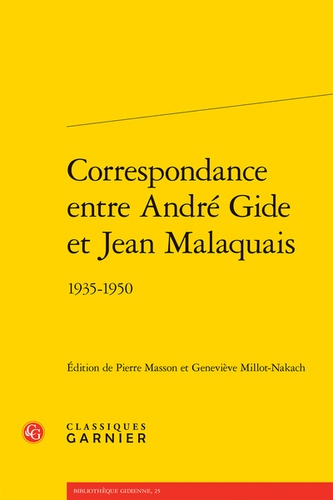
Correspondance
Correspondance entre andré gide et jean malaquais - 1935-1950. 1935-1950
08/2023
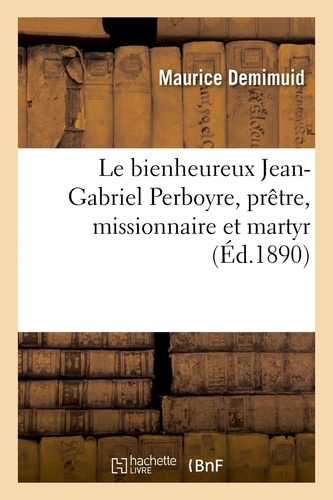
Généralités
Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, prêtre, missionnaire et martyr
02/2021
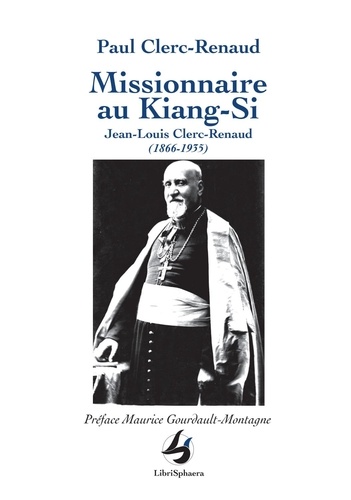
Du XVIe au XIXe siècle
Missionnaire au Kiang-Si. Jean-Louis Clerc-Renaud (1866-1935)
04/2024
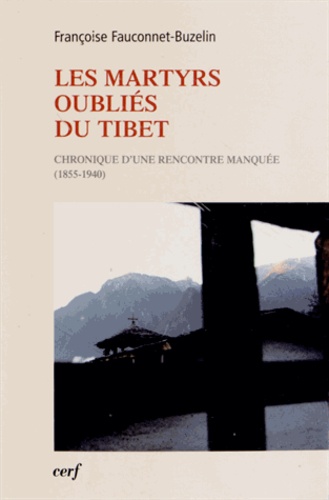
Histoire internationale
Les martyrs oubliés du Tibet. Chronique d'une rencontre manquée (1855-1940)
11/2012
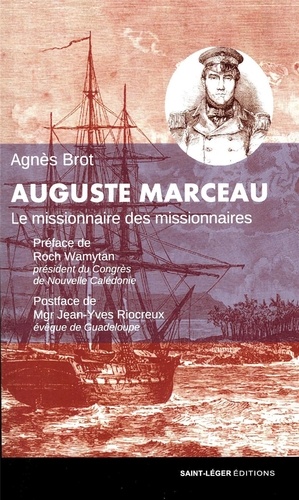
Religion
Auguste Marceau. Le missionnaire des missionnaires
10/2019
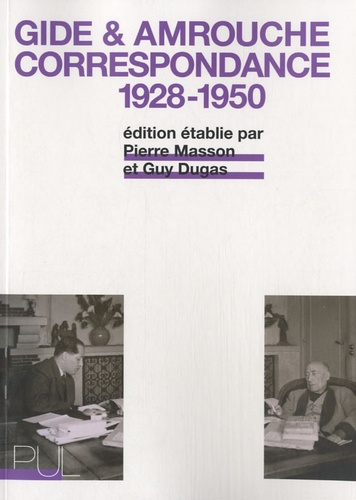
Critique littéraire
André Gide, Jean Amrouche. Correspondance 1928-1950
11/2010
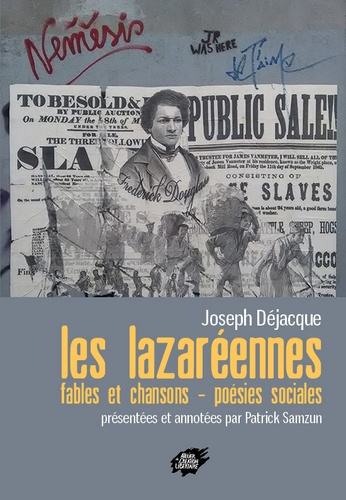
Poésie
Les Lazaréennes. Fables et chansons - Poésies sociales
07/2018
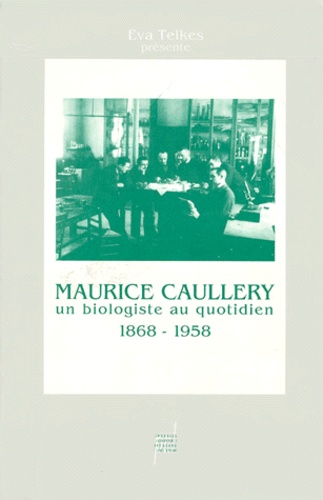
Histoire et Philosophiesophie
Maurice Caullery, 1868-1958, un biologiste au quotidien
07/1993
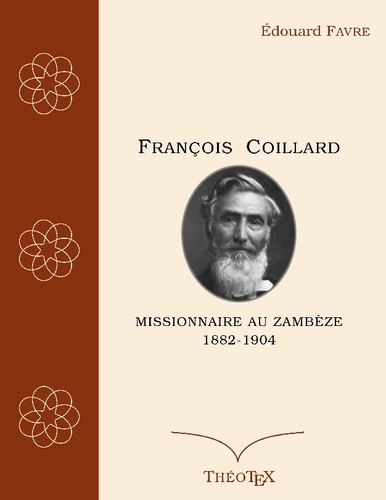
Histoire du protestantisme
François Coillard, missionnaire au Zambèze, 1882-1904
06/2022
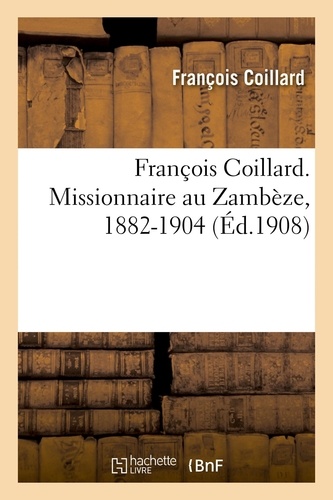
Histoire internationale
François Coillard. Missionnaire au Zambèze, 1882-1904
06/2020
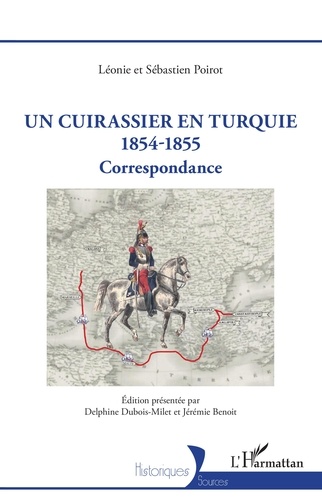
Etudes historiques
Un Cuirassier en Turquie 1854-1855. Correspondance
02/2023
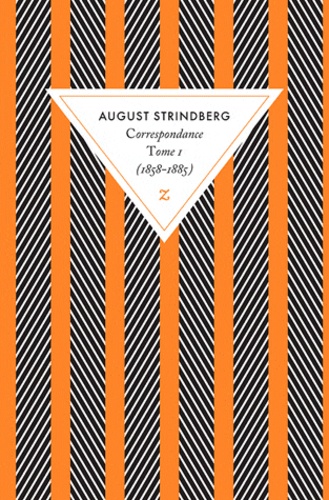
Littérature étrangère
Correspondance. Tome 1 (1858-1885)
10/2009
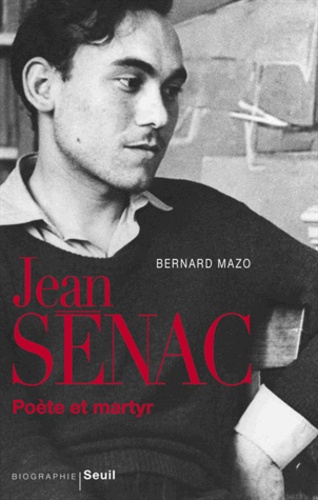
Critique littéraire
Jean Sénac, poète et martyr
10/2013
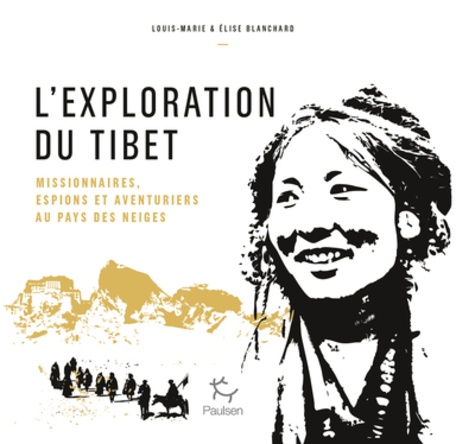
Récits de voyage
L'exploration du Tibet. Missionnaires, espions et aventuriers au pays des neiges
09/2019
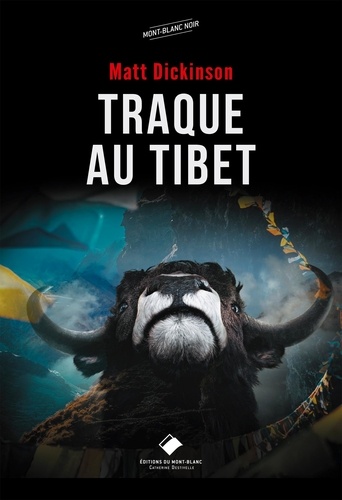
Thrillers
Traque au Tibet
03/2023
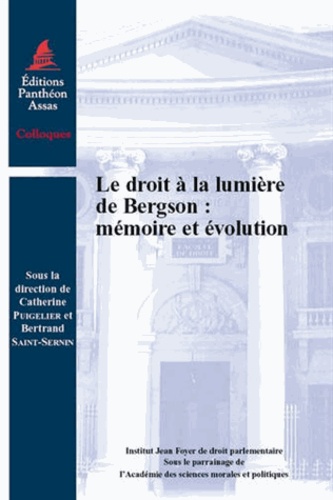
Droit
Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution
07/2013
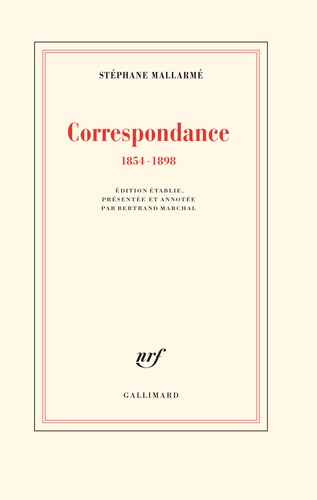
Critique littéraire
Correspondance. 1854-1898
03/2019
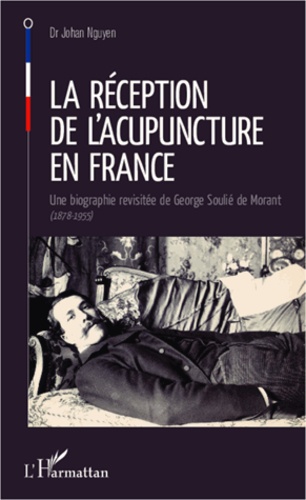
Santé, diététique, beauté
La réception de l'acupuncture en France. Une biographie revisitée de George Soulié de Morant (1878-1955)
11/2012
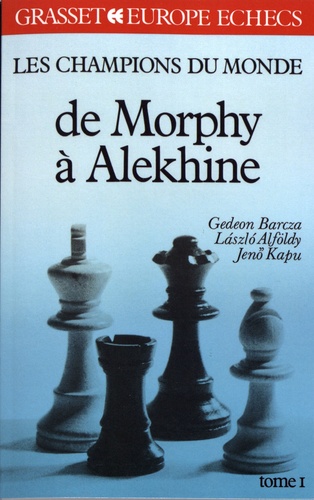
Loisirs
Les champions du monde du jeu d'échecs. Tome 1, De Morphy à Alekhine
06/1985
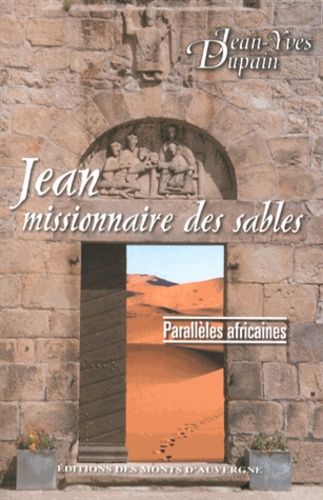
Littérature française
Jean missionnaire des sables. Parallèles africaines
07/2013
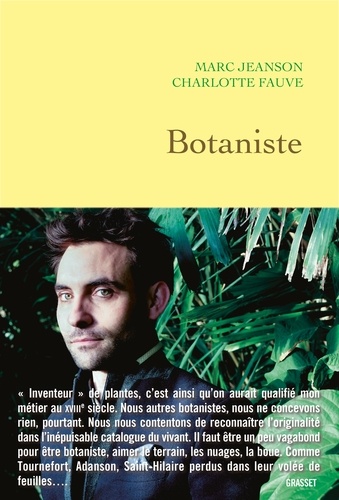
Histoire et Philosophiesophie
Botaniste
04/2019
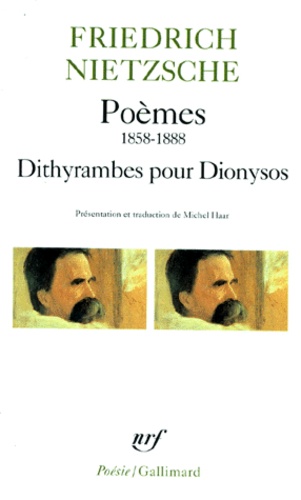
Poésie
POEMES 1858-1888, Dithyrambes pour Dionysos
05/1997
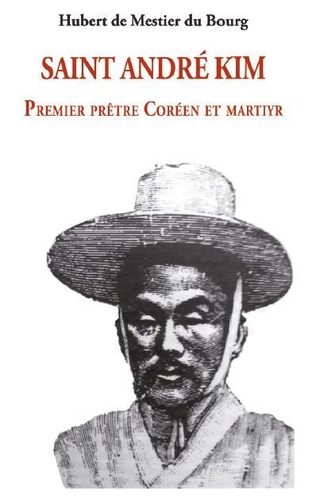
Vie des saints
Saint André Kim. Premier prêtre coréen et martyr
08/2021
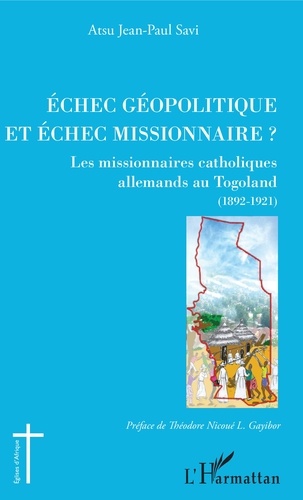
Religion
Echec géopolitique et échec missionnaire ?. Les missionnaires catholiques allemands au Togoland (1892-1921)
06/2020
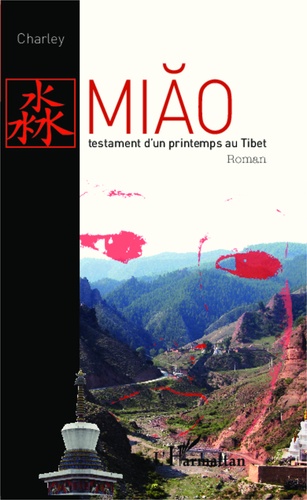
Littérature française
Miao, testament d'un printemps au Tibet
03/2014
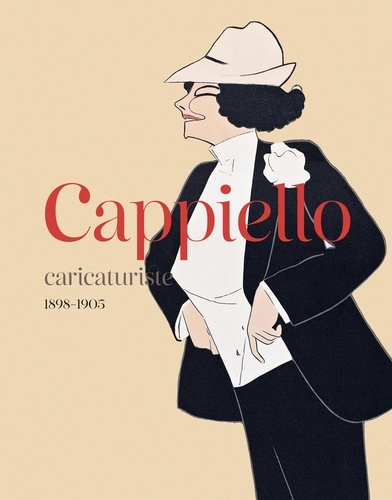
Dessin
Cappiello. Caricaturiste (1898-1905)
05/2024
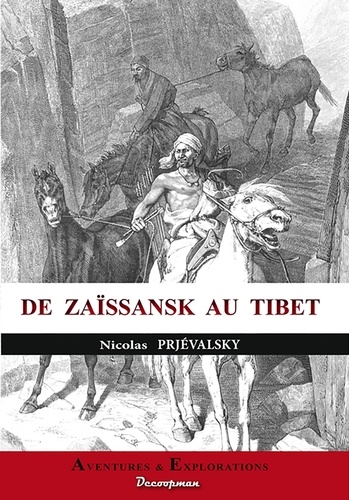
Récits de voyage
De Zaïssansk au Tibet
03/2012
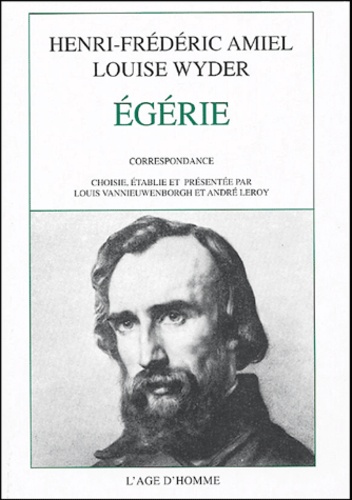
Critique littéraire
Egérie. Corerspondance 1853-1868
09/2004


