Pogrom
Extraits
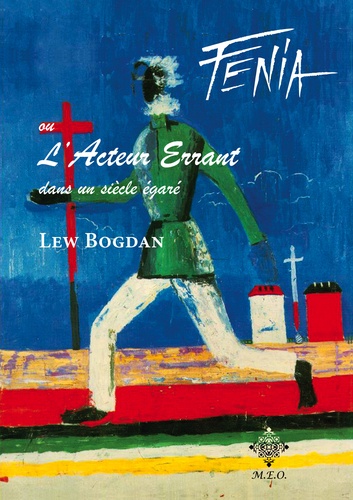
Romans historiques
Fenia, ou l'Acteur Errant dans un siècle égaré
A la fin de XIXe siècle, les Doukhobors, secte chrétienne communiste et pacifiste, sont persécutés par le tsar. Lev Tolstoï finance leur émigration vers le Canada, qu'organise son disciple Leopold Soulerjitski. Lors d'une escale, une fillette égarée d'un autreexode est adoptée par l'infirmière du bord et prend le nom de Fenia Koralnik. Pour échapper aux pogroms qui se multiplient, nombre de juifs fuient l'Empire russe. Parmi eux, Jacob "?Yankele?" Adler, le Grand Aigle du théâtre yiddish d'Odessa, qui s'en ira aux Etats-Unis constituer le socle de ce qui deviendra le théâtre de Broadway. Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch Dantchenko ont fondé le Théâtre d'Art de Moscou, au rayonnement international. Mais à théâtre nouveau, il faut un acteur nouveau, répondant à des exigences professionnelles autant qu'éthiques. Ainsi naît le Premier Studio, sous la houlette de Stanislavski et Soulerjitski. Une épopée fabuleuse pour ces jeunes studistes, au nombre desquels Fenia Koralnik. Ils vont connaître les prémices de la célébrité, traverser la révolution de 1905, la Première Guerre mondiale et la Révolution d'Octobre, accrochés à leur idéal. Les uns resteront en URSS et subiront la glaciation stalinienne? ; les autres entrelaceront leurs errances, Constantinople, Berlin, Paris, Londres, Riga ou Prague, souvent à la limite de la misère. Plusieurs émigreront aux Etats-Unis, où, à travers l'American Theatre Lab, le Group Theatre et l'Actors Studio, ils donneront naissance au prototype de l'acteur moderne et formeront nombre de monstres sacrés du théâtre et de l'écran. L'auteur, à travers le regard de Fenia, retrace le parcours erratique des plus importants, Jacob Adler et sa fille Stella, Richard Boleslavski, Michaël Chekhov, Maria Ouspenskaïa... Nous croisons et recroisons Maxime Gorki, Isadora et Lisa Duncan, Evgueni Vakhtangov, Vsevolod Meyerhold, Lénine et son Commissaire à la Culture Lounatcharski, Olga Tschekowa, star adulée par les dirigeants nazis et sans doute espionne de Staline, Louis Jouvet, Max Reinhardt, Lee Strasberg, Bobby Lewis, Lev Theremin, génial inventeur de la musique électronique et "?hôte?" du premier cercledu goulag, Elia Kazan, Yul Brynner, Marlon Brando, Marilyn Monroe et bien d'autres... D'Odessa à Broadway et Hollywood, une traversée épique du siècle et des continents, une lecture, par cet Acteur Nouveau, d'un monde et de ses utopies devenues souvent cauchemars. Unesaga passionnante? ; enrichissante aussi, tant l'idéal de ces acteurs et pédagogues tranche sur les aspects égotique et commercial sur lesquels se focalisent les médias.
01/2018

Littérature française
Le nageur de Bizerte
Nous sommes à Bizerte, en Tunisie, janvier 1921, sous le protectorat français. La vie serait presque douce pour le jeune docker du port de Bizerte, Tarik Aït Mokhtari, nageur longiligne et musculeux, s'il ne s'était heurté un matin, dans sa ligne de nage, à un obstacle infranchissable : il ne le sait pas encore, mais il s'agit d'un croiseur de bataille, survivant de la flotte impériale russe qui fuit l'irréversible et sanglante poussée des "rouges" et transporte à son bord toute une population d'exilés, de "blancs" aristocrates désormais appauvris, bousculés par le vent de l'histoire. Mais il ignore la guerre qui divise la Russie. Il vit à Bizerte, il est beau et pauvre, il a une soeur désirable, une mère veuve. Ce destroyer est-il " maskoun " ? Hanté, habité par un djinn, infréquentable pour le docker aux longs cils ? D'où vient le navire fantôme couleur d'âme grise ? Quel est son nom ? Que cherche-t-il à fuir ? Quelles horribles scènes de pogroms, de fermes incendiées quand les soviets lancent "le coq rouge" , pillent, tranchent au sabre et fusillent, quelles images hantent à jamais les passagers du Georguii Pobiedonossetz ? Depuis le 18 décembre 1920, les Russes sont confinés à bord des bateaux de guerre en rade de Bizerte. Des prisonniers flottants. Tarik aurait été avisé d'en rester là. Mais, comme le chant d'une sirène, le docker entend soudain la voix d'une jeune femme, une voix de théâtre, et il aperçoit, chatoyante, sa robe de mousseline blanche, gonfler sur le pont du navire. A l'instant il en est captif. Yelena Maksimovna Mannenkhova, fille unique d'un riche baron, personnage qu'on dirait issue de La Cerisaie, a la beauté fragile d'une porcelaine qui va se briser. Chaperonnée par sa tante Sofia, elle fuit la même horreur que toute une classe sociale gisant sans pouvoir s'en libérer dans les coursives d'un navire qui sera leur prison, et peut-être leur destin. Tarik parviendra-t-il à la rencontrer ? Avant que le cosaque Bissenko ne tranche la blanche gorge de notre héroïne ? Avant que la soeur du docker ne se marie ? Avant que le monde ne referme les rideaux d'un théâtre pourpre sang sur ces deux innocents ? Vivront-ils ?

Littérature française
Mémorial
La narratrice de ce très émouvant récit n'a cessé de vouloir échapper à ses origines, à sa famille : un frère et une soeur (son père et sa tante) indissolublement réunis pour avoir échappé à un passé trop lourd dont ils n'ont rien dit et qui ont fini par se murer dans une étrange maladie qui s'est attaquée à leur mémoire. Elle a essayé de répondre à leur attente en édifiant la vie qu'ils n'avaient pu avoir. Elle s'est éloignée mais, à la mort de sa grand-mère, a fini par revenir vers ce qu'elle avait fui. Et elle s'est résolue à entreprendre un nouveau voyage. Cette fois pour se rapprocher de l'événement douloureux qui est à l'origine de leur exil, de cette histoire qui est aussi la sienne. Ce détour, ou ce retour, lui étant soudain apparu comme une étape indispensable pour être enfin libre de s'en aller ailleurs. Le livre est le simple récit de ce voyage en train - l'attente interminable sur les quais de la gare de départ, le voyage lui-même avec ses rencontres, les conversations de compartiment, le séjour dans une ville étrangère qui est pourtant aussi la sienne, celle d'où vient sa famille : Kielce, en Pologne, où eut lieu, un an après la fin de la guerre, en 1946, un terrible pogrom. Mais les petits événements qui émaillent tout voyage dans un pays inconnu dont on ignore la langue sont sans cesse enrichis de toutes les pensées qui assaillent la narratrice, des voix intérieures qui la traversent. Progressant vers ce lieu d'origine, elle ne cesse, à partir des bribes que lui ont transmises ceux qui à force d'oublier pour pouvoir vivre ont fini par tout oublier, de reconstituer ce qu'elle a pu apprendre d'un autre voyage : celui de tous ceux qui tentaient de fuir ce même pays, à l'annonce d'un malheur encore indéfini. Des fantômes surgissent, comme celui de cet oncle qui s'est noyé dans la rivière qui traverse la ville, celui qui aurait voulu être médecin. Dans le train, la rencontre d'une jeune femme qui vit à Oswiecim et n'a pu quitter la ville malgré le poids de l'histoire ne fait que la conforter dans l'idée que le souvenir est le pire poison. Arrivée dans la petite ville, les voix se font encore plus insistantes, comme si elle avait été irrésistiblement entraînée au pays des morts, elle y retrouve la rivière noire et ces eaux sombres, ce Styx au bord duquel un guide mystérieux lui rappelle que les leçons du passé n'ont servi à rien. Elle découvre au cimetière les quelques tombes juives qui ont échappé à la destruction. Une dernière conversation avec l'oncle disparu (car c'était lui qui l'avait guidée) la laisse engourdie de stupeur et de froid, ayant compris que "l'au-revoir" qu'elle cherchait est en réalité impossible. Elle ne peut que repartir et, revenue auprès des siens, décider de se plonger comme eux dans le sommeil de l'oubli. Mémorial était originellement paru en 2005 aux éditions Zulma.
02/2019
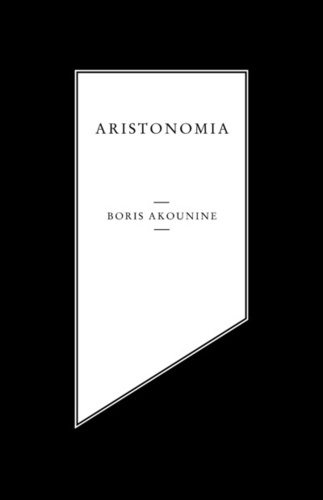
Littérature étrangère
Aristonomia
Aristonomia est le premier volet de la trilogie Album de famille, sorte de récit du XXe siècle russe au travers du prisme du destin d'une famille. Le premier volume est consacré aux années 1910, à la révolution et la guerre civile. Le second, aux années 1920 et le dernier aux années 1930. Mais Boris Akounine revendique également avec Aristonomia une entreprise littéraire expérimentale visant la synergie des deux vocations de l'écrivain : le dramaturge et l'érudit. Non pas un " projet commercial ", mais, dit-il, son " oeuvre la plus personnelle ", en gestation depuis son adolescence. D'affinité stendhalienne, cette oeuvre l'est d'autant plus qu'elle met en récit un Julien Sorel de la Russie du début du XXe siècle. Anton Kloboukov, personnage central écartelé entre les deux moitiés contradictoires de la nation : la rouge et la blanche, comme en écho à d'autres romans russes majeurs tels que Le Don paisible de Mikhaïl Cholokhov ou Le Docteur Jivago de Boris Pasternak. Avec, en filigrane, la quête philosophique d'un principe sublimatoire de la personnalité que le romancier-philosophe désigne par le terme d'aristonomie. Le roman s'ouvre à Petrograd, peu avant la chute de Nicolas II, pendant la révolution de février 1917. Le destin d'Anton Kloboukov, jeune étudiant en droit, fils d'un grand professeur, sera influencé par la rencontre avec deux anciens étudiants de son père : Pankrat Rogachov, bolchevique engagé, idéaliste, qui occupera des fonctions importantes dans la Tcheka, la police secrète de Dzerjinsky, et Piotr Berdichev, partisan de la cause blanche, fidèle au baron Wrangel, le dernier espoir des anticommunistes. Après la mort de ses parents, Anon vit une brève aventure avec Pacha, l'ancienne servante familiale. Mais leur relation passionnée s'achève lorsque, rentré après plusieurs semaines en prison, Anton est invité par elle à vivre dans un ménage à trois avec un de ses camarades bolcheviques. Il quitte la maison, cherche un emploi de gardien de nuit dans une maison aisée, mais il est soupçonné d'être un agent bolchevique. Avec l'aide de Berdyshev, vieil ami de la famille, Anton s'échappe en Finlande, passe par l'Allemagne et finit en Suisse. Il trouve du travail dans un hôpital à Zurich et gagne la confiance d'un chirurgien particulièrement talentueux qui le persuade de suivre une formation d'anesthésiste. Il tombe amoureux de Victoria, la compagne d'un jeune homme riche gravement malade, Laurence. Mais cette dernière l'éconduit. Il décide alors de rentrer, rongé par un sentiment de culpabilité. Il arrive à Sébastopol, au moment où l'Armée blanche est en retraite en Crimée et il y retrouve ses anciens amis. A leur contact, les convictions d'Anton vacillent et il finit par admettre que la force est parfois nécessaire et que les blancs auraient du mal à tenir tête aux rouges. Prisonnier des Polonais, il aidera un Cosaque rouge, grâce aux connaissances médicales acquises à Zurich. " C'est le moment le plus important dans ma vie ", pense Anton. La scène, très émouvante, n'est pas sans rappeler Platon Karataev et Pierre Bezoukhov dans Guerre et Paix, de Tolstoï. Peu de temps après, il assiste impuissant à un pogrome. Le roman s'achève sur une note de désespoir : Anton envisage une vie solitaire afin de se consacrer à rendre compte de ces événements tragiques. La construction du roman est particulièrement intéressante. Chaque partie " romanesque " (le roman d'Anton) est suivie d'une sorte de didascalie comprenant le point de vue de l'aristonome, sorte de pensée de l'" homme parfait " ; et le lecteur peut aisément faire lien avec Anton, le personnage central. C'est le moment où auteur et personnage ne font plus qu'un. Original, inattendu, risqué, le syncrétisme littéraire porté par l'auteur mérite à nos yeux de connaître un prolongement en version française.
09/2017
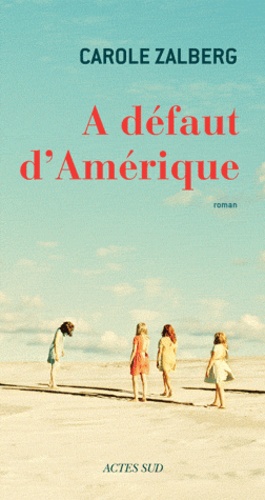
Littérature française
A défaut d'Amérique
Dans un cimetière parisien, on enterre une vieille dame. De loin, une femme observe la scène : Suzan a débarqué de Floride le matin même. A présent qu’Adèle n’est plus, l’Américaine se demande si elle a eu raison de détester cette femme qui a séduit son père, Stanley, alors jeune soldat, pendant les folles journées de la Libération de Paris, en 1945. Pourquoi elle a été irritée, voire jalouse, de l’exorbitante aptitude au bonheur qu’ont manifestée ces platoniques tourtereaux octogénaires qu’elle a tardivement réunis à Palm Beach pour tenter de consoler son père de son veuvage. Peut-être parce que la vieillissante “Jewish American Princess” qu’est à présent Suzan n’a jamais été douée pour la vie, n’a jamais su aimer - seulement obéir ? Que, brillante avocate, elle a perdu foi en son métier, se shoote au jogging pour oublier ses frustrations, et que, divorcée, ayant fait le choix de ne pas avoir d’enfants, elle n’a rien à transmettre ? Adèle, au moins, c’était la vie, excessive, débordante. Une spectaculaire survivante - aux pogroms en Pologne, à l’exil en France, à deux guerres mondiales, à l’exode - même les camps l’avaient épargnée. Mais est-ce que cela donne tous les droits et surtout celui de la rendre elle, Suzan, encore plus malheureuse ? Près de la tombe, une femme se tient un peu à l’écart du groupe : Fleur a aimé son arrière-grand-mère, Adèle, au moins autant qu’elle a fini par détester Sabine, sa mère dépressive, et toutes les autres femmes de sa lignée. Elle s’est fabriqué une famille à elle, résolument “inédite”, avec ses trois amours : son mari Julio venu d’Argentine et leurs deux fils. Adèle a toujours fasciné Fleur, avec son vouloir-vivre impérieux et presque tyrannique, son adaptabilité, depuis l’enfance, aux situations les plus tragiques, sa séduction dévorante (dont toutes les photos attestent) restée intacte, malgré les épreuves inhumaines de ces années passées à Paris - dans le quartier de Beaubourg où les réfugiés juifs avaient refondé leur communauté meurtrie et précaire -, avec sa capacité têtue, épuisante, à réaliser de petits miracles, à sauver des vies autour d’elle, à commencer par celle de l’amour de sa vie, son mari, Louis, auquel, jusqu’à la fin, elle est restée fidèle. Cette personnalité rayonnante - ou écrasante, c’est selon - qui n’a cessé d’éblouir son vieux père, l’Américaine n’en a eu, à Palm Beach, qu’un bref aperçu, et de surcroît dans sa “version senior”. Si, comme Fleur (qui va bientôt s’y employer afin de prendre, à travers Adèle, la mesure de la seule hérédité qu’elle accepte de se reconnaître), elle se plongeait dans l’histoire individuelle d’Adèle et dans la grande Histoire que celle-ci a, plus que traversée, incarnée, elle en saurait davantage sur “la française”, sa “rivale”, et sur la communauté de souffrance et d’amour dont elle est issue et d’où elle a tiré sa force exceptionnelle. Elle saurait comment Etele est devenue Adèle. Mais, comprend-elle alors, elle a peut-être, elle aussi, “son” Adèle en la personne de Sophia, sa tante, la sœur de sa mère, mondialement célèbre pour avoir été la première femme blanche à militer contre l’Apartheid en Afrique du Sud où elle a fait le choix de s’installer, plus de cinquante ans auparavant. C’est donc par le truchement indirect de “la française” honnie que Suzan va, à la veille des attentats du 11 Septembre, rejoindre à Cape Town, cette autre vieille dame afin de renouer avec la vérité de son histoire de fille trop peu curieuse, et découvrir enfin en quoi sa propre mère, Lisa, a, forte de renoncements assumés, embrassé une autre forme d’héroïsme, plus modeste, auquel il convient sans doute de donner le nom d’amour. Par delà sa capacité à nouer ensemble, sur trois générations et sur trois continents, les fils de l’histoire individuelle et collective, le roman de Carole Zalberg se signale par sa capacité à détourner, subtilement, le “roman de la filiation” de sa mécanique obligée, à en proposer une lecture ouverte. En confrontant l’exil subi (Adèle) ou choisi (Sophia), à l’errance, “sans étiquette”, d’une Américaine presque ordinaire (Suzan) ou au périlleux voyage dans l’interprétation du passé (Fleur), sans jamais instaurer, entre ses personnages, de suspecte hiérarchie, Carole Zalberg nourrit son roman d’une décision d’écriture qui en féconde admirablement l’ambition et la sensibilité. A nouveau crédités de l’humanité profonde qu’ils ont un jour eux aussi incarnée, les fantômes y gratifient l’existence de ceux qui prennent leur suite sur la scène du monde d’un legs d’amour et de souffrance, qui, sans consoler quiconque de vivre ou de mourir, façonne l’authentique présence que les vivants sont tenus de s’accorder à eux-mêmes, faisant de la découverte de l’autre la condition d’une authentique connaissance de soi.
02/2012
