petent
Extraits

Actualité et médias
L'ennemi du peuple
09/2019
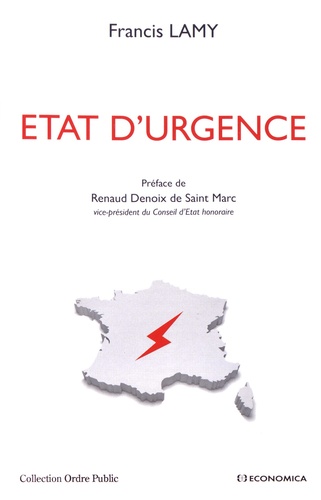
Droit
Etat d'urgence
06/2018
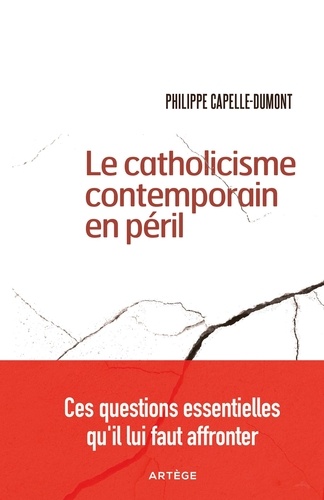
Vie chrétienne
Le catholicisme contemporain en péril. Ces questions essentielles qu'il lui faut affronter
02/2022
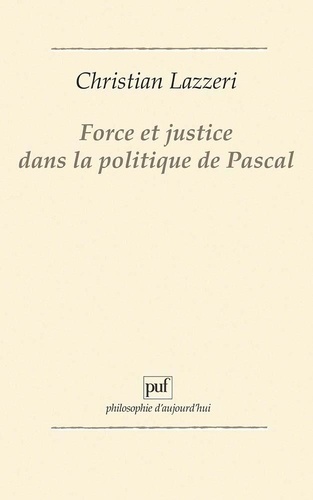
Philosophie
Force et justice dans la politique de Pascal
05/1993
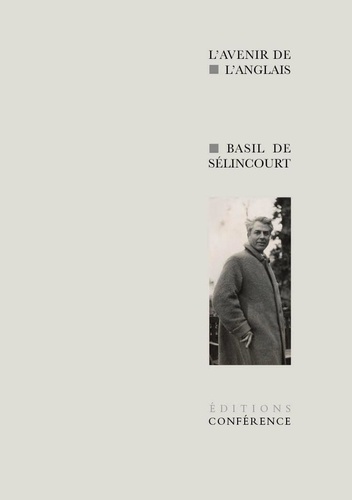
Linguistique
L'avenir de l'anglais
06/2023
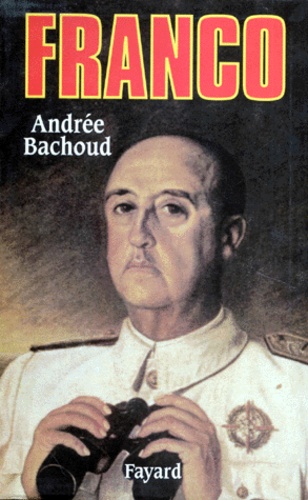
Histoire internationale
FRANCO. Ou la réussite d'un homme ordinaire
09/1997
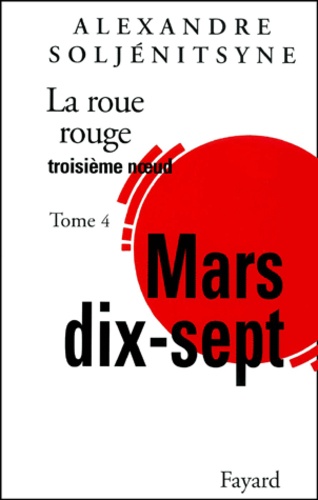
Littérature étrangère
La Roue rouge Tome 4 : Mars dix-sept
08/2001
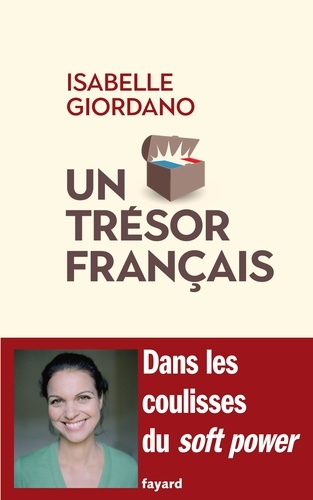
Actualité médiatique France
Un trésor français
06/2021
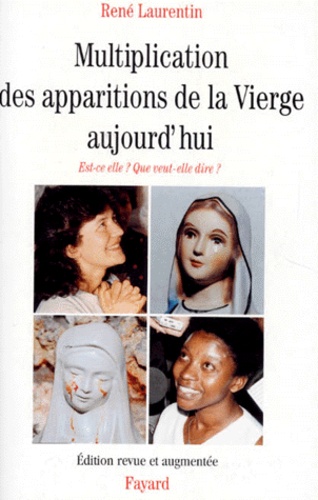
Religion
MULTIPLICATION DES APPARITIONS DE LA VIERGE AUJOURD'HUI. Est-ce elle ? Que veut-elle dire ?
10/1995
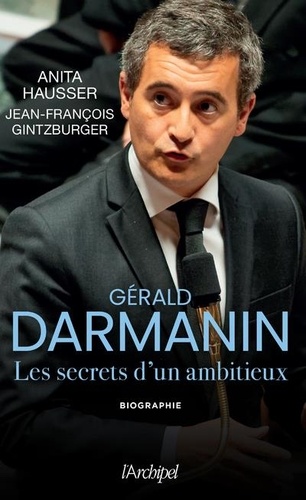
Actualité politique France
Gérald Darmanin. Les secrets d'un ambitieux
11/2021
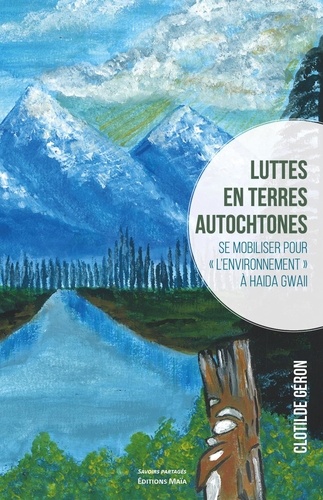
Littérature française
Luttes en terres autochtones. Se mobiliser pour "l'environnement" à Haida Guraii
11/2021
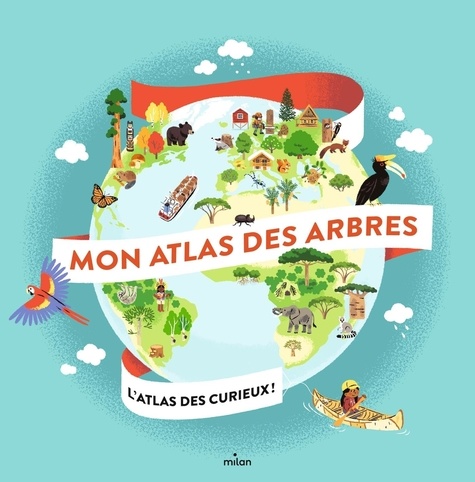
Atlas
Mon atlas des arbres
09/2023
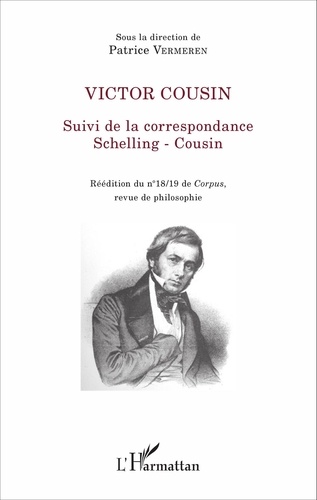
Philosophie
Victor Cousin. Suivi de la correspondance Schelling - Cousin
08/2016
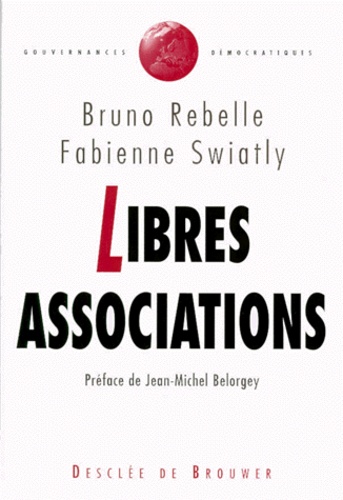
Droit
Libres associations. Ambitions et limites du modèle associatif
01/1999
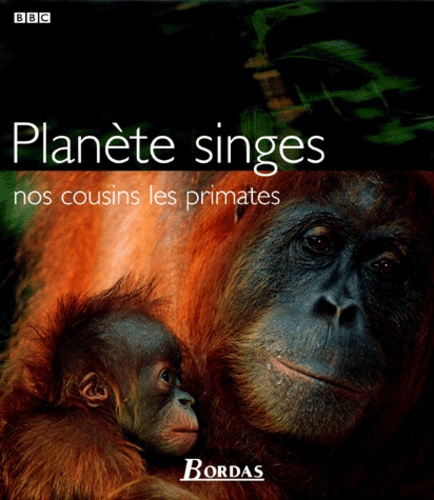
Animaux, nature
Planète singes. Nos cousins les primates
10/2001
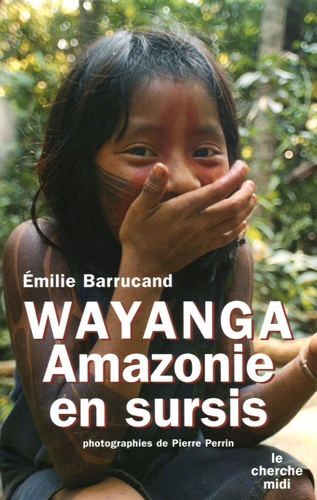
Ethnologie et anthropologie
Wayanga. Amazonie en sursis
10/2005
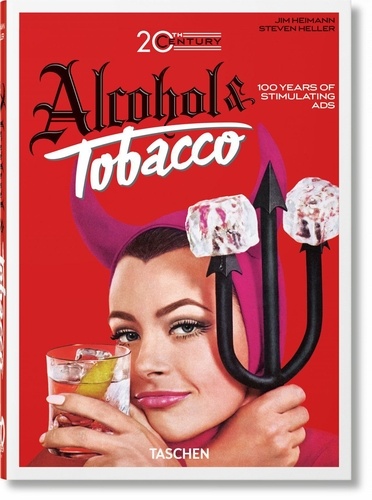
Publicité
20th Century Alcohol & Tobacco Ads. 40th Ed.
11/2022
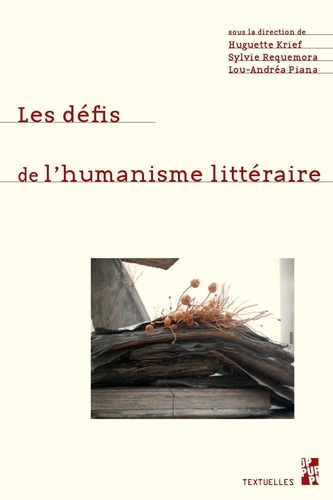
Critique
Les défis de l’humanisme littéraire
10/2022
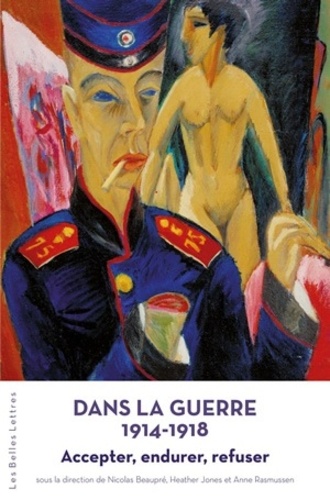
Histoire de France
Dans la guerre 1914-1918. Accepter, endurer, refuser
09/2015
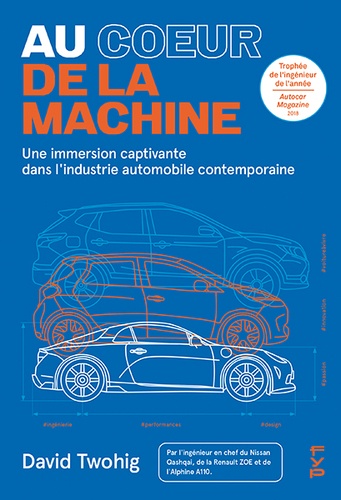
Design
Au coeur de la machine. Une immersion dans l'industrie automobile moderne
09/2023
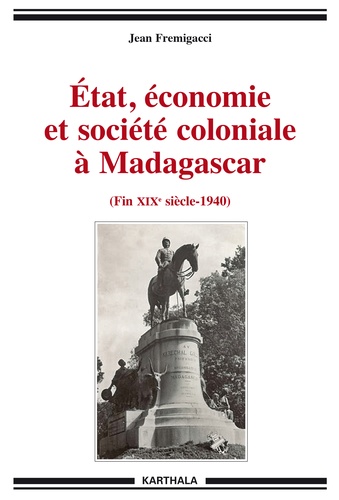
Histoire internationale
Etat, économie et société coloniale à Madagascar. De la fin du XIXe siècle aux années 1940
04/2014
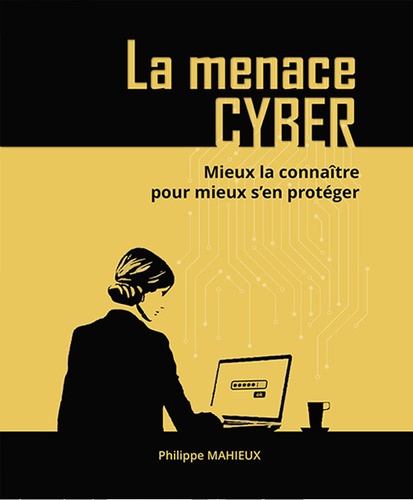
Sécurité
La menace cyber. Mieux la connaître pour mieux s’en protéger
03/2024
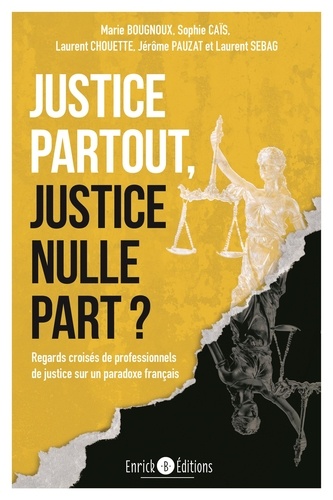
Institutions judiciaires
Justice partout, justice nulle part ? Regards croisés de professionnels de justice sur un paradoxe français
10/2023
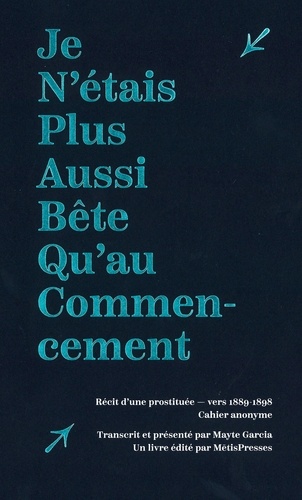
Sociologie
Je n'étais plus aussi bête qu'au commencement. Cahier manuscrit relatant la vie d’une prostituée anonyme — 1890
10/2023
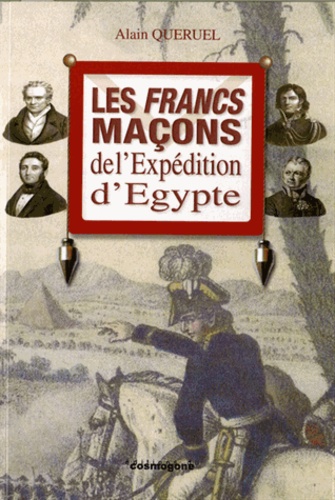
Esotérisme
Les francs-maçons de l'Expédition d'Egypte
02/2012
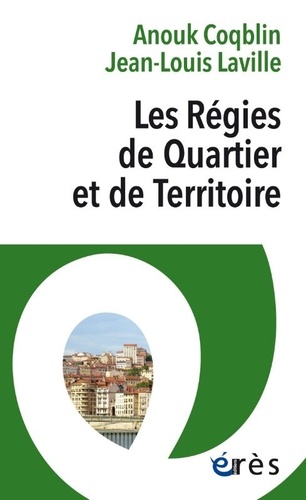
Sociologie urbaine
Les Régies de Quartier et de Territoire. Entre pratique instituante et démarche citoyenne
06/2023
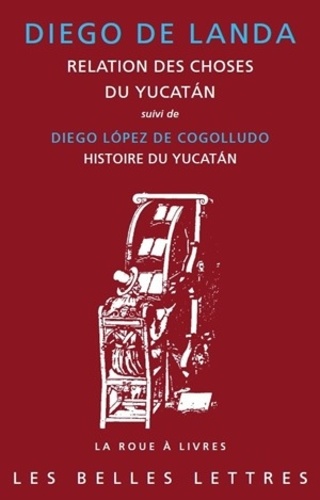
Histoire internationale
Relation des choses du Yucatàn (1560). Diego López de Cogolludo, Histoire du Yucatán (1660), Livre IV - Chapitres I à IX
12/2014
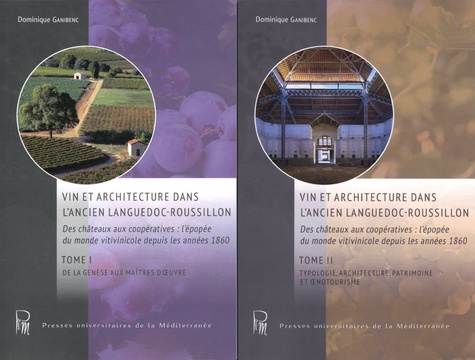
Vins et savoirs
Vin et architecture dans l'ancien Languedoc-Roussillon. Pack en 2 volumes : Tome 1, De la genèse aux maîtres d'oeuvre ; Tome 2, Typologie, architecture, patrimoine et oenotourisme
06/2021
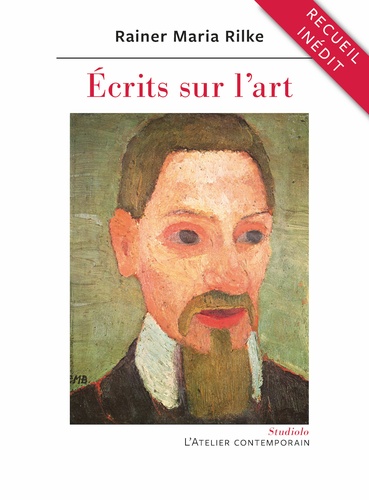
Ecrits sur l'art
Écrits sur l'art
10/2023
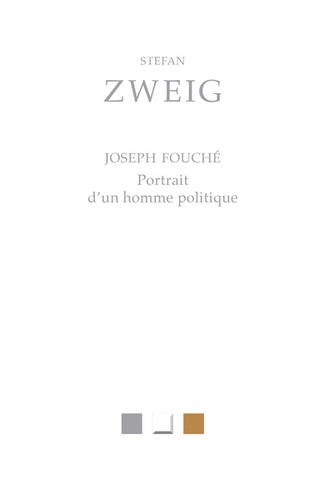
Histoire des idées politiques
Joseph Fouché. Portrait d’un homme politique
10/2021

