Bratislava 68, été brûlant
Viliam Klimacek
« Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kdesi ďaleko pristával obrovský antonov za antonovom. Snáď všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná, a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. »
Tableau un : Asphalte
* * *
En démocratie populaire tchécoslovaque, la seule voiture d’après-guerre reçut un honorable nom qui faisait penser aux anciennes dynasties anglaises.
Škoda Tudor. C’est ainsi que l’avait nommée le peuple. Elle rappelait les chevaux en armure maladroits sur lesquels les preux chevaliers d’Albion se ruaient au combat pour Dieu, le roi ou la patrie, bien que Staline, Lénine et Marx fussent la tendance.
Elle était tout en rondeur, bruyante, suintant l’huile, d’une fourrure faite davantage de métal que de verre. Plus de balourdise que de noblesse, plus de boucan que de puissance. Le mot « design » n’était pas encore à la mode ; et sous le capot, la technologie restait bien loin de l’univers aristocratique.
Mais l’époque était propice aux surprises. Les concepteurs de la marque Škoda misèrent sur l’éducation classique et déclinante du peuple ; après une Škoda Octavia plus nerveuse, ils proposèrent un autre modèle qu’ils appelèrent la Felicia.
La bienheureuse.
Un élégant cabriolet qui brillait sur l’asphalte tchécoslovaque telle une orange sur un tas de pommes de terre.
Dans l’imaginaire de la félicité de cette époque, il y avait également le réfrigérateur, la machine à laver et le téléviseur. Objets de rêve pour des milliers de foyers, comme n’importe quelle voiture d’ailleurs, sans même parler de la Felicia. La posséder faisait de vous un être exceptionnel. Mais pas dans le sens de la force, pas aussi exceptionnel que l’élite politique qui roulait en Cajka soviétiques. Encore moins exceptionnel que les autorités régionales dans leurs Tatra 603 nationales. Il s’agissait d’un esprit*1. Le club des conducteurs de Felicia formait une élite non officielle. Une sorte de clin d’œil.
Conduire une Felicia en juin 1968, alors que débute ce récit, n’était plus aussi exceptionnel que quelques années auparavant. Mais pour un citoyen dont le pays était cerné de fils barbelés, elle restait la voiture dans laquelle il pouvait se sentir aussi libre, l’espace d’un instant, que James Dean sur la route 66.
Alexander aimait conduire. Il n’avait pas besoin de ce sentiment de toute-puissance que sa voiture reflétait dans les yeux des passants. Pas un seul jour ne s’écoulait sans qu’on le salue de la main. Il répondait toujours. Cela faisait partie de la politesse. Saluer de la main, dans la région d’Alexander, était une longue tradition. Il n’appartenait pas au groupe de ceux qui saluent de la main sur le trottoir, mais au groupe de ceux qui reçoivent les salutations sur le siège de leur belle voiture.
Alexander occupait un poste dans l’unique entreprise tchécoslovaque de matériel médical. Cette société s’appelait Sanola. Combien de fois ne l’avait-il pas fait visiter à des sommités ! Parmi elles, il y avait le chirurgien Barnard, qui avait réalisé la première transplantation cardiaque humaine au monde.
Guère étonnant qu’un jour Šani2, comme on l’appelait à la maison, achète une voiture qui attire les regards envieux comme la flamme d’une bougie attire les papillons de nuit. Dans un pays où la liste d’attente pour obtenir une voiture était longue, la corruption était un passage obligé. Cependant Šani n’avait soudoyé personne.
Il s’était arrangé pour que l’hôpital où les ouvriers des usines automobiles se faisaient soigner soit le premier à recevoir un respirateur attendu par toute la République. Ensuite, le boomerang de la gratitude lui revint sous la forme de la voiture que les collégiens avaient en photo sur leurs murs, à côté des courbes lascives de Brigitte Bardot. Avec son petit bijou mécanique, Šani était devenu aussi original qu’une orchidée sur un bleu de travail. Il perturbait malgré lui. La voiture marqua une certaine distance entre ses collègues et lui, mais cela ne le dérangeait point.
Il ne souhaitait plus s’élever dans sa carrière. Être directeur technique avait été le but ultime de ses efforts, et il n’avait aucune envie de lutter pour cinq mille couronnes de plus.
Il y avait assez d’alpinistes de carrière qui grimpaient autour de lui, et qui ouvraient les portières de petites Škoda, s’asseyaient sur les sièges de Wartburg à deux temps ou roulaient sur des Jawa ; ils avaient tous un petit jardinet de dix sur quinze avec des rangées de carottes et de pommes de terre primeur, et des enfants qui avaient terminé leurs apprentissages de tourneur ou de vendeuse.
La fille de Šani avait fini l’école de médecine une semaine auparavant. Dans une petite ville, avoir un enfant qui réussissait était source de jalousie, alors ne parlons même pas d’une voiture extravagante. Si vous cousez votre rêve sur un drapeau, vous vous réveillerez bien avant de réussir à l’agiter.
Seulement, Šani pouvait rêver tranquillement. Il n’était pas un mortel ordinaire. Il était membre du Parti communiste. En Tchécoslovaquie, sans la carte rouge à petite étoile, il vous était impossible de faire une bonne carrière et de faire pleinement valoir vos connaissances. Quand Šani devait dire « nous les communistes », il avalait timidement le « c ». Šani était juste « ommuniste ». Parmi les premiers camarades de la ville, ce qui était douteux. Et de tous les douteux, il était le premier.
Il ne savait pas jusqu’à quand cette situation se maintiendrait. La physique d’un tel phénomène s’appelle « équilibre précaire », mais Šani, à peine un millimètre au-dessus du vide, ne devait pas cet évitement de la chute à sa situation, mais plutôt à l’époque qui fit plus tard son entrée dans les manuels scolaires sous le nom de « réchauffement politique ».
Pour monter au ciel, c’est toujours plus loin depuis la province. Quand le fœhn réformateur du printemps de Prague 68 souffla jusque-là, Šani réalisa que le froid y était encore glacial. À Stara Ruda, du point de vue sociétal, on n’était pas sorti de l’hiver 1965.
Mais dehors, le temps était merveilleux. C’est aussi pourquoi, en ce dimanche matin de juin, Šani ouvrit le garage, vêtu d’une chemisette, et sortit sa Felicia en reculant. Il cria à sa femme :
— Alors tu viens, s’il te plaît ? On ne sera même pas arrivés ce soir.
— Prends un gilet.
— Je fermerai le toit ouvrant.
— Quand même.
Anna lui tendit un gilet noir et jaune qu’elle avait terminé seulement la veille. D’un œil critique, elle vérifia qu’il n’y avait pas de maille lâche. Le gilet était sans défaut. Elle posa ensuite son regard sur la voiture familiale. Si, juste avant, son regard rayonnait de tendresse, caressant les boutons en forme de fleurs, celui-ci se transforma en une foudre qui consumait jusqu’au charbon.
Elle détestait cette voiture. Elle détestait son toit ouvrant. Elle détestait les courants d’air. La Felicia était un caprice de son mari, elle préférait l’ancienne Tudor démodée, dont ils s’étaient débarrassés des années plus tôt, mais dans laquelle le vent ne s’engouffrait pas.
À quoi ressemble une femme qui ressent un dégoût sincère à l’évocation même du mot « cabriolet » ? Je vous laisse deviner. Dans ce roman, j’omets volontairement la description des personnages et des paysages. Je les saute à votre place. Lecteur, je les ai toujours survolées et je vous imagine un peu comme moi, pour cette raison j’espère que ce rembourrage ne vous manquera pas.
Il suffit de savoir que la femme de Šani avait une petite quarantaine, soit quelques années de moins que son mari, qui enfila son gilet rayé d’un air bougon.
— Je ressemble à une guêpe.
— Mets-le quand même. Il va y avoir du vent.
En Tchécoslovaquie à cette époque-là, il était coutume de faire du crochet, du tricot, du batik et parfois aussi du macramé, dans les cuisines normalisées.
Les Italiens faisaient des pâtes maison, les Slovaques, de l’art.
Ils soudaient des capsules de bière pour en faire des lièvres tambourinant, accrochaient au mur des napperons synthétiques aux soleils couchants flamboyants, déposaient sur les étagères du bois mort vernis qui, après d’intenses efforts pour se réjouir de peu – ô combien nécessaires pour vivre dans un tel pays –, leur faisait penser à la sirène du Balaton.
Anna et Šani tiennent une discussion matinale ordinaire, durant laquelle ils ne parviennent guère à dissimuler leur étonnement : leur petite Petra a déjà quitté l’école maternelle en bois, l’école élémentaire en brique, le lycée en béton, l’université en marbre, elle est depuis peu diplômée de la faculté de médecine et ils vont justement la déménager d’un appartement privé de Bratislava.
Démarrage.
« Roule moins vite, s’il te plaît. »
« Ne double pas. »
« Laisse-le passer. Qu’est-ce qu’il peut te coller ! »
« Fais attention au poids lourd ! »
« T’as vu qu’il n’a pas d’essuie-glaces ? »
Cela faisait deux heures que durait le monologue théâtral du passager. Comme chez Beckett, Anna dans le rôle de Winnie, enfouie dans le siège de la Felicia jusqu’à la taille au lieu d’être dans le sable, et Šani dans le rôle de Willie, récipiendaire silencieux des paroles de sa partenaire qu’il gratifie toutes les demi-heures d’un regard qu’elle prend pour un sourire, histoire de passer une journée vraiment heureuse.
L’autoroute n’existe pas encore. L’entonnoir qui achemine le flux intense de la circulation jusqu’à Bratislava s’appelle la « route internationale E 16 », mais elle n’a d’international que le « E ». Une route étroite à deux voies où chaque dépassement est une véritable prouesse de cascadeur, car plus une voiture lente accélère, plus la fierté de son chauffeur s’enflamme. Doubler, c’est gagner. Doubler une Felicia rouge clinquant avec une Trabant bleu clair en matière plastique signifie faire le plein de confiance en soi pour une semaine.
Dans une République tchécoslovaque de laquelle aucune souris ne s’échappe sans la faveur de l’administration, un citoyen ne peut s’affranchir de sa frustration que de trois manières : « sexer », voler ou bien doubler. Généralement, il pratique le sexe à la maison, double sur l’asphalte et vole surtout au travail.
Efficacement bridé par Anna, Alexander subit à chaque instant l’orgasme des autres conducteurs accompagné de puissants coups de klaxon. Faut dire qu’il s’en fout. Après deux heures et demie de route, des dizaines de villes et de villages traversés, Šani rompt le silence.
— Bratislava.
La ville les accueille avec la puanteur de l’usine de produits chimiques Dimitrovka, avant même les panneaux routiers. De plus en plus souvent, des étoiles en métal, des faucilles et des marteaux en béton clignotent en alternance avec des publicités pour la paix et le socialisme. Des lettres jaunes sur banderoles rouges font la propagande de ce slogan, enjolivant les façades d’immeubles décrépites dont on a honte aujourd’hui. Le style de la Sécession et du classicisme sont étrangers à nos jours et, plutôt que de restaurer le crépi ou les toits des palais, on travaille à rénover l’économie qui dévore l’avenir des habitants et de leurs enfants. Un tramway sonne et Šani ralentit.
1. Les mots en italique et suivis d’un astérisque sont en français dans le texte.
2. Diminutif courant d’« Alexander ».
Tableau deux : Chambre privée
* * *
Petra ne voulait plus être étudiante. La vie d’étudiante ne l’amusait plus. Elle souffrait.
En première et deuxième années, elle fréquentait les étudiants de son groupe, allait dans les bars à vin et ratait le dernier moyen de transport, de sorte que tout le monde rentrait à pied en chantant dans la ville nocturne. Ces jeunes venaient de toute la Slovaquie et habitaient à l’internat.
Petra aimait étudier. Elle savourait les mots latins qui peignaient dans son cerveau de belles images, même s’ils désignaient des maladies douloureuses. Semestre après semestre, les polycopiés devenaient de plus en plus épais, et l’internat ne permettrait guère de se concentrer. Même si les compagnons d’étude les plus bohèmes avaient depuis longtemps regagné leurs Topoľčany et Snina natales, nombre de ceux qui avaient échoué aux examens partageaient équitablement leur énergie entre l’étude et la boisson. C’était épuisant, mais qui mieux qu’un jeune peut tout supporter ?
L’alcool était la marijuana du socialisme. Et quiconque a vingt-deux ans a parfois besoin de planer. Pour pouvoir terminer ses études, elle devait quitter l’internat. Week-end après week-end, elle fuyait chez ses parents, surtout l’hiver. Petra et la neige, un coup de foudre. Elle était excellente skieuse et, à neuf ans, elle avait maté les collines de Stara Ruda avec ses skis. Elle aurait pu devenir une sportive de haut niveau, elle avait été appelée pour intégrer l’équipe junior de la République, mais elle voulait faire du sport pour le plaisir et non pas pour vivre. Elle ne voulait pas s’exprimer par le corps, elle choisit la tête et fit bien.
Elle n’avait pas d’amie fidèle mais uniquement des « salut-copines ». En quatrième année, elle ne faisait qu’étudier. Elle dormait avec du coton dans les oreilles parce que les filles dans la chambre ne cessaient de pouffer de rire. Petra leur tapait sérieusement sur le système, et quand son père trouva enfin une chambre privée, tout le monde respira.
Les deux dernières années, elle vécut au 23, rue Panenska. Il lui tardait tellement de mettre un terme à sa vie d’étudiante que lorsque le doyen lui remit son diplôme, elle le lui arracha presque des mains. L’amphithéâtre plein à craquer de parents mit cette réaction sur le compte du trac de la jeune docteure et la gratifia d’un rire sympathisant.
Quitter l’école au plus vite et faire quelque chose. Six ans, c’est terriblement long quand vous êtes jeune et que vous ne savez pas quoi faire. Petra ne savait pas ce qu’elle voulait, mais elle savait parfaitement ce qu’elle ne voulait pas. Elle ne voulait plus être jeune. Il lui semblait excitant d’entrer dans l’âge adulte, d’oublier les polycopiés, de travailler à l’hôpital et de prendre des gardes de nuit jusqu’à épuisement. Et de skier sur son temps libre.
Deux ans auparavant, elle avait fait la connaissance de Tereza, qui préparait le bac au lycée de la rue Metodova. C’était la fille des gens qui la logeaient. Petra adorait leur vieil appartement au deuxième étage avec vue sur le jardin évangélique. Elle ne comprenait pas pourquoi cet appartement était devenu inconfortable pour Ferdinand, le père de Tereza, un ami de Šani. Vivre dans un lieu est une chose, être de passage en est une autre.
L’immeuble centenaire avait vécu. La peinture des volets s’était écaillée, le crépi était tombé, les chéneaux étaient rouillés et l’on se chauffait au charbon. Un interminable escalier menait en haut. Tereza ne pouvait s’imaginer vivre ailleurs. Si elle était la sœur que Petra avait toujours rêvé d’avoir, sa mère Maria remplaçait provisoirement Anna. Dans cette famille de substitution, il y avait aussi Janko, un petit observateur de dix ans, qui suivait avec admiration la locataire débordée de livres, et qui posait soudainement des questions qu’il lisait dans les manuels de cours ouverts.
— Ostéomyopathie ?
Et il s’échappait de la chambre en courant.
Il n’y avait pas de caractères plus opposés que Tereza le soleil et Petra la lune. Et ce n’était pas plus silencieux qu’à l’internat – peut-être même plus bruyant – puisque cinq personnes vivaient d’un seul coup dans un appartement de deux pièces et demie, mais il flottait dans l’air une odeur plus chère que le parfum de contrebande de Vienne.
La tolérance.
Le son de l’orgue s’échappait de l’imposante église évangélique, en face de laquelle se situait la fenêtre ouverte de la chambre où les jeunes filles étudiaient. Il ne jouait pas de mélodie concrète, le musicien s’entraînait seulement les doigts. Si un joueur de tambour se met à jouer, vous avez l’envie de danser, mais quand il s’agit d’un organiste, on entre en introspection.
La voix de Tereza interrompit Petra.
— Ce jardin m’a toujours paru mystérieux. Et cette musique… Étrange, solennelle. Plus grande que moi. Tu penses que c’est pour que les gens là-bas…
Elle fit un signe de tête en direction de la clôture derrière laquelle de jeunes prêtres se promenaient.
— Pour que quoi ?
— Pour qu’ils aient peur de Dieu ?
Petra avait une vision du monde bien claire depuis longtemps.
— Je ne crois pas. Quand j’étais petite, on m’a dit :
« Regarde Pet’ka1, pour certains, Dieu existe, pour d’autres, non. On ne te forcera à rien, si tu veux aller à l’église, vas-y, on ne t’en empêchera pas. »
— Et tu y es allée ?
— Une fois. Il faisait froid, l’air était irrespirable. Père a fait ça de manière raffinée. Il m’a laissé libre de faire mon choix, mais ma mère et lui n’y sont pas allés. Et ils n’ont jamais fumé. L’exemple est plus fort que mille mots. C’est pour ça qu’aujourd’hui je ne fume pas et que je ne sais pas prier. Et toi ?
Tereza lui jeta un coup d’œil.
— Un peu.
— Comment ça, un peu ? Tu sais ou tu ne sais pas.
De la fenêtre, Tereza posa son regard sur les prêtres qui se promenaient. C’étaient de jeunes séminaristes. Elle leur fit signe de la main. Ils lui firent signe en retour et l’observèrent. Ils hochèrent la tête puis continuèrent leur promenade. Plus d’autre œillade vers la fenêtre.
— Celui avec les cheveux noirs, tu le vois ? Il m’a longuement parlé. Il voulait me convertir.
— Quoi ?
— Il m’a tout expliqué sur la religion, alors que moi je lui posais juste des questions sur l’orgue. Étrange, non ?
— Il t’a draguée ?! Tereza s’esclaffa.
— Concentre-toi sur ta médecine…
Petra se pencha sur ses cours et épela :
— Gynécologie et accouchement… me tapent sur les nerfs. Tu tentes les jeunes prêtres, ma belle, c’est un péché. Petra se leva et partit boire un verre d’eau dans la cuisine. Tereza enlaça ses genoux et se balança délicatement.
— En l’occurrence c’est eux qui m’ont adressé la parole. Il paraît que lorsqu’ils convainquent une brebis égarée, ils font une trèèès, trèèès bonne action.
À chaque « èèè » Tereza bâillait avec délice.
— Que se passe-t-il à l’intérieur ? Ces gens-là chantent avec l’orgue. Tous ensemble. Ça doit être beau…
— Tu n’es jamais entrée dans une église ?
Tereza hocha la tête.
— Nous sommes juifs.
C’est ainsi que, seulement trois semaines après avoir emménagé rue Paneska, Petra comprit qu’elle vivait dans une famille juive. Tout comme l’orgue de l’église pour Tereza, cette chose secrète que les gens des autres confessions s’efforçaient de comprendre dans le judaïsme, superficiellement mais sincèrement, fascinait Petra. Un soir avant de s’endormir, au lieu du conte habituel, son père lui raconta comment les Juifs de Stara Ruda avaient été déportés dans les camps de concentration sans qu’un seul d’entre eux ne revienne après la guerre.
Šani parlait depuis longtemps, ses yeux brillaient. La faible lumière d’un lampadaire perçait l’obscurité de la chambre.
— Imagine, Pet’ka, que ce soit nous. Un soir, ils frappent à notre porte, ils t’enlèvent de ton petit lit, ta maman et moi on est chassés en pyjama dans la rue, ils nous poussent dans des wagons à bestiaux, nous conduisent, une semaine sans manger, et quand on arrive sur place, ils nous séparent et jamais plus on ne se revoit…
— Père, arrête !
Anna surgit sur le seuil de la chambre, comme un nuage d’orage. Elle était vraiment en colère. Pet’a avait la tête cachée sous l’oreiller, et le lit tremblait des pleurs de la petite.
— Pourquoi tu fais ça ?
Alexander regarda sa femme puis enlaça le duvet sanglotant. Longtemps il lui murmura qu’il ne la laisserait jamais, que rien n’arriverait, que c’était du passé. Mais la tendresse paternelle est comme une lime à dégrossir qui râpe vite, mais qui ne lisse pas finement. Ainsi cette nuit-là, Anna dormit auprès de sa fille qui ne voulait plus la lâcher ; même endormie, elle s’accrochait à sa mère comme une tique. Jamais elle n’en voulut à son père de lui avoir appris de cette façon que les plus grandes saloperies du monde ne doivent pas être oubliées.
Alors elle avait terriblement honte de n’avoir rien noté de particulier au 23, rue Panenska. En fait, à part quelques petites choses sur le secrétaire, l’intérieur était ordinaire. Chaque vendredi midi, elle faisait le voyage chez ses parents et c’est pour ça qu’elle ne pouvait pas remarquer que la famille honorait shabbat. Elle lia immédiatement cette image aux paroles de son père, à celles qu’il avait prononcées lors de son emménagement : « Rentre chaque week-end. On ne peut pas les déranger tout le temps. »
Elle leva les yeux sur Tereza et le visage de celle-ci s’enflamma.
— Excuse-moi… je suis vraiment cucul ! Je m’introduis chez vous et je ne comprends rien !
Tereza sourit et hocha la tête. Elle était habituée aux hôtes de passage.
1. Diminutif courant de « Petra ».
Tableau trois : Notre Père
* * *
Quand les Hongrois se révoltèrent contre le régime communiste en 1956, et que Budapest brûla, ravagée par les chars russes, leur appartement de la rue Panenska accueillit une trentaine de fugitifs. Pas tous en une fois, mais petit à petit, et cela dura six mois, six mois sans chambre d’enfant pour Tereza parce que des hôtes y dormaient.
Son père avait rapporté du camp de concentration la conviction inébranlable qu’il fallait coûte que coûte aider autrui.
— Normalement, ta chambre t’appartient, mais en cas de problème on doit s’entre-aider.
Finalement, Petra devait aussi son logement à cette éthique de fer.
Rapidement, la petite Tereza comprit, elle était attentive. Des antennes invisibles avaient poussé sur sa tête. Elle savait qu’elle était juive, mais ignorait ce que cela signifiait. Elle se sentait différente des autres élèves de son école. Elle s’entendait mieux avec certains, car leurs parents se fréquentaient. Elle savait que certains étaient des leurs et d’autres non. Mais pourquoi en était-il ainsi ? N’en demandez pas trop à des antennes d’enfant.
Dans les années cinquante, ils accueillaient beaucoup de visiteurs. Tous parlaient de politique. L’enfant était assise avec eux, et même si elle ne saisissait pas les termes utilisés, elle comprenait la situation. Ils avaient deux mille livres à la maison ; Maria était rédactrice aux éditions Pravda, elle rapportait des volumes rares, pour soi et pour les autres, et les prêtait à l’occasion. Grâce à cela, Tereza feuilletait des ouvrages que les enfants de son âge n’auraient même pas eu l’idée de prendre entre leurs mains.
Une nuit, un bruit la réveilla.
Dans le salon, il y avait des connaissances de son père ; ils rangeaient la bibliothèque. Ils triaient les volumes, en descendaient certains à la cave, en déplaçaient d’autres derrière la première rangée pour les cacher. C’était l’année du procès de Slánský1, l’époque du pogrom inavoué contre les communistes juifs. La police nationale faisait des descentes imprévisibles et la possession d’ouvrages suspects pouvait s’avérer dangereuse.
Durant le procès, le père d’une copine avait été enfermé dans le même bâtiment du palais de justice où l’on emprisonna plus tard la fameuse meurtrière Irena Čubírková, qui avait brûlé son compagnon dans un four à pain avant de balancer sa tête dans les toilettes d’un train. C’était l’époque où l’État jugeait un prisonnier politique avec plus de sévérité qu’un criminel. La petite Tereza s’était faite à l’idée qu’il y avait toujours une connaissance en prison. Et qu’elle était certainement innocente. Il ne lui venait même pas à l’esprit qu’un ami de la famille puisse être puni pour vol ou agression. Elle savait que c’était à cause des mots.
Ils allèrent rendre visite au père de sa copine à la prison de Léopold. Par son apparence, il était complètement différent des autres prisonniers. Par son visage, par sa manière de se tenir, par ses gestes. Ce n’était pas un homme qui avait commis l’erreur de sa vie, mais un homme qui vivait dans la vérité. L’école de la vie apprit à l’enfant la notion d’« altérité » et ces impressions se gravèrent dans son cerveau, tels des hiéroglyphes sur une plaque de marbre.
Le père de Tereza dirigeait le trafic des trains de marchandise à la gare centrale. Le rail était à peine moins stratégique que l’armée. On y transportait de tout – du minerai, du charbon, des céréales, des armes. Chaque retard de wagon faisait l’objet d’une enquête. Exercer ce genre de travail vous donnait l’impression d’être surveillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. À chaque instant, vous étiez susceptible d’être accusé.
Ferdinand était communiste, comme la plupart des intellectuels juifs d’après-guerre. Il était logique d’adhérer à la force qui avait stoppé le nazisme. Quasiment toutes les familles juives, « familles » au sens large, comptaient parmi les leurs au minimum un membre du parti, par précaution. Ils n’avaient plus confiance en rien ni personne, sauf en les leurs.
Tereza devint une belle fille. Mais elle garda en mémoire cette nuit de sa treizième année, où elle était couchée dans le dortoir des filles lors d’une classe verte.
Elles étaient vingt. Avant le coucher, une professeure vérifiait l’ordre, leur souhaitait bonne nuit et éteignait les lumières. Les filles attendaient un peu, jusqu’au moment où elles n’entendaient plus de pas derrière la porte, puis elles sortaient de leurs lits. Elles s’agenouillaient sur le plancher et récitaient en cachette le Notre Père.
Tereza s’agenouillait avec elles. Elle ne voulait pas être différente. Elle ne pouvait pas. Elle ouvrait la bouche et répétait après elles, toujours en retard, et toujours avec des fautes. L’acte de prière se répétait de soir en soir, et systématiquement l’une d’elles annonçait une phrase à haute voix, et les autres reprenaient. Une fois, l’une des filles se tourna vers elle avec malice.
— Et si c’était Tereza qui priait à haute voix, pour une fois ?
Elle garda son calme et rétorqua :
— Bien sûr je le ferai, mais demain.
Pendant un instant on entendit des gloussements sourds et des chuchotements voilés. Toutes étaient curieuses de savoir ce que l’élève la plus populaire allait faire le lendemain soir.
Pour être sûres, elles le lui rappelèrent au petit déjeuner alors qu’elle portait son plateau de lait chaud et de petit pain au pavot.
— Tu vas prier aujourd’hui ?
Elle opina du chef.
— Pour sûr.
Elle mordit machinalement dans son petit pain, mais n’attaqua pas la garniture au pavot, comme à son habitude. Son corps fut inondé d’une vague chaude de panique. Après le petit déjeuner, elle se décida. Elle s’adressa à un professeur en qui elle avait confiance. Le seul. Il leur enseignait la physique. Elle lui expliqua son problème. Il la regarda et, après d’interminables secondes, il sourit et fit « oui » de la tête. Il l’emmena faire une promenade.
Il déclamait la prière mot à mot et Tereza la répétait. De cette façon, elle put, le soir venu, se prosterner les genoux nus sur un plancher qui sentait l’huile et réciter d’une voix sûre ces mots lointains qui s’écoulaient dans des phrases mystérieuses.
Avec ces mots, elle aborda une île inconnue où poussaient des plantes étranges et où galopaient des animaux jamais observés ; et dans les hauteurs inaccessibles tournoyaient des oiseaux menaçants. Elle n’entra pas pieds nus dans cette île. Elle y arriva à genoux.
— Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié…
Elle avait réussi, mais elle sentait qu’elle ne voudrait plus vivre ce genre de situation absurde si elle devait continuer d’avoir de l’estime pour elle-même. Ce n’était qu’un test parmi tant d’autres que la plupart des gens de son entourage n’auraient jamais besoin de passer.
Une fois la prière achevée, elle se releva, les genoux marqués, et se recouvrit d’une couverture qui gratte. Puis silencieusement, pour que personne ne l’entende, elle se mit à pleurer. C’était le prix des antennes.
1. Nom du principal accusé lors des procès de Prague de 1952, condamné à tort pour « révisionnisme ».
Tableau quatre : Tunnel
* * *
Le portail de la rue Panenska franchi, Anna et Alexander furent déconcertés. Un petit tunnel traversait l’immeuble et donnait sur le jardin. Un court instant, il leur sembla que le soleil inondait la rue alors que la cour se noyait dans la pénombre.
Le tunnel menait dans une autre dimension où tout était sens dessus dessous – la lumière, le temps et l’existence. Au bout se balançait un pendule. Šani et Anna avançèrent avec précaution. Après quelques pas, la magie disparut. Dans la cour, un cri d’enfant retentit, un ballon à pois passa dans le ciel, et les arbres balancés par le vent cessèrent de faire de l’ombre. Le pendule s’avéra être un seau brillant plein de charbon que quelqu’un s’efforçait de tirer vers le haut.
Šani fit un clin d’œil à l’attention d’Anna et s’empara du seau des deux mains. La corde se tendit, se relâcha et se raidit à nouveau.
— Eh ! Tu la lâches ?!
— Dis le mot de passe !
Anna cria d’emblée.
— Alexander !
Lorsqu’elle était agacée par ses enfantillages, elle utilisait toujours son prénom officiel. Un père de famille ! Un ingénieur ! Presque un directeur ! La corde se détendit brièvement comme si elle réfléchissait. Puis, venue d’en haut, une voix claire :
— Que mille aiguilles de seringue te piquent le cul !
Šani lâcha le seau et, soudain libéré, ce dernier décolla si vite qu’un peu de charbon se renversa.
— Parfois je ne te comprends pas, Alexander !
Les paroles de sa femme le secouèrent tellement qu’il arriva au deuxième étage en quelques secondes. Au seuil de la porte ouverte, Ferdinand l’attendait déjà.
— J’aurais pu y penser moi-même. Salut, fabriquant de poires à lavement.
— Salut, wagonnier.
Ferdinand détacha le seau de la poulie. Avec ce simple appareil, il remontait également ses courses.
— Tu chauffes en juin ?
— Figure-toi qu’on cuisine.
— Salut papa, maman !
D’un baiser, Petra mit fin aux piques amicales que les deux anciens camarades de classe aimaient se lancer, tels des présidents qui s’échangent des titres honorifiques. Leurs facéties étaient aussi inconséquentes que ces titres. Ferdinand reprenait son souffle. Remonter le charbon l’avait éreinté.
— Qu’est-ce qui t’arrive, Ferdo ?
Il fit un geste de la main.
— Au fait, où est Tereza ?
L’appartement devint soudainement silencieux. Même l’horloge, avec ses aiguilles en forme de grands et petits crayons, cessa de dessiner le temps.
— Elle est partie, tu comprends ? Elle n’a même pas terminé sa deuxième année ! Il lui manque des examens, elle les a décalés à l’été et elle est partie avec sa bande.
— Faire du camping ?
— Elle est en Israël.
Tereza avait rejoint un groupe d’étudiants créé par Ladislav Mňačko1. Avec sa femme, ils avaient conçu l’idée de faire découvrir le véritable Israël à la jeunesse tchécoslovaque, juive ou non. Ils avaient organisé pour elle une mission de volontariat d’été dans un kibboutz, et l’enthousiasme de Tereza la poussa aussitôt à remplir toutes les formalités pour avoir le droit de voyager. Par la suite, on appela cette jeunesse « les enfants de Mňačko ».
On était en juin 1968, les formalités n’avaient jamais été aussi simples, un souffle chaud et régénérant traversait le pays, tout allait mieux, l’espoir renaissait. Tereza pria ses parents d’accepter l’interruption provisoire de sa deuxième année de faculté de philosophie, puisque ce voyage en valait la peine, qu’elle se rendrait dans un lieu où elle n’était jamais allée et d’où elle venait, d’une certaine façon. Elle ne savait pas si elle ressentirait ses racines, mais elle devait savoir, se tenir debout au pied du Mur des lamentations, voir le désert, se planter sous le soleil au zénith de son crâne et regarder la mer la plus salée du monde, la mer Morte.
Déjà, lors de ce speech, Ferdinand savait qu’il ne s’y opposerait pas. Il aimait sa fille d’un amour que seuls les pères sont capables d’éprouver. Tereza, l’espoir de la famille, la brillante étudiante, l’épicentre de tant d’univers autour duquel filaient des visages confus d’amis, de connaissances et de corps fortuitement placés dans son champ de gravité, et qui ne s’éloignaient pas davantage, satisfaits de leur sort de satellites.
— On y va ?
Petra essaya de sauver cette situation gênante.
Alexander hocha la tête.
— Je voudrais encore m’arrêter quelque part…
— Les petits trains, c’est ça ?
Ces deux-là avaient des caractères absolument opposés. Šani, le charitable spécialiste des technologies médicales, adorait les petites maquettes de chemins de fer, et le cheminot rationnel Ferdo chérissait la littérature.
— Te fâche pas, Ferdo, tu côtoies des trains tous les jours… ça ne t’intéresse même pas un poil ?
— C’est un boulot. Le travail présente un intérêt différent.
— Tu n’as jamais eu envie de collectionner les modèles réduits ?
— Tu dérailles ? T’as déjà vu un mineur se reposer dans la mine après son labeur ?
Šani avait un village de trains miniatures qui occupait la moitié de la chambre à coucher. Des sémaphores y rayonnaient, des tunnels y serpentaient et des aiguillages y cliquetaient. Chaque Noël, il achetait tout ce mécanisme complexe pièce après pièce pour Petra, jusqu’à ce qu’Anna se révolte.
Dès lors, il commença à mettre sous le sapin des ours en peluche rembourrés d’herbes séchées, des jeux de société tels que le Kloboučku hop (« saute-chapeau »), ou même une table de multiplication électrique. Il s’achetait désormais son petit train électrique de Noël tout seul, mais ne le déballait pas pour en avoir quelque surprise. Il le remettait à sa femme, selon un petit rituel.
— Comme d’hab.
Anna changeait l’emballage pour du papier cadeau. Elle aussi choisissait ses cadeaux toute seule, mais pour changer, c’était Šani qui les empaquetait. Il insistait sur ce point. Ils n’échangeaient leurs présents qu’à la fin des chants de Noël joués sur un disque rayé. Il y avait de la soupe à la choucroute, de la carpe frite et de la salade de pommes de terre. Invariablement, le soir du réveillon, ils écoutaient de la musique les yeux fermés, assis dans leurs fauteuils. Ils se passaient Eugène Onéguine, l’opéra préféré de maman. Parfois, tantôt Anna, tantôt Šani, tantôt Petra laissaient machinalement traîner leurs regards sur un autre membre de la famille comme pour s’assurer qu’il était bien à sa place. Et de nouveau, ils fermaient les yeux.
Cette année-là, M. Tricquet avait entonné une chanson sur la magnifique Tatiana2. Envoûtés par la voix du ténor, aucun d’eux ne se doutait que ce Noël 1967 serait le dernier qu’ils passeraient ensemble.
1. Ladislav Mňačko (1919-1994) est un écrivain tchécoslovaque très célèbre dans son pays.
2. Personnage d’Eugène Onéguine, opéra de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Tableau cinq : Panelaks
* * *
Le premier bâtiment en panneaux de béton de Slovaquie fut qualifié d’expérimental. Les autres n’eurent pas droit à cette appellation, même s’ils remplissaient parfaitement le critère expérimental de l’ancien régime : combien peut-on mettre d’habitants par mètre carré sans protestation ? J’ignore la réponse exacte, mais c’est beaucoup, comme nous le savons bien.
Ces premiers panelaks avaient été conçus dans une idée de simplicité nette, tout comme le parti communiste à ses débuts. Dans la misère d’après-guerre, ils représentaient un progrès – ils offraient des logements lumineux, chauds, confortables et dotés de toilettes privées, ce qui n’allait pas de soi à l’époque.
Dans les années soixante, ils n’étaient pas encore un symbole de concentration des masses périphériques, où la présence d’un médecin pour dix prolétaires était obligatoire. Bratislava devait devenir une ville ouvrière, elle devait moins penser et travailler plus. Des mains calleuses valaient une meilleure qualification que des études universitaires.
De tous les immeubles du socialisme naissant, le premier qui fut construit en panneaux de béton était d’une importance primordiale. Le bâtiment en kit expérimental, premier panelak slovaque, donnait sur la place de Kmet à Bratislava. Le professeur Karfíka et son atelier en avaient dessiné les plans, s’appuyant sur la technique des panneaux en béton précontraint sur un système d’ancrage à cadres. De quoi s’agit-il ? Seuls les architectes le savent. Nous ne sommes pas obligés d’en savoir plus.
Les premiers locataires emménagèrent en janvier 1956. Ils portèrent leur humble mobilier à travers deux entrées ; au-dessus de chacune trônait une œuvre d’art en guise de décoration. La vie devait être belle, quelle que soit l’opinion des habitants. De toute manière, ils ne l’exprimaient pas à voix haute. Les œuvres étaient des bas-reliefs. L’un représentait des garçons qui s’amusent et l’autre, des filles.
Anna passe justement sous les filles qui jouent, figées dans la pierre pour l’éternité. Elle rend visite à sa sœur Erika. Elle tient dans la main un petit paquet : un gilet pour son neveu. Elle l’a terminé juste avant le noir et jaune de son mari. Ils ne se sont guère attardés rue Panenska. Petra est restée aider Maria pour la préparation du déjeuner dominical, Ferdinand est parti à la gare et Alexander, au magasin de petits trains. Ils se sont donné rendez-vous dans deux heures.
Anna s’est dépêchée. Elle savait que Maria l’attendait pour le déjeuner, et rien n’est plus humiliant pour une femme qui a passé toute sa matinée derrière les fourneaux que de recevoir des convives en retard et de leur servir un repas froid. Il faut alors tout réchauffer, auquel cas une mère préférerait leur jeter des couteaux bien affûtés, si son bon cœur et son sens de la justice ne la retenaient pas. C’est pourquoi Anna est essoufflée quand elle sonne à la porte de sa sœur.
— Salut la petiote, t’as une minute ?
Erika restera toujours la petiote, même si elle dépasse Anna d’une demi-tête. Cependant, elle a un an de moins. Et une année, ça compte. Marko déboule de la cuisine.
— Bisous, tante Anna !
Alors qu’elle le soulève dans ses bras, elle évalue furtivement si le gilet est à sa taille.
— Tu es un grand garçon. Regarde ce que Tata t’apporte !
— Une petite voiture ?
Comme beaucoup de femmes avant elle, Anna déçoit l’enfant avec son cadeau pratique. Petites voitures et carabines à air comprimé continueront d’habiter les rêves des gamins, au lieu de quoi débarquent des chaussettes et des chemises qui envahissent le pays des merveilles comme de la mauvaise herbe.
— Non, ce n’est pas une petite voiture, mais au moins tu auras chaud quand tu iras jouer.
— Moi j’ai chaud !
— Marko ! gronda Erika.
Docilement, le fils enfila le pull et se fit pousser à contrecœur vers le miroir. Une voiture rouge brodée de coton velu surgit de la maille comme d’un tunnel. La même que son oncle Šani. Pour le petit garçon, Anna avait surmonté son aversion du cabriolet et Marko en fut ravi.
— Fééécia !
On était dimanche et le seul magasin au monde où Šani aimait se rendre était fermé. Mais il pouvait au moins lécher la vitrine. Ce qu’Anna déposerait au pied du sapin tenait de l’évidence.
Alexander réduisait son univers. Tel qu’un philosophe l’eût fait avec des idées, lui ciselait du contreplaqué et du balsa. Il transposait le monde à une échelle qui le rendait supportable. Depuis des années, il construisait un pays miniature avec de petites maisons, au bord de petites routes, sur lesquelles circulaient de petites voitures, le long de petits rails sur lesquels filaient de petits trains électriques dans un bourdonnement sourd.
Devant la vitrine, Šani faisait des « ah » et des « oh », se dandinant et miaulant. Si quelqu’un l’avait vu, il aurait douté de sa santé mentale. Mais tout le monde était à la maison en train d’écouter la radio, attendant les escalopes de porc panées et la salade de pommes de terre.
Tant que vos proches n’en souffrent pas, toutes les façons de vous adonner à votre passion de collectionneur sont autorisées. Cela n’incommodait pas Anna, qui était raisonnable au point de franchir avec son mari, main dans la main, le seuil à partir duquel l’amour passion se métamorphose en amour materno-paternel. Tolérer un hobby est une occasion de montrer à son partenaire qu’on l’aime encore, et vice versa, car le partenaire lui répond avec sa compréhension.
Concrètement, cela signifiait qu’Anna acceptait davantage, et c’est pourquoi je ne crains pas d’écrire que Šani était un homme heureux. Et il le savait.
— Comment vas-tu, dis-moi ?
— J’enseigne au collège, c’est cool. Je m’attends toujours à ce que les haut-parleurs de l’école annoncent « Camarade Rolova1, vous êtes convoquée à la direction du bureau éducatif pour un licenciement ! »
— Mais non.
— Ça va, t’inquiète pas, mais je n’arrive pas à me faire à l’idée que je puisse enseigner, tu comprends ?
— Où est ton mari ?
— À Modra, chez ses parents. Mon dieu, je voulais te demander, puisque vous êtes en voiture, vous pouvez m’y emmener avec le petit ?
— Je vais chercher Petra et on passe te prendre.
— Šani ne va pas grogner ?
— Il contemple ses petits trains, t’inquiète. Il sera de bonne humeur.
— Merci.
— On sera là d’ici une heure ou deux.
— Lajoš ne t’a pas appelée ?
— Non, pas depuis six mois. Et toi ?
— Moi non plus. Eh bien, quelle famille ! Je dois encore laver un truc.
— Salut Marko ! On va venir te chercher en Fééécia !
1. Dans la langue slovaque, on féminise les noms de famille par l’ajout du suffixe -ova.
Tableau six : Vigne
* * *
Comme beaucoup de couples à cette époque, Erika et son futur mari étaient tombés amoureux lors d’un défilé du 1er Mai. Le caractère forcé des « manifestations pour la paix et le bonheur » n’empêcha jamais la jeunesse d’avoir envie de vivre et de s’aimer. Erika adorait le regarder jouer au handball. Il était bon et s’envolait avec le ballon dans les airs tel l’ange avec la couronne de myrte. Tous deux étudiaient au lycée et obtenaient d’excellentes notes, jusqu’à ce que Jozef s’inscrive en théologie et n’obtienne plus que des 41 dans toutes les matières.
Il acheva ses études à la faculté de théologie évangélique dans sa ville natale. Il passa ses examens de vicaire et fut affecté à Nové Zámky.
Son ordination était prévue deux jours plus tard à Modra. Mais avant, il était convoqué par le secrétaire d’État chargé des affaires religieuses dans le ministère de l’Éducation nationale.
— Camarade Rola, en fait, je ne devrais pas m’adresser à vous ainsi… Allons droit au but. Vous êtes issu d’une famille ouvrière, n’est-ce pas ? Une famille de paysans ? Bien, bien… Nous savons que vos parents travaillent dans la vigne. Je présume que vous saisissez. Dans la paroisse de Nové Zámky, une sorte de mouvement souterrain se développe, nous avons besoin de quelqu’un qui pourrait nous informer de ce qui se passe là-bas. Quelqu’un de confiance. Vous n’êtes pas obligé de me répondre maintenant. Vous avez jusqu’à demain. Réfléchissez-y !
Jozef sortit tout pâle du bureau. Il ne sut même pas comment il atterrit dans la rue. Il s’alluma une cigarette, aspira profondément et rejeta un tourbillon de fumée blanche qu’il souffla par le nez comme un taureau. Sa crainte initiale se transforma en colère. Toute la famille était invitée, une dizaine de connaissances et des centaines de personnes s’étaient préparées à l’ordination de ce jeune pasteur qui incarnait l’espoir de leur ville. La plus enthousiaste était sa mère, elle qui était à l’origine de tout.
Enfant, il était rentré un jour de l’école et avait couru la retrouver dans le vignoble.
— Mamou, tu sais qu’aucun Dieu n’existe ? Le monde s’est créé tout seul, à partir de bactéries !
La mère reposa sa pioche, s’essuya le front et sourit.
— Alors, raconte-moi un peu tout ça.
Elle ne le contredit à aucun moment, le laissant parler. Et l’enfant raconta… mais plus il racontait, plus il s’embrouillait dans des questions auxquelles il ne savait répondre. La plus importante était : « OK, mais qui a créé ces bactéries ? » C’est peut-être ce jour-là que la foi s’empara du petit Jozef. Dès lors, elle ne le quitta plus, et il décida seul de sa vocation de prêtre.
Il termina lentement sa cigarette. Le bout ardent lui brûla les doigts. Il savait ce qu’il devait faire. Il resta encore un moment dans la rue puis se résolut à faire le pas qui allait changer sa vie.
Durant des dizaines d’années de socialisme, nombre de pasteurs luthériens avaient collaboré avec le pouvoir d’État. Ils étaient membres du Mouvement de la paix, tandis que les catholiques avaient Pacem in terris. Mais aucune organisation n’apportait la paix à l’âme.
Jozef éteignit sa cigarette et, cinq minutes plus tard, il était de nouveau dans le bureau du secrétaire d’État. Tous les deux étaient déconcertés. Avant même d’avoir fermé la porte, il lança :
— Je préfère être un simple citoyen plutôt qu’un pasteur délateur !
Trois jours plus tard, il reçut son ordre d’affectation. Mais avant et pour la forme, ils l’hospitalisèrent. Il ne pouvait pas dire publiquement qu’il renonçait à son ordination. Il ne pouvait surtout pas en expliquer la raison. Alors qu’il passait deux nuits blanches dans un service de médecine interne de l’hôpital, sa famille annonça à tout le monde que l’ordination de leur fils avait été reportée à cause d’une maladie… D’ailleurs, il n’y aurait plus d’ordination en Tchécoslovaquie avant un très long moment.
Avant même qu’elle passe le bac, le comité du parti communiste du lycée déclara qu’Erika n’était pas autorisée à faire des études supérieures. On était en 1960. Elle était « incompatible » : son père avait été dentiste dans le privé et un autre membre de sa famille avait été un grand capitaliste. Entendez par là qu’il avait eu un petit atelier de couture. Bien que leurs biens aient été pillés par l’État, que leur cabinet et leur atelier appartiennent désormais au peuple entier, les enfants continuaient de souffrir du fait que leurs parents n’avaient pas été des pauvres types, mais des personnes qui avaient réussi.
Selon cette logique pervertie, on ne l’autorisa pas à faire des études, alors qu’on le permit à la fille d’un milicien de la garde Hlinka, qui se promenait, quinze ans auparavant, avec l’uniforme noir cousu dans un tissu que le peuple avait nommé « la peau du diable ».
Erika pleurait. Elle avait le sentiment que sa vie venait de s’arrêter. Elle, la meilleure élève de sa classe, était interdite d’études. La voûte céleste s’abattit sur elle, les colonnes de marbre s’écroulèrent. Elle fut ensevelie sous le stucage des idéaux fissurés. Elle avait l’impression de n’être personne, d’être inutile et sans valeur. Toute sa famille avait un diplôme universitaire. Tous, excepté les enfants, bien sûr.
Sa sœur Anna n’avait pas non plus été acceptée à la fac. Elle avait suivi des cours pour devenir comptable et en avait fait son gagne-pain. La seule exception qui confirmait douloureusement la règle, c’était son plus jeune frère : Lajoš. Il était entré au parti depuis longtemps, avait terminé ses études d’économie et traînait au bistrot avec des personnes à qui vous n’auriez même pas offert de l’eau pétillante. Des indics, des membres de la police secrète et des hommes de main de la police nationale. Lajoš ne s’était pas éternisé à Pezinok, sa ville natale ; il habitait Stara Ruda et n’avait jamais aidé ses sœurs. Il les ignorait. Elles lui rendaient la pareille. Il faisait carrière au sein des instances régionales et visait plus haut. On murmurait qu’il voulait entrer au Comité central du parti communiste, carrément, c’est-à-dire l’antichambre du bon dieu socialiste, avec un téléphone en or.
Extraits

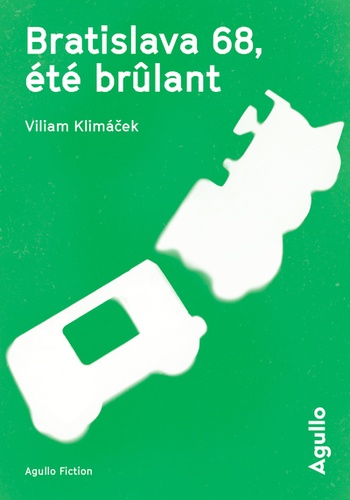


























Commenter ce livre