napoléon
Extraits
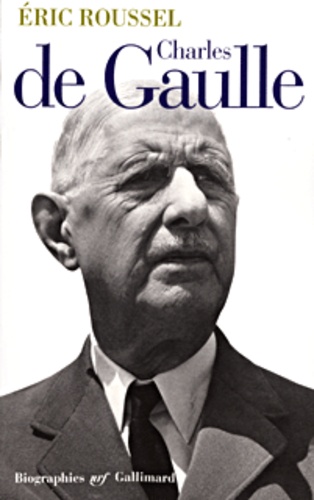
Histoire de France
Charles de Gaulle
05/2002
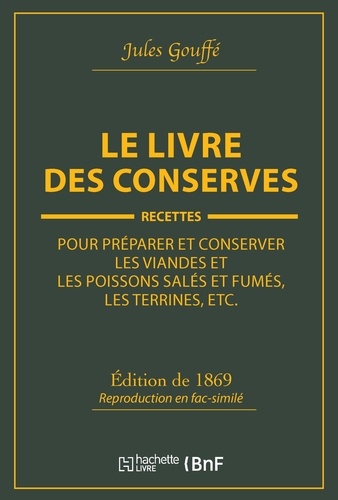
Cuisine
Le livre des conserves, ou Recettes pour préparer et conserver les viandes
12/2019
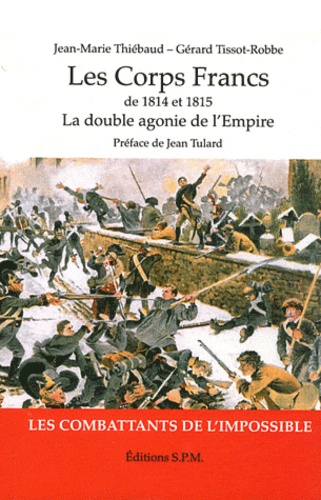
Histoire de France
Les corps francs de 1814 et 1815. La double agonie de l'Empire, les combattants de l'impossible
07/2011
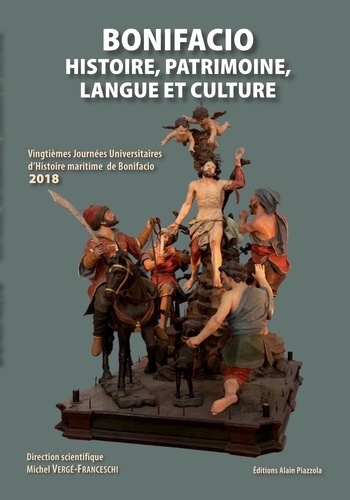
Sciences historiques
Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture
06/2019
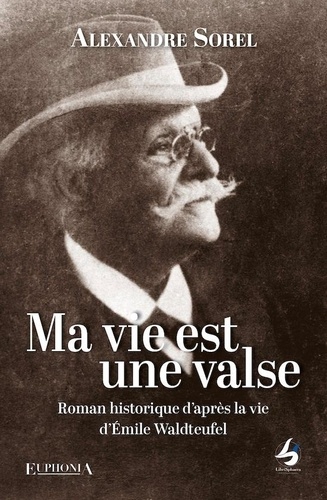
XIXe siècle
Ma vie est une valse
02/2022
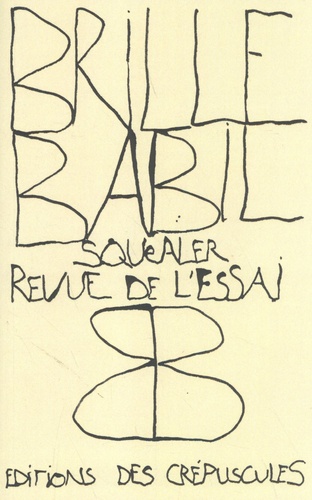
Revues
Brille Babil N° 2, printemps 2022
06/2022
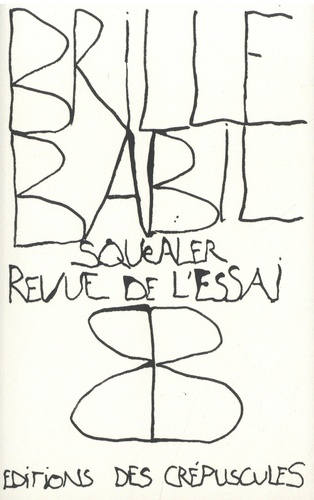
Revues
Brille Babil N° 1, automne 2021 : Squealer
10/2021
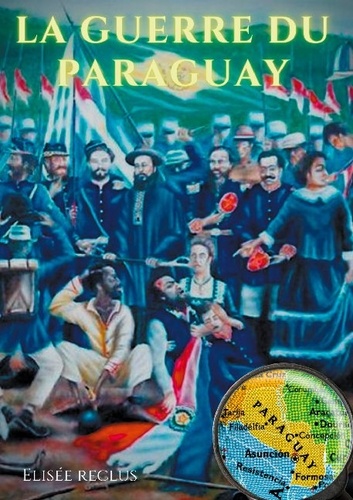
Autres pays
La guerre du Paraguay
05/2021
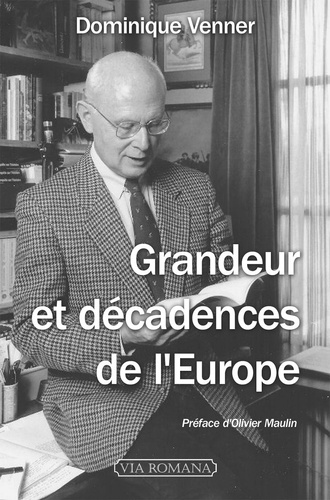
Ouvrages généraux
Grandeur et décadences de l'Europe
06/2021
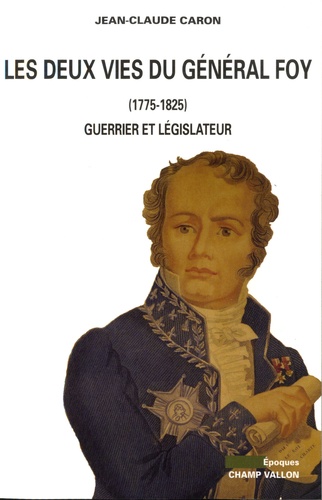
Histoire de France
Les deux vies du général Foy (1775-1825). Guerrier et législateur
08/2014
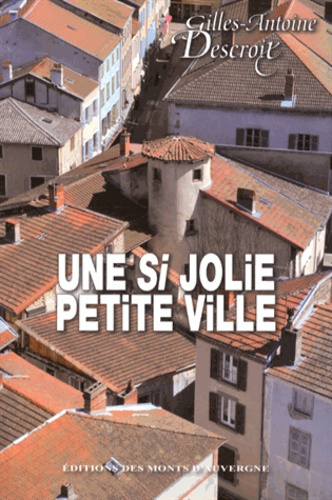
Littérature française
Une si jolie petite ville
08/2013
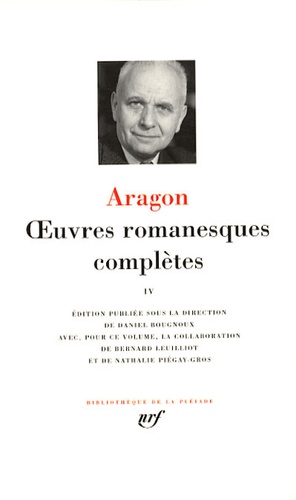
Pléiades
Oeuvres romanesques complètes. Tome 4, Les communistes ; Les rendez-vous romains ; La semaine sainte ; Chproumpph ; L'inconnue du printemps ; Histoire de Fred et Roberto ; Damien ou Les confidences ; Shakespeare en meublé ; Pastorale dernier cri ; Les his
09/2008
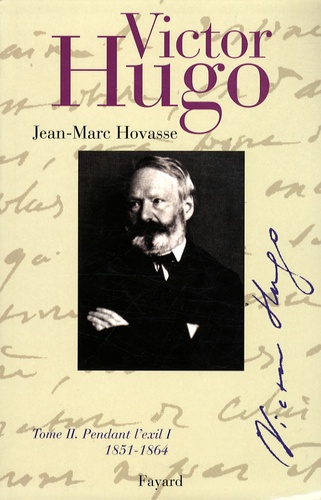
Critique littéraire
Victor Hugo. Tome 2, Pendant l'exil : 1851-1864
11/2008
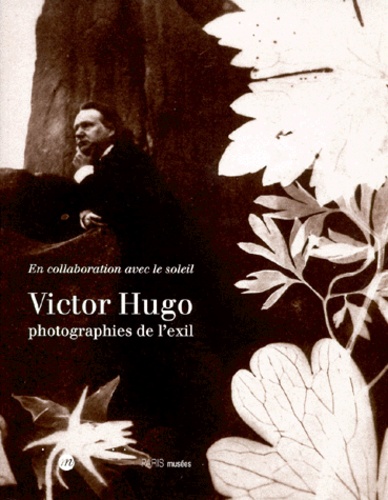
Critique littéraire
VICTOR HUGO. Photographies de l'exil, Paris, musée d'Orsay et maison de Victor Hugo, 27 octobre 1998-24 janvier 1999
10/1998
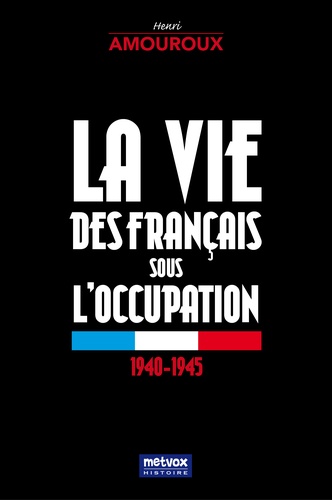
Histoire de France
La vie des Français sous l'Occupation. 1940-1945
11/2018
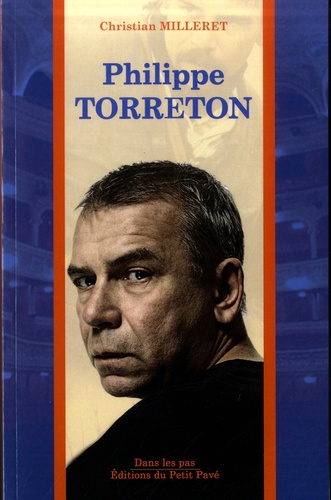
Cinéma
Philippe Torreton
02/2019
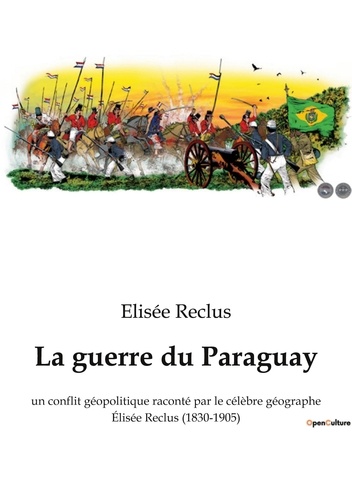
Sciences politiques
La guerre du Paraguay. un conflit géopolitique raconté par le célèbre géographe Élisée Reclus (1830-1905)
11/2022
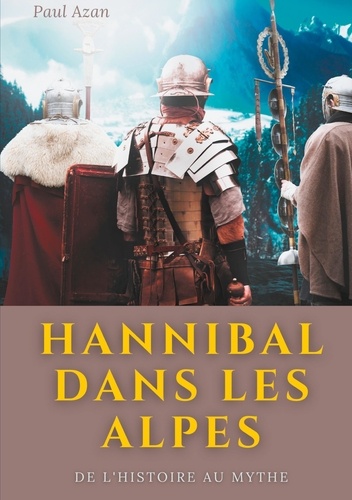
Histoire antique
Hannibal dans les Alpes. De l'histoire au mythe
03/2021
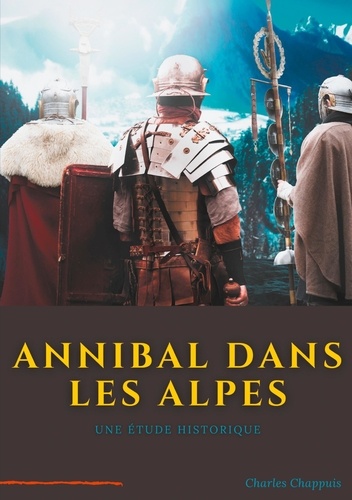
Rome
Annibal dans les Alpes. Une étape majeure de la marche vers l'Italie de l'armée d'Hannibal Barca, réalisée à la fin de l'année 218 av. J.-C., au début de la deuxième guerre punique déclenchée contre Rome
03/2021
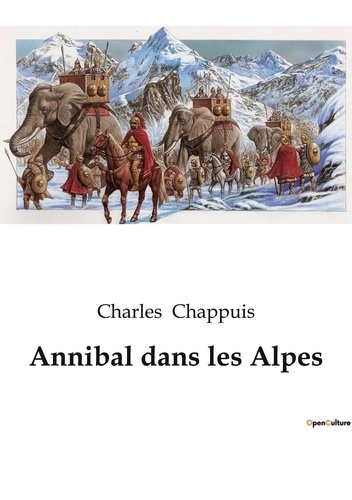
Histoire antique
Annibal dans les Alpes
10/2022
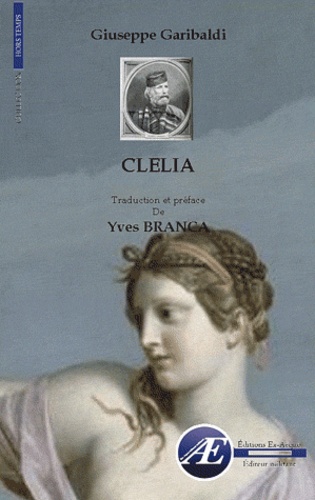
Littérature française
Clelia de Giuseppe Garibaldi
12/2010
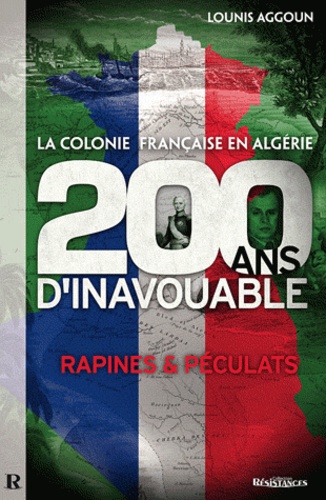
Histoire de France
La colonie française d'Algérie : 200 ans d'inavouable
11/2010
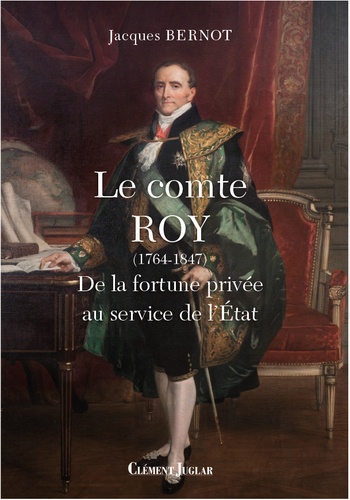
Histoire de France
Le comte Roy (1764-1847). De la fortune privée au service de l'Etat
02/2017
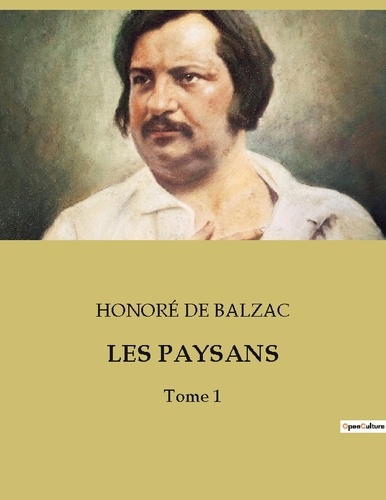
Littérature française
Les paysans. Tome 1
02/2023
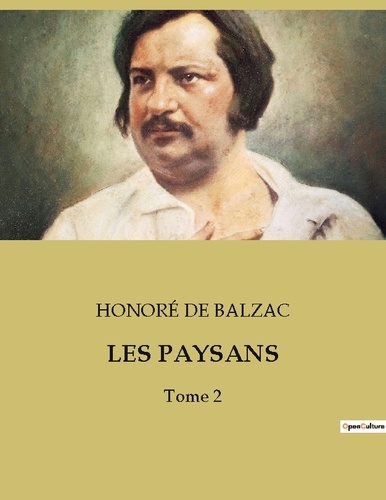
Littérature française
Les paysans. Tome 2
02/2023
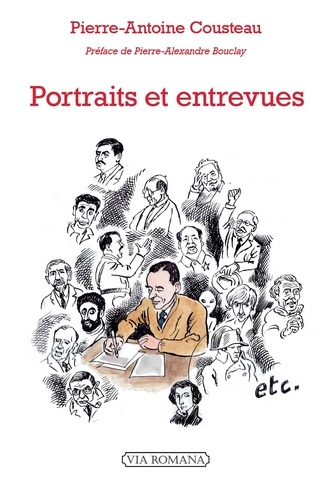
Vie chrétienne
Portraits et entrevues
02/2022
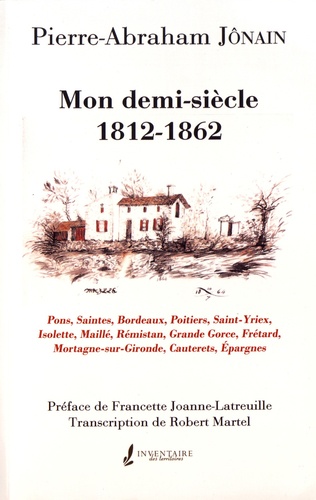
Sciences historiques
Mon demi-siècle (1812-1862)
03/2020
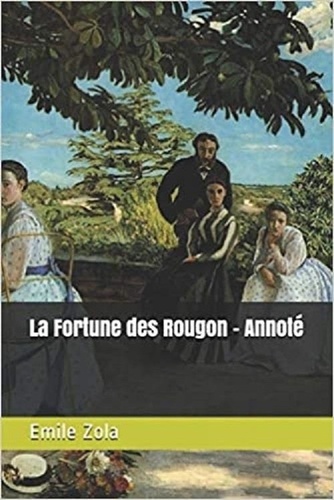
Sciences historiques
La Fortune des Rougon - Annoté
03/2020
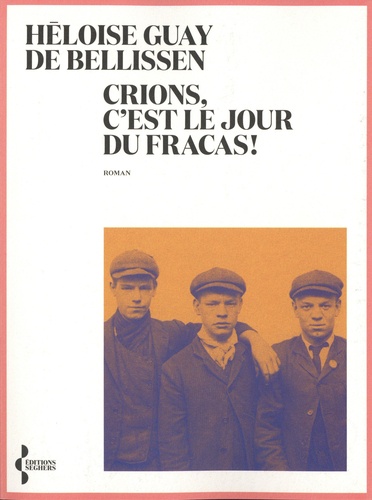
Littérature française
Crions, c'est le jour du fracas !
08/2021
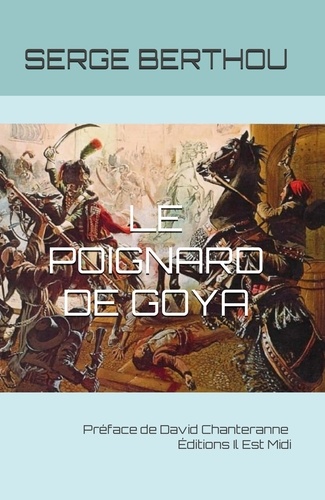
XIXe siècle
Le poignard de Goya
10/2021

