L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience
Extraits
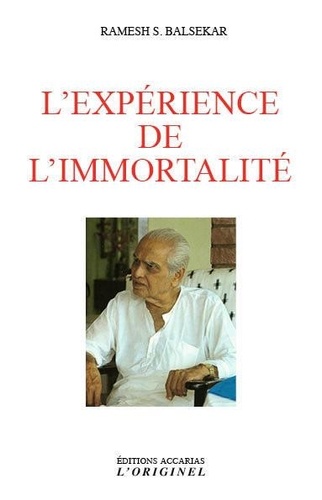
Religion
L'expérience de l'immortalité
01/2021
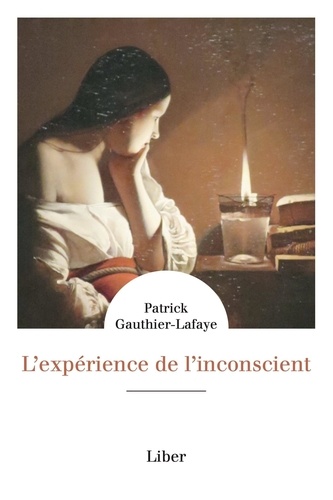
Essais
L'expérience de l'inconscient
08/2021
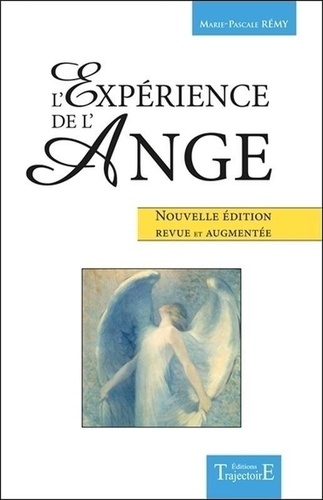
Esotérisme
L'expérience de l'ange
06/2017
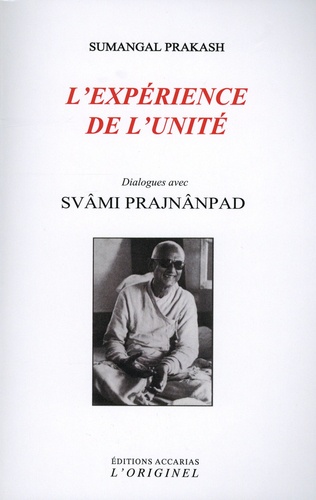
Méditation et spiritualité
L'expérience de l'unité
03/2023
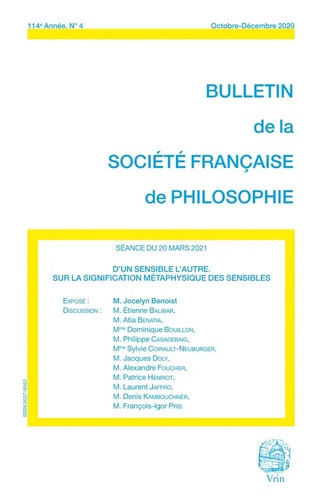
Autres
D'un sensible l'autre. Sur la signification métaphysique des sensibles
02/2022
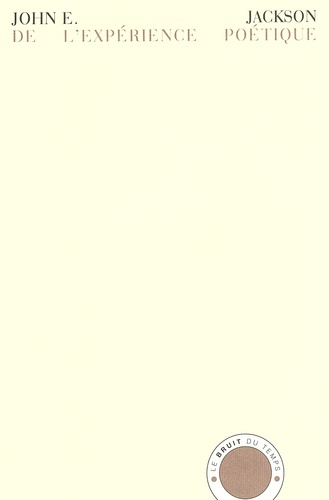
Critique Poésie
De l'expérience poétique
03/2023
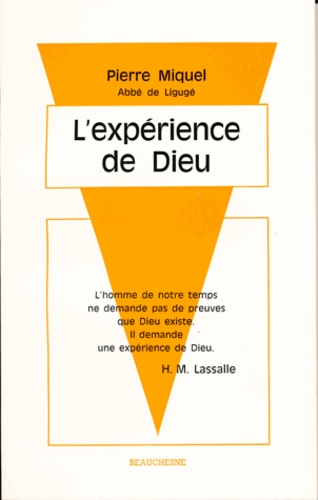
Religion
L'expérience de Dieu
04/1977
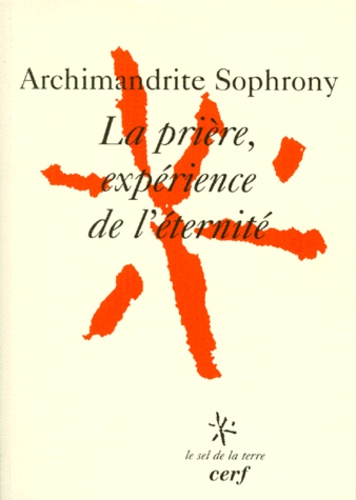
Religion
LA PRIERE, EXPERIENCE DE L'ETERNITE
11/1998
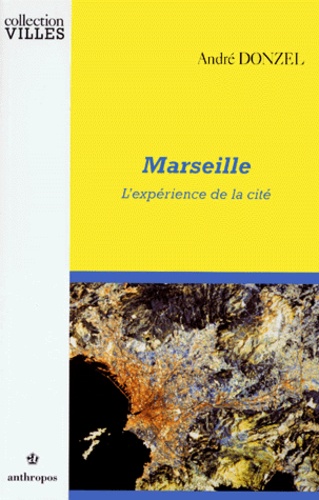
Géographie
Marseille. L'expérience de la cité
11/1998
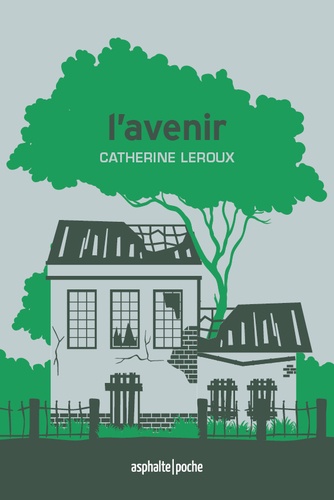
Littérature française
L'avenir
09/2023
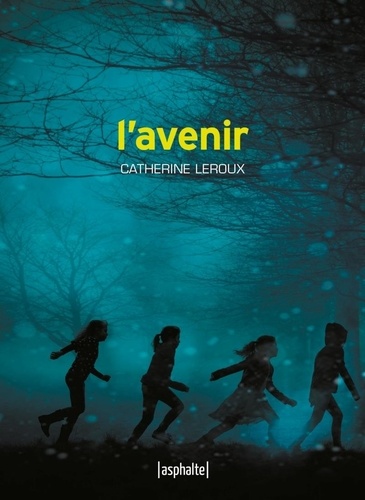
Littérature française
L'Avenir
01/2022
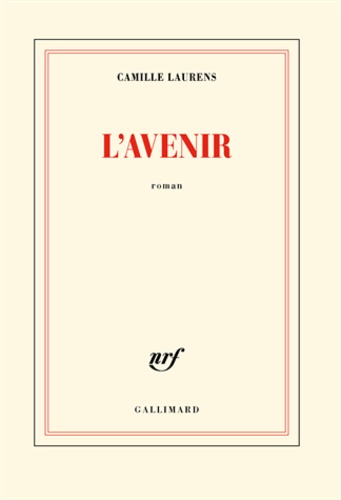
Littérature française
L'avenir
04/2013
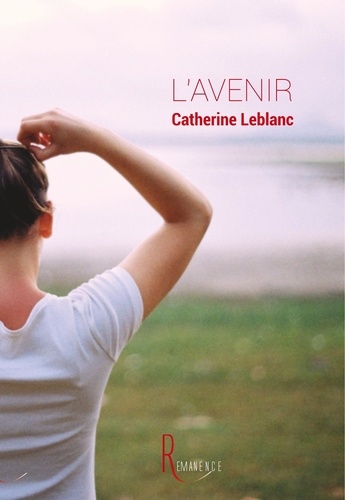
Littérature française
L'avenir
04/2004
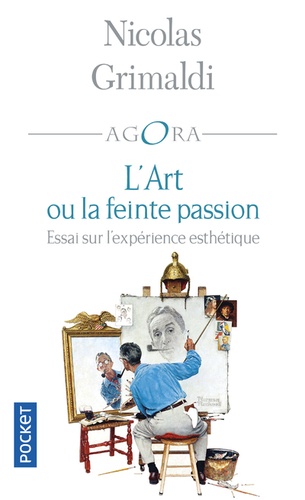
Philosophie
L'art ou la feinte passion. Essai sur l'expérience esthétique
06/2018
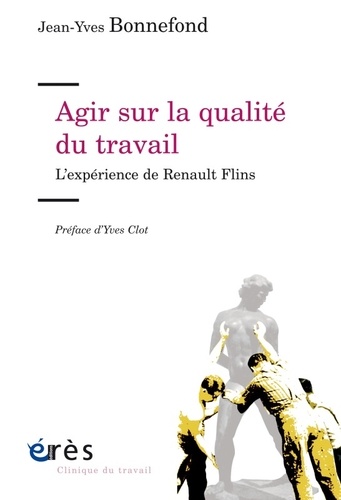
Psychologie, psychanalyse
Agir sur la qualité du travail. L'expérience de Renault Flins
10/2019
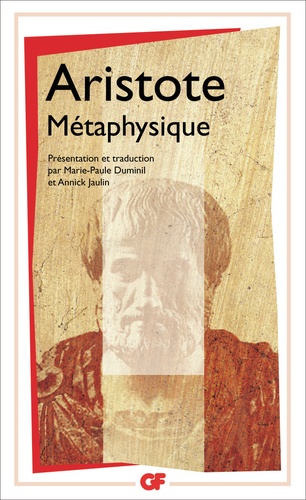
Philosophie
La métaphysique
02/2008
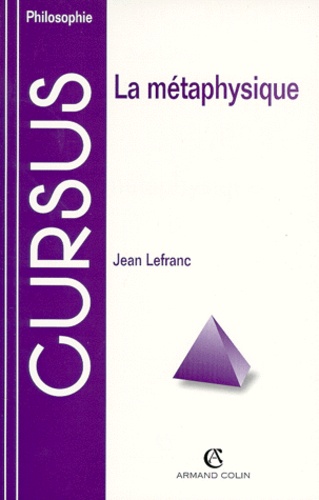
Philosophie
La métaphysique
09/1998

Philosophie
La métaphysique
11/2013
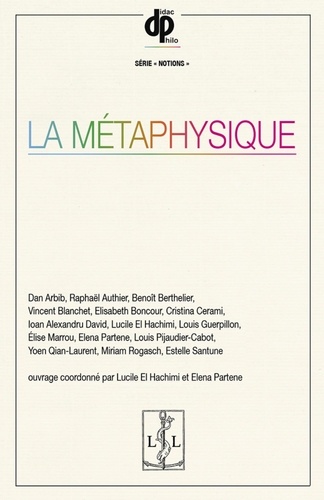
Notions
La métaphysique
09/2023
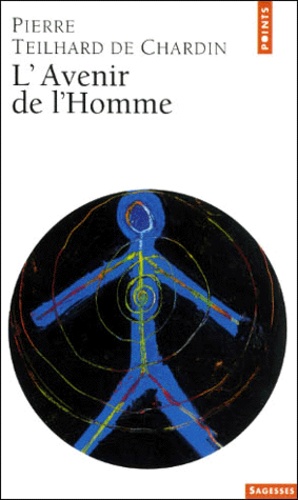
Religion
L'avenir de l'homme
02/2001
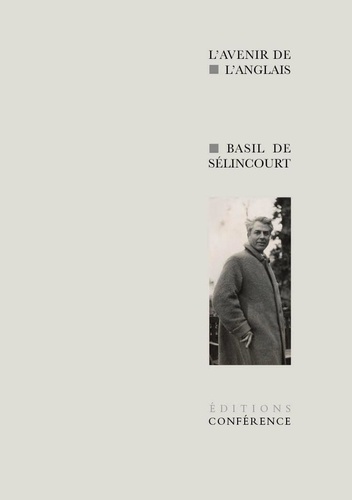
Linguistique
L'avenir de l'anglais
06/2023
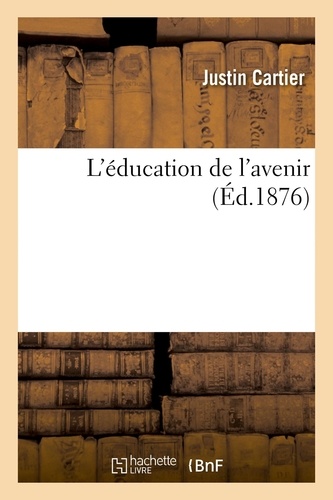
Sociologie
L'éducation de l'avenir
07/2021
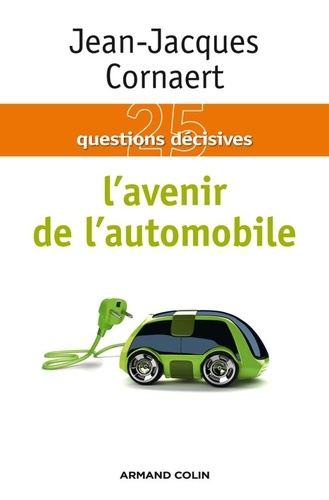
Développement durable-Ecologie
L'avenir de l'automobile
04/2010
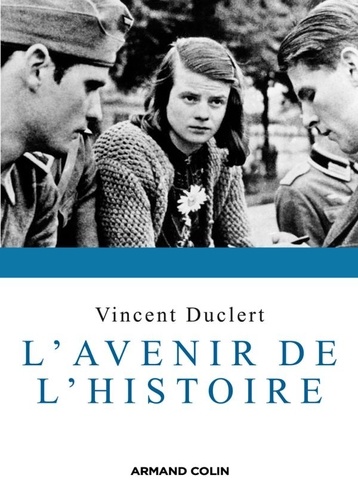
Sciences historiques
L'avenir de l'histoire
09/2010
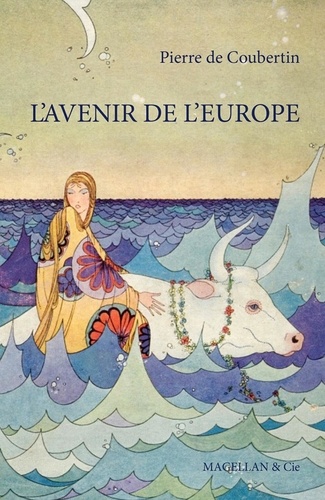
Sociologie
L'avenir de l'Europe
03/2021
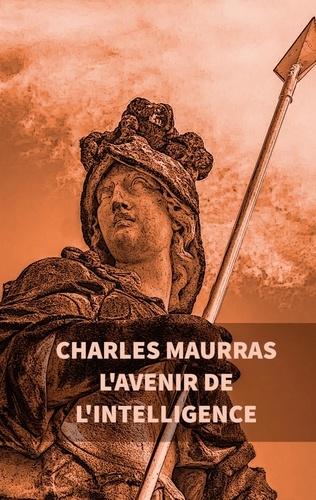
Manifestes extrémistes
L'avenir de l'intelligence
06/2022
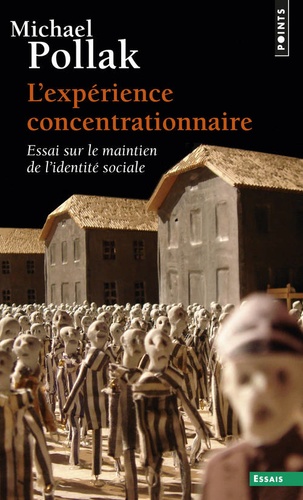
Histoire de France
L'expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l'identité sociale
03/2014
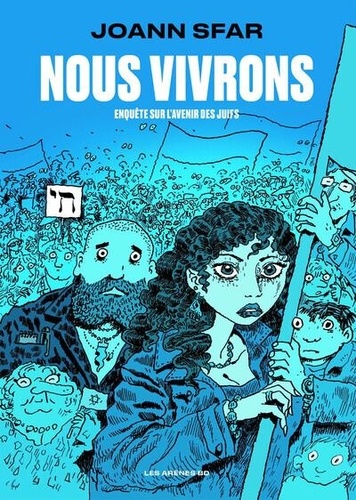
Réalistes, contemporains
Nous vivrons. Enquête sur l'avenir des juifs
04/2024
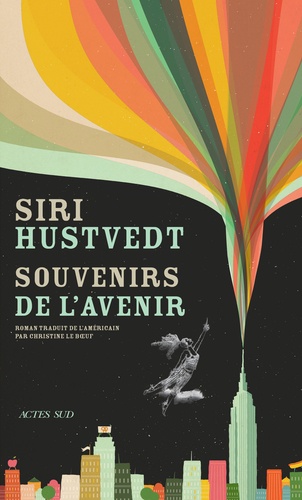
Littérature étrangère
Souvenirs de l'avenir
09/2019
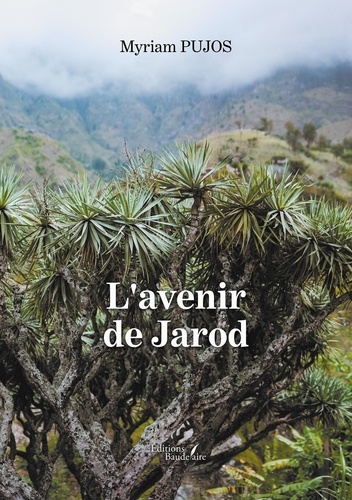
Littérature française
L'avenir de Jarod
07/2022

