hadopi etude confinement
Extraits
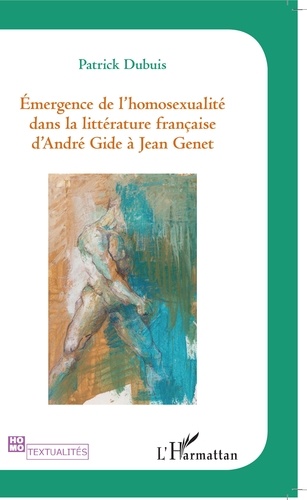
Critique littéraire
Emergence de l'homosexualité dans la litterature francaise d'Andre Gide à Jean Genet
04/2011
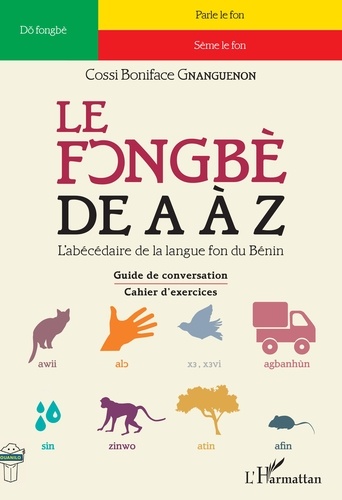
Autres langues
Le fongbè de A à Z. L'abécédaire de la lague fon du Bénin
12/2018
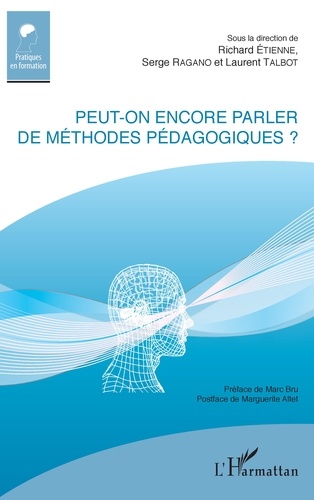
Pédagogie
Peut-on encore parler de méthodes pédagogiques ?
02/2019
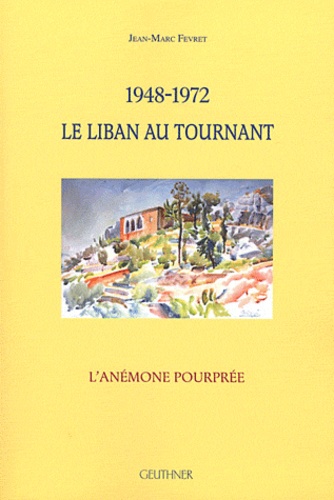
Histoire internationale
1948-1972 le Liban au tournant
09/2011
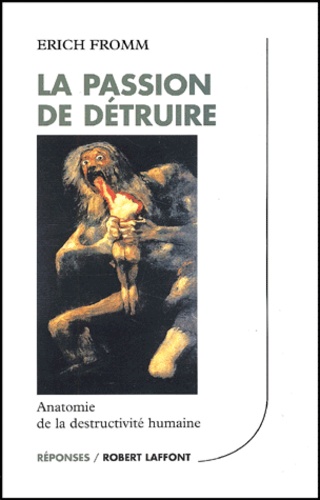
Psychologie, psychanalyse
La passion de détruire. Anatomie de la destructivité humaine
02/2002
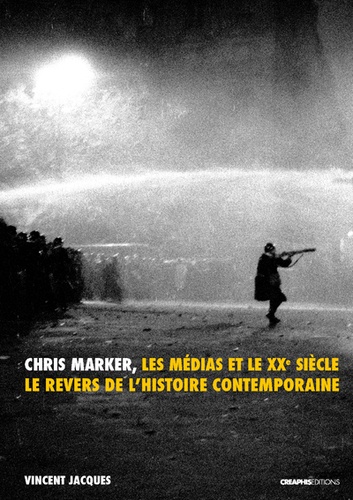
Cinéma
Chris Marker, les médias et le XXe siècle. Le revers de l'histoire contemporaine
07/2018
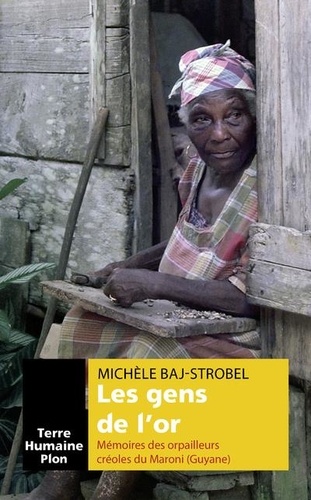
Ethnologie
Les gens de l'or
10/2019
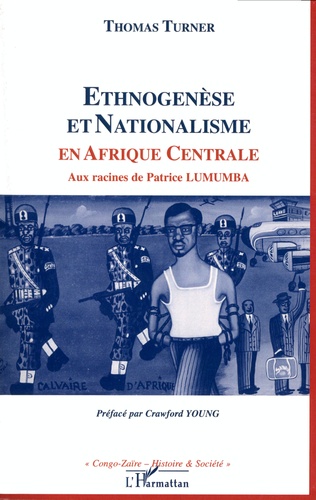
Histoire internationale
Ethnogenèse et nationalisme en Afrique centrale. Aux racines de Patrice Lumumba
09/2017
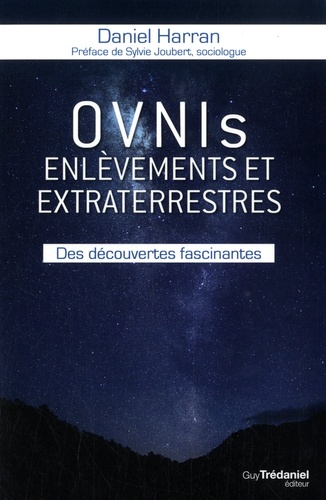
Esotérisme
Ovnis, enlèvements et extraterrestres. Des découvertes fascinantes
04/2019
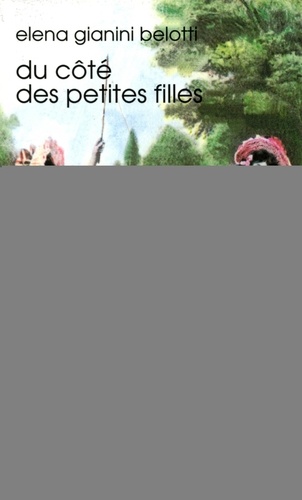
Ethnologie
Du côté des petites filles
05/2011
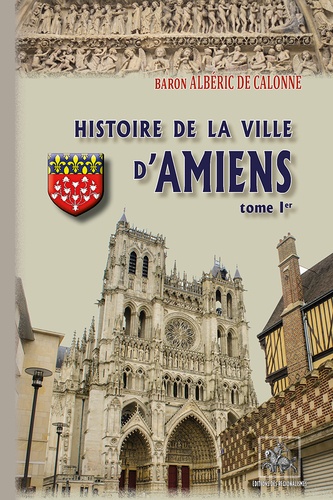
Sciences historiques
Histoire de la ville d'Amiens. Tome 1
01/2021
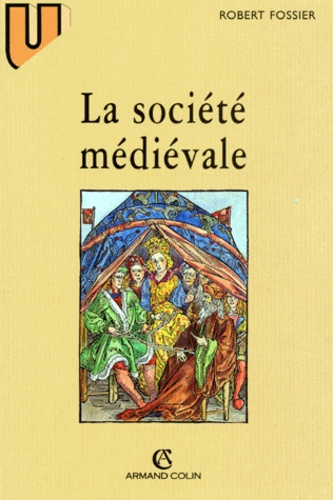
Histoire de France
LA SOCIETE MEDIEVALE
10/1999
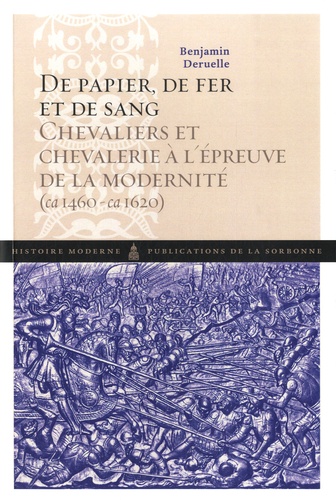
Histoire de France
De papier, de fer et de sang. Chevaliers et chevalerie à l'épreuve de la modernité (1460-1620)
06/2015
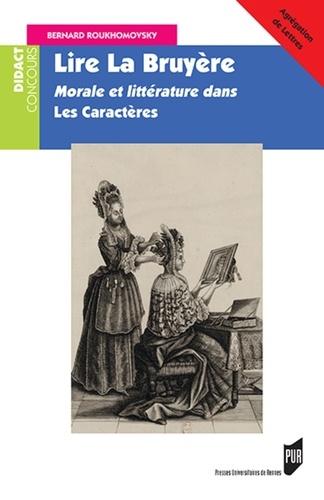
Critique littéraire
Lire La Bruyère. Morale et littérature dans Les caractères
11/2019
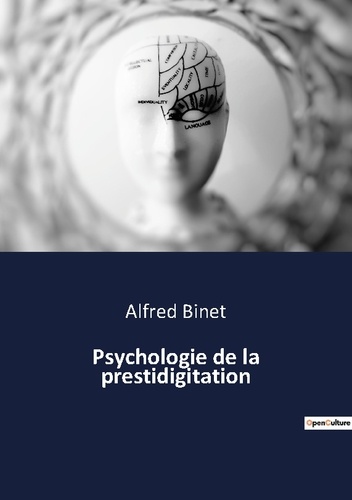
Ouvrages généraux
Psychologie de la prestidigitation
01/2023
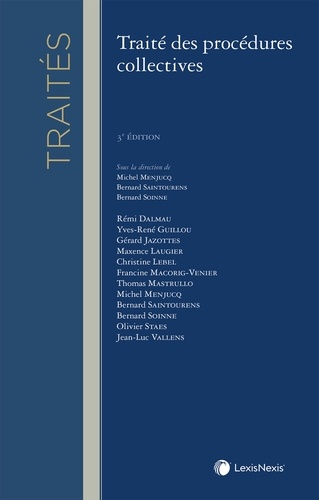
Procédure civile
Traité des procédures collectives. 3e édition
01/2021
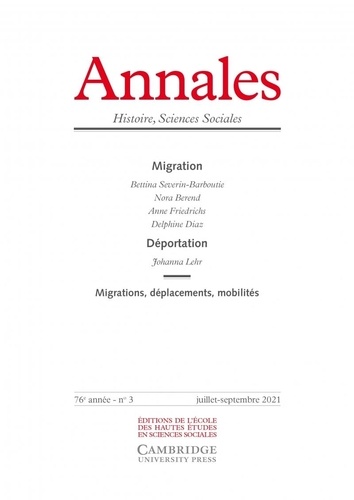
Ouvrages généraux
Annales Histoire, Sciences Sociales N° 3, 2021 : Migrations
03/2022
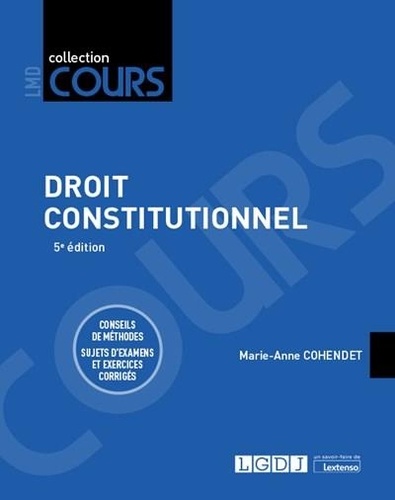
Droit constitutionnel
Droit constitutionnel. Conseils de méthodes, sujets d'examens et exercices corrigés, 5e édition
09/2021
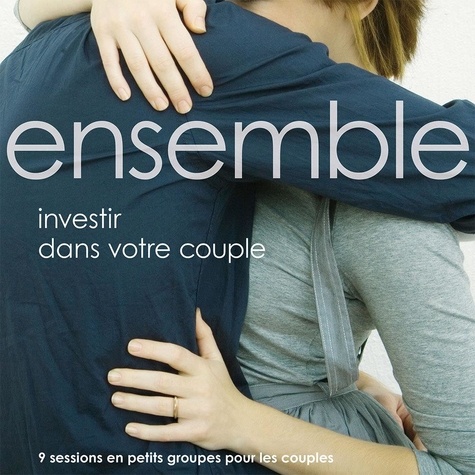
Religion
Ensemble. Investir dans votre couple
11/2019
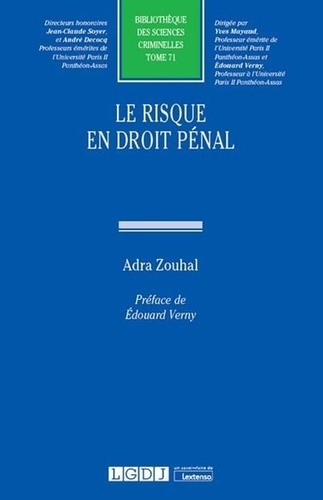
Droit pénal
Le risque en droit pénal
06/2021
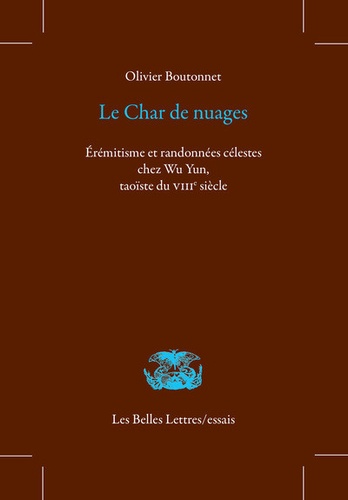
Taoïsme
Le Char de nuages. Erémitisme et randonnées célestes chez Wu Yun, taoïste du VIIIe siècle
09/2021
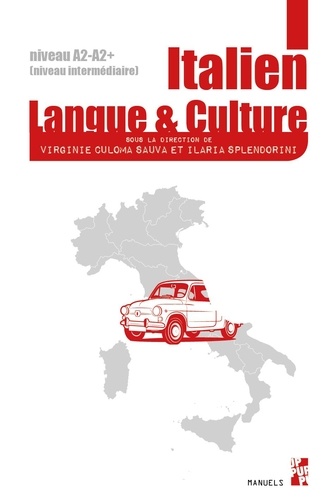
Méthodes adultes
Italien. Langue et culture. Manuel d’italien langue vivante étrangère pour l’enseignement supérieur, niveau A2
09/2023
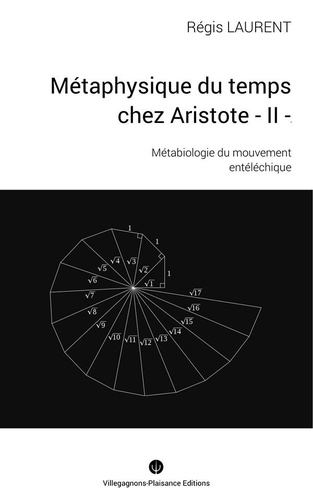
Aristote
Métaphysique du temps chez Aristote Tome 2 : Métabiologie du mouvement entéléchique
11/2021
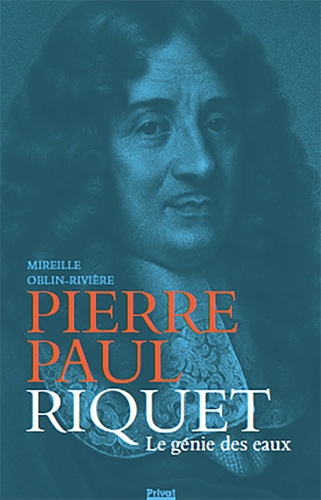
XVIIe siècle
Pierre Paul Riquet. Le génie des eaux
10/2021
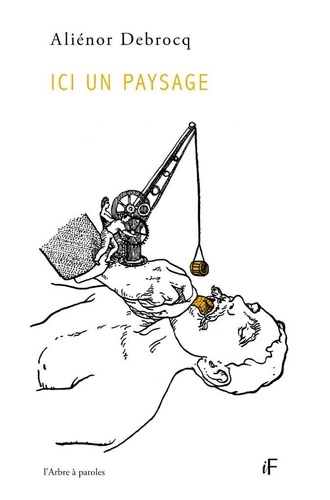
Littérature française
Ici un paysage
03/2023
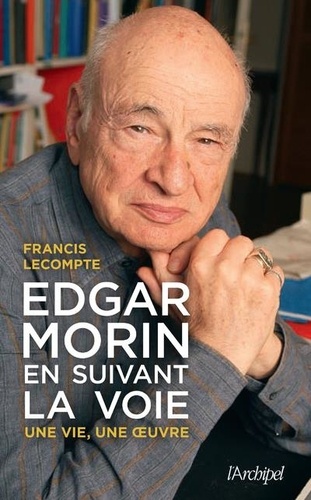
Autres
Edgar Morin, en suivant la voie. Une vie, une oeuvre
02/2023
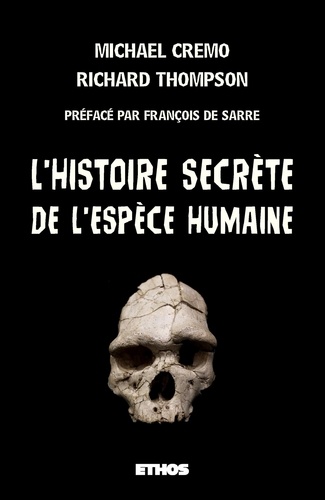
Esotérisme
L'histoire secrète de l'Espèce humaine
11/2021

Critique littéraire
Opuscules rhétoriques. Tome 2, Démosthène, Edition bilingue français-grec ancien
01/1988
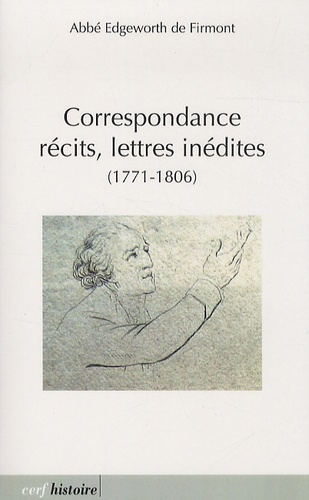
Histoire de France
Correspondance, récits, lettres inédites. 1771-1806
07/2013
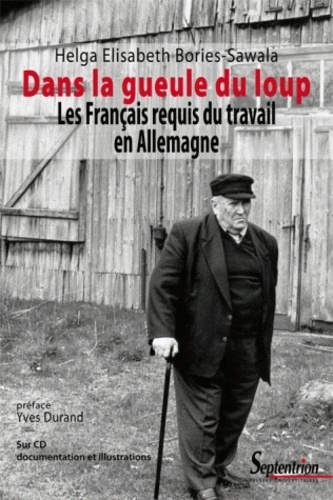
Histoire de France
Dans la gueule du loup. Les Français requis du travail en Allemagne, avec 1 CD-ROM
04/2010

