André Breton
Extraits
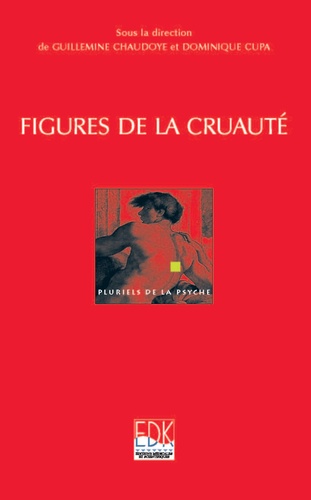
Psychologie, psychanalyse
Figures de la cruauté
04/2012
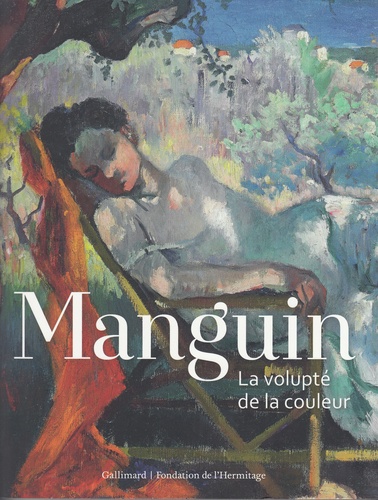
Beaux arts
Manguin. La volupté de la couleur (version suisse)
06/2018
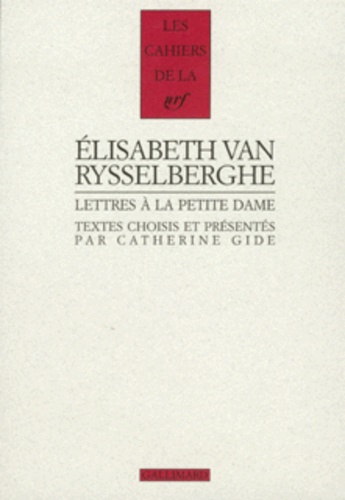
Critique littéraire
Lettres à la Petite Dame. Un petit à la campagne (juin 1924 - décembre 1926)
06/2000
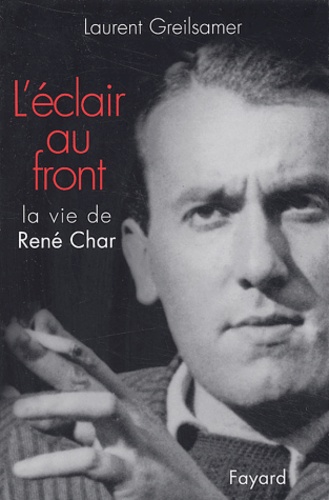
Critique littéraire
L'éclair au front. La vie de René Char
03/2004
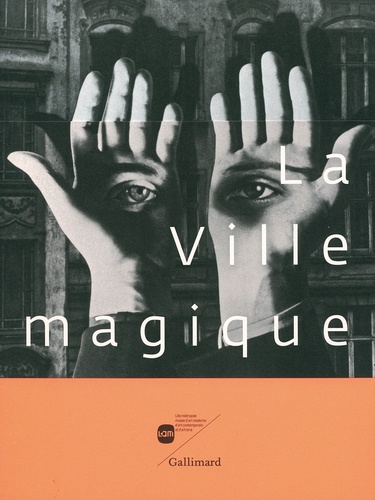
Beaux arts
La ville magique
10/2012
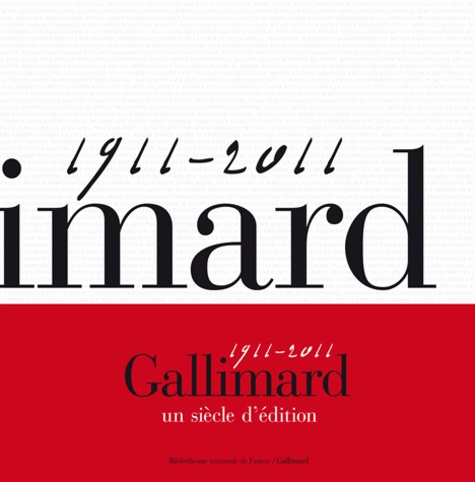
Critique littéraire
Gallimard un siècle d'édition. 1911-2011
03/2011
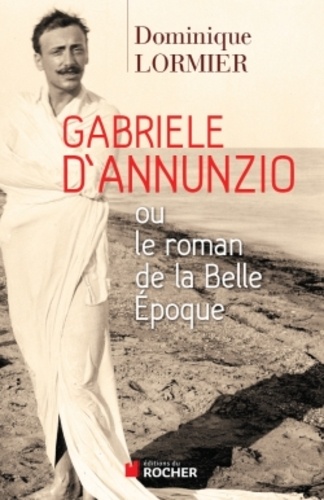
Romans historiques
Gabriele d'Annunzio ou le roman de la Belle Epoque
08/2014
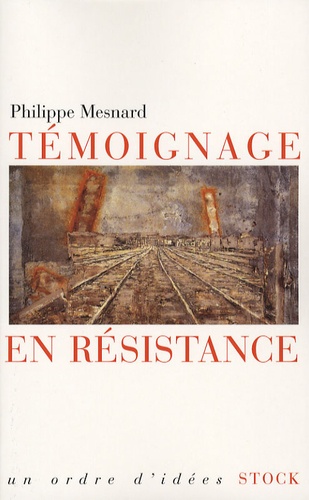
Critique littéraire
Témoignage en résistance
10/2007
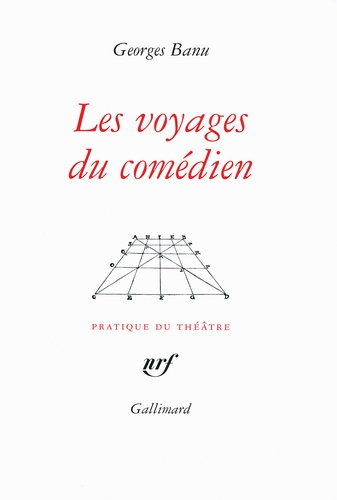
Théâtre
Les voyages du comédien
10/2012
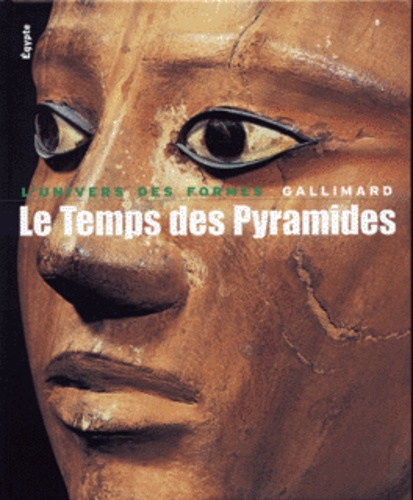
Beaux arts
Le Temps des Pyramides. De la Préhistoire aux Hyksos (1560 avant Jésus-Christ)
10/2006
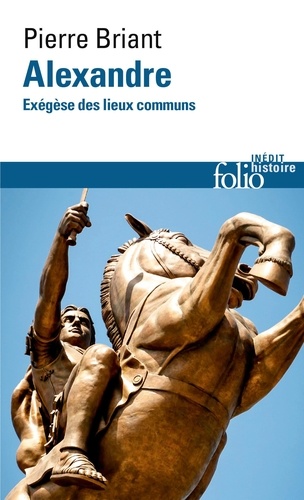
Histoire ancienne
Alexandre. Exégèse des lieux communs
11/2016
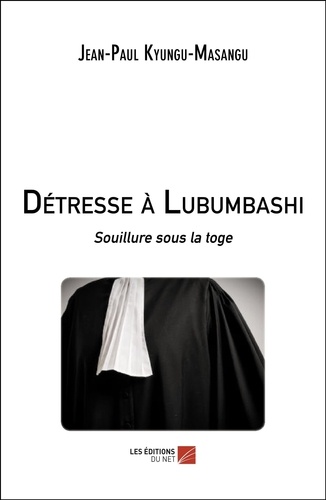
Littérature française
Détresse à Lubumbashi. Souillure sous la toge
09/2020
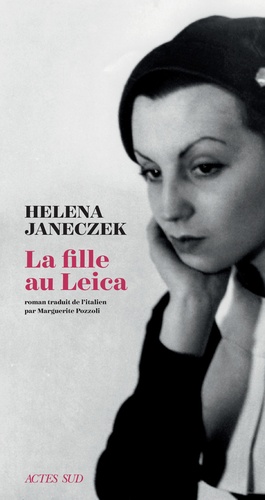
Littérature étrangère
La fille au Leica
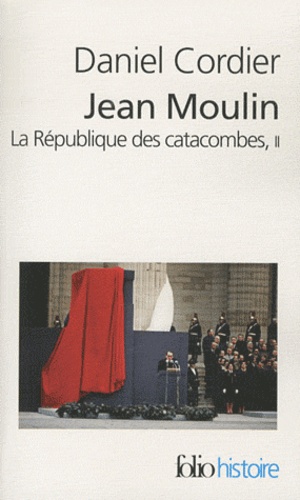
Histoire de France
Jean Moulin. La république des catacombes tome 2
03/2011
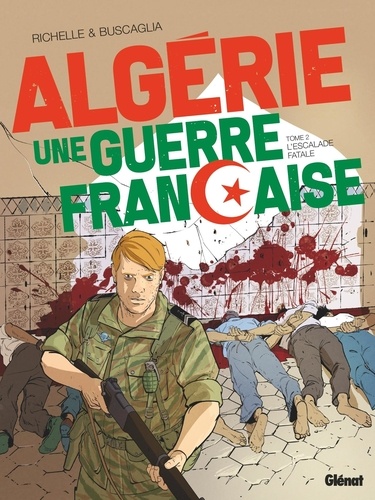
BD tout public
Algérie, une guerre française Tome 2 : L'escalade fatale
03/2020

Littérature étrangère
L'Arbre des tropiques. Tragédie en 3 actes
10/1984
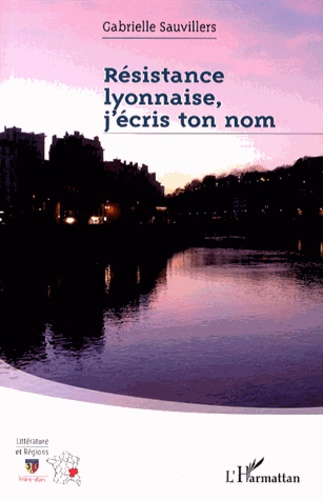
Romans historiques
Résistance lyonnaise, j'écris ton nom
04/2014
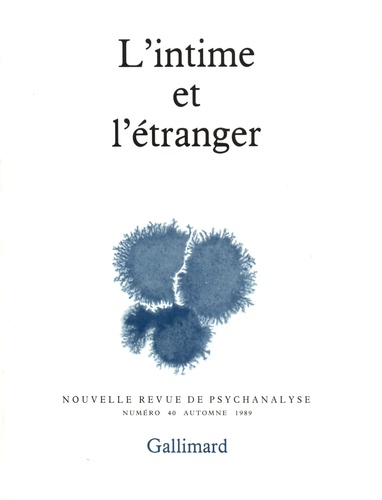
Psychologie, psychanalyse
Nouvelle revue de psychanalyse N° 40 automne 1989 : L'intime et l'étranger
11/1989
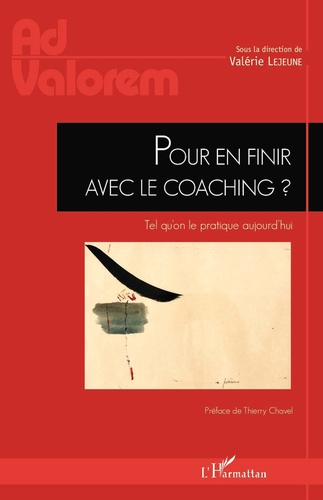
Gestion
Pour en finir avec le coaching ? Tel qu'on le pratique aujourd'hui
12/2018
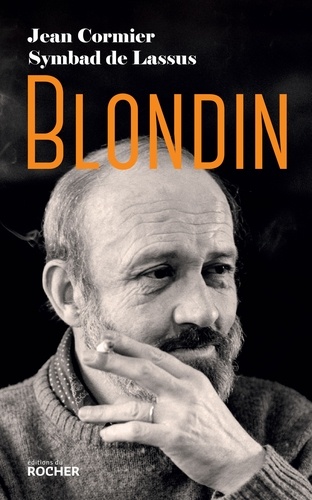
Critique littéraire
Blondin
06/2016
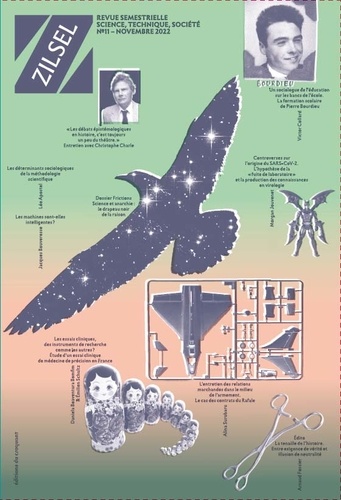
Sociologie
Revue Zilsel n° 11
01/2023
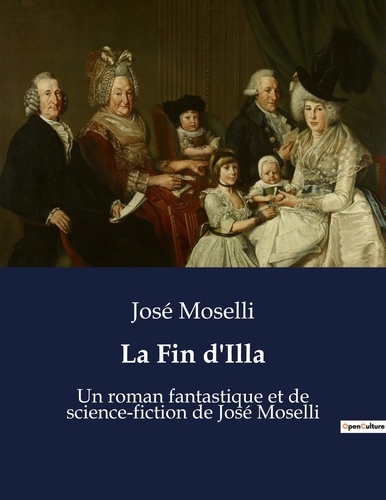
Littérature française
La Fin d'Illa. Un roman fantastique et de science-fiction de José Moselli
02/2023
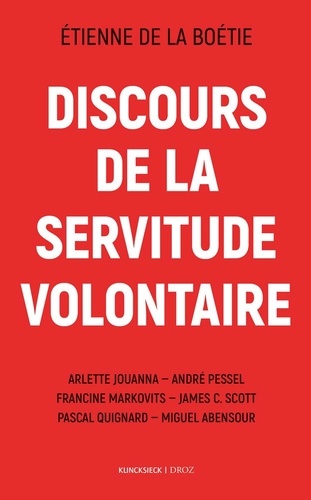
Autres philosophes
Discours de la servitude volontaire
09/2022
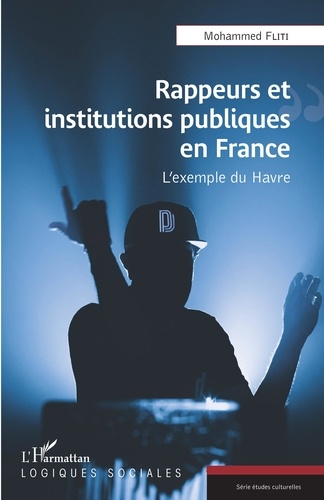
Sociologie urbaine
Rappeurs et institutions publiques en France. L'exemple du Havre
03/2021
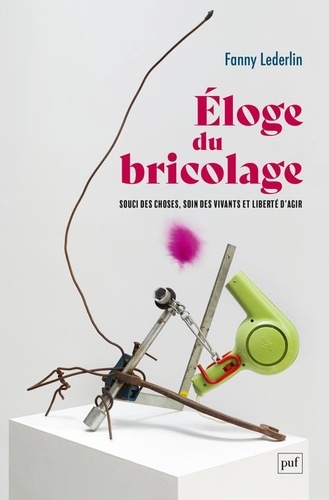
Sociologie
Eloge du bricolage. Souci des choses, soin des vivants et liberté d'agir
09/2023
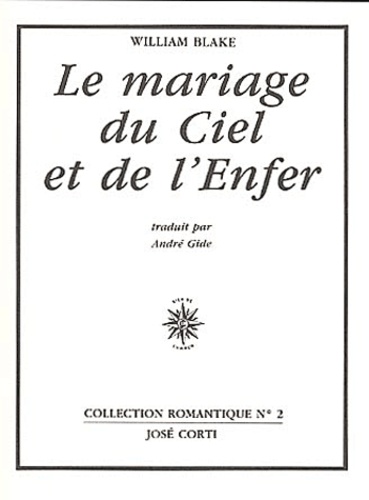
Littérature étrangère
Le mariage du Ciel et de l'Enfer
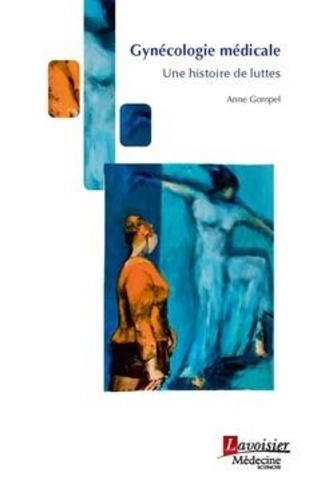
Gynécologie-obstétrique
Gynécologie médicale. Une histoire de luttes
09/2023
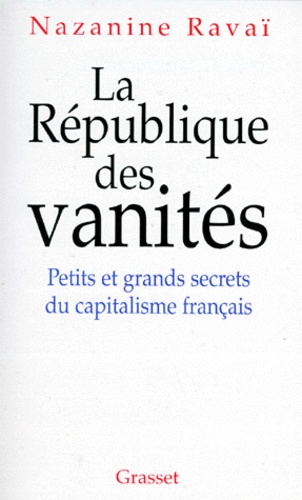
Sociologie
LA REPUBLIQUE DES VANITES. Petits et grands secrets du capitalisme français
07/1998
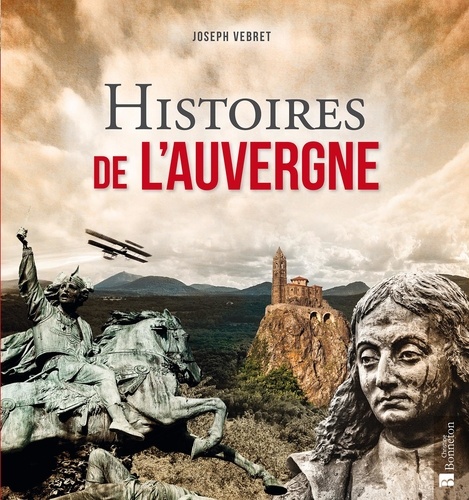
Histoire régionale
Histoires de l'Auvergne
11/2021
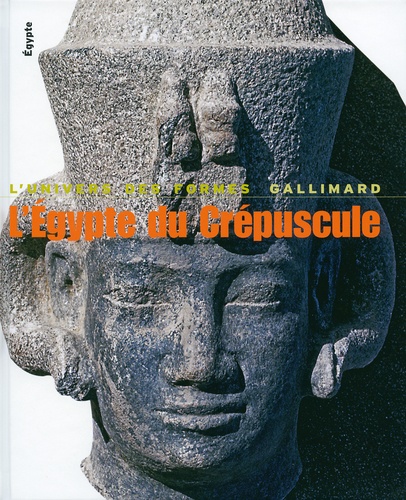
Beaux arts
L'Egypte du crépuscule. De Tanis à Méroé : 1070 av JC - 4e s après JC
10/2009

