Peintures italiennes du XIIIe au XVIIIe siècle. Musée Jacquemart-André
Extraits
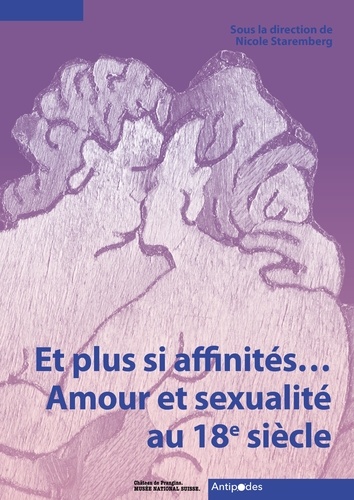
Histoire internationale
Et plus si affinites amour et sexualite au 18e siecle
06/2020
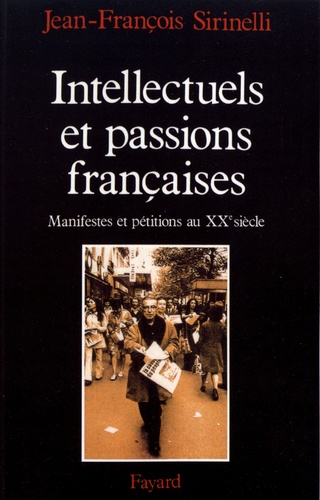
Sciences historiques
Intellectuels et passions françaises. Manifestes et pétitions au XXe siècle
03/1990
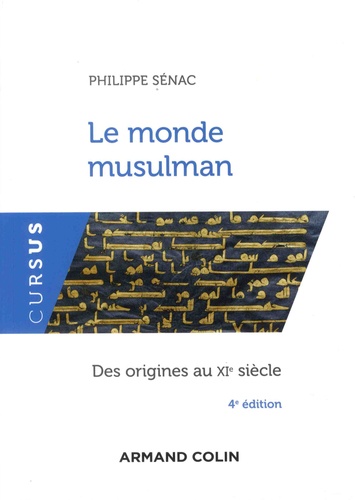
Histoire internationale
Le monde musulman. Des origines au XIe siècle, 4e édition
05/2018
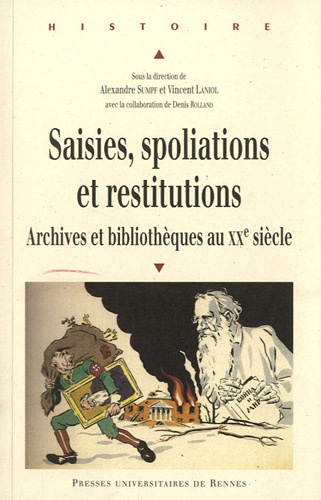
Sciences historiques
Saisies, spoliations et restitutions. Archives et bibliothèques au XXe siècle
08/2012
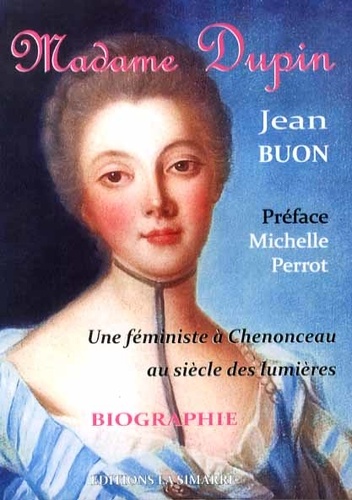
Critique littéraire
Madame Dupin. Une féministe à Chenonceau au siècle des Lumières
01/2014
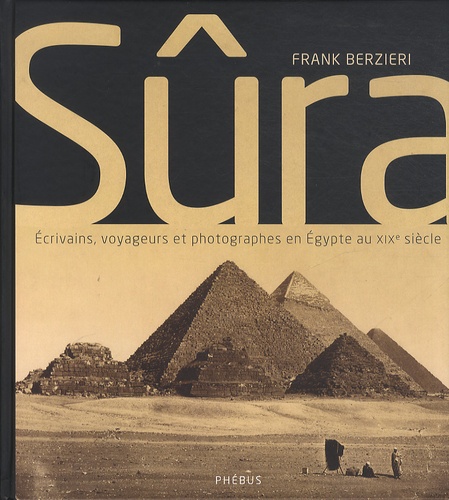
Photographie
Sûra. Ecrivains, voyageurs et photographes en Egypte au XIXe siècle
10/2012
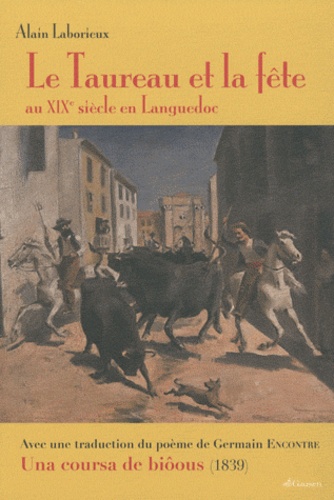
Sports
Le Taureau et la fête. Au XIXe siècle en Languedoc
03/2011
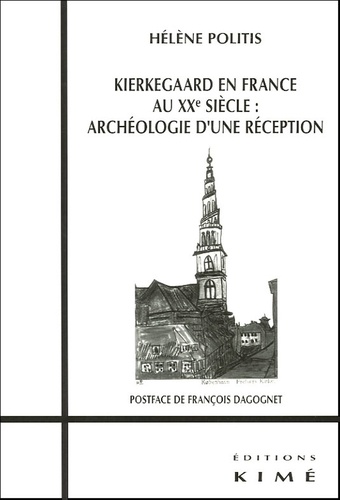
Philosophie
Kierkegaard en France au XXe siècle : archéologie d'une réception
04/2005
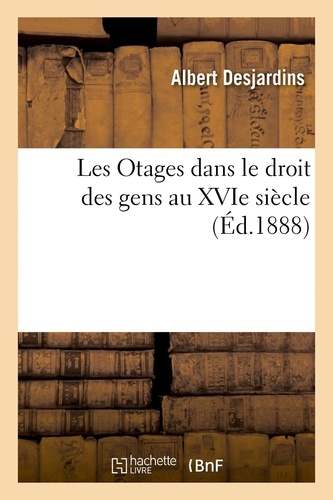
Sciences politiques
Les Otages dans le droit des gens au XVIe siècle
06/2020
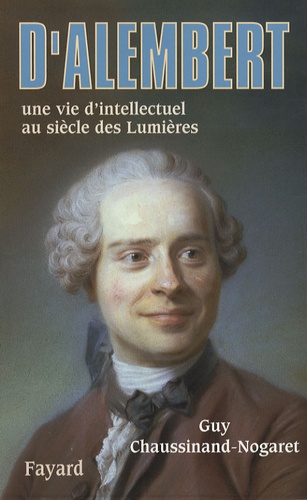
Philosophie
D'Alembert. Une vie d'intellectuel au siècle des Lumières
11/2007
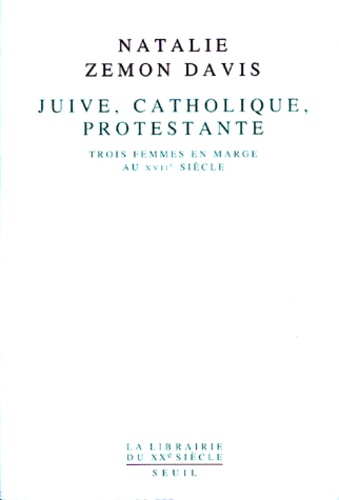
Sciences historiques
JUIVE, CATHOLIQUE, PROTESTANTE. Trois femmes en marge au XVIIème siècle
07/1998
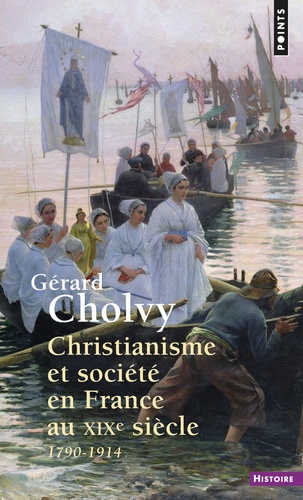
Religion
Christianisme et société en France au XIXe siècle. 1790-1914
05/2001
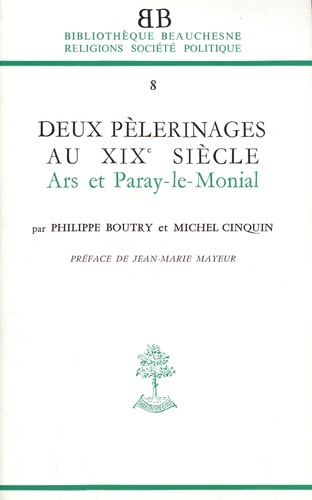
Religion
Deux pélerinages au XIXe siècle. Ars et Paray-le-Monial
09/1980
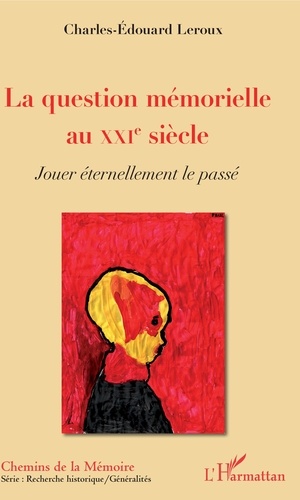
Philosophie
La question mémorielle au XXIe siècle. Jouer éternellement le passé
03/2019
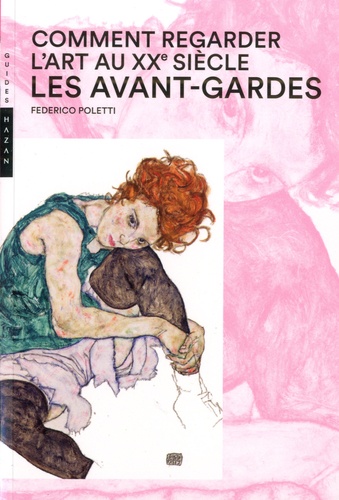
Beaux arts
Comment regarder l'art au XXe siècle. Les avant-gardes
04/2018
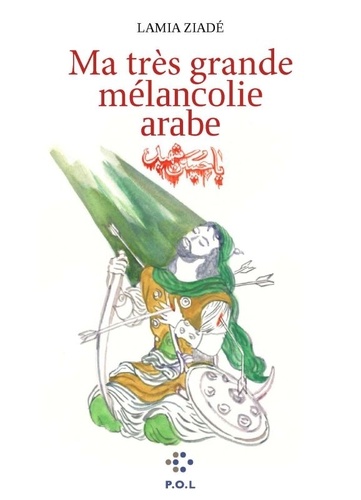
Histoire internationale
Ma très grande mélancolie arabe. Un siècle au Proche-Orient
10/2017
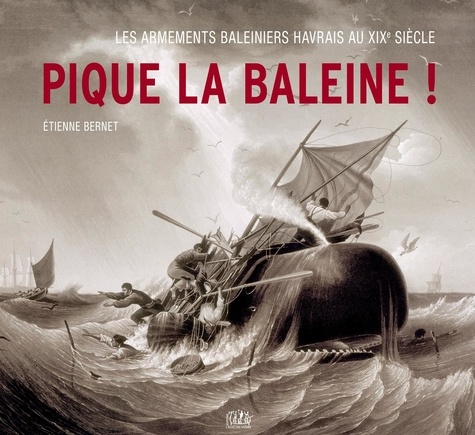
Histoire régionale
Pique la baleine !. Les armements baleiniers havrais au XIXe siècle
01/2022
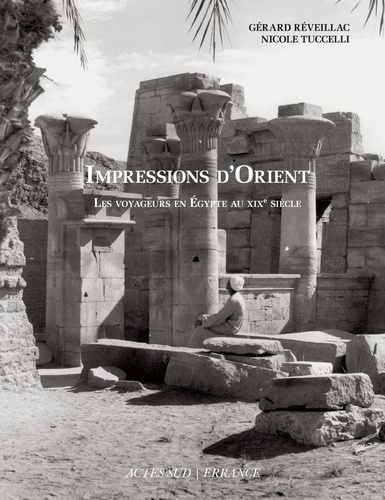
Egypte
Impressions d'Orient. Les voyageurs en Egypte au XIXe siècle
04/2022
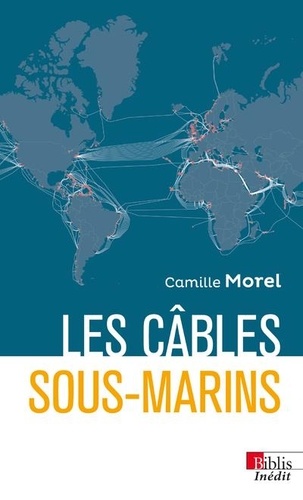
Géopolitique
Les câbles sous-marins. Enjeux et perspectives au XXIe siècle
03/2023
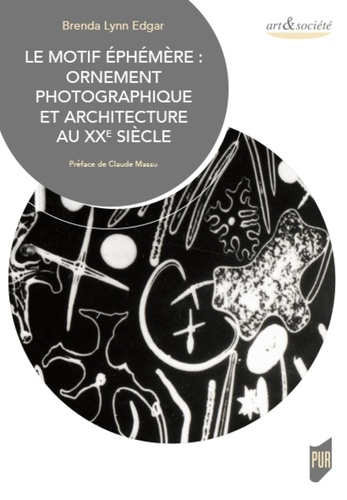
Histoire de l'art
Le motif éphémère : ornement photographique et architecture au XXe siècle
05/2021
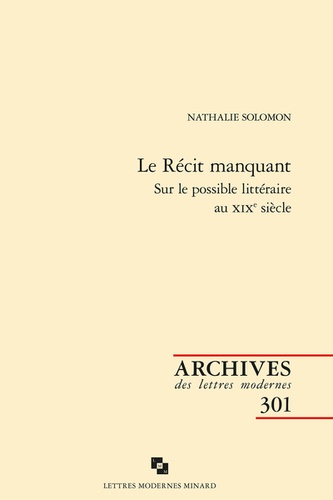
Critique
Le récit manquant. Sur le possible littéraire au XIXe siècle
02/2023
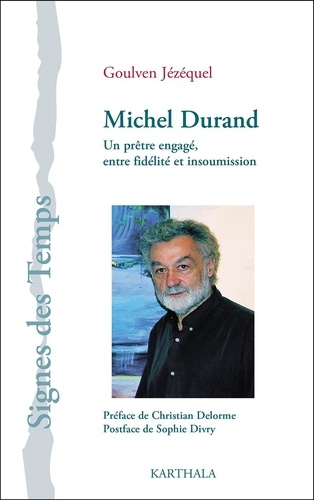
Vie de l'Eglise
Michel Durand, un prêtre au travail pour le XXIe siècle
04/2024
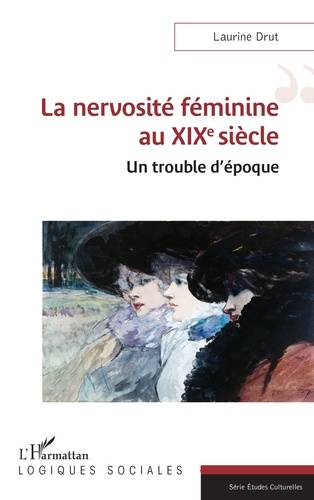
Sociologie
La nervosité féminine au XIXe siècle. Un trouble d’époque
04/2024
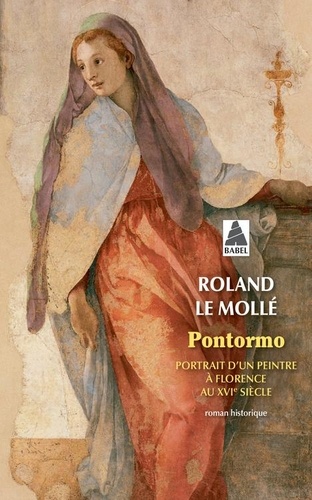
Romans historiques
Pontormo. Portrait d'un peintre à Florence au XVIe siècle
03/2024
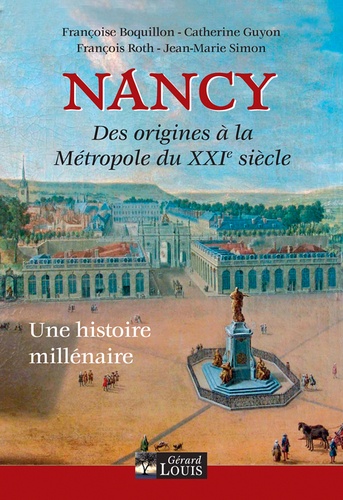
Histoire de France
Nancy. De ses origines à la métropole du XXIeme siècle
09/2019
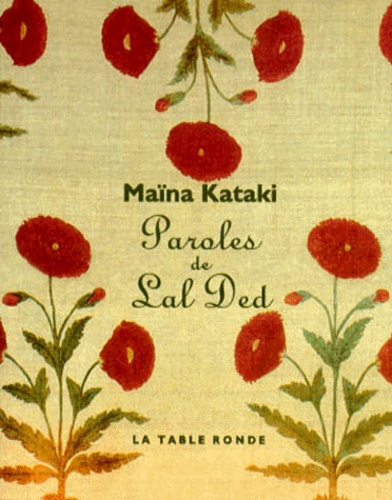
Religion
Paroles de Lal Ded. Une mystique du Cachemire (XIVe siècle)
09/1998
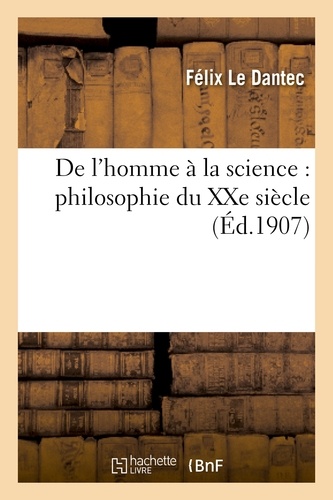
Littérature française
De l'homme à la science : philosophie du XXe siècle
05/2013
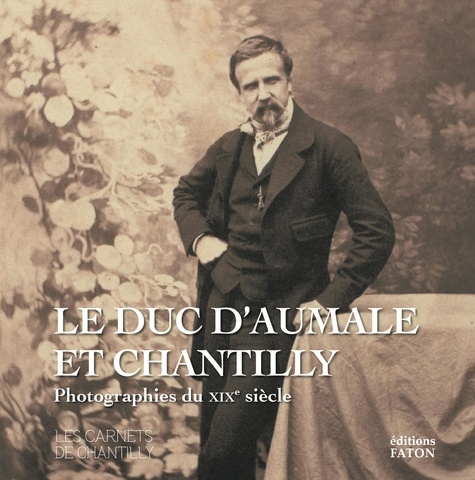
Photographie
Le duc d'Aumale et Chantilly. Photographie du XIXe siècle
11/2022
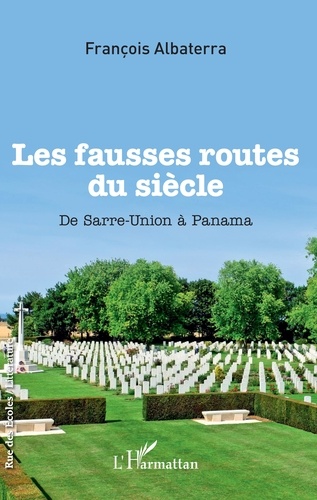
Littérature française
Les fausses routes du siècle. De Sarre-Union à Panama
01/2019
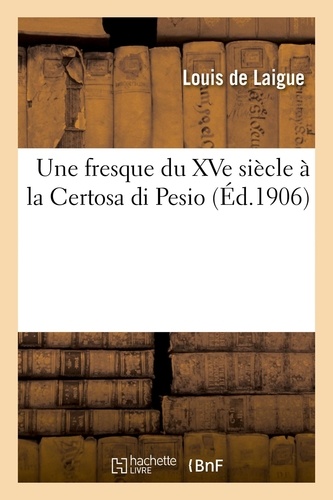
Histoire de l'art
Une fresque du XVe siècle à la Certosa di Pesio
07/2021

