Swing Time
Zadie Smith
À ma mère, Yvonne
Lorsque la musique change, la danse aussi.
Proverbe haoussa
Prologue
Ce fut le premier jour de mon humiliation. Mise dans un avion, renvoyée en Angleterre, installée dans un appartement à St John’s Wood, au huitième étage, qui donnait sur le terrain de cricket. L’endroit avait été choisi, je crois, à cause du concierge, qui éconduisait les curieux. Je restai enfermée. Le téléphone sur le mur de la cuisine sonna et sonna, mais j’avais pour consigne de ne pas répondre et de laisser mon portable éteint. Je regardai un match de cricket, un sport dont je ne connais pas les règles, ce qui ne me changea pas vraiment les idées, mais c’était toujours mieux que d’observer l’intérieur de cet appartement de luxe, entièrement conçu pour être d’une neutralité parfaite, où chaque angle était arrondi, à l’instar d’un iPhone. Lorsque le match s’acheva, j’examinai l’élégante machine à café encastrée dans le mur, et les deux photos de Bouddha – l’un en bronze, l’autre en bois –, et le cliché d’un éléphant s’agenouillant près d’un petit garçon indien, lui aussi à genoux. Les pièces, décorées avec goût dans les tons gris, étaient reliées par un couloir recouvert d’une moquette en laine tissée plat immaculée. Je fixai les stries du revêtement.
Deux jours se déroulèrent ainsi. Le troisième jour, le concierge appela pour dire que la voie était libre. Je jetai un coup d’œil à mon téléphone, posé sur le comptoir en mode avion. J’étais restée injoignable durant soixante-douze heures, et je me souviens avoir eu le sentiment que cela aurait dû être considéré comme un remarquable exemple de stoïcisme et d’endurance morale de notre époque. J’enfilai ma veste et descendis. Dans le hall, je croisai le concierge. Il en profita pour se plaindre amèrement (« Vous n’avez pas idée de comment c’était ici, ces derniers jours – on se serait carrément cru à Piccadilly Circus ! »), même s’il semblait évident qu’il était partagé, voire un peu déçu : il regrettait que l’agitation soit retombée – il s’était senti très important l’espace de quarante-huit heures. Il m’annonça fièrement avoir conseillé à plusieurs personnes de « se secouer », avoir dit à tel ou tel qu’« ils se mettaient le doigt dans l’œil jusqu’à l’omoplate » s’ils croyaient pouvoir passer. Je m’appuyai contre son comptoir et l’écoutai déblatérer. J’avais quitté l’Angleterre suffisamment longtemps pour que de simples expressions familières me semblent exotiques, presque incompréhensibles. Je lui demandai s’il pensait qu’il y aurait plus de monde le soir et il répondit que non, il n’y avait eu personne depuis la veille. Je voulus savoir s’il était envisageable que quelqu’un passe la nuit chez moi. « Je n’y vois aucun problème », répliqua-t-il, d’un ton qui me donna l’impression d’avoir posé une question ridicule. « Il y a toujours la porte de derrière. » Il soupira, et à cet instant une femme s’arrêta pour lui demander s’il pouvait réceptionner la livraison du teinturier pendant son absence. Elle s’adressait à lui avec rudesse et impatience, et, au lieu de le regarder, elle scrutait le calendrier posé sur le comptoir, bloc gris avec écran numérique, qui vous informait à la seconde près du moment de votre arrivée. Nous étions le vingt-cinq du mois d’octobre, en deux mille huit, et il était midi trente-six minutes et vingt-trois secondes. Je tournai les talons pour partir ; le concierge s’occupa de la femme avant de se précipiter pour m’ouvrir la porte. Il me demanda où j’allais ; je rétorquai que je l’ignorais. Je déambulai dans la ville. C’était un parfait après-midi d’automne à Londres, frais mais lumineux, et sous certains arbres s’étalait un tapis de feuilles dorées. Je passai devant le terrain de cricket et la mosquée, devant chez Madame Tussauds, je remontai Goodge Street, descendis Tottenham Court Road, traversai Trafalgar Square, et me retrouvai pour finir sur l’Embankment, où je franchis le pont. Je songeai – comme je songe souvent lorsque je franchis ce pont – aux deux jeunes étudiants qui, alors qu’ils s’y trouvaient très tard un soir, avaient été agressés et jetés dans la Tamise. L’un avait survécu, l’autre non. Je n’ai jamais compris comment le rescapé avait fait pour s’en sortir, dans l’obscurité et le froid absolu, en état de choc et avec ses chaussures aux pieds. Pensant à lui, je restai sur le côté droit du pont, le long de la voie ferrée, évitant de regarder le fleuve. Une fois sur South Bank, la première chose que je remarquai fut une affiche annonçant une rencontre l’après-midi même avec un réalisateur autrichien, qui commençait vingt minutes plus tard au Royal Festival Hall. Je décidai sur un coup de tête d’essayer d’avoir une place. Je m’y rendis et parvins à acheter un billet, au dernier rang du poulailler. Je ne m’attendais pas à grand-chose, sinon me changer les idées et oublier mes problèmes pendant un moment, assise dans la pénombre, à écouter des gens parler de films que je n’avais pas vus, mais au beau milieu du débat le réalisateur demanda à celui qui l’interviewait de passer un extrait de Swing Time, un film que je connaissais très bien, que j’avais regardé à maintes reprises quand j’étais enfant. Je me redressai. Sur un écran géant, Fred Astaire dansait avec trois silhouettes. Elles ne parvenaient pas à le suivre, et perdaient bientôt le rythme. Pour finir, elles jetaient l’éponge en faisant ce geste typiquement américain de la main gauche signifiant « Oh, pffffffff » avant de quitter la scène. Astaire continuait de danser seul. Je compris que les trois silhouettes étaient également Fred Astaire. L’avais-je perçu, enfant ? Personne ne s’appuyait sur l’air de cette façon, aucun autre danseur ne fléchissait les genoux comme lui. Pendant ce temps, le réalisateur évoqua sa théorie d’un « cinéma pur », qu’il se mit à qualifier d’« interaction entre la lumière et l’obscurité, exprimée comme à travers une sorte de rythme obéissant au temps qui passe », mais je trouvai cette notion ennuyeuse et difficile à suivre. Derrière lui, pour une raison ou pour une autre, le même extrait recommença du début, et mes pieds tapèrent sur le siège devant moi, en rythme avec la musique. Une merveilleuse légèreté envahit mon corps, un bonheur ridicule semblant surgir de nulle part. J’avais perdu mon travail, une certaine vision de ma vie, mon intimité, et pourtant tout cela paraissait insignifiant comparé à cette joie que j’éprouvais à regarder la danse et à me laisser pénétrer par la précision rythmique. Je sentis que je perdais conscience de l’endroit où je me trouvais, que je m’élevais au-dessus de mon corps, observant ma propre existence de très loin, comme si je planais. Cela me rappela la façon dont les gens décrivent leurs expériences avec les drogues hallucinogènes. J’eus une vision d’ensemble de toutes mes années, non pas défilant les unes après les autres, expérience après expérience, pour former quelque chose de substantiel – tout au contraire. J’eus une révélation : j’avais toujours essayé de m’attacher à l’éclat d’autrui ; je n’avais jamais produit ma propre lumière. J’eus le sentiment d’être une sorte d’ombre.
Extraits

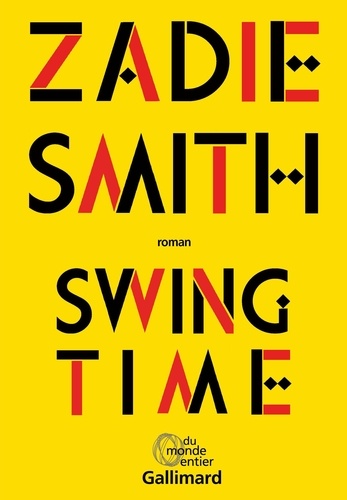


























Commenter ce livre