Coup d'état au Yémen
Gérard de Villiers
Malko se glissa à l'intérieur du jardin et le parcourut des yeux. Son regard s'immobilisa sur une colonne de pierre, en face de la véranda. Une tête était dessus. Mais pas une sculpture de marbre. Une tête humaine. Celle d'Amabeit." 1985, au Yémen. Le pays est encore moyenâgeux, resté à l'écart du monde et coupé en deux depuis une trentaine d'années entre la République démocratique et populaire du Yémen (Yémen du Sud), ancien protectorat britannique devenu un satellite de l'URSS, et la République arabe du Yémen (Yémen du Nord), resté dans la mouvance occidentale et soutenu par l'Arabie saoudite. A Sanaa, au Yemen du Sud un analyste de la CIA, Jack Penny, est assassiné au sortir d'un rendez-vous avec sa maîtresse, une éthiopienne du nom d'Assageth...
CHAPITRE PREMIER
Un chat noir, sans queue, couvert de mouches, miaulait, en équilibre sur une poubelle. Oleg Kopecki détourna la tête et s’arrêta en face d’une des passerelles enjambant l’énorme égout à ciel ouvert profond de plus de deux mètres qui séparait le Ring Road en deux. Étant donné son absence d’évacuation, l’utilité de cet égout, unique à Sanaa, apparaissait douteuse. Il servait surtout de piège aux automobilistes distraits ou maladroits qui s’y engloutissaient corps et biens.
Un panneau fixé à la passerelle indiquait « AI Ghaledi Group » souligné d’une flèche montrant l’autre côté de la route, où se dressait, entre une ruelle caillouteuse et un terrain vague, un building moderne de quatre étages à la façade marron tarabiscotée, les locaux commerciaux du rez-de-chaussée protégés par des rideaux de fer. Le Soviétique, attendant un ralentissement de la circulation, essuya son front avec un grand mouchoir à carreaux. Le soleil tapait encore fort et même sa casquette de toile blanche ne le protégeait pas. Il avait laissé sa Mercedes 200 grise au coin de Az Zubayri Road, à deux cents mètres de là.
Machinalement, il regarda autour de lui. Il ne vit, sur le trottoir qu’il venait de quitter, qu’un épicier allongé sur des sacs de semoule devant sa boutique-placard, la joue gauche déformée par une énorme chique, le regard dans le vague, ailleurs. L’armée soviétique tout entière aurait pu défiler devant lui, il ne s’en serait pas soucié...
Le qat. Les feuilles d’un beau vert cru d’un arbuste qui poussait un peu partout, que l’on mâchait pendant des heures et dont le suc procurait une évasion passagère semblable aux effets de l’opium. La folie du Yémen. Toutes les après-midi, la vie se ralentissait ou s’arrêtait jusqu’à la prière du soir. On « qatait ». Seul. Avec des amis. Chez soi. À son travail. Partout. Parfois, un chauffeur de taxi trop euphorique explosait contre un mur avec tous ses passagers. À cinquante ou cent rials la botte, cela constituait un fantastique marché. Le souci principal de la plupart des fonctionnaires, chaque matin, était de savoir comment ils allaient trouver leur botte quotidienne. On n’avait pas intérêt à avoir affaire à eux dans la matinée : le bakchich avait un punch d’enfer. Vers midi, la pression redescendait, ils envoyaient un enfant chercher leur ration au marché et, sereins, se préparaient à qater le reste de la journée.
Personne n’avait encore compris comment le pays continuait à marcher, la quasi-totalité des Yéménites mâles s’adonnant aux joies du qat, ce qui distendait leurs joues et leur donnait l’air perpétuellement allumé. Les gens sérieux se contentaient, eux, du jeudi et du vendredi...
Tandis que le Soviétique l’observait, l’épicier tira de sa large ceinture où elle était coincée à côté de son énorme et obscène jambia – le poignard recourbé traditionnel – une petite bouteille d’eau minérale et en but une rasade. Le qat donnait soif et les rues de Sanaa étaient jonchées de demi-bouteilles de Shamran, le Perrier local.
Oleg Kopecki jeta un regard dégoûté au vieux Yéménite et se lança sur la chaussée, le flot des voitures s’étant provisoirement tari.
Avec leur casquette blanche, leur pantalon trop large, leur mufle rubicond et leur chemise terne, on reconnaissait les Russes à un kilomètre. Il y en avait des milliers à Sanaa, conseillers militaires et civils, diplomates, ingénieurs...
Longeant une Mercedes noire aux vitres fumées et équipée d’un téléphone stationnant devant l’immeuble, le Soviétique pénétra dans le hall sombre et se dirigea vers l’escalier, immédiatement intercepté par un soldat qui lui barra la route, la main droite levée, les doigts réunis vers le haut, geste typiquement yéménite signifiant à peu près « arrêtez ! ». Un second surgit, murmura quelques mots à son oreille et il s’écarta. Un gros pistolet était passé à même leur ceinturon. Les Yéménites avaient horreur des holsters. Oleg Kopecki appuya sur un des boutons de l’interphone à gauche de l’escalier, soufflant déjà. Sanaa se trouvait à 2 200 mètres d’altitude et son cœur enrobé de graisse avait du mal à fournir. En plus, cette réunion l’inquiétait.
Le colonel Mohammed Bazara était affligé d’un battement de paupières incontrôlable, qui lui donnait l’air de dissimuler perpétuellement sa pensée, ce qui était d’ailleurs le cas. Lorsqu’il mettait des lunettes noires, ses cheveux irisés, son nez long et un peu fort, sa bouche bien dessinée le faisaient ressembler à un play-boy.
Il accueillit Oleg Kopecki d’une accolade chaleureuse et le salua en russe. Avant de devenir le chef du Elham El Makasi, il avait suivi une école d’officiers à Sébastopol et séjourné plusieurs fois en Union soviétique. Une grosse femme au visage ingrat, avec de petits yeux noirs enfoncés et des bajoues, fagotée comme une clocharde, apporta un plateau de thé et s’esquiva. Oleg Kopecki se laissa tomber sur un maigre canapé, se remettant de l’ascension des quatre étages.
Lorsqu’il eut avalé un peu de thé, il demanda d’un ton un peu trop jovial :
– Alors, Mohammed, pourquoi voulais-tu me voir ? Quelque chose ne va pas dans notre projet ?
Oleg Kopecki – rezident du KGB à Sanaa, sous la couverture de directeur du Poste d’Expansion Économique –n’utilisait cette « safe-house » que pour les rendez-vous secrets. Ceux qui n’entraient pas dans le cadre des relations étroites et officielles yéméno-soviétiques.
Le colonel Bazara battît furieusement des paupières.
– Non, non, il n’y a aucun contrordre. D’abord, je voulais te remettre ceci.
Il poussa vers le Soviétique un attaché-case noir tout neuf, encore dans son emballage plastique d’origine. Un objet superbe, signé Asprey, avec deux serrures à chiffres. Oleg Kopecki le regarda rapidement et demanda :
– L’autre a été remis à son destinataire ?
– Oui.
– Alors, dans ce cas, tout va bien...
L’officier yéménite se passa nerveusement la langue sur ses lèvres sèches. Entre la poussière et l’altitude, on avait toujours soif à Sanaa. Si, en outre on ajoutait l’angoisse...
– Je me demande si je n’ai pas commis une imprudence..., commença-t-il.
Oleg Kopecki se figea.
– Quoi ? demanda-t-il d’une voix trop calme.
Mohammed Bazara se pencha en avant, comme si on avait pu les entendre, bien qu’ils soient seuls dans le petit appartement.
– Voilà, tu sais que j’avais commandé les attaché-cases par l’intermédiaire d’une amie. Lorsqu’elle les a reçus, elle les a déposés chez l’Éthiopienne qui...
– Je sais, coupa Oleg un peu brusquement. Continue.
– J’ai autorisé cette Ethiopienne à avoir des contacts avec un de tes homologues. Tu vois qui je veux dire ?
– Oui. Et alors ?
C’était dur à passer. Les yeux du Soviétique étaient rivés à ceux de son interlocuteur, comme pour en extraire l’ultime parcelle de vérité.
– Eh bien, lorsque cet homme lui a rendu visite, hier, il a vu les deux attaché-cases et lui a demandé à qui ils étaient destinés. Elle a répondu qu’il y en avait un pour moi et un pour le capitaine Sharjaq. Ça a semblé lui suffire et je pense qu’il ne le mentionnera même pas dans son compte rendu. Seulement, plus tard, il risque de s’en souvenir...
Oleg Kopecki secoua lentement la tête comme un éléphant fatigué et fit d’une voix lasse :
– Je t’ai toujours dit que ces histoires d’agent double finiraient mal... – Tu crois que c’est grave ? demanda anxieusement Bazara.
Le Soviétique lui expédia un regard à geler l’Everest.
– Ce n’est pas grave. C’est catastrophique.
Un lourd silence suivit ses mots. Bazara n’osait plus le regarder en face, même pas allumer une cigarette. Oleg Kopecki s’appuya au dossier de son siège, jurant intérieurement en russe. Quelle tristesse de travailler avec des cons pareils ! Si Bazara avait été sous ses ordres, il l’aurait jeté dans le premier avion pour Moscou, avec l’ordre de lui faire finir sa carrière à Ninji-Novgorod... Hélas, ce n’était pas le cas et, d’ailleurs, il avait encore besoin de lui...
– Tu comprends, fit-il d’un ton cinglant, que nous devons renoncer à toute l’opération. Il est hors de question que l’on puisse remonter jusqu’à nous, même si le risque est minime. À moins que...
– À moins que quoi ?
Le Soviétique ne répondit pas et les deux hommes échangèrent un coup d’œil parfaitement explicite. L’officier yéménite se leva, comme mû par une pile électrique.
– Je m’en occupe tout de suite !
– Assieds-toi et écoute-moi, ordonna froidement Oleg Kopecki. Il ne s’agit pas de foncer tête baissée, mais de mettre en place un habillage qui empêchera qu’on nous désigne du doigt immédiatement. Nos homologues ne sont pas des imbéciles, mais même s’ils ne croient pas à notre montage, ils n’auront que des doutes, rien de solide.
– J’ai une idée, proposa Bazara.
Il l’exposa au Soviétique. Celui-ci, à la fin, dit du bout des lèvres :
– Cela peut tenir la route. Mais il faut faire vite. Chaque minute est un risque potentiel. Et ne touche pas à l’autre fille pour le moment. Fais-lui peur seulement.
– Rien n’est possible avant après-demain, si nous procédons de cette façon, avertit Bazara.
Oleg Kopecki regarda sa montre, prit l’attaché-case sous plastique et se leva :
– À la semaine prochaine.
Mohammed Bazara le raccompagna jusque sur le palier. De nouveau, ils se donnèrent l’accolade puis le Soviétique s’engagea d’un pas lourd dans l’escalier. Durant les quatre étages, il se demanda s’il allait ou non envoyer un compte rendu de son entretien à Moscou... S’il le faisait, le Centre risquait de geler indéfiniment une opération sur laquelle il travaillait depuis des mois. S’il s’abstenait et qu’il y ait un pépin, il risquait au minimum le rappel immédiat à Moscou et une fin de carrière comme archiviste...
Comme il débouchait dans la poussière du Ring Road, l’aboiement autoritaire d’un muezzin tout proche éclata, aussitôt répercuté par des dizaines d’autres, appelant à la prière du soir. À Sanaa, nul ne pouvait oublier que Dieu est Dieu et Mahomet son prophète.
Jack Penny sortit du building tout neuf de l’USIS, chef d’œuvre de l’architecture yéménite, avec ses fontaines, ses ouvertures en ogive, rehaussées de motifs en plâtre blanc, ses dallages harmonieux. Il eut du mal à introduire ses cent quatre-vingt-dix centimètres dans sa Pajero de service, La plupart des rues de Sanaa ressemblant aux pistes du Ténéré, aucune berline de série ne tenait longtemps.
Un de ses adjoints, un Noir de Géorgie, lui cria :
– Où vas-tu ?
– Au tennis, fit Jack Penny.
L’autre eut un rire complice.
– Bullshit ! Tu as encore trouvé une nana. Salaud !
Le jeune Américain était la coqueluche de Sanaa. Sa carrure athlétique, son profil de gladiateur, ses dents éclatantes, ses gestes posés et un peu larges, et même le léger tic qui lui remontait parfois la narine, lui donnaient un charme fou.
Accroché à son volant, il entreprit de franchir les bosses et les trous qui le séparaient de Haddah Road, dispersant un troupeau de chèvres. L’USIS se trouvait dans le sud de Sanaa, là où la ville et le désert se chevauchaient, dans un flou ocre et poussiéreux. Derrière lui, une imposante Toyota Land Cruiser Saloon luttait aussi contre la poussière. Le nec plus ultra au Yémen. Hautes sur pattes, puissantes, confortables, rapides sur route et sur piste, elles ravissaient les Bédouins qui s’en procuraient par tous les moyens, y compris le vol. Elles pullulaient à Sanaa. Le Yémen du Nord était officiellement un pays pauvre, mais plein de gens riches...
Arrivé enfin sur Haddah Road, il tourna à droite, en direction du sud. Il parcourut un kilomètre et tourna à gauche sur une piste effroyable.
Secoué comme un prunier, il se demanda soudain si les Yéménites avaient deviné son appartenance à la CIA. En poste depuis six mois, il n’avait pas pris beaucoup de contacts, se cantonnant dans l’analyse. Celle qu’il allait voir était sa première source, ce dont il était très fier. Oswald Byrnes, le chef de station de la CIA à Sanaa, lui avait recommandé la prudence. Les Américains n’étaient pas officiellement bien vus à Sanaa. À cause de l’influence soviétique et au moins autant en raison de leurs liens avec les Saoudiens, qui, eux, étaient particulièrement détestés. Cependant il n’y avait jamais de démonstration hostile. Le gouvernement yéménite se spécialisait dans un difficile numéro d’équilibriste entre l’Est et l’Ouest. Une voiture le croisa, laissant une traînée sonore assourdissante. Son conducteur enturbanné tapait sur son volant recouvert de fourrure synthétique au rythme d’un verset du Coran braillé par son haut-parleur. Il adressa un sourire affectueux à Jack Penny, la joue déformée par une énorme boule de qat. Les Yéménites semblaient tous atteints de rage de dents...
La nuit était presque tombée et le muezzin d’une mosquée voisine se déchaîna, assourdissant. Jack Penny acheva quelques zigzags dans les charias désertes d’un lotissement moderne, s’assurant ainsi qu’il n’était pas suivi puis en sortit, piquant vers le nord utilisant une piste parallèle à Haddah Road, gagnée au bulldozer sur le désert, décapée par le vent, rongée par les pluies rares et violentes. La mort des pneus et des amortisseurs.
Il dut contourner une énorme mare, reste d’une tornade, tanguant et roulant effroyablement. Pas une lumière. Dans ce coin, il n’y avait que quelques entrepôts et des maisons isolées. À sa gauche se dressait la masse sombre d’un djebel, aux sommets hérissés de DCA. Le palais présidentiel était tout proche, en bordure de l’ancien aéroport et le président du Nord-Yémen, Abdallah Saleh, craignait tout le monde : les Sud-Yéménites, les Saoudiens et ses propres pilotes, parfois portés sur le coup d’État. Ses deux prédécesseurs avaient involontairement abrégé leur mandat à la suite de menues fusillades qui avaient fait quelques centaines de morts en plus d’eux. Au Yémen, la politique avait encore du piquant.
Sept années de féroce guerre civile n’avaient pas calmé les Bédouins toujours prompts à s’entre-massacrer au nom d’Allah le Miséricordieux.
Le jeune Américain bifurqua et se gara le long d’une maison en construction. Il descendit et partit à pied en sifflotant. L’air était frais et le silence absolu, à part les éternels aboiements des chiens errants. Dans ce quartier, les maisons étaient plantées au hasard, séparées par des étendues caillouteuses transformées la plupart du temps en dépôts d’immondices. Grâce à Dieu, la sécheresse de l’air limitait la puanteur.
Arrivé à une porte de fer peinte en bleu, tranchant sur un haut mur blanc, il appuya sur le bouton d’un interphone. Une voix de femme répondit aussitôt :
– Aiwa ?
Il y eut des pas sur le gravier et la grille s’ouvrit. Jack Penny courba sa haute stature pour entrer.
– Good evening, Jack ! lança une voix féminine très douce.
Même dressée sur la pointe des pieds, Assageth arrivait tout juste à l’épaule du jeune Américain. D’un geste puissant, il la prit sous les aisselles, la souleva et amena sa bouche à la hauteur de la sienne. La jeune Éthiopienne se débattit gentiment et murmura :
– Pas ici ! Viens, rentrons.
Jack Penny se dit qu’il se conduisait comme un Yéménite. Ceux-ci étaient de complets obsédés sexuels, en raison de la rareté des femmes, beaucoup trop chères pour les pauvres. L’Éthiopienne le fît entrer dans un mofrech, une pièce dépouillée, quelques tapis, des coussins entassés contre les murs et une télévision. L’odeur fade du qat flottait encore dans l’air. Assageth avait dû recevoir un autre de ses amants...
Jack Penny s’installa confortablement dans les coussins. Aussitôt, la jeune femme se blottit à côté de lui et commença à défaire les boutons de sa chemise. Elle avait un visage triangulaire avec d’immenses yeux noirs pleins de timidité, une bouche trop grande aux lèvres épaisses et des dents très blanches contrastant avec sa peau sombre. Son corps, sous la djellaba blanche, ressemblait à celui d’un enfant, tant il était menu. Pourtant, Jack se délectait de ses petits seins ronds et fermes, et de sa chute de reins étonnamment marquée. Il glissa une main sous la djellaba, trouva les fesses cambrées et les caressa avec sa grande main. Assageth ferma les yeux et se frotta à lui comme un chat, continuant à le déshabiller avec des gestes doux.
Lorsqu’elle eut dénudé sa poitrine, elle se mit à la picorer de petits baisers, tout en parcourant inlassablement son dos de ses doigts légers.
– Comme tu es fort ! murmura-t-elle.
19/05/2016
234
pages
7,95
€
Extraits

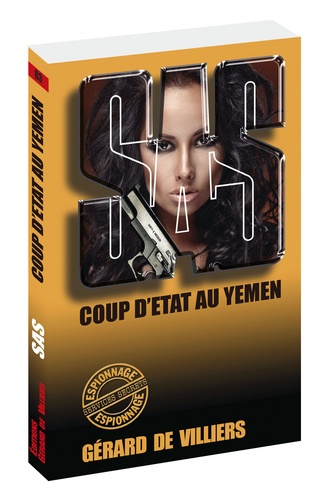


























Commenter ce livre