L'île des oubliés
Victoria Hislop
Editeur
Genre
Littérature étrangère
1
Plaka, 2001
Libérée de son point d'amarrage, la corde se déroula d'un mouvement vif, et des gouttelettes d'eau de mer aspergèrent les bras nus de la jeune femme. Elles séchèrent rapidement, et celle-ci remarqua que, sous le soleil de plomb qui brillait dans un ciel limpide, les cristaux de sel dessinaient des motifs complexes et scintillants sur sa peau, comme un tatouage de diamants. Alexis était l'unique passagère de la petite barque délabrée. Tandis qu'au son du moteur haletant elle s'éloignait du quai pour rejoindre l'île déserte qui se dressait face à eux, elle réprima un frisson, songeant à tous ceux et toutes celles qui s'y étaient rendus avant elle.
Spinalonga. Elle joua avec le mot, le fit rouler sur sa langue comme un noyau d'olive. L'île n'était pas loin et, quand l'embarcation approcha de l'imposante fortification vénitienne adossée à la mer, Alexis fut submergée à la fois par le poids du passé et par la sensation écrasante que ces murailles conservaient, aujourd'hui encore, une force d'attraction. Elle se mit à songer qu'il s'agissait peut-être d'un endroit où l'histoire, toujours palpitante, ne s'était pas figée dans les pierres froides, un endroit où les habitants étaient réels et non mythiques. Quelle différence avec les palais antiques et les sites qu'elle avait visités au cours des dernières semaines, mois, voire années !
Alexis aurait pu consacrer une journée supplémentaire à escalader les ruines de Cnossos, à se représenter, devant les fragments grossiers de pierre, la vie que les Cretois avaient menée en ces lieux plus de quatre mille ans auparavant. Ces derniers temps, cependant, ce passé si lointain commençait à se dérober à son imagination et à sa curiosité. Malgré son diplôme en archéologie et son poste dans un musée, elle sentait son intérêt pour la question s'émousser de jour en jour. Son père était un universitaire passionné, et elle avait grandi avec la croyance naïve qu'elle suivrait ses traces dans la poussière de l'histoire. Pour quelqu'un comme Marcus Fielding, toutes les civilisations, même les plus anciennes, étaient dignes d'intérêt, mais, du haut de ses vingt-cinq ans, Alexis trouvait que le bœuf qu'elle avait dépassé sur la route plus tôt dans la journée avait bien plus de réalité, plus de résonance avec sa propre vie que n'en aurait jamais le Minotaure enfermé dans le labyrinthe légendaire de Crète.
Pour l'heure, elle avait toutefois d'autres sujets de préoccupation que son orientation professionnelle ; elle devait prendre une décision au sujet d'Ed. Tout le temps qu'ils s'étaient prélassés, en cette fin d'été, sur une île grecque, les limites de leur liaison autrefois prometteuse lui étaient peu à peu apparues. Si leur histoire avait réussi à fleurir au sein du microcosme étouffant de l'université, elle s'était flétrie au contact du monde extérieur et, au bout de trois ans, ne ressemblait plus qu'à une bouture chétive qui n'aurait pas pris une fois passée de la serre au jardin.
Ed était bel homme. C'était un fait. Mais ce physique avantageux irritait souvent Alexis plus que tout : il ne faisait que souligner l'arrogance et l'assurance, parfois enviable, d'Ed. Ils formaient un couple bien assorti, au sens où les opposés s'attirent. Alexis avec sa peau pâle, ses yeux et ses cheveux foncés, Ed avec sa blondeur et son regard bleuté presque aryens. Parfois, cependant, elle avait le sentiment que sa nature, plus sauvage, était comme assourdie par la soif de discipline et d'ordre d'Ed et elle savait que ce n'était pas la vie qu'elle voulait ; même mesurée, la spontanéité à laquelle Alexis aspirait tant semblait insupportable aux yeux d'Ed.
Nombre des autres qualités de celui-ci, considérées par la plupart comme des atouts, avaient commencé à l'exaspérer. Une assurance tenace d'abord, conséquence logique d'une foi inébranlable en l'avenir, et ce depuis la naissance. Ed avait la garantie d'un poste à vie dans un cabinet d'avocats, et son existence suivrait ainsi l'évolution de sa carrière et des déménagements imposés. Alexis n'avait qu'une conviction : leur incompatibilité irait croissant. Au fil des vacances, elle avait consacré de plus en plus de temps à se représenter son futur, et Ed n'y occupait pas la moindre place. Dans les domaines les plus triviaux, même, ils ne s'accordaient pas. Si le tube de dentifrice était pressé au mauvais endroit, Alexis était forcément coupable. Face au laisser-aller dont elle faisait preuve, la réaction d'Ed était symptomatique de son approche de la vie en général : pour Alexis, la méticulosité qu'il exigeait trahissait un besoin de contrôle insupportable. Elle s'efforçait d'apprécier son goût pour l'ordre, mais prenait ombrage de ses critiques muettes à l'encontre de la vie prétendument chaotique qu'elle menait. Elle songeait d'ailleurs souvent qu'elle se sentait davantage chez elle dans le bureau sombre et désordonné de son père plutôt que dans la chambre à coucher de ses parents, domaine maternel par excellence, aux tons pastel et dépouillé, qui lui arrachait des frissons.
Rien n'avait jamais résisté à Ed. Les fées s'étaient penchées sur son berceau : sans le moindre effort, il avait obtenu les meilleures notes et remporté toutes les compétitions sportives, année après année. Le parfait délégué de classe. Les dommages seraient terribles si la bulle dans laquelle il vivait explosait. Il avait été élevé dans la croyance que le monde était son écrin, mais Alexis commençait à comprendre qu'elle ne supporterait pas d'y être enfermée avec lui. Elle se sentait incapable de renoncer à son indépendance pour faire partie de la vie d'Ed, quand bien même tout semblait la pousser à ce sacrifice. Une location légèrement miteuse à Crouch End, au nord de Londres, contre un appartement coquet en plein centre, à Kensington : avait-elle perdu la tête en refusant ? Ed espérait qu'elle s'installerait chez lui à l'automne, mais un tas de questions la taraudaient : quel intérêt de vivre avec lui s'ils n'étaient pas sûrs de se marier ? Et voulait-elle seulement qu'il soit le père de ses enfants ? Tels étaient les doutes qui planaient sur elle depuis des semaines, voire des mois à présent, et il faudrait bientôt qu'elle ait le courage de prendre les décisions qui s'imposaient. Ed était si absorbé par l'organisation de leurs vacances qu'il semblait à peine remarquer qu'Alexis se murait, de jour en jour, dans un silence plus profond.
Ce séjour différait en tout de son voyage d'étudiante dans les îles grecques, à l'époque où ses amis et elle étaient des esprits libres qui laissaient la fantaisie guider leurs pas à travers les longues journées ensoleillées : ils remettaient à une pièce de vingt drachmes la décision de s'arrêter dans tel bar, de se faire rôtir sur telle plage, de rester ou non sur telle île. Elle avait du mal à croire que la vie avait pu être aussi insouciante. Son séjour avec Ed était une source constante de conflits, de disputes et de remises en question : une lutte qui avait commencé bien avant qu'elle eût mis le pied sur le sol crétois.
Comment puis-je, à vingt-cinq ans, avoir aussi peu de certitudes sur mon avenir ? s'était-elle demandé en préparant sa valise pour ce voyage. Me voilà dans un appartement qui ne m'appartient pas, à la veille de quitter pour les vacances un travail que je n'aime pas, avec un homme dont je n'ai rien à faire. Qu'est-ce qui cloche chez moi ?
À l'âge d'Alexis, sa mère, Sophia, était mariée depuis plusieurs années et avait déjà deux enfants. Quelles circonstances l'avaient donc amenée à acquérir une telle maturité aussi jeune ? Comment avait-elle pu être aussi installée dans la vie alors qu'Alexis se sentait encore enfant ? Si seulement elle en avait su davantage sur la façon dont sa mère avait abordé l'existence, cela aurait pu l'aider à prendre ses propres décisions.
Sophia s'était toujours montrée très secrète sur son passé, et au fil des ans, sa discrétion s'était dressée comme une barrière entre elle et sa fille. Alexis voyait une forme d'ironie à ce que l'étude du passé fût à ce point encouragée dans sa famille et qu'on l'empêche d'examiner sa propre histoire à la loupe ; cette impression que Sophia dissimulait quelque chose à ses enfants teintait leurs relations de défiance. Sophia Fielding avait non seulement enterré ses racines mais aussi piétiné la terre qui les recouvrait.
Alexis n'avait qu'un seul indice du passé de sa mère : une photo de mariage décolorée, qui, aussi loin qu'elle s'en souvienne, s'était toujours trouvée sur la table de nuit de celle-ci. Son cadre en argent tarabiscoté était usé à force d'avoir été poli. Dans sa petite enfance, lorsque Alexis se servait du grand lit défoncé de ses parents comme d'un trampoline, l'image du couple qui, bien que souriant, prenait la pose avec raideur, allait et venait sous ses yeux. Parfois, elle interrogeait sa mère sur la belle dame en dentelle et l'homme au visage anguleux. Comment s'appelaient-ils ? Pourquoi avait-il les cheveux gris ? Où se trouvaient-ils à présent ? Sophia lui fournissait des réponses brèves : il s'agissait de sa tante Maria et de son oncle Nikolaos, qui avaient vécu en Crète et y étaient morts. Si ces explications avaient satisfait Alexis à l'époque, aujourd'hui elle avait besoin d'en savoir davantage. C'était le statut particulier de cette photo - la seule encadrée de toute la maison, à l'exception de celles représentant Alexis et son frère cadet, Nick - qui l'intriguait. Alors que ce couple avait, selon toute évidence, beaucoup compté dans l'enfance de sa mère, celle-ci répugnait à en parler. Plus que de la réticence, en réalité, cela ressemblait à un refus entêté. Au cours de son adolescence, Alexis avait appris à respecter la réserve de sa mère - aussi profonde, à l'époque, que son propre réflexe de repli sur soi, de mise à distance du monde extérieur. Mais elle avait dépassé ses complexes de jeune fille à présent.
La veille de son départ en vacances, elle s'était rendue chez ses parents, une maison mitoyenne, d'architecture victorienne, située dans une rue paisible du quartier de Battersea. La tradition familiale voulait qu'ils dînent ensemble dans le petit restaurant grec du coin avant le départ d'Alexis, ou de Nick, pour un nouveau semestre universitaire ou pour un voyage. Cette fois, la visite de celle-ci avait un autre motif. Elle voulait demander un conseil à sa mère au sujet d'Ed et, plus important encore, l'interroger sur son passé. Alexis arriva avec une bonne heure d'avance, bien résolue à convaincre sa mère de lever le voile sur cette partie de sa vie. Un mince rayon de lumière lui suffirait.
Après avoir franchi le seuil, elle se délesta de son lourd sac à dos sur le carrelage et jeta sa clé dans le vide-poches en laiton posé sur l'étagère dans l'entrée. Celle-ci y atterrit avec fracas. Alexis savait que sa mère ne détestait rien tant qu'être surprise.
— Salut, maman ! lança-t-elle dans le couloir désert.
Supposant que sa mère se trouvait au premier, elle monta les marches deux par deux ; en pénétrant dans la chambre de ses parents, elle s'émerveilla, comme toujours, de l'ordre extrême qui y régnait. Une modeste collection de perles était suspendue à un coin du miroir et trois bouteilles de parfum étaient alignées avec soin sur la coiffeuse. Pas un seul autre objet ne traînait dans la pièce. Rien qui pût renseigner Alexis sur la personnalité de sa mère ou sur son histoire : ni photo au mur, ni livre sur la table de nuit. Rien, à part le fameux cliché encadré à côté du lit. Sophia avait beau la partager avec Marcus, cette pièce était son domaine réservé, et son goût pour le rangement s'y exprimait pleinement. Chaque membre de la famille avait le sien, et chacun de ces domaines reflétait à la perfection la personnalité de son propriétaire.
Si le cadre minimaliste de la chambre correspondait au caractère de Sophia, le bureau de Marcus, avec ses innombrables piles de livres, était à l'image de ce dernier. Lorsque ces tours colossales s'effondraient, les volumes s'éparpillaient sur le sol ; dans ces cas-là, pour atteindre la table de travail, les ouvrages reliés en cuir se transformaient en pierres plates permettant de traverser un marécage. Marcus aimait travailler dans ce temple en ruine. Il lui rappelait ses fouilles archéologiques, où chaque morceau de roche était étiqueté avec soin, et où un œil non exercé n'y aurait vu qu'un tas de débris. Il faisait toujours chaud et, petite fille, Alexis s'y faufilait pour lire, lovée dans le fauteuil en cuir qui, bien qu'il perdît sans arrêt son rembourrage, restait le siège le plus confortable de la maison.
Alors que les enfants avaient quitté le domicile familial depuis longtemps, leur chambre respective n'avait pas bougé. Les murs de celle d'Alexis étaient toujours de ce violet agressif qu'elle avait choisi en pleine crise de révolte à quinze ans. Le mauve du couvre-lit, du tapis et de l'armoire, qui y répondait, était une couleur propice aux migraines et accès de colère - Alexis avait d'ailleurs fini par l'admettre avec l'âge. Un jour, ses parents se résoudraient peut-être à la repeindre, mais, dans une maison où le goût pour la décoration n'était que secondaire, il pourrait facilement s'écouler dix ans avant qu'ils ne passent à l'acte. La question de la couleur avait cessé depuis longtemps de se poser dans la chambre de Nick -impossible d'apercevoir le moindre centimètre carré de mur entre les affiches des joueurs d'Arsenal, des groupes de heavy métal et de blondes à la poitrine anormalement plantureuse. Alexis et lui se partageaient le salon où, en une vingtaine d'années, ils avaient dû regarder la télé dans la pénombre des milliers d'heures durant. La cuisine, en revanche, était à tout le monde. La table ronde en pin - le seul meuble que Sophia et Marcus avaient acheté ensemble, dans les années soixante-dix - en constituait le point de mire, l'endroit où ils se réunissaient pour discuter, jouer, manger et, malgré les débats animés et disputes qui s'y déchaînaient souvent, resserrer les liens familiaux.
— Bonjour, dit Sophia en saluant le reflet de sa fille dans le miroir.
Elle coiffait ses cheveux courts tout en farfouillant dans une petite boîte à bijoux.
— Je suis presque prête, ajouta-t-elle avant de mettre des boucles d'oreilles corail assorties à sa blouse.
Alexis n'en saurait jamais rien, mais tandis qu'elle se préparait pour ce rituel familial, Sophia avait une boule à l'estomac. Elle se rappelait toutes les soirées précédant le départ de sa fille pour l'université où elle avait feint la gaieté alors qu'elle éprouvait en réalité l'angoisse de la séparation imminente. Le talent de Sophia pour dissimuler ses émotions semblait croître proportionnellement à la violence des sentiments qu'elle refoulait. En observant le reflet d'Alexis à côté du sien, elle fut traversée par une onde de choc. Sa fille n'avait plus le visage d'adolescente qu'elle voyait quand elle songeait à elle ; elle était devenue une adulte, et son regard interrogateur répondait au sien.
— Bonjour, maman, souffla Alexis. À quelle heure rentre papa ?
— Il ne va pas tarder, j'espère. Il sait que tu dois te lever de bonne heure demain et m'a promis de ne pas être en retard.
Alexis prit la photo familière en inspirant profondément. À sa grande surprise, en dépit de ses vingt-cinq ans, elle devait toujours rassembler son courage avant de s'immiscer dans le passé maternel, comme si elle se glissait sous le cordon de sécurité délimitant une scène de crime. Elle avait besoin de connaître l'avis de sa mère. À vingt ans, Sophia était déjà mariée : considérait-elle qu'Alexis commettait une folie en renonçant à la possibilité de vivre jusqu'à la fin de ses jours aux côtés de quelqu'un comme Ed ? Ou pensait-elle au contraire, comme Alexis, que le simple fait de se poser cette question prouvait bien qu'il n'était pas la bonne personne ? En son for intérieur, Alexis répéta les questions qu'elle avait préparées. Comment sa mère avait-elle acquis la certitude, si jeune, que l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser était le « bon » ? Comment avait-elle su qu'elle serait heureuse pour les cinquante, les soixante, voire les soixante-dix années à venir ? À moins qu'elle n'y eût jamais réfléchi en ces termes... Au moment de se libérer enfin de toutes ces interrogations, elle hésita, redoutant soudain de se heurter à un mur. Il y avait une requête, cependant, qu'elle devait impérativement lui faire.
— Est-ce que... commença-t-elle. Ça t'embêterait si j'allais voir l'endroit où tu as grandi ?
À l'exception de son nom de baptême, seuls les yeux sombres d'Alexis trahissaient le sang grec qui coulait dans ses veines ; et ce soir-là, elle y concentra toute son intensité avant de les plonger dans ceux de sa mère.
— Nous terminerons notre voyage par la Crète, je trouverais dommage d'aller aussi loin et de ne pas saisir une telle opportunité.
Sophia n'était pas femme à sourire facilement, ni à montrer ses sentiments. La réticence était une seconde nature chez elle, et sa première réaction fut de chercher une excuse. Quelque chose l'en empêcha, toutefois. C'étaient les mots que Marcus lui répétait souvent : si Alexis resterait toujours leur fille, elle cesserait un jour d'être l'enfant qui se tournait vers sa mère. Même si elle avait du mal à s'y faire, Sophia savait qu'il avait raison, et la jeune femme indépendante qui se tenait devant elle en était d'ailleurs la confirmation. Au lieu de se renfermer, comme à son habitude, quand le passé menaçait de surgir dans la conversation, Sophia répondit avec une ferveur inattendue. Pour la première fois, elle admettait que la curiosité de sa fille au sujet de ses racines n'était pas seulement naturelle, mais peut-être bien légitime.
— Oui... hasarda-t-elle. Il me semble que oui.
Alexis tenta de dissimuler son étonnement, osant à peine respirer, de peur que sa mère ne change d'avis.
— Oui, reprit Sophia d'une voix plus assurée, c'est une bonne occasion. Je te donnerai une lettre pour Fotini Davaras, qui a bien connu ma famille. Elle doit être âgée maintenant, mais elle vit depuis toujours dans le village où je suis née. Elle a même épousé l'aubergiste... Tu auras peut-être droit à un bon repas.
Alexis brûlait d'excitation.
— Merci, maman... Où se trouve ce village, exactement ? Il est loin de La Canée ?
— Il se situe à environ deux heures à l'est d'Héraklion. De La Canée, il te faudra sans doute quatre ou cinq heures... C'est beaucoup pour faire l'aller-retour dans la journée. Ton père sera là d'une minute à l'autre, mais à notre retour du restaurant, j'écrirai le mot pour Fotini et je te montrerai Plaka sur une carte.
Marcus annonça son retour de la bibliothèque universitaire en claquant bruyamment la porte d'entrée. Il posa au milieu du couloir son attaché-case en cuir usé prêt à exploser - des morceaux de papier se faufilaient par le moindre interstice entre deux coutures. L'ours à lunettes et à l'épaisse tignasse argentée, qui devait peser autant que sa femme et sa fille réunies, accueillit cette dernière avec un large sourire en la voyant dévaler l'escalier. Arrivée à la dernière marche, elle s'élança dans ses bras, ainsi qu'elle le faisait depuis ses trois ans.
— Papa ! s'écria-t-elle simplement (ce qui était déjà superflu).
— Ma beauté, dit-il en l'accueillant dans ses bras douillets et en l'étreignant comme seuls les pères dotés de proportions aussi généreuses peuvent le faire.
Peu après, ils rejoignirent la taverne Loukakis, à cinq minutes à pied de la maison. Niché dans une enfilade de bars à vin tape-à-1'œil, de pâtisseries aux prix exorbitants et de restaurants branchés, cet établissement était le seul à résister. Il existait quasiment depuis l'installation des Fielding dans le quartier, qui avaient vu entre-temps une centaine de boutiques ou de restaurants ouvrir et mettre la clé sous la porte. Le propriétaire, Gregorio, les accueillit comme de vieux amis ; les visites des Fielding étaient si régulières qu'il savait, avant même qu'ils ne soient assis, ce qu'ils commanderaient. À leur habitude, ils écoutèrent d'une oreille polie la liste des plats du jour, puis Gregorio les désigna tour à tour en récitant :
— Mezze du jour en entrée, puis moussaka, sti-fado, calamars, une bouteille de retsina et une grande eau gazeuse.
Ils acquiescèrent tous trois avant d'éclater de rire lorsque Gregorio pivota sur ses talons en feignant d'être vexé par le mépris qu'ils manifestaient pour ses innovations culinaires.
Alexis (qui avait pris la moussaka) monopolisa la conversation : tandis qu'elle décrivait l'itinéraire qu'elle et Ed allaient suivre, son père (les calamars) intervenait de temps à autre pour suggérer un détour par un site archéologique.
— Mais, papa, s'exaspéra Alexis, tu sais bien qu'Ed ne s'intéresse pas aux ruines !
— Je sais, je sais, répondit-il avec patience. Il n'empêche, seul un philistin irait en Crète sans voir Cnossos. Ça reviendrait à faire un séjour à Paris sans visiter le Louvre ! Même Ed est capable de le comprendre.
Aucun d'eux n'ignorait qu'Ed était plus que prêt à snober tout ce qui touchait, de près ou de loin, à la culture avec un grand C, et, comme toujours lorsque la conversation tombait sur lui, un léger dédain pointait dans le ton de Marcus. Ce garçon ne lui était pas antipathique, il n'avait d'ailleurs rien à lui reprocher : Ed était exactement le genre de gendre qu'un père était censé espérer pour sa fille. Pourtant, Marcus ne pouvait s'empêcher d'éprouver une légère déception quand il imaginait sa fille faisant sa vie avec ce garçon si influent. Sophia, elle, adorait Ed. Il incarnait tout ce à quoi elle aspirait pour sa fille : la respectabilité, la garantie d'une vie stable, et un arbre généalogique qui le rattachait (même de façon ténue) à l'aristocratie anglaise.
Ce fut une soirée joyeuse. Ils ne s'étaient pas retrouvés tous les trois depuis plusieurs mois, et Alexis avait beaucoup de retard à rattraper ; entre autres, concernant les derniers rebondissements dans la vie amoureuse de Nick. Etudiant en troisième cycle à Manchester, il n'était guère pressé de mûrir, et sa famille s'émerveillait en permanence de la complexité de ses histoires.
Tandis qu'Alexis et son père échangeaient des anecdotes professionnelles, Sophia se surprit à repenser à la première fois qu'ils avaient mis le pied dans la taverne : Gregorio avait empilé des coussins pour permettre à Alexis d'atteindre la table. À l'époque où Nick était né, le restaurant avait investi dans une chaise haute. Ils avaient initié leurs enfants, dès leur plus jeune âge, au goût puissant du tarama et du tzat-ziki, que les serveurs leur présentaient sur des soucoupes. Durant près de vingt ans, ils avaient célébré ici les événements les plus importants de leurs vies, avec, pour bande son, les chants traditionnels grecs diffusés en boucle. Toujours plus frappée par le fait qu'Alexis n'était plus une enfant, Sophia se prit à songer à Plaka et à la lettre qu'elle écrirait bientôt. Pendant de longues années, elle avait correspondu régulièrement avec Fotini et lui avait d'ailleurs, un quart de siècle plus tôt, fait part de l'arrivée de son premier enfant dans les détails ; quelques semaines après, une petite robe brodée était arrivée au courrier, qu'elle avait mise à Alexis pour son baptême. Les deux femmes avaient cessé leur correspondance depuis bien longtemps, mais Sophia était certaine que le mari de Fotini l'aurait prévenue si quelque chose lui était arrivé. Se demandant à quoi Plaka pouvait bien ressembler aujourd'hui, elle chassa de son esprit une image du petit village envahi de pubs bruyants où la bière anglaise coulait à flots ; elle espérait qu'Alexis retrouverait l'endroit tel qu'elle-même l'avait quitté.
Au fil de la soirée, Alexis sentit croître son exaltation à la perspective de fouiller dans l'histoire familiale. En dépit des tensions auxquelles, elle le savait, elle devrait faire face au cours de ces vacances, elle se réjouissait d'avance de sa visite dans le village natal de sa mère. Alexis et Sophia échangèrent un sourire, et Marcus se surprit à se demander si l'époque où il jouait l'entremetteur entre son épouse et sa fille touchait à sa fin. Le cœur réchauffé par cette idée, il profita de la présence des deux femmes qu'il aimait le plus au monde.
Ils terminèrent leur repas, avalèrent, par politesse, la moitié du verre de raki offert par la maison, puis rentrèrent. Alexis passerait la nuit dans son ancienne chambre et elle se réjouissait d'avance de ces quelques heures dans son lit de petite fille avant de se rendre en métro à l'aéroport d'Heathrow. Elle se sentait étonnamment sereine, bien qu'elle n'ait pas réussi à solliciter les conseils de sa mère. La perspective de visiter Plaka, avec la bénédiction de celle-ci, lui semblait bien plus importante. Elle écarta pour un temps ses autres angoisses, qui portaient sur un avenir plus lointain.
De retour du restaurant, Alexis prépara du café à sa mère pendant que celle-ci, installée à la table de la cuisine, rédigeait une lettre à Fotini - elle froissa trois brouillons avant de sceller l'enveloppe et de la pousser sur la table, en direction de sa fille. Absorbée par sa tâche, Sophia avait conservé le silence pendant qu'elle écrivait. Et Alexis avait craint, en parlant, de rompre le charme et de la faire changer d'avis.
Depuis deux semaines et demie à présent, la lettre de Sophia dormait dans la poche intérieure du sac à main d'Alexis, avec son passeport. À sa façon, c'était aussi un passeport, qui lui donnerait accès à l'histoire maternelle. Cette lettre avait voyagé avec elle depuis Athènes, l'accompagnant lors des traversées, parfois agitées, sur les ferries enfumés, jusqu'à Paros, Santo-rin et, maintenant, la Crète. Ils étaient arrivés sur l'île quelques jours plus tôt et avaient trouvé une chambre en bord de mer, à La Canée - tâche aisée à cette période de l'année, l'essentiel des vacanciers ayant déjà déserté.
Il ne leur restait que quelques jours et Ed, qui avait à contrecœur visité Cnossos et le musée archéologique d'Héraklion, comptait bien se prélasser sur la plage, avant d'entreprendre leur long trajet de retour jusqu'au Pirée. Alexis, quant à elle, avait d'autres projets.
— Je vais aller voir une vieille amie de ma mère demain, annonça-t-elle tandis que, installés à la terrasse d'une taverne sur le port, ils attendaient de passer commande. Elle vit de l'autre côté d'Héraklion, cela me prendra la journée.
C'était la première fois qu'elle évoquait son pèlerinage devant Ed et elle craignait sa réaction.
— Super ! lâcha-t-il avant d'ajouter, non sans amertume : J'imagine que tu comptes prendre la voiture.
— Oui, sauf si ça t'embête. C'est à près de deux cent cinquante kilomètres et j'en aurai pour plusieurs jours si j'y vais en bus.
—Je suppose que tu ne me laisses pas vraiment le choix, si ? Et je te préviens, je n'ai aucune envie de t'accompagner.
Ses yeux, tels des saphirs dans son visage bronzé, lancèrent des éclairs avant de disparaître derrière la carte. Il allait bouder toute la soirée, mais Alexis était prête à encaisser sa mauvaise humeur : après tout, elle lui avait asséné la nouvelle sans ménagement. Elle digérait moins bien l'indifférence totale qu'il témoignait à l'égard de son projet, même si c'était du Ed tout craché. Il ne lui demanda même pas comment s'appelait la personne qu'elle allait voir.
Le lendemain matin, peu après le lever du soleil, elle sortit du lit en douce. La lecture des pages consacrées à Plaka dans son guide lui avait permis de faire une découverte inattendue. Au large de la côte de Plaka se trouvait une île que sa mère n'avait pas mentionnée. Le paragraphe qui lui était consacré, bien que succinct pour ne pas dire lapidaire, avait piqué la curiosité d'Alexis.
SPINALONGA : Dominée par une énorme forteresse vénitienne, l'île fut prise par les Turcs au XVIIIe siècle.
La plupart des Turcs quittèrent la Crète lors de la proclamation de son indépendance, en 1898, mais les habitants refusèrent d'abandonner leurs maisons et leurs lucratives activités de contrebande. Ils partirent en 1903, quand l'île devint une colonie de lépreux. En 1941, la Crète fut envahie par les troupes allemandes et occupée jusqu'en 1945 mais, grâce à la présence de lépreux, Spinalonga fut épargnée. Cette colonie fut abandonnée en 1957.
Selon toute apparence, Plaka servait principalement de centre d'approvisionnement pour la colonie de lépreux. Alexis fut d'autant plus intriguée que sa mère ne lui en avait pas touché un mot. Elle espérait avoir le temps de visiter Spinalonga. Installée au volant de sa Fiat 500, elle étala la carte de la Crète sur le siège inoccupé à côté d'elle : pour la première fois, elle remarqua que l'île avait la forme d'un animal alangui allongé sur le dos.
Elle prit la direction de l'est, dépassa Héraklion puis emprunta la route de la côte, qui traversait les stations balnéaires tentaculaires d'Hersonissos et de Malia. De temps à autre, elle repérait un panneau routier marron indiquant un site archéologique, logé étrangement entre deux hôtels modernes. Mais elle ne prêta aucune attention à ces pancartes : aujourd'hui, elle se rendait dans un village qui s'était développé non pas au XXe siècle avant J.-C, mais au XXe siècle après J.-C. et existait toujours.
Après avoir longé sur des kilomètres et des kilomètres des champs d'oliviers et, là où le sol était plus plat, d'énormes plantations de tomates et de vignes, elle finit par quitter la route principale pour entreprendre la dernière étape de son périple jusqu'à Plaka. La chaussée plus étroite la força à ralentir ; elle devait éviter les petits monticules de pierres que la montagne avait recrachées au milieu de la voie, et laisser passer parfois une chèvre qui traversait d'un pas tranquille, en la fixant de ce regard diabolique que lui conféraient ses yeux rapprochés. Au bout d'un moment, la route grimpa et, au sortir d'une épingle à cheveux très serrée, Alexis se gara sur le bas-côté, faisant crisser ses pneus sur les gravillons. À ses pieds, bien plus bas, dans les eaux bleues et éblouissantes du golfe de Mirabello, elle distingua la grande arche d'un port naturel presque circulaire ; à l'endroit où les deux anses de terre semblaient se rejoindre se trouvait un bout de terre pareil à une colline. De loin, on aurait pu la croire rattachée à la Crète, mais, grâce à la carte, Alexis savait que c'était l'île de Spinalonga et qu'il fallait traverser un bras de mer pour la rejoindre. Ecrasée par le paysage alentour, la butte s'élevait néanmoins avec fierté au-dessus des flots ; on distinguait nettement les vestiges de la forteresse vénitienne à une extrémité et, au-delà, un ensemble de lignes - son réseau routier. La fameuse île oubliée... Après avoir été occupée sans interruption durant des millénaires, elle avait été délaissée, moins de cinquante ans auparavant.
Alexis accomplit les derniers kilomètres qui la séparaient de Plaka en roulant lentement, vitres baissées, pour que la brise tiède et l'odeur puissante du thym envahissent la voiture. Il était 14 heures quand elle finit par atteindre la place du village, silencieuse. Elle coupa le moteur, les mains luisantes de sueur à cause du volant en plastique et le bras gauche rougi par le soleil du début d'après-midi. À cette heure de la journée, n'importe quel village de Grèce ressemblait à une ville fantôme. Des chiens jouaient les morts à l'ombre, et quelques rares chats rôdaient à l'affût de restes de nourriture. Aucun autre signe de vie, mais certains indices d'une présence humaine récente dans ces lieux - vélomoteur abandonné contre un arbre, paquet de cigarettes entamé sur un banc et plateau de backgammon installé à côté. Les cigales chantaient à tue-tête ; elles ne cesseraient qu'au crépuscule, lorsque l'atmosphère étouffante finirait par se rafraîchir. Le village n'avait sans doute pas changé d'un iota depuis le départ de la mère d'Alexis, dans les années soixante-dix. Il n'avait pas eu beaucoup de raisons de le faire.
Alexis avait décidé de visiter Spinalonga avant de se mettre en quête de Fotini Davaras. Elle se délectait du sentiment de liberté totale et d'indépendance dont elle jouissait et, une fois qu'elle aurait retrouvé la vieille femme, prendre congé afin d'aller sur l'île pourrait paraître incongru. Alexis avait tout à fait conscience qu'il lui serait impossible de rejoindre La Canée le soir même, mais, comptant avant tout profiter de son après-midi, elle remit à plus tard les questions de logistique - appeler Ed et chercher un endroit où passer la nuit.
Résolue à suivre le guide de voyage à la lettre (« Tentez votre chance au bar de Plaka, petit village de pêche, où, en échange de quelques milliers de drachmes, vous trouverez sans doute un pêcheur prêt à vous conduire à Spinalonga »), Alexis traversa la place avec détermination et écarta l'arc-en-ciel poisseux du rideau de plastique qui fermait l'entrée du bar. Ces lanières crasseuses, dont l'objectif était de garder les mouches dehors et la fraîcheur à l'intérieur, ne réussissaient en réalité qu'à prendre la poussière et plonger l'endroit dans une pénombre permanente. Dans les ténèbres, Alexis repéra vaguement les contours d'une femme attablée ; lorsqu'elle voulut rejoindre à tâtons la silhouette, celle-ci se leva pour se glisser derrière le bar. Alexis avait la gorge toute desséchée par la poussière.
— New, parakalo, dit-elle en hésitant.
D'un pas traînant, la femme longea d'énormes jarres en verre remplies d'olives, ainsi que plusieurs bouteilles entamées d'ouzo, pour sortir du réfrigérateur une eau minérale fraîche. Elle en remplit avec soin un grand verre, et y ajouta une épaisse rondelle de citron à la peau grumeleuse avant de le tendre à Alexis. Puis elle s'essuya les mains avec l'immense tablier à fleurs qui réussissait tout juste à faire le tour de son imposante taille.
— Anglaise ? demanda-t-elle.
Alexis acquiesça ; c'était une demi-vérité après tout. Elle résuma sa requête suivante d'un seul mot :
— Spinalonga ?
Pivotant sur ses talons, la femme s'engouffra dans une petite ouverture derrière le bar. Alexis entendit les cris étouffés (« Gerasimo ! Gerasimo ! »), suivis de près par des bruits de pas dans l'escalier en bois. Un homme âgé apparut, les yeux bouffis : il avait été tiré de sa sieste. Sa femme lui baragouina quelque chose ; le seul mot qu'Alexis identifia, « drachma », revint à plusieurs reprises. À l'évidence, celle-ci expliquait, sans mâcher ses mots, qu'il y avait de l'argent à se faire. Lui restait planté là, enregistrant le torrent d'instructions sans broncher.
La femme finit par griffonner sur le carnet qui devait lui servir à prendre les commandes un nombre et un schéma. Si Alexis avait parlé le grec couramment, cela n'aurait pas été plus clair. À grand renfort de gestes circulaires et de traits sur le papier, la femme lui fit comprendre que, pour un trajet aller-retour jusqu'à Spinalonga, avec un arrêt sur place de deux heures, il lui en coûterait 20 000 drachmes, soit environ 35 livres. Ce petit pèlerinage finirait par lui revenir très cher, mais Alexis n'était pas en position de négocier. Et elle avait, plus que jamais, envie de visiter l'île. Elle acquiesça et sourit au batelier, qui lui rendit son signe en dodelinant de la tête. Ce fut à cet instant qu'elle réalisa que son silence cachait autre chose. Gerasimo n'aurait pas pu parler, même s'il l'avait voulu : il était muet.
Le ponton auquel était amarrée la vieille barque décrépie se trouvait juste à côté. Ils marchèrent en silence, dépassant les chiens endormis et les maisons aux volets clos. Pas un frémissement. Les seuls sons provenaient des cigales et du doux frottement de leurs semelles en caoutchouc sur le sol. Même la mer plate se taisait.
Voilà comment Alexis avait atterri dans ce bateau, sur lequel elle parcourut cinq cents mètres en compagnie d'un homme avec lequel elle n'échangeait qu'un sourire occasionnel. Le visage buriné, comme tous les pêcheurs crétois après des dizaines d'années passées sur des mers tumultueuses à affronter les éléments la nuit et à réparer les filets sous un soleil cuisant le jour, il devait avoir à peine plus de soixante ans. Pourtant, si les rides pouvaient, comme les cernes d'un chêne, servir à mesurer l'âge d'un homme, un calcul grossier le situerait plutôt du côté des octogénaires. Ses traits ne révélaient aucun sentiment : ni douleur, ni malheur, ni joie non plus. Son masque paisible avait la résignation du grand âge tout en reflétant ce qu'il avait vécu au cours du siècle précédent. Si, après les Vénitiens, les Turcs et les Allemands - cet homme avait dû connaître l'Occupation -, les touristes apparaissaient comme les nouveaux envahisseurs, peu d'entre eux se donnaient la peine d'apprendre le moindre mot de grec ; Alexis se reprochait d'ailleurs de ne pas avoir demandé à sa mère de lui enseigner le vocabulaire de base (Sophia parlait sans doute encore couramment sa langue maternelle, bien que sa fille ne l'eût jamais entendue). Tout ce qu'Alexis put offrir au batelier fut un poli efharisto, « merci », quand il l'aida à monter à bord, auquel il répondit en effleurant le bord de son chapeau en paille cabossé.
À l'approche de Spinalonga, Alexis sortit son appareil photo et la bouteille d'eau en plastique que la tenancière du café l'avait forcée à emporter, en lui conseillant de boire beaucoup. Lorsque la barque heurta l'appontement, le vieux Gerasimo lui tendit la main et elle monta sur la planche qui servait de siège pour rejoindre la plate-forme déserte. Elle remarqua alors que le moteur tournait toujours. Le vieux n'avait de toute évidence pas l'intention de rester et réussit à se faire comprendre : il reviendrait deux heures plus tard. Elle le regarda manœuvrer la barque pour repartir en direction de Plaka.
En songeant qu'elle était seule sur Spinalonga, Alexis se sentit gagnée par une vague de peur. Et si Gerasimo l'oubliait ? Combien de temps s'écoulerait-il avant qu'Ed ne se lance à sa recherche ? Serait-elle capable de parcourir à la nage le bras de mer qui la séparait de la Crète ? Elle n'avait jamais connu un tel isolement, se retrouvant rarement à plus de quelques mètres d'un autre être humain et, à l'exception des moments où elle dormait, n'étant jamais privée de tout contact extérieur pendant plus d'une heure. Son absence d'indépendance lui apparut soudain comme une chaîne, et elle se secoua. Elle allait profiter de ce moment, ces quelques heures d'isolement représentaient à peine une poussière à l'aune de la vie solitaire à laquelle les anciens habitants de Spinalonga avaient dû être contraints.
Les épaisses murailles de la forteresse vénitienne la dominaient ; comment franchirait-elle cette bâtisse en apparence imprenable ? Elle remarqua alors, au centre d'un pan de mur arrondi, une petite ouverture, dans laquelle elle devait tout juste tenir debout.
Celle-ci faisait une minuscule entaille sombre dans la pierre ocre ; en s'approchant, Alexis vit que c'était l'entrée d'un long tunnel incurvé - dissimulant ainsi ce qui se trouvait à l'autre extrémité. Coincée entre la mer, dans son dos, et les hauts murs, devant elle, Alexis n'avait d'autre issue que ce passage oppressant. Il s'étendait sur plusieurs mètres et, lorsqu'elle quitta la pénombre pour la lumière éblouissante du début d'après-midi, elle constata que l'échelle des lieux avait changé du tout au tout. Elle se figea de stupéfaction.
Elle se tenait au pied d'une longue rue bordée de part et d'autre de petites maisons à deux niveaux. S'il fut un temps où elles avaient dû ressembler à celles de n'importe quel village crétois, aujourd'hui elles étaient dans un état d'abandon avancé. Les fenêtres aux gonds cassés pendaient, les volets oscillaient en grinçant sous l'effet de la légère brise marine. Alexis s'avança d'un pas hésitant dans la rue poussiéreuse, le regard attiré par le moindre détail : l'église, sur sa droite, à la lourde porte sculptée, le bâtiment qui, à en juger par la taille des châssis de ses fenêtres, accueillait un magasin, et celui, un peu plus grand et à l'écart, doté d'un balcon en bois, d'une porte cintrée et des vestiges d'un jardin clos. Un silence inquiétant régnait sur l'ensemble.
Des touffes de fleurs sauvages aux couleurs vives envahissaient le rez-de-chaussée des maisons, tandis qu'à l'étage des giroflées apparaissaient à travers les fissures. Beaucoup de numéros étaient encore lisibles et, en observant les nombres qui s'effaçaient - 11, 18, 29 -, elle songea que derrière chacune de ces portes des vies avaient été vécues. Elle poursuivit sa balade dans cet endroit ensorcelant, comme une somnambule. Ce n'était pas un rêve et, pourtant, ce décor semblait irréel.
Alexis dépassa ce qui avait dû être un café, puis une plus grande bâtisse et un bâtiment contenant plusieurs bassins en béton - sans doute un lavoir. À côté se trouvaient les ruines d'un vilain immeuble fonctionnel à deux étages ponctué de rambardes en fer forgé rectilignes. La taille de la construction offrait un contraste étrange avec les autres maisons, et Alexis eut du mal à concevoir que celui qui avait présidé à son édification, moins de soixante-dix ans plus tôt, avait pu y voir le comble de la modernité. À présent, l'air s'engouffrait par ses larges fenêtres béantes et des fils électriques pendaient des plafonds comme des amas de spaghettis agglutinés. C'était sans doute l'endroit le plus triste de tous.
À la sortie du village, elle déboucha sur un sentier, envahi par la végétation, qui menait à un endroit privé de toute trace de civilisation. Ce promontoire naturel tombait à pic dans la mer, une centaine de mètres plus bas. Arrivée là, elle s'autorisa à imaginer le malheur des lépreux et se demanda si, poussés par le désespoir, il leur était arrivé de venir ici et d'envisager d'y mettre un terme. Son regard se perdit à l'horizon. Jusqu'à maintenant, elle avait été si absorbée par l'atmosphère des lieux que toute réflexion la concernant avait disparu. Le fait d'être la seule personne sur cet îlot lui permit de prendre conscience d'une chose : la solitude ne signifiait pas nécessairement être seul. On pouvait se sentir seul au milieu d'une foule. Cette pensée lui donna la force qui lui manquait pour faire le choix qui s'imposait : à son retour, elle entamerait la prochaine étape de sa vie, seule.
Elle rebroussa chemin à travers le village muet et se reposa un temps sur un pas de porte en pierre, où elle se désaltéra avec l'eau qu'elle avait apportée. Il n'y avait pas un seul mouvement, à l'exception d'un lézard ou deux, détalant dans les feuilles sèches qui tapissaient le sol des maisons délabrées. À travers une fissure dans le mur devant elle, elle aperçut la mer et, au-delà, la Crète. Jour après jour, les lépreux devaient observer Plaka, capables de distinguer chaque maison, chaque bateau, peut-être même les villageois vaquant à leurs activités quotidiennes. Alexis commençait seulement à mesurer combien cette proximité avait dû les tourmenter.
Quelles histoires pouvaient raconter les murs de cette ville ? Ils avaient sans doute vu de grandes souffrances. La vie avait distribué de mauvaises cartes aux lépreux prisonniers de ce rocher. Habituée à faire parler les pierres, Alexis comprenait devant ces ruines que les habitants de cet endroit avaient connu bien d'autres émotions que le malheur et le désespoir. Si leur existence s'était résumée à une vie de misère, pourquoi y aurait-il eu des cafés ? Et un bâtiment qui accueillait selon toute vraisemblance une mairie ? Derrière la mélancolie, elle percevait des signes de normalité. Cette minuscule île avait accueilli une communauté : elle n'avait pas seulement été un lieu où venir attendre la mort.
Le temps avait filé. En regardant sa montre, elle constata qu'il était déjà 17 heures. Le soleil restait si haut dans le ciel et dardait des rayons si brûlants qu'elle avait perdu toute notion du temps. Elle bondit sur ses pieds, le cœur battant la chamade. Si elle avait apprécié le silence et la paix de Spinalonga, elle n'avait aucune envie que Gerasimo reparte sans elle. Elle s'engouffra dans le long tunnel noir pour rejoindre l'appontement de l'autre côté. Le vieux pêcheur l'attendait dans sa barque et, à l'instant où il l'aperçut, il remit le contact. Il ne comptait pas s'attarder plus que nécessaire.
Le trajet de retour jusqu'à Plaka ne dura pas plus de quelques minutes. Dès qu'elle repéra le bar et la voiture de location garée juste en face, Alexis se sentit soulagée. À cette heure de la journée, le village avait repris vie. Des femmes discutaient devant les maisons et, sur la placette ombragée à côté du café, des hommes s'étaient regroupés autour d'un jeu de cartes sous le nuage formé par l'épaisse fumée de leurs cigarettes brunes. Gerasimo et elle rejoignirent le bar dans un silence désormais familier ; ils furent accueillis par la femme qui devait être l'épouse du pêcheur. Alexis compta la somme et lui tendit les billets fatigués.
— Vous voulez boisson ? lui proposa la tenancière dans un mauvais anglais.
Alexis réalisa alors qu'elle avait non seulement besoin de se désaltérer mais aussi de se nourrir. Elle n'avait rien avalé de la journée et la chaleur, associée au trajet en mer, l'avait affaiblie. Se souvenant que l'amie de sa mère tenait une taverne, elle farfouilla dans son sac à dos à la recherche de l'enveloppe froissée qui contenait la lettre de Sophia. Elle montra l'adresse à la femme, qui la reconnut aussitôt et prit Alexis par le bras pour l'entraîner vers le bord de mer. À environ cinquante mètres, au bout de la route, se trouvait une taverne qui débordait sur une petite jetée. Cette oasis, avec ses chaises peintes en bleu et ses nappes à carreaux bleus et blancs, attira aussitôt la jeune femme et, dès qu'elle fut accueillie par le propriétaire, Stephanos, qui avait donné son nom au restaurant, elle sut qu'elle serait heureuse de s'y installer et d'admirer le coucher de soleil.
Stephanos possédait un point commun avec tous les autres taverniers qu'Alexis avait rencontrés : une épaisse moustache bien taillée. En revanche, contrairement à la majeure partie d'entre eux, il ne semblait pas manger autant de plats qu'il en servait. Etant la seule cliente - il était bien trop tôt pour les autochtones -, Alexis choisit une table juste au bord de l'eau.
— Fotini Davaras est-elle là aujourd'hui ? se risqua-t-elle à demander. Ma mère, qui a grandi ici, l'a connue, et j'ai une lettre pour elle.
Stephanos, qui parlait bien mieux anglais que le couple du bar, lui répondit que oui, sa femme était là, et qu'elle viendrait la trouver dès qu'elle aurait fini en cuisine. Il proposa ensuite de lui servir une sélection de spécialités locales afin qu'elle n'ait pas à s'embêter avec la carte. Une fois munie d'un verre de retsina frais et d'une corbeille de pain de campagne pour apaiser sa faim en attendant le dîner, Alexis se sentit balayée par une vague de bien-être. Cette journée de solitude lui avait procuré beaucoup de plaisir. Son regard se posa sur Spinalonga. Les lépreux y avaient vécu en détention, eux, mais cette vie leur avait-elle apporté quelque chose malgré tout ?
Stephanos revint les bras chargés de minuscules assiettes blanches, chacune contenant une petite portion de nourriture savoureuse et fraîche - crevettes, fleurs de courgettes farcies, tzatziki et petits friands au fromage. Alexis n'était pas sûre d'avoir jamais eu aussi faim de sa vie ni de s'être vu offrir des mets aussi appétissants.
Au moment de la servir, Stephanos s'était rendu compte qu'elle observait l'île. Il était intrigué par cette jeune Anglaise, qui avait passé l'après-midi sur Spina-longa, seule, comme Andriana, la femme de Gerasimo, le lui avait expliqué. Au cœur de l'été, plusieurs bateaux bourrés de touristes faisaient l'aller-retour quotidiennement, mais la plupart d'entre eux y restaient une demi-heure maximum avant de rejoindre en car l'une des énormes stations balnéaires plus bas sur la côte. Poussés par une curiosité morbide, ils en revenaient souvent déçus, à en juger par les bribes de conversation que Stephanos avait pu surprendre quand ces touristes prenaient le temps de manger à Plaka. Ils s'imaginaient sans doute voir autre chose que quelques maisons en ruine et une église aux issues barricadées avec des planches. Qu'espéraient-ils ? Voilà ce que Stephanos était toujours tenté de leur demander. Des cadavres ? Des béquilles oubliées ? Leur indifférence ne manquait jamais d'éveiller son irritation. Cette jeune femme n'était pas comme eux.
— Qu'avez-vous pensé de l'île ? lui demanda-t-il.
— J'ai été surprise. Je m'attendais à un endroit très mélancolique, ce qu'il est, mais j'ai senti autre chose. À l'évidence, les gens qui y ont vécu ne se sont pas contentés de passer leurs journées à s'apitoyer sur leur sort. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue.
Sa réaction était pour le moins inhabituelle. Elle semblait heureuse de faire la conversation, et Stephanos, toujours désireux de pratiquer son anglais, ne comptait pas la décourager.
— Je ne sais pas vraiment d'où me vient cette impression, reprit-elle. Je me trompe ?
— Puis-je m'asseoir ?
Sans attendre de réponse, Stephanos tira une chaise, en raclant les pieds sur les planches. Il sentit d'instinct que cette jeune femme était réceptive à la magie de Spinalonga.
— Ma femme avait une amie là-bas, autrefois. Elle est l'une des rares ici à avoir encore des liens avec l'île. Tous les autres sont partis le plus loin possible après la découverte du remède. À l'exception du vieux Gerasimo, bien sûr.
— Gerasimo... était un lépreux ? s'étonna Alexis. Cela expliquait sa hâte à quitter l'île. Intriguée par
cette information, elle ajouta :
— Et votre femme, s'est-elle déjà rendue sur l'île ?
— De nombreuses fois. Elle en connaît plus sur le sujet que n'importe qui.
Des clients commençaient à arriver, Stephanos se leva de sa chaise en osier pour les installer et leur remettre des cartes. Maintenant que le soleil avait basculé de l'autre côté de l'horizon, le ciel avait pris une teinte rose foncé. Des hirondelles descendaient en piqué pour attraper des insectes dans l'air rafraîchi. Une éternité sembla s'écouler. Alexis avait mangé tout ce que Stephanos avait placé devant elle, mais elle avait encore faim.
Alors qu'elle envisageait de se rendre dans la cuisine pour choisir la suite, coutume répandue en Crète, son plat principal arriva.
— La pêche du jour, lui annonça la serveuse en déposant une assiette ovale. Du barbouni... ou rouget, je crois. J'espère que vous aimerez la façon dont je l'ai préparé, il est simplement grillé avec des herbes fraîches et un filet d'huile d'olive.
Alexis en resta bouche bée. Pas seulement à cause du plat magnifique devant elle, ni de l'anglais fluide de la femme, qu'elle parlait presque sans accent. Non, ce qui la surprit fut la beauté de celle-ci. Alexis s'était toujours demandé quel genre de visage avait pu provoquer le départ de mille navires. Sans aucun doute un comme celui de cette femme.
— Merci, finit-elle par répondre. Ça a l'air délicieux.
L'apparition se prépara à tourner les talons, puis se ravisa.
— Mon mari m'a dit que vous vouliez me voir. Alexis leva des yeux étonnés vers elle. Sa mère lui
avait parlé d'une femme de soixante-dix ans, mais celle qui lui faisait face était élancée, à peine ridée, et ses cheveux, relevés en un chignon sur le sommet du crâne, étaient encore de la couleur des châtaignes mûres. Ce n'était pas la vieille dame qu'Alexis s'attendait à rencontrer.
— Vous n'êtes pas... Fotini Davaras ? demandât-elle d'une voix hésitante en se levant.
— Si, elle-même, affirma-t-elle avec douceur.
—J'ai une lettre pour vous. De la part de ma mère, Sophia Fielding.
Le visage de Fotini s'éclaira.
— Vous êtes la fille de Sophia ! Mon Dieu, quelle merveilleuse surprise ! Comment va-t-elle ? Dites-moi, comment va-t-elle ?
Fotini accepta avec enthousiasme la lettre qu'Alexis lui tendait et la pressa contre sa poitrine comme s'il s'agissait de Sophia en personne.
—Je suis si heureuse ! Je n'ai pas eu de nouvelles depuis la mort de sa tante, il y a quelques années. Avant, elle m'écrivait tous les mois, puis elle a cessé, brusquement. Je me suis fait un sang d'encre quand mes dernières lettres sont restées sans réponse.
Alexis ignorait que sa mère entretenait une correspondance aussi régulière avec la Crète et s'étonna de n'avoir jamais vu, au cours de toutes ces années, une seule lettre portant un cachet de la poste grecque - elle s'en serait souvenu, ayant toujours pris le courrier sur le paillasson. Sa mère avait dû déployer des trésors d'ingéniosité pour dissimuler cet échange.
À présent, Fotini avait saisi Alexis par les épaules et la dé
Extraits

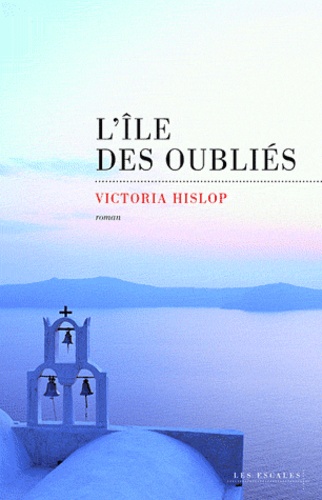


























Commenter ce livre