Les écrivains dans la Deuxième Guerre mondiale
Extraits
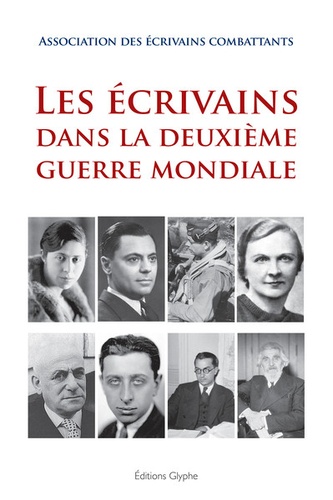
Histoire de France
Les écrivains dans la Deuxième Guerre mondiale
01/2021
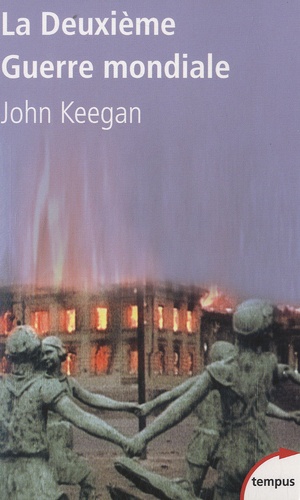
Histoire de France
La Deuxième Guerre mondiale
01/2010
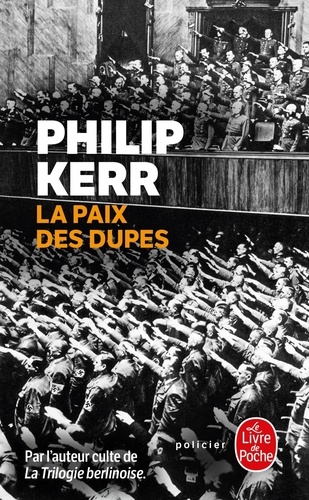
Policiers
La paix des dupes. Un roman dans la Deuxième Guerre mondiale
10/2012
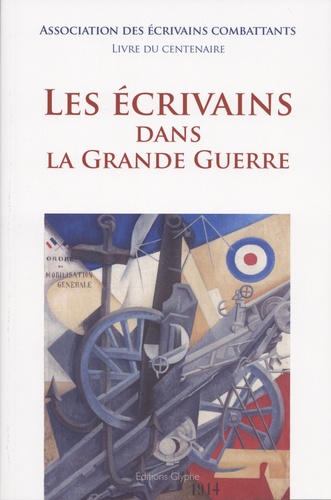
Critique littéraire
Les écrivains dans la Grande Guerre
11/2018
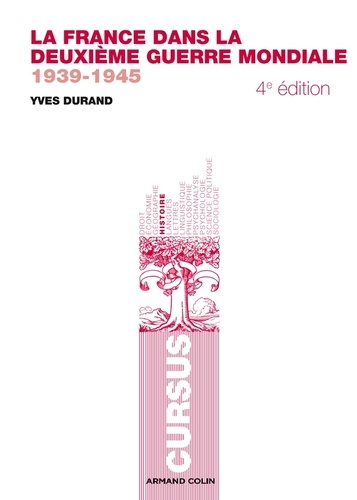
Histoire de France
La France dans la deuxième guerre mondiale 1939-1945. 4e édition
06/2011
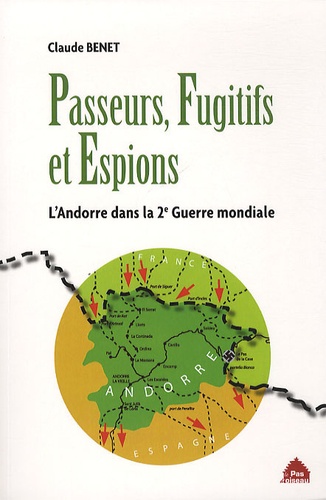
Histoire de France
Passeurs, fugitifs et espions. L'Andorre dans la Deuxième Guerre mondiale
08/2010
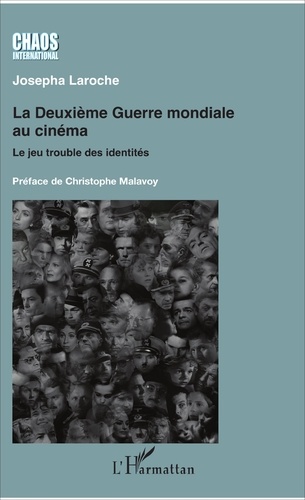
Cinéma
La Deuxième Guerre mondiale au cinéma. Le jeu trouble des identités
07/2017
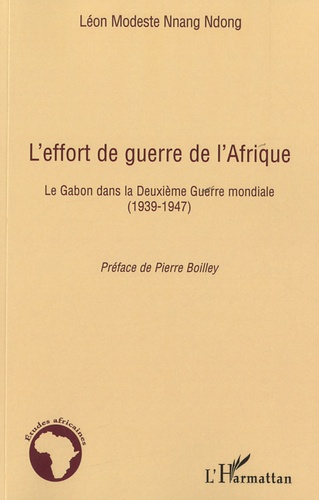
Histoire internationale
L'effort de guerre de l'Afrique. Le Gabon dans la Deuxième Guerre mondiale (1939-1947)
05/2011
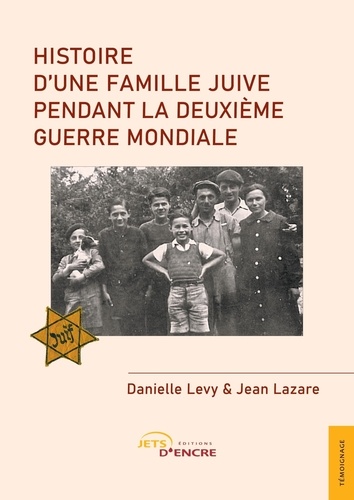
Littérature française
Histoire d'une famille juive pendant la Deuxième Guerre mondiale
09/2023
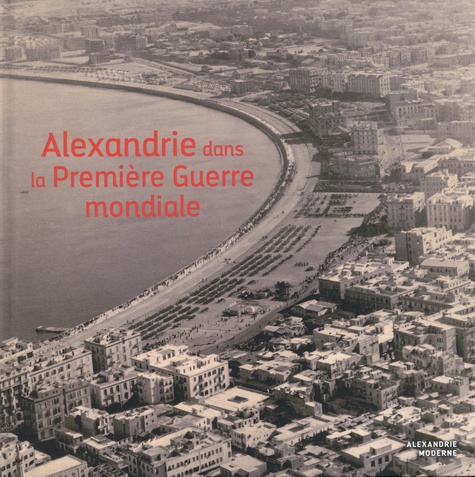
Histoire internationale
Alexandrie dans la Première Guerre mondiale
11/2018
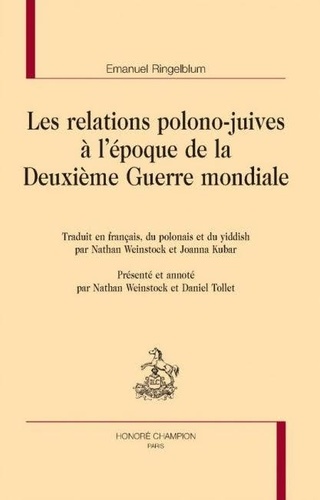
Europe centrale et orientale
Les relations polono–juives à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale
11/2021
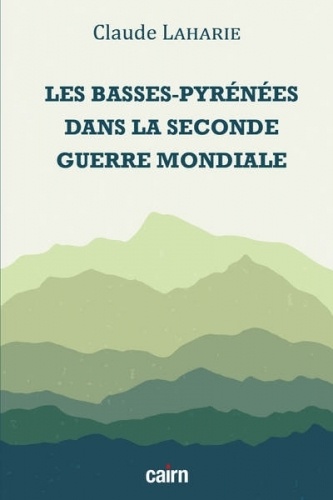
Histoire régionale
Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale
11/2021
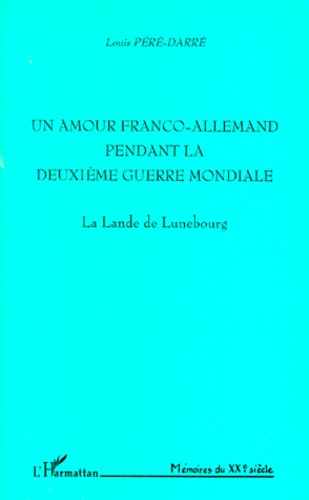
Histoire de France
UN AMOUR FRANCO-ALLEMAND PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE. La Lande
04/1998
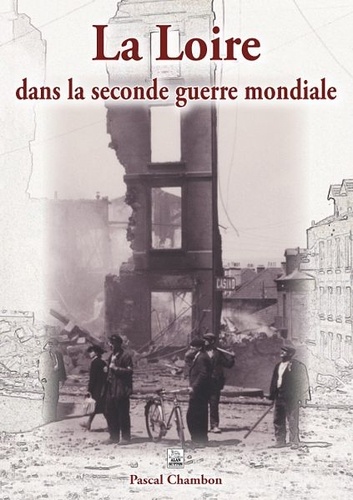
Sciences historiques
La Loire dans la Seconde Guerre mondiale
11/2010
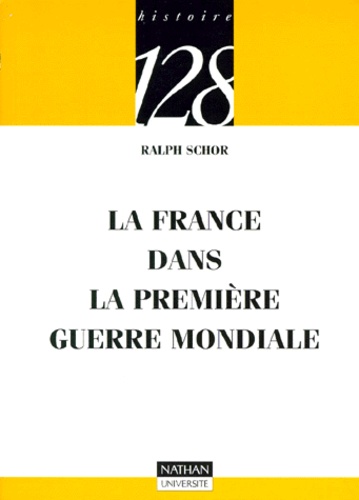
Histoire de France
La France dans la Première guerre mondiale
05/1999
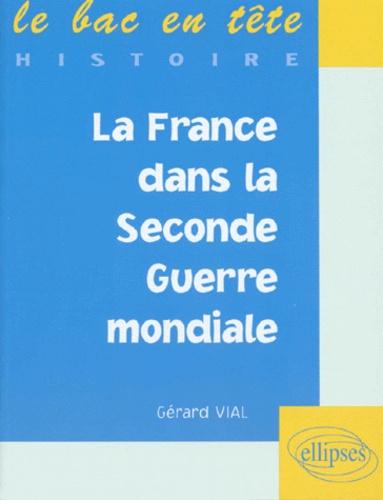
Lycée parascolaire
La France dans la Seconde guerre mondiale
06/1998
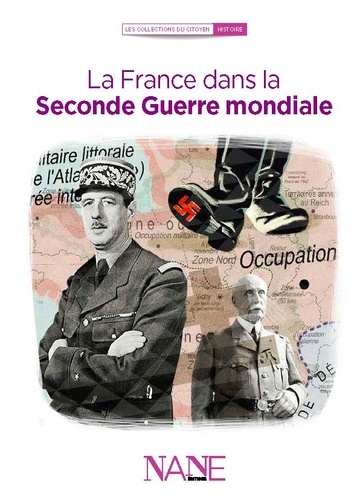
De la Révolution à nos jours
La France dans la Seconde Guerre mondiale
07/2021
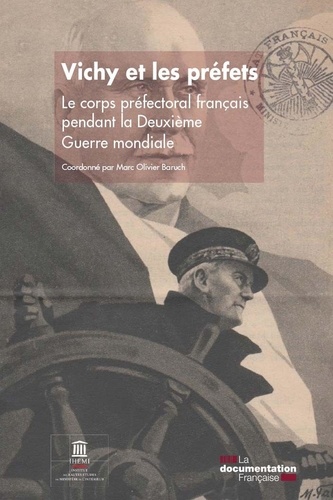
Vichy
Vichy et les préfets. Le corps préfectoral français pendant la deuxième Guerre mondiale
08/2021
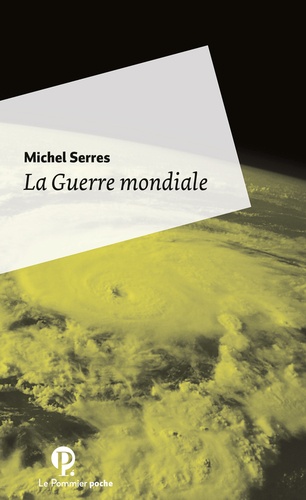
Philosophie
La Guerre mondiale
03/2011
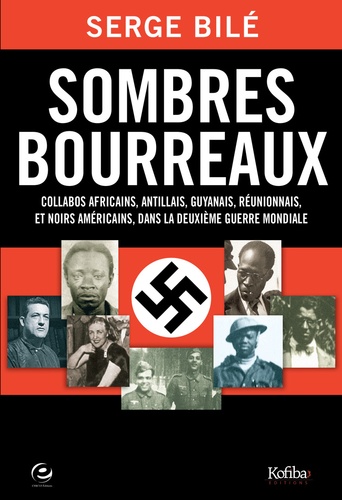
Histoire de France
Sombres bourreaux. Collabos africains, antillais, guyanais, réunionnais et noirs américains dans la Deuxième Guerre mondiale
11/2019
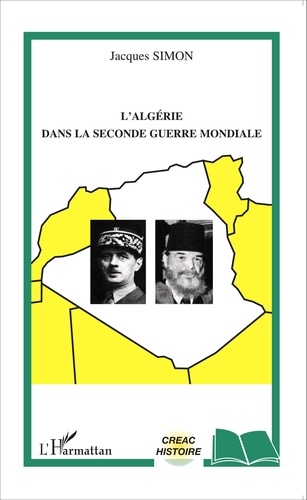
Histoire internationale
L'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale
11/2015
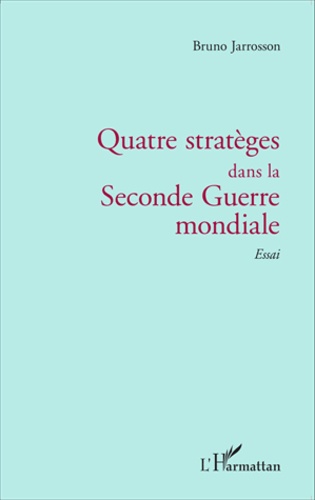
Histoire de France
Quatre stratèges dans la Seconde Guerre mondiale
03/2015
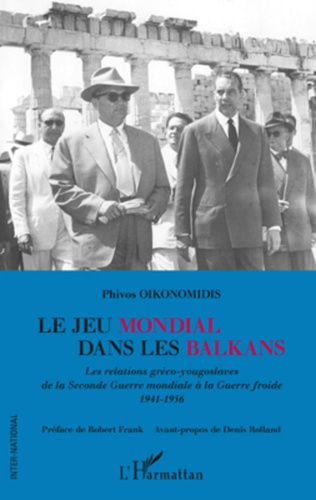
Histoire internationale
Le jeu mondial dans les Balkans. Les relations gréco-yougoslaves de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre froide (1941-1956)
05/2011
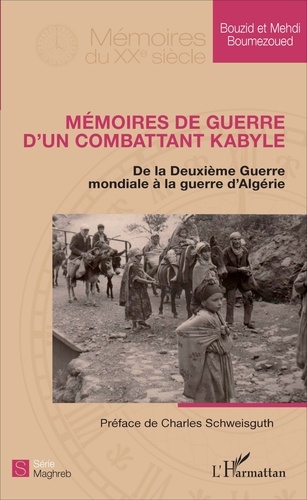
Histoire internationale
Mémoires de guerre d'un combattant kabyle. De la Deuxième Guerre mondiale à la guerre d'Algérie
12/2016

BD tout public
La Seconde Guerre mondiale dans la bande dessinée
07/2015
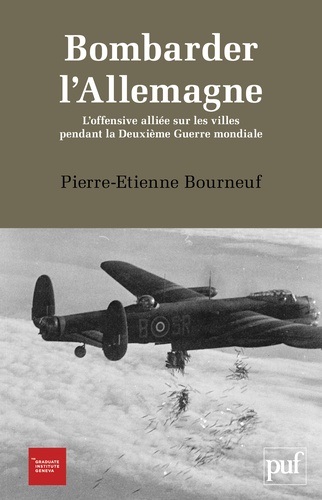
Histoire internationale
Bombarder l'Allemagne. L'offensive alliée sur les villes pendant la Deuxième Guerre mondiale
02/2014
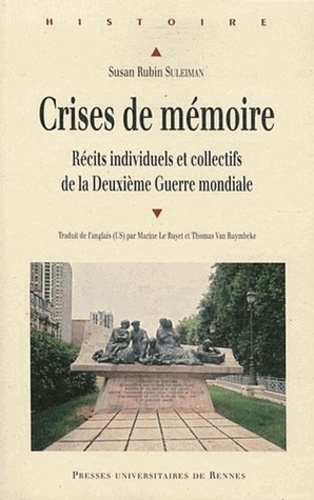
Histoire de France
Crises de mémoire. Récits individuels et collectifs de la Deuxième Guerre mondiale
04/2012
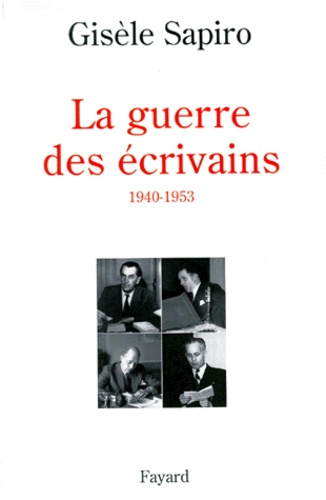
Critique littéraire
La Guerre des écrivains. 1940-1953
09/1999
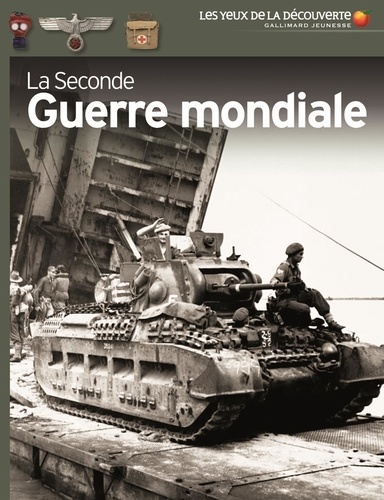
Documentaires jeunesse
La Seconde Guerre mondiale
03/2013
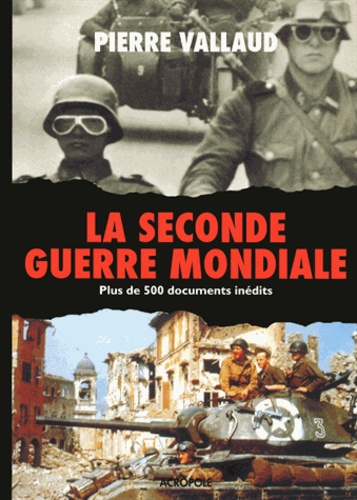
Histoire de France
La Seconde Guerre mondiale
10/2010
