La République romaine et son empire. 509-31 av. J.-C.
Extraits
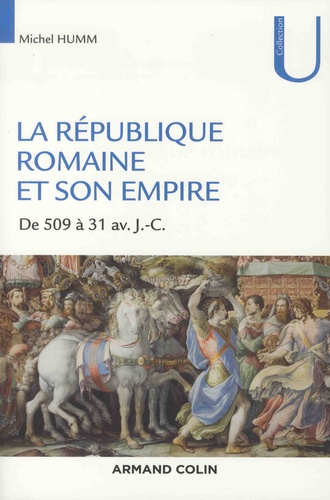
Histoire ancienne
La République romaine et son empire. 509-31 av. J.-C.
03/2018
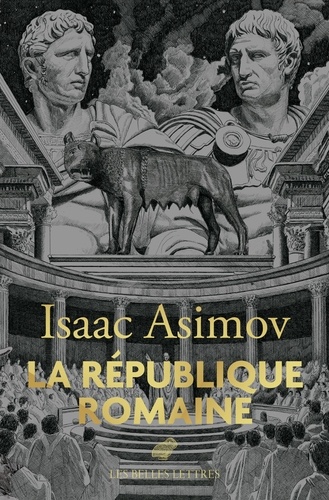
République
La République romaine
10/2023
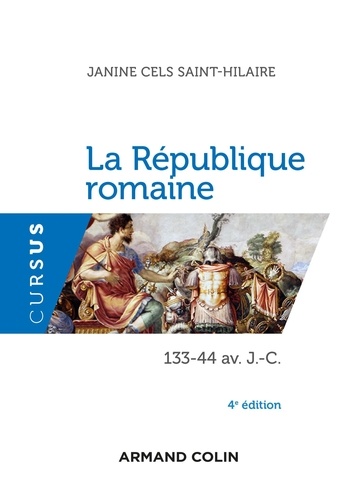
Histoire ancienne
La république romaine. 133-44 av. J.-C., 4e édition
05/2020
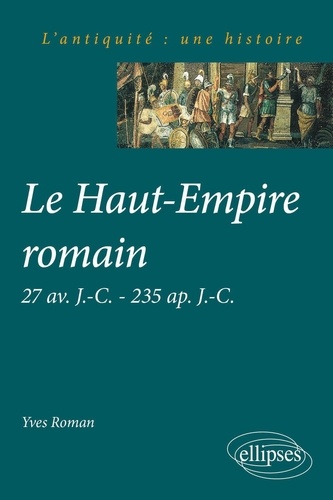
Histoire ancienne
LE HAUT-EMPIRE ROMAIN. 27 av J-C, 235 ap J-C
09/1998
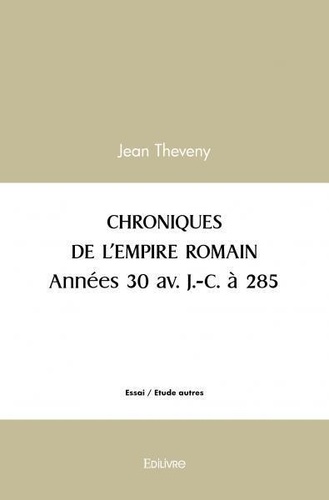
Littérature française
Chroniques de l’empire romain années 30 av. j. c. à 285
10/2022
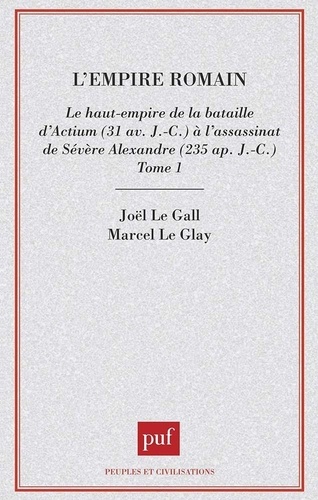
Histoire ancienne
L'EMPIRE ROMAIN. Tome 1, le Haut-Empire de la bataille d'Actium (31 av J-C) à l'assassinat de Sévère Alexandre (235 ap J-C)
10/1992
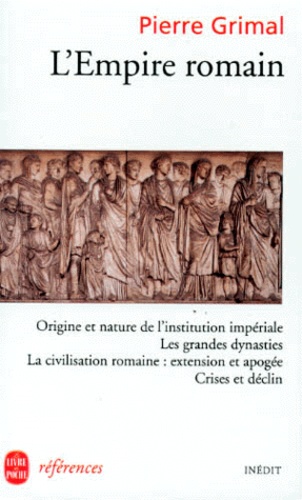
Histoire ancienne
L'Empire romain
08/2007
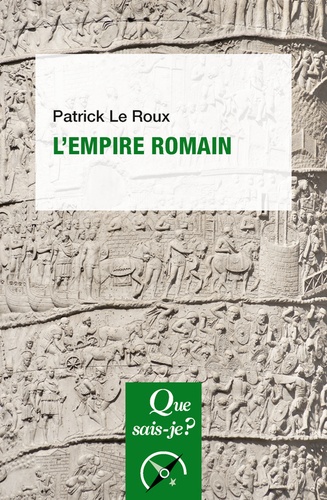
Que-sais-je ?
L'Empire romain
02/2022
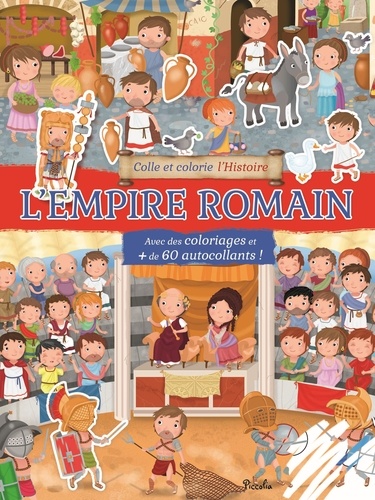
Coloriage, gommettes et autoco
L'Empire Romain
06/2023
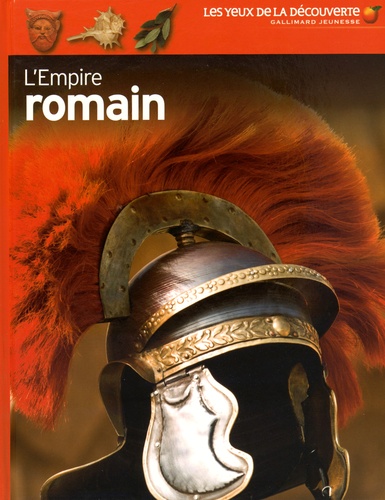
Documentaires jeunesse
L'empire romain
09/2015
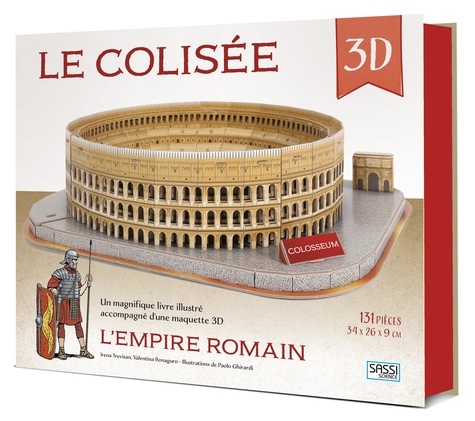
Documentaires jeunesse
Le Colisée 3D. L'Empire romain
09/2019
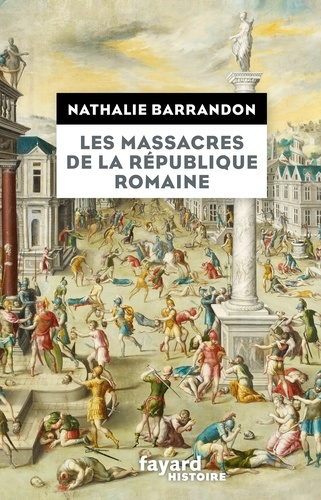
Histoire ancienne
Les massacres de la République romaine
04/2018
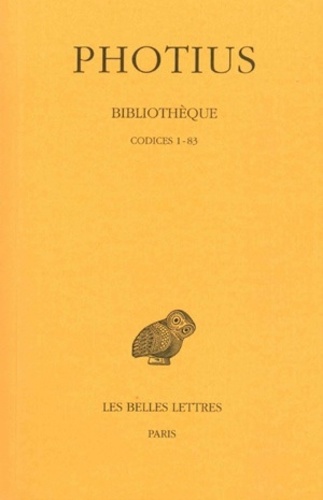
Critique littéraire
Bibliothèque. Tome 1, Codices 1-83, Edition bilingue français-grec ancien
01/1959
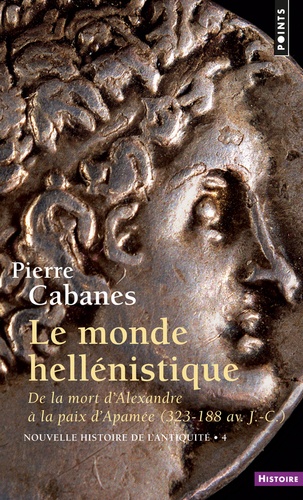
Histoire ancienne
Nouvelle histoire de l'Antiquité. Tome 4, Le monde hellénistique, de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée
09/1997
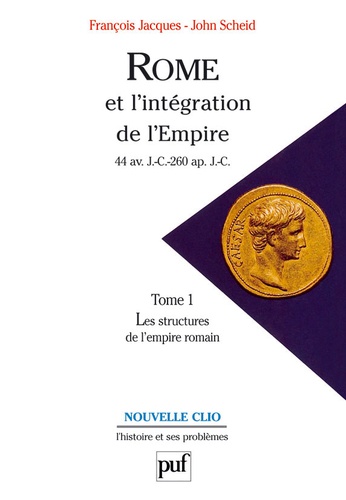
Histoire ancienne
Rome et l'intégration de l'Empire. 44 av. J.-C.- 260 ap. J.-C., Tome 1, Les structures de l'empire romain
05/2010

Histoire ancienne
Histoire Romaine. Livres 36 et 37
11/2014
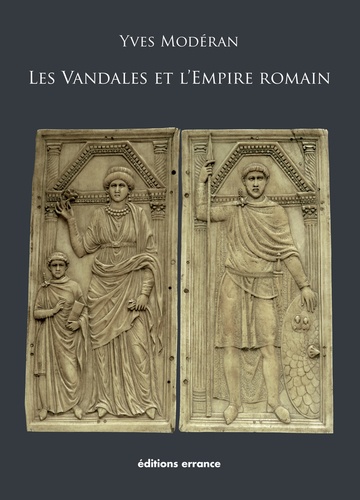
Histoire ancienne
Les Vandales et l'Empire romain
09/2014
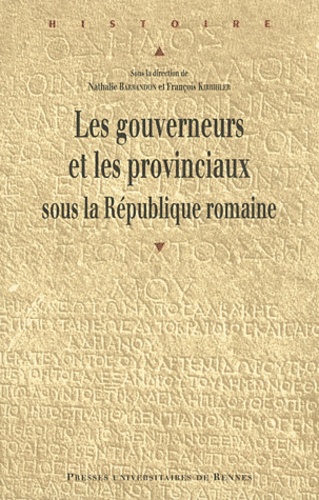
Histoire ancienne
Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine
09/2011
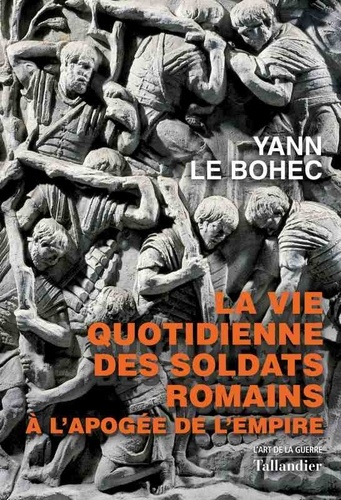
Histoire ancienne
La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'empire. 31 avant J.-C. - 235 après J.-C.
Yann Le Bohec nous plonge dans la vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'empire, de 31 av. J.-C. à 235 ap. J.-C. : qui étaient les hommes recrutés pour faire la guerre, comment se déroulait une journée au camp, comment les soldats conciliaient leur religion et leur métier, leur vie familiale et leurs loisirs, quelles étaient les punitions, corvées, récompenses...
A partir des sources disponibles (les textes des grands auteurs, l'épigraphie, la papyrologie et la numismatique), et des nombreuses et récentes découvertes des archéologues, notamment les ostraka, les papyrus et les tablettes, l'auteur nous permet de comprendre pourquoi l'armée romaine du Principat a atteint un niveau d'excellence sans exemple dans l'histoire. Avec ce nouvel ouvrage, Yann Le Bohec, le grand spécialiste de l'armée romaine, apporte une contribution précieuse et originale à l'histoire militaire.
#CultureAntique
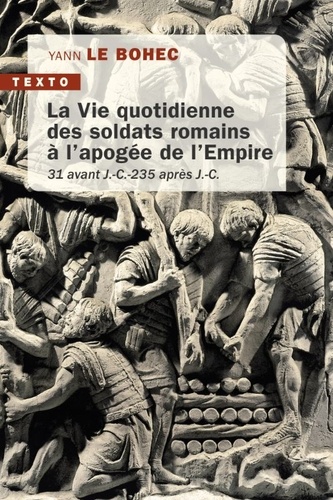
Empire
La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire. 31 avant J.-C. - 235 après J.-C.
05/2023
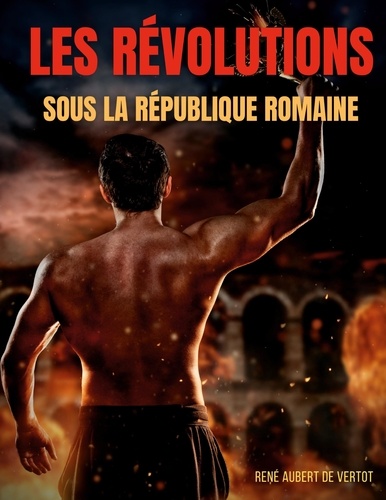
République
Les révolutions sous la République romaine. Soulèvements, révoltes et rebellions contre l'autorité politique et militaire des Romains
04/2022
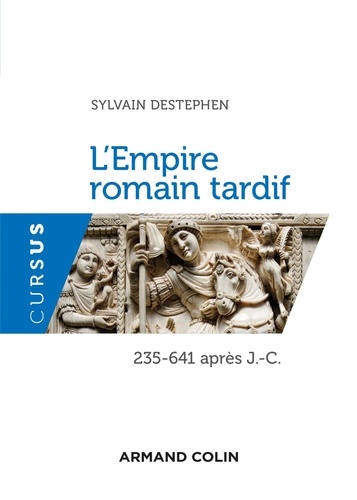
Histoire antique
L'Empire romain tardif. 235-641 après J.-C.
03/2021
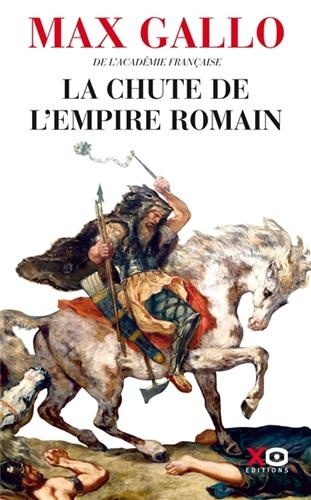
Romans historiques
La Chute de l'Empire romain
03/2014
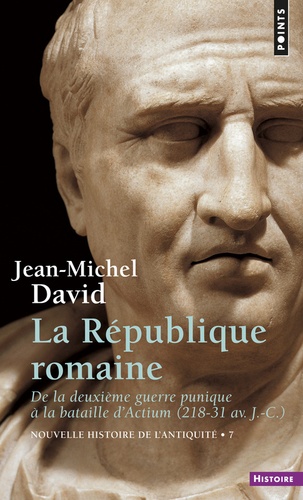
Histoire ancienne
Nouvelle histoire de l'Antiquité. Tome 7, La République romaine, De la deuxième guerre punique à la bataille d'Actium 218-31
05/2000
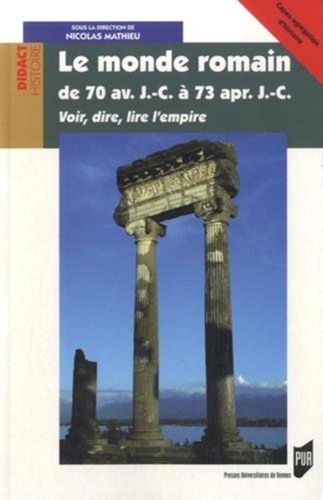
Empire
Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.-C.. Voir, dire, lire l'empire
11/2014
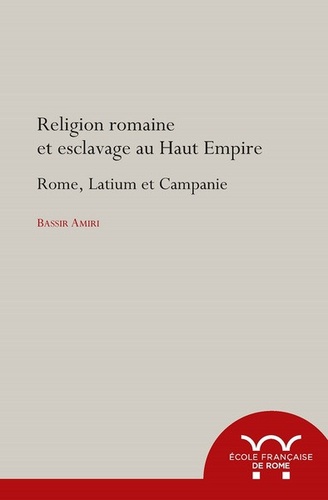
Empire
Religion romaine et esclavage au Haut-Empire. Rome, Latium et Campagnie
02/2021
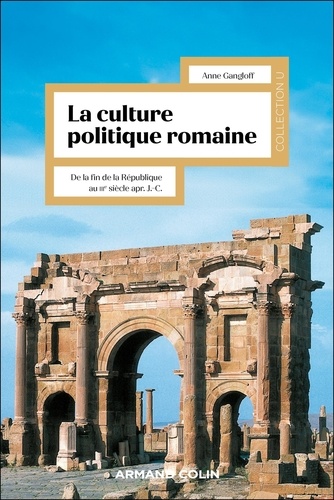
République
La culture politique romaine. De la fin de la République au IIIe siècle après J.-C.
06/2024
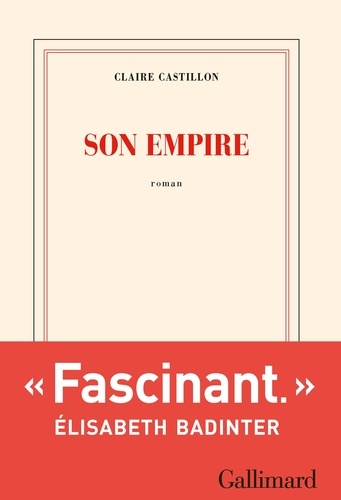
Littérature française
Son empire

Littérature française
Son empire
09/2023
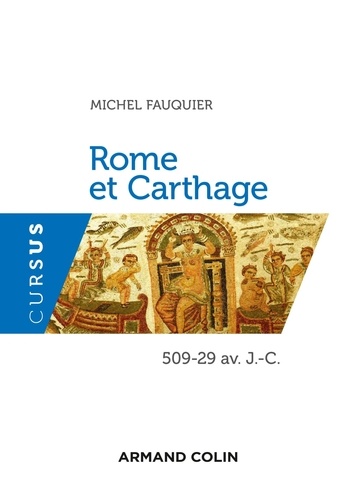
Histoire ancienne
Rome et Carthage. 509-29 av. J.-C.
08/2020

