En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle
Extraits
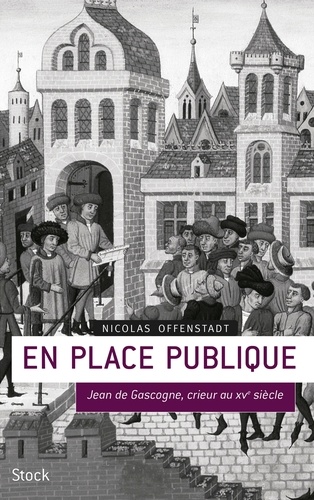
Histoire de France
En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle
09/2013
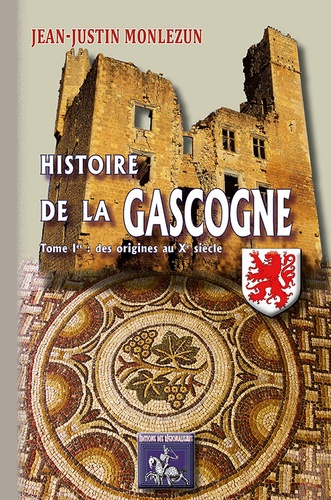
Sciences historiques
Histoire de la Gascogne. Tome 1, Des origines au XIe siècle
09/2015
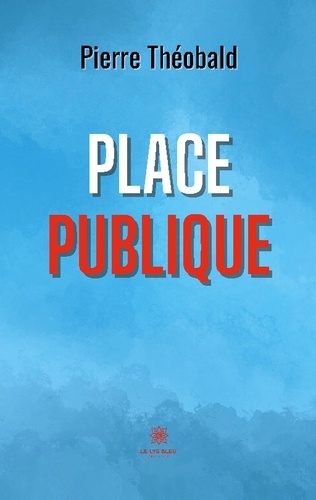
Poésie
Place publique
03/2022
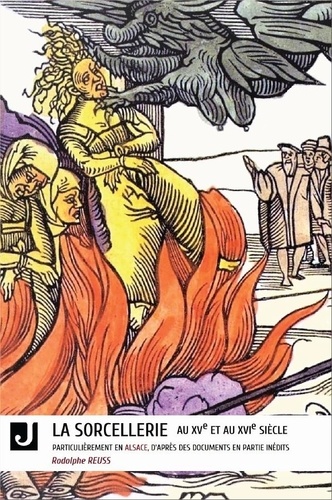
Ouvrages généraux
LA SORCELLERIE AU XVe ET AU XVIe SIÈCLE PARTICULIÈREMENT EN ALSACE
02/2023
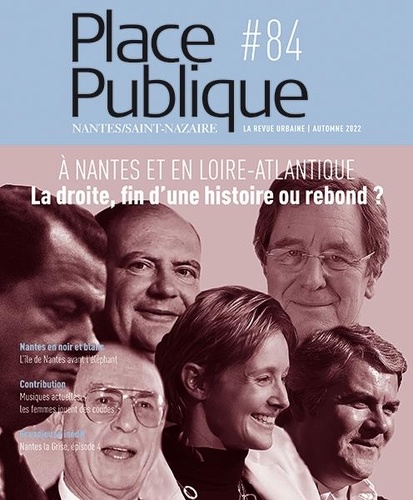
Sociologie
Place publique #84
10/2022
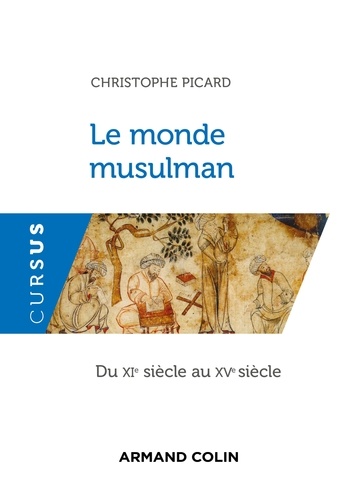
Histoire internationale
Le monde musulman du XIe au XVe siècle
01/2019
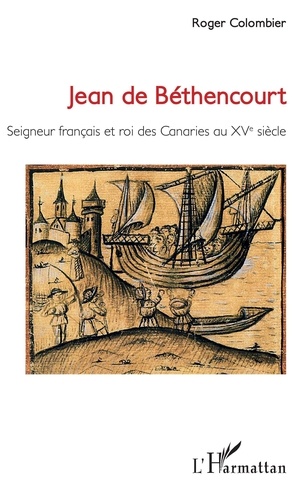
Histoire de France
Jean de Béthencourt. Seigneur français et roi des Canaries au XVe siècle
11/2019
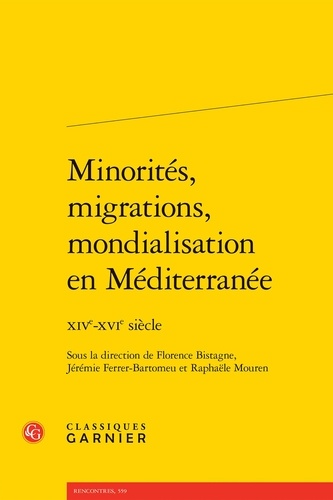
Histoire de la population
Minorités, migrations, mondialisation en méditerranée - xive-xvie siècle. XIVe-XVIe siècle
12/2022
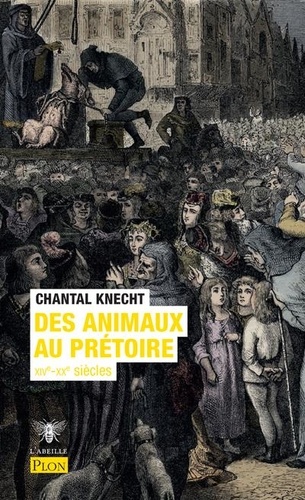
Droit
Des animaux au prétoire. XIVe-XXe siècle
05/2020
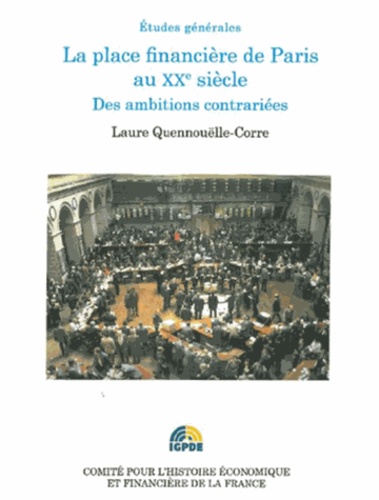
Economie
La place financière de Paris au XXe siècle. Des ambitions contrariées
02/2015
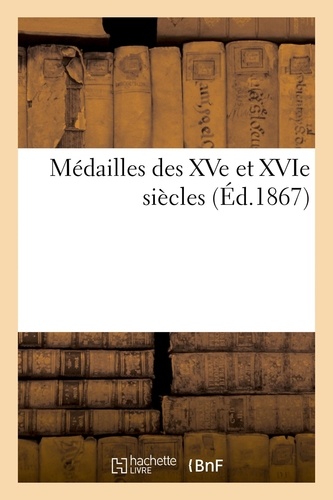
Dictionnaire français
Médailles des XVe et XVIe siècles
03/2020
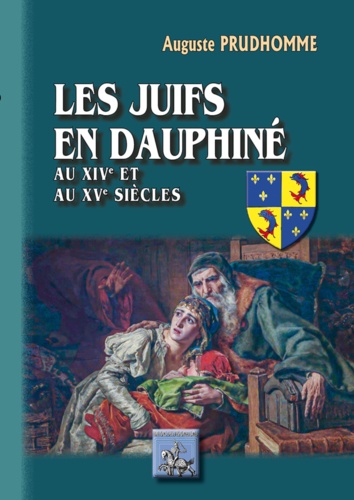
Religion
Les juifs en Dauphiné aux XIVe et XVe siècles
10/2019
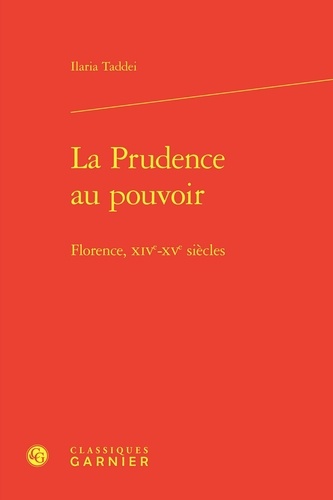
Histoire internationale
La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles
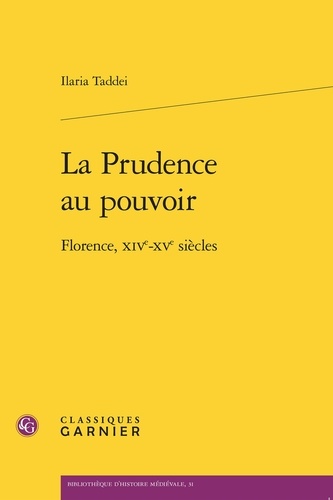
Italie
La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles
11/2022
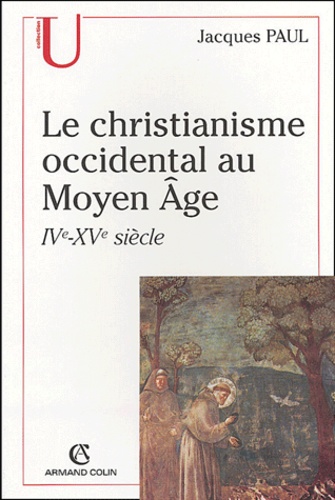
Religion
Le christianisme occidental au Moyen Âge. IVe-XVe siècle
03/2004
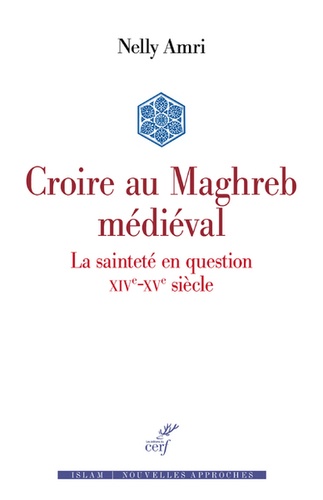
Religion
Croire au Maghreb médiéval. La sainteté en question (XIVe-XVe siècle)
02/2019
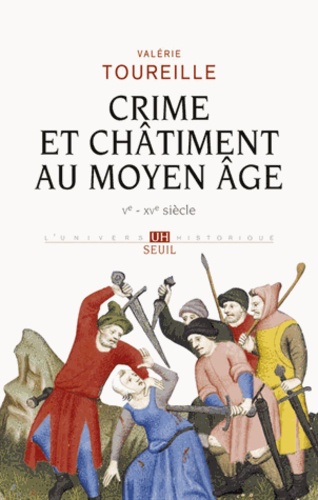
Histoire de France
Crime et chatiment au Moyen Age. Ve - XVe siècle
01/2013

Beaux arts
Sotteville, la place publique
06/2019
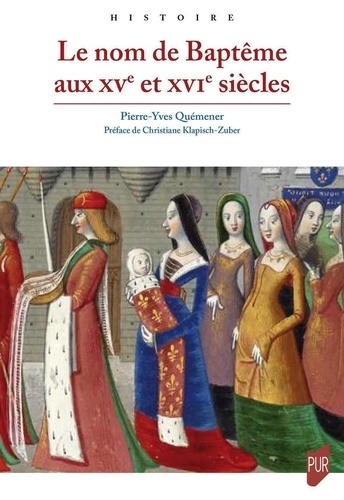
Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè
Le nom de baptême aux XVe et XVIe siècles
06/2023
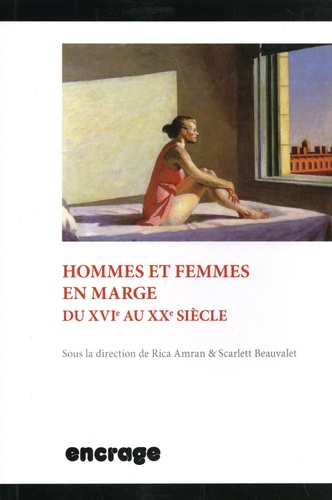
Histoire de la population
Hommes et femmes en marge du XVIe au XXe siècle
06/2021
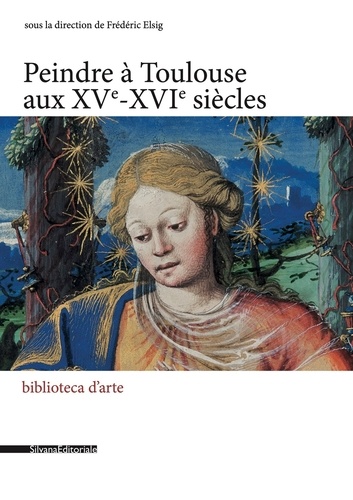
Renaissance
Peindre à Toulouse aux XVe-XVIe siècles
03/2021
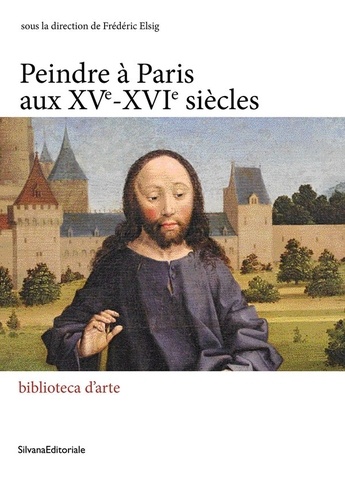
Histoire de la peinture
Peindre à Paris aux XVe-XVIe siècles
04/2024
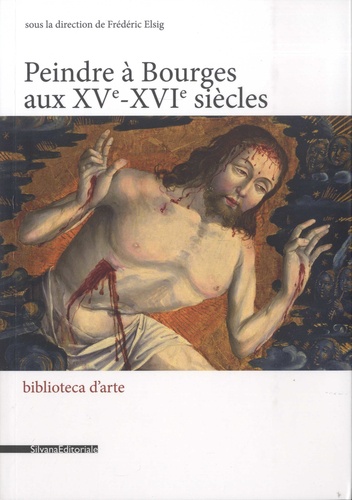
Beaux arts
Peindre à Bourges aux XVe-XVIe siècles
03/2019
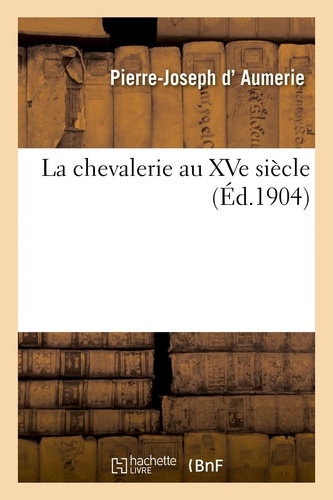
Histoire internationale
La chevalerie au XVe siècle
02/2020
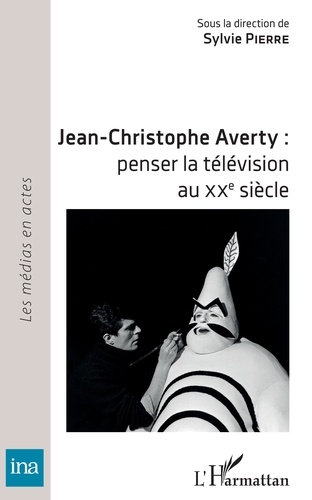
Cinéma
Jean-Christophe Averty : penser la télévision au XXe siècle
07/2019
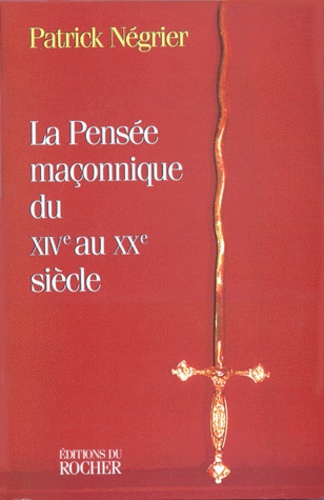
Esotérisme
La pensée maçonnique du XIVe au XXe siècle
11/1998
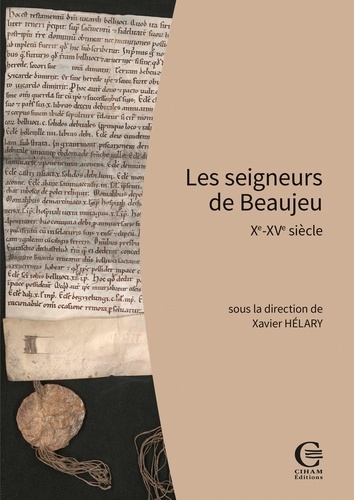
Moyen Age classique (XIe au XI
Les seigneurs de Beaujeu. Xe - XVe siècle
06/2024
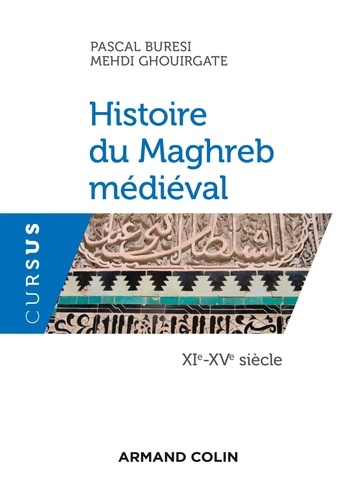
Histoire internationale
Histoire du Maghreb médiéval. XIe-XVe siècle
01/2021

Sciences historiques
Charivaris en Gascogne. La "morale des peuples" du 16e au 20e siècle
03/2007
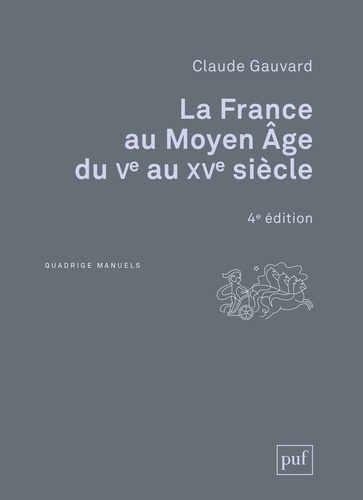
Ouvrages généraux et thématiqu
La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle. 4e édition
06/2019

