CORRESPONDANCE. Tome 1, 1915-1928
Extraits
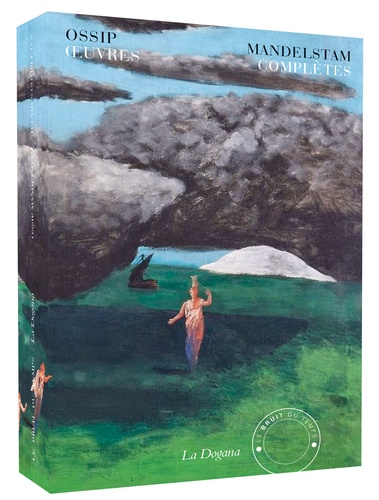
Littérature étrangère
Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose
03/2018
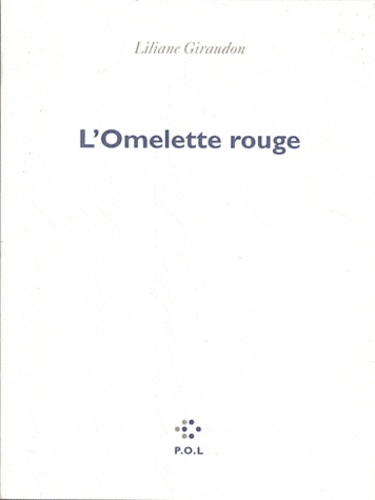
Poésie
L'Omelette rouge
05/2011
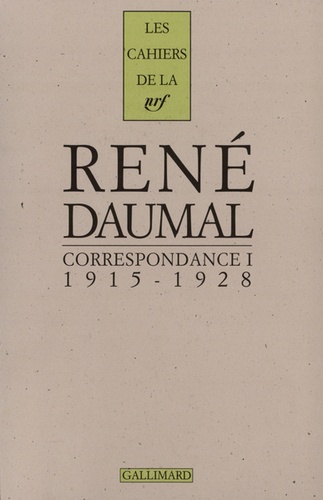
Critique littéraire
CORRESPONDANCE. Tome 1, 1915-1928
05/1992
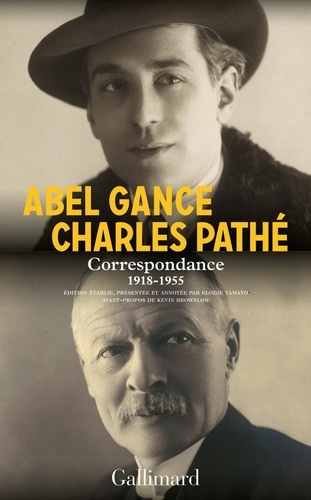
Cinéastes, réalisateurs
Correspondance 1918-1955
06/2021
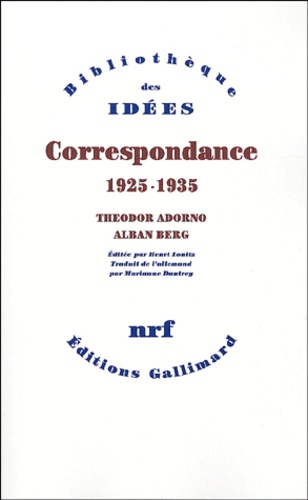
Philosophie
Correspondance 1925-1935
04/2004
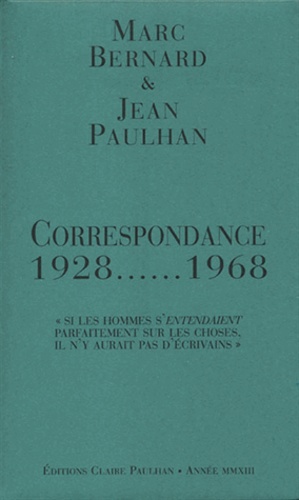
Critique littéraire
Correspondance 1928-1968
11/2013
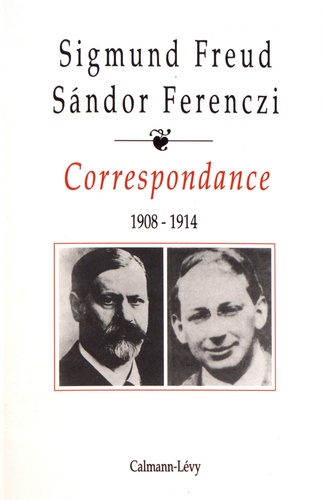
Psychologie, psychanalyse
Correspondance. Tome 1, 1908-1914
04/1994
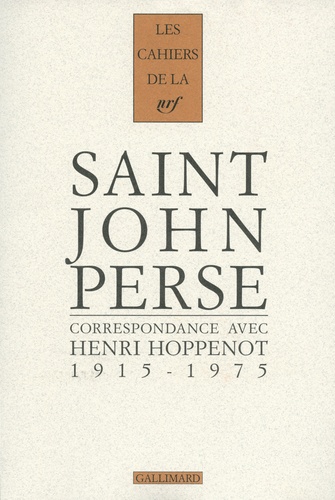
Critique littéraire
Correspondance 1915-1975
10/2009
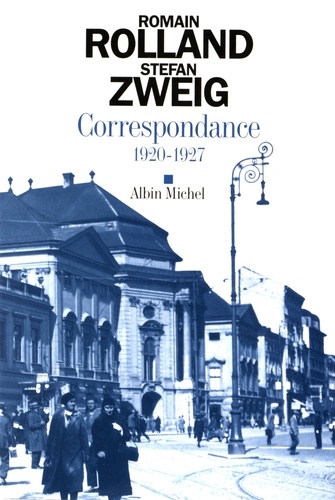
Critique littéraire
Correspondance 1920-1927
09/2015
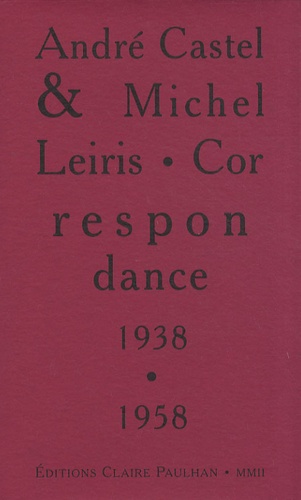
Critique littéraire
Correspondance 1938-1958
05/2002
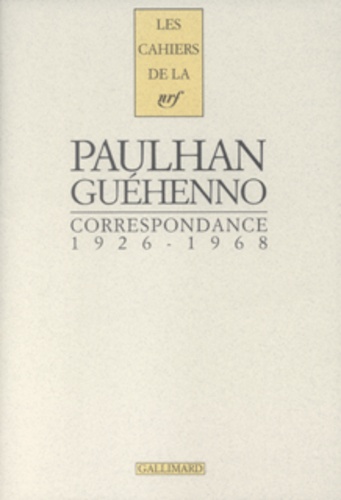
Critique littéraire
Correspondance 1926-1968
11/2002
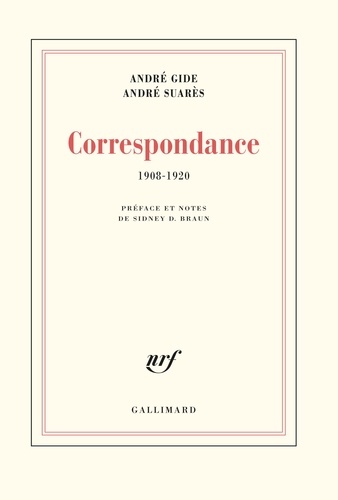
Critique littéraire
Correspondance (1908-1920)
10/1963
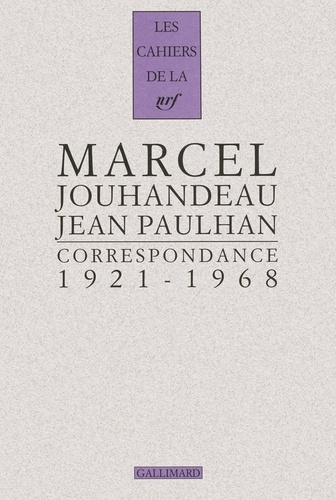
Critique littéraire
Correspondance 1921-1968
04/2012
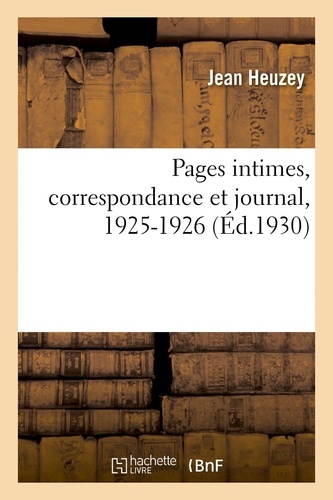
Histoire internationale
Pages intimes, correspondance et journal, 1925-1926
02/2020
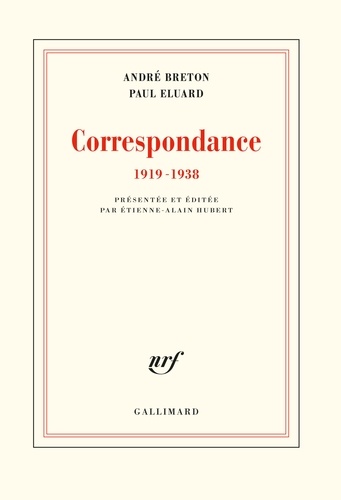
Critique littéraire
Correspondance. (1919-1938)
12/2019
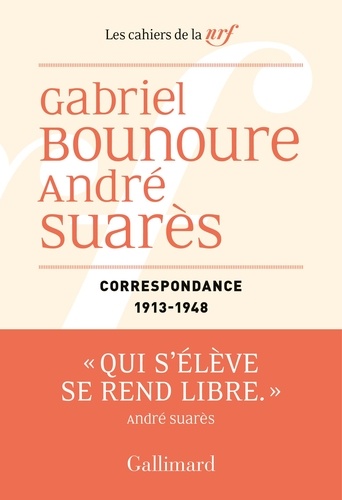
Correspondance
Correspondance 1913-1948
01/2023
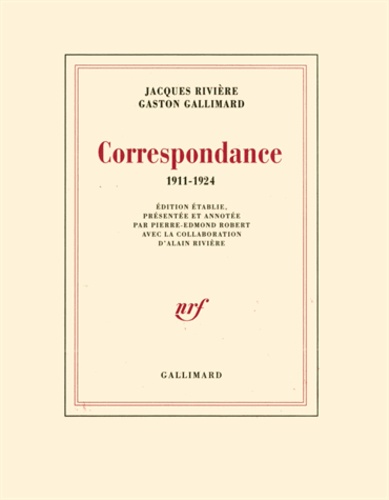
Critique littéraire
Correspondance. 1911-1924
07/1994
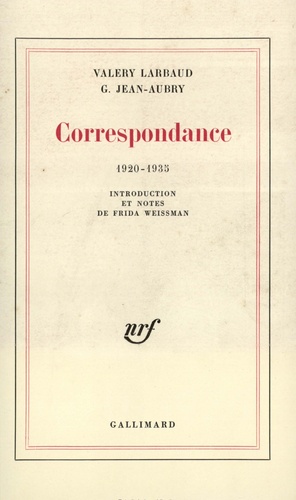
Littérature française
CORRESPONDANCE 1920-1935
01/1971
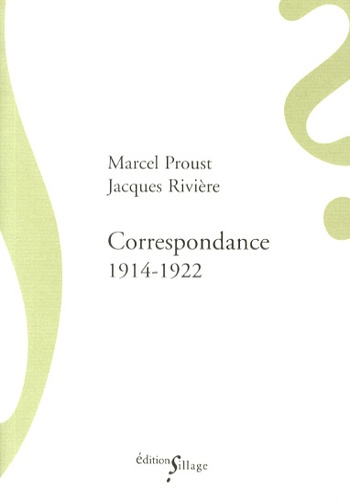
Critique littéraire
Correspondance 1914-1922
10/2013
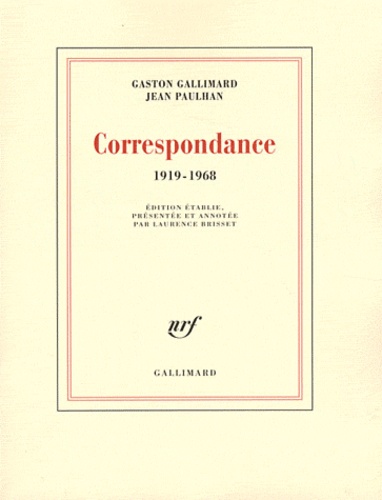
Critique littéraire
Correspondance 1919-1968
11/2011
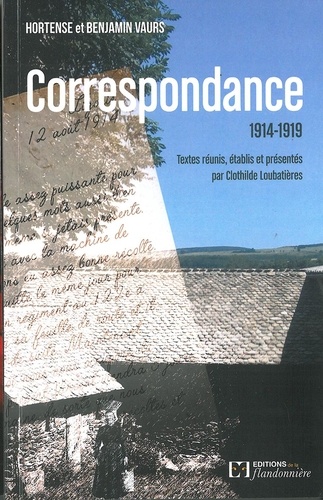
Critique littéraire
Correspondance. 1914-1919
06/2019
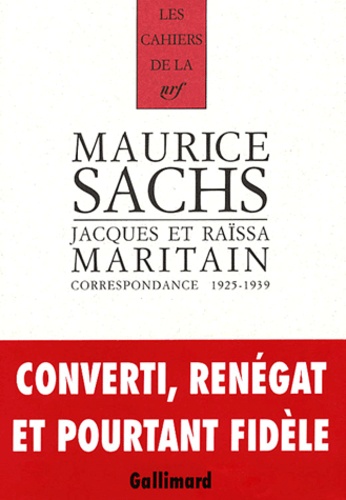
Critique littéraire
Correspondance 1925-1939
10/2003
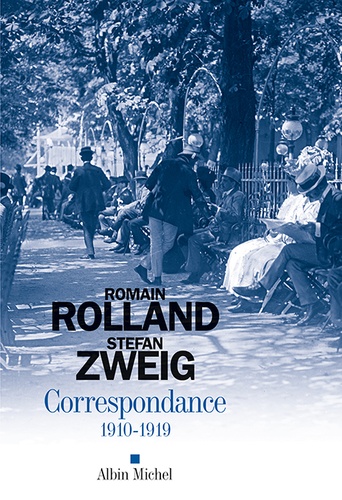
Critique littéraire
Correspondance. 1910-1919
03/2014
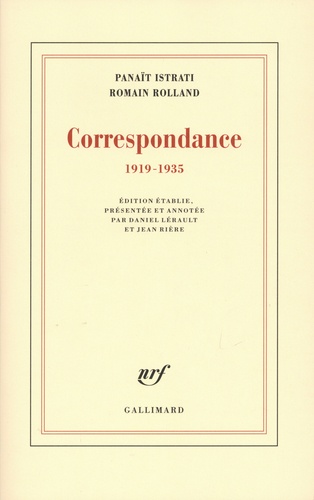
Critique littéraire
Correspondance. 1919-1935
05/2019
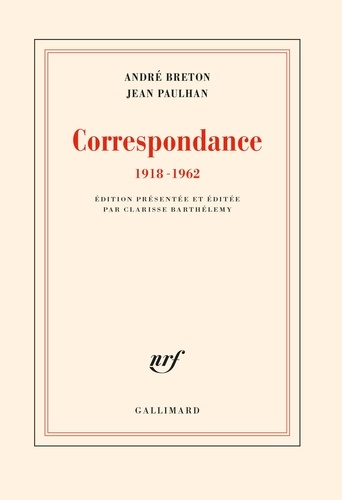
Correspondance
Correspondance, 1918-1962
11/2021
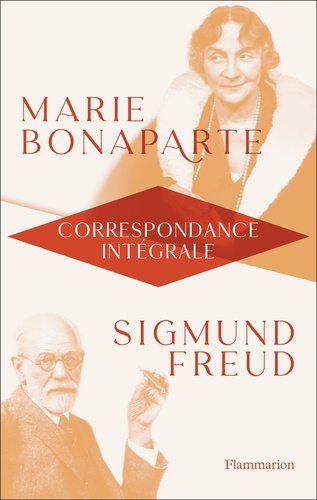
Freud
Correspondance. 1925-1939
10/2022
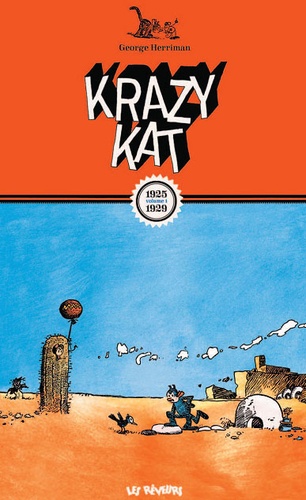
BD tout public
Krazy Kat Tome 1 : 1925-1929
10/2012
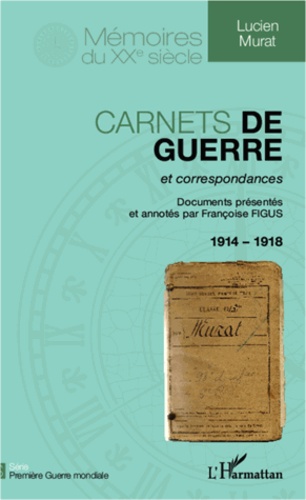
Histoire de France
Carnets de Guerre et correspondances 1914-1918
12/2012
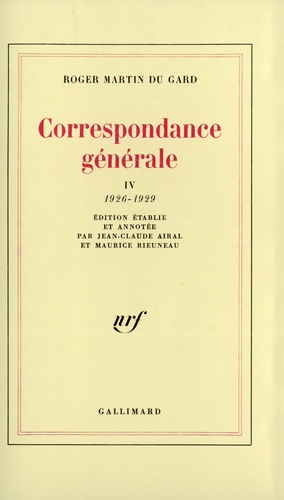
Critique littéraire
Correspondance générale. Tome 4, 1926-1929
11/1987
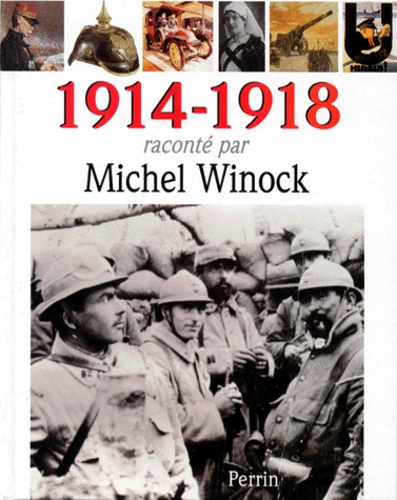
Documentaires jeunesse
1914-1918
09/1998

