Dictionnaire Goldoni
Extraits
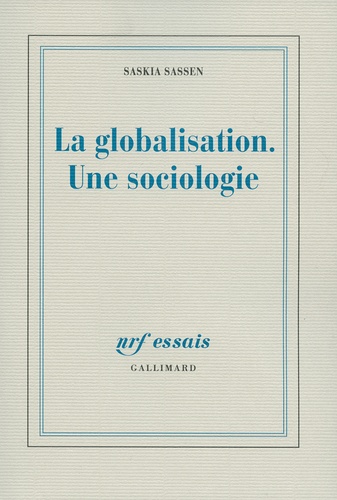
Sociologie
La globalisation. Une sociologie
03/2009
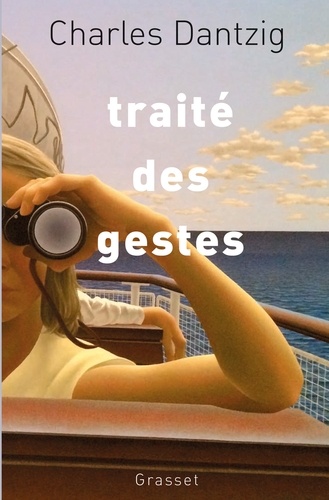
Critique littéraire
Traité des gestes
10/2017
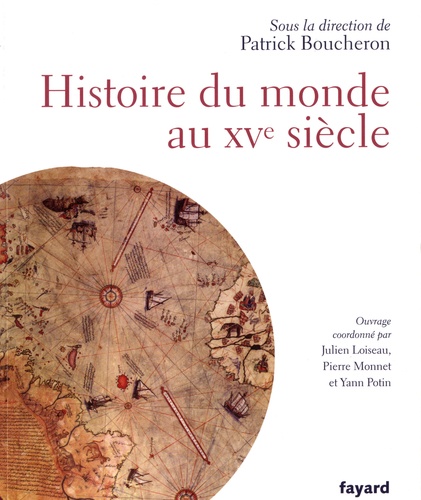
Histoire internationale
Histoire du monde au XVe siècle
11/2009
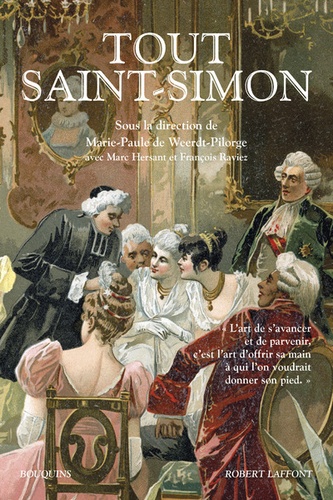
Critique littéraire
Tout Saint-Simon
11/2017
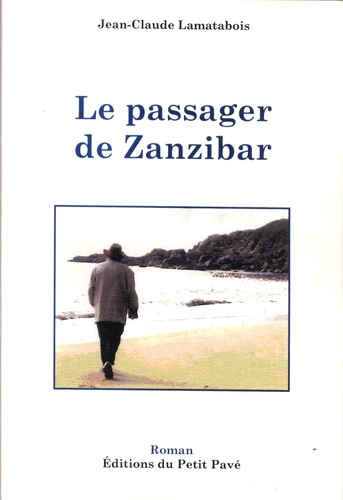
Littérature française
Le passager de Zanzibar
01/2018
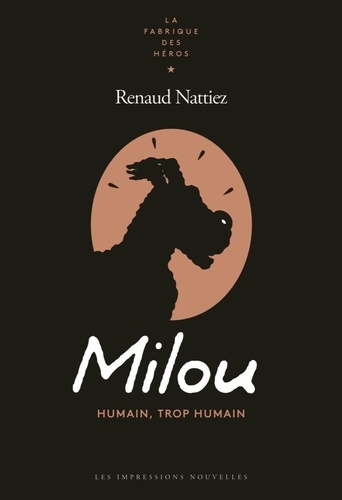
Monographies et entretiens
Milou. Humain, trop humain
03/2022
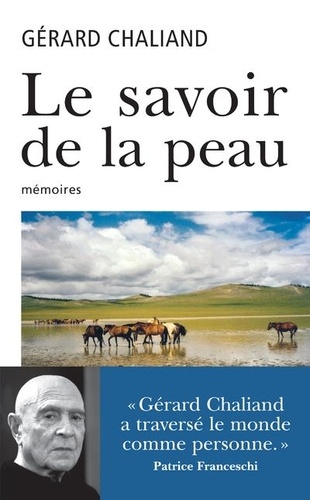
Géopolitique
Le savoir de la peau
03/2022
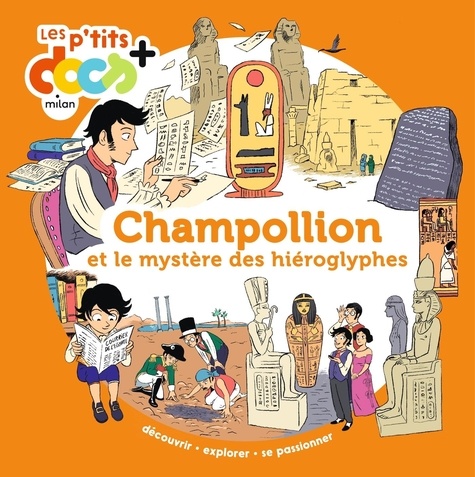
Egypte
Champollion et le mystère des hiéroglyphes
03/2023
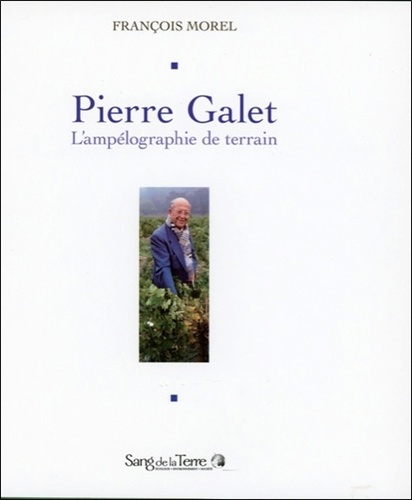
Sciences de la terre et de la
Pierre Galet. L'ampélographie de terrain, avec 2 CD audio
07/2013
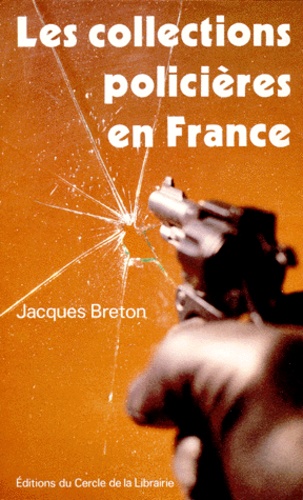
Critique littéraire
LES COLLECTIONS POLICIERES EN FRANCE. Au tournant des années 1990
01/1992

Revues Ethnologie
Cahiers d'études africaines N° 244/2021
12/2021
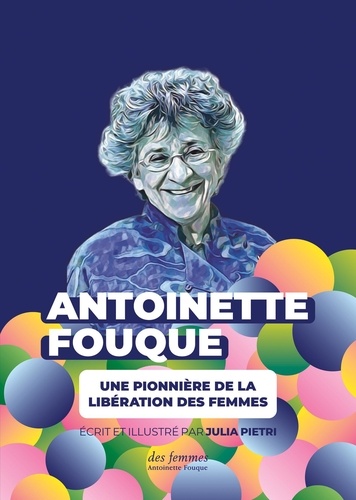
Histoire des femmes
Antoinette Fouque, une pionnière de la libération des femmes
03/2024
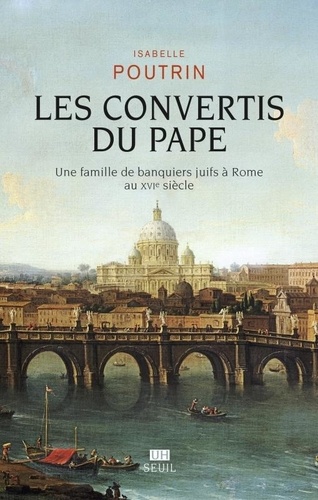
Histoire des religions
Les convertis du pape. Une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle
11/2023
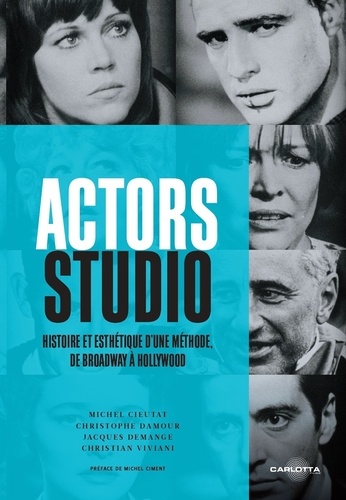
Histoire du cinéma
Actors Studio. Histoire et esthétique d'une méthode, de Broadway à Hollywood
11/2023
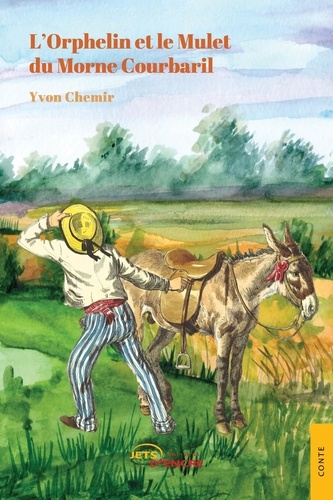
Contes et nouvelles
L'Orphelin et le Mulet du morne Courbaril
11/2022
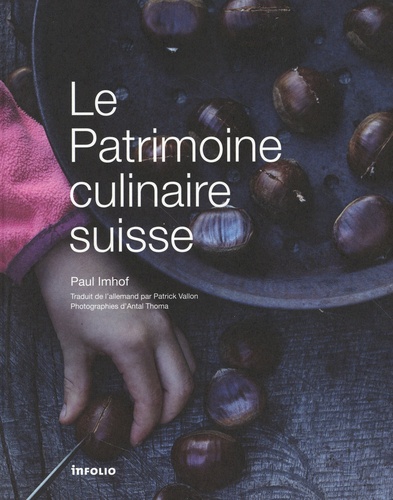
Tous pays
Le Patrimoine culinaire suisse
12/2022
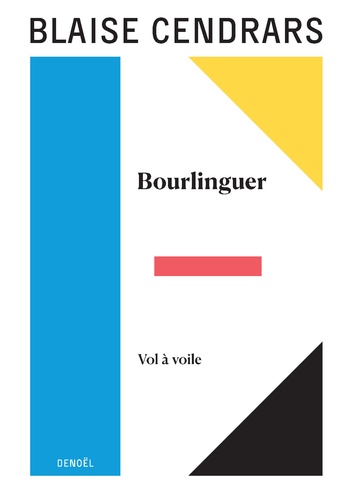
Littérature française
Œuvres complètes (Tome 9-Bourlinguer - Vol à voile). 9 Bourlinguer - Vol à voile
10/2023
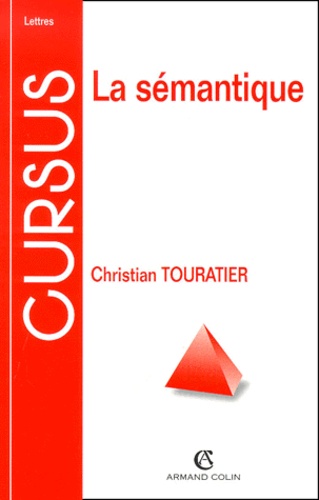
Critique littéraire
La sémantique
11/2000
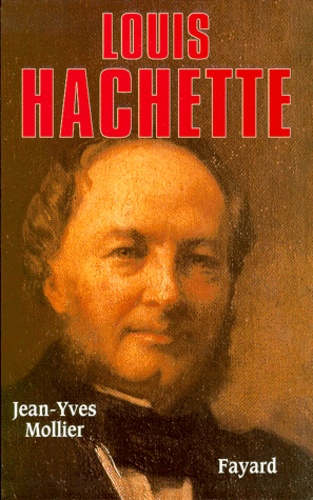
Critique littéraire
Louis Hachette. Le fondateur d'un empire, 1870-1940
03/1999
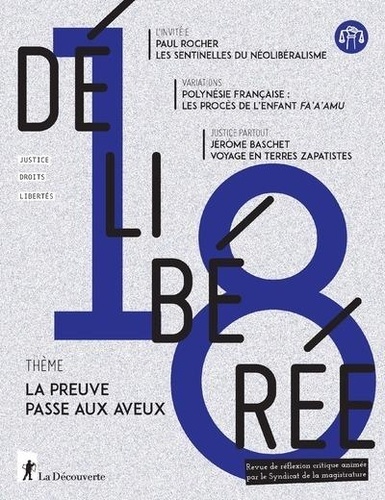
Revues de droit
Délibérée N° 18, mars 2023
03/2023

Suisse romand
Le Dico romand. Lexique de chez nous
04/2021

Histoire de France
Honneur, bourgeoisie et commerce au XVIIIe siècle. Le mémorial à mes enfans du marchand-drapier orléanais, Pierre-Etienne Brasseux
09/2019
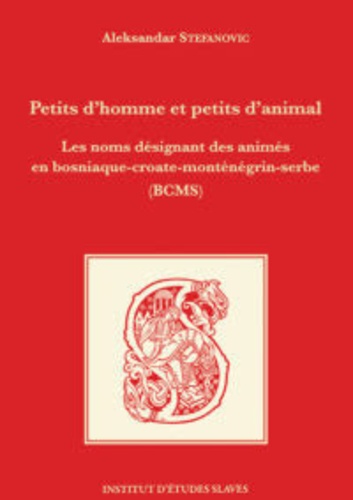
Autres langues
Petits d’homme et petits d’animal. Les noms désignant des animés en bosniaque-croate-monténégrin-serbe (BCMS)
01/2021
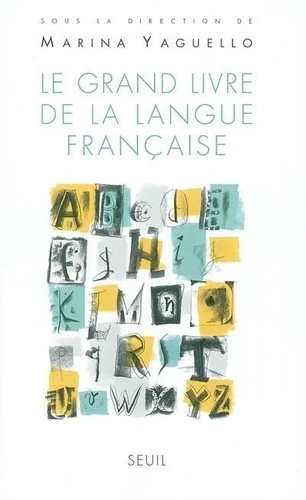
Critique littéraire
Le grand livre de la langue française
04/2003
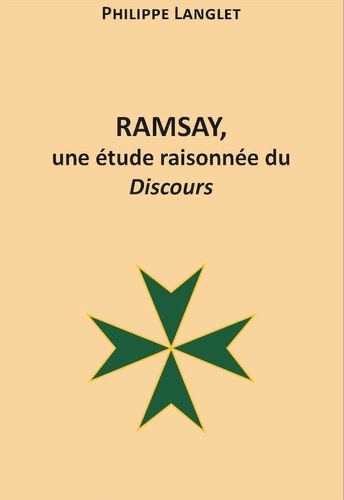
Franc-maçonnerie
Ramsay. Une étude raisonnée du Discours
02/2023
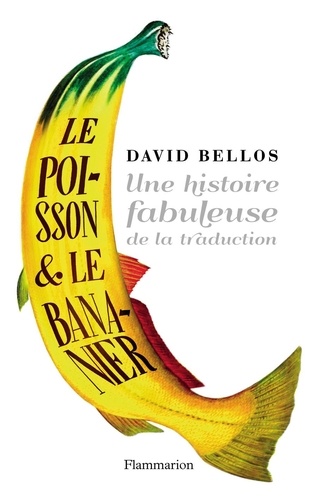
Critique littéraire
Le poisson et le bananier. L'histoire fabuleuse de la traduction
01/2012
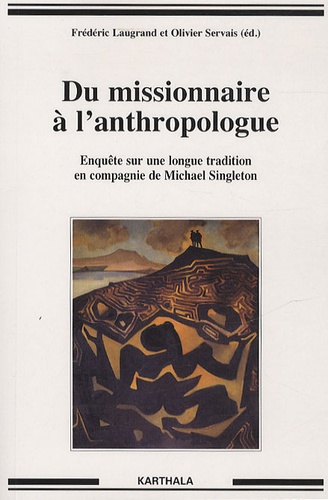
Ethnologie
Du missionnaire à l'anthropologue. Enquête sur une longue tradition en compagnie de Mike Singleton
08/2012
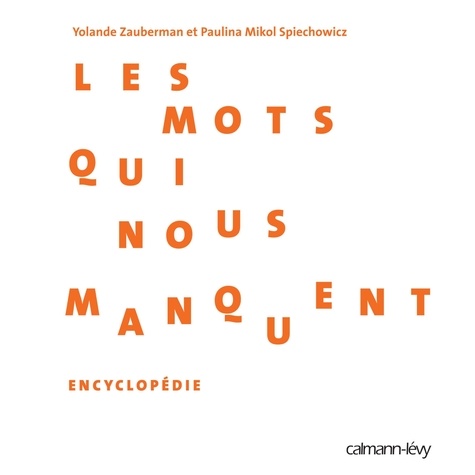
Critique littéraire
Les mots qui nous manquent. Encyclopédie
10/2016
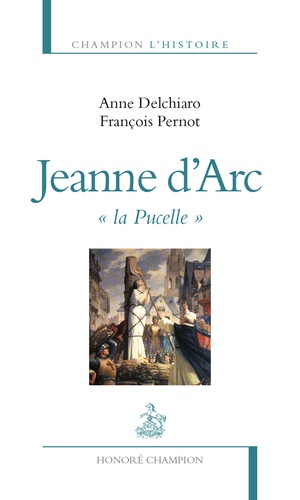
Histoire de France
Jeanne d'arc "la pucelle"
06/2015
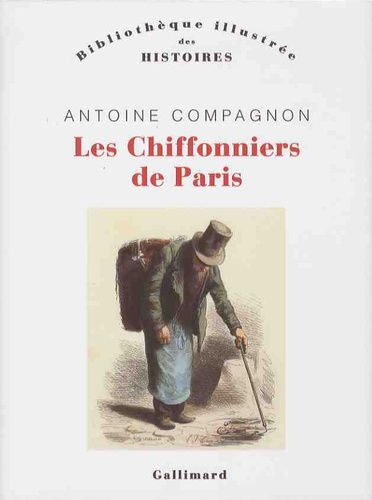
Sciences historiques
Les chiffonniers de Paris
10/2017

