éruption Vésuve Pompéi
Extraits
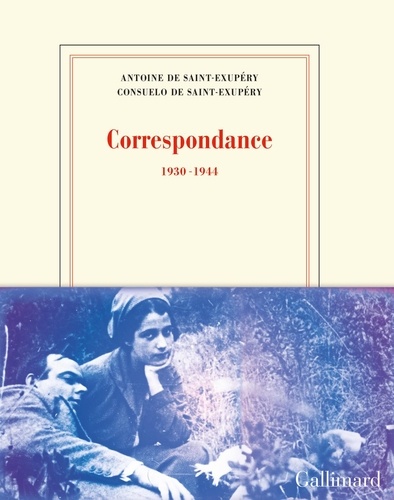
Correspondance
Correspondance. 1930-1944
05/2021
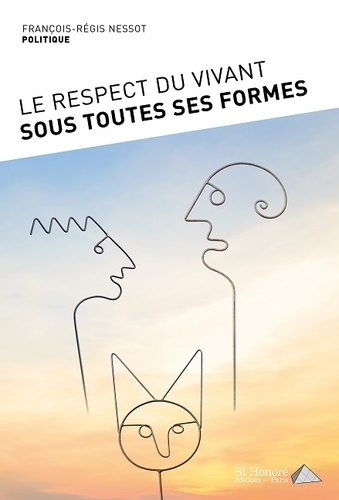
Philosophie
Le respect du vivant sous toutes ses formes
07/2018
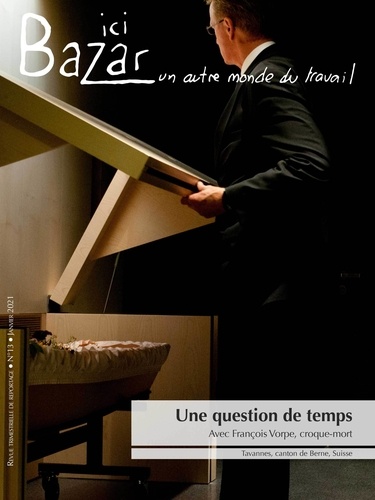
Sociologie
Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort
01/2021
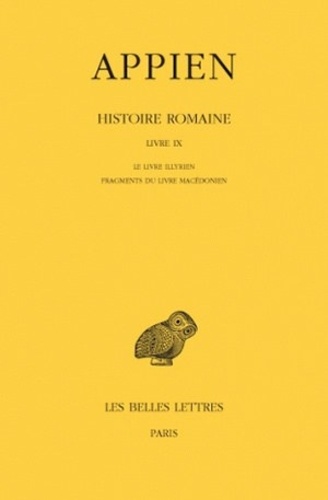
Critique littéraire
Histoire romaine. Tome 5, Livre IX, Le livre illyrien ; Fragments du livre macédonien, Edition bilingue français-grec ancien
11/2011

Actualité et médias
Résistons
10/2019
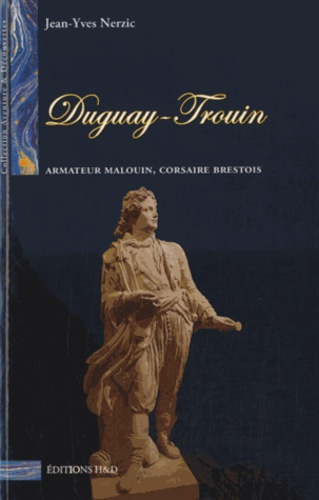
Histoire de France
Duguay-Trouin. Armateur malouin, corsaire brestois
11/2012
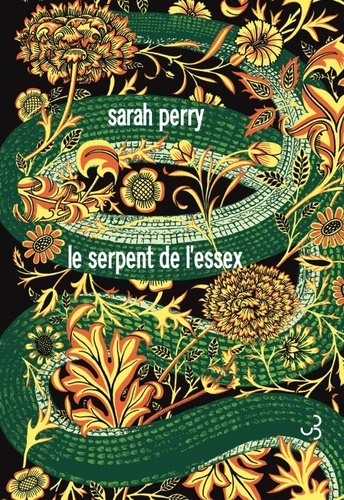
Littérature étrangère
Le serpent de l'Essex
01/2018
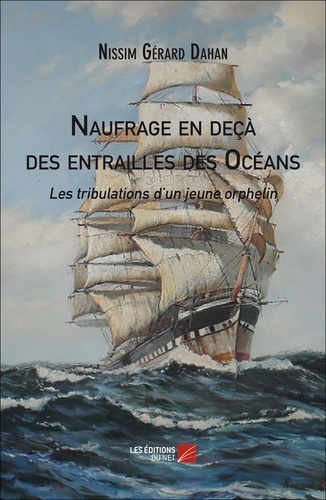
Littérature française
Naufrage en deçà des entrailles des Océans
04/2016
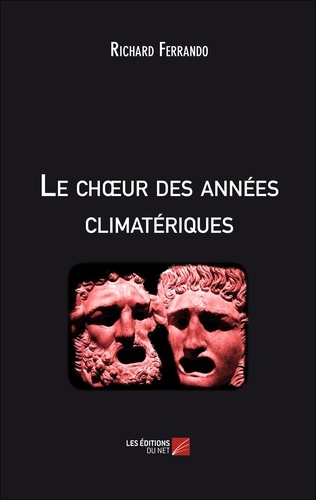
Littérature française
Le chour des années climatériques
02/2015
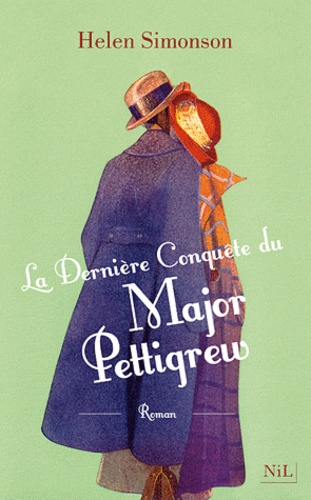
Littérature étrangère
La dernière conquête du major Pettigrew
03/2012
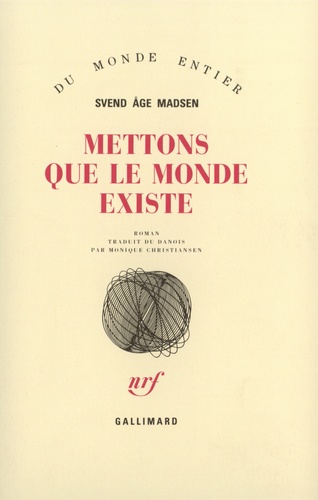
Littérature étrangère
Mettons que le monde existe
05/1991
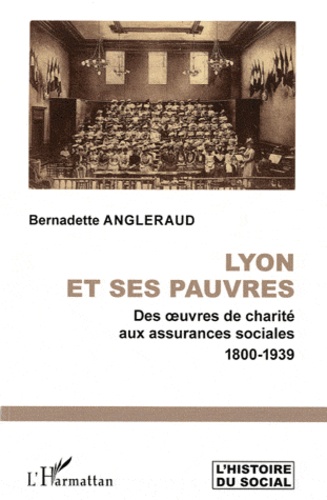
Sciences historiques
Lyon et ses pauvres. Des oeuvres de charité aux assurances sociales 1800-1939
12/2011
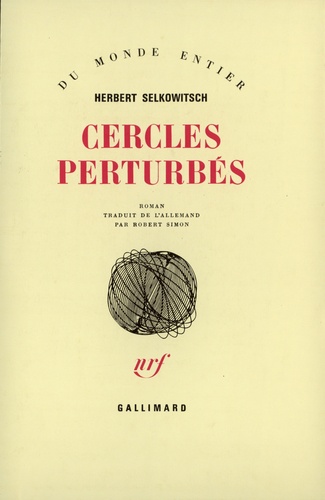
Littérature étrangère
Cercles perturbés
05/1987
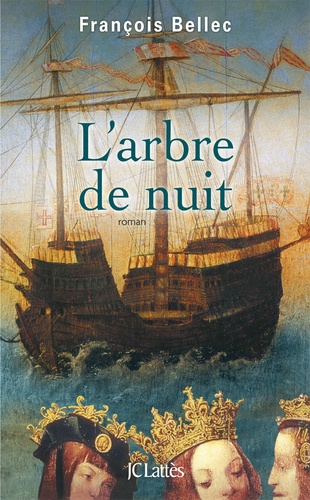
Romans historiques
L'arbre de nuit
02/2012
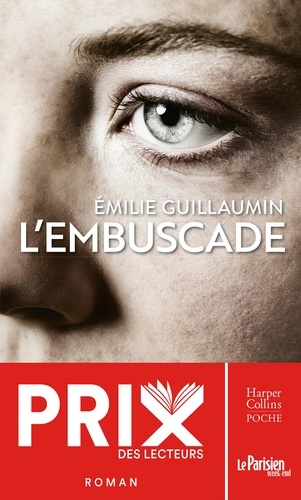
Littérature française
L'embuscade
06/2023
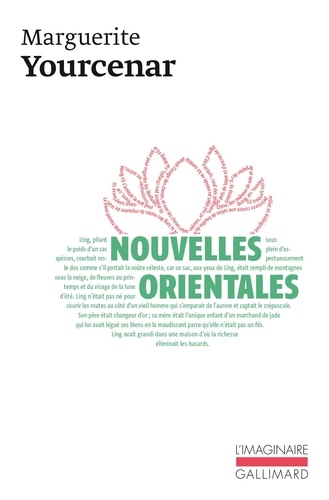
Littérature française (poches)
Nouvelles orientales
06/2006
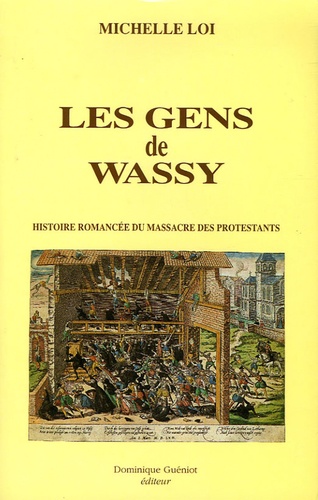
Romans historiques
Les gens de Wassy. Histoire romancée du massacre des protestants
12/1993
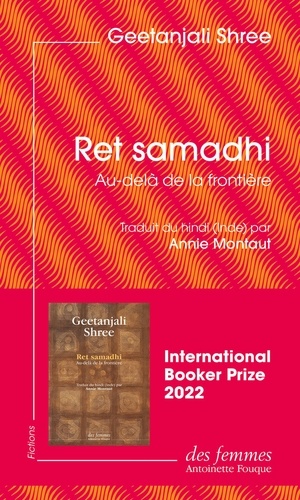
Littérature indienne
Ret samadhi (éd. poche). Au-delà de la frontière
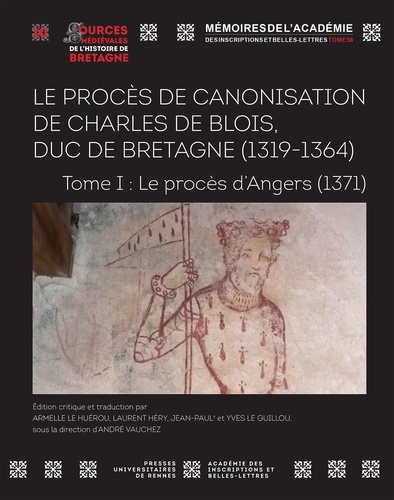
Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè
Le procès en canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (1319-1364). Tome I : Le procès d'Angers (1371)
04/2023
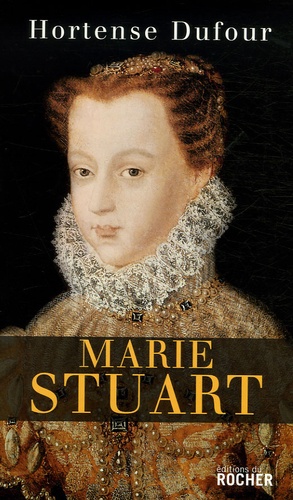
Histoire de France
Marie Stuart. "En ma fin est mon commencement"
03/2007
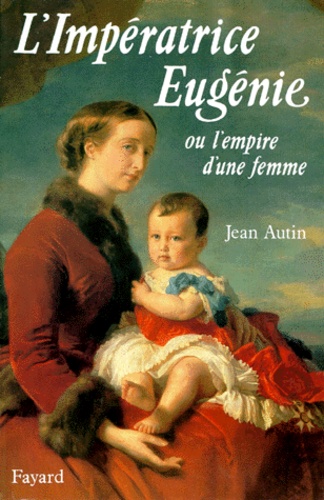
Histoire de France
L'Impératrice Eugènie ou l'Empire d'une femme
09/1995
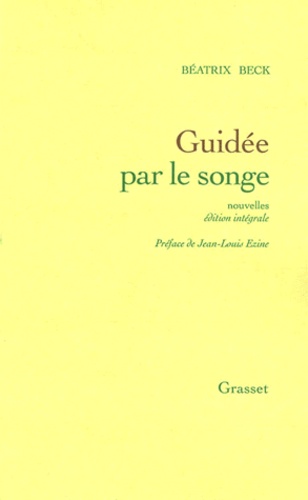
Littérature française
GUIDEE PAR LE SONGE. Nouvelles, texte intégral
09/1998
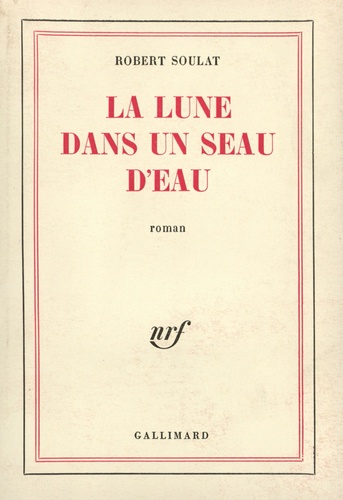
Littérature française
La lune dans un seau d'eau
09/1963
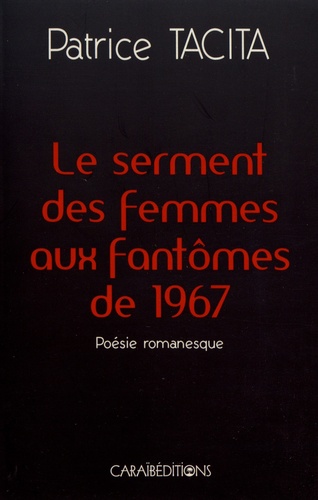
Littérature française
Le serment des femmes aux fantômes de 1967
06/2018
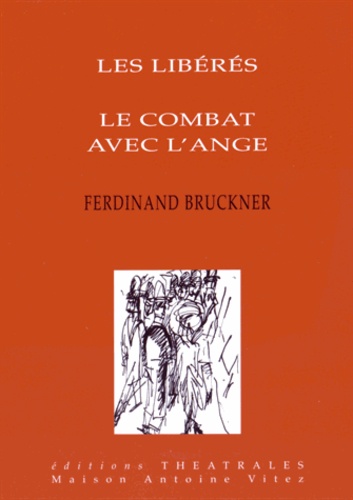
Théâtre
Les libérés ; Le combat avec l'ange
03/2015
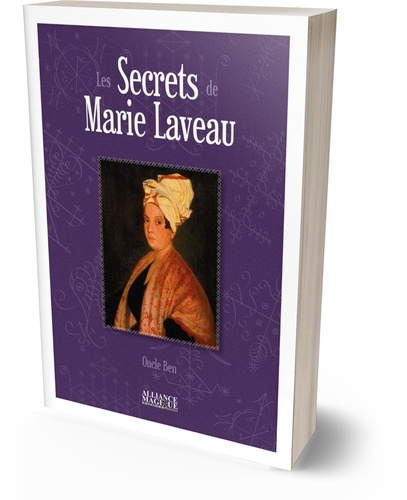
Sorcellerie
Les Secrets de Marie Laveau
02/2022
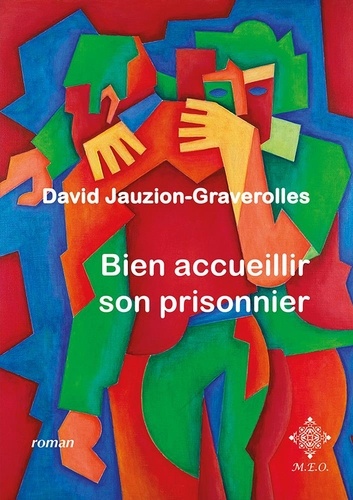
Littérature française
Bien accueillir son prisonnier
03/2023
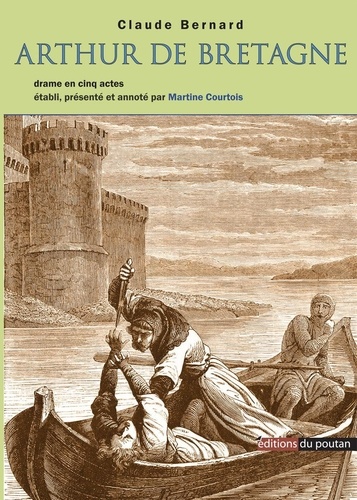
Théâtre
Arthur de Bretagne. Drame en cinq actes et en prose avec un chant
06/2013
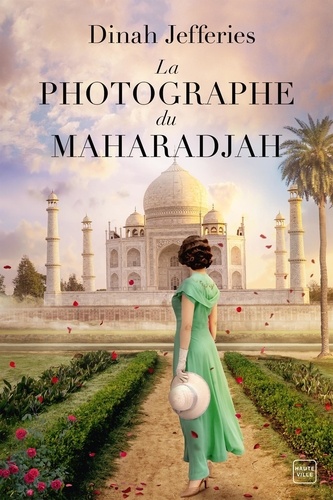
XXe siècle
La photographe du Maharadjah
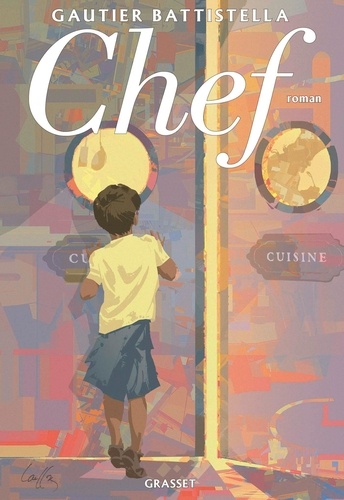
Littérature française
Chef [EDITION EN GROS CARACTERES
03/2022


