Extrémisme
Extraits
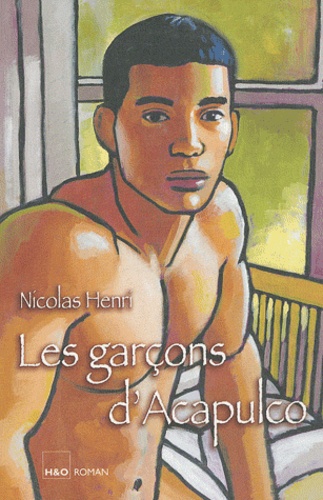
Littérature érotique et sentim
Les garçons d'Acapulco
02/2011
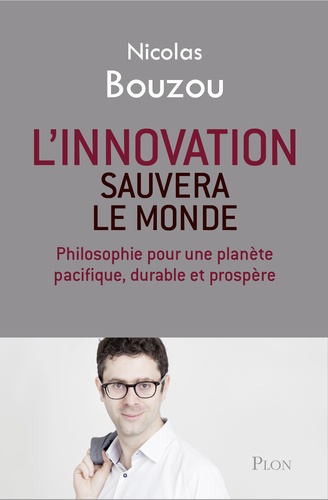
Gestion
L'innovation sauvera le monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère
09/2016
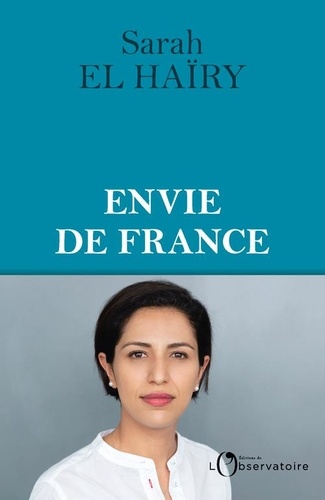
Actualité politique France
Envie de France
10/2021
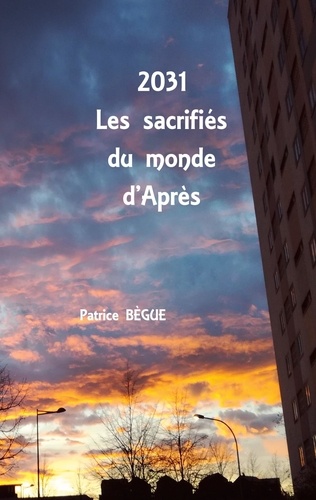
Science-fiction
2031. Les sacrifiés du monde d'après
10/2021
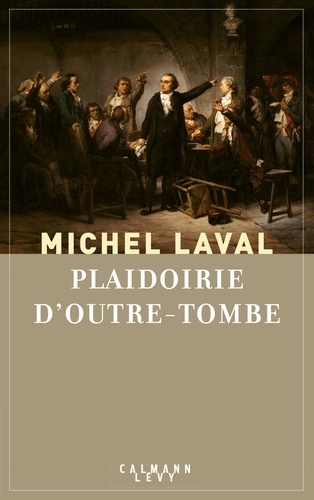
Droit
Plaidoirie d'outre-tombe
03/2017
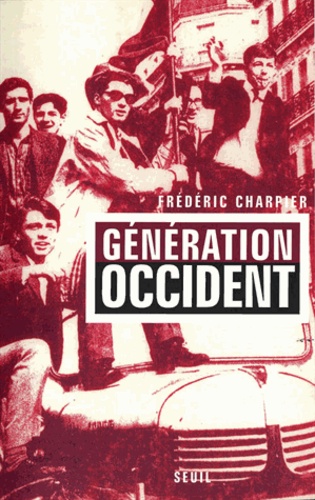
Droit
Génération Occident. De l'extrême droite à la droite
01/2005
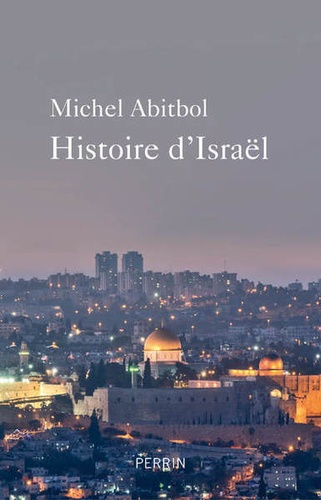
Histoire internationale
Histoire d'Israël
04/2018
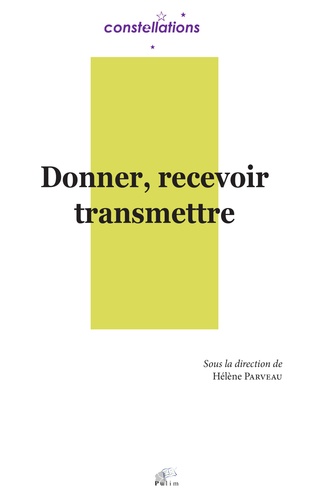
Sociologie
Donner, recevoir, transmettre
01/2019
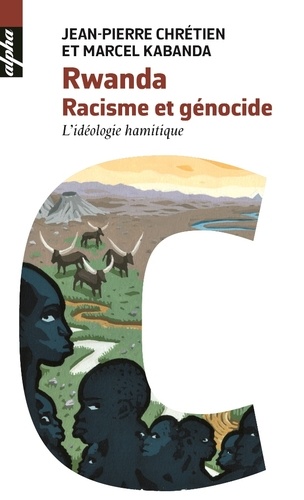
Histoire internationale
Rwanda. Racisme et génocide
09/2016
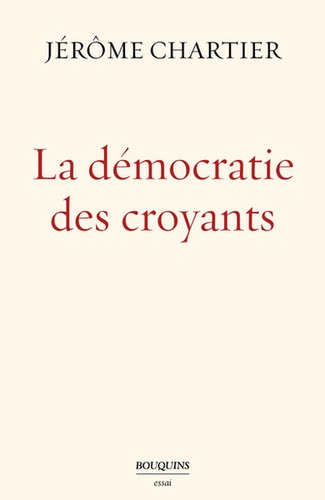
Sciences politiques
La démocratie des croyants
04/2023
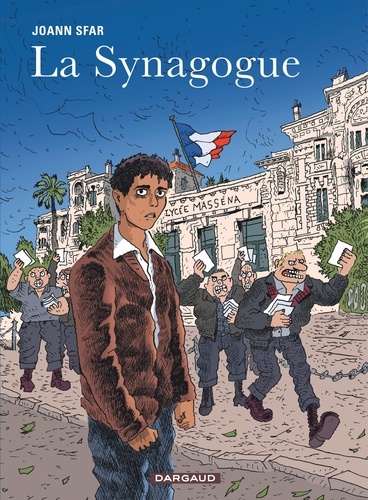
Réalistes, contemporains
La Synagogue
09/2022
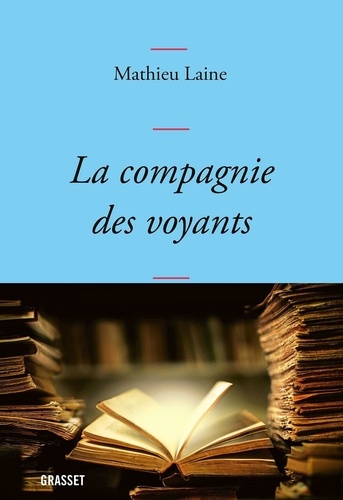
Littérature française
La compagnie des voyants. Ces grands romans qui nous éclairent
01/2023
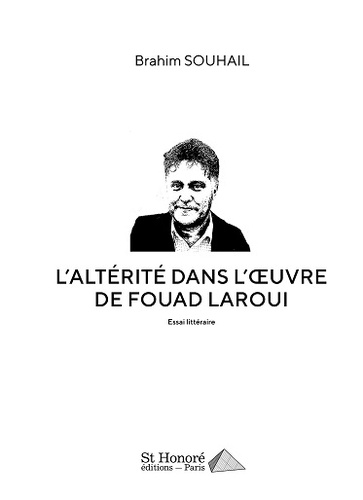
Littérature française
L'altérité dans l'oeuvre de Fouad Laroui
09/2019
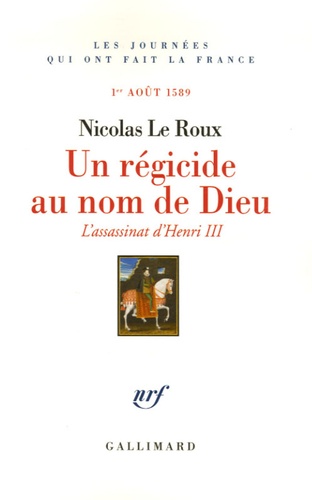
Histoire de France
Un régicide au nom de Dieu. L'assassinat d'Henri III, 1er août 1589
11/2006
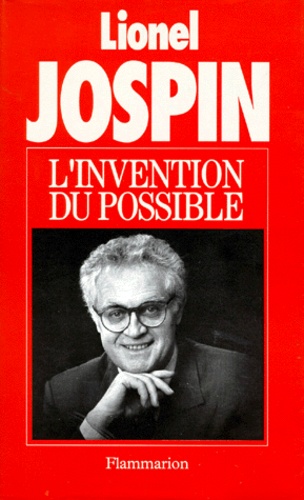
Sociologie
L'invention du possible
09/1991
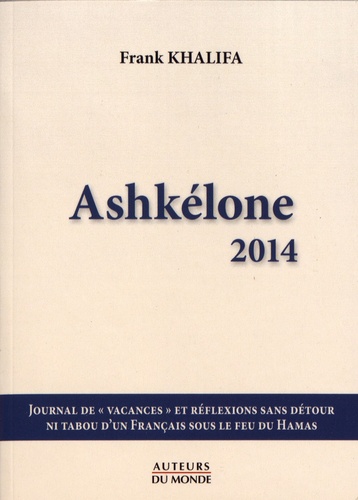
Littérature française (poches)
Ashkélone 2014
06/2020
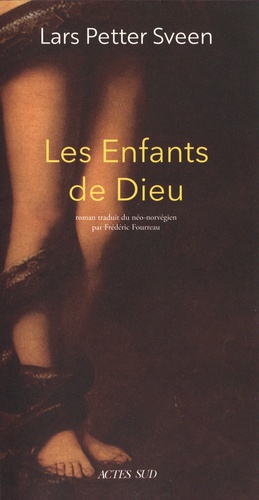
Littérature scandinave
Les enfants de Dieu
04/2021
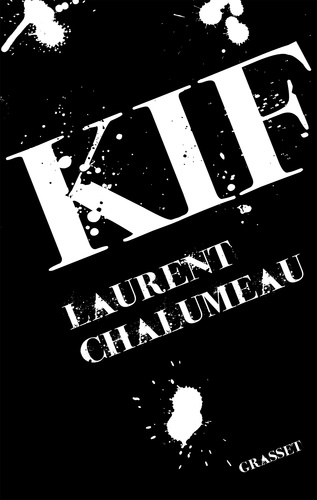
Littérature française
Kif
10/2014
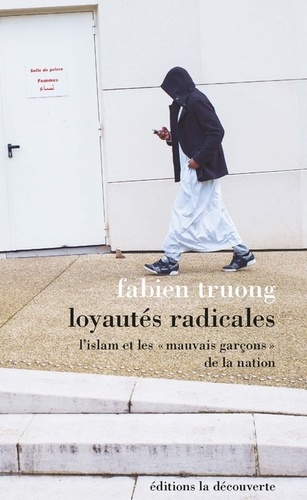
Sociologie
Loyautés radicales. L'islam et les "mauvais garçons" de la Nation
10/2017
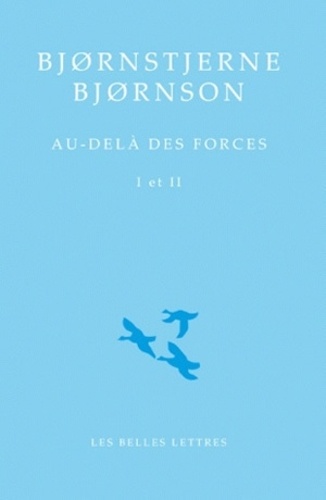
Théâtre
Au-delà des forces. Tomes 1 & 2
06/2010
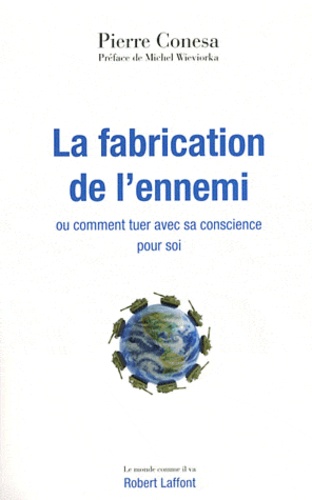
Sciences politiques
La fabrication de l'ennemi. ou Comment tuer avec sa conscience pour soi
09/2011
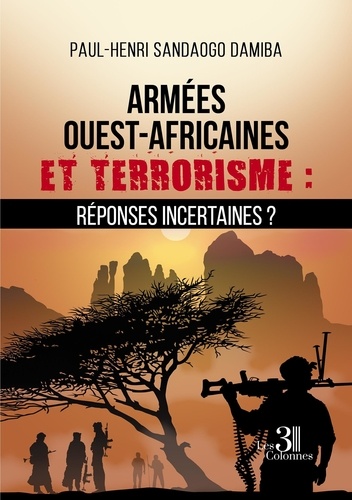
Terrorisme
Armées ouest-africaines et terrorisme : réponses incertaines ?
06/2021
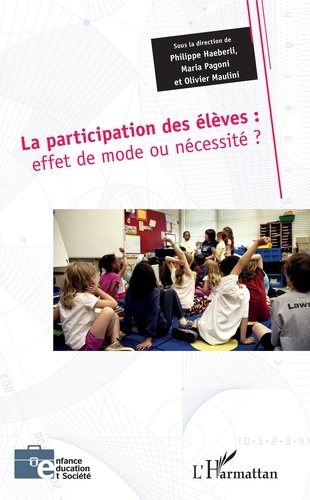
Pédagogie
La participation des élèves. Effet de mode ou nécessité ?
11/2017
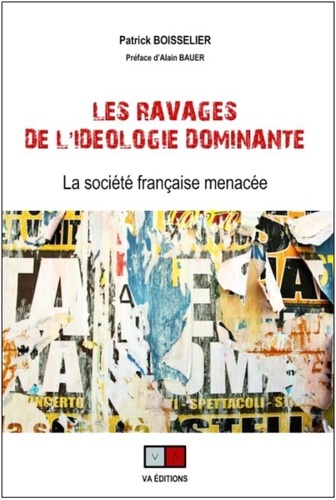
Actualité et médias
Les ravages de l'idéologie dominante. La société française menacée
11/2019
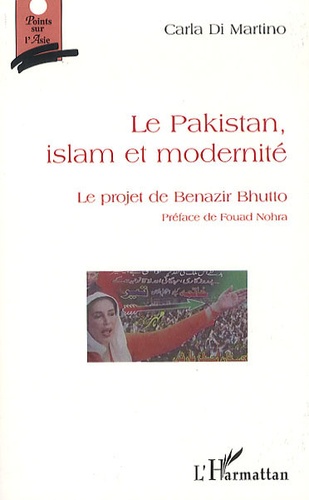
Histoire internationale
Le Pakistan, islam et modernite. Le projet de Benazir Bhutto
10/2010
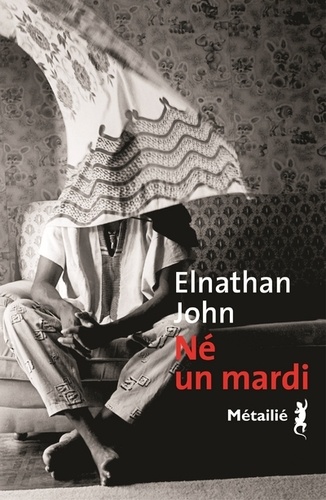
Littérature étrangère
Né un mardi
01/2018
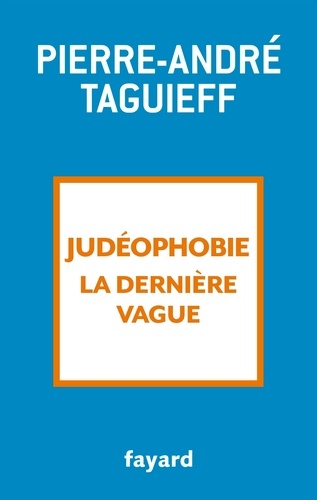
Sociologie
Judéophobie, la dernière vague. 2000-2018
05/2018
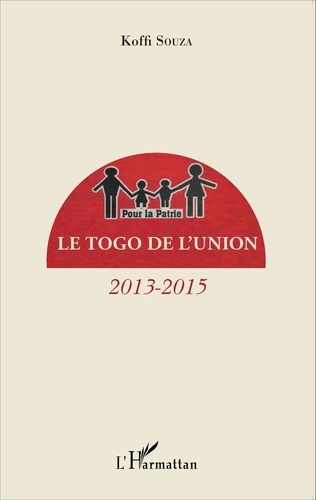
Histoire internationale
Le Togo de L'Union (2013-2015)
10/2015
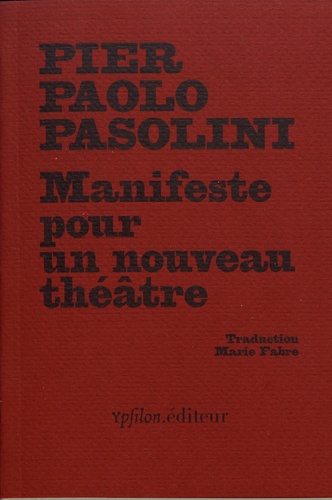
Théâtre
Manifeste pour un nouveau théâtre. Edition bilingue français-italien
03/2019
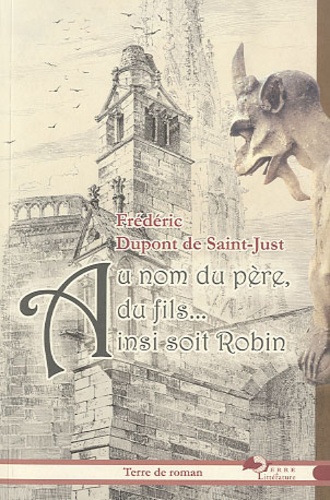
Romans historiques
Au nom du père, du fils... Ainsi soit Robin
05/2010

