Carrie Elks
Extraits
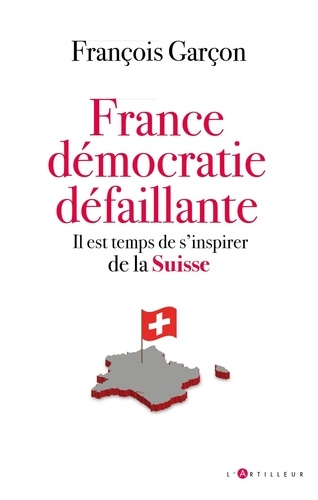
Sciences politiques
France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse
04/2021
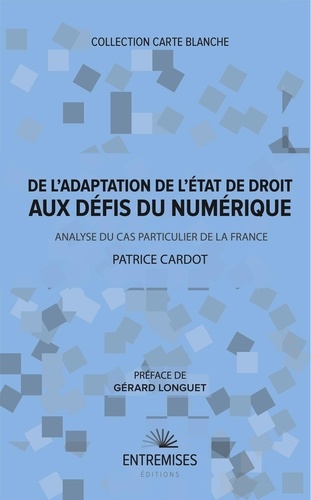
Droit constitutionnel
De l'adaptation de l'état de droit aux défis du numérique. Analyse du cas particulier de la France
05/2021
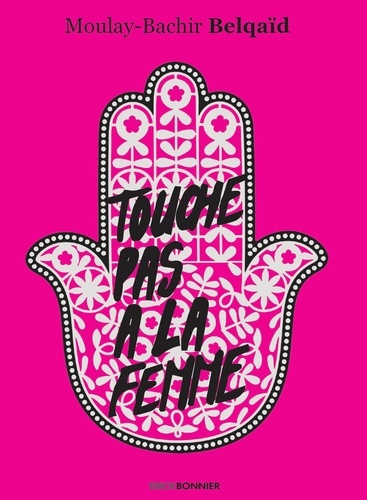
Islam
Touche pas à la femme
02/2023

Art contemporain
Marges N° 38 : Sociologie de l'art contemporain
04/2024
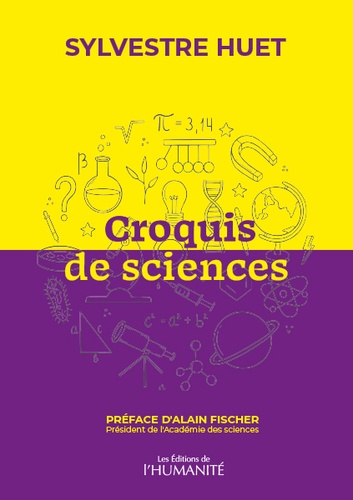
Communication - Médias
Croquis de sciences
04/2024
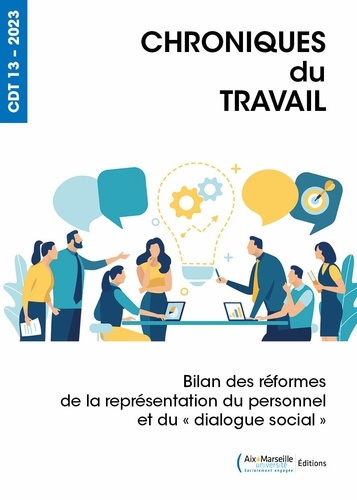
Sociologie du travail
Chroniques du Travail N° 13/2023 : Bilan des réformes de la représentation du personnel et du "dialogue social"
12/2023
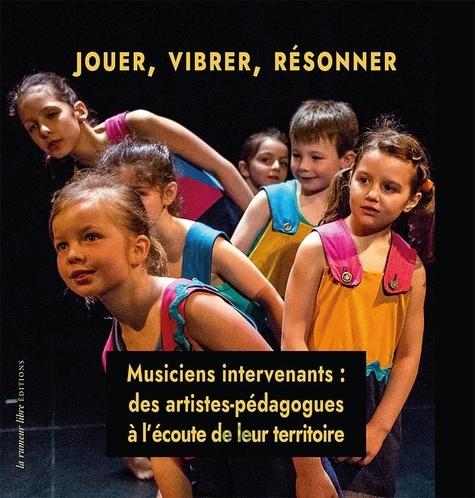
Musique
Jouer, vibrer, résonner. Musiciens intervenants : des artistes-pédagogues à l'écoute de leur territoire
06/2023
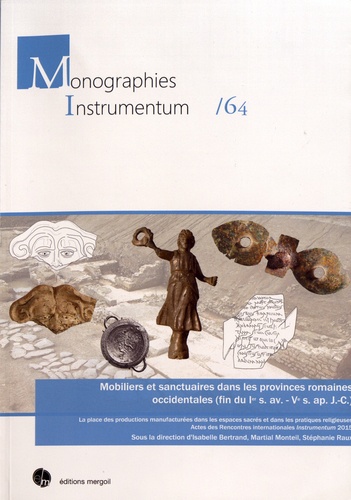
Histoire ancienne
Mobiliers et sanctuaires dans les provinces romaines occidentales (fin du Ier siècle avant - Ve siècle après J.-C.). La place des productions manufacturées dans les espaces sacrés et dans les pratiques religieuses
09/2019
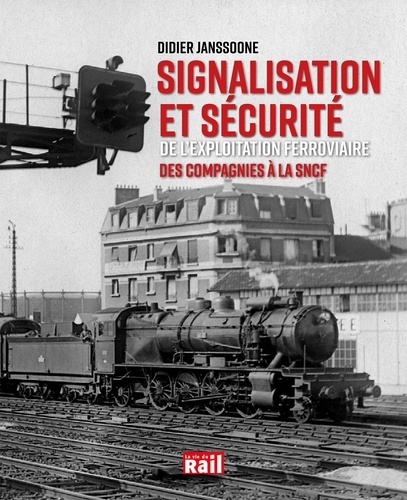
Sports
Signalisation et sécurité de l'exploitation ferroviaire. Des compagnies à la SNCF
11/2019
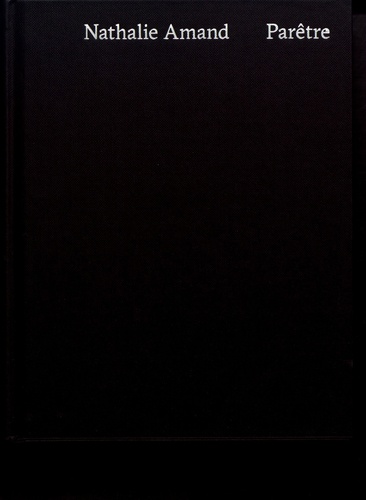
Photographie
Parêtre
10/2019
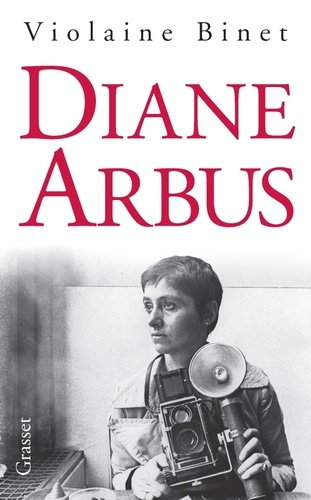
Photographie
Diane Arbus
09/2009
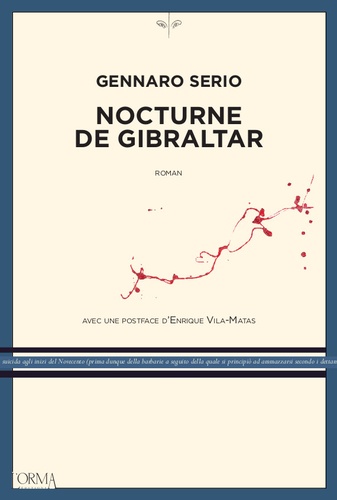
Littérature Italienne
Nocturne de Gibraltar
08/2023
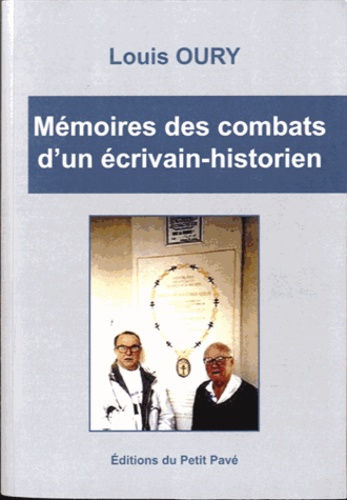
Histoire de France
Mémoires des combats d'un écrivain-historien
07/2013
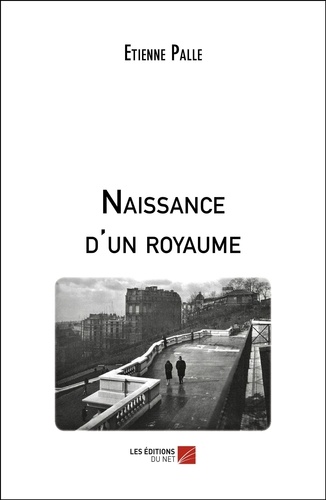
Littérature française
Naissance d'un royaume
09/2017
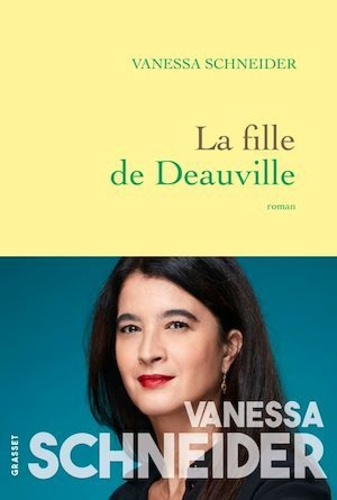
Littérature française
La fille de Deauville
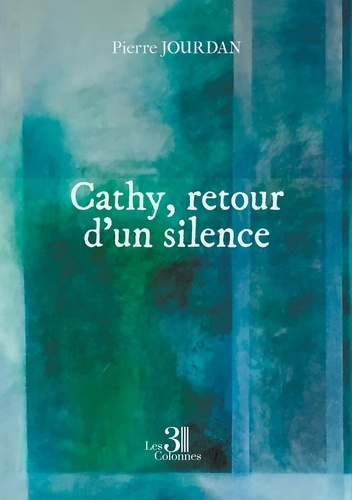
Littérature française
Cathy, retour d'un silence
05/2021
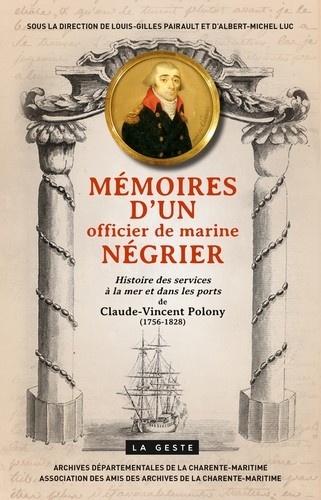
Histoire de France
Mémoires d'un officier de marine négrier. Histoire des services à la mer et dans les ports de Claude-Vincent Polony (1756-1828)
05/2019
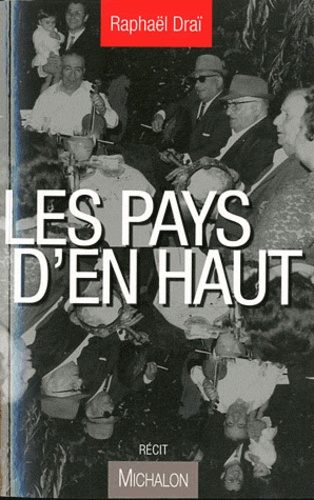
Littérature française
Les pays d'en haut
08/2011
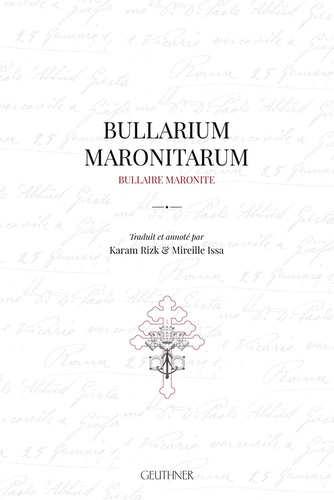
Religion
Bullarium maronitarum. Bullaire maronite
04/2019
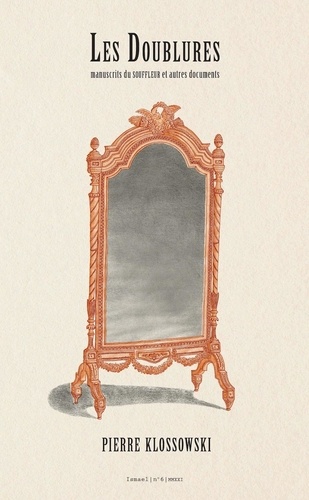
Littérature française
Les Doublures.. Manuscrits du Souffleur et autres documents
09/2021
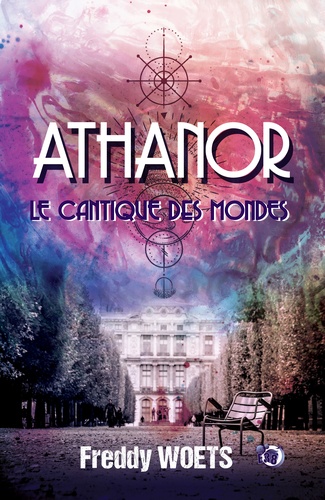
Science-fiction
Athanor. Le Cantique des Mondes
06/2019
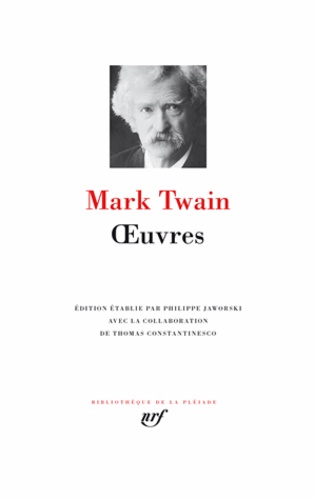
Pléiades
Oeuvres. Les aventures de Tom Sawyer ; La vie sur le Mississippi ; Aventures de Huckleberry Finn ; La tragédie de David Wilson, le parfait nigaud
04/2015
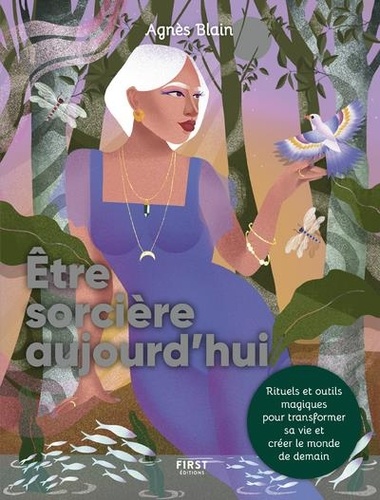
Sorcellerie
Etre sorcière aujourd'hui
10/2021
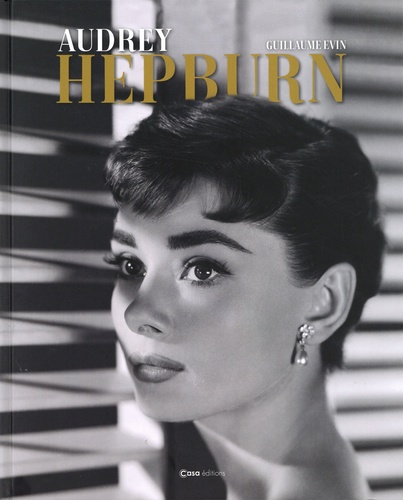
Acteurs
Audrey Hepburn
09/2023
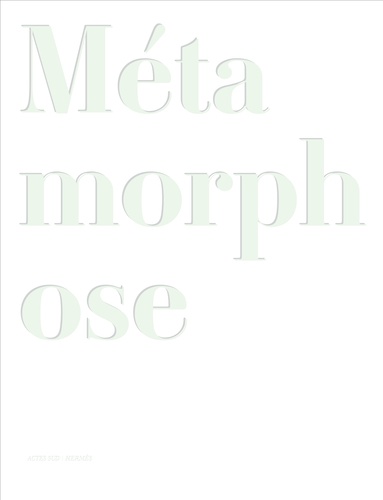
Littérature française
Métamorphose
10/2014
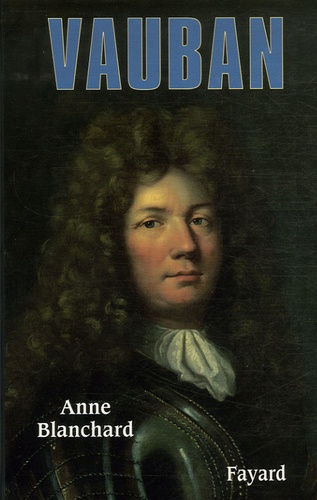
Histoire de France
Vauban. Edition revue et corrigée
05/2007
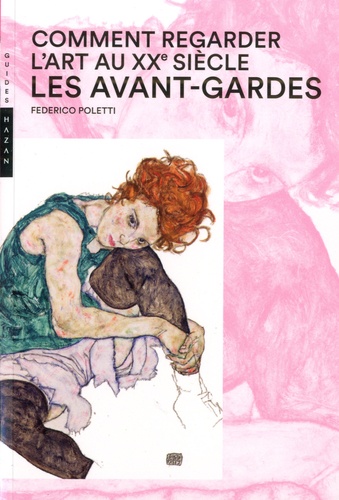
Beaux arts
Comment regarder l'art au XXe siècle. Les avant-gardes
04/2018
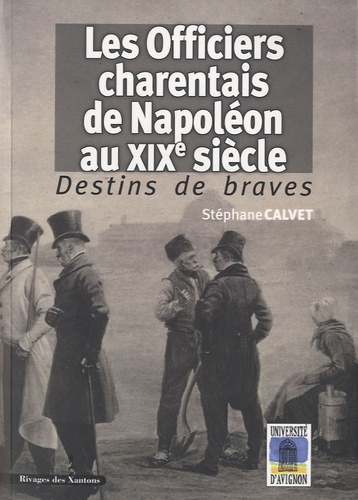
Histoire de France
Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle
04/2010
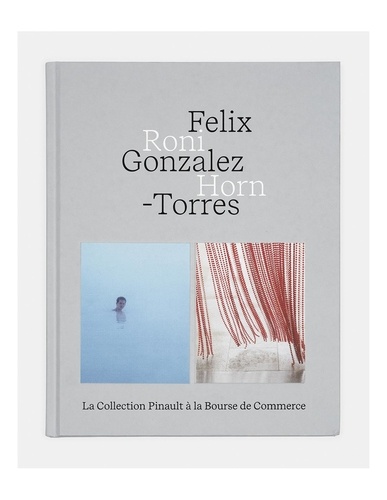
Art contemporain
Felix Gonzalez-Torres Roni Horn
05/2022
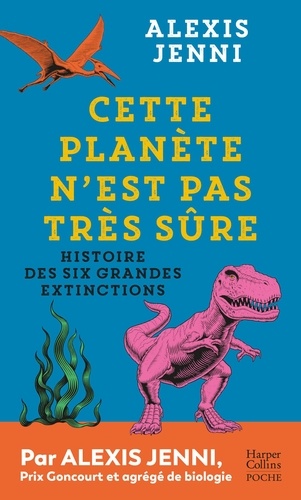
Evolution
Cette planète n'est pas très sûre. Histoire des six grandes extinctions
11/2023

