Charlie Lecach
Extraits
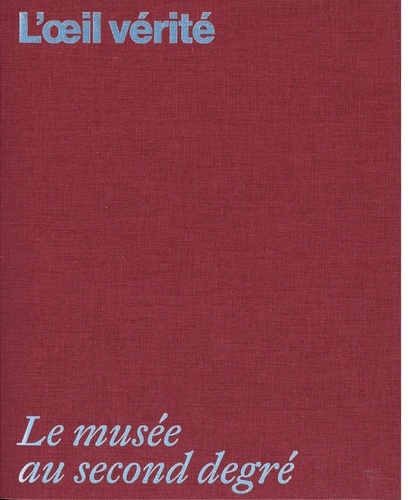
Musées français
L' oeil vérité. Le musée au second degré
L'oeil vérité Le musée au second degré Parcours de la collection du MAC VAL 256 pages 190 reproductions Format : 21 x 17 cm Broché, sous jaquette toilée Textes : Marie Castaing, Florence Cosson, Béatrice Joyeux-Prunel, Céline Latil, Anaïs Linares, Ilan Michel, Margaut Segui, Nicolas Surlapierre Graphisme : Lisa Sturacci Editions du MAC VAL ISBN : 978-2-900450-17-8 Office : 18 août 2023 15 euros Sous le signe de Gérard Genette et de son ouvrage Palimpsestes. La littérature au second degré (1982), cette nouvelle présentation de la collection du MAC VAL a souhaité répondre à une demande : l'envie de retrouver des oeuvres qui, pour la plupart, n'avaient pas été montrées depuis l'ouverture du musée en 2005. Il est rapidement apparu qu'il était possible d'écrire à partir d'elles, selon une unité de temps et de lieu, une histoire de l'art contemporain en France. Tous les artistes qui ont participé de cette histoire ne sont pas forcément conservés au musée, toutefois les principaux s'y retrouvent. Entre la première oeuvre de ce parcours et la dernière, il est également possible de voir que la distinction entre art moderne et contemporain ne s'est pas faite immédiatement, contrairement à ce que les historiennes et les historiens de l'art ont pu dire en avançant la date un peu trop commode de 1945. Cette nouvelle présentation est aussi le récit d'une distinction et d'une construction critique et historienne. Il s'avère qu'en suivant les mouvements, cet accrochage relate les différents débats qui ont servi pour établir des signes distinctifs entre moderne et contemporain. Ce nouvel opus offre une réflexion sur le passage entre un art moderne, traditionnellement défini en rupture, et un art contemporain qui ne se satisfait pas simplement de ce prérequis. Ce n'est donc plus simplement des notions historiques ou chronologiques, mais une nouvelle relation aux problématiques. Dans le sillage de l'exposition mythique Responsive Eye (1965) ou plus proche de celle L'oeil moteur (2005), plutôt que de structurer l'accrochage de la collection en donnant le nom des mouvements, l'oeil a été choisi comme dénominateur commun : l'oeil retors, l'oeil abusé, l'oeil imprévisible, l'oeil attendri, l'oeil pilote... Chaque partie de l'exposition sera ponctuée de contrepoints qui, parallèlement au profil historique, affirmeront que ce ne sont pas les oeuvres qui sont post-modernes mais l'accrochage qui assume son caractère presque citationnel. Il essaye de reconstituer ce que pourrait être désormais un musée d'art contemporain modèle, une sorte de "musée témoin" , vestige d'une histoire de l'art clé en main. Commissariat général : Nicolas Surlapierre. Exposition au MAC VAL à partir du 8 juin 2023. Avec les oeuvres de Gilles Aillaud, Arman, Geneviève Asse, Martin Barré, Robert Breer, Anne Brégeaut, Joël Brisse, Camille Bryen, Marie-Claude Bugeaud, Pierre Buraglio, Daniel Buren, Pol Bury, César, Jacques Charlier, Roman Cieslewicz, Delphine Coindet, Emile Compard, Olivier Debré, Jean Degottex, Despatin et Gobeli, Daniel Dezeuze, Erik Dietman, Robert Doisneau, Jean Dubuffet, François Dufrêne, Erro, Sylvie Fanchon, Jacques Faujour, Philippe Gronon, Raymond Hains, Jean Hélion, Christian Jaccard, Alain Jacquet, Asger Jorn, Raymond Hains, Hans Hartung, Ladislas Kijno, Jacqueline Lamba, Alberto Magnelli, Robert Malaval, Alfred Manessier, Bernard Moninot, Jacques Monory, Bernard Pagès, Gina Pane, Pavlos, Bruno Peinado, Daniel Pommereulle, André Raffray, Bernard Rancillac, Martial Raysse, Judit Reigl, Germaine Richier, Willy Ronis, François Rouan, Sarkis, Peter Saul, Jean-Claude Silbermann, Jesus Rafael Soto, Daniel Spoerri, Peter Stämpfli, Takis, Marino di Teana, Hervé Télémaque, Luis Tomasello, Geer van Velde, Claude Viallat, Jacques Villeglé, Sabine Weiss...
07/2023
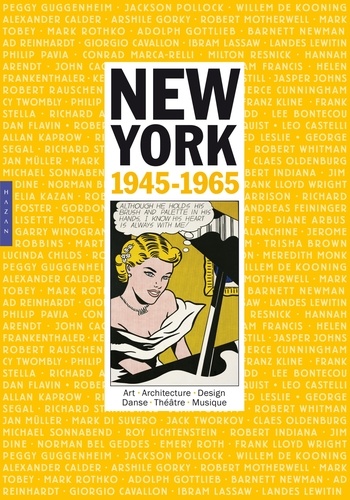
Beaux arts
New-York : 1945-1965. Art, architecture, design, danse, théâtre, musique
Histoire complète et très illustrée de l'émergence de New York comme capitale culturelle du monde après la Seconde Guerre mondiale, racontée avec brio par trois spécialistes réputés dans leurs domaines respectifs : Annie Cohen-Solal (arts plastiques), Paul Goldberger (architecture et design) et Robert Gottlieb (arts du spectacle). Comment New York a émergé après la guerre en tant que capitale du monde dans tous les secteurs de la création arts, architecture, design, musique, théâtre et danse. Les années entre 1945 et 1965 sont une période d'échanges fructueux et intenses entre poètes et critiques, artistes et marchands d'art, musiciens, danseurs et chorégraphes, architectes et designers. Annie Cohen-Solal, a signé de nombreux best-sellers, dont une biographie de Jean-Paul Sartre et une du marchand d'art Leo Castelli qui fait revivre la fermentation artistique de cette époque : les légendaires galeries, les critiques et les collectionneurs influents, et les artistes eux-mêmes, depuis les expressionnistes abstraits Pollock, Rothko et de Kooning jusqu'à Johns, Rauschenberg et Warhol. Paul Goldberger, ancien critique d'architecture pour le New York Times et le New Yorker, nous guide à travers les chefs-d'œuvre modernistes qui renouvellent le paysage new-yorkais : la Lever House de Gordon Bunshaft, le Seagram Building de Mies van der Rohe, le siège des Nations Unies de Le Corbusier et Wallace Harrison, le restaurant Four Seasons de Philip Johnson et son pavillon de l'Etat de New York à l'Exposition universelle de 1964, le Guggenheim Museum de Frank Lloyd Wright, le Terminal TWA d'Eero Saarinen à l'aéroport d'Idlewild, et, naturellement, le Lincoln Center la réponse de New York aux grandes plazzas du monde. Il nous conduit aussi dans les magasins, bureaux et appartements raffinés de l'époque, évoque le mobilier dessiné par les icônes du modernisme, de Charles et Ray Eames à Florence Knoll et George Nelson, et il nous présente les réalisations des grands publicitaires de l'époque, celles que l'on voit dans la série télévisée Mad Men. Il conclut le chapitre en retraçant la bataille philosophique qui s'est jouée entre les urbanistes qui souhaitaient tout raser pour reconstruire à neuf (le camp de Robert Moses) et les partisans de la préservation du patrimoine et de l'authenticité des vieux quartiers (le camp de Jane Jacobs). Robert Gottlieb, ancien rédacteur en chef du New Yorker et membre du conseil d'administration du New York City Ballet, aujourd'hui critique de danse pour New York Observer, nous invite au théâtre, à Broadway et off Broadway, pour nous faire revivre la grande époque de la comédie musicale, du Carousel au Roi et moi, de My Fair Lady à West Side Story, ainsi que les pièces intenses de Williams, Albee et Miller, et les productions très novatrices de Shakespeare in the Park de Joseph Papp. Il nous entraîne dans les clubs de jazz de Harlem et de la 52e Rue pour rencontrer Miles Davis, Charlie Parker, Billie Holiday et Dizzy Gillespie ; sur les scènes de l'univers de la danse, où George Balanchine et le New York City Ballet ont révolutionné le ballet et où Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón, Paul Taylor et Alwin Nikolais enthousiasmaient le public avec cette nouveauté américaine qu'a été la danse moderne. Il nous accompagne enfin dans les cabarets et night-clubs légendaires le Blue Angel et le Café Society Downtown, le Latin Quarter et Copacabana où des vedettes aussi diverses que Pearl Bailey, Barbra Streisand, Mike Nichols et Elaine May, Harry Belafonte, Carol Burnett et Woody Allen ont fait leurs débuts. Et quand les expositions d'art, les pièces de théâtre, les revues et les spectacles de danse ont baissé le rideau, Mr Gottlieb nous invite à finir la soirée au Stork Club ou au El Morocco. Richement illustré de centaines de tableaux, dessins, photographies, plans, affiches et autres documents de l'époque, New York Mid-Century est une évocation stimulante d'une période remarquablement féconde dans l'histoire de la ville. Le style et l'esthétique de cette époque connaissent d'ailleurs actuellement un grand renouveau.
10/2014
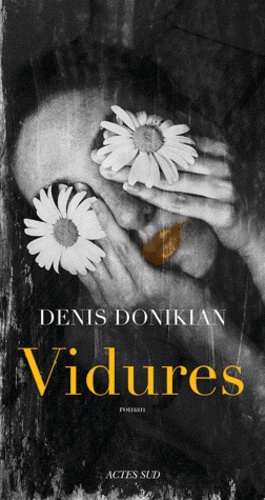
Littérature française
Vidures
C’est une journée dans la vie de Gam’, une journée qui contient toute une vie. Unité de temps, unité de lieu, unité d’action, matière première de tragédie classique que Denis Donikian sculpte en roman-monde. On est au pied du mont Ararat, sous le bleu du ciel et le rire des mouettes moqueuses, les pieds dans la boue, entre la grande décharge et le cimetière, peut-être le chemin le plus court pour raconter la vie sur terre. Et tout est vrai. Poète contrarié, journaliste-pamphlétaire clandestin, vagabond magnifique, fils en fugue, orphelin inconsolable, chiffonnier de fortune dans une Arménie en ruine qui ressemble diablement à sa décharge - cette “apocalypse en sursis”, Gam’ conduit cette danse folle, dangereuse et salvatrice, épique et dérisoire : la traversée d’un jour parmi les sans-riens qui fouillent les entrailles de la ville pour en faire leur festin. Et Gam’ nous prête ses yeux, ses oreilles et ses sens pour appréhender une réalité de fable ou de mauvaise blague historique aussi invraisemblable que réaliste, aussi anachronique qu’actuelle. On est à la marge - dans l’ombre toujours vaguement menaçante d’un régime qui pour être indépendant n’en est pas moins autoritaire, mafieux, expéditif ; où la police envoie au feu ses voyous en costards à la gâchette facile, où tous les cadavres doivent disparaître. Voici Dro, le “bouseux sensuel”, le patron de la décharge, qui a baptisé son chien et ses porcs préférés des surnoms des trois caricatures de présidents qui se sont succédés aux commandes de la petite république - et qui manie le tractopelle en scénographe de la pourriture. Voici Roubo, le gardien du cimetière, son voisin-frère-ennemi, collé toute la sainte journée à son tabouret, qui biberonne sa gnôle et surveille les entrées et sorties, aussi attaché à “ses” morts que l’autre l’est à ses porcs. Et voici les chiffonniers, hommes, femmes, enfants, dont le désespoir et les épreuves n’ont jamais entamé la fierté. L’humanité en deuil d’elle-même que nous présente Denis Donikian nous colle au cœur : elle est à part égale effrayante et attachante pour ce qu’elle ravive de souvenirs autant que pour ce qu’elle promet - parce qu’elle nous pend au nez. Le regard qu’elle pose sur son absence d’horizon (de la décharge, on voit le cimetière et vice-versa) est chargé d’une lucidité acérée, d’un humour de dépossédés et d’un sens de la fête proche de l’instinct de survie. C’est un pays, un peuple, qui a tout subi, injustice des hommes et de la nature, génocide et tremblement de terre, un pays qui s’est tout juste assez relevé, construit, pour céder aux fausses sirènes d’une comédie d’Indépendance conquise de haute lutte et aussitôt gangrénée par toutes les corruptions. Dans ce contexte sans merci, Denis Donikian échappe au folklore et aux lamentations légitimes pour mieux mener la ronde des affaiblis, explorer la hiérarchie sophistiquée de la misère et sonner l’heure du réveil. Aux confins d’un pays en charpie, dans l’urgence reçue en héritage, parce que quand “on n’a plus d’avenir à offrir, on patauge dans la fatalité”, comme un chant contestataire improvisé pendant qu’il est trop tard, Vidures est un hymne à la résistance humaine (à la survivance de l’humain), fort d’un constat paradoxal qui vaut pour tout un peuple : Vivre était encore possible après qu’on avait touché le fond. Vidures est une allégorie de l’Arménie dans un miroir tendu à toute la planète. Un hymne et un appel, un hymne et un coup de tonnerre pour rallumer les âmes, secouer les corps et rendre aux esprits le seul pouvoir qui vaille : celui des mots choisis, celui des histoires transmises, pour nourrir la mémoire qui est le meilleur moyen de transport vers l’avenir. Il y a dans ce texte une puissance rare et fondamentale - et fondamentalement singulière, qui évoque des grandes voix à la pelle (on pense à Beckett, à Shakespeare, à Céline, à Hrabal…) et/mais qui ne ressemble à rien. Il y a, au-delà du souffle narratif, un texte qui fonce vent debout contre les pseudo-fatalités de l’histoire, une révolte qui creuse et qui jaillit, une rage pleine d’amour contre ses semblables si aisément vaincus, si vite démissionnaires. Il y a, enlacés, la colère et la joie de vivre, l’ordure et la poésie, le rire et l’impossible. Le “vin fou des légendes” et la honte bus d’un même trait. Il y a les messies narcissiques et les révoltés désarmés, des hommes qui font les morts et des morts qui ne lâchent rien. Der Vorghomia ! crie au petit matin Gam’, perché sur sa colline qui domine la ville. Ce sont les premiers mots de Vidures. Ils signifient : Seigneur, prends pitié ! Pourtant, après avoir résonné tout au long du roman, ils sonnent à nos oreilles comme un toast et comme un cri de guerre. Comme une improbable promesse. Comme une prière active.
11/2011

